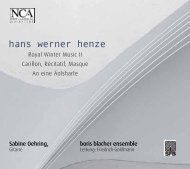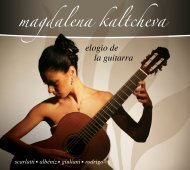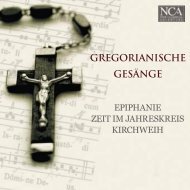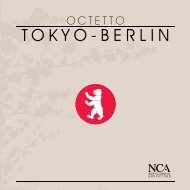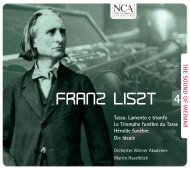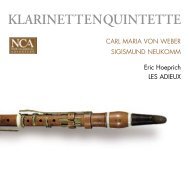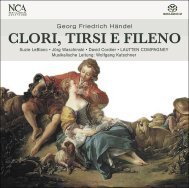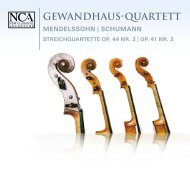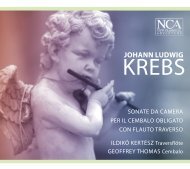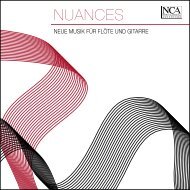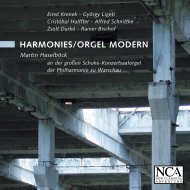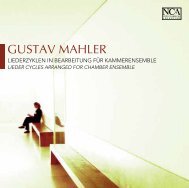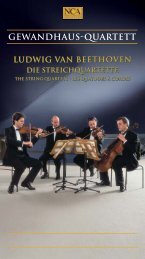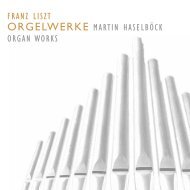georg philipp telemann (1681-1767) - nca - new classical adventure
georg philipp telemann (1681-1767) - nca - new classical adventure
georg philipp telemann (1681-1767) - nca - new classical adventure
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Le SOLO IX est EN SI MINEUR. Dans un rythme tranquille à 12/8, des croches et des<br />
doubles croches passent en coulant comme une rivière. Des tournures chromatiques et<br />
des appoggiatures dans la voix supérieure dessinent le portrait d’un caractère abattu par<br />
la douleur. De grands sauts d’intervalle semblent évoquer l’état d’une âme déchirée qui<br />
aspire à s’exprimer et qui cherche à s’évader de sa situation triste. Elle semble y parvenir,<br />
en effet, dans le deuxième mouvement Vivace, où les courtes figurations rythmiquement<br />
et mélodiquement incisives se font énergiques et résolues plutôt que virtuoses. Le<br />
troisième mouvement apporte la délivrance acquise de haute lutte : dénommée « Pomposo »,<br />
la pièce défile devant l’auditeur, fière et pleine d’espoir, dans un ré majeur rayonnant.<br />
L’Allegro assai final est inspiré indubitablement de la musique populaire polonaise. Déjà<br />
les mesures initiales au-dessus d’une basse du type bourdon laissent penser à<br />
l’idiomatique de la cornemuse.<br />
Les deux premiers mouvements du SOLO X EN MI MAJEUR reprennent l’ambiance<br />
bucolique de la deuxième sonate en mi mineur. Le premier mouvement, Soave, à 6/8, fait<br />
recours au modèle formel du Siciliano, esquissant, à partir de la forme, l’image idyllique<br />
d’un « locus amoenus » : des notes répétées réalisées à coups de pinceau légers et<br />
d’autres figurations « délicates » évoquent des vents murmurants, des feuilles tremblantes<br />
ou des sources clapotantes qui font partie des accessoires indispensables au « locus<br />
amoenus ». Avec les effets d’écho dynamiquement différenciés, Telemann fait appel au<br />
topos ancien de « l’écho de la nature ». L’homme se rend compte de sa solitude idyllique<br />
dans la nature au moment où il s’aperçoit qu’il n’y a personne qui puisse répondre à son<br />
chant, à sa musique sauf, peut-être, une montagne – sauf la nature elle-même. Dans le<br />
deuxième mouvement, l’intimité du premier est troublée, pourtant il s’intègre parfaitement<br />
à l’image pastorale. Avec ses motifs courts et marquants rythmiquement plutôt que<br />
mélodiquement, le mouvement rappelle une danse paysanne vigoureuse et rustique. Dans<br />
le troisième mouvement, caractérisé par sa mélodie enchanteresse en ut dièse mineur et<br />
ses ornements galants, presque fragiles, Telemann transporte l’auditeur dans le monde<br />
de la cour – pour déchaîner un vrai tourbillon de virtuosité essoufflée dans le<br />
Spirituoso final, avec ses triolets perpétuels dans la voix supérieure et dans la basse.<br />
Dans le SOLO XI EN LA MINEUR, l’indication « Dolente » mise au-dessus du premier<br />
mouvement devient en fait le programme de la composition entière. Face aux moyens<br />
musicaux employés par le compositeur, on se sent à peu près amené à croire que<br />
Telemann a voulu donner l’exemple modèle d’une composition funèbre : le mètre<br />
volontairement lent à 3/2, la mélodique serrée à petits intervalles, les appoggiatures<br />
plaintives, les sauts d’intervalle diminués et les progressions chromatiques dans les deux<br />
voix nous présentent de manière impressionnante la totalité du vocabulaire de la<br />
musique funèbre baroque. Dans le deuxième mouvement, le deuil se transforme en rage.<br />
Les appoggiatures courtes et les staccati, les grands sauts d’intervalle et les triolets<br />
fugitifs se font furieux, rebelles, parfois presque insolents. Ce n’est que le troisième<br />
mouvement qui apporte à l’âme la tranquillité désirée : Un Cantabile mélodique, dans un<br />
ut majeur enjoué au-dessus d’une basse volontairement simple, où les sauts d’intervalle<br />
optimistes ascendant à la grande sixte et les accords brisés porteurs d’espoir dessinent<br />
l’image d’une sérénité rassurée. L’Allegro final débute dans un rythme dansant enjoué en<br />
3/8 pour éclater dans une joie débordante qui se traduit par la juxtaposition désinvolte<br />
des figurations les plus diverses, dont des passages « fourmillants » en triples croches<br />
extrêmement rapides qui semblent se culbuter par exubérance.<br />
Le début de la dernière sonate du recueil, du SOLO XII EN FA DIÈSE MINEUR, est<br />
empreint de pathos. Le premier mouvement présente à l’auditeur un caractère qui<br />
cherche constamment à exprimer ses peines avec de grands gestes pour retomber sur<br />
soi-même bientôt après, ne parvenant pas à s’en débarrasser. D’un caractère tendre,<br />
comme le suggère déjà l’indication « Teneramente », le mouvement dans son entier reste<br />
pourtant curieusement réservé et discret. Les deux mouvements suivants, auxquels leur<br />
facture contrapuntique confère un air surprenant de conservatisme, ne peuvent pas<br />
apporter dans le contexte dramatique de la sonate, une solution convai<strong>nca</strong>nte à la<br />
situation de départ. Les efforts du deuxième mouvement, Spirituoso, se figent plutôt<br />
dans une certaine raideur, tandis que le troisième mouvement, Gratioso, développant un<br />
dialogue entre la mélodie et la basse, garde, derrière le masque du gracieux, son esprit<br />
quasiment neutre et émotionnellement retenu. Ce n’est que dans l’Allegro conclusif que<br />
38 39