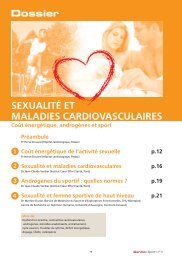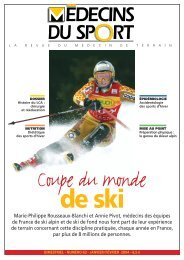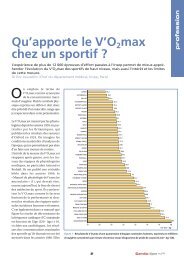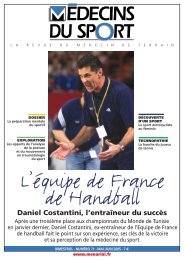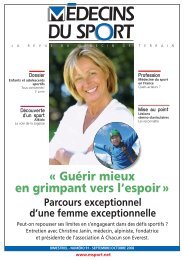You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
EDECINS<br />
DU SP RT<br />
L A R E V U E D U M É D E C I N D E T E R R A I N<br />
PROFESSION<br />
ANAES :<br />
recommandations et<br />
conférences de consensus<br />
DOSSIER<br />
Cardiologie et <strong>sport</strong><br />
1 re partie :<br />
les urgences<br />
cardiologiques sur le<br />
terrain <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
La course<br />
landaise<br />
DÉCOUVERTE<br />
D’UN SPORT<br />
Le jet-ski<br />
MISE AU POINT<br />
Conflit antérieur<br />
de hanche<br />
Jeux mondiaux<br />
Championnat de France<br />
Après avoir fait vibrer les arènes <strong>du</strong> Sud-Ouest tout l’été,<br />
la course landaise boucle la saison avec son championnat<br />
à Nogaro (Gers) début octobre. Le Dr Philippe Ducamp,<br />
traumatologue <strong>du</strong> <strong>sport</strong> et médecin fédéral, nous présente<br />
ce <strong>sport</strong> tauromachique de haut niveau souvent méconnu.<br />
BIMESTRIEL - NUMÉRO <strong>53</strong> - AOÛT /SEPTEMBRE 2002 - 5,5 E
ÉDITO<br />
LA CORRIDA: SPORT<br />
OU PHILOSOPHIE?<br />
La tauromachie ne laisse jamais indifférent,<br />
certains se disent même pour le taureau<br />
contre le matador, comme je suppose qu’ils<br />
sont pour les pucerons contre le jardinier!<br />
Le taureau vit de façon paradisiaque pendant<br />
4 ans puis, pendant ce court combat, il doit<br />
montrer sa force mais aussi ce que nous,<br />
“aficionados”, appelons ses qualités morales.<br />
Au terme <strong>du</strong> combat, il peut même être gracié<br />
et, si tel est le cas, il finira ses jours en<br />
Andalousie comme étalon! Beaucoup de<br />
bœufs lui envieraient un tel sort.<br />
Pour l’homme, toréer c’est s’efforcer de mettre<br />
en lumière les qualités et les défauts<br />
de son taureau, afin que chaque spectateur<br />
puisse en apprécier le comportement.<br />
Le torero est, comme l’a si bien écrit<br />
Jean Cocteau, « un acteur auquel il arrive<br />
des choses réelles » mais c’est aussi un <strong>sport</strong>if<br />
de haut niveau car il doit vaincre son angoisse,<br />
porter un costume lourd et manipuler cape<br />
et muleta souvent d’un poids imposant.<br />
Il doit enfin, lors de l’estocade, plonger sur<br />
les cornes <strong>du</strong> taureau, basculer sur la tête<br />
<strong>du</strong> fauve, et tout cela avec une précision<br />
mathématique. L’estocade devient le moment<br />
le plus dangereux <strong>du</strong> combat, moment où de<br />
nombreux taureaux demandèrent vie pour vie.<br />
Le combat entre l’homme et le taureau<br />
symbolise à merveille cet équilibre sans cesse<br />
recherché mais rarement atteint entre<br />
la verticalité (si bien représenté par la position<br />
<strong>du</strong> torero) et l’horizontalité (si bien mise<br />
en exergue par la charge <strong>du</strong> taureau).<br />
On peut ne pas apprécier la corrida.<br />
Simplement, mais sincèrement, je tiens à dire<br />
ici que les toreros, par le prix <strong>du</strong> sang versé et<br />
les taureaux, par leur constance à être et non<br />
pas à paraître, m’ont apporté quelque chose<br />
qui peut sembler désuet mais indispensable<br />
à la vie: la dignité!<br />
Dr Christian Derbuel<br />
Gynécologue, obstétricien,<br />
médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> et “torero”,<br />
Fréjus.<br />
E<br />
DU<br />
P. 4-5 PROFESSION<br />
ANAES: recommandations et<br />
conférences de consensus<br />
P. 6-7 PROFESSION<br />
Echos <strong>du</strong> Congrès de l’ACSM 2002<br />
P. 9-12 ÉVÉNEMENT<br />
COURSE LANDAISE<br />
CHAMPIONNAT DE FRANCE<br />
Le Dr Philippe Ducamp, traumatologue <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
et médecin fédéral, nous présente ce <strong>sport</strong><br />
tauromachique de haut niveau trop souvent<br />
méconnu.<br />
P.13-21<br />
P. 23-25 DÉCOUVERTE D’UN SPORT<br />
Le jet-ski<br />
P. 27-31 MISE AU POINT<br />
Le conflit antérieur de hanche<br />
P. 33 CONGRÈS / FORMATION<br />
E<br />
DU<br />
P. 34 ABONNEMENT<br />
Cardiologie et <strong>sport</strong><br />
1 re<br />
partie<br />
Les urgences cardiologiques<br />
sur le terrain de <strong>sport</strong><br />
Connaître les risques et savoir agir,<br />
sur le plan curatif et sur le plan préventif.<br />
Directeur de la publication: Dr Antoine Lolivier - Rédacteur en chef: Dr Didier Rousseau - Rédacteur en chef adjoint: Odile Mathieu - Secrétaire de rédaction:<br />
Isabelle Ampart - Maquette: Christine Lecomte - Pro<strong>du</strong>ction: Gracia Bejjani - Comité de rédaction: DrJean-Christophe Bertrand - Dr Gilles Bruyère - Pr François Carré<br />
- Pr Pascal Christel - Dr Jean-Marie Coudreuse - Laurence Ducrot - Dr Hervé de Labareyre - Dr Olivier Fichez - Dr Jacques Gueneron - Dr Eric Joussellin - Dr Pascal Lefèvre<br />
- Dr Philippe Le Van - Dr Dominique Lucas - Dr Patrick Middleton - Dr Paule Nathan - Dr Marie-France Oprendek-Roudey - Dr Jacques Parier - Dr Gérard Porte<br />
- Dr Jacques Pruvost - Dr Philippe Thelen - Dr Hervé Zakarian. - Service d’abonnement: Cathia Aznelos - Photos de couverture: Dr Ducamp.<br />
Cette publication est éditée par Expressions Santé, 2, rue de la Roquette – Passage <strong>du</strong> Cheval Blanc, cour de Mai - 75011 Paris. Tél.: 0149292929. Fax: 0149292919.<br />
E-mail: mds@expressions-sante.fr - N° ISSN : 1279-1334. Imprimeur: Imprimerie de Compiègne, 60205 Compiègne.<br />
Tous les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.<br />
D.R. <<br />
DOSSIER ><br />
Retrouvez <strong>Médecins</strong> <strong>du</strong> Sport sur Inter<strong>net</strong><br />
www.menarini.fr<br />
Articles, mises au point, banque d’images,<br />
formations, événements…<br />
ERRATUM<br />
La photo de couverture de <strong>Médecins</strong> <strong>du</strong> Sport n°52 doit être attribuée<br />
au photographe Philippe Guegan et non à l’agence DPPI.<br />
MÉDECINS DU SPORT 3 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Sommaire
Profession<br />
ÉCHOS DU CONGRÈS DE L’ACSM (28 MAI/1 ER JUIN 2002 - ST LOUIS - USA)<br />
C’est bien l’Amérique…<br />
Il faut d’abord souligner l’extrême professionnalisme des organisateurs <strong>du</strong> congrès<br />
et l’efficacité et la convivialité des représentants <strong>du</strong> Laboratoire Menarini.<br />
De la descente de l’avion aux limousines, leur gigantisme nous<br />
a donné le tournis. Imaginez St Louis, belle ville de province<br />
mais aussi éten<strong>du</strong>e que Paris, une chambre d’hôtel<br />
comme un appartement, un centre de congrès comme le<br />
Stade de France et 6 000 participants à la réunion annuelle<br />
de médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.On ne peut rêver plus beau début.<br />
La découverte de la ville est abordée dès le petit matin.Gloire<br />
au décalage horaire qui nous a fait parcourir en footing les<br />
bords <strong>du</strong> Mississipi. Fleuve imposant qui symbolise parfaitement<br />
ce continent riche,puissant,si difficile à contenir quand<br />
il décide de donner sa pleine mesure.“Stars et stripes” sur<br />
toutes les vitrines,l’Amérique affiche sa fierté et sa puissance<br />
sans retenue. Notre entrée dans le congrès se fait les yeux<br />
grands ouverts,prêts à tout voir et tout enregistrer.<br />
Du rugby en première intention<br />
On ne parlera que des blessures de la Rugby League, notre<br />
rugby à treize,où la progression est étonnante :27 % de joueurs<br />
blessés en 1993-1994,47 % en 1997-1998,mais 90 % la même<br />
année dans le rugby professionnel ! Ces blessures intéressent,<br />
pour moitié,l’appareil musculo-ligamentaire et la plupart interviennent<br />
entre la 25 e et la 40 e minute.<br />
Retour sur les bancs de la fac<br />
J’ai choisi ensuite “pain and shoulder”,pour vérifier s’il existe<br />
des différences de prise en charge thérapeutique entre nos<br />
pays ;mais la présentation consistera en l’exposé de 4 cas cliniques<br />
de luxation postérieure gléno-humérale. Que <strong>du</strong> classique<br />
: présentation de l’athlète et de son niveau <strong>sport</strong>if,<br />
description de la chute, examen clinique à l’admission, bilan<br />
radio et chirurgie.Première discussion avec le modérateur qui<br />
demande à la salle de s’exprimer.La surprise vient <strong>du</strong> nombre<br />
de questions et de la notion de responsabilité très discutée…<br />
La présentation se termine par la réé<strong>du</strong>cation et les différents<br />
soins jusqu’à la reprise <strong>sport</strong>ive.Tonnerre d’applaudissements et<br />
on passe à la suivante.Sceptique,j’ai déjà décidé de vérifier l’incidence<br />
de cette luxation postérieure, effectivement peu fréquente mais pas<br />
orpheline.J’ai l’impression d’être revenu sur les bancs de la faculté…<br />
La quête<br />
Les repas sont un moment privilégié :on ironise à cœur joie sur la cuisine<br />
américaine,tout en apprenant à se connaître dans le groupe.On<br />
se rend compte que nous rencontrons tous les mêmes problèmes dans<br />
notre pratique quotidienne.Et que nous voulons finalement arriver au<br />
même but :faire de la médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong> un vrai métier.Le bénévolat<br />
que chacun pratique à sa manière,avec son cœur et ses envies,trouve<br />
ses limites dans la disponibilité et la compétence. Que l’arche de<br />
St Louis,porte mythique de la ruée vers l’Ouest,devienne le symbole<br />
de notre quête. Ce voyage a désormais un autre mérite, il permet la<br />
rencontre de gens passionnés ; les discussions deviennent ardentes,<br />
âpres et réactives.Un mini congrès somme toute,qui pourrait se continuer<br />
en France… Je réserve l’après-midi à la découverte des posters :<br />
salle imposante,une foule décontractée mais studieuse,des quantités<br />
de petites études exposées où l’on pioche des informations souvent<br />
cherchées mais jamais recherchées.Plaisir et travail emmêlés.Un vrai<br />
bonheur.Je sens que je vais revenir souvent…<br />
Lésions <strong>du</strong> LCA<br />
Plus fréquentes chez les femmes ?<br />
Présentée par le Dr TA Warren (Nashville)<br />
Cette étude se propose de mettre en évidence des facteurs favorisant les lésions intra-articulaires<br />
<strong>du</strong> genou chez la <strong>sport</strong>ive comparées aux mêmes lésions chez le <strong>sport</strong>if. L’historique de<br />
la communication rapporte des études (au niveau mondial) semblant affirmer que les lésions<br />
<strong>du</strong> LCA sont statistiquement plus nombreuses chez les femmes que chez les hommes. Les<br />
auteurs de cette étude n’ont pas été satisfaits des résultats de ces articles, notamment par le<br />
manque de rigueur des critères de choix des sujets inclus dans les études référencées.<br />
Ils ont donc cherché un protocole statistique rigoureux qui pourrait permettre de mettre<br />
en évidence une réelle différence pour poursuivre la recherche de la cause de cette différence.<br />
221 <strong>sport</strong>ifs et <strong>sport</strong>ives souffrant d’une lésion intra-articulaire <strong>du</strong> genou et devant être opérés<br />
ont été sélectionnés pour cette étude.<br />
Les critères définis étaient les suivants :<br />
• lésion avérée <strong>du</strong> LCA,<br />
• lésions associées (ménisque ou lésion chondrale),<br />
• traumatisme parfaitement identifié,<br />
• pas d’antécédents sur ce genou et l’opposé,<br />
• suivi supérieur à 18 mois avec reprise d’activité <strong>sport</strong>ive.<br />
Ils ont ensuite défini 26 items codés et identifiés comme étant le seuil minimal d’inclusion.<br />
Les résultats de l’étude, en tenant compte des mécanismes lésionnels, <strong>du</strong> <strong>sport</strong> pratiqué<br />
et de son niveau, ainsi que des critères morphologiques, n’ont pas démontré de différence significative<br />
exploitable et cohérente entre les hommes et les femmes ayant subi une lésion intraarticulaire<br />
<strong>du</strong> genou, contrairement aux études qui avaient été prises pour référence. La<br />
solidité des valeurs statistiques est sûrement le facteur important qui a permis ce non résultat<br />
et l’infirmation de la tendance qui affirmait que les femmes étaient plus souvent atteintes<br />
de lésions <strong>du</strong> LCA que les hommes.<br />
La rigueur statistique a écarté cette hypothèse, pourtant attrayante, car elle donnait un rôle<br />
de fragilisation ligamentaire aux hormones en période de menstruation.<br />
Dr Roger Rua, Médecin de la Fédération<br />
française de basket-ball (FFB), Rueil-Malmaison.<br />
Troubles <strong>du</strong> comportement alimentaire<br />
La deuxième journée sera beaucoup plus riche et importante en enseignement.Au<br />
menu :“eating disorders”. Maigre public, pourtant les<br />
USA semblent en tête sur les problèmes de poids !<br />
La communication de Daniel M.Landers (Université d’Arizona) consistait<br />
à définir le terme “troubles <strong>du</strong> comportement alimentaire”,faire le<br />
point sur les différents outils de recherche comparant les <strong>sport</strong>ifs<br />
atteints de ces affections avec la population générale, revoir dans la<br />
littérature scientifique les différentes études portant sur le sujet, et<br />
discuter de l’avenir de ces recherches. Les troubles psychologiques<br />
associés à d’importantes perturbations <strong>du</strong> comportement alimentaire<br />
sont appelés “eating disorders”. On distingue classiquement l’anorexie<br />
et la boulimie des autres perturbations (repas excessifs, grignotages<br />
incessants,“toxicomanie au sucré ou au chocolat”,absorption<br />
de diverses substances comestibles ou non,potomanie…).<br />
• Critères diagnostiques de l’anorexie<br />
Il s’agit <strong>du</strong> refus de maintenir le poids corporel à un niveau normal<br />
pour l’âge et la taille, associé à une peur intense de grossir.A la terrible<br />
souffrance physique s’ajoute une perturbation de l’image corporelle<br />
et une aménorrhée chez les femmes. Le déni de la maladie<br />
représente souvent l’obstacle majeur au traitement.<br />
MÉDECINS DU SPORT 6 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
DR
• Critères diagnostiques de la boulimie<br />
Ce sont des épisodes récurrents de pulsions incontrôlables vis-à-vis<br />
de la nourriture, suivis d’une peur de grossir à l’origine de diverses<br />
pratiques néfastes :vomissements,utilisation de diurétiques,jeûnes et<br />
restrictions alimentaires.Les cycles boulimiques se répètent au minimum<br />
2 semaines par trimestre et se vivent souvent dans la honte et<br />
la clandestinité.<br />
• Incidence des troubles alimentaires<br />
En Grande-Bretagne,une étude portant sur 2 000 patients retrouve de<br />
1 à 2 cas d’anorexie, et 18 cas de boulimie, et recense entre 100 et<br />
200 adolescentes utilisant des méthodes pour perdre <strong>du</strong> poids (vomissements,<strong>sport</strong><br />
intensif,laxatif ou diurétiques…).<br />
Aux USA, 1 à 2 % des Américains souffriraient d’anorexie et 5 à 20 %<br />
d’entre eux en meurent.Le début de la maladie commence au milieu<br />
de l’adolescence et 90-95 % sont des filles.<br />
La boulimie atteint 1 à 3 % des Américaines au lycée et dans les grandes<br />
écoles,et de 1 à 4 % des filles au collège (80 % des boulimiques sont des<br />
femmes).<br />
Les autres troubles <strong>du</strong> comportement alimentaire ont une prévalence<br />
incertaine, mais le sexe ratio est de 60/40 pour les femmes par rapport<br />
aux hommes,et on retrouve souvent des antécédents dépressifs.<br />
• Problèmes particuliers de l’anorexie mentale chez l’homme<br />
La pathologie semble identique quel que soit le sexe, mais les problèmes<br />
sexuels sont largement augmentés chez les hommes, qui ne<br />
représentent pourtant que 5 à 10 % de ces troubles alimentaires.Leur<br />
expérience sexuelle est faible,l’identification à la mère est supérieure<br />
à celle <strong>du</strong> père et les homosexuels sont sur-représentés dans cette<br />
population.<br />
• Plus de troubles chez les <strong>sport</strong>ifs ?<br />
Notre société in<strong>du</strong>it des normes physiques de minceur qui entraînent<br />
un idéal de perte de poids par la diète et l’activité physique.<br />
L’environnement <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if suggère la restriction de poids (gymnaste,coureur,bodybuilder,jockey,danseur,nageur…)<br />
et la pression<br />
sociale est augmentée par celle des entraîneurs, juges,<br />
managers… L’effort physique intense entraîne souvent une diminution<br />
de l’appétence. La préparation physique de l’athlète<br />
demande souvent le développement de qualités qui sont déjà des<br />
facteurs de risque comme le perfectionnisme, la compulsion, la<br />
motivation…<br />
• Le <strong>sport</strong> est-il un facteur de risque ?<br />
Des études démontrent un risque plus élevé chez les athlètes par<br />
rapport à la population générale.Les <strong>sport</strong>s à catégories de poids<br />
et ceux se rapprochant des idéaux esthétiques <strong>du</strong> moment ne<br />
semblent pas plus dangereux que les autres.<br />
Une méta-analyse de Hansenblau et Carron (1999), portant sur<br />
92 études et 10 878 <strong>sport</strong>ifs,examinant le “tout minceur”,l’anorexie<br />
et la boulimie,retrouve des chiffres plus élevés chez les <strong>sport</strong>ifs,<br />
mais avec un écart-type minime de 0,11.<br />
Chez les femmes, les chiffres sont significativement plus élevés<br />
chez les athlètes par rapport aux groupes comparatifs. L’auteur<br />
différencie même les <strong>sport</strong>s dits esthétiques aux <strong>sport</strong>s d’en<strong>du</strong>rance<br />
et de balle, et montre une gradation plus importante dans<br />
ces <strong>sport</strong>s esthétiques sur les items minceur,anorexie et boulimie.<br />
Chez les hommes, les chiffres sont plus élevés chez les <strong>sport</strong>ifs,<br />
mais ne retrouvent pas de différence significative entre les différentes<br />
pratiques.<br />
• Des protocoles à valider<br />
Malheureusement,ces études ne reposent que sur des entretiens<br />
et des auto-questionnaires remplis par les athlètes eux-mêmes.Le<br />
biais intro<strong>du</strong>it est difficilement quantifiable mais semble réel.Pour<br />
valider les futurs protocoles,il sera essentiel d’utiliser des entretiens<br />
basés sur les critères <strong>du</strong> DSM-IV, con<strong>du</strong>its par des psychologues<br />
ou psychiatres <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
Les études longitudinales devront,dans l’avenir :<br />
- porter sur la carrière d’un athlète avec questionnaires et<br />
entretiens s’intéressant à toutes les variations de poids et d’alimentation ;<br />
- prendre en compte le type de <strong>sport</strong> pratiqué,pour déterminer si la participation<br />
à un <strong>sport</strong> engendre des perturbations,expliquant ainsi certaines<br />
pathologies fréquemment rencontrées dans certains <strong>sport</strong>s ;<br />
- comparer les athlètes pendant et après la saison,pour déterminer le<br />
lien de causalité : le <strong>sport</strong> génère-t-il certains troubles <strong>du</strong> comportement<br />
alimentaire ? Une pathologie pré-éxistante favorise-t-elle la performance<br />
<strong>sport</strong>ive ?<br />
J’ai fini ce congrès bien fatigué mais, alors que l’on pensait déjà au<br />
retour,nous avons eu droit à l’incendie dans l’hôtel.Evacuation disciplinée,<br />
énormes camions (6) avec échelles et soldats <strong>du</strong> feu, sirènes,<br />
le fire-chief lui-même et trente minutes d’un grand show à l’Américaine.<br />
Le reste se devine :transfert,aéroport,dernier Mac Do,l’avion qui <strong>du</strong>re<br />
longtemps et des adieux qui n’en finissent plus.<br />
J’ai repris le travail avec plein de souvenirs et, désormais, une<br />
certitude. Si on me demande comment c’était, je répondrai<br />
forcément, avec toute la rocaille de mon<br />
accent :c’est bien l’Amérique ! ■<br />
Dr Pierre Sébastien<br />
Médecin de la Fédération<br />
française de roller-skating (FFRS),<br />
Toulouse.<br />
Cas cliniques<br />
Cet atelier offrait la présentation de cas cliniques documentés par des médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong> de<br />
terrain et argumentés par des universitaires comme un jury d’oral d’examen. Chaque cas<br />
comprend un historique des circonstances accidentelles, les résultats de l’examen clinique<br />
et des explorations, le diagnostic proposé, et le suivi thérapeutique. Après la présentation,<br />
le jury pose des questions complémentaires et demande ensuite à l’assistance de compléter<br />
éventuellement les questions.<br />
Un mécanisme lésionnel peu fréquent<br />
Présenté par le Dr JL Moeller (Michigan)<br />
Un jeune joueur de football de 18 ans entré en contact violent avec un autre joueur lors d’un<br />
match ; le choc se fait épaule contre épaule. Douleurs immédiates et sortie <strong>du</strong> terrain. L’examen<br />
sur le terrain montre une épaule douloureuse sans instabilité ni déformation. Les radiographies<br />
montrent une fracture de la glène. Le traitement consiste en une immobilisation<br />
de 3 semaines avec refroidissement dans les 48 h initiales et AINS. Puis, début de physiothérapie<br />
et de réé<strong>du</strong>cation à la fin de l’immobilisation. Le retour sur le terrain est autorisé à<br />
6 semaines. L’originalité tient au mécanisme lésionnel peu fréquent.<br />
Un placage traumatique<br />
Présenté par le Dr KJ Cassas (Dallas)<br />
Un jeune joueur de foot de 16 ans présente un traumatisme de l’épaule par écrasement, un autre<br />
joueur lui est tombé dessus lors d’un placage.<br />
Douleur immédiate et sortie <strong>du</strong> terrain. L’examen est quasi impossible, le <strong>sport</strong>if est donc<br />
immobilisé. Des radiographies montrent une fracture <strong>du</strong> cartilage de conjugaison de l’extrémité<br />
supérieure de l’humérus, de type salter 1 sans déplacement qui a été, semble-t-il, difficile<br />
à mettre en évidence. Le traitement consiste en 3 semaines d’immobilisation, suivies de réé<strong>du</strong>cation<br />
lente et la reprise <strong>du</strong> <strong>sport</strong> ne se fait que le 4 e mois, <strong>du</strong> fait de douleurs persistantes. L’originalité<br />
tient à la rareté de cette fracture chez le jeune adolescent, même <strong>sport</strong>if.<br />
Ateliers pratiques<br />
Il était possible d’assister à de nombreux et intéressants ateliers pratiques tels que l’examen<br />
programmé <strong>du</strong> genou, l’examen <strong>du</strong> rachis traumatisé ou l’examen de l’épaule. Un préambule<br />
théorique précédait une mise en situation avec examen de volontaires sous la surveillance<br />
des experts et avec une grande disponibilité.<br />
MÉDECINS DU SPORT 7 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Dr Roger Rua, Médecin de la Fédération<br />
française de basket-ball (FFB), Rueil-Malmaison.
MDS<strong>53</strong> - 04a05 ANAES 29/09/03 12:56 Page 4<br />
Profession<br />
ANAES<br />
Recommandations et conférences<br />
de consensus<br />
L’ANAES est un organisme<br />
indépendant placé sous la tutelle<br />
<strong>du</strong> ministère chargé de la Santé.<br />
C’est au sein de cette agence que<br />
sont organisées les conférences<br />
de consensus et les recommandations<br />
de bonnes pratiques cliniques.<br />
L<br />
Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé<br />
’ est un établissement public administratif créé en avril 1997<br />
dans le cadre de la réforme <strong>du</strong> système de soins français.<br />
Cet organisme scientifique et technique est chargé notamment<br />
d’établir des recommandations et conférences de consensus<br />
qui apportent l’état des connaissances médicales en matière<br />
de stratégies diagnostiques et thérapeutiques, chacune dans<br />
des situations particulières que nous décrirons ci-dessous.<br />
Le service des recommandations pour la pratique clinique<br />
(RPC) et les conférences de consensus appartiennent au département<br />
“Evaluation” de l’Agence. L’objectif de ce service est<br />
d’apporter une information de qualité aux professionnels de<br />
santé aussi bien sur la pratique médicale que sur les avancées<br />
de la recherche.<br />
QU’EST-CE QU’UNE CONFÉRENCE<br />
DE CONSENSUS ?<br />
L’élaboration d’une conférence de consensus trouve sa place<br />
lorsque le thème à traiter est limité (peut par exemple se décliner<br />
en 4 à 6 questions précises) mais surtout lorsque ce thème<br />
donne lieu à une controverse ou une divergence des pratiques<br />
nécessitant un débat et une prise de position de la part de la<br />
communauté professionnelle.<br />
Il est décidé de réaliser une conférence de consensus lorsqu’il<br />
s’agit d’un problème important en terme de santé publique<br />
par sa fréquence, par l’intérêt que lui portent les professionnels<br />
de santé ou par l’impact potentiel que la conférence de<br />
consensus pourra apporter à la pratique. Le but est d’apporter<br />
une réponse claire et définitive aux questions posées afin<br />
d’améliorer la qualité générale des soins. La conférence de<br />
consensus peut être réalisée dans un délai relativement court.<br />
Le principe:un groupe d’experts (chercheurs,médecins,etc.)<br />
débat sur un sujet déterminé,à partir d’une analyse bibliographique<br />
réalisée pour un groupe bibliographique,et en tire un rapport faisant<br />
la synthèse des dernières connaissances acquises.<br />
Un jury,multidisciplinaire et multiprofessionnel,composé d’experts<br />
et de personnalités impartiales (n’ayant pas d’intérêt en jeu<br />
dans le domaine traité), est ensuite chargé d’établir les points<br />
d’accord et de divergence de la communauté scientifique,en apportant<br />
une réponse précise à chacune des questions posées.Il s’agit<br />
donc de rédiger un texte consensuel de la manière la plus indépendante<br />
et la plus objective possible,en distinguant ce qui relève<br />
de la preuve scientifique,de la présomption et de la pratique usuelle.<br />
QU’EST-CE QU’UNE RECOMMANDATION ?<br />
Une recommandation est une synthèse des connaissances et publications<br />
médicales sur un sujet déterminé destinée aux professionnels<br />
de santé.Elle s’applique,contrairement aux conférences<br />
de consensus,lorsque le thème à traiter est vaste (les controverses<br />
ne doivent pas occuper une trop grande place). Ce travail, qui<br />
repose sur un travail prolongé, permet de définir une stratégie<br />
médicale optimale en précisant ce qui est approprié, ce qui ne<br />
l’est pas ou ce qui doit faire l’objet d’études complémentaires.<br />
Les recommandations pour la pratique clinique (RPC) reflètent<br />
l’état des connaissances à un instant donné (année de publication)<br />
ainsi que l’opinion d’experts sur un thème de pratique clinique.<br />
Cette démarche a pour but l’harmonisation des prises en charge de<br />
différentes pathologies à l’échelle d’un pays ou d’une région.<br />
En pratique,les recommandations sont élaborées par un groupe<br />
de travail composé de personnes de diverses compétences<br />
(spécialistes et non-spécialistes en CHU,spécialistes ou généralistes<br />
libéraux) venus de toute la France.Au cours de plusieurs<br />
réunions étalées dans le temps,ce groupe sélectionne,<br />
synthétise et analyse de manière objective la littérature scientifique<br />
disponible sur un sujet déterminé,ainsi que l’état des pratiques<br />
professionnelles.<br />
Le texte est ensuite soumis pour validation à un groupe de lecture<br />
avant d’être finalisé.<br />
Ainsi, les RCP consistent en:<br />
● l’analyse d’une littérature abondante par le groupe de travail<br />
qui rédige les recommandations,avec prise en compte de l’avis<br />
des experts,<br />
● la rédaction de recommandations détaillées sur une stratégie<br />
médicale qui peut être vaste et complexe.<br />
CONFÉRENCE DE CONSENSUS<br />
OU RECOMMANDATION ?<br />
Elles sont toutes deux basées sur l’analyse et la synthèse<br />
de la littérature, des pratiques et des avis d’experts,<br />
mais leurs objectifs sont différents.<br />
Les conférences de consensus répondent à une<br />
controverse ou à une divergence de pratique, sur un<br />
thème bien précis.<br />
Les recommandations répondent à la nécessité d’une<br />
synthèse à partir de données multiples ou dispersées<br />
sur un sujet plus vaste.
MDS<strong>53</strong> - 04a05 ANAES 29/09/03 12:56 Page 5<br />
Les RPC sont réactualisées,selon les pathologies et en fonction<br />
des progrès scientifiques.<br />
QUELLE UTILISATION ?<br />
Ces textes sont considérés comme des standards pour la pratique<br />
médicale « déterminant ce qui est approprié et/ou non de<br />
faire, lors de la mise en œuvre de stratégies préventives, diagnostiques<br />
et/ou thérapeutiques dans des situations cliniques<br />
données (...) ».<br />
Ils pourront, par exemple, être utilisés à des fins:<br />
Pédagogiques<br />
En effet,les recommandations constituent une synthèse de l’état<br />
des connaissances et des pratiques utilisables aussi bien en formation<br />
initiale qu’en formation continue.<br />
Professionnelles<br />
Ces documents servent de point de départ à l’élaboration des référentiels<br />
utilisables dans des démarches qualité,tels que l’audit clinique<br />
ou les programmes d’amélioration continue de la qualité.<br />
Institutionnelles<br />
Les recommandations constituent l’assise scientifique et professionnelle<br />
de guides pour le système des médecins référents ou d’outils<br />
conventionnels,tels que les RMO (Références médicales opposables).<br />
QUELLE DIFFUSION ?<br />
Une fois rédigés,ces textes doivent être diffusés auprès <strong>du</strong> public<br />
concerné. Cette diffusion utilise tous les supports accessibles:<br />
documents,guides ou site Inter<strong>net</strong> de l’ANES.Des conférences<br />
de presse (annoncées à l’avance), avec diffusion de communiqués<br />
de presse, peuvent être organisées pour présenter la synthèse<br />
et la conclusion de ces travaux.<br />
Le site de l’ANAES permet d’accéder rapidement et gratuitement<br />
à ces documents,il suffit de sélectionner “publication”puis “nouveautés”pour<br />
accéder aux nouvelles parutions.<br />
Le texte publié doit mentionner les noms et qualifications des<br />
membres <strong>du</strong> Comité d’organisation,<strong>du</strong> groupe d’experts,<strong>du</strong> groupe<br />
bibliographique et des membres <strong>du</strong> jury,ainsi que les sources de<br />
financement et la participation de sociétés savantes,associations…<br />
QUELQUES THÈMES D’INTÉRÊT<br />
● Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)<br />
● Diagnostic et traitement de l’hypertension artérielle essentielle de l’a<strong>du</strong>lte de<br />
20 à 80 ans<br />
● Examens complémentaires dans le genou traumatique récent de l’a<strong>du</strong>lte<br />
● Explorations et chirurgie <strong>du</strong> genou<br />
● L’arthroscopie <strong>du</strong> genou<br />
● L’entorse de cheville au service d’accueil et d’urgence<br />
● Massokinésithérapie dans les suites précoces de ligamentoplastie pour lésion <strong>du</strong><br />
pivot central <strong>du</strong> genou<br />
● Pathologies non opérées de la coiffe des rotateurs et masso-kinésithérapie<br />
● Réé<strong>du</strong>cation de l’entorse externe de la cheville<br />
Les textes publiés sont disponibles sur le site de l’Anaes (rubrique “publication” ou<br />
“nouveautés”)<br />
LE RÔLE DES MÉDECINS AU SEIN DE L’ANAES<br />
Les médecins correspondants<br />
La diffusion des recommandations passe également par le biais<br />
de médecins correspondants de l’ANAES.<br />
Ils sont actuellement 157 médecins, libéraux et hospitaliers,<br />
salariés de l’ANAES.Leur rôle est de servir de relais entre l’Agence<br />
et leurs collègues en région, et ainsi d’assurer la diffusion des<br />
recommandations.<br />
Ces médecins sont recrutés en fonction de leur motivation,mais<br />
ils doivent également remplir certains critères:en effet,un correspondant<br />
doit être installé et en activité afin de ne pas perdre<br />
pied avec le terrain,le critère le plus important étant leur engagement<br />
au niveau régional, qu’il participe activement au leadership<br />
régional ou qu’il soit engagé dans la formation<br />
médicale continue (FMC).<br />
Leur recrutement se fait dans un premier temps par le biais d’un<br />
cabi<strong>net</strong> de recrutement. Le candidat passe ensuite devant une<br />
commission interne regroupant le Directeur général, le Directeur<br />
<strong>du</strong> Service des évaluations des pratiques cliniques et le Responsable<br />
<strong>du</strong> réseau des correspondants. Dans certains cas, les<br />
correspondants,s’ils sont experts dans un domaine particulier,<br />
peuvent participer à l’élaboration des recommandations,en vérifiant<br />
la faisabilité et l’acceptabilité de ces recommandations sur<br />
le terrain, auprès de leurs confrères.<br />
Les médecins habilités<br />
Les médecins habilités (généralistes ou spécialistes libéraux)<br />
sont formés par l’ANAES.<br />
Ils sont chargés de l’évaluation des pratiques professionnelles<br />
et donc des médecins eux-mêmes; il s’agit là d’une des autres<br />
missions de l’ANAES. Les médecins visités sont volontaires, ils<br />
s’engagent dans une démarche d’amélioration des soins.<br />
Pour être habilité, un médecin doit avoir reçu une formation<br />
de trois jours au sein de l’Agence et assuré une activité médicale<br />
depuis au moins cinq ans. L’habilitation à exercer l’évaluation<br />
des pratiques est prononcée par le Directeur de<br />
l’ANAES, et ce pour une <strong>du</strong>rée de 5 ans.<br />
Un médecin habilité ne peut pas devenir un correspondant<br />
régional de l’ANAES. ■<br />
Julie Fortis<br />
Pour en savoir plus<br />
ANAES<br />
(Agence Nationale d’Accréditation<br />
et d’Evaluation en Santé)<br />
159, rue Nationale - 75013 PARIS<br />
Tél. : 01 42 16 72 72<br />
Site : http ://www.anaes.fr<br />
Vous pouvez consulter et télécharger<br />
gratuitement les textes de<br />
l’ANAES (conférences de consensus,<br />
recommandations pour la pratique<br />
clinique, recommandations et références<br />
médicales…) et la méthodologie<br />
des conférences de consensus<br />
et recommandations.
La course landaise<br />
Championnat de France<br />
Même si elle n’a qu’un rapport éloigné des sacrifices et combats de taureaux décrits<br />
sur les fresques crétoises d’Héraklion, on peut penser que la tauromachie landaise est<br />
née d’une tradition de jeux <strong>sport</strong>ifs ou religieux, profondément encrée dans les<br />
civilisations méditerranéennes.<br />
Jeu rural, tradition ancestrale, <strong>sport</strong> tauromachique de haut niveau, la course landaise<br />
cherche encore sa voie pour définir son appartenance. Depuis le mois de juillet, la<br />
temporada bat son plein essayant d’oublier la retraite bien méritée des champions de<br />
la dernière décennie et le décès prématuré de Jean-Pierre Rachou dans les arènes de<br />
Dax le 10 août 2001.<br />
Cette année encore avec la découverte de nouvelles stars, la fin de saison et son<br />
championnat de France à Nogaro (Gers) laissent présager une finale pleine de suspense<br />
et de panache. Le Docteur Philippe Ducamp, traumatologue <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, médecin à<br />
l’Institut européen des thérapies <strong>sport</strong>ives (IETS) de Dax, nous présente, après avoir été<br />
l’un des plus grands champions de la discipline et aujourd’hui son médecin fédéral<br />
national, un <strong>sport</strong> presque totalement méconnu. ■<br />
MÉDECINS DU SPORT 9 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
AFP<br />
Evénement: Championnat de France de course landaise<br />
Evénement: Championnat de France de course landaise
Evénement: Championnat de France de course landaise<br />
Evénement: Championnat de France de course landaise<br />
UN PEU D’HISTOIRE<br />
Si les pratiques taurines ont résisté, et<br />
si on les retrouve aujourd’hui,dans le Sud-<br />
Ouest et en Camargue, sous des formes<br />
plus païennes que religieuses, c’est probablement<br />
parce que les troupeaux de<br />
taureaux sauvages y ont toujours été nombreux<br />
et combattus hardiment par de<br />
jeunes hommes téméraires.<br />
Dès 1289,on fait courir dans les rues de<br />
Bayonne (en partie commune landaise)<br />
des taureaux et des vaches.<br />
En 1457,une lettre <strong>du</strong> roi Charles VII explique<br />
qu’en la ville de Saint-Sever, on a<br />
coutume de faire courir un taureau le jour<br />
de la Saint Jean-Baptiste.Ceci est encore<br />
pratiqué à Pampelune avec son Encierro,<br />
et en Camargue avec son Abrivado.<br />
De ces pratiques ancestrales, pulsions<br />
<strong>du</strong> jeu et de la provocation, est née en<br />
Gascogne une tradition de jeux taurins<br />
tout à fait originale et distincte de la tauromachie<br />
espagnole :la course landaise.<br />
Dès la fin <strong>du</strong> XVI e siècle,les jeux taurins<br />
sont largement implantés sur le territoire<br />
landais.Ils s’inscrivent dans une tradition<br />
festive où se mêlent acteurs et spectateurs.<br />
La première forme de tauromachie n’a ni<br />
espace,ni temps propre,elle se contente<br />
d’investir la rue.Les jeunes gens détournent<br />
l’attention des bêtes menées par<br />
le boucher en direction de l’abattoir.Les<br />
premiers espaces clos apparaissent en<br />
barrant certaines rues <strong>du</strong> village de manière<br />
à ce que tous ceux qui le souhaitent<br />
puissent se mesurer au taureau.<br />
La tauromachie a trouvé son premier site,<br />
il est déjà convivial.<br />
XVII e SIÈCLE,<br />
LES LANDAIS FONT<br />
DE LA RÉSISTANCE<br />
Les conciles,bulles papales et autres anathèmes<br />
n’y pourront rien,l’évêque Gilles<br />
Bouteau essaiera vainement d’interdire,<br />
sous peine d’excommunication, les<br />
courses et agitation de taureaux les dimanches<br />
et jours de fêtes.<br />
Il devra battre en retraite devant les taureaux<br />
lâchés par quelques impies qui<br />
chargent vers l’Autel après avoir défoncé<br />
les portes de l’Eglise.<br />
Son successeur Jean-Louis de Fromentière<br />
regrettera tout aussi vainement ce<br />
reste de paganisme, d’autant plus difficile<br />
à détruire que les peuples sont<br />
indociles.<br />
AFP<br />
Trois catégories de compétitions<br />
● La course landaise concours, ou concours landais où les meilleurs écarteurs<br />
et sauteurs affrontent les vaches de différentes ganaderias.<br />
● La course landaise formelle, compétition par équipe opposant plusieurs<br />
quadrilla.<br />
● La course landaise mixte où une compétition amicale précède un spectacle<br />
de jeu taurin.<br />
Avec le titre de Champion de France, le titre le plus convoité est “l’Escalot”<br />
qui récompense les toreros les plus brillants et les plus réguliers.<br />
L’Escalot correspond au classement des compétiteurs, écarteurs et<br />
sauteurs, de même que “l’ATP” en tennis.<br />
LÉGITIMITÉ ROYALE<br />
EN ESPACE CLOS<br />
Dès 1648,le Sud-Ouest se passionne pour<br />
les jeux taurins.<br />
Au XVIII e siècle,la tauromachie va s’adapter<br />
aux exigences de l’époque. On ne<br />
peut plus tolérer les accidents, souvent<br />
mortels, des spectateurs.<br />
Un secrétaire d’Etat en est particulièrement<br />
choqué:« Si ces courses se faisaient<br />
hors des villes ou dans des quartiers qui<br />
leur fussent affectés, je ne verrai nulle<br />
nécessité de les défendre parce qu’en<br />
supposant des accidents, il ne pourrait<br />
jamais tomber que sur ceux qui s’y<br />
exposeraient. Mais en les faisant indistinctement<br />
dans toutes les rues, il peut<br />
en résulter des malheurs. » Une ordonnance<br />
royale de Louis XV en date <strong>du</strong><br />
16 février 1757, autorise les courses de<br />
taureaux, à condition qu’elles aient lieu<br />
MÉDECINS DU SPORT 10 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Les qualités <strong>du</strong> gymnaste<br />
doivent s’exprimer sur un<br />
terrain non idéal.<br />
en dehors des agglomérations,en des endroits<br />
clos par des barrières et sous réserve<br />
de l’autorisation municipale.<br />
La tauromachie landaise se découvre un<br />
espace en même temps qu’elle obtient<br />
la légitimité royale,puis connaît un essor<br />
considérable.<br />
NAISSANCE D’UN SPORT<br />
SPECTACLE<br />
Au XX e siècle, la course landaise s’humanise<br />
et perd une partie de sa cruauté<br />
initiale:“L’emboulage”des cornes et l’apparition<br />
de la corde sont destinés à éviter<br />
les traumatismes sanglants tout en<br />
permettant un déroulement plus rapide<br />
<strong>du</strong> spectacle.<br />
L’écarteur landais perd son statut d’errant,<br />
ce frondeur marginal qui vivait,<br />
jusque-là, au rythme de ses libations
Dr Ducamp<br />
légendaires devient un quasi professionnel<br />
comme tous les <strong>sport</strong>ifs.<br />
La course landaise est désormais un spectacle<br />
au sens moderne <strong>du</strong> terme.<br />
La batte, qui était un acteur essentiel <strong>du</strong><br />
drame,est désormais un outil qui permet<br />
aux hommes de briller et de se mesurer<br />
les uns aux autres.<br />
L’enjeu <strong>du</strong> combat s’est déplacé,la lutte<br />
entre un homme et un animal, qui tournait<br />
souvent à l’avantage de la bête, est<br />
devenu une compétition entre participants.Un<br />
<strong>sport</strong> de haut niveau hautement<br />
traumatique.<br />
L’institutionnalisation de la course landaise<br />
en tant que <strong>sport</strong> est finalement<br />
très récente,avec la création de challenge<br />
en 1952 et de la Fédération française de<br />
la course landaise (FFCL) en 19<strong>53</strong>,<br />
nantie de ses deux comités régionaux<br />
(Armagnac et Landes-Béarn).<br />
La FFCL possède son règlement technique,<br />
son calendrier de compétitions et son corps<br />
arbitral. Le déroulement de la course et<br />
l’ordre de sortie des toreros et des vaches<br />
obéissent à des règles différentes selon<br />
la catégorie de compétition.<br />
Chaque écarteur effectue,en général,une<br />
à dix figures par vache devant six à dix<br />
vaches différentes. Le jury juge la gestuelle,l’attaque,le<br />
dessin et la finition de<br />
la figure. Il bonifie l’écart intérieur. Le<br />
comportement <strong>du</strong> bétail est également<br />
noté.<br />
La totalisation des points est annoncée à<br />
chaque sortie.Il n’y a pas de mise à mort,<br />
mais au contraire, une sélection rigoureuse<br />
<strong>du</strong> bétail.<br />
DEUX ACTEURS<br />
PRINCIPAUX<br />
Le sauteur<br />
Le sauteur est le <strong>sport</strong>if le plus apprécié<br />
des néophytes.Véritable gymnaste de<br />
haut niveau de formation,il effectue sur<br />
le sable des arènes des figures acrobatiques<br />
au-dessus de vaches et/ou taureaux<br />
de 300 à 500 kg, lancés à une vitesse de<br />
30 à 45 km/h.<br />
Il réalise des sauts à la course, des sauts<br />
de l’ange,des sauts périlleux,des sauts périlleux<br />
vrillés et des sauts à pieds joints avec,<br />
pour corser la difficulté,les jambes liées et<br />
les pieds emprisonnés dans un béret.<br />
L’écarteur<br />
Le personnage le plus important de<br />
l’arène est l’écarteur. Il effectue trois figures<br />
principales :<br />
- l’écart sur la feinte,<br />
- l’écart sur le saut extérieur protégé par<br />
la corde,<br />
- l’écart sur le saut intérieur, très difficile<br />
et plus coté,non protégé par la corde.<br />
L’écarteur,immobile au centre de l’arène,<br />
attend de pieds fermes la charge de la<br />
Le rachis en hypertension<br />
sur ce traumatisme est<br />
rarement sans séquelles.<br />
vache ou <strong>du</strong> taureau ; puis, par un jeu<br />
de jambes très avisé,évite la charge de la<br />
bête et le coup de corne,jadis meurtrier,<br />
en faisant passer cette dernière le plus<br />
près possible dans la cambrure des reins,<br />
en réalisant un pivot sur une jambe.<br />
UN SPORT<br />
TRÈS TRAUMATIQUE<br />
MÉDECINS DU SPORT 11 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Outre le courage formidable qui caractérise<br />
l’écarteur et le sauteur landais pour<br />
affronter sans protection un animal de<br />
combat, c’est la rudesse des chocs et les<br />
traumatismes, qui font de ce <strong>sport</strong> peutêtre<br />
le <strong>sport</strong> le plus traumatique au monde.<br />
La course landaise est un <strong>sport</strong> complet<br />
aux microtraumatismes variés et aux traumatismes<br />
dignes de l’accidentologie routière.<br />
Le niveau des compétitions et des compétiteurs<br />
ne définit pas une catégorie particulière<br />
de traumatismes ; toutes les<br />
parties <strong>du</strong> corps sont atteintes avec prépondérance<br />
pour le thorax,les membres<br />
supérieurs et les membres inférieurs.<br />
Chez l’écarteur, les traumatismes les<br />
plus fréquents sont :<br />
● des traumatismes par chocs directs à<br />
grandes vitesses (fractures des membres,<br />
luxations articulaires,fractures de côtes,<br />
épineuses, vertébrales, hémo-pneumothorax)<br />
;<br />
Les grands rendez-vous<br />
de la course landaise<br />
● Avril<br />
Le festival Art et Courage Landais se déroule<br />
chaque année le dernier week-end d’avril<br />
● Juin<br />
Concours landais à Aire/Adour<br />
● Juillet<br />
Le 14 juillet célèbre la Corne d’or à Nogaro<br />
● Août<br />
Concours Landais de la Féria de la Madeleine<br />
(Arène <strong>du</strong> Plumaçon à Mont de Marsan)<br />
● Octobre<br />
Les concours Landais de la féria de Dax ont lieu<br />
le 1er week-end d’octobre. C’est l’occasion pour<br />
les toreros de concourir pour les Championnats<br />
de France (à Nogaro le 6 octobre 2002)<br />
Evénement: Championnat de France de course landaise
Evénement: Championnat de France de course landaise<br />
Evénement: Championnat de France de course landaise<br />
Petit lexique taurin<br />
Arènes<br />
Longueur et largeur : 40 m/30 m, enceinte fermée, terrain de jeu.<br />
Cazérienne<br />
Hymne de la course landaise joué à chaque passée.<br />
Corde et têtière<br />
Matériel permettant le placement rapide <strong>du</strong> bétail.<br />
Cordier<br />
“Ange gardien” de l’arène détournant la corne meurtrière.<br />
Coursière<br />
Vache de combat sélectionnée d’origine espagnole ou portugaise.<br />
Ecarteur<br />
Torero porteur <strong>du</strong> boléro (habit de lumière).<br />
Entraîneur<br />
Raseteur à la poigne d’acier replaçant le bétail en bout de piste après<br />
chaque écart.<br />
Ganaderias et cuadrillas<br />
Chaque troupeau est appelé ganaderia à laquelle est rattachée, pour<br />
une <strong>du</strong>rée d’un an, une équipe (cuadrilla) de licenciés.<br />
En course formelle, une cuadrilla est composée de 6 à 7 écarteurs,<br />
de 1 ou 2 sauteurs, de 2 entraîneurs et d’un cordier.<br />
5 cuadrillas sont engagées dans la compétition collective appelée chalenge,<br />
et chaque homme est également pointé indivi<strong>du</strong>ellement dans<br />
l’Escalot.<br />
Gitouns<br />
Protections contre les brûlures des mains et doigts <strong>du</strong> cordier.<br />
Paséo<br />
Défilé des toreros au début et à la fin de la course.<br />
Pitrangle<br />
Présidence technique, tribune officielle.<br />
Sauteur<br />
Torero réalisant des figures acrobatiques au-dessus des vaches et<br />
taureaux.<br />
Talenquère<br />
Refuge interne à la piste.<br />
● des traumatismes par chocs directs par<br />
projections ;<br />
● des traumatismes par chocs directs par<br />
écrasement (impact de la corne protégée<br />
sur la masse musculaire,piétinement<br />
par les sabots de l’animal).<br />
Chez le sauteur, les traumatismes les<br />
plus fréquents sont des traumatismes par<br />
chocs directs dans l’espace pendant la réalisation<br />
de la figure,surtout au niveau de la<br />
partie céphalique,et au niveau des membres<br />
inférieurs (chevilles,genoux) au moment<br />
de l’impulsion et de la réception des sauts.<br />
Mais nous rencontrons tout autre<br />
type de pathologies traumatiques :<br />
● plaies de lacération de la paume de la<br />
main par brûlures et cisaillement de la<br />
corde chez le cordier ;<br />
● traumatismes oculaires par projection<br />
de corps étrangers (cailloux, sable des<br />
arènes) ;<br />
● perforations musculaires et viscérales<br />
par encornage ;<br />
● pathologies vasculaires par encornage<br />
(rares) ;<br />
● beaucoup plus spécifiques à ce <strong>sport</strong>,<br />
les hématomes des fessiers et des loges<br />
externes de cuisses par décollement cisaillement<br />
des plans musculaires et cutanés<br />
les uns sur les autres par répétitions<br />
des frottements <strong>du</strong> corps de la vache à<br />
chaque passage.<br />
Plus que des microtraumatismes,ce sont<br />
souvent des pathologies hautement traumatiques<br />
et négligées qui deviennent<br />
dégénératives.<br />
On retrouve le plus souvent des DIM<br />
MÉDECINS DU SPORT 12 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Dr Ducamp<br />
cervico-dorso-lombaires, puis des lombarthroses,des<br />
discarthroses évoluées et<br />
ostéophytoses exubérantes étagées par<br />
multiplication des chocs en position cambrée<br />
favorisant des extensions extrêmes<br />
<strong>du</strong> rachis dorso-lombaire et des pathologies<br />
interapohysaires postérieures.<br />
Les chocs répétés des sabots de l’animal<br />
à chaque passage contre les malléoles<br />
externes des chevilles favorisent les<br />
arthroses,ostéochondroses articulaires,<br />
de même qu’au niveau des poig<strong>net</strong>s par<br />
impactions à chaque retombée de saut<br />
de l’ange chez le sauteur.<br />
Le médecin de terrain devra être un traumatologue<br />
aguerri et un urgentiste avisé.<br />
Les traumatismes crâniens avec coma ne<br />
sont pas rares. Il devra surtout être un<br />
fin psychologue pour se faire écouter et<br />
approcher ces <strong>sport</strong>ifs hors <strong>du</strong> commun,<br />
derniers véritables “gladiateurs” des<br />
temps modernes. ■<br />
Dr Philippe Ducamp<br />
Pour en savoir plus<br />
Fédération Française<br />
de Course Landaise (FFCL)<br />
BP 201<br />
40 282 St-Pierre <strong>du</strong> Mont Cédex<br />
Tél. : 05 58 46 50 89<br />
Fax : 05 58 06 17 45<br />
Site Inter<strong>net</strong> :<br />
www.courselandaise.org<br />
Malgré la corde<br />
protectrice, les accidents<br />
par chocs divers sont<br />
fréquents.
DOSSIER ><br />
Cardiologie<br />
et <strong>sport</strong><br />
1 re partie<br />
Les urgences cardiologiques<br />
sur le terrain de <strong>sport</strong><br />
La pratique <strong>sport</strong>ive<br />
régulière et modérée<br />
s’accompagne de nombreux<br />
effets bénéfiques, en<br />
particulier sur le plan<br />
cardiovasculaire. Cependant,<br />
elle peut aussi être<br />
à l’origine d’accidents<br />
cardiovasculaires inauguraux<br />
sur le terrain de <strong>sport</strong>.<br />
Le médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> doit<br />
connaître ces risques et le<br />
rôle qu’il doit jouer, tant sur<br />
le plan curatif que préventif.<br />
* SERVICE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES,<br />
UNITÉ DE BIOLOGIE ET MÉDECINE DU SPORT,<br />
CHU PONTCHAILLOU, RENNES.<br />
Intro<strong>du</strong>ction Page 14<br />
Le stress de<br />
l’exercice musculaire<br />
aigu Page 14<br />
● A - Trouble hémodynamique<br />
● B - Insuffisance coronaire<br />
● C - Arythmies cardiaques<br />
La mort subite Page 15<br />
● A - Incidence au cours des activités<br />
physiques<br />
● B - Les <strong>sport</strong>s à “risque”<br />
● C - La population à risque<br />
Les traumatismes<br />
cardiaques Page 16<br />
● A - Etiologie<br />
● B - Physiopathologie<br />
MÉDECINS DU SPORT 13 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
Mots clés<br />
Cœur<br />
Accident<br />
cardiovasculaire<br />
Infarctus<br />
Syncopes<br />
Mort subite<br />
Réanimation<br />
PR FRANÇOIS CARRÉ*<br />
Sommaire<br />
L’infarctus<br />
<strong>du</strong> myocarde Page 16<br />
● A - Etiologie<br />
● B - Facteurs favorisants<br />
Les “syncopes” Page 17<br />
● A - Etiologie<br />
● B - Importance de l’interrogatoire<br />
● C - Cardiopathie avec foyer arythmogène<br />
● D - Les <strong>sport</strong>s concernés<br />
Con<strong>du</strong>ite à tenir<br />
sur le terrain Page 18<br />
● A - Tableau clinique<br />
● B - Manœuvres de réanimation<br />
● C - Con<strong>du</strong>ite préventive<br />
Conclusion Page 21<br />
Bibliographie Page 21<br />
A paraître dans<br />
le prochain numéro :<br />
2 e partie<br />
Les effets cardiologiques<br />
<strong>du</strong> dopage
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
Intro<strong>du</strong>ction<br />
Pour le système cardiovasculaire,<br />
l’exercice musculaire aigu in<strong>du</strong>it un<br />
stress :<br />
● direct par la majoration de la consommation<br />
myocardique d’oxygène et par<br />
les perturbations pariétales vasculaires<br />
qu’il impose,<br />
● et indirect par les perturbations homéostasiques<br />
générales (hydroélectrolytiques,<br />
nerveuses et humorales) qui l’accompagnent.<br />
Ainsi, lors d’un exercice d’intensité maximale,<br />
le débit cardiaque est quintuplé alors<br />
que la pression artérielle systolique est doublée.<br />
Ce surcroît de travail multiplie par 10<br />
la consommation d’oxygène <strong>du</strong> cœur !<br />
L’apport d’oxygène se fera essentiellement<br />
par la vasodilatation coronaire, on voit<br />
donc le rôle central de l’intégrité de ce système<br />
artériel. D’autant plus que les<br />
contraintes mécaniques sur les parois vasculaires<br />
secondaires à l’augmentation de<br />
la fréquence cardiaque et <strong>du</strong> débit sanguin<br />
sont <strong>net</strong>tement majorées.<br />
Enfin, le système cardiovasculaire est soumis<br />
à des perturbations neuro-humorales<br />
avec levée <strong>du</strong> frein parasympathique,<br />
augmentation <strong>du</strong> tonus sympathique,<br />
des catécholamines, de l’angiotensine,<br />
des substances endothéliales et des radicaux<br />
libres, et à des perturbations hydroélectrolytiques<br />
avec déshydratation,<br />
élévation de la kaliémie, et acidose métabolique<br />
par augmentation de l’acide lactique<br />
et des protons circulants (4).<br />
Il est donc évident qu’un système cardiovasculaire<br />
défaillant tolérera mal la réa-<br />
< DOSSIER ><br />
Le système cardiovasculaire, au même titre que les systèmes<br />
pulmonaire, musculaire et ostéo-articulaire, joue un rôle<br />
important dans les adaptations au stress que l’exercice physique<br />
représente pour l’organisme. Aujourd’hui, il est bien reconnu<br />
que la pratique d’une activité physique régulière et modérée est<br />
bénéfique pour l’organisme et en particulier pour le système<br />
cardiovasculaire (1). Cependant, il est aussi vrai que la pratique<br />
intense d’un <strong>sport</strong> peut être à l’origine d’accidents cardiaques<br />
graves par le pronostic vital mis en jeu, en particulier chez un<br />
“cardiaque” méconnu (2, 3).<br />
Le stress de l’exercice<br />
musculaire aigu<br />
lisation d’un exercice aigu qui pourra<br />
alors être le révélateur d’une pathologie<br />
cardiaque méconnue. L’accident pourra<br />
être dû à une altération hémodynamique,<br />
une insuffisance coronaire aiguë<br />
et/ou à la survenue d’arythmies cardiaques.<br />
■A - Trouble<br />
hémodynamique<br />
Un trouble hémodynamique peut entraîner<br />
une syncope pendant l’effort. Celleci<br />
peut survenir en cas d’obstacle sur la<br />
chambre de chasse d’un ventricule: rétrécissement<br />
aortique ou pulmonaire, cardiomyopathie<br />
hypertrophique obstructive<br />
ou en cas de troubles <strong>du</strong> rythme.<br />
■B - Insuffisance<br />
coronaire<br />
Un exercice physique peut provoquer,<br />
sur des artères coronaires altérées, une<br />
insuffisance coronaire aiguë par différents<br />
mécanismes. L’intensité de l’effort pourra<br />
être à l’origine d’une inadéquation entre<br />
les besoins et les apports en oxygène<br />
chez un coronarien méconnu, ce qui<br />
peut se tra<strong>du</strong>ire par une douleur angineuse.<br />
L’augmentation des contraintes<br />
mécaniques intra- et extra-vasculaires<br />
pourra favoriser une rupture ou la majoration<br />
d’une fissure au sein d’une plaque<br />
d’athérome. Ces accidents pouvant<br />
secondairement se compliquer d’une<br />
vasoconstriction endothéliale (“spasme”)<br />
et de la formation d’un thrombus favorisé<br />
par l’hyperagrégabilité plaquettaire<br />
et la déshydratation. S’il est occlusif, le<br />
MÉDECINS DU SPORT 14 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
thrombus sera à l’origine d’un infarctus<br />
<strong>du</strong> myocarde, voire d’une mort subite,<br />
un thrombus non occlusif aggravera<br />
silencieusement la maladie coronaire ou<br />
sera à l’origine d’un angor instable.<br />
■C - Arythmies<br />
cardiaques<br />
La physiopathologie des arythmies cardiaques<br />
liées à l’exercice est complexe et<br />
pluri-factorielle. De manière générale, l’apparition<br />
et la pérennisation d’une arythmie<br />
cardiaque réclament la survenue d’un<br />
facteur déclenchant (extrasystole par<br />
exemple) sur un foyer arythmogène préexistant<br />
(foyer de fibrose comme la cicatrice<br />
d’un infarctus, d’un foyer infectieux…)<br />
et la présence d’un environnement “favorable”<br />
(modifications électrolytiques et/ou<br />
neuro-hormonales). Les perturbations<br />
décrites précédemment créent une instabilité<br />
électrophysiologique qui peut favoriser<br />
le déclenchement et l’entretien d’un<br />
trouble <strong>du</strong> rythme pendant l’effort ou lors<br />
de la récupération précoce, surtout en<br />
présence d’un foyer arythmogène. Celuici<br />
peut être anatomique (maladie arythmogène<br />
<strong>du</strong> ventricule droit par exemple),<br />
électrophysiologique (syndrome <strong>du</strong> QT<br />
long) ou fonctionnel, en cas d’altération<br />
de la vasodilatation coronaire (hypertrophie<br />
ventriculaire gauche pathologique,<br />
insuffisance coronaire…). La découverte<br />
d’une arythmie à l’effort chez un <strong>sport</strong>if<br />
doit faire rechercher l’existence d’un foyer<br />
arythmogène classique: coronaropathie,<br />
valvulopathie, cardiopathie arythmogène,<br />
myocardite.
la première des urgences<br />
cardiologiques <strong>du</strong> terrain de<br />
C’est<br />
<strong>sport</strong>. Globalement, une cause<br />
cardiovasculaire est objectivée dans plus<br />
de 90 % des cas de mort subite (Tab. I).<br />
■A - Incidence au cours<br />
des activités<br />
physiques<br />
L’incidence exacte de la mort subite est<br />
difficile à chiffrer et sûrement sous-estimée.<br />
Elle est globalement voisine de<br />
1 pour 50000 pratiquants (5), mais varie<br />
en fonction de l’âge, <strong>du</strong> sexe et <strong>du</strong><br />
niveau d’entraînement. Avant 35 ans, on<br />
s’accorde sur une fréquence de l’ordre<br />
de 1 pour 100 000 pratiquants (respectivement<br />
0,75 et 0,13 pour 100000 <strong>sport</strong>ifs<br />
masculins et féminins).<br />
Chez les <strong>sport</strong>ifs de compétition, elle serait<br />
voisine de 1/200 000 (6). En France, le<br />
nombre annuel de morts subites est compris<br />
entre 1 500 et 4 500, dont moins de<br />
50 cas par an avant 35 ans (7).<br />
■B - Les <strong>sport</strong>s<br />
à “risque”<br />
Il n’y a pas réellement de <strong>sport</strong> “à risque”<br />
(5, 7). Trois facteurs jouent un rôle favorisant:<br />
● l’intensité, plus que la <strong>du</strong>rée, de l’effort;<br />
ainsi quel que soit l’âge le risque de survenue<br />
d’une mort subite sur une cardiopathie<br />
méconnue est majoré par la<br />
pratique de la compétition ;<br />
● le niveau d’entraînement ; la réalisation<br />
d’un exercice soutenu multiplie par<br />
56 le risque de mort subite chez le sédentaire<br />
et “seulement” par 5 chez le sujet<br />
entraîné (2) ; de même, après 35 ans la<br />
fréquence des morts subites chez les<br />
Tableau I: causes des morts subites lors<br />
de la pratique d’une activité <strong>sport</strong>ive.<br />
(Amérique <strong>du</strong> Nord, 1975-1984, n = 252) (6)<br />
Affection en cause Pourcentage<br />
Coronaropathie acquise 60,0<br />
Autre cardiopathie 22,6<br />
Accident vasculaire cérébral 6,7<br />
Autre cause 3,2<br />
Cause inconnue 7,5<br />
< DOSSIER ><br />
La mort subite<br />
“joggers” (1/15 000) est plus élevée que<br />
chez les “marathoniens” (1/50 000) ;<br />
● enfin l’environnement, et en particulier<br />
les conditions thermiques et l’altitude.<br />
■C - La population<br />
à risque<br />
La population touchée est surtout masculine<br />
(Tab. II) avec un âge charnière<br />
de 35 ans (45 ans chez les femmes) tant<br />
en ce qui concerne l’incidence que les<br />
causes des morts subites.<br />
Après 35 ans, c’est la maladie coronaire<br />
qui est la cause de la mort subite. Le rôle<br />
de la prévention dans cette tranche d’âge<br />
est donc majeur.<br />
MÉDECINS DU SPORT 15 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
Avant 35 ans, les causes sont plus<br />
diverses (Tab. II). Les cardiopathies hypertrophiques<br />
prédominent, mais la fréquence<br />
de la maladie arythmogène <strong>du</strong><br />
ventricule droit et des myocardites infectieuses<br />
ne doit pas être sous-estimée (5,<br />
6, 8). Les anomalies de naissance des<br />
coronaires aussi sont souvent en cause<br />
(5, 8). A cet âge aussi le niveau d’entraînement<br />
intervient, comme en<br />
témoigne l’incidence plus élevée de la<br />
maladie coronaire dans la mort subite<br />
des jeunes survenant en dehors <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong> (8). Les <strong>sport</strong>ifs d’origine afro-américaine<br />
sont plus exposés au risque de<br />
mort subite, en particulier par cardiomyopathie<br />
hypertrophique (6). Il est<br />
important de noter que, dans cette<br />
tranche d’âge, il n’est pas mis en<br />
évidence de mort subite en relation<br />
avec une hypertension artérielle.<br />
Ainsi, bien que souvent amplifiée<br />
par les médias, la mort subite <strong>du</strong> jeune<br />
athlète, vu son caractère exceptionnel,<br />
ne représente pas un réel problème de<br />
santé publique. Ceci n’exclut pas,<br />
comme nous le reverrons, la nécessité<br />
d’une approche préventive la plus efficace<br />
possible. En effet, dans plus de la<br />
moitié des cas rapportés, des symptômes,<br />
cachés ou négligés, ont précédé<br />
l’épisode fatal.<br />
Tableau II: comparaison des causes de morts subites liées ou<br />
non à l’exercice dans une population de sujets jeunes < 35 ans.<br />
Affection en cause Athlète (6) Non athlète (9)<br />
% (n = 134) % (n = 34)<br />
Cardiomyopathie hypertrophique 46 24<br />
Anomalie congénitale des coronaires 23 12<br />
Myocardite 6 6<br />
Dissection aortique 5 0<br />
Rétrécissement aortique 4 0<br />
Maladie arythmogène <strong>du</strong> VD 3 3<br />
Cardiomyopathie non obstructive 3* 0*<br />
Hypertrophie VG idiopathique 0* 9*<br />
Prolapsus mitral 2 0<br />
Autres cardiopathies 6 3<br />
Inconnue 2 18<br />
* La distinction entre ces deux causes est difficile à la lecture de ces deux études.<br />
Tableau modifié d’après Williams RA in : “Sudden cardiac death in the athlète”. Este, Salem,<br />
Wang (eds) Armonk NY 1998 ; pp 205-220.
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
< DOSSIER ><br />
Les traumatismes cardiaques<br />
Les accidents cardiaques par lésions<br />
traumatiques comme les contusions<br />
myocardiques, les lésions vasculaires<br />
(dissection aortique ou coronaire) ou valvulaires,<br />
ne se distinguent guère des<br />
autres causes traumatiques comme les<br />
accidents de la voie publique.<br />
Bien différent est le “commotio cordis”.<br />
Cet accident, heureusement rare, est dramatique<br />
car il entraîne, le plus souvent,<br />
une mort instantanée (9).<br />
■A - Etiologie<br />
Il est secondaire à un impact thoracique,<br />
pas obligatoirement violent par un projectile<br />
(balle de base-ball ou de soft-ball,<br />
palet de hockey…) ou un coup (<strong>sport</strong> de<br />
combat). L’âge des victimes est, le plus<br />
souvent, très jeune (4 à 18 ans), ce qui<br />
pourrait s’expliquer par une grande déformabilité<br />
thoracique avec transmission complète<br />
de l’énergie de l’impact au myocarde.<br />
Les techniques classiques de réanimation,<br />
lorsqu’elles peuvent être mises en œuvre,<br />
restent souvent inefficaces.<br />
■B - Physiopathologie<br />
La physiopathologie de cet accident<br />
Une activité physique, surtout si<br />
elle est d’intensité inhabituelle,<br />
peut favoriser la survenue d’un<br />
accident coronarien (7). En France,<br />
annuellement 5000 à 6000 patients font<br />
un infarctus <strong>du</strong> myocarde au cours ou<br />
au décours d’une activité <strong>sport</strong>ive (10).<br />
■A - Etiologie<br />
Ces accidents coronariens au cours <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong> concernent des hommes relativement<br />
jeunes (âge voisin de 50 ans). S’ils<br />
sont souvent inauguraux, il faut noter<br />
que dans plus de 30 % des cas l’existence<br />
de prodromes négligés est retrouvée. Le<br />
reste mal expliquée et aujourd’hui trois<br />
hypothèses sont proposées. La survenue<br />
de l’impact thoracique lors de la<br />
période de vulnérabilité <strong>du</strong> cycle cardiaque<br />
(sommet de l’onde T) déclencherait<br />
une fibrillation ventriculaire sans<br />
lésion thoracique ou cardiaque indivi<strong>du</strong>alisable.<br />
Un spasme coronarien<br />
“traumatique” ou une hémorragie myo-<br />
plus souvent, le <strong>sport</strong>if est un coronarien<br />
“classique” méconnu, dont le facteur de<br />
risque principal est le tabagisme, et pour<br />
MÉDECINS DU SPORT 16 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
cardique minime pourraient aussi être<br />
en cause (9).<br />
Ce risque d’accident pousse à conseiller le<br />
port d’équipements adéquats de protection<br />
thoracique dans les <strong>sport</strong>s à risque d’impact<br />
thoracique surtout par des projectiles de<br />
taille minime ou moyenne.<br />
L’infarctus <strong>du</strong> myocarde<br />
qui l’exercice physique a favorisé la rupture<br />
d’une plaque d’athérome secondairement<br />
compliquée par une thrombose.<br />
Des anomalies anatomiques comme un<br />
pont intra-myocardique ou une anomalie<br />
congénitale de naissance des coronaires<br />
sont plus rarement en cause.<br />
■B - Facteurs<br />
favorisants<br />
Des facteurs favorisants ce type d’accident<br />
méritent d’être connus, comme l’association<br />
exercice et tabac après l’effort,<br />
et la pratique <strong>sport</strong>ive dans des conditions<br />
de températures extrêmes.
Définie comme une perte brutale<br />
de conscience et <strong>du</strong> tonus postural<br />
avec une récupération spontanée<br />
rapide et complète, la vraie<br />
syncope et ses équivalents mineurs, à<br />
type de “malaises” souvent mal étiquetés,<br />
représentent les urgences cardiologiques<br />
de terrain les plus fréquentes.<br />
■A - Etiologie<br />
Les syncopes sont liées, le plus souvent, à<br />
une baisse brutale <strong>du</strong> débit sanguin cérébral.<br />
Plus rarement, elles sont secondaires<br />
à une hypoglycémie (diabétique), une épilepsie<br />
ou une hypoxie cérébrale (maladie<br />
cardiopulmonaire). Dans une population<br />
standard, c’est une cause fréquente de<br />
consultation aux urgences et une étiologie<br />
cardiovasculaire ou neurologique est rarement<br />
retrouvée (21 % des cas chez les<br />
hommes et 12 % chez les femmes).<br />
En l’absence de pathologie cardiovasculaire<br />
sous-jacente, le pronostic de ces syncopes<br />
chez le <strong>sport</strong>if est globalement bon. Le bilan<br />
médical post-accident s’attachera donc à<br />
“détecter” les patients à “haut risque”.<br />
■B - Importance<br />
de l’interrogatoire<br />
Les interrogatoires <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if et de son entourage<br />
devront préciser les circonstances de<br />
survenue de l’incident et les signes ressentis<br />
et/ou observés. Il est absolument essentiel<br />
de savoir si le malaise est arrivé pendant, à<br />
l’arrêt ou après l’effort.<br />
Sa survenue pendant l’effort, dont<br />
l’intensité sera précisée, évoque d’emblée<br />
< DOSSIER ><br />
Les “syncopes”<br />
une obstruction sur une des chambres<br />
de chasse ventriculaires ou un trouble <strong>du</strong><br />
rythme (Fig. 1). Une défaillance de la<br />
pompe cardiaque ou un accident ischémique<br />
transitoire sont plus rarement en<br />
cause sur le terrain de <strong>sport</strong>.<br />
Sa survenue lors d’une baisse d’intensité<br />
de l’exercice (descente suivant une côte en<br />
vélo par exemple) évoque une cause arythmique<br />
d’origine “vagale” le plus souvent.<br />
Enfin, sa survenue à l’arrêt de l’effort<br />
et surtout après l’arrêt de l’effort est<br />
évocatrice d’un malaise vagal. Il est alors<br />
le plus souvent précédé de prodromes<br />
qui laissent au <strong>sport</strong>if le temps de s’asseoir.<br />
Chez des athlètes hyper-en<strong>du</strong>rants,<br />
une intolérance prononcée à l’orthosta-<br />
MÉDECINS DU SPORT 17 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
tisme peut être rencontrée, il faudra leur<br />
conseiller d’éviter l’arrêt brutal lors de<br />
toute pratique <strong>sport</strong>ive (en particulier aux<br />
ravitaillements).<br />
Les caractéristiques <strong>du</strong> rythme cardiaque,<br />
rapide ou lent, régulier ou irrégulier, sont très<br />
utiles au diagnostic de même que la description<br />
de signes associés tels qu’une pâleur,<br />
des sueurs, une douleur ou des palpitations.<br />
Si une cause simple comme une tachycardie,<br />
une bradycardie ou un malaise<br />
vagal sont faciles à établir, le plus souvent<br />
le diagnostic étiologique précis sera fait<br />
a posteriori. Il réclamera un bilan cardiologique<br />
orienté par la symptomatologie,<br />
mais qui comprendra au moins un ECG<br />
et un échocardiogramme transthoracique<br />
de repos puis un ECG d’effort.<br />
Figure 1: épisode de tachycardie ventriculaire chez un jeune cycliste. ECG de repos (en haut) et<br />
d’effort (en bas) enregistrés avec un Holter rythmique. Noter sur l’ECG de repos la grande<br />
bradycardie (FC = 30 bpm avec intervalle RR > 1700 msec). Lors de l’effort, survenue d’une<br />
tachycardie ventriculaire (entre les flèches, FC = 220 bpm) qui cède spontanément.
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
■C - Cardiopathie avec<br />
foyer arythmogène<br />
Une crise de tachycardie à l’effort peut<br />
être d’origine supraventriculaire ou ventriculaire.<br />
Elle peut être <strong>du</strong>e à une cardiopathie<br />
avec foyer arythmogène<br />
anatomique comme une maladie coronaire,<br />
une cardiomyopathie hypertrophique,<br />
une maladie arythmogène <strong>du</strong><br />
ventricule droit, une cardiopathie congénitale,<br />
voire une myocardite. Le prolapsus<br />
valvulaire mitral est sûrement moins<br />
souvent en cause que certaines études<br />
anciennes ne l’ont laissé croire (11).<br />
Il peut aussi s’agir d’un foyer arythmogène<br />
électrophysiologique comme un<br />
syndrome de de Wolff-Parkinson-White<br />
ou un syndrome <strong>du</strong> QT long. Enfin, une<br />
tachycardie catécholergique “idiopathique”<br />
peut être en cause, elle se voit<br />
surtout chez l’enfant ou l’adolescent et<br />
est bien repro<strong>du</strong>ctible par l’épreuve d’effort.<br />
La prise de pro<strong>du</strong>its interdits comme<br />
la cocaïne ou les amphétamines peut<br />
aussi être à l’origine de troubles <strong>du</strong><br />
rythme graves (12).<br />
La survenue d’un accident cardiovasculaire<br />
sur le terrain de <strong>sport</strong><br />
est toujours compliquée par les<br />
modifications physiologiques liées à la<br />
pratique d’un exercice musculaire souvent<br />
intense (14, 15). L’organisme<br />
déshydraté est en dette d’oxygène avec<br />
une acidose métabolique et respiratoire.<br />
Les taux de catécholamines et de radicaux<br />
libres circulants sont élevés et le<br />
métabolisme glucidique est modifié.<br />
Toutes ces adaptations qui persistent<br />
après l’arrêt de l’effort peuvent compliquer<br />
les manœuvres de réanimation. Il<br />
faudra toujours assurer une bonne oxygénation<br />
en O 2 pur au début, une perfusion<br />
tissulaire efficace avec un<br />
remplissage vasculaire à bon débit sans<br />
apport glucidique inconsidéré (vérification<br />
de la glycémie si doute). L’apport<br />
d’emblée de bicarbonates est dangereux<br />
et celui d’adrénaline à forte dose<br />
est inutile.<br />
< DOSSIER ><br />
Une bradycardie est le plus souvent liée<br />
à un malaise vagal où le ralentissement<br />
de la fréquence cardiaque est associé à<br />
une vasodilatation avec chute tensionnelle.<br />
La survenue d’un bloc auriculo-ventriculaire<br />
d’effort est rarement en cause.<br />
■D - Particularités des<br />
<strong>sport</strong>s aquatiques<br />
La natation et la plongée sous marine,<br />
surtout en apnée, peuvent se compliquer<br />
de syncopes de différentes natures qui,<br />
vu le milieu environnant relativement hostile,<br />
sont toujours graves (13). Lors d’un<br />
plongeon, la stimulation <strong>du</strong> trijumeau<br />
peut provoquer une syncope avec asystolie<br />
cardiaque. Les personnes prédisposées<br />
aux malaises vagaux ou à<br />
l’hypotension orthostatique peuvent présenter<br />
des hypotensions lors de l’immersion.<br />
La pratique de l’apnée peut se<br />
compliquer de syncopes de physiopathologies<br />
diverses. La syncope anoxique<br />
de l’apnéiste est liée au maintien trop prolongé<br />
d’une apnée. Sa survenue est souvent<br />
favorisée par une hyperventilation<br />
■A - Tableau clinique<br />
Il faut rapidement apprécier la gravité <strong>du</strong><br />
tableau clinique. Sportif conscient, ou non,<br />
et en cas d’inconscience totale, présence<br />
de respiration et de pouls carotidien (sur<br />
10 secondes, pour ne pas méconnaître<br />
une bradycardie profonde) ou non.<br />
Si le patient est conscient, le rassurer ainsi<br />
que l’entourage et en fonction des symptômes<br />
appeler une équipe médicale spécialisée.<br />
Si le patient est inconscient, sans pouls<br />
ni respiration, l’alerte est donnée, alors que<br />
les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaires<br />
(RCP) de base sont immédiatement<br />
débutées.<br />
■B - Manœuvres<br />
de réanimation<br />
Elles associent le bouche-à-bouche ou<br />
l’oxygénation au masque (10-12 cycles<br />
par minute) après vérification de la liberté<br />
des voies aériennes et le massage cardiaque<br />
externe (80-100 par minute) qui<br />
MÉDECINS DU SPORT 18 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
préalable à la plongée. Lors de la remontée,<br />
le plongeur peut être confronté au<br />
classique rendez-vous syncopal des derniers<br />
mètres, favorisé par le retour <strong>du</strong><br />
volume sanguin vers le bas <strong>du</strong> corps et<br />
par le déficit en oxygène intra-alvéolaire.<br />
Enfin, à la sortie de l’eau, une hypotension<br />
orthostatique parfois retardée peut<br />
survenir. L’interrogatoire précisera donc le<br />
moment exact de survenue de la syncope<br />
dans, ou hors de l’eau et dans ce cas la<br />
posture au moment <strong>du</strong> malaise. Les accidents<br />
de plongée avec scaphandre autonome<br />
ne seront pas envisagés ici.<br />
Con<strong>du</strong>ite à tenir sur le terrain<br />
sont poursuivis jusqu’à l’arrivée des<br />
secours médicalisés.<br />
Leur arrivée va permettre d’adapter les<br />
gestes de secours au diagnostic précis<br />
qui repose surtout sur le tracé ECG. Une<br />
brève interruption de la RCP pour permettre<br />
l’analyse de l’ECG et la réalisation<br />
d’un choc électrique externe (CEE) éventuel<br />
peut être nécessaire.<br />
● En cas d’asystolie, si possible vérifiée<br />
sur plusieurs dérivations ECG, le CEE est<br />
inutile. L’efficacité <strong>du</strong> coup de poing sternal<br />
peut être testée, les manœuvres de<br />
RCP doivent être poursuivies. Après mise<br />
en place d’une voie veineuse (sérum<br />
salé), l’adrénaline (1 mg en IVD ou 3 mg<br />
dans 10 ml de sérum physiologique à travers<br />
la sonde d’intubation associée à des<br />
insufflations pour nébulisation) peut être<br />
utilisée. La réapparition d’un rythme cardiaque,<br />
souvent lent, permet l’utilisation<br />
d’isoprénaline.
● Une bradycardie peut être <strong>du</strong>e à un<br />
malaise vagal dont le meilleur traitement<br />
reste la position allongée avec surélévation<br />
des membres inférieurs. L’indication<br />
de l’atropine (0,75 à 100 mg chez un<br />
a<strong>du</strong>lte en injection intraveineuse) reste<br />
rare dans cette population. Une autre<br />
cause de bradycardie est le bloc auriculoventriculaire<br />
complet qui est diagnostiqué<br />
par l’ECG. En cas d’échappement<br />
supra-ventriculaire (complexes QRS fins),<br />
l’atropine peut être utilisée. Si l’échappement<br />
est plus bas situé (ventriculaire<br />
avec des complexes QRS élargis), une<br />
perfusion de sérum glucosé à 5 % contenant<br />
5 ampoules d’isoprénaline (2 mg<br />
par ampoule) doit être utilisée. Le débit<br />
de perfusion sera réglé pour maintenir<br />
chez le patient bien oxygéné une fréquence<br />
cardiaque de 80 bpm en attendant<br />
son transfert en milieu<br />
cardiologique.<br />
● Les troubles <strong>du</strong> rythme rapides à<br />
type de tachycardie ou de fibrillation, le<br />
plus souvent ventriculaires mais parfois<br />
supraventriculaires, vont bénéficier <strong>du</strong> CEE.<br />
Si le patient est inconscient, celui-ci doit<br />
être tenté dès que le diagnostic est posé.<br />
Son intensité sera de 3 joules par kg, soit<br />
au moins 200 joules et, en cas d’échec, il<br />
sera répété en l’augmentant progressivement<br />
jusqu’à 5 joules par kg. En l’absence<br />
de perte de connaissance et de mauvaise<br />
tolérance hémodynamique, le CEE doit<br />
être toujours précédé d’une anesthésie<br />
générale (10 mg Valium IV).<br />
● Défibrillation sur le terrain<br />
La défibrillation sur les terrains de <strong>sport</strong><br />
devrait bénéficier <strong>du</strong> développement<br />
récent des défibrillateurs semi-automatiques<br />
(DSA). Ces appareils légers, donc<br />
facilement portables, de maintenance et<br />
d’entretien ré<strong>du</strong>its, comprennent des<br />
microprocesseurs d’analyse de l’ECG performants.<br />
Après analyse <strong>du</strong> rythme cardiaque<br />
et confirmation d’une tachycardie<br />
ou d’une fibrillation, une intervention<br />
manuelle reste nécessaire pour la délivrance<br />
<strong>du</strong> choc électrique. La simplicité<br />
de ces appareils rend leur utilisation possible<br />
par des non-médecins préalablement<br />
formés. Il serait cependant irréaliste,<br />
sur un plan économique, de vouloir pla-<br />
< DOSSIER ><br />
cer un DSA dans toutes les enceintes<br />
<strong>sport</strong>ives. Il semble plus raisonnable<br />
d’équiper les secours médicaux responsables<br />
de la surveillance d’une compétition<br />
<strong>sport</strong>ive et les sites à hauts risques,<br />
surtout pour le public.<br />
■C - Con<strong>du</strong>ite<br />
préventive<br />
La prévention est très importante. Il serait<br />
cependant aujourd’hui illusoire de penser<br />
qu’un dépistage standardisé et systématique<br />
des maladies cardiovasculaires<br />
chez les <strong>sport</strong>ifs permettrait d’éliminer<br />
tous les risques d’accidents sur le terrain.<br />
Tout d’abord, le médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> devra<br />
rappeler les quelques règles préventives<br />
“cardiovasculaires” à respecter sur le terrain<br />
(Tab. III).<br />
Cette prévention repose surtout sur l’interrogatoire<br />
et l’examen physique (Tab. IV et V).<br />
MÉDECINS DU SPORT 19 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
● L’interrogatoire<br />
L’interrogatoire doit être dirigé et “policier”.<br />
Il précisera les antécédents personnels<br />
et familiaux cardiovasculaires (maladie<br />
coronaire, cardiomyopathies hypertrophiques<br />
ou dilatées, maladie de Marfan,<br />
syndrome <strong>du</strong> QT long, arythmies cardiaques…)<br />
et recherchera, en particulier,<br />
l’existence d’une mort subite dans la famille<br />
avant 60 ans. Il cherchera la présence de<br />
signes fonctionnels anormaux (Tab. IV) lors<br />
de la pratique <strong>sport</strong>ive. La période de survenue<br />
de ces symptômes dans la séance<br />
sera toujours précisée (échauffement, pendant<br />
l’effort et pour quelle intensité, juste<br />
après l’effort ou retardée). La recherche<br />
d’un épisode infectieux récent éventuel doit<br />
être systématique, vu l’incidence immédiate<br />
qu’il pourra avoir sur la pratique <strong>sport</strong>ive<br />
(interruption temporaire des séances d’entraînement<br />
de forte intensité).<br />
Tableau III: règles de bonnes pratiques “cardiovasculaires” d’un exercice<br />
physique.<br />
• Respect des “trois phases” : échauffement, “travail”, retour au calme.<br />
• Hydratation pré-, per- et post-séance.<br />
• Respect des conditions ambiantes : forte chaleur, grande humidité, grand froid, haute altitude.<br />
• Pas d’effort trop proche d’un repas.<br />
• Pas de douche trop précoce après la séance.<br />
• Pas de tabac après l’effort.<br />
• Etre à l’écoute de ses sensations.<br />
• Abstention en cas de fièvre, infection ou fatigue anormale.<br />
• Consulter en cas de survenue de sensations inhabituelles et inexpliquées.<br />
Tableau IV: examen clinique <strong>du</strong> sujet qui veut participer à des compétitions<br />
<strong>sport</strong>ivesen 14 points essentiels.<br />
Antécédents familiaux et personnels<br />
1 - Mort subite.<br />
2 - Maladie cardiovasculaire dans la famille proche.<br />
3 - Facteur(s) de risque cardiovasculaire(s) indépendant(s).<br />
Signes fonctionnels<br />
4 - Souffle cardiaque.<br />
5 - Hypertension artérielle.<br />
6 - Fatigabilité anormale.<br />
7 - Dyspnée anormale à l’effort.<br />
8 - Douleur thoracique à l’effort.<br />
9 - Palpitations à l’effort.<br />
10 - Syncope ou équivalent mineur.<br />
Examen physique<br />
11 - Souffle ou arythmie cardiaque.<br />
12 - Pouls fémoraux.<br />
13 - Pression artérielle.<br />
14 - Signes de maladie de Marfan.
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
< DOSSIER ><br />
Tableau V: facteurs de risque cardiovasculaires indépendants à rechercher<br />
chez un <strong>sport</strong>if pour guider la réalisation d’une épreuve d’effort.<br />
● L’examen physique<br />
L’examen physique recherchera un souffle<br />
dans l’aire cardiaque en position couchée,<br />
assise, debout et, si besoin, après<br />
quelques flexions et sur les trajets vasculaires.<br />
La symétrie des pouls fémoraux à<br />
la recherche d’une coarctation aortique<br />
sera toujours vérifiée. La pression artérielle<br />
sera systématiquement mesurée.<br />
Un aspect Marfanoïde (basket-ball, volley-ball…)<br />
pourra être une indication à<br />
la réalisation d’un échocardiogramme.<br />
● L’ECG de repos<br />
La place de l’ECG de repos reste discutée<br />
(16), sa réalisation est cependant<br />
recommandée chez les <strong>sport</strong>ifs vétérans<br />
désireux de pratiquer des compétitions<br />
(18). Il est souvent, mais pas toujours,<br />
anormal dans les cardiomyopathies<br />
hypertrophiques, dilatées et dans la maladie<br />
arythmogène <strong>du</strong> ventricule droit<br />
(Tab. VI). Il permet de révéler les syndromes<br />
de Brugada, de pré-excitation et<br />
certains syndromes <strong>du</strong> QT long. Mais cet<br />
examen présente aussi des limites dans<br />
d’autres pathologies, comme dans la<br />
maladie coronaire silencieuse, les arythmies<br />
d’effort et les anomalies cardiaques<br />
structurelles. De plus, la découverte de<br />
particularités électrocardiographiques liées<br />
à la pratique d’un haut niveau d’entraînement,<br />
en particulier dans les disciplines<br />
aérobies, peut être à l’origine de “faux<br />
positifs” dans 20 à 25 % des cas (17).<br />
Dans tous les cas, au moindre doute<br />
sur l’intégrité <strong>du</strong> système cardiovasculaire,<br />
un bilan cardiologique<br />
• Hypercholestérolémie (Cholestérol total ≥ 240 mg/dl,<br />
LDL-C >130 mg/dl, HDL-C < 35 mg/dl pour un homme et<br />
45 mg/dl pour une femme) ou dyslipidémie.<br />
• Hypertension artérielle (systolique > 140 mm Hg et ou<br />
diastolique > 90 mm Hg).<br />
• Tabagisme récent ou actuel.<br />
• Diabète (glycémie à jeun ≥ 126 mg/dl ou traitement par<br />
insuline ou hypoglycémiants oraux).<br />
• Antécédent dans la famille proche d’un infarctus <strong>du</strong><br />
myocarde ou d’une mort subite avant 60 ans.<br />
devra être réalisé. Si ce bilan confirme<br />
l’existence d’une pathologie cardiovasculaire,<br />
la décision de l’autorisation à la<br />
pratique <strong>sport</strong>ive, en particulier en compétition,<br />
pourra être guidée par les recommandations<br />
nord-américaines récemment<br />
adaptées aux <strong>sport</strong>s nationaux (18).<br />
● L’épreuve d’effort<br />
La place de l’épreuve d’effort (EE) dans<br />
le bilan d’aptitude au <strong>sport</strong> mérite d’être<br />
Tableau VI: ECG de repos. Quelques critères électrocardiographiques.<br />
Cardiomyopathie hypertrophique<br />
• Complexes QRS très amples surtout en précordiales témoignant d’une hypertrophie<br />
ventriculaire gauche avec souvent ondes T négatives associées.<br />
• Ondes Q fines et profondes.<br />
• Arythmie ventriculaire et supraventriculaire.<br />
Cardiomyopathie dilatée<br />
• Pas toujours de signes spécifiques.<br />
• Complexes QRS élargies parfois avec bloc de branche gauche témoignant d’une hypertrophie<br />
ventriculaire gauche.<br />
• Troubles de repolarisation souvent associés.<br />
• Arythmie ventriculaire ou supraventriculaire parfois révélatrice.<br />
Maladie arythmogène <strong>du</strong> ventricule droit<br />
• Prolongation des complexes QRS avec surtout un QRS plus large en V2-V3 qu’en V6 et<br />
souvent un bloc de branche droit.<br />
• Ondes T inversées en V1-V2-V3.<br />
• Présence inconstante d’une onde epsilon qui prolonge le complexe QRS et témoigne de<br />
la présence d’un foyer arythmogène.<br />
• Arythmie ventriculaire évocatrice de la maladie, si large avec un aspect de bloc de<br />
branche gauche en précordiales et un axe droit en périphériques.<br />
MÉDECINS DU SPORT 20 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
discutée. La maladie coronaire silencieuse<br />
est rarement détectable par l’ECG de<br />
repos ou par l’échocardiographie transthoracique<br />
de repos. Une indication systématique<br />
de l’EE à la recherche d’une<br />
maladie coronaire silencieuse chez tous<br />
les <strong>sport</strong>ifs n’est pas justifiée (1,17). En<br />
effet, dans une population générale, la<br />
sensibilité de l’EE est voisine de 65 % et sa<br />
spécificité de 80 % (ce qui correspond à<br />
20 % de “faux positifs”). De plus, dans<br />
une population asymptomatique et à<br />
faible prévalence de la maladie coronaire,<br />
la valeur prédictive positive de l’EE est ≤ à<br />
25 % (10) et sa valeur prédictive négative<br />
est difficile à préciser.<br />
C’est pourquoi l’indication de l’EE doit<br />
être ciblée par l’interrogatoire et l’examen<br />
physique. Ainsi, selon les recommandations<br />
de l’American College of Sports<br />
Medicine (1) et de la Société Française<br />
de Cardiologie (19), la réalisation d’une<br />
EE est justifiée :<br />
- chez tout sujet symptomatique et/ou<br />
porteur d’une cardiopathie,<br />
- chez un sujet asymptomatique présentant<br />
au moins deux facteurs de risque<br />
(Tab. V),
- et chez un homme de plus de 40 ans,<br />
ou une femme de plus de 50 ans (ou plus<br />
tôt si ménopausée), qui désire reprendre<br />
une activité <strong>sport</strong>ive intense ou intensifier<br />
son activité physique habituelle.<br />
Si cette épreuve d’effort est anormale, un<br />
autre examen diagnostique non invasif<br />
est justifié. Il s’agira, le plus souvent, d’une<br />
scintigraphie de perfusion myocardique,<br />
mais un échocardiogramme transthoracique<br />
de stress (effort ou dobutamine)<br />
peut aussi être proposé. La forte valeur<br />
prédictive négative de ces examens doit<br />
permettre de ne réserver la réalisation de<br />
la coronarographie qu’aux cas fortement<br />
suspects.<br />
La réalisation systématique d’un échocardiogramme<br />
transthoracique de repos<br />
n’est pas justifiée. Il faut de plus rappeler<br />
que cet examen n’a aucune indication<br />
dans le suivi de l’entraînement. Cet<br />
examen doit être réservé à la recherche<br />
d’une valvulopathie et plus particulièrement<br />
d’une sténose aortique, d’une<br />
séquelle fonctionnelle d’infarctus, d’une<br />
cardiomyopathie hypertrophique ou dilatée<br />
ou d’une maladie arythmogène <strong>du</strong><br />
ventricule droit. ■<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
1. American Heart Association Committee on<br />
Exercise. Circulation 1992 ; 86 : 340-44.<br />
2. Siskovick DS et al. The incidence of primary<br />
cardiac arrest <strong>du</strong>ring vigorous exercise. New<br />
Eng J Med 1988 ; 318 : 129-33.<br />
3. Maron BJ et al. Risk for sudden death associated<br />
with marathon running. J Am Coll<br />
Cardiol 1996 ; 28 : 428-31.<br />
4. Carré F. Adaptations cardiovasculaires et respiratoires<br />
au cours de l’effort. In “Cardiologie<br />
<strong>du</strong> Sport”. Amoretti R et Brion R (eds). Paris :<br />
Masson, 2000 ; pp 16-21.<br />
5. Thompson PD. The cardiovascular complications<br />
of vigourous physical activity. Arch Int<br />
Med 1996 ; 156 : 2297-307.<br />
6. Maron BJ et al. Sudden death in young competitive<br />
athletes. Clinical, demographic and<br />
pathological profiles. JAMA 1996; 276: 199-204.<br />
7. Ollivier JP et Genero-Gygay M. Epidémiologie<br />
de la mort subite <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if. In “Cardiologie<br />
<strong>du</strong> Sport”. Amoretti R. et Brion R. (eds).<br />
Paris : Masson, 2000 ; pp 181-87.<br />
< DOSSIER ><br />
Conclusion<br />
MÉDECINS DU SPORT 21 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Cardiologie et <strong>sport</strong> - 1 re partie<br />
Les urgences cardiologiques sur le terrain de <strong>sport</strong> restent relativement<br />
rares, mais leur gravité, majorée par les conditions environnantes dans lesquelles<br />
elles surviennent, explique l’intérêt qui leur est porté.<br />
Le rôle <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> est surtout préventif, mais s’il accepte de<br />
surveiller des compétitions <strong>sport</strong>ives, il devra être capable de réaliser les premiers<br />
gestes essentiels de secours en cas d’urgence cardiologique.<br />
8. Burke AP et al. Sports-related and non<strong>sport</strong>s-related<br />
sudden cardiac death in young<br />
a<strong>du</strong>lts. Am Heart J 1991 ; 121 : 568-75.<br />
9. Link MS et al. Commotio cordis. In “Sudden<br />
Cardiac Death in the Athlete”. Estes NAM, Salem<br />
DN, Wang PJ (eds). Futura Pub 1998; pp 515-28.<br />
10. Machecourt J et al. Détection de la pathologie<br />
coronaire chez le <strong>sport</strong>if. In “Cardiologie<br />
<strong>du</strong> Sport”. Amoretti R et Brion R (eds). Paris :<br />
Masson, 2000 ; pp 92-99.<br />
11. Myerburg RJ Sudden cardiac death in persons<br />
with normal (or near normal) hearts. Am<br />
J Cardiol 1997 ; 79 : 3-9.<br />
12. Gauthier J. Le dopage: effets et risques cardiovasculaires.<br />
In “Cardiologie <strong>du</strong> Sport”.<br />
Amoretti R et Brion R (eds). Paris : Masson,<br />
2000 ; pp 251-58.<br />
13. Gancia GP, Lin YC. Applied physiology of<br />
diving. Sports Med 1988 ; 5: 41-56.<br />
14. American Heart Association. Guidelines for<br />
cardiopulmonary ressucitation and emergency<br />
cardiac care. JAMA 1992 ; 268 : 2171-302.<br />
15. Trifot M. Gestion d’une urgence cardiovasculaire<br />
sur le terrain. In “Cardiologie <strong>du</strong> Sport”.<br />
Amoretti R et Brion R (eds). Paris : Masson, 2000;<br />
pp 1881-1920.<br />
16. Fuller CM, Mc Nulty CM, Spring DA et al.<br />
Prospective screening of 5615 high school athletes<br />
for risk of sudden cardiac death. Med Sci<br />
Sports Exerc 1997 ; 2 : 1131-38.<br />
17. Maron BJ et al. Recommendations for preparticipation<br />
screening and the assessment of<br />
cardiovascular disease in masters athletes.<br />
Circulation 2001 ; 103 : 327-34.<br />
18. Brion R, Amoretti R, Godon P. Aptitude à la<br />
compétition des athlètes porteurs de cardiopathies<br />
: les conseils de la 26e conférence de<br />
Bethesda. In “Cardiologie <strong>du</strong> Sport”. Amoretti R<br />
et Brion R (eds). Paris : Masson, 2000 ; pp 235-<br />
244.<br />
19. Anonymous. La pratique des épreuves d’effort<br />
en cardiologie. Recommendations de la<br />
Société Française de Cardiologie. Arch Mal Cœur<br />
1994 (Suppl.1) : 35-49.
D.P.P.I.<br />
Le jet-ski<br />
Loisir d’été au bord<br />
des plages, décliné<br />
en <strong>sport</strong> à part entière,<br />
le jet-ski fait désormais<br />
partie <strong>du</strong> paysage<br />
des bords de mers,<br />
pour le meilleur<br />
et pour le pire…<br />
Pour le meilleur,car cette discipline<br />
est devenue un <strong>sport</strong> spectaculaire<br />
et très physique où s’affrontent<br />
des stars comme Nicolas Rius, Jeff<br />
Jacobs, Christopher Fischetti, Chris<br />
Mc Clugage, Franky Zapata ou la<br />
Française Karine Paturel, championne<br />
<strong>du</strong> Monde de vitesse.<br />
Mais aussi,malheureusement,pour le pire<br />
puisqu’il ne se passe pas un été sans que<br />
les faits divers ne rapportent un accident<br />
entre un jet-ski et un baigneur ou entre<br />
deux jet-skis.<br />
UN SPORT À RISQUE ?<br />
Difficile de savoir si le jet-ski est un<br />
<strong>sport</strong> à risque, puisqu’il n’existe pas<br />
encore de statistiques fiables.Il est toutefois<br />
évident qu’une collision entre<br />
deux jets peut entraîner une traumatologie<br />
grave,en fonction de la vitesse,<br />
<strong>du</strong> choc et des protections portées,ou<br />
non, par les “jet-skieurs”.<br />
Citons,ainsi,des fractures au niveau des<br />
membres inférieurs,des poig<strong>net</strong>s et des<br />
traumatismes crâniens, recensés après<br />
hospitalisations.Ces données,très fragmentaires<br />
et confidentielles, proviennent<br />
d’un CHU d’Aquitaine qui, par<br />
manque de recul et d’études quantifiées,ne<br />
souhaite pas se prononcer sur<br />
la spécificité <strong>du</strong> jet-ski.<br />
Seule certitude, un heurt violent entre<br />
deux machines peut avoir des conséquences<br />
dramatiques.A titre d’exemple,<br />
l’année dernière, une jeune femme de<br />
25 ans a été mortellement blessée lors<br />
d’un télescopage entre deux jet-skis sur<br />
la base nautique de Pompoint dans<br />
l’Oise. La victime, qui pilotait l’un des<br />
deux engins,a été tuée sur le coup.Pour<br />
une raison indéterminée, la jeune<br />
femme a fait une fausse manœuvre et<br />
coupé la route à l’autre jet-ski…<br />
Heureusement rare,ce type d’accident<br />
doit aussi rappeler l’enjeu <strong>du</strong> pilotage<br />
d’un engin aussi puissant.<br />
MÉDECINS DU SPORT 23 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE<br />
Mots clés<br />
Jet-ski<br />
Sécurité<br />
Législation maritime<br />
UN SPORT PHYSIQUE ?<br />
Pour une professionnelle comme Karine<br />
Paturel, la pratique <strong>du</strong> jet-ski s’accompagne<br />
en effet d’une préparation physique<br />
intense. Elle pratique quotidiennement<br />
1 h 30 de vélo ou de footing,<br />
30 minutes d’abdominaux,50 pompes et<br />
environ 20 tractions. Elle pratique en<br />
outre le kayak (trois fois par semaine),la<br />
corde à sauter,30 minutes à taper sur un<br />
sac de sable et,l’hiver,le motocross pour<br />
muscler les bras.<br />
« Si l’on respecte les règles de sécurité,<br />
assure un pratiquant assi<strong>du</strong>,le jet-ski n’est<br />
pas dangereux.Le plus gros risque reste<br />
celui des collisions entre nous, car nos<br />
machines montent jusqu’à 110 km/h. Il<br />
faut être vigilant et nous nous montrons<br />
suffisamment prudents pour éviter les<br />
accidents. »<br />
“JET-SKIEURS”<br />
SAUVETEURS ?<br />
Souvent considérés comme potentiellement<br />
dangereux,ces véhicules nautiques<br />
Découverte d’un <strong>sport</strong><br />
Découverte d’un <strong>sport</strong>
Découverte d’un <strong>sport</strong><br />
Découverte d’un <strong>sport</strong><br />
sont, paradoxalement, en train de révolutionner<br />
le sauvetage en mer.Toutefois,<br />
l’apparition des premiers jets biplaces ne<br />
datant que de 1988,leur développement<br />
au sein des postes de secours en France<br />
n’en est encore qu’au premier stade.Bien<br />
moins imposant qu’un zodiac,il est beaucoup<br />
plus maniable et surtout beaucoup<br />
plus malléable dans les vagues.Motorisé<br />
par une turbine,le jet-ski ne possède pas<br />
d’hélices, ce qui est un atout majeur au<br />
niveau de la sécurité;les sauveteurs peuvent<br />
donc plus facilement s’aventurer<br />
dans la zone de bain.<br />
QUI PRATIQUE ?<br />
DANS QUELLES<br />
CONDITIONS ?<br />
D’après une étude diffusée sur Inter<strong>net</strong><br />
et réalisée par Strat’Expo, organisateur<br />
d’événements,en partenariat avec la Fédération<br />
française motonautique (FFM),<br />
le jet-ski est en progression constante<br />
avec 17 % de vente d’engins par an. « La<br />
tendance, explique l’étude, est de voir<br />
des pilotes de plus en plus jeunes. »<br />
Les pratiquants français seraient ainsi environ<br />
30 000, dont 7 000 licenciés à la<br />
FFM, contre 300 000 aux Etats-Unis.<br />
Les spots sont situés à 60 % en mer (Méditerranée/Atlantique)<br />
à 40 % en eaux intérieures<br />
(lacs/rivières).Environ 60 % des<br />
amateurs pratiquent le jet dans les<br />
quelque 150 clubs (dont 90 affiliés FFM).<br />
Les compétiteurs sont des <strong>sport</strong>ifs<br />
(hommes : 85 % ; femmes : 15 %), âgés<br />
entre 16 et 35 ans,ayant pratiqué la moto,<br />
le kart, la voiture (tout terrain-rallye) ou<br />
le bateau.<br />
Environ 2 000 licenciés FFM participent<br />
aux épreuves nationales et régionales de<br />
vitesse,d’en<strong>du</strong>rance ou de offshore (type<br />
Tour de Corse, Oléron).<br />
Le jet-skieur “plaisancier” est plutôt un<br />
cadre moyen supérieur (hommes :80 % ;<br />
femmes:20 %) qui s’adonne à son hobby<br />
plutôt le week-end et l’été. Enfin, 60 %<br />
d’entre-eux sont inscrits dans des clubs.<br />
JET-SKI, SEA-DOO,<br />
MOTOMARINE<br />
OU MARINE JET ?<br />
Tout commence en 1968,lorsque la firme<br />
canadienne Bombardier invente la motomarine<br />
en créant la première Sea-doo.<br />
Kawasaki lui emboîte le pas quelques<br />
années plus tard en imposant le concept<br />
<strong>du</strong> jet à bras ou stand-up sous l’appella-<br />
tion de “Jet-ski”. Un terme devenu aujourd’hui<br />
générique mais qui recouvre<br />
en fait deux types de véhicules : les jets<br />
à bras et les jets assis (runabout). Dans<br />
les années quatre-vingt,Yamaha entre en<br />
lice avec ses Marinejet devenus depuis<br />
Waverunner,puis Polaris tente sa chance<br />
alors qu’Artic cat échoue avec ses Tigershark.<br />
Aujourd’hui, Bombardier est le chef de<br />
file de l’in<strong>du</strong>strie.Mais,comme pour tout<br />
<strong>sport</strong> à moteur, les constructeurs sont<br />
rois et imposent leurs vues. C’est notamment<br />
le cas <strong>du</strong> Japonais Honda,avec<br />
son Aquatrax,qui rend bientôt obsolètes<br />
ces technologies en intro<strong>du</strong>isant le moteur<br />
quatre-temps dans les motomarines.<br />
Yamaha (FX140) et maintenant Bombardier<br />
(Fourtech) lui ont emboîté le pas.<br />
Parallèlement les carènes évoluent aussi,<br />
les coques s’allongent. On distingue désormais<br />
des machines de type moto et<br />
des embarcations plus orientées vers la<br />
plaisance et la randonnée (triplaces,<br />
quatre places pour le Genesis et le SUV,<br />
cinq places pour le LRV).Les modèles ont<br />
aussi de la puissance : en 1992 la norme<br />
des moteurs était de 650 cm 3 de 60HP,<br />
aujourd’hui les 1 000 cc et 1 200 cc de<br />
130HP et plus apparaissent.<br />
Les nuisances sonores, véritables plaies<br />
des vacances à la plage, qui avaient tendance<br />
à suivre les courbes de puissance<br />
sont aujourd’hui l’objet des soins des<br />
fabricants:consommation en baisse avec<br />
les injections,bruits étouffés avec les systèmes<br />
de ré<strong>du</strong>ction sonore.Reste encore<br />
à trouver un moyen de ré<strong>du</strong>ire les émissions<br />
d’huile.<br />
S’ajoute à cela un changement de public;<br />
jusqu’ici,le jet,qui s’était développé par<br />
le biais de la compétition, s’oriente désormais<br />
vers le loisir.<br />
LÉGISLATION<br />
Le permis mer<br />
Tout engin flottant motorisé d’une puissance<br />
de plus de 6 chevaux est considéré<br />
comme un navire à propulsion mécanique<br />
et nécessite la détention d’un titre<br />
de navigation. Par conséquent, le jet-ski<br />
impose à son utilisateur de posséder au<br />
moins le permis mer,étant donné qu’un<br />
utilisateur de la carte mer reste limité à<br />
un moteur d’une puissance maximum de<br />
MÉDECINS DU SPORT 24 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
50 chevaux.De plus,si le jet est utilisé en<br />
mer,il doit être immatriculé et être armé<br />
comme un navire à propulsion mécanique<br />
de 5 e catégorie.<br />
La zone de navigation<br />
La navigation des véhicules nautiques à<br />
moteur est autorisée uniquement de jour.<br />
Elle s’exerce en deçà de deux miles nautiques,<br />
à compter de la limite des eaux,<br />
pour les engins sur lesquels le pilote se<br />
tient en position assise. Pour les engins<br />
sur lesquels le pilote se tient en équilibre<br />
dynamique, cette limite est de 1 mile.<br />
En règle générale,la vitesse maximum est<br />
de 5 nœuds dans la zone des 300 mètres.<br />
Un encadrement pour<br />
les plaisanciers<br />
La législation est très stricte, tant pour<br />
le pratiquant confirmé, licencié et titulaire<br />
des permis,que pour les débutants.<br />
Ainsi, avant de louer un jet, le vacancier<br />
doit suivre un cours d’initiation, accompagné<br />
par un moniteur titulaire d’un brevet<br />
de moniteur fédéral jet deuxième<br />
degré. En clair, la con<strong>du</strong>ite sans permis<br />
est autorisée avec un encadrement. Car,<br />
pour con<strong>du</strong>ire ces véhicules, il faut détenir<br />
un permis.Lors de la signature d’un
LES CHAMPIONS EN 2001<br />
Les meilleurs pilotes <strong>du</strong> Monde sont français :<br />
Nicolas RIUS (champion <strong>du</strong> Monde vitesse)<br />
Karine PATUREL (championne <strong>du</strong> Monde vitesse féminine)<br />
Jean-François MULTARI (champion <strong>du</strong> Monde offshore)<br />
Cyril LEMOINE (champion d’Europe vitesse)<br />
contrat de location,le locataire doit donc<br />
remplir une déclaration contresignée par<br />
le loueur,attestant de la possession d’un<br />
permis.<br />
La licence <strong>sport</strong>ive<br />
Pour être titulaire d’une licence <strong>sport</strong>ive<br />
délivrée par la Fédération française motonautique<br />
(FFM),il faut adhérer à un club<br />
affilié, être possesseur d’un permis de<br />
con<strong>du</strong>ire (vitesse, en<strong>du</strong>rance, offshore,<br />
free-style) ;un certificat médical est également<br />
nécessaire,ainsi qu’une fiche de<br />
contrôle médico-<strong>sport</strong>if à se procurer à<br />
la Fédération.<br />
Le port d’un gilet ou d’une brassière de<br />
sauvetage (de couleur vive) est obligatoire.<br />
En compétition,un casque de protection<br />
de la tête et de la mâchoire (30 % <strong>du</strong><br />
casque doit être peint en couleur vive<br />
orangé), un gilet de sauvetage, une combinaison<br />
intégrale ainsi qu’une protection<br />
dorsale et des jambières sont imposés.<br />
Les normes de sécurité<br />
Tous les véhicules doivent comporter un<br />
système d’arrêt automatique <strong>du</strong> moteur<br />
ou de mise en giration lente en cas de<br />
chute inopinée <strong>du</strong> pilote.Les hélices non<br />
entièrement carénées sont proscrites<br />
ainsi que les turbines non équipées d’une<br />
grille de protection. Chaque jet-ski doit<br />
comporter un compartiment étanche<br />
contenant deux feux automatiques à<br />
main et être équipé d’un anneau et d’un<br />
cordage permettant le remorquage. Le<br />
niveau sonore ne doit pas dépasser<br />
80 décibels A à 7,5 mètres. ■<br />
Cyril Hofstein<br />
MÉDECINS DU SPORT 25 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
D.P.P.I.<br />
EXPLOIT:<br />
La traversée de<br />
l’Atlantique en jet-ski!<br />
La première traversée<br />
de l’Atlantique en jet-ski<br />
a eu lieu fin juin, entre<br />
l’Espagne et la Floride.<br />
5200 miles nautiques<br />
en 117 jours: premier record<br />
à battre, détenu par<br />
le Comte Alvaro<br />
de Marichalar y Saenz<br />
de Tejada, un aristocrate<br />
espagnol âgé de 41 ans.<br />
En naviguant 14 h par jour<br />
(presque tout le temps<br />
debout), en dormant dans<br />
un canot de sauvetage<br />
équipé d’un système à<br />
ultrasons pour éloigner les<br />
requins, l’homme a pu,<br />
grâce à un navire de renfort<br />
qui l’a suivi, tran<strong>sport</strong>ant<br />
vivres et essence, relier<br />
Rome à Miami.<br />
Il a dédié son périple<br />
à la lutte contre<br />
la dépendance aux drogues.<br />
« Je veux montrer aux<br />
jeunes qu’à travers le <strong>sport</strong><br />
et l’aventure, ils peuvent<br />
réussir tout ce qu’ils<br />
veulent, sans drogue »,<br />
a-t-il déclaré.<br />
Pour en savoir plus<br />
Fédération Française Motonautique<br />
49 rue Boulainvilliers 75016 Paris<br />
Tél.: 01 42 24 60 88<br />
Fax: 01 42 24 60 13<br />
Site Inter<strong>net</strong><br />
www.ffm.free.fr<br />
Découverte d’un <strong>sport</strong><br />
Découverte d’un <strong>sport</strong>
Le conflit antérieur<br />
de hanche<br />
Physiopathologie, imagerie<br />
et implications thérapeutiques<br />
Les adeptes de certains<br />
<strong>sport</strong>s comme les arts<br />
martiaux, la boxe<br />
française, le foot,<br />
la danse… ne sont pas<br />
à l’abri de l’apparition<br />
d’un conflit antérieur<br />
de hanche. Afin d’éviter<br />
les conséquences<br />
handicapantes pouvant<br />
aboutir à une prothèse<br />
de hanche, la prévention<br />
et le dépistage de<br />
cette pathologie<br />
prennent une importance<br />
considérable.<br />
Pendant de nombreuses années,les orthopédistes<br />
se sont intéressés à la<br />
hanche d’une manière statique.Tous<br />
les calculs de coxométrie se faisaient sur une<br />
radiographie de face debout et sur le fameux<br />
faux profil de Lequesne.Depuis quelques<br />
années,il a fallu se rendre à l’évidence que<br />
pour comprendre certaines coxarthroses,il<br />
fallait intro<strong>du</strong>ire la notion de mouvement.<br />
La notion de conflit dans l’articulation<br />
de la hanche est donc une notion nouvelle<br />
qui découle de cette nouvelle façon<br />
d’aborder le problème.Ce conflit n’existe<br />
que dans les mouvements extrêmes.Il est<br />
pourtant suffisamment fréquent pour,<br />
semble-t-il, être à l’origine d’un nombre<br />
très important de coxarthroses précoces.<br />
PHYSIOPATHOLOGIE<br />
DES LÉSIONS<br />
On peut considérer qu’il existe 2 types<br />
de conflit antérieur de hanche.<br />
Conflit avec effet came (Fig. 1)<br />
La tête <strong>du</strong> fémur n’est pas parfaitement<br />
ronde et, à sa partie antérieure, il existe<br />
une augmentation <strong>du</strong> rayon de courbure<br />
de la tête <strong>du</strong> fémur. Il existe donc une<br />
bosse et un méplat à la jonction tête col<br />
qui vient,en flexion de hanche,créer une<br />
zone d’hyperpression localisée sur le cartilage<br />
de la paroi antérieure <strong>du</strong> cotyle.<br />
Ce mouvement répété va être à l’origine<br />
d’une délamination <strong>du</strong> cartilage antéroexterne<br />
<strong>du</strong> cotyle. Celle-ci peut s’accompagner<br />
d’un kyste <strong>du</strong> bourrelet ou<br />
d’un kyste intra-osseux.<br />
Sur le fémur, il existe une irritation <strong>du</strong><br />
cartilage au niveau de la tuméfaction qui<br />
peut,à la longue,devenir un ostéophyte.<br />
Les lésions <strong>du</strong> bourrelet ne surviennent<br />
qu’après et témoignent déjà de lésions<br />
avancées.Il est important de bien se souvenir<br />
qu’au début de l’évolution, tout le<br />
dôme <strong>du</strong> fémur et la majeure partie <strong>du</strong><br />
cartilage <strong>du</strong> cotyle sont intacts.<br />
MÉDECINS DU SPORT 27 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
1a<br />
Figure 1a : il existe à la face antérieure de la<br />
tête <strong>du</strong> fémur, à la jonction tête col, une<br />
"bosse" (en rouge ici) qui va entraîner en<br />
flexion de hanche une hyperpression sur le<br />
cartilage <strong>du</strong> cotyle. Cette hyperpression<br />
localisée va entraîner des lésions <strong>du</strong> cartilage<br />
d’abord à l’intérieur <strong>du</strong> cotyle puis sur le<br />
cartilage recouvrant la “bosse”. En principe<br />
le bourelet n’est pas lésé.<br />
La “bosse” qui est à l’origine <strong>du</strong> problème<br />
n’est pas un ostéophyte mais une<br />
véritable dysplasie de la tête fémorale.<br />
Les ostéophytes ne vont survenir<br />
qu’après et majorer le conflit.<br />
La lésion de la partie antérieure <strong>du</strong> cartilage<br />
va ensuite s’aggraver, la tête <strong>du</strong><br />
fémur se subluxe, puis les signes d’arthrose<br />
se précisent.<br />
Figure 1b : les lésions <strong>du</strong> cartilage<br />
intéressent la partie antérieure <strong>du</strong> cotyle<br />
et le cartilage recouvrant la "bosse" sur le<br />
fémur. Dans le cotyle, les lésions débutent<br />
par une chondromalacie puis par une<br />
délamination <strong>du</strong> cartilage. Une fois, le<br />
cartilage délaminé, des kystes synoviaux<br />
peuvent se développer. Ils sont bien<br />
visibles sur le faux profil et sur l’IRM.<br />
* Clinique des Lilas, Les Lilas.<br />
Drs Frédéric Laude*<br />
et Philippe Paillard*<br />
Mots clés<br />
Hanche<br />
Imagerie<br />
Col <strong>du</strong> fémur<br />
Arthrose<br />
Figure 1c : des ostéophytes peuvent se<br />
développer sur la zone d’irritation<br />
cotyloïdienne et fémorale et aggraver le<br />
conflit avant d’enraidir la hanche<br />
principalement en rotation. Le conflit ne naît<br />
pas des ostéophytes mais de l’irrégularité de<br />
sphéricité de la tête <strong>du</strong> fémur. Les<br />
ostéophytes ne surviendront qu’après.<br />
1b<br />
1c<br />
Mise au point<br />
Mise au point
Mise au point<br />
Mise au point<br />
L’évolution finale est une coxarthrose<br />
avec pincement polaire supérieur et une<br />
subluxation antérieure bien visible sur le<br />
faux profil de Lequesne.<br />
Conflit avec effet tenaille (Fig. 2)<br />
La tête <strong>du</strong> fémur est bien ronde et c’est<br />
le col <strong>du</strong> fémur qui vient, en fin de<br />
flexion, buter sur le labrum. Il n’y a pas,<br />
dans la forme pure, d’hyperpression sur<br />
la partie antérieure <strong>du</strong> cartilage et c’est<br />
le labrum qui est le premier atteint.<br />
Durant la flexion de hanche, il peut se<br />
pro<strong>du</strong>ire une décoaptation de la partie<br />
la plus postérieure de l’articulation.<br />
Quand la hanche revient en extension,<br />
la tête <strong>du</strong> fémur vient “taper” contre la<br />
paroi postérieure <strong>du</strong> cotyle à l’origine de<br />
lésion localisée <strong>du</strong> cartilage.<br />
Il existe aussi une irritation <strong>du</strong> cartilage<br />
à la jonction tête col.<br />
Cette forme de conflit est moins grave que<br />
le conflit par effet came.Les lésions <strong>du</strong> cartilage,<br />
à la partie antérieure <strong>du</strong> cotyle, ne<br />
vont apparaître que lorsque les ostéophytes<br />
<strong>du</strong> col <strong>du</strong> fémur vont,à leur tour,apparaître<br />
et simuler un conflit par effet came !<br />
Dans la forme la plus pure, ce type de<br />
conflit va donner une arthrose postérieure<br />
avec, sur le faux profil de Lequesne, un<br />
amincissement <strong>du</strong> cartilage et des ostéophytes<br />
sur la corne postérieure <strong>du</strong> cotyle.<br />
Ces 2 types de conflit sont souvent associés<br />
chez un même indivi<strong>du</strong>.Dans certaines<br />
zones c’est l’effet came qui prédomine,<br />
dans d’autres c’est l’effet tenaille…<br />
Si l’absence de sillon à la face antérieure<br />
<strong>du</strong> col est à l’origine de la plupart des<br />
conflits, l’existence d’une rétroversion<br />
de la partie supérieure <strong>du</strong> cotyle est aussi<br />
un facteur déclenchant.<br />
En principe, le cotyle humain regarde<br />
en avant d’environ 25°. Dans certains<br />
cas,l’ouverture de la cavité est modifiée<br />
et,à la partie supérieure principalement,<br />
il peut regarder en bas et en arrière.<br />
Cette paroi, trop couvrante, va logiquement<br />
favoriser une limitation de la<br />
flexion de hanche et contribue à l’apparition<br />
<strong>du</strong> conflit antérieur.<br />
Chez bon nombre de patients, il existe<br />
à la fois une absence de sillon à la jonction<br />
tête col et une rétroversion <strong>du</strong> cotyle.Ces<br />
patients vont,bien sûr,être les<br />
meilleurs candidats au conflit antérieur,<br />
surtout s’ils pratiquent un <strong>sport</strong> à risque.<br />
C’est le terrain privilégié de la coxarthrose<br />
précoce (avant 40 ans).<br />
PRÉSENTATION CLINIQUE<br />
Il s’agit très souvent de patients jeunes,<br />
qui pratiquent des <strong>sport</strong>s à pivot,où l’articulation<br />
est soumise à de grandes amplitudes<br />
en flexion, assez violents (arts<br />
martiaux surtout,football,danse,rugby…)<br />
Les douleurs ne vont d’abord survenir<br />
qu’après des efforts violents et prolongés.Cette<br />
douleur débute assez souvent<br />
au niveau <strong>du</strong> grand trochanter, des ad<strong>du</strong>cteurs.<br />
Beaucoup de patients suivis pour des<br />
problèmes d’ad<strong>du</strong>cteur ont, en fait, un<br />
conflit antérieur de hanche.La douleur<br />
va devenir de plus en plus fréquente.La<br />
marche simple n’est, en général, pas<br />
Figure 2 : la tête <strong>du</strong> fémur est bien ronde. Dans les mouvements extrêmes, le col <strong>du</strong> fémur<br />
vient buter violemment sur la partie antérieure <strong>du</strong> cotyle et écrase le bourrelet cotyloïdien.<br />
La tête peut se décoapter en hyperflexion et lors de la remise en extension de la hanche,<br />
entraîner des lésions par "contre coup" sur la paroi postérieure <strong>du</strong> cotyle ou sur la tête <strong>du</strong><br />
fémur. Les lésions cartilagineuses sont moins sérieuses que dans le conflit par effet came.<br />
MÉDECINS DU SPORT 28 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
2<br />
pénible.Beaucoup de patients sont plus<br />
gênés en position assise,sur des chaises<br />
basses par exemple,où la hanche est en<br />
grande flexion. L’existence de craquements,<br />
de pseudo-blocages et de dérobements<br />
est habituelle.<br />
L’examen simple de la hanche est proche<br />
de la normale. Il faut cependant noter<br />
que,dans la plupart des cas, il existe<br />
une diminution importante de la rotation<br />
interne de hanche en extension<br />
et plus particulièrement en<br />
flexion. Dans le cas le plus caricatural,<br />
la simple flexion de hanche impose la<br />
mise en rotation externe.<br />
On retrouve toujours, ou presque, une<br />
douleur inguinale provoquée en ad<strong>du</strong>ction,<br />
flexion et rotation interne sur<br />
un patient en décubitus dorsal.Ceci tra<strong>du</strong>it,le<br />
plus souvent,des lésions de la paroi<br />
antérieure <strong>du</strong> cotyle ou une lésion <strong>du</strong><br />
bourrelet.<br />
On retrouve assez souvent une douleur<br />
postérieure en extension rotation<br />
externe l’autre hanche étant fléchie.Ceci<br />
peut tra<strong>du</strong>ire soit une instabilité de<br />
hanche, soit une lésion postérieure <strong>du</strong><br />
cotyle.<br />
EXAMEN RADIOLOGIQUE<br />
Fait important,l’interprétation classique<br />
des radiographies est normale au stade<br />
de la forme débutante.<br />
Il n’existe pas,en tout cas initialement,de<br />
modification de l’interligne,de géodes importantes<br />
et de condensation localisée.<br />
Le scanner,l’arthroscanner et l’IRM sont<br />
le plus souvent sans particularité notable.<br />
Tout au plus peut-on avoir,dans les formes<br />
avancées, un doute sur une lésion <strong>du</strong> labrum<br />
à l’IRM.<br />
Eclairé par la compréhension <strong>du</strong> mécanisme,<br />
l’examen des radiographies standard<br />
peut cependant mettre en évidence<br />
un conflit antérieur.<br />
Cliché de face<br />
Sur la radio de face,on cherche une tête<br />
pas tout à fait ronde (Fig. 3a). La forme<br />
la plus caricaturale étant la “tête phallique<br />
de Mathieu”(que les Anglo-saxons<br />
appellent “crosse de revolver”).L’offset,<br />
(2) c’est-à-dire le ratio entre largeur <strong>du</strong><br />
col et taille de la tête <strong>du</strong> fémur, est souvent<br />
peu important.Tout cela peut donner<br />
une fausse impression de dysplasie
3a<br />
Figure 3a : radiographie de face d’un conflit<br />
antérieur caricatural. La paroi antérieure (en<br />
rouge) et la paroi postérieure (en vert) se<br />
superposent. Il existe donc une rétroversion<br />
<strong>du</strong> cotyle. On voit (flèche jaune) la “bosse”<br />
même sur cette incidence de face ce qui n’est<br />
pas toujours le cas. Il existe (flèche jaune<br />
supérieure) des remaniements de l’os avec<br />
une petite image ronde signant l’existence<br />
d’un petit kyste synovial intra-osseux. La<br />
flèche bleue montre un petit kyste de la<br />
paroi antéro-externe <strong>du</strong> cotyle.<br />
cotyloïdienne.En réalité,c’est la tête <strong>du</strong><br />
fémur qui est trop grosse par rapport<br />
au cotyle.L’existence d’une coxa vara est<br />
aussi un facteur favorisant le conflit.<br />
On recherche une ébauche d’ostéophyte<br />
sur la partie externe de la tête. On peut<br />
distinguer, sur le col de face, une ligne<br />
qui correspond à la jonction tête/col<br />
beaucoup trop bas.L’existence d’un kyste<br />
dans le col <strong>du</strong> fémur est un excellent argument<br />
en faveur <strong>du</strong> conflit.<br />
Rétroversion <strong>du</strong> cotyle<br />
C’est surtout sur ce cliché de face que l’on<br />
va rechercher la rétroversion <strong>du</strong> cotyle.<br />
En principe, sur un cliché fait en position<br />
debout la paroi antérieure est toujours<br />
en dedans de la paroi postérieure.<br />
A aucun moment elle ne croise la paroi<br />
postérieure. Elle ne se rencontre qu’au<br />
bord externe <strong>du</strong> toit <strong>du</strong> cotyle.En cas de<br />
rétroversion de la partie supérieure <strong>du</strong> cotyle,<br />
la paroi antérieure est en dehors de<br />
la paroi postérieure et la croise en son milieu.<br />
Si ce signe existe, on peut parler de<br />
rétroversion <strong>du</strong> cotyle.Pour que ce cliché<br />
soit interprétable,il doit être fait debout.<br />
À un stade plus avancé, les signes classiques<br />
d’arthrose apparaissent.<br />
Faux profil de Lequesne<br />
Le faux profil de Lequesne n’est pas inutile.<br />
Il permet juste de rechercher une<br />
dysplasie modérée ou éventuellement<br />
une fausse dysplasie par trop grosse tête.<br />
Il permet cependant de bien analyser<br />
la paroi postérieure <strong>du</strong> cotyle et l’on<br />
recherche un amincissement <strong>du</strong> cartilage<br />
ou un ostéophyte de traction sur<br />
la corne postérieure <strong>du</strong> cotyle. On<br />
recherche un petit kyste juste au-dessus<br />
de la paroi antérieure <strong>du</strong> cotyle. Celuici<br />
apparaît juste au niveau de la zone de<br />
conflit. Ce n’est pas sur ce cliché que<br />
l’on va rechercher les modifications anatomiques<br />
sur le fémur.<br />
Profil chirurgical pied en rotation<br />
interne<br />
Le profil chirurgical pied en rotation<br />
interne maximum est finalement plus intéressant<br />
(Fig. 3b). Il met en évidence<br />
l’absence de sillon à la face antérieure<br />
<strong>du</strong> col et montre souvent la tuméfaction<br />
ou l’augmentation <strong>du</strong> rayon de courbure<br />
de la tête <strong>du</strong> fémur à la jonction tête/col.<br />
Il permet parfaitement de voir une épiphysiolyse<br />
a minima. On estime sur ce<br />
cliché la rétroversion <strong>du</strong> fémur qui est<br />
un facteur de conflit.<br />
Scanner<br />
Le scanner n’est pas très intéressant. Il<br />
va,dans notre expérience,ne servir qu’à<br />
calculer les troubles de torsion <strong>du</strong><br />
membre inférieur. La mise en évidence<br />
de l’antéversion <strong>du</strong> fémur est classique.<br />
Le calcul de l’antéversion <strong>du</strong> cotyle ne<br />
doit pas se faire, comme le font la plupart<br />
des radiologues,à l’endroit ou la tête<br />
<strong>du</strong> fémur est la plus grosse, mais uniquement<br />
dans la zone <strong>du</strong> conflit,c’est-àdire<br />
dans les coupes les plus hautes.<br />
IRM<br />
L’IRM (Fig.4) fournit des renseignements<br />
beaucoup plus pro<strong>du</strong>ctifs.Il doit être fait,<br />
si possible,sur une machine de 1,5 tesla.<br />
Les coupes sont très particulières.Il s’agit<br />
de coupes radiaires qui se font dans le<br />
plan <strong>du</strong> cotyle.<br />
Figure 3b : radiographie de profil. On voit très bien la<br />
“bosse” antérieure. On voit aussi un petit pincement<br />
postérieur avec un ostéophyte débutant. On<br />
distingue (flèche bleue) les petites lésions kystiques<br />
de la paroi antérieure <strong>du</strong> cotyle. Pas de pincement de<br />
l’interligne supérieur.<br />
MÉDECINS DU SPORT 29 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
ArthroIRM<br />
L’arthroIRM [3] est l’examen qui permet<br />
d’analyser encore mieux le cartilage, le<br />
labrum, la partie antérieure <strong>du</strong> cotyle<br />
et les réactions osseuses dans le fémur<br />
à la jonction tête col.Dans certains cas,<br />
on trouve des hernies kystiques (pit herniary)<br />
juste sur cette zone.<br />
Les lésions <strong>du</strong> labrum sont très bien analysées<br />
sur les coupes IRM.Elles se situent,<br />
dans 90 % des cas, sur la partie antéroexterne<br />
<strong>du</strong> cotyle, c’est dire juste sur<br />
la zone <strong>du</strong> conflit. Dans un très grand<br />
nombre de cas, on ne retrouve aucune<br />
lésion <strong>du</strong> bourrelet.On voit juste des modifications<br />
<strong>du</strong> signal au niveau de l’os<br />
sous-chondral,en regard <strong>du</strong> cartilage antéro-supérieur.<br />
PROPOSITIONS<br />
THÉRAPEUTIQUES<br />
ET PREMIERS RÉSULTATS<br />
Si les lésions sont déjà trop avancées, il<br />
n’y a pas grand-chose à faire. En cas de<br />
pincement sérieux de l’interligne,de subluxation<br />
de la tête sur le faux profil de<br />
Lequesne, il faut savoir mettre en place<br />
le traitement médical classique d’une<br />
coxarthrose.<br />
La prothèse de hanche n’est plus très<br />
loin…<br />
Figure 4 : image IRM. On voit sur le<br />
cliché de profil la tuméfaction. Le<br />
cliché d’IRM dans la même position<br />
montre bien les lésions et surtout<br />
l’atteinte de la partie antéro-externe<br />
<strong>du</strong> cotyle.<br />
Mise au point<br />
Mise au point<br />
3b 4
Mise au point<br />
Mise au point<br />
Traitement chirurgical conservateur<br />
S’il n’existe pas de lésion évidente <strong>du</strong> cartilage,<br />
c’est-à-dire si la hauteur de l’interligne<br />
n’est pas modifiée sur les différentes<br />
incidences, on peut envisager un<br />
traitement chirurgical conservateur (Fig.5<br />
a, b c).<br />
Ce passage à la chirurgie ne s’envisage,<br />
bien sûr, qu’avec des patients motivés,<br />
douloureux dans leur pratique <strong>sport</strong>ive<br />
ou dans la vie de tous les jours. Il faut<br />
savoir que, sauf arrêt complet <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
incriminé, les lésions n’ont aucune<br />
tendance à guérir spontanément. L’aggravation<br />
est la règle et con<strong>du</strong>it de manière<br />
inéluctable à l’arthrose de hanche.<br />
La seule amélioration temporaire que l’on<br />
peut observer passe par l’apparition<br />
d’ostéophytes qui vont entraîner une di-<br />
5a<br />
minution des mobilités de la hanche.<br />
Celle-ci va apporter un soulagement temporaire<br />
par diminution de l’irritation de<br />
la zone conflictuelle.<br />
Chirurgicalement il faut faire disparaître<br />
le conflit soit en créant un sillon à la jonction<br />
tête/col, soit diminuer la rétroversion<br />
<strong>du</strong> cotyle.<br />
La technique de Ganz<br />
Cette chirurgie a été développée en<br />
Suisse à Berne par Reinhold Ganz. Nous<br />
avons proposé un geste chirurgical un<br />
peu moins invasif qui semble intéressant<br />
dans les cas où les modifications morphologiques<br />
ne sont pas majeures.<br />
Ganz, qui a tout particulièrement bien<br />
étudié la vascularisation de l’épiphyse<br />
fémorale, a proposé une nouvelle voie<br />
MÉDECINS DU SPORT 30 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
5b<br />
5c<br />
Figure 5a : jeune footballeur de 24 ans.<br />
Le conflit est déjà beaucoup plus franc avec<br />
des signes de dégénérescence. Il existe un<br />
début d’ostéophyte très <strong>net</strong>. Le patient se<br />
plaint en plus d’un ressaut très douloureux<br />
avec pseudoblocage. La rétroversion <strong>du</strong><br />
cotyle est franche avec un signe <strong>du</strong><br />
croisement des 2 parois antérieure et<br />
postérieure.<br />
Figure 5b : <strong>du</strong>rant l’intervention, on retrouve<br />
une superbe “bosse” de conflit. Il existe un<br />
méplat (flèches vertes) à la jonction tête col<br />
qui vient buter dans l'articulation en fin de<br />
mouvement à l'origine des lésions articulaires<br />
cotyloïdiennes. Comme on peut le voir,<br />
il s'agit bien de cartilage et non d'un<br />
ostéophyte. Au niveau de la flèche bleue,<br />
le cartilage commence à souffrir et finira par<br />
donner un ostéophyte. On va réséquer toute<br />
cette bosse sur environ 1 centimètre et donc<br />
faire disparaître le conflit.<br />
Figure 5c : radio post-opératoire. Disparition<br />
de la bosse et des ostéophytes. Les 2 vis<br />
servent à maintenir la trochantérotomie<br />
digastrique qui permet d’exposer<br />
l’articulation sans compromettre la<br />
vascularisation de la hanche.<br />
La notion<br />
de conflit antérieur<br />
repose sur un faisceau<br />
d’arguments<br />
● Clinique<br />
Diminution de la rotation interne<br />
Douleur inguinale et exacerbation<br />
en flexion ad<strong>du</strong>ction et rotation<br />
interne<br />
● Sur la radio de face<br />
Tête phallique<br />
Absence d’offset<br />
Coxa vara<br />
Rétroversion <strong>du</strong> cotyle<br />
● Sur le profil chirurgical<br />
Méplat à la jonction tête/col voire tuméfaction<br />
● Scanner<br />
Rétroversion de la partie supérieure<br />
<strong>du</strong> cotyle<br />
Faible antéversion <strong>du</strong> fémur<br />
● IRM<br />
Modification de signal sur le col <strong>du</strong><br />
fémur à la jonction tête col<br />
Lésion <strong>du</strong> bourrelet<br />
Modification <strong>du</strong> signal de l’os souschondral<br />
sur la partie antérieure <strong>du</strong><br />
cotyle ou sur la corne postérieure.
d’abord qui permet d’ouvrir et de luxer<br />
l’articulation de la hanche sans compromettre<br />
sa vascularisation. [4] Il devient<br />
alors possible de bien voir les “dégâts”<br />
et de traiter la cause <strong>du</strong> conflit.<br />
On peut donc, sans aucun danger, pratiquer<br />
l’ablation de la tuméfaction à la<br />
jonction col/tête, mais aussi des ostéophytes<br />
qui peuvent s’être formés sur<br />
la zone irritée.<br />
Si la paroi antérieure est trop couvrante,<br />
on peut en pratiquer une exérèse partielle.<br />
Il n’est pas rare qu’il existe une<br />
ossification localisée <strong>du</strong> bourrelet et l’on<br />
peut alors l’exciser.<br />
Les dégâts cartilagineux seront notés et<br />
les gros clapets régularisés.Nous avons<br />
essayé, en cas de lésions importantes<br />
chez des sujets jeunes, de faire des<br />
greffes de cartilage selon la technique<br />
de la “Mosaïc plasty”,mais nous n’avons<br />
pas assez de recul et de cas pour en<br />
parler sérieusement.<br />
Voie d’abord<br />
Dans les cas simples, nous n’utilisons<br />
pas la voie de Ganz pour explorer l’articulation.<br />
Une petite voie d’abord antérieure<br />
de 3 ou 4 centimètres associée<br />
à une aide arthroscopique nous permet<br />
de traiter la grande majorité des<br />
lésions avec des suites très simples.L’inconvénient<br />
de la voie de Ganz est de sectionner<br />
une partie <strong>du</strong> grand trochanter<br />
et sa consolidation passe par une<br />
décharge de 6 semaines. C’est cependant<br />
une voie anatomique qui ne laisse<br />
aucune séquelle.<br />
Des résultats encourageants<br />
Les résultats de cette chirurgie sont très<br />
encourageants. Dans un récent symposium,<br />
[5] Ganz nous a présenté ses résultats.Il<br />
est important de noter que,sur<br />
plus de 400 hanches opérées avec luxation<br />
chirurgicale,aucun des patients n’a<br />
développé de nécrose de la tête fémorale.<br />
En ce qui concerne les douleurs,<br />
si l’on réserve cette chirurgie aux patients<br />
ayant un interligne conservé,<br />
l’amélioration ou la guérison est de 90 %.<br />
Bien sûr le recul est encore insuffisant<br />
(4 ans maximum),mais ces premiers résultats<br />
semblent confirmer la justesse<br />
des propositions physiopathologiques.<br />
Le problème des cas avancés<br />
S’il existe des dégâts cartilagineux avec<br />
un pincement de l’interligne, la qualité<br />
des résultats n’est plus la même.L’amélioration<br />
n’est que passagère, même si<br />
les patients sont en général satisfaits<br />
d’avoir retrouvé une meilleure mobilité<br />
de hanche. Dans ces cas avancés, les<br />
greffes de cartilages auront peut-être un<br />
intérêt.<br />
Ces résultats corroborent parfaitement<br />
ce que nous avons trouvé dans notre série.<br />
Ils nous permettent surtout d’insister<br />
sur la prévention et le dépistage de<br />
ce problème. C’est probablement à ce<br />
prix que l’on pourra éviter à des patients<br />
très jeunes de développer une coxarthrose<br />
donc la sanction finale est souvent<br />
une prothèse avant 40 ans.<br />
CONCLUSION<br />
Le conflit antérieur de hanche se caractérise<br />
par l’existence d’une zone de<br />
conflit entre la partie antéro-inférieure<br />
de la tête <strong>du</strong> fémur et la paroi antérieure<br />
<strong>du</strong> cotyle en flexion de hanche. Ce<br />
conflit entraîne des lésions cartilagineuses<br />
sur la partie antérieure <strong>du</strong> cotyle.<br />
L’évolution naturelle se fait vers<br />
la coxarthrose précoce à moyen ou long<br />
terme.<br />
Le diagnostic est principalement clinique<br />
devant l’existence d’une diminution<br />
de la rotation interne et l’existence<br />
d’une douleur en ad<strong>du</strong>ction,<br />
flexion,rotation interne.Les renseignements<br />
que fournissent les examens complémentaires<br />
sont souvent pauvres par<br />
méconnaissance de cette entité patho-<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
MÉDECINS DU SPORT 31 N°<strong>53</strong>-AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
logique, mais la radiographie standard<br />
(face et profil chirurgical) peut mettre<br />
en évidence des variations anatomiques<br />
intéressantes.<br />
L’IRM est l’examen complémentaire le<br />
plus intéressant, s’il est bien fait. Les<br />
coupes sont cependant un peu particulières.L’injection<br />
de gadolinium intraarticulaire<br />
augmente la précision de<br />
l’examen. Le scanner ou l’arthro scanner<br />
sont décevants et n’ont d’utilité que<br />
dans le calcul des mesures de torsion <strong>du</strong><br />
squelette <strong>du</strong> membre inférieur.<br />
Un traitement chirurgical conservateur,<br />
visant à faire disparaître le conflit,existe<br />
à un stade précoce. Il semble très efficace<br />
sur les douleurs et sur l’amélioration<br />
des mobilités.<br />
Ce traitement chirurgical est moins efficace<br />
en cas de pincement de l’interligne<br />
ou de subluxation antérieure.<br />
Des moyens de prévention devraient<br />
donc être mis en place.Il semble logique<br />
de faire passer le message auprès des fédérations<br />
<strong>sport</strong>ives. Les principaux<br />
<strong>sport</strong>s à risque sont les arts martiaux,la<br />
boxe française, le foot, la danse et les<br />
<strong>sport</strong>s où l’on exige des flexions extrêmes<br />
et répétées de la hanche. Chez<br />
les adeptes de ces <strong>sport</strong>s, l’existence<br />
d’une diminution de la rotation interne<br />
de hanche, une rétroversion <strong>du</strong> cotyle,<br />
une coxa-vara ou une absence d’antéversion<br />
<strong>du</strong> col <strong>du</strong> fémur favorisent l’apparition<br />
d’un conflit et donc à terme<br />
d’une coxarthrose précoce. ■<br />
1. Myers SR, Eijer H, Ganz R. Anterior femoroacetabular impingment<br />
after periacetabular osteotomy. Clin Orthop 1999; 363: 93-99.<br />
2. Eijer H, Leunig M, Mahomed MN, Ganz R. Cross-table lateral radiographs<br />
for screening of the anterior femoral head-neck offset in patient with<br />
femoro-acetabular impingment. Hip international 2001; 11 (1): 37-41.<br />
3. Ito K, Minka-II MA, Leunig M, Werlen S, Ganz R. Femoroacetabular<br />
impingement and the cam-effect. A MRI-Based quantitative anatomical<br />
study of the femoral head-neck offset. J Bone Joint Surg [Br] 83-B ; 2 :<br />
171-76.<br />
4. Ganz R, Gill TJ, Gautier E et al. Surgical dislocation of the a<strong>du</strong>lt hip. A<br />
technique with full access to the femoral head and acetabulum without<br />
the risk of avascular necrosis. J Bone Joint Surg [Br] 83-B; 8: 1119-24.<br />
5. Impingement and dysplasia of the hip. Internationnal Symposium.<br />
Berne, 17 au 17 janvier 2002.<br />
Mise au point<br />
Mise au point
19 E JOURNÉE RAPHAÉLOISE<br />
DE MÉDECINE, RHUMATOLOGIE<br />
ET TRAUMATOLOGIE SPORTIVE<br />
19 octobre 2002<br />
St Raphaël - Palais des congrès<br />
■ Thèmes<br />
Muscle, médicaments et <strong>sport</strong><br />
Technique d’électromyostimulation<br />
Pathologie des jumeaux<br />
Quand opérer une lésion musculaire chez le <strong>sport</strong>if?<br />
Traitement des fractures <strong>du</strong> scaphoïde carpien<br />
Les problèmes posés par la prise en charge <strong>du</strong> transplant lors de<br />
la chirurgie <strong>du</strong> LCA<br />
La chirurgie de l’instabilité <strong>du</strong> genou chez l’enfant (rotule, LCA)<br />
Pathologie discale lombaire chez le <strong>sport</strong>if<br />
Principe de réé<strong>du</strong>cation dans la lombalgie <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if<br />
Attitude pratique face à un traumatisme <strong>du</strong> rachis cervical<br />
Pathologie <strong>du</strong> grand trochanter<br />
Le <strong>sport</strong>if blessé, quand l’arrêter et comment le faire reprendre?<br />
La coiffe des rotateurs en 2002<br />
Aponévrosite plantaire<br />
■ Ateliers pratiques<br />
Examen programmé <strong>du</strong> genou<br />
Examen programmé de l’épaule<br />
Examen programmé <strong>du</strong> rachis cervical<br />
■ Renseignements<br />
Dr Fichez<br />
Place Coulet, St Raphaël<br />
Tél.: 04 94 19 50 50 - Fax: 04 94 19 50 51<br />
3 E JOURNÉE DE PATHOLOGIE<br />
DE L’ÉPAULE<br />
L’ÉPAULE DU SPORTIF<br />
11 octobre 2002<br />
Paris - espace St Martin<br />
■ Thèmes<br />
ÉPAULE TRAUMATIQUE RÉCENTE<br />
Bilan clinique de première intention<br />
Bilan d’imagerie initial, les signes à rechercher, les pièges à éviter<br />
Prise en charge médicale initiale<br />
CONDUITES À TENIR DEVANT<br />
Une entorse ou une disjonction acromio-claviculaire<br />
Une première luxation gléno-humérale antérieure<br />
Une instabilité antérieure chronique<br />
ÉPAULE MICROTRAUMATIQUE<br />
Epaule neurologique<br />
Arthropathie et arthrose acromio-claviculaire<br />
Pathologie de la coiffe des rotateurs, démembrement et prise en<br />
charge thérapeutique<br />
Isocinétisme et épaule: intérêt chez le <strong>sport</strong>if<br />
■ Table ronde<br />
L’épaule <strong>du</strong> joueur de tennis<br />
■ Renseignements<br />
Nukléus<br />
55 rue Bobillot, 75 013 Paris<br />
Tél.: 01 45 88 66 88 - Fax: 01 45 88 70 10<br />
Mail: contact@nukleus.fr<br />
F O R M A T I O N<br />
CAPACITÉ DE BIOLOGIE ET MÉDECINE DU SPORT<br />
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Durée : 1 an<br />
Date limite d’inscription : 30 septembre 2002<br />
Directeur de l’enseignement : Pr Jean-Michel Viton<br />
Coordinateur de l’enseignement : Dr Jean-Marie Coudreuse<br />
L’enseignement théorique est réparti sur 3 séminaires<br />
de 5 jours, soit un total de 120 heures d’enseignement.<br />
● 1er séminaire: 25-29 novembre 2002. Traumatologie aiguë<br />
et chronique des membres supérieurs et inférieurs…<br />
● 2e séminaire: 27-31 janvier 2003. Rachis, isocinétisme,<br />
physiologie, cardiologie, plongée, <strong>sport</strong> en altitude,<br />
technopathies, spécificité de la femme, <strong>du</strong> sujet âgé…<br />
● 3e séminaire: 24-28 mars 2003. Endocrinologie, biologie,<br />
nutrition, analyse <strong>du</strong> mouvement, pédiatrie <strong>du</strong> <strong>sport</strong>…<br />
L’enseignement pratique comporte 25 demi-journées.<br />
Parmi les thèmes abordés:<br />
● examens cliniques programmés,<br />
● techniques pratiques de réé<strong>du</strong>cation,<br />
● techniques d’immobilisation,<br />
● consultations de traumatologie <strong>du</strong> <strong>sport</strong>,<br />
● bilans isocinétiques,<br />
● VO2 max,<br />
● épreuves cardiologiques d’effort,<br />
● bilans diététiques…<br />
Les Stages sur le terrain peuvent être choisis en fonction<br />
<strong>du</strong> lieu de résidence.<br />
L’examen comporte :<br />
● une épreuve écrite de 2 heures (fin avril 2003),<br />
● une épreuve orale (qui peut être remplacée<br />
par la rédaction d’un mémoire).<br />
Renseignements<br />
JM COUDREUSE<br />
Service de médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong> - APHM<br />
A Delarque - JM Viton - JM Coudreuse<br />
Hôpital Salvator<br />
249, Bd Ste Marguerite<br />
13009 Marseille<br />
Tél. : 04 91 74 50 40<br />
Fax : 04 91 74 61 57<br />
Email : jean-marie.coudreuse@mail.ap-hm.fr<br />
MÉDECINS DU SPORT 33 N°<strong>53</strong> - AOÛT/SEPTEMBRE 2002<br />
Congrès / formation<br />
Congrès / formation