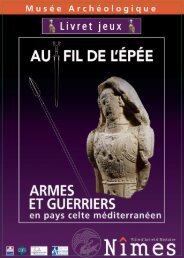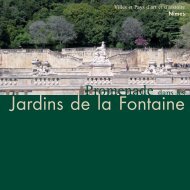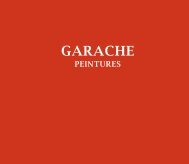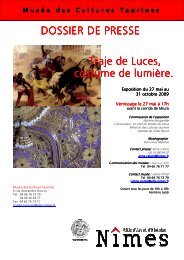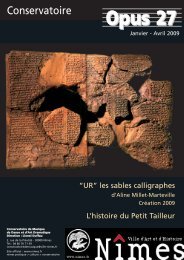MARJORIE ACCARIER EMILIE ASSEMAT HUBERT ... - Nîmes
MARJORIE ACCARIER EMILIE ASSEMAT HUBERT ... - Nîmes
MARJORIE ACCARIER EMILIE ASSEMAT HUBERT ... - Nîmes
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6<br />
L orsque<br />
l’on regarde une machine,<br />
on est tout de suite frappé par l’organisation<br />
des pièces. Y a-t-il dans cette<br />
organisation une idée de l’architecture?<br />
J’éprouve le désir de mettre l’esthétisme<br />
de la machine au même rang qu’un paysage<br />
urbain. Ma machine est une utopie,<br />
elle ne produit rien, sauf son visuel. Il y a<br />
aussi le désir de faire « rentrer » le spectateur<br />
dans mon œuvre, c’est pour cette<br />
raison qu’elle se veut grande et qu’elle<br />
s’intègre à la dimension du mur.<br />
J ’ai<br />
Par <strong>HUBERT</strong> BAUCHU<br />
enregistré le son d’un atelier de<br />
cordonnerie pour exprimer l’ambiance<br />
de ce lieu. Il y a beaucoup de sons,<br />
de bruits de machines, de pinceaux, de<br />
marteaux etc... Les spectateurs peuvent<br />
imaginer ce lieu par le son.<br />
L ’idée<br />
Par dONGKUN KIM<br />
Document de travail de Dongkun Kim<br />
de la durée est relative à<br />
chacun de nous... Nous l’établissons<br />
quand il s’agit du travail qui est<br />
planifié, calculé et qui s’organise en<br />
fonction de certains projets précis. Ces<br />
projets ont donc un temps «commun».<br />
J’ai voulu montrer deux temps de<br />
l’existence diamétralement opposés et<br />
VISITES AU FId<br />
Au coeur des<br />
choix artisti-<br />
ques du FID-<br />
Marseille ; le<br />
documentaire.<br />
Défendu comme<br />
un art du témoi-<br />
gnage sans critère de format, le festi-<br />
val présente des films et des artistes<br />
qui modifient les frontières du genre<br />
documentaire. Depuis trois années,<br />
un tournant décisif a été pris, celui<br />
d’accueillir au sein de la sélection officielle,<br />
des films de fiction aux côtés<br />
des films documentaires dans le<br />
même souci de fidélité au réel.<br />
En 2009, le FIDMarseille a présenté<br />
environ 140 films, pour la plupart des<br />
premières mondiales et internationales<br />
dans un programme dense comprenant<br />
sélection officielle, écrans<br />
parallèles, tables rondes...<br />
L’homme à la caméra<br />
de Dziga Vertov, 76’, 1929, Pologne.<br />
Ce film commence avec les images<br />
d’un orchestre qui se prépare, qui<br />
répète Des chaises vides se plient et<br />
se déplient. Cette séquence comme<br />
qui pourtant n’en font qu’un. La ville<br />
de <strong>Nîmes</strong> s’éveille, nous suivons les<br />
personnes dans leur travail, leur manoeuvres<br />
presque machinales s’opèrent<br />
(l’homme et la machine ne font qu’un,<br />
ils se complètent dans les efforts).<br />
Chacun a son métier, sa fonction, tout<br />
est organisé.<br />
prologue, donne le ton rythmique de<br />
l’ensemble du film. Avant que le film<br />
ne commence réellement, il règne un<br />
moment de silence et de suspense. Le<br />
film «démarre» quand les musiciens<br />
s’apprêtent à jouer.<br />
Les rues sont vides , les machines et<br />
les usines ne sont pas encore en route<br />
et petit à petit les gens partent au<br />
travail, vont et viennent, crescendo,<br />
comme dans une fourmilière.<br />
J’aime beaucoup le parallèle entre<br />
les images filmées par Dziga Vertov<br />
et celles qui le montre filmé par une<br />
personne qu’on ne voit pas.<br />
Le jeu des images, fondues les unes<br />
avec les autres peut donner l’impression<br />
qu’un parlement s’écroule ou<br />
que les rues se penchent sous le tumulte<br />
des passants. Le spectateur est<br />
entrainé dans une sorte de chevauchée<br />
fantastique au sein d’une ville en<br />
ébullition.<br />
Parallèlement aux mouvements des<br />
personnes qui partent au travail et<br />
qui participent aux activités humaines<br />
journalières, on voit une femme<br />
qui coupe des bandes filmiques et<br />
qui les recolle, leur donne vie dans<br />
Chaque jour, recommence le ballet des<br />
camions de nettoyage, l’ascension des<br />
voitures qui se dirigent hors du centre,<br />
les commerçants qui préparent leurs<br />
étals, les passants et les consommateurs<br />
qui vont et viennent...<br />
Puis nous entrons dans l’intimité de<br />
deux personnes qui ont décidé d’oublier<br />
un laboratoire. Le spectateur est entièrement<br />
inclus à l’intérieur de cette<br />
fabrication...<br />
Le plein pays<br />
de Antoine Boutet, 58’, 2009, France.<br />
Le plein pays désigne volontairement<br />
ce lieu entre l’imaginaire du personnage<br />
présenté et le réel intemporel qui<br />
l’entoure. Cet homme vit-il vraiment<br />
ou a t-il vécu? Nous n’en doutons pas<br />
puisque le cadre ou il évolue à l’air de<br />
lui appartenir pleinement. En effet, il<br />
se déplace dans ce « plat » pays qui<br />
est le sien, que chante Jacques Brel.<br />
Seul dans sa maison de campagne, il<br />
enregistre sa voix ou des chansons et<br />
des émissions radios qu’il réécoute<br />
par la suite, lorsqu’il est chez lui ou<br />
dans sa carrière de pierre.<br />
Au fond des terres, au milieu des roches<br />
éternelles, il creuse ses galeries,<br />
grave des figures animales ou abstraites<br />
comme le faisait l’homme de Néandertal<br />
dans les grottes. Il chante à gorge<br />
déployée des paroles qui résonnent<br />
mais qui sont à peine compréhensible.<br />
Cet homme, comme une force de la<br />
nature, déplace frénétiquement de<br />
Hôtel-Rivet n°10 A.R.C. lieux de production exposition du 10 février au 4 mars 2010 Hôtel-Rivet n°10 A.R.C. lieux de production exposition du 10 février au 4 mars 2010<br />
le temps et de se l’approprier...<br />
Dans les deux cas il y a production.<br />
D’un côté, production matérielle pour<br />
vivre, et de l’autre, développement de<br />
l’être dans son espace intime.<br />
lourdes pierres dans un monde retiré<br />
et nous livre en même temps sa fragilité<br />
lorsque il s’entoure d’idoles telle<br />
que Brigitte Bardot, qui orne les murs<br />
de sa maison, ou quand il précise avec<br />
ironie que la vie et la mort n’est pour<br />
lui qu’une mascarade...<br />
Un documentaire où Antoine Boutet<br />
fait le bon choix des angles de vue et<br />
ne cherche ni à dramatiser, ni à juger<br />
la vie de cet homme qu’il nous présente<br />
avec simplicité.<br />
Ici et ailleurs<br />
Par ELSA LANGER<br />
de Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin<br />
et Anne-Marie Miéville, 53’, 1976,<br />
France.<br />
Ici, nous voyons une famille de français<br />
moyens devant leur écran de télévision.<br />
Ailleurs, ce sont les images<br />
de la révolution palestinienne. Ici et<br />
ailleurs développe le dernier état du<br />
montage de jusqu’à la victoire, film<br />
antécédent à ce moyen métrage tourné<br />
en Palestine au printemps 1970, et<br />
demeuré inachevé.<br />
Nous vivons aujourd’hui en 2009<br />
dans un occident submergé d’images.<br />
Elles s’accumulent et s’annulent les<br />
Photographie de la peinture murale d’ Hubert Bauchu<br />
Image tirée de la vidéo d’ Elsa Langer<br />
unes, les autres dans notre mémoire<br />
de sorte qu’au lieu d’apprendre à voir,<br />
nous devenons aveugle. Ici et ailleurs<br />
nous prouve que la situation n’a pas<br />
changé depuis que le film a été réalisé<br />
et même depuis les années 50.<br />
Le film expose des palestiniens et des<br />
israéliens qui s’embourbent dans des<br />
luttes sans échappatoire et qui meurent<br />
dans l’espoir d’une liberté. De<br />
l’autre coté, il y a le monde occidental<br />
caricaturé volontairement par la<br />
famille devant la télévision (Godard<br />
critique ici les médias mais son film<br />
en ait un aussi et il le rappelle au<br />
spectateur par les clichés qu’il laisse<br />
surgir), qui absorbe passivement les<br />
images, de la guerre, de la publicité<br />
ou du sport dans le silence et sans jamais<br />
communiquer entre eux.<br />
Sont alors représentés deux mondes<br />
qui ne peuvent plus se croiser car les<br />
médias ont creusé les différences et<br />
ont effacé toutes possibilités d’un espoir<br />
en individualisant et en séparant<br />
les individus et les peuples qui ne sont<br />
plus indépendants. Il y a la société<br />
capitaliste qui incite à la réussite personnelle<br />
et fonctionne sur le mérite et<br />
TRAVAUX<br />
C<br />
onsidérons que la télévision est<br />
le théâtre de production et de<br />
diffusion d’images mobiles, génériques...<br />
Considérons que notre cerveau<br />
est le réceptacle de tout ce flux d’images,<br />
de tous ces mots qui ont pour seul<br />
but d’informer et d’illustrer les images<br />
qui défilent. Maintenant, si je déforme<br />
le son et si je modifie le temps<br />
de diffusion, si j’imagine un journal<br />
qui durerait 20 heures, que reste t-il<br />
alors du sens des images? On passe<br />
d’un état passif où l’on éponge l’information<br />
à un état de contemplation qui<br />
reste tout de même hypnotique. Le fait<br />
de ralentir des images produites pour<br />
être rapides et efficaces afin d’ingurgiter<br />
l’information, comme s’il s’agissait<br />
de restauration rapide, veut signifier<br />
qu’il faut apprendre à voir, prendre<br />
le temps de regarder ce qu’on nous<br />
propose. Le son, le caquetage médiatique,<br />
l’absence de sens dans les mots<br />
sont annihilés par le ralentissement,<br />
ils deviennent des borborygmes quasi<br />
angoissants. Mon but est de montrer<br />
que l’on peut regarder différemment<br />
les choses établies, produites et diffusées,<br />
ces images du non-sens, ces<br />
sentiments qui ne nous appartiennent<br />
pas, comme la peur, la paranoïa, la<br />
culpabilité ou la bêtise.<br />
Par <strong>MARJORIE</strong> <strong>ACCARIER</strong><br />
Image tirée de la vidéo de Marjorie Accarier<br />
C<br />
e projet vidéo porte sur le travail<br />
de la terre, thématique importante<br />
en France, où le paysan est encore<br />
un symbole national, même si le secteur<br />
agricole est désormais un domaine<br />
d’emploi résiduel.<br />
Le travail de la terre reste encore transfiguré<br />
comme symbole d’une époque<br />
dorée perdue, face à une identité nationale<br />
qui éprouve des difficultés à mûrir,<br />
face à une industrie agro-alimentaire<br />
mondialisée qui semble avoir oublié<br />
L es<br />
photographies ne parlent pas<br />
d’un chantier en particulier, l’architecture<br />
et les éléments qui les composent<br />
créent des associations difficiles<br />
à comprendre. Ce sont des sortes de<br />
superpositions de plans d’espaces réels,<br />
mis au même niveau, et qui mènent<br />
vers une autre dimension spatiale, intemporelle,<br />
et d’une certaine manière<br />
irréelle. Cette ambiguïté suggère l’idée<br />
D<br />
ans une forêt où des arbres sont<br />
abattus, le travail s’organisera<br />
en trois temps.<br />
Récupérer les débris de l’arbre c’està-dire<br />
les branches, l’écorce, la souche<br />
et la sciure avec lesquels je ferais un<br />
assemblage pour donner l’image d’un<br />
arbre sur le sol.<br />
Ensuite dans le champ où sont rangés<br />
et recoupés les troncs, je rassemblerai<br />
les chutes éparses qui sont devenues<br />
pour moi des disques de tailles différentes<br />
que je superposerai afin de créer<br />
toute dimension humaine, et en souvenir<br />
d’une harmonie perdue avec un<br />
environnement certes rude mais non<br />
pas susceptible de bouleversements climatiques.<br />
Évoquer le travail de la terre, c’est examiner<br />
la réalité de la vie du paysan<br />
d’avant 1950, et la confronter au mythe<br />
avec lequel nous nous protégeons de<br />
nos peurs face aux défis de notre époque.<br />
Par <strong>EMILIE</strong> <strong>ASSEMAT</strong><br />
Image tirée de la vidéo d’ Emilie Assemat<br />
d’une production en surabondance, qui<br />
tend à l’asphyxie, et tel le propos des<br />
photo-montages va au-delà du constat<br />
du chantier comme lieu de production.<br />
Il est question ici d’évoquer le lieu de<br />
production en tant qu’espace difficilement<br />
cernable.<br />
Par ALICE LAFONT<br />
Montage photographique réalisé par Alice Lafont<br />
une ligne verticale rappelant la verticalité<br />
de l’arbre.<br />
Enfin je me servirai des cendres pour<br />
dessiner un arbre sur le sol.<br />
Par BASTIEN dENGERMA<br />
« Le temps s’enfuit.<br />
Seules ces choses restent là,<br />
présentes, inertes, vivantes<br />
dans ce lieu intemporel,<br />
nous parlant dans le silence<br />
de leur vie d’antan. »<br />
Par SUZIE BOUëT<br />
L ’<br />
appareil en main, je suis partie<br />
pour photographier divers<br />
personnages figurant chacun dans un<br />
lieu spécifique. Ils ont tous en commun<br />
la notion de travail. Cependant,<br />
de portraits en portraits, on se rend vite<br />
compte que le travailleur fusionne avec<br />
son environnement. Les couleurs, le<br />
sourire, le matériau ou la position sont<br />
autant d’éléments qui dévoilent une<br />
composition. Un tandem entre le corps<br />
et l’espace; un vêtement de travail qui<br />
génère un rôle, un métier.<br />
Par ANAELLE BERROCHE<br />
Photographie d’ Anaëlle Berroche<br />
Photographie réaliseé par Bastien Dengerma<br />
Photographie de Suzie Bouët<br />
3