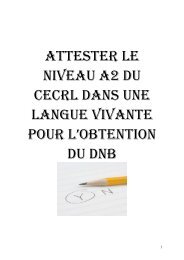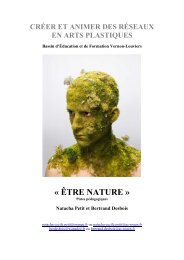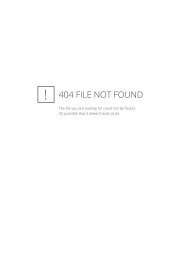Patrick Dupouey, Professeur de Première supérieure au Lycée Saint ...
Patrick Dupouey, Professeur de Première supérieure au Lycée Saint ...
Patrick Dupouey, Professeur de Première supérieure au Lycée Saint ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Je ne retiendrai que les thèmes directement liés <strong>au</strong>x préoccupations <strong>de</strong>s philosophes,<br />
celles que je viens d’évoquer. Voici, sur ces thèmes, les conclusions <strong>de</strong>s <strong>au</strong>teurs.<br />
1 e conclusion : le vieillissement pourrait n’être pas la loi universelle du mon<strong>de</strong> vivant.<br />
C’est un étonnement tout aristotélicien qui avait conduit Weismann à se poser la<br />
question du sens biologique <strong>de</strong> la mort :<br />
« Nous ne voyons <strong>au</strong>cunement pourquoi l’aptitu<strong>de</strong> à la multiplication cellulaire ne<br />
s<strong>au</strong>rait être infinie, ce qui permettrait à l’organisme <strong>de</strong> vivre éternellement. De même,<br />
à un point <strong>de</strong> vue purement physiologique, nous ne verrions <strong>au</strong>cune raison pour que<br />
l’organisme ne pût pas, <strong>de</strong> son côté, fonctionner éternellement ». 17<br />
Puisque les vivants sont équipés pour remonter le courant <strong>de</strong> l’entropie croissante,<br />
pourquoi ne sont-ils pas équipés pour le faire plus longtemps, <strong>au</strong>ssi longtemps qu’<strong>au</strong>cun<br />
acci<strong>de</strong>nt mortel ne les frappe ? Pourquoi la nature n’a-t-elle pas généralisé et perfectionné<br />
les mécanismes <strong>de</strong> réparation ? La conservation par réparation d’un organisme existant ne<br />
serait pas un miracle plus étonnant que la formation <strong>de</strong> cet organisme à partir <strong>de</strong> la fusion <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux cellules. S’il y a une fatalité <strong>de</strong> la mort, elle n’est pas nécessairement d’ordre<br />
biologique : « La mort naturelle pourrait bien n’être pas inscrite <strong>de</strong> toute éternité dans la<br />
nature même du vivant » (p. 12) ; vieillissement et mort « ne constituent pas <strong>de</strong>s propriétés<br />
intrinsèques du vivant » (p. 127) ; « la conclusion principale, c’est l’absence <strong>de</strong> fatalité ultime<br />
<strong>de</strong> la mort. […] Il n'existe <strong>au</strong>cune loi <strong>supérieure</strong> qui condamnerait inexorablement tout être<br />
vivant <strong>au</strong> vieillissement et à la mort » (p. 95).<br />
2 e conclusion : les explications <strong>de</strong> la mort qui renvoient à une utilité (pour l’espèce ou<br />
pour la vie en général) relèvent d’une approche finaliste qui ne v<strong>au</strong>t pas davantage pour la<br />
mort que pour n’importe quel <strong>au</strong>tre phénomène biologique. « La mort naturelle n’a pas <strong>de</strong><br />
valeur en soi » (p. 240). En particulier (p. 95), « Il n’y a pas <strong>de</strong> lien obligatoire entre mort et<br />
sexualité, ou entre mort et multicellularité » 18 .<br />
3 e conclusion : vieillissement et mort trouvent pourtant une explication rationnelle dans<br />
les mécanismes darwiniens <strong>de</strong> la sélection naturelle à l’œuvre dans l’évolution générale <strong>de</strong>s<br />
organismes. Cette conclusion est peut-être la plus paradoxale, dans la mesure où la<br />
sélection naturelle est précisément ce qui, dans l’évolution, produit <strong>de</strong> l’adaptation, c’est-àdire<br />
<strong>de</strong> la finalité.<br />
Réintégrer la mort dans un dispositif supposé harmonieux permet <strong>de</strong> rendre à la mort<br />
son caractère acceptable, en lui accordant un rôle dans le vaste mouvement qui emporte la<br />
vie vers la perfection. Mort rassurante, mort consolante. Mais pourquoi f<strong>au</strong>drait-il que la mort<br />
ait un sens et qu'elle s'inscrive dans un plan universel ? « L'homme suinte le projet, dit<br />
François Jacob. Sue le <strong>de</strong>ssein. Pue l'intention. Ne tolère pas la contingence. […] Il verse du<br />
sens sur les événements comme du sel sur les aliments » 19 . La mort n'échappe pas à ce<br />
traitement. Elle offre même <strong>au</strong> désir humain <strong>de</strong> sens son objet privilégié. Il est bien naturel<br />
que nous voulions conférer une signification transcendante à ce que nous regardons comme<br />
l'aspect le moins supportable, le moins acceptable <strong>de</strong> notre condition. Le plus grand <strong>de</strong>s<br />
m<strong>au</strong>x veut la plus énergique <strong>de</strong>s consolations. Eh bien, il f<strong>au</strong>t se gar<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à la<br />
science cette consolation qu'on n'attend plus guère <strong>de</strong> la religion.<br />
4. Critique <strong>de</strong> l’argument d’utilité<br />
A. Circularité <strong>de</strong> l’argument <strong>de</strong> Weismann<br />
Revenons <strong>au</strong> raisonnement <strong>de</strong> Weismann : les organismes s’usant avec le temps et<br />
<strong>de</strong>venant moins performants, il importe à la bonne santé <strong>de</strong> l’espèce qu’un mécanisme les<br />
fasse disparaître la circulation. Le problème, c’est que ce raisonnement est circulaire. Que<br />
les organismes <strong>de</strong>viennent moins performants avec le temps, c’est précisément ce qu’on<br />
veut expliquer, et dont on ne peut donc pas faire un présupposé sans admettre ce qui est<br />
précisément à expliquer. Pourquoi les mécanismes <strong>de</strong> réparation ne sont-ils pas plus<br />
répandus et plus efficaces ? C’est tout le problème.<br />
17 Cité par AK et FR, p. 25.<br />
18 On évoque en effet souvent la thèse <strong>de</strong> l’immortalité cellulaire, défendue par Alexis Carrel en 1912 (année <strong>de</strong><br />
son Prix Nobel) : De la vie permanente <strong>de</strong>s tissus en-<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s organismes. Carrel prétend cultiver indéfiniment<br />
<strong>de</strong>s cellules <strong>de</strong> poulet. En effet, ces cellules cardiaques se multiplient pendant 34 ans (bien <strong>au</strong>-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la durée<br />
<strong>de</strong> vie d’un poulet !). L’immortalité cellulaire restera un dogme jusqu’en 1960. Mais il y avait un biais dans la<br />
manip <strong>de</strong> Carrel : il nourrissait ses cellules en culture avec <strong>de</strong> l’extrait liqui<strong>de</strong> d’embryon <strong>de</strong> poulet ; mal purifié,<br />
cet extrait contenait <strong>de</strong>s cellules fraîches. Il y a bien une limite à la division cellulaire. Limite variable en raison <strong>de</strong><br />
la longévité <strong>de</strong> l’organisme, mais plus étroite pour <strong>de</strong>s cellules d’organisme âgé.<br />
19 François Jacob, La statue intérieure, Éditions Odile Jacob, 1987.