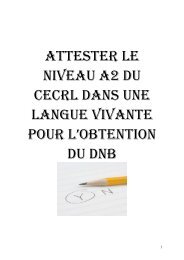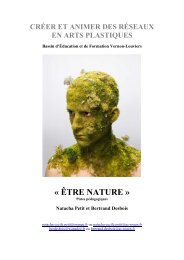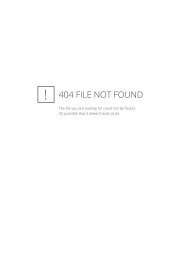Patrick Dupouey, Professeur de Première supérieure au Lycée Saint ...
Patrick Dupouey, Professeur de Première supérieure au Lycée Saint ...
Patrick Dupouey, Professeur de Première supérieure au Lycée Saint ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
« Le vieillissement et la mort qu’il précipite doivent certes êtres considérés<br />
comme <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s processus évolutifs, apparues plus ou moins<br />
tardivement dans l’histoire <strong>de</strong> la vie. Ils ne constituent pas <strong>de</strong>s propriétés<br />
intrinsèques du vivant ».<br />
6. Conclusion : critique <strong>de</strong> la thématique du mystère<br />
J’avais annoncé mon intention <strong>de</strong> revenir sur ce thème rebattu <strong>de</strong> la mort comme<br />
mystère insondable, énigme à jamais indéchiffrable, secret impénétrable. Lieu commun <strong>de</strong><br />
toutes les dissertations philosophiques, Capes et agrégation compris. Pour Lévinas, « La<br />
mort est départ […] dont la <strong>de</strong>stination est inconnue. […] question sans donnée, pur point<br />
d’interrogation » 22 . « Sur la mort, déclarait Jankélévitch, je n'ai <strong>au</strong>cun renseignement » ; « Le<br />
secret est bien gardé », ajoute-t-il dans son grand livre. Il est plus étonnant <strong>de</strong> retrouver ce<br />
thème jusque chez <strong>de</strong>s philosophes se réclamant du matérialisme athée. André Comte-<br />
Sponville, Présentations <strong>de</strong> la philosophie, Albin Michel, p. 39 – 40 :<br />
[…] il n’y a rien, dans la mort, à penser. Qu’est-elle ? Nous ne le savons pas.<br />
Nous ne pouvons le savoir. Ce mystère ultime rend toute notre vie mystérieuse,<br />
comme un chemin dont on ne s<strong>au</strong>rait où il mène, ou plutôt on ne le sait que trop<br />
(à la mort), mais sans savoir pourtant ce qu’il y a <strong>de</strong>rrière – <strong>de</strong>rrière le mot,<br />
<strong>de</strong>rrière la chose –, ni même s’il y a quelque chose.<br />
Je ne suis pas sûr que confronté à la mort, l'homme ait d'emblée éprouvé le sentiment<br />
du mystère, qu'il l'ait d’abord considérée comme un problème à résoudre, et que les<br />
innombrables représentations, croyances, mythes, théories sont <strong>au</strong>tant <strong>de</strong> réponses à cette<br />
interrogation initiale. Je tends plutôt à croire qu’ils se sont imposés d'abord comme <strong>de</strong>s<br />
évi<strong>de</strong>nces allant <strong>de</strong> soi, comme <strong>de</strong> pures affirmations, et que le sentiment d'avoir affaire à un<br />
problème est venu plus tard. Comme je l’ai dit, ethnologie et histoire montrent que la<br />
croyance <strong>au</strong>x esprits, <strong>au</strong>x spectres, <strong>au</strong>x ombres, <strong>au</strong>x fantômes - à toutes les formes <strong>de</strong> ce<br />
qu'Edgar Morin appelle le double - s'impose par-<strong>de</strong>là les frontières culturelles. Cette<br />
universalité suggère un enracinement dans un structure humaine essentielle et peut-être<br />
indépassable. Mais justement pour cette raison, il est peu probable que la question ait été<br />
première : on lui <strong>au</strong>rait trouvé <strong>de</strong>s réponses plus variées. Les croyances humaines se sont<br />
sans doute d'abord constituées comme réponses, bien avant que ne surgissent les questions<br />
correspondant à ces réponses. L'interrogation n'est pas l'attitu<strong>de</strong> première <strong>de</strong> l'homme, parce<br />
que le choix d'interroger traduit un privilège donné à la pensée et qu'avant <strong>de</strong> penser,<br />
l'homme doit vivre. D'abord, <strong>de</strong>s réponses. Pour les questions, on verra plus tard. C'est la<br />
bouta<strong>de</strong> <strong>de</strong> Woody Allen : « La réponse est oui, mais quelle est la question ? ».<br />
Les questions surgissent quand les réponses jamais questionnées commencent à faire<br />
problème, parce que les représentations <strong>au</strong>xquelles elles s'adossaient ne vont plus <strong>de</strong> soi.<br />
La mort n'a probablement acquis la dignité d'un problème (plus ou moins angoissant)<br />
qu'assez tardivement, <strong>au</strong> moment où il est <strong>de</strong>venu impossible <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r les anciennes<br />
certitu<strong>de</strong>s comme "naturelles" et frappées du sce<strong>au</strong> <strong>de</strong> l'évi<strong>de</strong>nce. De même qu'il ne peut y<br />
avoir <strong>de</strong> «problème <strong>de</strong> l'existence <strong>de</strong> Dieu» <strong>au</strong>ssi longtemps que les représentations<br />
religieuses s'imposent comme <strong>de</strong>s données "naturelles", immanentes à la vie sociale et<br />
intégrées <strong>au</strong>x pratiques quotidiennes. La possibilité <strong>de</strong> parler <strong>de</strong> "la religion" en général,<br />
comme d'un phénomène culturel parmi d'<strong>au</strong>tres (la science, l'art, la philosophie...), est issue<br />
d'une situation historique particulière, qui a contribué à isoler le religieux en tant que tel et à<br />
le démarquer du profane. Certaines cultures, où le religieux tient une gran<strong>de</strong> place, et<br />
précisément à c<strong>au</strong>se <strong>de</strong> cela, ne pensent pas la religion en tant que telle.<br />
Le thème <strong>de</strong> la mort-mystère est un thème idéologique, qu’il est urgent <strong>de</strong> critiquer.<br />
Comme je l’ai dit, nous avons affaire, avec la mort, à un phénomène naturel. Bien entendu,<br />
je ne veux pas exclure a priori qu’il puisse revêtir une signification surnaturelle, comme<br />
n’importe quel <strong>au</strong>tre : la vie, l’amour, la naissance, le langage, la religion. Concernant par<br />
exemple l’amour, personne n’affirme – pour cette raison qu’il pourrait avoir une signification<br />
surnaturelle – qu’on n’en peut rien connaître et que psychologie, psychanalyse,<br />
neurosciences, sociologie ou que sais-je encore ‘<strong>au</strong>raient pas leur mot à dire. On s’enferme<br />
a priori dans un cercle si l’on déduit la signification surnaturelle <strong>de</strong> la mort du fait que nous<br />
sommes dans l’impossibilité <strong>de</strong> rien connaître du phénomène. Par quelle raison<br />
extraordinaire expliquerait-on que sur ce phénomène, et seulement sur celui-là, l'esprit<br />
humain avait – <strong>de</strong>s siècles durant – œuvré en pure perte, usant en vain ses griffes sur la<br />
porte qui nous sépare <strong>de</strong> l'absolument <strong>au</strong>tre, du radicalement étranger ?<br />
22 Dieu, la mort et le temps, cours <strong>de</strong> Sorbonne, 1975 – 1976, Le livre <strong>de</strong> poche, Biblio-Essais, 1993, p. 23.