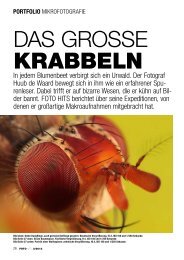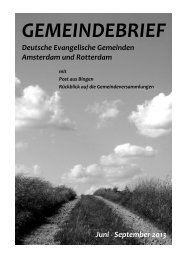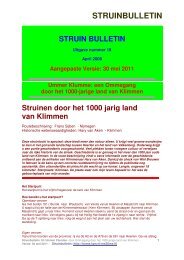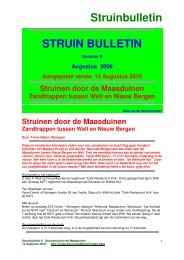Arnaud Guillaume, constructeur du cloître de Moissac
Arnaud Guillaume, constructeur du cloître de Moissac
Arnaud Guillaume, constructeur du cloître de Moissac
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L'operarius, ou la personne désignée par '<strong>de</strong> opere' ou '<strong>de</strong> opera', n'est donc pas un simple ouvrier ni<br />
un laïc, mais un moine, voire l'un <strong>de</strong>s moines les plus importants <strong>du</strong> monastère. Le moine "ouvrier" est<br />
le maître <strong>de</strong> la fabrique <strong>de</strong> l'église, le moine chargé <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> l'entretien <strong>de</strong>s<br />
bâtiments. Il est difficile <strong>de</strong> ne pas voir en lui le concepteur, l'auctor intellectualis <strong>de</strong> la construction,<br />
donc également <strong>du</strong> programme iconographique.<br />
Durant la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> construction <strong>de</strong>s grands monuments <strong>de</strong> <strong>Moissac</strong>, nous connaissons les noms <strong>de</strong><br />
trois "moines-ouvriers" : Dieudonné, <strong>Arnaud</strong> <strong>Guillaume</strong>, et Raimond <strong>de</strong> Mala Musca.<br />
Le premier s'appelle Dieudonné. Nous ne savons pratiquement rien <strong>de</strong> lui. Son nom, Deus<strong>de</strong>t <strong>de</strong><br />
opera, ne figure qu'une seule fois dans un texte, un acte <strong>de</strong> 1097 7 rappelant un fait qui s'est déroulé <strong>du</strong><br />
temps <strong>du</strong> prieur Aton, religieux qu'il faut placer dans les années 1074 - 1085. 8 Ce texte donne aussi la<br />
première mention <strong>de</strong> son successeur dans l'office d'operarius, <strong>Arnaud</strong> <strong>Guillaume</strong>.<br />
Le <strong>de</strong>uxième s'appelle <strong>Arnaud</strong>, ou encore <strong>Arnaud</strong> <strong>Guillaume</strong>. Il apparaît sous l'abbatiat d'Ansquitil<br />
(1085 - 1115), et il est cité dans les chartes <strong>de</strong> l'abbaye <strong>de</strong> <strong>Moissac</strong> <strong>de</strong> la fin <strong>du</strong> XI e et <strong>du</strong> début <strong>du</strong> XII e<br />
siècle. En 1097 et en 1107, 9 il est cité comme Arnal<strong>du</strong>s <strong>de</strong> opere ou Arnal<strong>du</strong>s monachus <strong>de</strong> opere. Entre<br />
1114 10 et 1126, 11 nous le trouvons mentionné comme Arnal<strong>du</strong>s Willelmi operarius, ou Arnal<strong>du</strong>s<br />
Guillelmi <strong>de</strong> opera. Le contexte historique, sur lequel nous allons revenir, prouve qu'il s'agit bien d'une<br />
seule et même personne. Au regard <strong>de</strong> la fourchette chronologique <strong>de</strong>s textes où il est cité (1097 - 1126),<br />
on peut lui attribuer la construction <strong>du</strong> <strong>cloître</strong>.<br />
Le troisième "ouvrier", Raimond, appelé aussi Raimun<strong>du</strong>s <strong>de</strong> opere ou Raimun<strong>du</strong>s monachus <strong>de</strong><br />
opere, lui succè<strong>de</strong> sous l'abbatiat <strong>de</strong> Roger (1115 - 1131/35). Il est cité pour la première fois en 1129. 12<br />
Nous apprenons un peu plus tard son nom <strong>de</strong> famille ou nom <strong>de</strong> provenance : Raimun<strong>du</strong>s <strong>de</strong> Mala<br />
Musca. Au regard <strong>de</strong> la fourchette chronologique fournie par ses citations dans les chartes, <strong>de</strong> 1129 à<br />
1146, 13 on peut lui attribuer le clocher-porche, construction <strong>de</strong>s années 1130 - 1140. Vers 1150, les<br />
travaux <strong>du</strong> clocher-porche sont probablement achevés. Raimond <strong>de</strong> Mala Musca reçoit alors une<br />
nouvelle charge. En 1156, il est cité comme prieur <strong>de</strong> Saint-Pierre <strong>de</strong>s Cuisines à Toulouse. 14 En 1155,<br />
l'abbé Etienne <strong>de</strong> Roquefort vend à Pierre <strong>de</strong> Cantamerle la maio <strong>de</strong> la obra, 15 la "maison <strong>de</strong> l'oeuvre".<br />
Si l'on donne au mot occitan obra le même sens que le latin opus, on peut penser à la maison où<br />
travaillaient et logeaient les architectes, les entrepreneurs et les sculpteurs <strong>de</strong> l'abbaye, la loge. 16 Cela<br />
voudrait dire qu'en 1155 les travaux <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> l'abbaye <strong>de</strong> <strong>Moissac</strong> sont définitivement<br />
terminés.<br />
Dans la hiérarchie <strong>du</strong> monastère <strong>de</strong> <strong>Moissac</strong>, la fonction d'operarius était un office important. Il faut<br />
savoir que dans les chartes <strong>du</strong> Moyen Age, les témoins assistant à la rédaction d'une charte sont cités<br />
dans l'ordre <strong>de</strong> préséance hiérarchique. L'abbé vient toujours en tête, suivi <strong>de</strong> son alter ego, nommé par<br />
lui, le prieur. Pour les autres offices monastiques, leur place dans l'énumération <strong>de</strong>s listes <strong>de</strong> témoins<br />
permet à l'historien d'établir les préséances hiérarchiques. Or, dans l'acte <strong>de</strong> donation <strong>de</strong> 1097,<br />
l'operarius est cité immédiatement après l'abbé, le prieur et le sacriste. Dans un acte <strong>de</strong> 1085/1108, il est<br />
cité après l'abbé, le prieur, le sacriste et le cellérier. 17 Si, dans un acte <strong>de</strong> 1104 18 et dans l'acte déjà cité <strong>de</strong><br />
1114, Arnal<strong>du</strong>s Willelmi operarius passe avant le prieur et le sacriste, c'est parce qu'il est le récipiendaire<br />
<strong>de</strong> la donation. Vers 1135, dans le célèbre privilège <strong>de</strong> coutumes <strong>de</strong> Saint-Nicolas-<strong>de</strong>-la-Grave,<br />
7. Paris, BN, coll. Doat, vol. 128, f. 264r - 265v.<br />
8. Apogée <strong>de</strong> <strong>Moissac</strong>, p. 137.<br />
9. ADTG, G 688 (An<strong>du</strong>randy 5235).<br />
10. ADTG, G 571 (An<strong>du</strong>randy 5799).<br />
11. ADTG, G 684 (An<strong>du</strong>randy 2831).<br />
12. ADTG, G 596 (An<strong>du</strong>randy 1888).<br />
13. ADTG, G 663 (An<strong>du</strong>randy 5214).<br />
14. ADTG, G 692.<br />
15. ADTG, G 569 II, f. 6v.<br />
16. Sur les "maisons <strong>de</strong> l'oeuvre" à l'époque romane, on ne sait pratiquement rien. Le phénomène est mieux connu<br />
à l'époque gothique : ALAIN ERLANDE-BRANDENBURG, La Cathédrale (Paris 1989), p. 285 - 287 ; GÜNTHER<br />
BINDING, Baubetrieb im Mittelalter (Darmstadt 1993), p. 101 - 107.<br />
17. ADTG, G 669.<br />
18. Paris, BN, coll. Doat, vol. 128, f. 297r - 199r.<br />
2