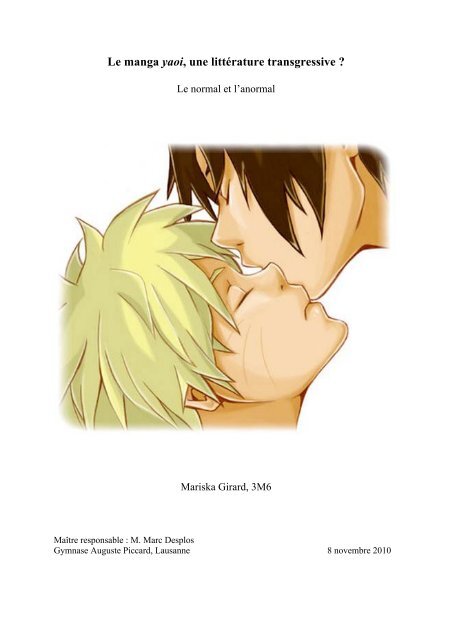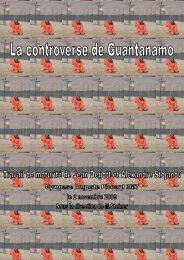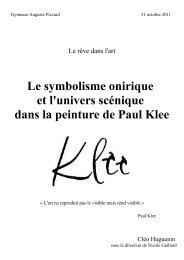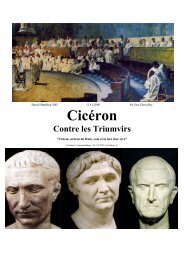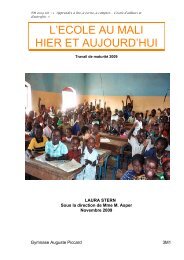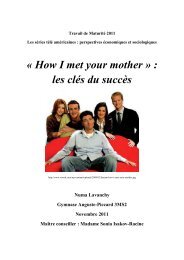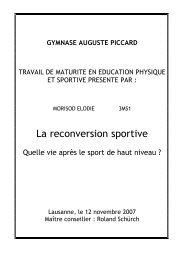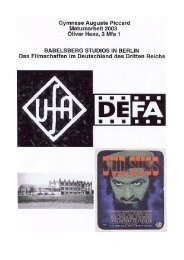Le manga yaoi, une littérature transgressive ? - Gymnase Auguste ...
Le manga yaoi, une littérature transgressive ? - Gymnase Auguste ...
Le manga yaoi, une littérature transgressive ? - Gymnase Auguste ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Le</strong> <strong>manga</strong> <strong>yaoi</strong>, <strong>une</strong> <strong>littérature</strong> <strong>transgressive</strong> ?<br />
<strong>Le</strong> normal et l’anormal<br />
Mariska Girard, 3M6<br />
Maître responsable : M. Marc Desplos<br />
<strong>Gymnase</strong> <strong>Auguste</strong> Piccard, Lausanne 8 novembre 2010
1. Introduction 3<br />
1.1. Intérêt 3<br />
1.2. L’homosexualité masculine au Japon jusqu’au XVIIIe siècle<br />
1.2.1. Sous quelle forme s’est-elle développée ?<br />
1.2.2. Origine de l’homosexualité masculine au Japon<br />
1.2.3. <strong>Le</strong>s différentes classes dans lesquelles l’homosexualité s’est développée<br />
1.2.4. L’amour homosexuel dans les monastères (Xe – XVe siècle)<br />
1.2.5. L’amour homosexuel dans le monde des samurais (XVe – XIIIe siècle)<br />
1.2.6. L’amour homosexuel dans le monde du théâtre (XIe – XVIIIe siècle)<br />
1.2.7. La mort du shudô en tant que culture pédérastique<br />
3<br />
3<br />
3<br />
4<br />
5<br />
5<br />
7<br />
9<br />
1.3. L’homosexualité dans le Japon contemporain (XIXe – XXIe siècle)<br />
1.3.1. Période de transition ; de la mode à la déviance (XIXe siècle)<br />
1.3.2. Tabou moderne de l’homosexualité (XXe siècle)<br />
1.3.3. Comment les homosexuels japonais vivent-ils aujourd’hui ?<br />
1.3.4. Conclusion<br />
9<br />
9<br />
10<br />
10<br />
12<br />
1.4. Histoire et développement du <strong>yaoi</strong><br />
1.4.1. Qu’est-ce que le <strong>yaoi</strong> ?<br />
1.4.2. Histoire du <strong>yaoi</strong><br />
1.4.3. Développement du <strong>yaoi</strong> au Japon, aux États-Unis et en francophonie<br />
13<br />
13<br />
13<br />
14<br />
2. Problématique 16<br />
2.1. Quel est le lien entre la réalité, historique et actuelle, et la fiction ? 16<br />
2.1.1. Quel est le regard des Japonais sur leur histoire ? 16<br />
2.1.2. Quels sont les similitudes entre le <strong>yaoi</strong>, l’histoire pédérastique japonaise et la vision actuelle de<br />
l’homosexualité ? 16<br />
2.2. Pourquoi les <strong>manga</strong>s traitant de l’homosexualité masculine (<strong>yaoi</strong>) sont-ils produits et<br />
lus par des femmes ?<br />
2.2.1. Des auteures proches de leur lectorat<br />
2.2.2. Qu’est-ce qui plaît tant aux lectrices dans le <strong>yaoi</strong> ?<br />
19<br />
19<br />
20<br />
2.3. Problème d’identification<br />
2.3.1. L’héroïne typique de shôjo et l’uke, <strong>une</strong> femme déguisée<br />
2.3.2. L’identification à l’adolescence<br />
2.3.3. S’identifier à un personnage de <strong>yaoi</strong>, en quoi cela résout-il le problème ?<br />
2.3.4. <strong>Le</strong> Cosplay, ou plus précisément, le Crossplay<br />
20<br />
20<br />
22<br />
22<br />
24<br />
2.4. Une relation hétérosexuelle idéalisée<br />
2.4.1. L’hétérosexualité, <strong>une</strong> norme frustrante<br />
2.4.2. Pour <strong>une</strong> égalité des sexes<br />
2.4.3. Mais aussi pour pouvoir s’affirmer<br />
2.4.4. Et affirmer ses envies<br />
24<br />
24<br />
25<br />
26<br />
26<br />
2.5. La question de la norme sexuelle dans le <strong>yaoi</strong><br />
2.5.1. Une hétérosexualité très présente<br />
2.5.2. Mais représentée par <strong>une</strong> relation tout de même homosexuelle<br />
28<br />
28<br />
29<br />
2.6. En quoi le <strong>yaoi</strong> a-t-il changé la perception de l’homosexualité masculine ?<br />
2.6.1. La communauté gay anti-<strong>yaoi</strong><br />
2.6.2. <strong>Le</strong>s effets positifs du <strong>yaoi</strong><br />
2.6.3. Une frontière abattue<br />
29<br />
29<br />
30<br />
30<br />
3. Conclusion 31<br />
4. Index 32<br />
5. Bibliographie et sources Internet 33<br />
2
1. Introduction<br />
1.1. Intérêt<br />
Évidemment, l’idée de ce sujet et l’envie de le traiter me sont venues en premier<br />
lieu parce que je suis moi-même lectrice de <strong>manga</strong>s, et, entre autres, de <strong>yaoi</strong>.<br />
D’<strong>une</strong> part, j’ai toujours trouvé dommage que la bande dessinée japonaise ait<br />
<strong>une</strong> si mauvaise réputation de légèreté. De plus, j’avais déjà évoqué, de manière<br />
personnelle, la question de savoir si, oui ou non, le style <strong>yaoi</strong> était cohérent face<br />
au mode de vie des homosexuels japonais. Ce travail était donc <strong>une</strong> excellente<br />
occasion d’approfondir ce sujet.<br />
1.2. L’homosexualité masculine au Japon jusqu’au XVIIIe siècle 1<br />
1.2.1. Sous quelle forme s’est-elle développée ?<br />
Avant tout, il faut savoir que l’homosexualité masculine au Japon s’est<br />
développée, durant les siècles, de manière exponentielle jusqu’au XIXe siècle.<br />
Cette partie du travail sert en particulier à la déterminer dans son contexte,<br />
puisque l’un des buts de celui-ci sera de comparer cette homosexualité à celle<br />
que l’on trouve aujourd’hui au Japon, spécialement dans les <strong>manga</strong>s.<br />
L’homosexualité masculine au Japon, contrairement à notre définition<br />
occidentale de l’homosexualité, qui unirait deux personnes adultes, s’est<br />
développée sous la forme pédérastique ; par ce terme, il faut entendre<br />
pédagogique. La forme la plus proche, que l’on connaît mieux en Occident, est<br />
celle qui se développa en Grèce antique. Comme son étymologie l’indique (παις<br />
[pais] « enfant » et εραστης [érastès], « amant ») 2 , le mot pédéraste décrit un<br />
homme d’âge mûr portant de l’amour à un adolescent, voire à un préadolescent.<br />
En outre, cette relation avait, comme en Grèce, <strong>une</strong> portée éducative 3 .<br />
1.2.2. Origine de l’homosexualité masculine au Japon<br />
Selon la coutume, la mode de la pédérastie japonaise aurait pris source au retour<br />
du moine Kûkai 4 de son voyage en Chine, en 806 après J.-C. Ce serait donc<br />
d’après <strong>une</strong> habitude chinoise que ce moine aurait répandu cette pratique,<br />
d’abord grâce à l’enseignement bouddhique de l’école Shingon, « vraies<br />
paroles », qu’il aurait fondée. Bien sûr, il n’existe aucun livre d’histoire<br />
permettant d’affirmer cela, mais il semble que ce soit effectivement à partir de<br />
ce moment que la culture de la pédérastie se soit développée au Japon, d’abord<br />
dans les temples, puis dans la haute société (samurais 5 ) pour enfin se répandre<br />
dans le peuple.<br />
1<br />
Pour le chapitre 1.2, la référence est La Voie des Éphèbes, Histoire et Histoires des Homosexualités au Japon,<br />
par Ts<strong>une</strong>o WATANABE et Jun’ichi IWATA. [éd. Trismegiste, 1987]<br />
2<br />
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pédéraste<br />
3<br />
Cf. <strong>Le</strong> Banquet, de Platon.<br />
4<br />
Moine reconnu comme étant l’importateur de la tradition culturelle de la pédérastie au Japon à son retour de<br />
Chine en 806. Il est le fondateur de l’école Shingon, « vraies paroles », branche du bouddhisme ésotérique.<br />
5<br />
Ils représentaient la haute société mais étaient surtout les membres de la classe guerrière
Cependant, bien que cette histoire relève de la légende, l’un des livres les plus<br />
anciens écrits en japonais, le Nihon Shoki, paru en 720, narre <strong>une</strong> histoire<br />
concernant la faute d’azunai (azunai no tsumi), terme qui désignait le vice<br />
homosexuel, haï des dieux.<br />
Une autre lecture possible, qui semble d’ailleurs plus probable, est que ce n’est<br />
pas l’homosexualité qui était ici perçue comme un vice. En effet, cette légende<br />
veut que Ono no Hafui, l’un des deux protagonistes de l’histoire, <strong>une</strong> fois que<br />
son ami fut mort de maladie, se suicidât tout contre son ancien amant. <strong>Le</strong>s deux<br />
hommes étaient prêtres, et servaient chacun un dieu différent. D’après <strong>une</strong><br />
lecture plus moderne, il semblerait donc que ce soit cette inhumation comm<strong>une</strong><br />
qui ait été prohibée par les dieux.<br />
Personnellement, je privilégie cette deuxième hypothèse, puisque les deux<br />
hommes n’avaient jamais été inquiétés à cause de leurs relations intimes de leur<br />
vivant. De plus, l’évolution au caractère positif de l’homosexualité qui se<br />
développa ensuite tendrait à nier <strong>une</strong> quelconque forme de discrimination de<br />
l’homosexualité masculine.<br />
Dans tous les cas, cette histoire concerne deux hommes adultes, et leur relation<br />
rejoindrait donc notre définition actuelle de l’homosexualité, alors que<br />
l’homosexualité masculine au Japon s’est ensuite développée sous la forme<br />
pédérastique.<br />
1.2.3. <strong>Le</strong>s différentes classes dans lesquelles l’homosexualité s’est développée<br />
L’homosexualité masculine au Japon, en tant que culture pédérastique, a eu du<br />
succès dans toutes les classes sociales. Au vu de son origine, il est évident que la<br />
première à avoir été touchée fut la classe religieuse, c’est pourquoi ce point sera<br />
le premier à être développé (Xe – XVe). Ensuite, il s’est répandu dans la classe<br />
guerrière, suite à un changement de mode (XVe – XVIII). C’est cette branche<br />
qui a fini par aboutir à l’homosexualité moderne, et donc tabou et anormale.<br />
Parallèlement, s’étendant sur <strong>une</strong> durée qui se superpose aux deux autres,<br />
l’homosexualité s’est développée dans le peuple, à travers le monde du théâtre<br />
(XIe – XVIIIe). C’est <strong>une</strong> autre direction que prit l’homosexualité dans les<br />
monastères. Aujourd’hui, au Japon, certaines vieilles pièces de Nô 6 comportent<br />
encore des traces de cette ancienne tradition pédérastique, même si les<br />
spectateurs ne le voient pas forcément. Quant au kabuki 7 , ce sont encore<br />
aujourd’hui des acteurs masculins qui jouent les rôles féminins ; les acteurs<br />
doivent cependant cacher leur homosexualité. C’est également ce<br />
développement qui se rapproche le plus du sujet qui nous intéressera dans la<br />
deuxième partie : l’amour homosexuel dans les <strong>manga</strong>s : le <strong>yaoi</strong>.<br />
Cependant, l’aspect chronologique ne me semble pas fondamental ici, c’est<br />
pourquoi la classe des samurais sera traitée avant celle du théâtre.<br />
6 <strong>Le</strong> mot vient d’un verbe qui signifie « pouvoir, être capable de » et prend donc le sens de « pouvoir, talent » en<br />
tant que nom. D’abord utilisé pour définir le talent des artistes, il définit la pièce en elle-même actuellement. <strong>Le</strong><br />
nô est un drame lyrique (il faut entendre le terme « drame » dans son sens premier, soit « action »), alliant<br />
pantomimes et paroles presque chantées. <strong>Le</strong> protagoniste porte un masque. (<strong>Le</strong> théâtre no : études sur le drame<br />
lyrique japonais, Noël Peri, Ecole Francaise d'Extreme Orient, Paris, 1 er mai 2005)<br />
7 Théâtre populaire plus moderne que le Nô, inspiré de la danse principalement<br />
4
1.2.4. L’amour homosexuel dans les monastères (Xe – XVe siècle)<br />
Revenons un peu en arrière et demandons-nous « Pourquoi un amour<br />
pédérastique ? », alors qu’à notre époque, nous parlerions de pédophilie. La<br />
raison vient justement du fait que cette tradition se soit développée dans le<br />
monde des monastères. En effet, les Japonais représentaient toujours leurs dieux<br />
incarnés en de beaux je<strong>une</strong>s garçons angéliques. C’est pourquoi les chigos 8<br />
étaient à la fois objet d’un amour sexuel, mais également d’<strong>une</strong> admiration<br />
spirituelle.<br />
<strong>Le</strong>s aristocrates avaient l’habitude de faire entrer leurs fils au monastère, souvent<br />
provisoirement, pour les préparer à <strong>une</strong> vie religieuse. Il était évident que ces<br />
je<strong>une</strong>s garçons bien éduqués fussent adorés par les moines. On peut donc<br />
constater que c’était un passage normal pour tous les je<strong>une</strong>s garçons de<br />
l’aristocratie : à travers cela, on perçoit la tradition culturelle de la pédérastie.<br />
Une autre raison pour laquelle la pédérastie s’est développée dans les écoles de<br />
bouddhisme ésotérique est un paradoxe : la différence la plus importante entre le<br />
bouddhisme et le bouddhisme ésotérique (celui qu’apporta le moine Kûkai à son<br />
retour de Chine) est que dans ce dernier le corps n’est pas mis à l’écart et qu’il<br />
est donc possible pour les hommes, de leur vivant, d’accéder à la délivrance. <strong>Le</strong><br />
corps n’étant pas méprisé, ses désirs ne devaient donc pas, par définition, être<br />
méprisés non plus. Là où le paradoxe intervient, c’est que, par tradition, les<br />
moines étaient obligés de célibat, et l’amour de la femme interdit. La solution<br />
morale pour ne désobéir à aucun commandement était donc pour les moines<br />
d’aimer un homme. <strong>Le</strong> mélange de leurs autres traditions fit que ce ne fût pas les<br />
hommes qu’ils aimassent, mais les je<strong>une</strong>s garçons.<br />
D’ailleurs, cette tradition culturelle glissa doucement du monde religieux au<br />
monde des samurais lorsque la règle du célibat des moines fut abandonnée dans<br />
la plus grande secte religieuse du pays (XVe siècle), ce qui se généralisera<br />
rapidement. Au XVIIe siècle, ils avaient même le droit de se marier.<br />
1.2.5. L’amour homosexuel dans le monde des samurais (XVe – XIIIe siècle)<br />
Comme je l’ai dit, la culture pédérastique passe, vers les XV et XVIe siècles,<br />
majoritairement au monde des samurais, à la fois militaire et aristocratique.<br />
Comme toutes les modes au Japon, elles vont de haut en bas. En d’autres termes,<br />
elles partaient en général de la maison du shôgun 9 pour ensuite descendre dans le<br />
peuple. Il n’est donc pas surprenant qu’il se soit produit la même chose dans le<br />
cas du passage de l’amour homosexuel dans les monastères à celui des guerriers.<br />
Ce serait le shôgun Yoshimochi (1368 – 1427) qui, le premier, aurait aimé un<br />
je<strong>une</strong> éphèbe, alors que son père préférait encore des je<strong>une</strong>s moines ou des<br />
comédiens. <strong>Le</strong> changement a donc bel et bien eu lieu aux alentours du XVe<br />
siècle.<br />
Ce passage est principalement marqué par un changement majeur : alors que les<br />
moines aimaient les chigos, le nom pour désigner le je<strong>une</strong> homme aimé par un<br />
samurai devint wakashu 10 (littéralement : je<strong>une</strong> (waka) homme (shu), traduit par<br />
« éphèbe »). Cela correspond également au changement qui se produisit en ce<br />
8 « Je<strong>une</strong>s garçons »<br />
9 Dirigeant de la classe guerrière (les samurais).<br />
10 À traduire par je<strong>une</strong> homme ou éphèbe.<br />
5
qui concernait les âges limites des je<strong>une</strong>s pour être aimés : celui des chigos<br />
correspondait à la période de dix à dix-sept ans, alors que celui des wakashu<br />
correspond aux âges allant de treize à dix-neuf ans, voire plus. C’est ainsi<br />
qu’apparut le shudô, « Voie des Éphèbes ».<br />
<strong>Le</strong> mot shudô, qui fut employé pour la première fois dans un document en 1485,<br />
est en réalité l’abréviation du terme wakashu-dô (la Voie (dô) des éphèbes<br />
(wakashu)).<br />
Au Japon, tout art et toute technique pouvaient potentiellement servir de Voie<br />
vers l’Éveil pour autant qu’il demandât un long et sévère apprentissage. Cet<br />
Éveil signifie prendre conscience de notre vraie nature et ainsi atteindre le<br />
nirvāna, terme qui, bien qu’impossible à définir, est souvent rapproché de « la<br />
fin de l’ignorance ». Ainsi, on trouve différentes voies, parallèles à celle du<br />
shudô : le jû-dô (Voie de la souplesse), le Butsu-dô (Voie du Bouddha), le kyûdô<br />
(Voie du tir à l’arc) ou encore, plus étonnants, le sa-dô (Voie du thé) ou le<br />
sho-dô (Voie de la calligraphie). L’application du terme shudô à cette pédérastie<br />
est donc détournée de son sens premier, puisqu’elle désignait, à la base,<br />
l’apprentissage de l’honnêteté, de la vertu, de l’obéissance et de l’esthétisme,<br />
considérés comme utiles pour les garçons, surtout dans le monde militaire, qui<br />
était également à lui seul <strong>une</strong> autre Voie, la Voie du samurai (bushi-dô). La<br />
pratique de la pédérastie était un moyen d’appliquer le shudô, qui a finalement<br />
été désigné par ce même terme.<br />
On peut même aller plus loin en disant que, du shudô, on passe au bushidô. Pour<br />
bien comprendre cela, il est important de connaître l’<strong>une</strong> des facettes du monde<br />
des samurais la moins connue. Certes, les samurais étaient des guerriers avant<br />
tout, mais leur apparence était toute aussi importante : un samurai nommé<br />
Yamamoto Jôchô (1659 – 1719) écrivit un guide pratique et spirituel appelé<br />
Hagakure destiné aux guerriers. Dans celui-ci, il prodigue des conseils à ses<br />
semblables, et <strong>une</strong> grande partie des conseils sont liés à l’apparence et aux soins<br />
corporels. Par exemple, il dit qu’un samurai doit toujours porter du rouge et de<br />
la poudre sur soi, au cas où. On sait d’ailleurs que les samurais avaient souvent<br />
les cheveux parfumés et se brossaient les ongles tous les jours. Ils se<br />
maquillaient même avant d’aller au combat ; dans le cas où ils mourraient, leur<br />
vue ne serait pas désagréable à l’ennemi.<br />
En ce qui concerne les liens qui se tissaient entre un samurai et un wakashu, le<br />
meilleur exemple figure dans un document écrit par le père Frois, premier<br />
missionnaire jésuite au Japon, arrivé le 15 août 1549, qui fut d’ailleurs<br />
scandalisé en arrivant par le péché de Sodome qu’il trouva un peu partout au<br />
Japon : « « Un garçon de treize ans, fils d’un seigneur distingué appelé<br />
Odachidono, page de Monseigneur le shogun, s’est battu avec tellement de<br />
vaillance et d’esprit intrépide que tous les rebelles ont commencé à s’écrier<br />
qu’on ne devait pas le tuer et qu’on devait le prendre vivant. Toutefois, voyant<br />
son maître mourir et croyant qu’il lui serait d’un grand déshonneur de survivre à<br />
son patron, le je<strong>une</strong> abandonne l’épée et dégaine son poignard d’un coup duquel<br />
il se frappe la gorge, puis le ventre ; finalement il se donne la mort en se<br />
couchant à plat ventre sur le poignard… ». Bien que le père Frois ne semble pas<br />
en avoir conscience, il paraît peu probable que le garçon se suicidât uniquement<br />
par loyauté. Il semble en effet qu’il mourût également à cause du lien d’amour<br />
qui devait exister entre lui et son maître. » 11 Un autre épisode du même genre se<br />
11 La Voie des Éphèbes, Histoire et Histoires des Homosexualités au Japon,par Ts<strong>une</strong>o WATANABE et<br />
Jun’ichi IWATA. [éd. Trismegiste, 1987], p.41-42.<br />
6
produisit vingt ans après cette histoire, en 1582, lorsqu’Oda Nobunaga, l’un des<br />
trois plus grands capitaines de l’époque qui pacifia la moitié du Japon à lui seul,<br />
fut trahit par l’un de ses vassaux. Ranmaru, je<strong>une</strong> homme dont la relation intime<br />
avec Nobunaga était connue, se battit aux côtés de son maître et mourut avec lui.<br />
Une autre différence s’impose alors entre les chigos et les wakashus : alors que<br />
les premiers se contentaient d’être doux, passifs et attentifs à leur maître, les<br />
wakashus étaient au contraire de valeureux guerriers, combatifs.<br />
1.2.6. L’amour homosexuel dans le monde du théâtre (XIe – XVIIIe siècle)<br />
C’est au milieu du Xe siècle que la coutume d’avoir des mignons dans un palais<br />
s’installe. Apparemment, ce serait <strong>une</strong> habitude depuis l’ex-empereur<br />
Shirakawa-In (1053 – 1129) (à cette époque, c’était l’empereur qui quittait son<br />
trône qui possédait le pouvoir réel, afin d’échapper à l’influence de la famille<br />
des régents). On voit donc que c’est à cette époque que la pédérastie a dépassé<br />
l’enceinte des monastères pour atteindre la cour, puis, plus tard, le peuple. Quant<br />
à l’ex-empereur suivant, le fils de Shirakawa, Toba-no-In (1103 – 1156), ce<br />
serait lui qui, comme il adorait la danse des chigos, aurait instauré la coutume<br />
de se poudrer, de se parfumer, de se peindre des faux sourcils et de s’habiller<br />
aussi gracieusement que les je<strong>une</strong>s filles. Cette mode tapageuse et élégante s’est<br />
rapidement répandue au sein de la classe guerrière. Cependant, comme je l’ai dit<br />
précédemment, la culture de la pédérastie dans le monde des samurais n’est<br />
réellement apparue qu’au XVe siècle. L’explication vient du fait que le quartier<br />
général du shôgunat ne se trouvait pas à Kyoto, centre culturel de l’aristocratie,<br />
mais très loin de celle-ci, à Kamakura. Ce n’est qu’en 1336 que le shôgunat fut<br />
déplacé à nouveau au centre Kyoto, et que l’évolution de la pédérastie dans le<br />
monde des guerriers se développa.<br />
Dès lors, comme à la cour, les shôguns et les grands seigneurs prirent l’habitude<br />
d’avoir des mignons dans leur palais. <strong>Le</strong> plus connu des shôguns ayant eu cette<br />
pratique est Yoshimitsu Ashikaga (1358 – 1408).<br />
En 1374, Yoshimitsu assista à un spectacle de sarugaku (littéralement : danse de<br />
singes ; des numéros de jonglerie, de danse, d’acrobatie et de pantomime),<br />
l’ancêtre du Nô. Alors que le sarugaku était considéré comme un divertissement<br />
populaire, le shôgun fut impressionné, surtout par la prestation du je<strong>une</strong><br />
Fujiwaka, qui avait onze ans à l’époque, qui sera plus tard appelé Zéami et qui<br />
deviendra l’un des grands théoriciens du théâtre Nô, tentant de trouver l’idéal du<br />
Nô, le yûgen (subtil (Yû) et profond (Gen).<br />
Grâce à des lettres, on sait que Zéami était en effet très beau, et que les grands<br />
seigneurs qui lui offraient de somptueux cadeaux étaient bien vus par l’empereur.<br />
Il ne fait aucun doute que Zéami fut, dans sa je<strong>une</strong>sse, l’un des mignons de<br />
Yoshimitsu, ce qui n’était absolument pas considéré comme négatif pour<br />
l’époque, au contraire.<br />
<strong>Le</strong> Nô était un spectacle voluptueux, voire érotique, et certaines petites troupes<br />
de provinces n’hésitaient pas à prostituer leurs je<strong>une</strong>s artistes. C’est<br />
principalement par ce biais que la pédérastie atteignit le peuple et les provinces,<br />
à partir de l’aristocratie.<br />
En cette période-là, le terme wakashu se généralisa et engloba également la<br />
définition de chigo. Et c’est sous ce terme que se développa le shudô, dont j’ai<br />
déjà parlé, principalement dans le monde des samurais, mais aussi dans le<br />
7
peuple. Cependant, pour qu’il se développe totalement dans les classes les plus<br />
basses, il faudra attendre la naissance du kabuki, <strong>une</strong> autre sorte de théâtre plus<br />
populaire que le Nô, qui se créa au début de l’Époque d’Edo (1603 – 1868),<br />
période de paix durant laquelle les shôguns dirigeaient le pays.<br />
<strong>Le</strong> kabuki tire son origine des ballets de danseuses, aux alentours de 1600.<br />
C’était donc à la base un onna kabuki, un kabuki de femmes. Celui-ci fut interdit<br />
en 1629 pour cause de dépravation des mœurs, de scènes trop érotiques et parce<br />
que les actrices étaient trop souvent également des prostituées. En réalité, ce<br />
n’était qu’un prétexte pour interdire aux femmes de monter sur scène ; en effet,<br />
le onna kabuki fut rapidement remplacé par la wakashu kabuki, où tous les<br />
acteurs étaient de beaux éphèbes. <strong>Le</strong> shudô, jusque-là réservé aux aristocrates,<br />
devenaient à portée de mains des gens du peuple.<br />
<strong>Le</strong> succès du kabuki par rapport au Nô s’explique de plusieurs manières : il était<br />
totalement profane, il traitait du quotidien, les masques n’étaient pas utilisés et le<br />
charme des acteurs, qui se travestissaient souvent en belles je<strong>une</strong>s femmes - ce<br />
qui plaisait énormément - avait un rôle important, ainsi que les costumes<br />
toujours magnifiques. En d’autres termes, il était devenu accessible à tout le<br />
monde, aristocrate ou pas, ce qui provoqua un enthousiasme incroyable. Un<br />
document de 1658 parle même d’hommes devenant infirmes à cause de<br />
blessures sévères au bras ; <strong>une</strong> blessure au bras signifiait un amour éternel par le<br />
mélange de sang entre deux amants. Quant aux riches, ils dépensaient souvent<br />
tellement d’argent pour ces je<strong>une</strong>s hommes qu’ils finissaient par se ruiner.<br />
On peut tirer <strong>une</strong> conclusion intéressante à partir de cela : les hommes n’étaient<br />
pas dégoûtés par le charme féminin, mais préféraient les hommes au charme<br />
féminin. Pourquoi ? L’amour masculin, tel le feu, a tendance à monter, et<br />
représente le positif (Yin). Quant à l’amour féminin, le principe négatif (Yang),<br />
il descend, comme l’eau. Faire l’amour avec <strong>une</strong> femme était donc rabaissant,<br />
féminisant ; alors qu’avoir des relations avec un homme, quelqu’un d’un niveau<br />
égal, ne provoquait pas cette chute. C’est également ce qui explique pourquoi les<br />
samurais se sont également tournés vers la pédérastie, malgré le fait que rien ne<br />
les empêchait d’aimer les femmes.<br />
Pourtant, en 1652, le wakashu kabuki fut lui aussi interdit pour dépravation de<br />
mœurs. Avant que, sous la pression des admirateurs, ils puissent être rouverts<br />
l’année suivante, avec cependant <strong>une</strong> légère modification qui eut des effets<br />
imprévus sur le développement du kabuki : les acteurs étaient alors obligés de se<br />
faire raser le maé-gami, les cheveux de devant, qui étaient justement le symbole<br />
de beauté des je<strong>une</strong>s hommes. <strong>Le</strong> wakashu kabuki devint alors le yarô kabuki,<br />
yarô désignant <strong>une</strong> sorte de petit mouchoir violet que les acteurs se mirent<br />
depuis lors sur la tête, afin de se rendre à nouveau érotiques. <strong>Le</strong>s hommes<br />
pouvaient donc pratiquer plus longtemps leur art, puisque leur beauté n’était plus<br />
dépendante du maé-gami, que tous les hommes rasaient aux alentours des vingt<br />
ans dans tous les cas. C’est d’ailleurs sous cette forme que le kabuki persiste<br />
aujourd’hui au Japon, puisqu’il est joué par des hommes adultes. Mais, comme<br />
pour le Nô, il a perdu son étendue pédérastique, l’homosexualité étant<br />
actuellement très mal vue au Japon, comme je le montrerai plus tard.<br />
C’est surtout grâce au goût pour la pédérastie des shôguns que le kabuki put<br />
atteindre son apogée. En effet, en théorie, le gouvernement avait interdit aux<br />
comédiens d’être des objets pédérastiques, ce qui n’était évidemment pas<br />
respecté par les dirigeants eux-mêmes. La plupart de ces je<strong>une</strong>s hommes étaient<br />
plus soignés et plus beaux que les je<strong>une</strong>s filles. Encouragé officieusement par la<br />
8
classe des samurais, le kabuki, comme spectacle pédérastique, permis la totale<br />
expansion du shudô dans le peuple à cette époque (1688 – 1704 : ère Genroku).<br />
1.2.7. La mort du shudô en tant que culture pédérastique<br />
C’est au XVIIIe siècle que le shudô, en tant que Voie vers l’Éveil, commença à<br />
décliner, alors que le côté pervers de la pédérastie florissait. De plus, les<br />
prostitués, alors qu’ils s’habillaient en beaux je<strong>une</strong>s hommes auparavant, se<br />
vêtaient comme des je<strong>une</strong>s filles. Ces prostitués disparurent définitivement à<br />
cause de deux lois : la première, datant de 1841, interdisait l’acte<br />
d’homosexualité et condamnait à nonante jours de prison. La deuxième,<br />
proclamée en 1883, remplaça la première, le motif d’accusation était cette fois<br />
l’outrage à la pudeur et condamnait quiconque séduisait un je<strong>une</strong> homme ou <strong>une</strong><br />
je<strong>une</strong> femme de moins de seize ans à un ou deux mois de travaux forcés.<br />
La fin du XVIIIe siècle marque la fin du shudô et le début de l’homosexualité<br />
masculine moderne. Il n’est pas inintéressant de souligner que la fin de ce siècle<br />
marque également la fin de la période de claustration volontaire du Japon, qui<br />
n’avait eu jusque-là que quelques rapports chaotiques avec des commerçants et<br />
religieux occidentaux.<br />
1.3. L’homosexualité dans le Japon contemporain (XIXe – XXIe siècle) 12<br />
1.3.1. Période de transition ; de la mode à la déviance (XIXe siècle)<br />
<strong>Le</strong> XIXe siècle est pourtant un siècle où l’homosexualité est très présente, bien<br />
qu’elle apparaisse sous <strong>une</strong> forme totalement différente, bien plus proche de la<br />
forme qu’elle avait pris en Occident. C’est un siècle de transition, où la forme<br />
change mais où elle est encore <strong>une</strong> sorte de mode, qui commence pourtant à être<br />
critiquée et à être vue comme déviante.<br />
C’est surtout dans l’armée que se propage l’homosexualité mais, à la différence<br />
du shudô, il n’y a plus aucun but éducatif. De plus, les relations se font entre<br />
deux hommes du même âge.<br />
Il en est de même pour le monde estudiantin, à tel point qu’il était plus<br />
dangereux pour les je<strong>une</strong>s hommes de sortir le soir que pour les je<strong>une</strong>s filles à la<br />
fin des années 1890. Mais là aussi, on pourra mettre en avant l’âge identique des<br />
amants. Cependant, le regard n’est plus le même, et des articles de journaux<br />
s’inquiètent de savoir que ce sont ces mêmes je<strong>une</strong>s qui occuperont plus tard les<br />
hauts postes.<br />
12 Pour le chapitre 1.3, les références sont La Voie des Éphèbes, Histoire et Histoires des Homosexualités au<br />
Japon, par Ts<strong>une</strong>o WATANABE et Jun’ichi IWATA. [éd. Trismegiste, 1987] et l’article « Homosexualités<br />
masculines dans le Japon contemporain », par Érick Laurent, in Japon pluriel 4, Actes du quatrième colloque de<br />
la société française des études japonaises. [éd. Philippe Picquier, 2001]<br />
9
1.3.2. Tabou moderne de l’homosexualité (XXe siècle)<br />
L’homosexualité est donc bel et bien devenue <strong>une</strong> déviance sexuelle. Au XXe<br />
siècle, elle entamera <strong>une</strong> décroissance importante, pour ne plus jamais renaître<br />
de la même manière, alors que l’industrie et le capitalisme, eux, ne cessent de<br />
croître. On peut d’ailleurs supposer que ces deux phénomènes ne sont pas sans<br />
rapport. L’influence de la culture occidentale n’a jamais été aussi présente et il<br />
se passe en accéléré au Japon ce qu’il s’est passé en Occident durant des siècles :<br />
le tabou de l’homosexualité.<br />
D’après Michel Foucault 13 , l’influence qu’a eue ce développement industriel,<br />
surtout sur la notion de déviance sexuelle, est due au désir de la classe<br />
ascendante, la bourgeoisie, de contrôler, de banaliser et de comprendre la<br />
sexualité. Entre autres, et c’est un facteur déterminant, cette société en a fait un<br />
outil de reproduction de l’espèce, et non de plaisir. Ce qui, évidemment, excluait<br />
logiquement les rapports homosexuels.<br />
L’industrialisation du Japon a également eu un autre impact : la mort du bushidô,<br />
ou Voie du samurai, qui, rappelons-le, était non seulement un code de conduite<br />
mais aussi un code de l’esthétisme ; les hommes devaient être beaux. Or, avec la<br />
culture occidentale est venue l’exclusivité de la beauté féminine. J’entends par<br />
beauté tout ce qui est soin, maquillage, coiffure, habillement et gestuelle, critères<br />
auxquels répondaient les wakashus et les samurais. En d’autres termes, alors que<br />
c’était considéré comme extrêmement positif au Japon à l’époque, un garçon<br />
efféminé aura tendance à être critiqué et rabaissé aujourd’hui. Pour résumer, un<br />
homme n’a pas le droit d’être efféminé, car cela le rabaisse à la condition de<br />
femme. On verra que cette importance de la beauté n’est pas inintéressante à<br />
étudier d’un point de vue iconographique dans les <strong>yaoi</strong>.<br />
Il est aussi important de préciser que, contrairement à l’Occident où le tabou et<br />
l’interdit de l’homosexualité ont surtout été causés par la répression de l’Église,<br />
c’est l’évolution et la modernisation de la société japonaise qui a transformé la<br />
vision nippone de l’homosexualité pour en faire <strong>une</strong> maladie. La faible<br />
importance du christianisme vient du fait qu’elle ne s’est jamais vraiment<br />
implantée au Japon. En 1942, seule 0,3% de la population était chrétienne, et le<br />
bilan actuel n’est pas plus impressionnant : en 2005, ils étaient seulement deux<br />
millions, soit 2% de la population, à être chrétiens.<br />
1.3.3. Comment les homosexuels japonais vivent-ils aujourd’hui ?<br />
Tout d’abord, on peut constater qu’il y a <strong>une</strong> grande similitude entre la façon<br />
dont l’homosexualité est vécue au Japon et la façon dont elle l’était il y a<br />
quelques années dans les pays occidentaux. Par exemple, il y a de fortes<br />
différences entre l’activité homosexuelle dans les grandes villes comme Tokyô,<br />
qui compte un nombre relativement important de lieux définis comme « gay »,<br />
dont tout un quartier, le Nichôme, qui compte environ 300 bars gays, alors qu’à<br />
la campagne, par peur d’être découverts, les homosexuels cachent leur<br />
orientation sexuelle.<br />
Parallèlement à ces tentatives d’acceptation, les mouvements anti-homosexuels<br />
sont parfois très violents ; <strong>une</strong> partie de la population approuve même le<br />
13 Histoire de la sexualité, tome 1 : La Volonté de savoir, par Michel Foucault [éd. Gallimard, 1977]<br />
10
comportement de certains je<strong>une</strong>s lycéens qui, pour se défouler, allaient tabasser<br />
des homosexuels le soir à coup de battes de base-ball. Une autre constante est<br />
qu’on retrouve aussi plusieurs appellations pour nommer les homosexuels : du<br />
vocabulaire psycho-médical comme dôseiaisha (littéralement, personne aimant<br />
quelqu’un du même sexe, terme utilisé pour les hommes comme pour les<br />
femmes) à celui péjoratif de okama (« marmite, chaudron », en référence à la<br />
morphologie des fesses) en passant par un vocabulaire neutre et populaire,<br />
inspiré de l’anglais (homo ou gei, décrivant uniquement les hommes<br />
homosexuels).<br />
Mais quel est le quotidien des homosexuels adultes ? La grande majorité d’entre<br />
eux pratiquent simplement l’autocensure ; c’est-à-dire qu’ils ne sont pas<br />
ouvertement homosexuels d’un point de vue social. Lors d’<strong>une</strong> étude, publiée<br />
dans Japon pluriel 4, les raisons avancées à ce non-coming out peuvent être<br />
résumées en deux catégories. La première est familiale : c’est pour ne pas<br />
blesser et pour éviter la honte à leur famille qu’ils se taisent. Ce problème peut<br />
plus ou moins être réglé grâce à l’immigration dans les grandes villes, loin de la<br />
famille. L’autre raison est liée à la peur d’être rejeté socialement, voire d’être<br />
licencié de sa boîte. En résumé, la quantité d’avantages est tellement inférieure à<br />
celle des désavantages que les homosexuels ne voient pas l’utilité de se déclarer.<br />
<strong>Le</strong>s homosexuels ont donc <strong>une</strong> double vie : le jour, ils jouent à l’hétérosexuel<br />
« normal », sortent avec des femmes. <strong>Le</strong> soir, ils sortent et fréquentent les lieux<br />
gays, cherchant la rencontre, dans l’anonymat. La conscience de cette double vie<br />
est très présente, la cassure est nette et parfaitement assumée et l’impression de<br />
double personnalité est perçue, voire caractéristique. La plupart d’entre eux se<br />
considèrent eux-mêmes comme anormaux, décalés, voire fous.<br />
Cet ensemble de faits conduit les homosexuels à trouver que, pour eux, vivre au<br />
Japon n’est pas très difficile, malgré la sévérité morale qu’il y a contre<br />
l’homosexualité, à condition de se cacher. Cependant, il est évident que cette<br />
seule condition démontre la discrimination dont l’homosexualité fait l’objet et<br />
qu’elle est effectivement considérée par la société comme anormale, voire<br />
perverse.<br />
Une autre spécificité est liée au mariage. Selon l’étude, près de trois quarts des<br />
gays pensent se marier, soit pour éviter d’être découverts, soit à cause des<br />
pressions familiale et d’« hétéronormativé », qui s’expliquent par le sentiment de<br />
devoir prolonger la lignée familiale, surtout pour le fils aîné. Cette notion est<br />
d’ailleurs apparue au Japon suite à son occidentalisation. Cependant, les<br />
homosexuels des années 2000 veulent trouver <strong>une</strong> épouse qui accepte leur<br />
homosexualité et n’imaginent même pas la leur cacher. Ils critiquent d’ailleurs<br />
ceux l’ayant fait.<br />
En ce qui concerne le cercle d’amis, les demi-mesures n’existent pas vraiment.<br />
Plus de la moitié des homosexuels avouent ne côtoyer que d’autres homosexuels,<br />
surtout à cause des centres d’intérêts alors qu’un quart des personnes interrogées<br />
rencontre exclusivement des hétérosexuels pour se protéger.<br />
Un autre aspect intéressant à étudier est le cadre juridique. 14 Au Japon, il n’existe<br />
auc<strong>une</strong> loi qui interdise les relations homosexuelles, ou l’homosexualité de<br />
manière plus globale. Au contraire, certaines lois protègent les droits des<br />
homosexuels et des transsexuels. <strong>Le</strong> gouvernement de Tokyo a même fait passer<br />
<strong>une</strong> loi qui prohibe la discrimination à l’embauche des homosexuels.<br />
14 Source : http://www.ten-ryu.org/article-21379469.html<br />
11
Cependant, certaines préfectures ont des lois qui cherchent à « protéger la<br />
je<strong>une</strong>sse », en interdisant par exemple aux je<strong>une</strong>s de moins de dix-huit ans<br />
d’avoir des relations homosexuelles, alors qu’ils ont déjà le droit d’avoir des<br />
relations hétérosexuelles. <strong>Le</strong> comportement homosexuel est donc bel et bien vu<br />
comme déviant, mais n’est pas strictement interdit. Il faudra d’ailleurs attendre<br />
2003 pour qu’un candidat transsexuel à un poste d’affaires publiques au Japon,<br />
Aya Kamikawa, se présente et 2005 pour qu’<strong>une</strong> femme de l’assemblée d’Osaka,<br />
Kanako Otsuji, proclame ouvertement son homosexualité. En 2007, elle a même<br />
organisé un mariage public symbolique avec son amie.<br />
Quant aux lois des principales religions du Japon, auc<strong>une</strong> n’interdit<br />
l’homosexualité.<br />
On peut donc en conclure que, ce qui réfrène l’homosexualité au Japon, sont le<br />
contrôle social et l’autocensure. En effet, les Japonais font très attention à leur<br />
image, donc l’étiquette « déviance » que porte l’homosexualité suffit amplement<br />
à empêcher celle-ci de se développer.<br />
Pourtant, on peut noter <strong>une</strong> autre similitude entre le développement de<br />
l’homosexualité moderne en Occident et au Japon : les tentatives de<br />
banalisations et les essais pour lui décoller <strong>une</strong> image sordide apparaissent peu à<br />
peu. Au Japon, l’année 1992 est relativement significative : cette année-là voit<br />
apparaître un engouement, mû par la curiosité, pour les homosexuels. Ce sont<br />
des je<strong>une</strong>s femmes, habitant en ville, qui se rendaient parfois dans les lieux gays<br />
et demandaient poliment aux homosexuels si leur condition n’était pas trop dure<br />
à gérer. <strong>Le</strong>s publications et les dossiers thématiques ont très nettement augmenté<br />
depuis cette période. On pourra constater que cet « engouement soudain » des<br />
je<strong>une</strong>s femmes n’est pas sans rapport avec l’engouement exponentiel qu’a connu<br />
le <strong>yaoi</strong>, les <strong>manga</strong>s traitant de l’homosexualité masculine.<br />
1.3.4. Conclusion<br />
On peut constater que, depuis son introduction au Japon en 806 après J.-C.,<br />
l’homosexualité masculine a suivi deux voies différentes : la première, suite<br />
logique de l’homosexualité qui s’est développée dans l’armée puis dans le milieu<br />
estudiantin, a abouti à l’homosexualité moderne, taboue et anormale.<br />
La seconde est celle du théâtre, qui subsiste encore plus ou moins aujourd’hui<br />
dans les pièces de kabuki. Elle est restée très proche de son point de départ, soit<br />
de l’amour porté à des je<strong>une</strong>s garçons, beaux, doux, passifs et efféminés, qui ont<br />
besoin d’apprendre (ce qui se faisait par le biais des relations pédérastiques). On<br />
pourra constater que, d’un point de vue comportemental et iconographique, c’est<br />
ce deuxième chemin qui se rapproche le plus des relations mises en scène dans<br />
les <strong>yaoi</strong>.<br />
12
1.4. Histoire et développement du <strong>yaoi</strong> 15<br />
1.4.1. Qu’est-ce que le <strong>yaoi</strong> ?<br />
<strong>Le</strong> <strong>yaoi</strong> serait l’acronyme de « YamA nashi, Ochi nashi, Imi nashi », ce qui<br />
signifie « pas de climax [dans la narration], pas de chute [au récit], pas de sens [à<br />
l’histoire] ». Cette origine explique aussi pourquoi son emploi est souvent en<br />
majuscules.<br />
Une autre origine possible viendrait du hentai, <strong>manga</strong> pornographique, et serait<br />
cette fois l’acronyme de « YAmete! Oshiri ga Itai! », ce qui signifierait<br />
« Arrête ! J’ai mal aux fesses ! ». Cependant, la première possibilité est la plus<br />
souvent citée.<br />
<strong>Le</strong> terme désigne, en Europe et aux Etats-Unis, les<br />
<strong>manga</strong>s comportant des relations homosexuelles<br />
masculines, plus ou moins explicites ; la tendance<br />
est d’utiliser le terme shonen-ai pour désigner <strong>une</strong><br />
version ou les relations sont suggestives voire<br />
platoniques. (Il existe un terme bien spécifique pour<br />
les <strong>manga</strong>s comportant des relations homosexuelles<br />
féminines : le yuri (shôjo-ai pour la version<br />
« soft »)).<br />
Au Japon, le terme est beaucoup plus restrictif et<br />
désigne les productions amateurs, vendues hors des<br />
circuits commerciaux. <strong>Le</strong> terme général utilisé au<br />
Japon est boys love, souvent abrégé BL.<br />
La particularité du <strong>yaoi</strong> est que, contrairement aux<br />
ouvrages gays habituels, ils sont écrits par des<br />
femmes et sont destinés à un public féminin<br />
hétérosexuel. Je reviendrai plus tard sur ce point.<br />
1.4.2. Histoire du <strong>yaoi</strong><br />
Couverture du seconde volume de<br />
Gakuen Heaven, de You Higuri,<br />
auteure célèbre de <strong>yaoi</strong><br />
Avant de pouvoir comprendre la naissance du <strong>yaoi</strong>, il faut avoir <strong>une</strong> petite idée<br />
du développement du <strong>manga</strong> de manière générale. C’est au début du XXe siècle<br />
que les premières planches font leur apparition dans quelques magazines<br />
satiriques. Puis, en 1920, deux magazines spécialisés pour les enfants (l’un pour<br />
les garçons et l’autre pour les filles) font leur apparition, insérant quelques<br />
planches dans leur revue. <strong>Le</strong>s histoires ne dépassent cependant jamais <strong>une</strong> seule<br />
page. C’est seulement après la deuxième guerre mondiale que les premières<br />
histoires longues, possédant un véritable scénario, appelées « story <strong>manga</strong> »,<br />
apparaissent.<br />
De 1953 à 1958, le premier shôjo 16 appartenant au « story <strong>manga</strong> »,<br />
intitulé Princesse Saphir est prépublié. Au début, même les auteurs de shôjo sont<br />
des hommes, et ils ne céderont cette place aux femmes que petit à petit, durant<br />
les années 1970. C’est en 1969 que la voie pour le <strong>yaoi</strong> s’ouvre, avec le début de<br />
la prépublication de Fire!, le premier shôjo dans lequel se trouve <strong>une</strong> relation<br />
15<br />
La source concernant ce chapitre est Homosexualité et <strong>manga</strong> : le <strong>yaoi</strong>, dirigé par Hervé Brient. [éd. ÉditionsH,<br />
2008]<br />
16<br />
Manga destiné à un public féminin d’adolescentes, basé sur les relations sentimentales.<br />
13
sexuelle explicite. C’est également à la fin des années 1960 qu’apparaît le<br />
seinen 17 , dans lequel les relations sexuelles sont de plus en plus fréquentes.<br />
<strong>Le</strong>s années 1970 sont donc celles du développement commercial pour le <strong>manga</strong>,<br />
ce qui permit ces différenciations de genre, chacun destiné à un public bien<br />
déterminé, ainsi que le développement de plusieurs thèmes, dont celui du sexe.<br />
Cette époque vit <strong>une</strong> vague de <strong>manga</strong>ka 18 féminins faire son apparition, qui<br />
introduisit l’identité sexuelle, puis la sexualité, dans les shôjo. Surtout, elles<br />
inventent un nouveau genre, alors appelé shônen-ai, mettant en scène <strong>une</strong><br />
histoire d’amour entre garçons et la tragédie de leur relation. Cependant, il faut<br />
évidemment imaginer que les contraintes éditoriales et le je<strong>une</strong> âge des lectrices<br />
ne permettent pas au phénomène de se développer dans le réseau professionnel.<br />
C’est donc dans le réseau amateur, celui des dôjinshi 19 , que se développa le <strong>yaoi</strong>.<br />
Des groupes d’auteurs de dôjinshi firent leur apparition dès les années 1950 ;<br />
mais c’est grâce au premier Comicket (aussi appelé Comiket ou Comic Market),<br />
la plus grande convention du <strong>manga</strong> et de l’animé au monde qui se tient deux<br />
fois par an à Tokyo, en 1975, que l’extension du <strong>yaoi</strong> devient possible.<br />
Justement exemptées de contraintes éditoriales, certaines auteures amateurs<br />
peuvent créer et vendre par ce biais des <strong>manga</strong>s dans lesquels se trouvent des<br />
relations homosexuelles explicites. Ce nouveau genre est à l’origine d’un tel<br />
succès qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour que des éditeurs s’emparent<br />
du phénomène et l’exploitent. <strong>Le</strong> <strong>yaoi</strong> devient alors un genre à part entière et<br />
entre dans le réseau professionnel en prenant le nom de boys love, alors que le<br />
terme <strong>yaoi</strong> reste dans le circuit amateur.<br />
1.4.3. Développement du <strong>yaoi</strong> au Japon, aux États-Unis et en francophonie<br />
Dès le début des années 1980, les magazines de <strong>manga</strong>s, tout genre confondu,<br />
connaissent <strong>une</strong> expansion gigantesque, en passant de 950 millions à 1600<br />
millions de tirages. C’est en 1981 que le <strong>yaoi</strong> s’impose avec le retour du<br />
magazine J<strong>une</strong>, qui ne contient que des histoires traitant de l’homosexualité<br />
masculine. Il avait fait <strong>une</strong> première tentative en 78-79, sous le nom de Comic<br />
J<strong>une</strong>. Aujourd’hui, il a été remplacé par un mensuel, qui a repris le nom de<br />
Comic J<strong>une</strong>, et est toujours publié.<br />
D’autres éditions surfent sur le phénomène de <strong>yaoi</strong> et sortent des magazines<br />
consacrés au <strong>yaoi</strong> ou insèrent dans leurs magazines shôjo des histoires d’amour<br />
entre garçons.<br />
L’<strong>une</strong> des preuves du succès commercial du <strong>yaoi</strong> est que dans les années 1996 à<br />
1998, alors que la crise économique qui touche le Japon atteint son pic, seul le<br />
boys love semble échapper au phénomène de décroissance des ventes de <strong>manga</strong>s.<br />
Certains éditeurs décident même de se lancer dans ce genre, qui offre encore des<br />
possibilités de développement, afin de toucher un public plus large qui<br />
apparemment, achète malgré tout.<br />
Aux Etats-Unis, le <strong>yaoi</strong> est à la mode depuis 2005. Quelques indépendants qui<br />
s’étaient lancés dans la vente de <strong>manga</strong>s, décident de se spécialiser dans le <strong>yaoi</strong>.<br />
17<br />
Manga destiné aux je<strong>une</strong>s adultes, mettant des relations humaines réalistes au premier plan. Souvent plus<br />
violents que le shônen.<br />
18<br />
Auteur de <strong>manga</strong>. <strong>Le</strong> terme peut désigner soit le scénariste, soit le dessinateur ou bien les deux à la fois (cas le<br />
plus fréquent).<br />
19<br />
Auto-publication amateur.<br />
14
<strong>Le</strong>s auteurs sont parfois américains ou coréens, mais seul le genre semble<br />
important pour les lectrices. Un magazine consacré au <strong>yaoi</strong> voit le jour début<br />
2008 et <strong>une</strong> convention <strong>yaoi</strong>, nommée YaoiCon, est organisée depuis 2001 près<br />
de San Francisco, attirant de plus en plus de monde. L’âge minimal pour entrer<br />
est cependant de dix-huit ans.<br />
Sous l’influence du Japon et des Etats-Unis, le <strong>yaoi</strong> ne peut que se développer en<br />
francophonie, qui reste pourtant très pauvre en la matière. <strong>Le</strong> phénomène du <strong>yaoi</strong>,<br />
d’après le responsable du rayon « bandes dessinées » de la FNAC de Lausanne,<br />
ne s’est pourtant mis en place qu’il y a un an et demi et le nombre de titres<br />
disponibles est passé du simple au double dans ce laps de temps, les éditeurs<br />
s’étant enfin rendu compte du potentiel commercial du genre, alors que les fans<br />
existent, elles, depuis bien plus longtemps. C’est l’un des faits qui a poussé les<br />
fans francophones du genre à se tourner vers Internet, où elles peuvent visionner,<br />
la plupart du temps illégalement mais gratuitement, des animes 20 venant tout<br />
droit du Japon et sous-titrés par des fans ou alors suivre <strong>une</strong> série non licenciée<br />
grâce aux scans 21 , également traduits par des fans, suivant ainsi le rythme de<br />
parution japonais.<br />
Peu importe le pays, le <strong>yaoi</strong> est également resté très présent dans le circuit<br />
amateur. Que ce soit par le biais des dôjinshi où grâces aux fan-fictions 22 , les<br />
lectrices de <strong>manga</strong>s créent des histoires où elles peuvent mettre leurs<br />
personnages favoris en couple ; les personnages appartiennent d’ailleurs<br />
rarement à un <strong>yaoi</strong>, comme l’illustre le fan-art ci-dessous.<br />
Fan-art, par CheshireMao, intitulé « ZoroSanji », de Sanji et Zoro, personnages de<br />
One Piece, de Eiichirô Oda, shônen le plus lu au Japon<br />
20 Parfois francisé en « animé », le terme désigne <strong>une</strong> production animée, souvent tirée d’un <strong>manga</strong> (par<br />
exemple : il existe le <strong>manga</strong> Gravitation et l’anime tiré de celui-ci)<br />
21 <strong>Le</strong>s scans sont les planches (≅ pages) d’un <strong>manga</strong>, qui ont été scannées dans le but d’être mises à disposition<br />
sur Internet. Pour certains <strong>manga</strong>s extrêmement connus, comme Naruto, cela permet aux fans de suivre le<br />
rythme de parution japonais.<br />
22 Tiré de l’anglais, parfois appelées Fanfic, Fiction voire même Fic, ce sont des histoires amateurs écrites par<br />
des fans, reprenant les personnages, le contexte ou les deux d’un <strong>manga</strong>. Un vocabulaire très spécifique est<br />
utilisé pour différencier les types de fan-fictions.<br />
15
2. Problématique<br />
2.1. Quel est le lien entre la réalité, historique et actuelle, et la fiction ?<br />
2.1.1. Quel est le regard des Japonais sur leur histoire ?<br />
Avant toute chose, il est important de préciser qu’aujourd’hui, la société<br />
japonaise n’a plus la moindre idée du passé pédéraste de leur histoire. Au<br />
contraire, le concept même aura tendance à les répugner. <strong>Le</strong>s historiens cachent<br />
aux Occidentaux et aux Japonais contemporains cette ancienne tradition et<br />
mêmes certaines élites intellectuelles n’en savent rien. Un tel rejet de<br />
l’homosexualité explique pourquoi Ts<strong>une</strong>o Watanabe, en 1987, a directement<br />
écrit son livre La Voie des Éphèbes, Histoire et Histoires des Homosexualités au<br />
Japon en français. Avec cet ouvrage, il avait d’ailleurs l’intention de montrer au<br />
monde <strong>une</strong> des vérités sur l’histoire pédérastique au Japon 23 .<br />
Une évidence apparaît donc : les auteures de <strong>yaoi</strong> n’ont pas pu s’inspirer<br />
directement de l’histoire de leur pays pour créer des scénarios qui reprendraient<br />
certaines caractéristiques du shudô, puisqu’elles ne connaissent certainement pas<br />
cette ancienne tradition culturelle.<br />
2.1.2. Quels sont les similitudes entre le <strong>yaoi</strong>, l’histoire pédérastique japonaise et la<br />
vision actuelle de l’homosexualité ?<br />
Tout un tas de caractéristiques habituelles du <strong>yaoi</strong> sont comparables, tout du<br />
moins en surface, au shudô ; la plupart des formes sont identiques. La grande<br />
majorité des <strong>yaoi</strong> se ressemblent, reprenant les mêmes idées fondamentales.<br />
Mais alors, quelles sont les caractéristiques d’un <strong>yaoi</strong>, quelles sont celles qui<br />
rappellent l’histoire du shudô et celles qui<br />
montrent que ces histoires sont écrites dans le<br />
Japon contemporain ?<br />
On retrouve deux types de constantes dans ce<br />
genre de <strong>manga</strong>s : les premières sont celles se<br />
rapportant à l’image et les deuxièmes au scénario<br />
et au contexte. Chac<strong>une</strong> de ces caractéristiques<br />
sera approfondie au cours de la suite du travail,<br />
mais on peut en faire <strong>une</strong> première liste.<br />
Pour celles relatives à l’image, on retrouve :<br />
- La beauté 24 des personnages, surtout le plus<br />
je<strong>une</strong>, qu’on confond parfois avec <strong>une</strong> femme : ils<br />
ont de grands yeux, de longs cils, des visages<br />
extrêmement fins, un corps et un style<br />
vestimentaire soignés ; on peut dire qu’il est mignon,<br />
Kanô et Ayase, du <strong>manga</strong> Okane ga<br />
nai, créé par Hitoyo Shinozaki et<br />
illustré par Tōru Kōsaka, illustrent<br />
bien la différence entre seme et uke<br />
23<br />
Préface de La Voie des Éphèbes, Histoire et Histoires des Homosexualités au Japon<br />
24<br />
Ici, il faut voir la beauté comme l’expression de l’ambigüité physique, et donc sexuelle, comme le montre la<br />
norme esthétique des wakashus à l’époque.<br />
16
- La différence de taille, d’âge et de carrure entre le seme 25 (plus âgé, plus grand,<br />
plus masculin) et le uke 26 (plus petit, je<strong>une</strong> et frêle). Opposition qu’on retrouve<br />
aussi dans la couleur des cheveux et des yeux (le uke est souvent blond aux yeux<br />
bleus, ce qui ne fait pas très « japonais », alors que le seme est brun / noir aux<br />
yeux bruns foncés).<br />
<strong>Le</strong> lien entre l’apparence des uke et celle des wakashus est évident : ils sont<br />
je<strong>une</strong>s et beaux, voire efféminés ; ils prennent soin d’eux. <strong>Le</strong> seme, qui est plus<br />
âgé, représente forcément l’autorité et la sagesse, par rapport à l’uke. On peut<br />
donc constater que d’un point de vue iconographique, les <strong>yaoi</strong> reprennent tout ce<br />
qui faisait physiquement un bon wakashu. Cependant, comme dit plus haut, les<br />
créatrices de <strong>yaoi</strong> n’ont pas pu s’inspirer du shudô, on peut donc en conclure<br />
qu’elles ont rendu leurs protagonistes, spécialement l’uke, beaux de manière<br />
instinctive. Ce n’est pourtant pas un choix innocent, et le fait qu’un wakashu fût<br />
beau n’a pas la même signification que le fait que les personnages de <strong>yaoi</strong> le<br />
soient, même si cela montre que les canons de beauté n’ont pas évolué. Ce point<br />
sera étudié de manière plus approfondie plus tard.<br />
Pour celles relatives au contexte et au scénario, on retrouve :<br />
- <strong>Le</strong>s personnages principaux ont vécu un drame, souvent dans leur enfance (le<br />
uke échappe parfois à ce schéma),<br />
- <strong>Le</strong> seme n’est presque jamais exclusivement homosexuel et a déjà eu des<br />
expériences avec des femmes. En général, un seul garçon lui fait de l’effet, ce<br />
qui le fait douter et l’étonne, avant qu’il ne finisse par accepter la vérité,<br />
- <strong>Le</strong> uke est souvent très je<strong>une</strong> (fin du lycée, début de l’université, rarement plus<br />
de vingt ans). Il n’a jamais eu de relation sexuelle et ne s’était jamais vraiment<br />
posé de question sur son orientation sexuelle jusque-là,<br />
- <strong>Le</strong> uke ne comprend pas ses sentiments tout de suite et c’est en général le seme<br />
qui déclenche la relation proprement dite, même s’il existe des exceptions plus<br />
ou moins forte,<br />
- <strong>Le</strong>s amis des protagonistes aident la relation et ne renient jamais l’amitié. Il n’y<br />
a jamais de réaction d’incompréhension ou d’homophobie,<br />
- La famille peut avoir deux types de réaction : soit elle aide aussi le couple,<br />
mais c’est rare, soit elle jouera le camp de l’opposition, qui finit obligatoirement<br />
pas tomber (réconciliation, acceptation, autres membres de la famille<br />
homosexuels, fuite),<br />
- L’histoire finit toujours bien, les personnages sont en couple et heureux. Même<br />
les fins dramatiques sont considérées comme des « happy end » car elles<br />
apportent toujours le bonheur et la liberté aux protagonistes.<br />
<strong>Le</strong> scénario et le contexte apportent des éléments qui rapprochent le <strong>yaoi</strong> de<br />
l’homosexualité telle qu’elle est vécue à notre époque au Japon. <strong>Le</strong> seul élément<br />
qui rappellerait le shudô serait la cadre scolaire, qui revient fréquemment, dans<br />
lequel se trouve souvent l’uke, mais il est évident que le lycée ou l’université<br />
25 Terme utilisé pour définir les comportements amoureux dans les relations homosexuelles masculines. Vient du<br />
verbe « semeru » qui signifie, dans la terminologie sportive, « attaquer ». Il désigne donc le personnage<br />
dominant, actif.<br />
26 Terme utilisé pour définir les comportements amoureux dans les relations homosexuelles masculines. Vient du<br />
verbe « ukeru » qui signifie, dans la terminologie sportive, « recevoir ». Il désigne donc le personnage dominé,<br />
passif.<br />
17
sont simplement un contexte normal pour un je<strong>une</strong>, et l’importance de<br />
l’apprentissage est rarement mise au premier plan, sauf dans les cas ou le seme<br />
serait le répétiteur de l’uke, par exemple. Mais même dans ces cas-là,<br />
l’avancement scolaire reste un prétexte. Par contre, on peut clairement<br />
apercevoir à travers presque tous les <strong>yaoi</strong> que l’éducation sexuelle de l’uke se<br />
fait par le seme. Il ne faut toutefois pas oublier que le shudô était <strong>une</strong> voie pour<br />
atteindre la sagesse et n’était en aucun cas, dans sa définition de base, <strong>une</strong><br />
simple éducation sexuelle.<br />
Quant aux autres caractéristiques du <strong>yaoi</strong>, elles mettent en avant les problèmes<br />
rencontrés par les homosexuels, mais toujours de manière atténuée ; le « happy<br />
end » constant montre parfaitement l’irréalisme de ces fictions. Comme je l’ai<br />
dit dans l’introduction, les homosexuels au Japon vivent presque toujours cachés,<br />
ne révèlent jamais leur orientation sexuelle à leur famille et choisissent leurs<br />
amis de manière spécifique : on peut donc difficilement imaginer que les amis<br />
qui soutiennent le nouveau couple homosexuel sans remise en questions de leur<br />
amitié, que l’homosexualité franchement révélée et que l’opposition parentale<br />
qui ne sert à rien soient représentatives de la réalité. C’est <strong>une</strong> des raisons pour<br />
laquelle peu d’homosexuels lisent ces <strong>yaoi</strong> : ils ne retrouvent pas leur véritable<br />
situation. C’est pourquoi on peut séparer le <strong>yaoi</strong>, <strong>manga</strong> mettant en scène des<br />
relations homosexuelles mais dont le contexte est édulcoré, et les <strong>manga</strong>s ou la<br />
presse gay, écrits par des hommes pour les homosexuels, qui eux sont beaucoup<br />
plus réalistes. Ceci dit, la barrière n’est pas étanche, et les lecteurs passent<br />
souvent de l’un des genres à l’autre.<br />
<strong>Le</strong>s autres éléments ont bien sûr leur signification, mais sont propres au <strong>yaoi</strong> et<br />
n’ont pas de lien particulier avec l’homosexualité japonaise ; au contraire, ce<br />
sont les éléments qui auront tendance à normaliser le <strong>yaoi</strong>. Ils seront également<br />
approfondis plus tard.<br />
Il reste pourtant un aspect à ne pas oublier : pourquoi le <strong>yaoi</strong> s’est-il développé<br />
au Japon, et non pas en Occident, où la bande dessinée était pourtant très<br />
répandue ? Ou plutôt, comment l’idée de mettre en scène deux beaux je<strong>une</strong>s<br />
hommes, dont l’un semble nettement représenter la femme dans le couple, a-telle<br />
pu venir à l’esprit de plusieurs femmes et pourquoi cela n’a-t-il pas choqué<br />
le monde japonais ? « […], l’art nippon ne connaît aucun tabou dans la<br />
représentation sexuelle, et le <strong>yaoi</strong> ne fait pas exception. » 27 En effet, il existe<br />
encore bel et bien un autre art qui met en scène un homme dans le rôle de la<br />
femme : le kabuki, cette forme de théâtre qui a vécu la période du Japon où la<br />
pédérastie a été la plus développée. Il y a donc effectivement un lien entre<br />
l’Histoire homosexuelle japonaise et le <strong>yaoi</strong> : on peut dire que sans cette<br />
évolution, l’idée du <strong>yaoi</strong> n’aurait certainement jamais vu le jour.<br />
27 Homosexualité et <strong>manga</strong> : le <strong>yaoi</strong>, p.72<br />
18
2.2. Pourquoi les <strong>manga</strong>s traitant de l’homosexualité masculine (<strong>yaoi</strong>) sont-ils produits<br />
et lus par des femmes ?<br />
2.2.1. Des auteures proches de leur lectorat<br />
<strong>Le</strong> premier point important à ne pas oublier est que le<br />
<strong>yaoi</strong> est dérivé du shôjo, <strong>manga</strong> romantique à souhait<br />
par excellence qui s’adresse aux filles et qui est écrit<br />
par des femmes. Il semble donc évident que les<br />
femmes soient également les auteures et les lectrices<br />
du <strong>yaoi</strong>. La question est donc plutôt : qu’est-ce qui a<br />
permis la création et le développement du <strong>yaoi</strong> ?<br />
Une partie de l’explication vient du fait que les<br />
auteures de <strong>yaoi</strong>, elles-mêmes souvent grandes<br />
consommatrices du genre, ont commencé en tant<br />
qu’auteures amateurs. Elles participaient aux<br />
différentes conventions <strong>manga</strong>s à travers le Japon, se<br />
Photo, par User:Kamakura du<br />
Comic Market de 2005. C’est la<br />
plus grande convention de <strong>manga</strong>s,<br />
attendant environ 400'000<br />
visiteurs sur 3 jours.<br />
créant ainsi un cercle de lecteurs et <strong>une</strong> certaine notoriété. Ce n’est que plus tard<br />
que les maisons d’éditions ont désiré publier du <strong>yaoi</strong> ; alors, lorsque ces maisons<br />
repéraient <strong>une</strong> auteure talentueuse, cette dernière arrivait déjà souvent à vivre<br />
des conventions et possédait un lectorat fidèle. La plupart du temps, soit elles<br />
refusaient les offres, soit elles restaient au moins en contact avec le monde du<br />
dôjinshi, le monde amateur.<br />
Cette proximité avec les lecteurs, ou plutôt lectrices, a fait que les auteures<br />
pouvaient juger la demande, en ce qui concerne les histoires. Comme le <strong>yaoi</strong><br />
vient du dôjinshi, les histoires sont souvent courtes et dépassent rarement cinq<br />
tomes 28 . De fait, les lectrices demandent un renouvellement constant dans le<br />
contexte dans lequel se place l’histoire : hobbys des héros, professions, époques.<br />
Une autre raison qui explique la proximité entre auteures et lectrices, c’est que<br />
les auteures sont toutes à la base des lectrices, qui ont décidé de se lancer dans le<br />
dessin amateur. <strong>Le</strong>s auteures sont des lectrices comme les autres : il est donc<br />
facile pour elles de suivre la tendance.<br />
<strong>Le</strong> monde du <strong>yaoi</strong> s’est donc développé grâce aux fans, pour les fans et par des<br />
fans. C’est un cercle fermé mais qui accueille chaque année de nouvelles<br />
lectrices et dessinatrices, puisque le genre ne cesse de s’étendre. <strong>Le</strong> <strong>yaoi</strong><br />
s’autoalimente.<br />
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il existe le même état d’esprit chez les<br />
lectrices de <strong>yaoi</strong> en Occident, malgré le fait qu’elles n’aient pas accès à ces<br />
fameuses conventions. Comme il existe peu de <strong>manga</strong>s édités, un réseau<br />
important s’est développé sur Internet, notamment par deux biais : comme je l’ai<br />
déjà dit, la traduction des scans et le sous-titrage des animes, où d’ailleurs on<br />
retrouve souvent des indications comme « sous-titré gratuitement pour les fans<br />
par des fans » et les fan-fictions. Ces réseaux ne sont d’ailleurs pas spécifiques<br />
au <strong>yaoi</strong> mais s’étendent à tous les genres de <strong>manga</strong>s.<br />
28 Un tome contient environ entre 150 et 200 planches, ce qui correspond environ à <strong>une</strong> heure de lecture.<br />
19
2.2.2. Qu’est-ce qui plaît tant aux lectrices dans le <strong>yaoi</strong> ?<br />
Tout d’abord, on peut mettre en relation deux phénomènes chez les lectrices :<br />
premièrement, elles se sont tournées vers les histoires romantiques et érotiques<br />
mettant en scène des couples homosexuels et, deuxièmement, elles ont, pour la<br />
plupart, délaissé les shôjos, tout du moins ceux qui reprennent les clichés<br />
incontournables du genre.<br />
Ce choix à trois causes plus ou moins en relation les <strong>une</strong>s avec les autres, et ce<br />
sont ces causes qu’il est intéressant d’étudier. En effet, il ne semble pas logique<br />
que des adolescentes hétérosexuelles choisissent de fantasmer sur des relations<br />
qu’elles ne pourront jamais avoir et qui ne les concernent donc pas directement.<br />
Ce marché du <strong>yaoi</strong> n’est donc pas logique, et dépend forcément d’un ou<br />
plusieurs problèmes relatifs à la société japonaise, mais également aux sociétés<br />
occidentales, puisque le genre a traversé les frontières.<br />
Ces trois raisons, qui ont finalement permis au <strong>yaoi</strong> de naître, de survivre puis de<br />
s’étendre, peuvent se résumer ainsi : il permet aux femmes de s’identifier<br />
psychologiquement à un personnage sans que leur condition de femme, physique<br />
ou sociale, ne leur soit rappelée, il rend possible les relations sexuelles sans<br />
discrimination et, pour finir, ce genre de <strong>littérature</strong> sert de catalyseur aux<br />
fantasmes féminins.<br />
2.3. Problème d’identification<br />
2.3.1. L’héroïne typique de shôjo et l’uke, <strong>une</strong> femme déguisée<br />
Comme pour tout type de <strong>manga</strong>, le shôjo possède ses codes et ses clichés,<br />
même s’il existe des exceptions. Pour ce qui est du scénario, les constantes sont<br />
à peu de chose près les mêmes que celles du <strong>yaoi</strong>, ce qui n’est pas surprenant<br />
puisque le <strong>yaoi</strong> découle du shôjo et qu’ils ont tous les deux pour thèmes de base<br />
habituels la romance et l’amour. Bien sûr, chacun des deux genres permet ou<br />
interdit certaines situations, mais le but est toujours de provoquer des sontextes<br />
délicate, embarrassante, ambigus. On peut par exemple comparer ces deux<br />
images, où les deux auteurs utilisent la promiscuité gênante d’<strong>une</strong> cabine de<br />
grande roue comme déclencheur :<br />
Tsukasa et Tsukushi, du <strong>manga</strong> (shôjo)<br />
Hana Yori Dango, de Yoko Kamio,<br />
chapitre 125<br />
1<br />
Misaki, dans l’anime <strong>yaoi</strong> de Junjou<br />
Romantica, tiré du <strong>manga</strong> de<br />
Shungiku Nakamura, épisode 21<br />
20
Habituellement, les shôjos ont pour héroïne principale <strong>une</strong> adolescente, plus ou<br />
moins âgée, voire <strong>une</strong> je<strong>une</strong> adulte. La tranche la plus courante est 12 – 22 ans.<br />
Physiquement, elle est petite (souvent moins d’un mètre soixante) ce qui fait<br />
qu’elle a <strong>une</strong> bonne tête de moins que son amoureux ; il ne faudrait surtout pas<br />
qu’elle soit plus grande que lui, bien évidemment, puisque le rôle de protecteur<br />
revient à l’homme. Elle a les cheveux longs (se couper les cheveux, au Japon,<br />
avait la signification d’un échec amoureux), parfois ondulés et surtout rarement<br />
noirs, mais plutôt bruns, voire blonds (or, ce sont deux caractéristiques assez<br />
rares chez les Japonaises). Elle est évidemment fine, et a un tas de prétendants.<br />
Elle n’a pas beaucoup de caractère, est plutôt effacée et déclenche justement ce<br />
besoin de la protéger chez les autres. Bref, elle est parfaite. Et contrairement à ce<br />
qu’on pourrait penser, la majeure partie des shôjos, en tout cas de ceux<br />
disponibles en français, sont réellement fidèles à cette description et possèdent<br />
rarement un scénario recherché, malgré les thèmes plutôt sérieux abordés. <strong>Le</strong>s<br />
séries comptent d’ailleurs souvent peu de tomes, l’intrigue étant vite résolue.<br />
Bien sûr, certains shôjos ne contiennent pas tous ces clichés, leur auteur les<br />
utilisent même volontairement pour les détourner, comme dans Lovely Complex,<br />
où l’héroïne mesure 1m70 alors que le héros ne mesure que 1m56, ce qui leur<br />
pose problème dans leur vie amoureuse respective – il n’est cependant pas<br />
difficile de deviner qu’ils finiront ensemble.<br />
Pour ce qui est des constantes du <strong>yaoi</strong>, plus particulièrement des personnages, je<br />
les ai déjà listées plus haut, mais il ne me semble pas inutile de rappeler que le<br />
uke possède non seulement des caractéristiques habituellement féminines<br />
(grands yeux, visage fin, longs cils, petite taille, caractère un peu naïf,…) mais<br />
occupe également un rôle de femme dans le couple (ménage, cuisine, mais aussi<br />
rôle du dominé dans les relations sexuelles). Finalement, la seule différence<br />
notable entre lui et l’héroïne de shôjo, c’est que c’est un homme. Alors pourquoi<br />
certaines lectrices délaissent ces shôjos pour les mêmes scénarios, mais avec des<br />
personnages masculins homosexuels ?<br />
Il existe des shôjos où l’héroïne représente <strong>une</strong> femme forte, dirigée par ses<br />
raisonnements et non pas par ses sentiments, qui a le droit de goûter à l’aventure.<br />
Il existe aussi des héroïnes qui se battent pour qu’on<br />
reconnaisse leur valeur. Ce n’est pas à ces héroïnes-là<br />
que les lectrices reprochent leur passivité, mais c’est<br />
parce qu’il n’y a que peu de shôjos qui mettent en<br />
place ce genre de personnages féminins qu’elles<br />
recherchent « autre chose ». Et c’est à cause de ce<br />
manque que les lectrices un peu plus âgées se tournent<br />
vers <strong>une</strong> autre forme où la « femme » vaut la même<br />
chose que l’ « homme » : le <strong>yaoi</strong>. Dans les shôjos, les<br />
lectrices s’identifient à un modèle féminin qui leur<br />
renvoie <strong>une</strong> image qu’elles n’apprécient pas,<br />
physiquement comme mentalement. En transformant<br />
l’héroïne en héros, l’identification devient plaisante<br />
car physiquement impossible ; quant au caractère naïf<br />
et maladroit de l’uke, il devient drôle, car associé à un<br />
être masculin, alors que le côté romantique et<br />
sentimental est fort apprécié. C’est donc bien un<br />
problème d’identification.<br />
Lady Oscar, personnage<br />
féminin emblématique de<br />
La Rose de Versailles, shôjo<br />
de Riyoko Ikeda<br />
21
2.3.2. L’identification à l’adolescence<br />
Il devient maintenant nécessaire de se pencher sur cet aspect qu’est<br />
l’identification. Comme je viens de le démontrer, il est le phénomène qui<br />
explique quelles sont la place et l’utilité du <strong>yaoi</strong>. Rappelons d’abord que les<br />
lectrices de <strong>manga</strong>s – de shôjos particulièrement – se tournent vers le <strong>yaoi</strong> aux<br />
alentours de 15 ou 16 ans, soit en plein milieu de la période d’adolescence. Il<br />
faut donc préciser ce terme d’adolescence, dans le contexte qui nous occupe,<br />
puisque cette définition-même explique pourquoi un problème d’identification<br />
survient à cette période : « la période de l’adolescence est un mouvement de<br />
mise en place d’<strong>une</strong> personnalité non encore constituée » 29 , qui est « caractérisée<br />
par la maturation génitale ; maturation génitale qui ne peut se réaliser dans<br />
auc<strong>une</strong> forme normative satisfaisante apportée par le contexte socioculturel ou<br />
éthique » 30 . De plus, selon É. Kestemberg 31 , l’acquisition de l’appareil génital<br />
terminé remet en lumière le conflit œdipien, ce qui provoque un bouleversement<br />
chez l’adolescent de sa relation aux imagos parentales et il a un désir conscient<br />
de les rejeter, pour pouvoir s’affirmer 32 . Pour résumer : « le rejet des imagos<br />
parentales – et donc le conflit d’identification – s’inscrivent en <strong>une</strong> recherche<br />
angoissante de l’identité propre de l’adolescent » 33 . Il faut donc voir cette<br />
période comme <strong>une</strong> phase de doute, de recherche, où l’adolescent tente de<br />
retrouver des images auxquelles il peut se rattacher et s’identifier (les parents ne<br />
pouvant plus remplir ce rôle).<br />
On peut alors se demander si des personnages de fiction – et, dans notre cas, de<br />
<strong>yaoi</strong> – peuvent remplir ce rôle et en quoi ils satisfont ces demandes inconscientes<br />
des lectrices.<br />
2.3.3. S’identifier à un personnage de <strong>yaoi</strong>, en quoi cela résout-il le problème ?<br />
Avant tout, il est important de préciser qu’auc<strong>une</strong> étude n’a été menée<br />
spécifiquement sur le sujet et que les éléments de réponses amenés ici sont donc<br />
le fruit d’extrapolations et d’adaptations. Cependant, il me semble que c’est tout<br />
de même cette idée-là qui explique pourquoi le <strong>yaoi</strong> existe, et rencontre un<br />
certain succès.<br />
D’abord, revenons au problème que consiste l’héroïne de shôjo : il vient de deux<br />
éléments bien distincts. D’<strong>une</strong> part : « <strong>Le</strong>s difficultés de l’adolescent sont donc<br />
essentiellement relationnelles, qu’il s’agisse d’<strong>une</strong> relation avec autrui ou avec<br />
son propre corps, ce dernier étant lui-même mis en relation avec autrui » 34 . Or,<br />
on a vu que l’adolescence consistait à trouver <strong>une</strong> identité propre. Donc : « ce<br />
dont il s’agit, c’est toujours de se conquérir soi-même, certes, au travers d’un<br />
29 « L’Identité et l’Identification chez les adolescents », É. Kestemberg in L’adolescence à vif [Broché, 1999].<br />
30 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.40.<br />
31 Née en 1918 et morte en 1989, c’est <strong>une</strong> psychanalyste française, philosophe de formation. Très inventive et<br />
possédant <strong>une</strong> forte volonté de trouver <strong>une</strong> méthode de traitement pour les patients auxquels <strong>une</strong> cure habituelle<br />
ne convenait pas, elle crée, avec l’aide de René Diatkine et Serge <strong>Le</strong>bovici, le psychodrame psychanalytique<br />
individuel. Elle s’est, entre autres, beaucoup penchée sur le problème de l’adolescence. (Évelyne Kestemberg,<br />
par Liliane Abensour [Broché ; 1 janvier 1999])<br />
32 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.61.<br />
33 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.27.<br />
34 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.62.<br />
22
objet, mais d’un objet mal individualisé en son altérité » 35 . D’autre part, comme<br />
je l’ai déjà dit, les héroïnes de shôjos ne semblent présenter aucun défaut, mais<br />
se comportent de manière passive. La réunion des deux choses semblent<br />
logiquement conduire à un malaise de la lectrice, et donc à un rejet viscéral du<br />
personnage de l’héroïne de shôjo. En effet, la lectrice se sent rabaissée et<br />
inférieure à ce personnage parfait, alors qu’en réalité, l’image de la femme<br />
parfaite ne lui convient pas. Elle ne veut pas ressembler à l’idéal féminin qu’on<br />
lui propose.<br />
Pourtant, puisque le <strong>yaoi</strong> rencontre beaucoup de succès auprès des lectrices, il<br />
faut croire qu’<strong>une</strong> identification à un personnage de fiction n’est pas un système<br />
à exclure dans le but de gérer les conflits œdipiens à l’adolescence. Un cas<br />
intermédiaire – celui d’<strong>une</strong> je<strong>une</strong> femme qui avait fait <strong>une</strong> dépression suite au<br />
divorce de son frère - serait celui résumé en ces termes : « On put ainsi mettre en<br />
lumière qu’en somme, si elle ne vivait pas pour son propre compte, puisqu’elle<br />
ne faisait rien, elle vivait en quelque sorte par l’intermédiaire de son frère auquel<br />
elle s’identifiait en cette participation intense à sa vie amoureuse » 36 . Il est clair<br />
que la personne en question vit au travers d’un personnage, qui pourrait tout<br />
aussi bien être celui d’<strong>une</strong> fiction. De plus, cette constatation a pu être établie<br />
après un traitement psychodramatique 37 , ce qui n’est pas inintéressant. Toujours<br />
d’après É. Kestemberg, celui-ci apporte, grâce à la fiction justement, <strong>une</strong><br />
distance entre l’adolescent et les rôles qu’il joue, ce qui lui permet des<br />
identifications, qu’il pourra nier par la suite si nécessaire, en mettant en avant<br />
l’argument de cette même fiction – il ne jouait pas vraiment son propre rôle.<br />
Et le <strong>yaoi</strong> dans tout ça ? Tout d’abord, on peut constater qu’il répond<br />
parfaitement à la possibilité qu’offre la fiction : <strong>une</strong> variété d’identifications<br />
possibles (en particulier seme ou uke). Mais jusque-là, le shôjo a les mêmes<br />
caractéristiques. Alors qu’apporte en plus <strong>une</strong> relation imagée par deux<br />
hommes ?<br />
Il faut revenir au problème du conflit œdipien remis au premier plan à<br />
l’adolescence, selon la psychanalyse. Comme l’illustre cette citation : « Pour<br />
n’être pas détruite par ma mère que je peux détruire si je suis comme elle, il faut<br />
que je sois comme mon père qui n’est pas comme moi » 38 , le <strong>yaoi</strong> répond par<br />
définition à ce problème, n’offrant auc<strong>une</strong> rivale féminine à la lectrice ; cette<br />
dernière ne peut donc pas être détruite et ne risque pas de détruire.<br />
Enfin, rappelons que l’adolescence est <strong>une</strong> période durant laquelle, bien que<br />
muni d’un appareil génital adulte, l’adolescent ne vit pas dans un contexte<br />
socioculturel dans lequel il a le droit de s’en servir ; il est un être sexué, mais n’a<br />
pas moralement le droit de s’en servir. « […] on peut toujours retrouver au sein<br />
de la crise, la lutte contre les identifications aux images parentales et le rejet de<br />
soi en tant qu’être sexué » 39 . Or, le <strong>yaoi</strong>, même s’il ne permet pas un retour à un<br />
corps asexué, rend possible <strong>une</strong> identification à <strong>une</strong> relation entre personnes du<br />
35 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.142.<br />
36 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.42.<br />
37 On parle ici du psychodrame analytique individuel, créé entre autre par Kestemberg. Il s’agit d’<strong>une</strong> adaptation<br />
du psychodrame, inventé par Moreno, psychiatre et psychologue américain, vers les années 1930. <strong>Le</strong> but est,<br />
grâce à l’interprétation théâtrale, de rejouer des scènes vécues par le patient et, par différents procédés, de faire<br />
ressortir le problème (entre autres en modifiant les réactions de certains personnages par rapport à la réalité). Il<br />
s’agit donc d’<strong>une</strong> mise en scène, soit d’<strong>une</strong> fiction. (<strong>Le</strong> psychodrame psychanalytique, de Evelyne Kestemberg et<br />
Philippe Jeammet [Broché ; 1 mars 1987])<br />
38 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.50.<br />
39 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.37.<br />
23
même sexe, ce qui en ôte le caractère différencient. Ce point est traité un peu<br />
plus bas.<br />
2.3.4. <strong>Le</strong> Cosplay 40 , ou plus précisément, le Crossplay 41<br />
Phénomène ayant été créé aux États-Unis, dans les années 1970, le cosplay a pris<br />
énormément d’ampleur avec les séries de Star Trek et de Star Wars. <strong>Le</strong>s fans<br />
venaient cosplayés lors des conventions sur la science-fiction. Puis, le tout s’est<br />
développé en masse au Japon, ou l’importance est vraiment liée au réalisme du<br />
costume, voire à la ressemblance physique entre le cosplayer et le personnage. Il<br />
n’est pas rare de voir, dans certains quartiers<br />
de Tokyo, des gens cosplayés se promener. En<br />
Europe, il existe <strong>une</strong> dimension beaucoup plus<br />
théâtrale, et les conventions (comme<br />
JapanExpo en France ou Poly<strong>manga</strong> en Suisse)<br />
organisent des concours de cosplay.<br />
Évidemment, le phénomène illustre<br />
parfaitement cette idée d’identification,<br />
puisque les fans choisissent un personnage<br />
auquel ils pensent s’apparenter, physiquement<br />
ou mentalement. Ou simplement, un<br />
personnage qu’ils apprécient. L’important,<br />
c’est que pendant quelques heures, ils<br />
deviennent leur modèle. En rapport avec le<br />
<strong>yaoi</strong>, le crossplay est encore plus évident,<br />
puisqu’il illustre bien l’idée que le sexe du<br />
personnage n’a pas d’importance : mieux,<br />
souvent, les je<strong>une</strong>s femmes ressemblent plus<br />
aux personnages masculins de <strong>manga</strong>s, car leur visage se prête plus volontiers à<br />
l’ambigüité.<br />
2.4. Une relation hétérosexuelle idéalisée<br />
2.4.1. L’hétérosexualité, <strong>une</strong> norme frustrante<br />
Crossplay de Link, héros du jeu<br />
vidéo Zelda, par <strong>une</strong> femme<br />
(Poly<strong>manga</strong> 2009)<br />
Alors que dans nombre des sociétés modernes de nos jours, il subsiste encore et<br />
toujours <strong>une</strong> discrimination envers les femmes, surtout dans le domaine du<br />
travail, il n’est pas difficile d’imaginer qu’<strong>une</strong> certaine discrimination existe<br />
dans les relations hétérosexuelles, à l’égard de la gent féminine. <strong>Le</strong> Larousse<br />
donne pour définition de l’hétérosexualité : « Désir sexuel pour des individus de<br />
sexe opposé ». Cela suppose donc <strong>une</strong> relation homme – femme, ou tout du<br />
moins mâle – femelle, soit déjà <strong>une</strong> différence fondamentale ; la femme est<br />
40 Abréviation des termes anglais « Costume playing », le concept consiste à de déguiser en un personnage tiré<br />
d’un <strong>manga</strong>, d’un jeu vidéo ou même en un acteur ou chanteur.<br />
41 Sous-genre du cosplay, le terme, moins connu et moins employé, désigne un cosplay d’un personnage féminin<br />
par un homme, ou vice-versa. Cependant, le terme « cosplay » est plus souvent utilisé, de manière indistincte. On<br />
peut remarquer l’utilisation du terme anglais « cross » qui, ici, a le sens de « au travers », « s’échanger » (on<br />
retrouve le terme de « crossing-over en biologie ayant le même sens).<br />
24
“autre” que l’homme. Allié à cela, <strong>une</strong> longue tradition socioculturelle<br />
patriarcale, que ce soit au Japon ou en Occident, a donné un statut à chacun des<br />
partenaires, qui est défini, ainsi que son rôle : la femme est la dominée, la<br />
pénétrée alors que l’homme a le rôle contraire. Une femme ayant un fantasme de<br />
domination est généralement vue comme perverse, déviante alors que c’est un<br />
fantasme couramment admis pour les hommes.<br />
De plus, pour <strong>une</strong> femme, <strong>une</strong> relation sexuelle implique parfois certaines<br />
angoisses liées aux grossesses, à la contraception voire, pour les Japonaises, un<br />
souci de « ne plus être bonne à marier » dans le cas de la perte de la virginité.<br />
Quant à ces fameuses héroïnes stéréotypées de shôjos, si l’on se fie à leur<br />
parcours parfait, elles renvoient l’image de je<strong>une</strong>s filles passives, qui ne pensent<br />
qu’à l’amour, sans projet de carrière professionnelle (il est encore normal pour<br />
<strong>une</strong> femme d’abandonner sa carrière au moment du mariage au Japon). De plus,<br />
là-bas, il y a encore peu, <strong>une</strong> « date de péremption » de vingt-cinq ans était<br />
communément admise, au-delà de laquelle <strong>une</strong> femme se devait d’être mariée.<br />
On comprend donc pourquoi la seule véritable préoccupation de ces demoiselles<br />
de shôjo est de se trouver un bon mari. Il n’empêche que l’optique proposée à de<br />
quoi être frustrante pour des femmes cherchant à s’épanouir dans d’autres<br />
domaines, en particulier dans le domaine du travail.<br />
À travers tout cela, le <strong>yaoi</strong> marque <strong>une</strong> envie d’émancipation.<br />
2.4.2. Pour <strong>une</strong> égalité des sexes<br />
En partant donc du principe que la lectrice s’identifie sentimentalement à l’uke,<br />
il lui est possible de vivre <strong>une</strong> relation amoureuse et sexuelle dénuée de<br />
hiérarchie sociale, sans cependant se sentir victime de la relation 42 : « s’identifier<br />
au garçon plutôt que d’être rejetée par lui, ce qui lui permettait en même temps<br />
de dénier sa qualité de femme » 43 . De plus, les lectrices de <strong>yaoi</strong> ont souvent<br />
quinze ou seize ans lorsqu’elles se mettent au <strong>yaoi</strong>, âge auquel elles se<br />
retrouvent facilement confrontées dans leur vie réelle à un regard masculin<br />
parfois désireux. Se voir, en tant que femme, comme objet sexuel n’est pas<br />
évident, surtout que les sociétés modernes n’hésitent pas à réifier le corps<br />
féminin, par exemple dans la publicité. Pouvant donc s’identifier mentalement<br />
mais pas physiquement avec le uke, elles peuvent observer ce désir et en<br />
apprécier le caractère passionnel sans toutefois en ressentir l’agressivité,<br />
puisqu’elle est dirigée contre un corps masculin. De plus, comme je l’avais<br />
mentionné plus haut, on peut également voir le <strong>yaoi</strong> comme <strong>une</strong> « éducation<br />
sexuelle » ; on peut donc supposer que le genre initie les je<strong>une</strong>s femmes, par<br />
identification, au désir masculin.<br />
Il ne faut pas non plus oublier qu’<strong>une</strong> relation homosexuelle masculine signifie<br />
pour certaines femmes, et spécialement celles qui vivent dans des sociétés<br />
codifiées, la liberté : pas d’enfants, pas de mariage, pas de contraintes morales<br />
ou sociales, l’amour pour l’amour, le sexe pour le sexe. Il faut ajouter que,<br />
contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les problèmes liés au sida ou autres<br />
42 <strong>Le</strong>s viols sont très présents dans les shôjos. Il faut cependant dire qu’ils n’ont pas la même signification qu’en<br />
Occident. D’<strong>une</strong> part, ils sont l’expression brute du désir et, d’autre part, <strong>une</strong> femme doit protéger sa virginité,<br />
pour <strong>une</strong> question d’honneur. En d’autres termes, la femme violée qui éprouvera du plaisir lors de la relation<br />
n’aura pas de remords à avoir, puisqu’elle se sera défendue de toutes ses forces.<br />
43 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.35.<br />
25
maladies sexuellement transmissibles ne sont jamais abordés – ou très rarement,<br />
que ce soit dans le shôjo ou dans le <strong>yaoi</strong>.<br />
« […] ; l’adolescent, à la puberté, est contraint à n’avoir qu’un seul sexe, être un<br />
homme ou être <strong>une</strong> femme, mais ne peut plus être quelqu’un qui serait les deux<br />
potentiellement ; fantasme, comme l’on sait, tout à fait prégnant, fécond,<br />
nécessaire au fonctionnement mental. » 44 <strong>Le</strong> <strong>yaoi</strong>, lui, permet en quelque sorte<br />
de contourner cette obligation, par les caractéristiques uniques, mixtes, de ses<br />
personnages.<br />
2.4.3. Mais aussi pour pouvoir s’affirmer<br />
Avant tout, n’oublions pas que le <strong>yaoi</strong> était à la base produit dans un circuit<br />
amateur, les dôjinshis, et mettait en couple des personnages masculins qui, la<br />
plupart du temps, n’avaient rien d’homosexuels dans le <strong>manga</strong> d’origine ; le<br />
genre est également produit et lu par des femmes.<br />
Il permet donc aux femmes, par ces deux biais, de prendre le pouvoir aux<br />
hommes, tout du moins dans le domaine des relations sentimentales. En effet,<br />
alors que dans les shônens, les je<strong>une</strong>s hommes apprennent à protéger les autres<br />
et à ne jamais se laisser faire et que les je<strong>une</strong>s femmes, dans les shôjos,<br />
apprennent à être de bonnes petites<br />
épouses, le <strong>yaoi</strong> offre, lui, la possibilité de<br />
retourner le scénario. <strong>Le</strong>s auteures de<br />
dôjinshis <strong>yaoi</strong> reprennent d’ailleurs<br />
volontiers ces mêmes personnages de<br />
shônens, approfondissant leurs sentiments,<br />
creusant sous le superficiel que représente<br />
l’action, créant des hommes gouvernés<br />
par leur amour. Dans <strong>une</strong> relation<br />
homosexuelle, l’un des deux hommes<br />
sera forcément dominé par l’autre, image<br />
inenvisageable pour des sociétés où<br />
l’homme domine forcément.<br />
<strong>Le</strong>s femmes peuvent donc faire ce<br />
qu’elles veulent de ces hommes, les<br />
mettent dans la situation qui leur plaît ;<br />
bref, elles leur substituent<br />
symboliquement le pouvoir.<br />
2.4.4. Et affirmer ses envies<br />
Lorsque, sur un forum ou dans <strong>une</strong> discussion, la question du « Pourquoi les<br />
filles aiment le <strong>yaoi</strong> ? » apparaît, les réponses des lectrices tournent<br />
majoritairement autour des « Parce que j’aime voir deux beaux garçons<br />
ensemble », ce qui nous donne deux informations : la première est que ces<br />
lectrices aiment voir de beaux je<strong>une</strong>s hommes dans les <strong>manga</strong>s et la deuxième<br />
est qu’elles aiment voir deux hommes ensemble.<br />
44 L’adolescence à vif, par Évelyne Kestemberg [Broché, 1999], p.145.<br />
Shun et Ikki, frères, dans l’anime du shônen<br />
Saint Seiya, de Masami Kurumada, qu’il a<br />
commencé en 1986. Déjà, ces deux personnages<br />
reprennent les codes uke / seme. Il existe<br />
d’ailleurs un nombre important de fan-arts<br />
<strong>yaoi</strong> d’eux.<br />
26
La plupart des <strong>manga</strong>s, shôjos en tête mais aussi shônens ou seinens, contiennent<br />
au moins un personnage qui sera référencié comme le « beau garçon », celui qui<br />
plaît à toutes les filles et ce, ne serait-ce que pour attirer la gent féminine ; le<br />
concept fonctionne d’ailleurs bien puisqu’un magasine comme le Weekly Shônen<br />
Jump, hebdomadaire de prépublication de shônens le plus lu au Japon (presque 3<br />
millions d’exemplaires chaque semaine), et bien qu’il soit initialement adressé<br />
aux garçons, a <strong>une</strong> clientèle féminine qui représente presque 40% des lecteurs.<br />
<strong>Le</strong> Shônen Jump est connu pour pré-publier ou avoir pré-publié pratiquement la<br />
totalité des séries à gros succès comme One Piece,<br />
Naruto, Death Note ou Bleach, voire Dragon Ball à<br />
l’époque, et ce n’est pas un hasard si ce sont ces<br />
mêmes séries qui connaissent les taux de dôjinshis ou<br />
fan-fictions <strong>yaoi</strong> les plus élevés : elles contiennent<br />
toutes des bishônens 45 , souvent par paires. Il ne reste<br />
donc plus qu’aux lectrices amateurs de <strong>yaoi</strong> à créer<br />
des dôjinshis ou fan-fictions, le contexte et les<br />
personnages étant servis sur un plateau. La première<br />
condition n’est donc pas bien dure à réaliser, puisque<br />
les beaux je<strong>une</strong>s hommes sont présents partout dans<br />
les <strong>manga</strong>s.<br />
Par contre, les voir « ensemble », c’est <strong>une</strong> autre<br />
histoire. Pourquoi <strong>une</strong> adolescente hétérosexuelle a-telle<br />
envie de voir deux hommes ensemble ? La<br />
réponse la plus simple, et certainement la plus juste,<br />
est qu’au même titre que le lesbianisme est reconnu<br />
comme étant un fantasme masculin, <strong>une</strong> relation<br />
homosexuelle masculine est un fantasme féminin. Un<br />
autre exemple est que l’auteure, ou la lectrice, peut<br />
également s’identifier au seme, soit dans un rôle<br />
protecteur, soit dans un rôle dominateur.<br />
<strong>Le</strong> <strong>yaoi</strong> sert donc, entre autres, d’exutoire, de<br />
catalyseur pour ces femmes, qui se décrivent elles-<br />
L et Light, personnages du<br />
shônen Death Note, créé par<br />
Tsugumi Ōba et illustré par<br />
Takeshi Obata<br />
mêmes comme « anormales », « perverses » ou « déviantes » lorsqu’elles<br />
évoquent leurs fantasmes, alors qu’il est reconnu que ces fantasmes sont tout à<br />
fait normaux, et même nécessaires 46 .<br />
D’ailleurs, même si l’idée première du <strong>yaoi</strong> peut paraître bizarre et même<br />
déviante, l’interdit ne s’arrête pas là. Alors que l’homosexualité n’est, certes, pas<br />
la norme sexuelle, elle reste tolérée et légale. Or, d’autres perversions, plus<br />
dérangeantes encore, existent dans les <strong>manga</strong>s avec principalement le shota 47 et<br />
l’inceste. Certains pays, comme les États-Unis ou le Canada, ont interdit les<br />
shotas, alors que la France hésite, puisque ce sont des personnages fictifs.<br />
Certains <strong>manga</strong>s parviennent même à regrouper les trois, comme Papa to Kiss in<br />
the Dark, de Nambara Ken.<br />
45<br />
Littéralement « beau garçon ». Personnage masculin au visage androgyne, dont la sexualité est souvent<br />
ambigüe.<br />
46<br />
Dr Catherine Solano, médecin sexologue dans « A quoi servent les fantasmes », http://www.esante.fr/psychologie-couple-servent-fantasmes-NN_6546-92-7.htm<br />
47<br />
Manga où un je<strong>une</strong> garçon pré-pubère ou à peine pubère est vu dans des situations érotiques ou suggestives<br />
avec <strong>une</strong> femme (Straight Shota) ou avec un homme / autre je<strong>une</strong> garçon (YaoiShota)<br />
27
2.5. La question de la norme sexuelle dans le <strong>yaoi</strong><br />
2.5.1. Une hétérosexualité très présente<br />
Tout d’abord, le cœur de cible visé par cette production est les adolescentes<br />
hétérosexuelles qui, si elles ne se reconnaissaient pas en ces personnages,<br />
n’auraient jamais acheté ce produit.<br />
Ensuite, les scénarios romantiques, la très forte présence du thème de l’amour, la<br />
profondeur des sentiments et les situations décrites laissent facilement croire aux<br />
lectrices à <strong>une</strong> histoire de couple « normal », dans laquelle elles peuvent se<br />
projeter. <strong>Le</strong>s problèmes que ce couple rencontre ressemblent beaucoup aux<br />
disputes quotidiennes et rarement aux problèmes liés à l’homosexualité. De plus,<br />
le rythme de l’action est souvent meilleur.<br />
<strong>Le</strong> physique de l’uke est tellement androgyne et son rôle dans le couple est<br />
tellement proche de ceux typiquement féminins qu’il n’est pas bien difficile de<br />
l’imaginer en femme – en général, le personnage prend d’ailleurs plaisir à ce<br />
rôle.<br />
<strong>Le</strong>s personnages sont très rarement des homosexuels affirmés et ont souvent eu,<br />
pour les seme en tout cas, plusieurs relations avec des femmes. <strong>Le</strong> thème même<br />
de l’homosexualité est rarement abordé par les protagonistes, comme si la<br />
question ne se posait même pas dans leur esprit et que seul l’amour était<br />
important, ce qui n’est pas réaliste du tout. Bien sûr, il existe des exceptions,<br />
mais qui tendent à soutenir le scénario. La question est de moins en moins<br />
abordée, les récits étant de plus en plus légers et heureux, alors qu’ils avaient à<br />
l’époque <strong>une</strong> dimension dramatique liée à <strong>une</strong> idée d’amour impossible. Cette<br />
évolution vient sans doute du fait que le <strong>yaoi</strong> est, de manière globale, mieux<br />
compris et accepté ; ainsi, son rôle de catalyseur peut être pleinement satisfait, le<br />
réalisme n’étant pas obligatoire.<br />
<strong>Le</strong>s oppositions familiales, les « questions d’honneur » ou de succession, alors<br />
que le Japon traditionnel y prête <strong>une</strong> grande attention, semblent à peine effleurer<br />
l’esprit des personnages et sont même parfois inexistantes. Lorsqu’il y a <strong>une</strong><br />
opposition, il s’agit en général d’<strong>une</strong> question de rang social, d’âge, d’argent ;<br />
mais rarement d’orientation sexuelle.<br />
D’ailleurs, dans les <strong>yaoi</strong>, la majorité des personnages se révèlent être<br />
« homosexuels », ce qui défie, et de loin, les chiffres statistiques, ce qui tend à<br />
prouver que ces relations « homosexuelles » ne sont pas réalistes.<br />
De ce point de vue-là, le <strong>yaoi</strong>, c’est <strong>une</strong> relation homosexuelle, exprimée par<br />
deux corps physiques semblables – il n’y a plus d’identité sexuée 48 - mais<br />
complémentaires sentimentalement, qui, finalement, font bien plus référence aux<br />
stéréotypes des couples hétérosexuels, soit aux couples « normaux ». Il faut donc<br />
en déduire que, même si le <strong>yaoi</strong> est imagé par des relations homosexuelles, il ne<br />
veut en rien modifier la norme sexuelle.<br />
48 Selon la définition du terme d’après Anne Daflon Novelle dans Identité sexuée : construction et processus. Par<br />
là, le mot « sexué » n’évoque pas un lien avec la sexualité, mais plutôt avec la dimension sociale liée à la<br />
différence entre les sexes<br />
28
2.5.2. Mais représentée par <strong>une</strong> relation tout de même homosexuelle<br />
On ne peut cependant pas omettre le fait que, fondamentalement, il s’agit bien<br />
d’<strong>une</strong> relation homosexuelle entre deux hommes et que cette <strong>littérature</strong> défie par<br />
là la norme.<br />
J’ai expliqué tout au long de ce travail pourquoi le <strong>yaoi</strong> existait, je ne vais donc<br />
pas revenir là-dessus. Or, mis à part la relation homosexuelle elle-même, rien,<br />
dans le <strong>yaoi</strong>, ne tend à explorer le fonctionnement particulier d’<strong>une</strong> telle relation<br />
ou les problèmes typiques qu’elle va rencontrer. Mais alors, a-t-il <strong>une</strong> réelle<br />
influence sur l’homosexualité masculine, malgré le fait qu’il n’en parle pas ?<br />
2.6. En quoi le <strong>yaoi</strong> a-t-il changé la perception de l’homosexualité masculine ?<br />
2.6.1. La communauté gay anti-<strong>yaoi</strong><br />
Avant tout, il faut comprendre qu’au Japon, un acte pouvait être homosexuel,<br />
mais non pas <strong>une</strong> personne ; jamais quelqu’un n’était exclusivement homosexuel<br />
et cela ne constituait pas son identité. Cependant, depuis <strong>une</strong> cinquantaine<br />
d’année, un mouvement gay, au sens occidental donc, s’est créé et a commencé<br />
à revendiquer ses droits, d’abord de manière très discrète puis un peu plus<br />
franchement depuis les années 1990.<br />
C’est cette communauté gay, à l’homosexualité franchement assumée, qui a<br />
critiqué massivement le <strong>yaoi</strong>, ce qui est plutôt surprenant à première vue<br />
puisqu’il devrait aider à l’acceptation de l’homosexualité.<br />
Pourtant, plusieurs reproches ont été faits aux auteures et aux lectrices de <strong>yaoi</strong>.<br />
Ce mouvement a été appelé « controverse du <strong>yaoi</strong> » et a débuté par la<br />
publication d’un article écrit par Masaki Satô, un artiste ouvertement<br />
homosexuel, en 1992, dans un magazine sur la sexualité féminine. Malgré tout,<br />
certains arguments paraissent cohérents et fondés : les personnages de <strong>yaoi</strong> étant<br />
tous extrêmement beaux, les gays qui ne répondaient pas à ces critères<br />
esthétiques se sentent mis à l’écart ; la plupart des <strong>yaoi</strong> créés à cette époque se<br />
déroulaient à l’étranger ou bien les personnages n’étaient pas japonais, les gays<br />
avaient alors l’impression de ne pas pouvoir vivre en tant que gays dans leur<br />
propre pays ; la plupart des personnages de <strong>yaoi</strong> continuent de s’affirmer<br />
hétérosexuels alors, à nouveau, même impression d’impossibilité de vivre<br />
heureux en étant un gay assumé ; la majorité des <strong>yaoi</strong> de l’époque se terminaient<br />
tragiquement : même constat.<br />
Il est donc clair que, du point de vue du réalisme des relations homosexuelles, le<br />
<strong>yaoi</strong> n’a pas aidé les mouvements gays de l’époque, surtout que le <strong>yaoi</strong><br />
commence à bien se vendre, alors que les <strong>manga</strong>s gays restent dans le cadre de<br />
l’ « underground ». Cependant, les réponses données à ces accusations ont été<br />
intéressantes : les auteures ne cherchaient pas à reproduire <strong>une</strong> relation plausible<br />
homosexuelle mais simplement à écrire des histoires d’amour idéalisées sans<br />
passer par la norme homme / femme dans lesquelles elles ne parviennent à voir<br />
la femme que comme victime de la relation.<br />
Ce style de <strong>manga</strong> ne peut donc en aucun cas nous donner des informations sur<br />
le mode de vie des homosexuels au Japon. Mais pouvons-nous exclure la<br />
possibilité qu’il ait eu <strong>une</strong> influence sur la vision de l’homosexualité en général ?<br />
Là, la réponse semble être « non ».<br />
29
2.6.2. <strong>Le</strong>s effets positifs du <strong>yaoi</strong><br />
C’est au début des années 1990 que le <strong>yaoi</strong> commence vraiment à se vendre et<br />
que le marché se développe considérablement. Est-ce <strong>une</strong> coïncidence si, en<br />
1992 : « On a vu, par exemple, débarquer soudain dans les rues de Nichôme ou<br />
dans le seul club Gay-<strong>une</strong>-fois-par-mois de Kyôto, de très je<strong>une</strong>s filles curieuses<br />
qui demandaient poliment « C’est vrai que vous êtes homosexuel ? C’est pas<br />
trop difficile à vivre ? » » 49 . L’homosexualité est devenue un sujet à part entière,<br />
dont on parle. Depuis 2000, le <strong>yaoi</strong> est considéré comme un phénomène de<br />
masse, que les éditeurs et autres agents de l’économie japonaise ne peuvent plus<br />
éviter. Or, bien que le genre ne soit pas réaliste, il traite tout de même de couples<br />
homosexuels, ce qui implique de passer outre cette petite bizarrerie et, forcément,<br />
par extrapolation, l’image de l’homosexualité dérange moins.<br />
2.6.3. Une frontière abattue<br />
Ajouté à cela l’occidentalisation toujours plus forte du Japon, l’homosexualité<br />
est aujourd’hui bien mieux acceptée. Quant au <strong>yaoi</strong>, quelques librairies disent<br />
que leur « clientèle <strong>yaoi</strong> » est constituée entre 25% et 30% d’hommes. Si, pour<br />
certains vendeurs, l’argument est qu’ils essaient de mieux comprendre les<br />
femmes à travers leurs lectures, d’autres n’hésitent pas à affirmer que ce sont<br />
certainement des homosexuels. D’après <strong>une</strong> discussion avec un ami hétérosexuel<br />
qui aime le <strong>yaoi</strong>, c’est simplement parce que le scénario lui plaît, et que le<br />
rythme de l’action est meilleur que dans les shôjos. En d’autres termes,<br />
l’homosexualité du couple n’a auc<strong>une</strong> importance pour certains lecteurs. Quant à<br />
certaines femmes, elles achètent du <strong>manga</strong> gay.<br />
De plus, autre preuve que l’homosexualité est mieux acceptée, les amateurs de<br />
<strong>yaoi</strong> n’ont plus peur de s’affirmer en tant que tels et revendiquent leur goût pour<br />
le genre, tout du moins dans leur cercle d’amis.<br />
Quant au lien entre la vision améliorée de l’homosexualité et le <strong>yaoi</strong>, on peut<br />
donner comme exemple les nombreux groupes sur Skyrock souhaitant afficher<br />
leur soutien à la population homosexuelle à travers le <strong>yaoi</strong> 50 .<br />
Mira et Kyousuke, respectivement fils<br />
et père, dans le deuxième OAV (vidéo<br />
d’animation originale) de Papa to kiss<br />
in the Dark, tiré de l’œuvre de<br />
Nambara Ken<br />
49 « Homosexualités masculines dans le Japon contemporain », article d’Érick Laurent, in Japon Pluriel 4, p.309<br />
50 Par exemple : http://groups.skyrock.com/group/5ze0-Fiction-Yaoi-Aide-au-gays<br />
30
3. Conclusion<br />
Après ce travail, il serait difficile de ne considérer le <strong>yaoi</strong> que comme simple<br />
divertissement, alors que, finalement, il s’agit bien de son rôle premier. Comme<br />
on a pu le voir au travers de ce travail, le <strong>yaoi</strong> est un genre de <strong>manga</strong>s bien<br />
particulier, qui ne trouve pas sa justification là où on aurait pu l’attendre, soit<br />
dans la volonté d’<strong>une</strong> meilleure acceptation de l’homosexualité masculine.<br />
Cependant, l’<strong>une</strong> des forces du <strong>yaoi</strong>, c’est que, malgré son véritable but<br />
d’émancipation féminine, il parvient tout de même à jouer sur ce tableau de<br />
l’homosexualité, la rendant moins tabou et mieux acceptée, même s’il lui faut<br />
pour cela répondre, dans le <strong>yaoi</strong>, à un cliché peu réaliste.<br />
En choisissant <strong>une</strong> forme singulière, le <strong>yaoi</strong> s’est fermé à <strong>une</strong> partie des lecteurs :<br />
tout d’abord les hommes qui ne comprennent pas toujours comment <strong>une</strong> fille<br />
peut aimer « voir deux hommes se tripoter ». Et grâce à cette brève étude du<br />
caractère psychologique lié à ce qui peut, entre autre, pousser <strong>une</strong> je<strong>une</strong> femme à<br />
lire ce genre de <strong>manga</strong>s, il nous a été possible de dire pourquoi ce n’est qu’à<br />
partir de 15-16 ans que les filles se mettent au <strong>yaoi</strong>. Ce n’est, et de loin, pas <strong>une</strong><br />
lecture innocente.<br />
Un autre point qu’il est important de relever de cette étude est le manque de<br />
sources et d’études réellement fiables sur le sujet. Considéré comme peu sérieux,<br />
le <strong>manga</strong> de manière générale a de la peine à se faire accepter, et sa portée est<br />
donc peu étudiée, ce qui est réellement dommage quand on constate à quel point<br />
il amène <strong>une</strong> vision intéressante et révélatrice de la société. C’est<br />
particulièrement d’un point vue psychologique que les sources m’ont manquées,<br />
ce qui m’a forcée à extrapoler certaines informations. Ce travail apporte donc<br />
<strong>une</strong> question : quelle influence aura <strong>une</strong> identification féminine à un personnage<br />
masculin de fiction homosexuel, et plus particulièrement sur sa propre relation à<br />
la sexualité ?<br />
Pour terminer, il est primordial de souligner que ce travail m’a permis de mettre<br />
en lumière les enjeux cachés du <strong>yaoi</strong>, ceux qui justifient son existence, ou même<br />
sa création. Alors que ce type de lecture est produit sur-mesure pour plaire et<br />
pour vendre, il est en réalité témoin d’un véritable problème de société : les<br />
femmes ont un besoin d’émancipation. Au Japon, en 1946, elles obtenaient le<br />
droit de vote. En 1985, <strong>une</strong> loi était votée pour certifier aux femmes qu’il n’y<br />
aurait plus de discrimination à l’embauche. Cependant, en 2004, seuls 41% des<br />
femmes étaient actives, dont environ 40% n’avaient obtenu que des postes<br />
partiels, contre 10% pour les hommes. Quant aux postes de cadre, seulement<br />
10% d’entre eux sont occupés par la gent féminine ; et cela, entre autres, parce<br />
qu’il est difficile pour <strong>une</strong> femme de retourner sur le marché du travail après<br />
avoir arrêté quelque temps pour élever des enfants, le système fonctionnant sur<br />
l’ancienneté 51 . <strong>Le</strong> <strong>yaoi</strong> leur permet de se libérer, de prendre emblématiquement<br />
le pouvoir dans <strong>une</strong> société patriarcale, de ne plus se soucier du problème des<br />
enfants. Si le <strong>yaoi</strong> change <strong>une</strong> norme, c’est celle de la condition de la femme. En<br />
un mot, il est symboliquement transgressif.<br />
51 Compte-rendu, par Stéphanie Anne MAURO/ Maison Universitaire France-Japon : conférence du<br />
18/03/2004 « <strong>Le</strong>s femmes et le travail au Japon », Kimie IWATA<br />
31
4. Index<br />
Bishônen : littéralement « beau garçon ». Personnage masculin au visage androgyne, dont la<br />
sexualité est souvent ambigüe.<br />
Boys love (BL) : terme japonais pour tout support (papier, jeu vidéo, animé) comportant des<br />
relations homosexuelles masculines. Correspond à la définition occidentale du <strong>yaoi</strong>, additionné au<br />
shônen-ai.<br />
Chigo : je<strong>une</strong> garçon.<br />
Dôjinshi : auto-publication amateur.<br />
Fan-Fiction : tiré de l’anglais, parfois appelées Fanfic, Fiction voire même Fic, ce sont des histoires<br />
amateurs écrites par des fans, reprenant les personnages, le contexte ou les deux d’un <strong>manga</strong>. Un<br />
vocabulaire très spécifique est utilisé pour différencier les types de fan-fictions.<br />
Kabuki : théâtre populaire plus moderne que le Nô, inspiré de la danse principalement.<br />
Kûkai : moine reconnu comme étant l’importateur de la tradition culturelle de la pédérastie au Japon<br />
à son retour de Chine en 806. Il est le fondateur de l’école Shingon, « vraies paroles », branche du<br />
bouddhisme ésotérique.<br />
Mangaka : auteur de <strong>manga</strong>. <strong>Le</strong> terme peut désigner soit le scénariste, soit le dessinateur ou bien les<br />
deux à la fois (cas le plus fréquent).<br />
Nô : le mot vient d’un verbe qui signifie « pouvoir, être capable de » et prend donc le sens de<br />
« pouvoir, talent » en tant que nom. D’abord utilisé pour définir le talent des artistes, il définit la<br />
pièce en elle-même actuellement. <strong>Le</strong> nô est un drame lyrique (il fait entendre le terme « drame »<br />
dans son sens premier, soit « action »), alliant pantomimes et paroles presque chantées. <strong>Le</strong><br />
protagoniste porte un masque.<br />
Samurai : personne appartenant à la classe guerrière.<br />
Seinen : <strong>manga</strong> destiné aux je<strong>une</strong>s adultes, mettant des relations humaines réalistes au premier plan.<br />
Souvent plus violents que le shônen.<br />
Seme : terme utilisé pour définir les comportements amoureux dans les relations homosexuelles<br />
masculines. Vient du verbe « semeru » qui signifie, dans la terminologie sportive, « attaquer ». Il<br />
désigne donc le personnage dominant, actif.<br />
Shôgun : dirigeant de la classe des samurais.<br />
Shôjo : <strong>manga</strong> destiné à un public féminin d’adolescentes, basé sur les relations sentimentales.<br />
Shôjo-ai : terme désignant tout support (papier, jeu vidéo, animé) comportant des relations<br />
homosexuelles féminines subjectives, voire platoniques. En outre, c’est le terme « soft » du yuri.<br />
Shônen : <strong>manga</strong> destiné à un public masculin d’adolescents, basé sur l’action.<br />
Shônen-ai : terme utilisé en Occident pour définir tout support (papier, jeu vidéo, animé)<br />
comportant des relations homosexuelles masculines subjectives, voire platoniques. En outre, c’est<br />
le terme « soft » du <strong>yaoi</strong>.<br />
Shota : <strong>manga</strong> où un je<strong>une</strong> garçon pré-pubère ou à peine pubère est vu dans des situations érotiques<br />
ou suggestives avec <strong>une</strong> femme (Straight Shota) ou avec un homme / autre je<strong>une</strong> garçon<br />
(YaoiShota).<br />
Shudô : Voie des éphèbes.<br />
Uke : Terme utilisé pour définir les comportements amoureux dans les relations homosexuelles<br />
masculines. Vient du verbe « ukeru » qui signifie, dans la terminologie sportive, « recevoir ». Il<br />
désigne donc le personnage dominé, passif.<br />
Wakashu : je<strong>une</strong> homme<br />
Yaoi : en Occident : tout support (papier, jeu vidéo, animé) comportant des relations homosexuelles<br />
masculines, destiné à un public féminin hétérosexuel. Au Japon, désigne les productions amateurs<br />
et vendue hors des circuits commerciaux de ces mêmes supports. Sauf précision, c’est le sens<br />
occidental qui sera utilisé dans le travail.<br />
Yuri : terme désignant tout support (papier, jeu vidéo, animé) comportant des relations<br />
homosexuelles féminines.<br />
32
5. Bibliographie et sources Internet<br />
Homosexualité et <strong>manga</strong> : le <strong>yaoi</strong> , <strong>manga</strong> 10 000 images, ÉditionsH, France, 2008.<br />
« Homosexualités masculines dans le Japon contemporain », article d’Érick Laurent in<br />
Japon Pluriel 4 Actes du quatrième colloque de la Société française des études japonaises,<br />
[Éd. Philippe Picquier 2001].<br />
La Voie des Éphèbes, Histoire et Histoires des Homosexualités au Japon, par Ts<strong>une</strong>o<br />
WATANABE et Jun’ichi IWATA. [éd. Trismegiste, 1987].<br />
L’adolescence à vif, Éveline Kestemberg, le fil rouge, France, 1999.<br />
« La déviance : normes, transgression et stigmatisation », in Sciences Humaines, 1999, n°<br />
99, pp. 20-25.<br />
Compte-rendu, par Stéphanie Anne MAURO/ Maison Universitaire France-Japon :<br />
conférence du 18/03/2004 : « <strong>Le</strong>s femmes et le travail au Japon », Kimie IWATA.<br />
Psychiatrie et homosexualité : <strong>Le</strong>ctures médicales et juridiques de l'homosexualité dans les<br />
sociétés occidentales de 1850 à nos jours, par Malick Briki et Florence Tamagne [Broché,<br />
2009].<br />
<strong>Le</strong> Droit et le Couple homosexuel, par Flora <strong>Le</strong>roy-Forgeot et Caroline Mécary [Broché,<br />
2001].<br />
<strong>Le</strong>s Archives de mimi yuy : http://www.mimimuffins.com/initiation.html : dernière<br />
consultation : 21.08.2010<br />
Forum sur le <strong>yaoi</strong> : http://boyslove.superforum.fr/forum.htm : dernière consultation :<br />
21.08.2010<br />
Images :<br />
Page de garde : fan-art, par Habox, intitulé « SasuxNaru », reprenant les personnages de<br />
Sasuke et Naruto, du <strong>manga</strong> Naruto, par Masashi Kishimoto<br />
http://browse.deviantart.com/?q=SasukexNaruto&order=9&offset=96#/d1f441j<br />
http://www.editions-tonkam.fr/img/couv/g/9782759501229.jpg<br />
http://browse.deviantart.com/?qh=§ion=&q=ZoroSanji#/d20do9q<br />
http://movies-comics-anime.blogspot.com/2008/06/label-o.html<br />
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Comic_market01.JPG<br />
http://teemix.aufeminin.com/album/see_81438/The-<strong>manga</strong>-and-boss.html<br />
http://fuunoroad.free.fr/gallery/captures/brothers06.jpg<br />
http://club.ados.fr/akito-san/death-note-129526/photo/light-1624062.html#photo-1624062-635-jpg<br />
http://images.ados.fr/bd-<strong>manga</strong>/photo/1985253198/death-note-<strong>yaoi</strong>/light-72461018c.png<br />
33