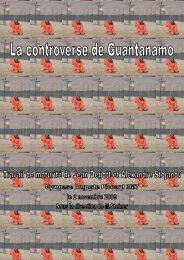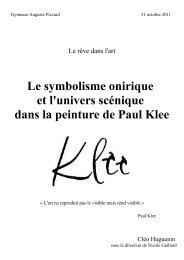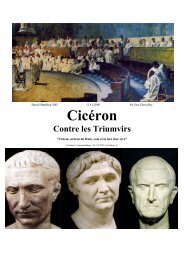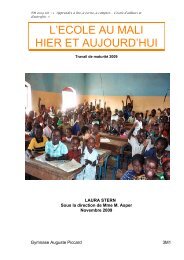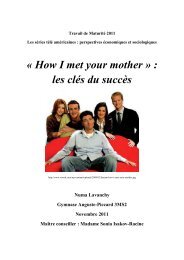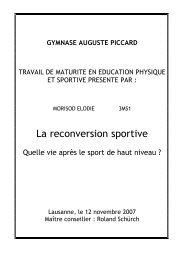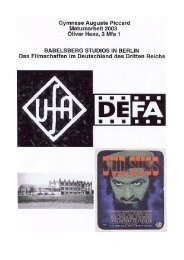Travail complet au format pdf - Gymnase Auguste Piccard
Travail complet au format pdf - Gymnase Auguste Piccard
Travail complet au format pdf - Gymnase Auguste Piccard
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La chanson jazz française Arn<strong>au</strong>d Nussb<strong>au</strong>mer 3M3<br />
Olivier Piguet 13.nov.2006<br />
Vincenzo Di Marco<br />
<strong>Gymnase</strong> <strong>Auguste</strong> <strong>Piccard</strong><br />
Au-delà du masque de Gainsbourg<br />
Chanter parfume crânement la nuit
Remerciements<br />
Sachant pertinemment que les remerciements ne sont lus uniquement par les personnes espé-<br />
rant retrouver leur nom dans une liste interminable, il est de mon devoir d’essayer d’être<br />
concis afin d’éviter à un maximum de personnes non concernées de lire cette page.<br />
Commençons par l’essentiel : merci à Serge Gainsbourg d’avoir été.<br />
Merci <strong>au</strong>x <strong>au</strong>teurs de mes sources qui, avant moi, ont été passionnés par le sujet.<br />
Je remercie également mes deux professeurs : messieurs Vincenzo Di Marco et Olivier Pi-<br />
guet, pour le suivi de ce travail, et l’intérêt qu’ils ont manifesté pour le sujet.<br />
Merci <strong>au</strong>ssi à Cl<strong>au</strong>dio Rugo, mon professeur de guitare, pour les cours d’harmonie qu’il me<br />
donne avec patience…<br />
Merci à mon frère Quentin, qui m’a prêté d’une part son ordinateur avec tous les risques que<br />
cela implique et d’<strong>au</strong>tre part, l’intégrale des disques de Gainsbourg.<br />
Merci à mes parents qui aiment la musique et sans qui je ne serais probablement pas né.<br />
Merci à ma tante Véronique de m’avoir prêté un be<strong>au</strong> documentaire sur Gainsbourg.<br />
Merci à Florian Sulliger et Mathias Rumo pour les séances de photocopies.<br />
Finalement, un grand merci <strong>au</strong> <strong>Gymnase</strong> <strong>Auguste</strong> <strong>Piccard</strong> qui offre un grand choix de sujets<br />
de travail et qui donne les moyens de les réaliser.
Table des matières<br />
I Introduction ………………………………………………………………………………….2<br />
II Les femmes « de » Gainsbourg…………....…….…………………………………………..3<br />
III De la peinture à la musique……...….………………………………………………………4<br />
IV Un amour pur……………….……….……………………………………………………...6<br />
V L’imperfection………………………………………………………………………………7<br />
VI Un Gainsbourg moqueur……………………………………………………………………9<br />
VII Le misogyne……….……………………………………………………………………..11<br />
VIII Le poète et le provocateur……………………………………………………………….12<br />
IX Conclusion………………………………………………………………………………...16<br />
X Sources…………….…….............…………………………………………………………17<br />
XI Annexes………………………...…………………………………………………………18<br />
1
I Introduction « Je suis l’homme à tête de chou »<br />
Il est l’homme à tête de chou ! Difficile de se faire aimer. Et pourtant… « Moitié légume,<br />
moitié mec ». Personnage étonnant, Gainsbourg était <strong>au</strong>ssi une personnalité complexe qui<br />
restera toujours une énigme pour ses admirateurs comme pour ses <strong>au</strong>diteurs. En public, il se<br />
jouait de tout, ne connaissait <strong>au</strong>cune limite. Ses textes, qu’ils portent sur l’amour, la politique,<br />
l’art, ont toujours eu quelque chose de dérangeant ou <strong>au</strong> moins de taquin. Où se trouvait la<br />
limite entre le réel et le jeu, la limite entre l’acteur et l’homme sensé, la limite entre le poète et<br />
le provocateur ? Serge Gainsbourg, chantre de la provocation !<br />
Dans cette présentation, nous 1 nous sommes concentrés sur la « période jazz » de son oeuvre<br />
en choisissant quatre chansons tirées de ses premiers albums. Le premier but de ce travail<br />
étant de comprendre, dans la mesure du possible, certains comportements de Gainsbourg par<br />
l’entremise de sa musique, nous avons choisi un corpus musical en fonction du style des<br />
chansons et du thème qu’elles évoquaient. Ainsi, Elaeudanla teïteïa (1963), La fille <strong>au</strong> rasoir<br />
(1963), En relisant ta lettre (1961) et, Ce mortel ennui (1962) ont été analysées dans l’ordre<br />
précité car, comme nous le verrons plus bas, cet ordre permet de voir une évolution du carac-<br />
tère de Serge Gainsbourg. 2<br />
Ce travail n’a évidemment pas la prétention d’être une étude systématique de la vie de Serge<br />
Gainsbourg. Nos affirmations sont soit des relations trouvées dans des livres cités dans la bi-<br />
bliographie, soit les interprétations ou hypothèses que nous laissent entrevoir les textes de<br />
l’<strong>au</strong>teur. Les deux premiers chapitres portent essentiellement sur la biographie de Gainsbourg,<br />
et ce afin de donner un sens <strong>au</strong>x études de textes qui les suivent. Quant <strong>au</strong> dernier chapitre, il<br />
a pour but de synthétiser les quatre analyses précédentes et nous conduira à la conclusion.<br />
La démarche qui suit nous permettra de vérifier si Gainsbourg était <strong>au</strong>ssi «aquoiboniste» qu’il<br />
le prétendait. La question est la suivante : le masque du cynisme ne pourrait-il cacher <strong>au</strong>tre<br />
chose qu’un visage blasé et moqueur ? Physiquement, moitié légume, moitié mec ; mais psy-<br />
chologiquement… ?<br />
1 La première personne du pluriel est utilisée dans ce travail car j’ai jugé que, ce que j’y disais n’était en fin de<br />
compte, que le fruit de mes lectures et non un travail accompli par ma personne, en son entier. C’est donc par<br />
honnêteté intellectuelle que nous utiliserons cette forme.<br />
2 Afin de rendre le travail plus facile et agréable à lire, les textes des quatre chansons figurent dans l’annexe du<br />
travail<br />
2
II Les femmes « de » Gainsbourg<br />
Comme tous les enfants, Gainsbourg eut comme premier contact féminin, le contact maternel.<br />
De grandes oreilles, braillant dans la petite cuisine d’un appartement misérable à Paris, il est<br />
né le 2 avril 1928. Autant dire qu’il vécut son adolescence durant la deuxième guerre et, étant<br />
juif, qu’il endura de nombreuses persécutions. Sa mère, comme le disait Gainsbourg lui<br />
même, était une sainte. Elle se décarcassait pour trouver des combines afin que tous ses en-<br />
fants mangent à leur faim. Cette énergie qu’elle déployait était le fruit de sa mélancolie, de sa<br />
tristesse. Selon Jane Birkin, qui fut l’épouse de Gainsbourg, ces deux éléments naissaient du<br />
fait que la famille Ginzburg était déracinée. Alors, pour trouver la force de survivre, ils<br />
avaient toujours un « surs<strong>au</strong>t de burlesque » 3 , un sens de la dérision que l’on sent reporté dans<br />
les chansons de Gainsbourg.<br />
La deuxième approche que Serge eut des femmes se déroula dans une académie de peinture<br />
où il rencontra une très belle femme. Cette dernière, probablement un modèle, le croisait ré-<br />
gulièrement. Le jeune apprenti en peinture n’en était pas encore <strong>au</strong> nu. Et son imagination lui<br />
permettait de croire en une femme parfaite, en un tout qui, contrairement <strong>au</strong>x hommes, se<br />
rapprochait de la perfection. Il f<strong>au</strong>t dire que jusque-là le futur Gainsbarre n’avait connu que<br />
deux modèles féminins, sa mère et ce mannequin, qui possédaient tous deux, à leur manière,<br />
quelque chose d’angélique, un aspect de la perfection. Grande fut sa déception lorsqu’un be<strong>au</strong><br />
jour, il aperçut d’entre les jambes d’un modèle un bout de serviette hygiénique. Cet incident<br />
provoqua chez lui une répulsion, qui pourtant donna de be<strong>au</strong>x fruits sous la forme de chan-<br />
sons.<br />
Gainsbourg décrit 4 , ou plutôt cite, de nombreux petites aventures avec des femmes <strong>au</strong> terme<br />
desquelles il ressent toujours une déception profonde. Tout doucement le petit Lucien sentait<br />
en lui poindre une inévitable misogynie bientôt amplifiée par un chagrin d’amour : Serge ra-<br />
conte 5 qu’une fois, alors qu’il avait rencontré une arrière-petite-fille de Tolstoï, il l’emmena<br />
dans sa chambre, et lorsqu’elle fut nue, elle prit peur. Gainsbourg explique qu’il respecta son<br />
appréhension. Il devait la revoir le lendemain, elle n’est pas revenue. Mais quinze ans plus<br />
3 Gilles VERLANT, Gainsbourg ou le garçon s<strong>au</strong>vage, Paris, Albin Michel, 1985, p. 16<br />
4 Gilles VERLANT, Au bout de la nuit, Paris, Editions Hors Collection, 1996, p.88<br />
5 Yves SALGUES, Gainsbourg ou la provocation permanente, éditions Jean-Cl<strong>au</strong>de Lattès, 1989, pp. 141 à 145<br />
3
tard ils se revoient, et Gainsbourg explique : « …Je n’étais plus Lucien, j’étais Gainsbourg et<br />
cette fois c’est elle qui voulait se faire baiser, mais je l’ai envoyée chier… ».<br />
Ainsi Serge Gainsbourg avait grandi, il n’était plus un petit morveux complexé par ses gran-<br />
des oreilles. Il était laid, mais il utilisait sa laideur ; ce qui <strong>au</strong>rait passé pour de la misogynie,<br />
sa dureté envers les femmes, n’avait cessé de croître. Il expliquait cela de la façon sui-<br />
vante : « À cette époque je n’étais pas misogyne, j’étais pudique (…) Comment voulez-vous<br />
qu’avec ma gueule je sois tendre ? » 6 . Durant sa vie, il <strong>au</strong>ra plusieurs femmes. Parfois céliba-<br />
taire, parfois polygame, « ses » femmes vont lui inspirer l’amour. Chacun de ses albums, qu’il<br />
soit jazz, pop, rock, reggae ou funk comportera <strong>au</strong> minimum quelques chansons ayant pour<br />
titre le nom d’une femme. Il chantera le bel amour dans ses grands moments de dépression et<br />
les ruptures quand tout ira bien. Mais jamais, ô grand jamais, il ne dira « je t’aime » sans ar-<br />
rière-pensées ou sous-entendus à une femme. Il alignera par exemple ces deux mots pour<br />
dire : « Je dois avoir perdu la raison, je t’aime Manon ». Ce « Manon » que l’on peut inter-<br />
préter comme un « mais non ». (Cette chanson fut un hommage <strong>au</strong> livre de l’abbé Prévost.)<br />
Son aversion des femmes est née d’une désillusion. Il voulait croire en une femme parfaite<br />
(et, en cela, il pourrait très bien être comparé à Solal des Solal dans Belle du Seigneur), qui<br />
n’existe pas. Celle qui s’approcha le plus de la perfection fut Jane Birkin qu’il dit avoir peinte<br />
avant même de l’avoir connue. « C’était un idéal pictural » 7<br />
III De la peinture à la musique<br />
La musique fut, dans un premier temps, un gagne-pain pour Serge Gainsbourg. Tout comme<br />
son père, il avait eu comme première ambition de devenir peintre. Il avait be<strong>au</strong>coup de talent<br />
et ses professeurs croyaient en lui. Mais il savait pertinemment que, dans le métier, on<br />
« crevait la dalle » et que pour vivre, il lui f<strong>au</strong>drait <strong>au</strong>tre chose. Joseph Ginzburg qui était un<br />
bon pianiste de boîtes avait prévu le coup et avait payé à son fils des cours de guitare. Le voilà<br />
donc lancé dans la musique. Mais quinze années de sa vie avaient été, ou allaient être consa-<br />
crées à la peinture. Autant dire que cela lui laisserait des traces. Quand il parlait de la musi-<br />
que, Serge la définissait comme étant « un art mineur destiné <strong>au</strong>x mineures » 8 . Un art mineur<br />
6 Gilles VERLANT, Au bout de la nuit, Paris, Editions Hors Collection, 1996, p. 91<br />
7 Gilles VERLANT, Au bout de la nuit, Paris, Editions Hors Collection, 1996, p. 18<br />
8 Gilles VERLANT, Au bout de la nuit, Paris, Editions Hors Collection, 1996, p. 46<br />
4
par opposition bien sûr à la peinture. Mineur car, selon lui, tout art pouvant être abordé sans<br />
connaissances préalables (nous vous réservons le droit d’être d’accord ou pas avec cela) ne<br />
peut être considéré que comme mineur. Mais ceci n’avait rien d’insultant pour qui que ce fût<br />
si ce n’est pour Gainsbourg lui-même.<br />
Le plus surprenant dans cette période, est que les rares toiles qui en restent, celle qui n’ont pas<br />
été détruites par Gainsbourg, seraient peintes d’une manière délicate et nous montreraient un<br />
peintre impressionniste <strong>au</strong>x couleurs tendres. Certains disent que c’est une contradiction totale<br />
avec son art, dit mineur, qui est souvent violent, cynique, démesuré, agressif. Nous ne voyons<br />
pas cela ainsi. Ce contraste entre ces deux manières de s’exprimer, ces deux arts, viendrait<br />
d’une frustration. Cette dernière évidemment induite par le fait que Gainsbourg fut forcé à<br />
faire de la musique. Un art majeur plein de vie, de joie, de tendresse ; un art mineur triste, dur<br />
et cynique. Deux aspects complémentaires grâce <strong>au</strong>xquels on comprend que ce peintre-<br />
musicien qu’était Gainsbourg n’était pas tout noir comme ses chansons le laissent entendre.<br />
Serge Gainsbourg raconte que ses premiers souvenirs furent <strong>au</strong>ditifs. Son père, comme nous<br />
l’avons dit précédemment, était un pianiste de boîte. Il était plus précisément ce qu’on appelle<br />
un pianiste de métier et était capable de jouer dans tous les styles. Il faisait partie d’une race<br />
de musiciens qui n’existe plus de nos jours. Son aisance, on la retrouve chez son fils, dans son<br />
style. En effet, du jazz <strong>au</strong> reggae en passant par le rock, on peut dire que Gainsbourg est un<br />
des seuls <strong>au</strong>teurs qui ait essayé et joué <strong>au</strong>tant de styles. Ainsi Serge Gainsbourg fut par<br />
l’entremise de son père, très vite plongé dans la musique.<br />
La musique que Gainsbourg aimait était le jazz. Il aimait Charles Trenet pour son côté swing.<br />
Mais jusque-là, la passion n’y est pas vraiment. Il ne cesse de regretter sa peinture qu’il aimait<br />
tant. Il ne crée rien et ne fait que jouer dans des boîtes pour gagner son pain. Il assiste de ma-<br />
nière intéressée à quelques concerts de jazz, mais sans plus. Jusqu’<strong>au</strong> jour où il voit Boris<br />
Vian sur scène en 1957! « Il prend une claque dans la tronche, c’est le déclic » 9 . Et la passion<br />
est née ainsi. Gainsbourg va alors composer une année plus tard « le poinçonneur des lilas »,<br />
qui, pour une première chanson, et même dans l’absolu, est un chef d’œuvre. Il f<strong>au</strong>t dire que<br />
Gainsbourg a alors trente ans et qu’il a un vaste bagage culturel. Sur scène il se comportera<br />
9 Gilles VERLANT, Gainsbourg ou le garçon s<strong>au</strong>vage, Paris, Albin Michel, 1985, p. 24<br />
5
comme Boris Vian. Froid et rigide, il deviendra d’une totale agressivité face <strong>au</strong> public. Cette<br />
manière de faire est une réaction à la timidité qui l’habitait.<br />
On pourra voir par la suite que Gainsbourg a totalement abandonné le jazz pour se tourner,<br />
dans un premier temps, vers le rock. Cet abandon est, à la musique, ce que fut la destruction<br />
des toiles de Gainsbourg à la peinture. Une envie de détruire 10 sa propre création qui ne<br />
s’atténuera pas avec le temps et qui dévoile chez Gainsbourg un profond besoin de change-<br />
ment, de renouve<strong>au</strong>. « Tout ce qui est atteint est détruit » écrit Montherlant. Peut-être que<br />
Gainsbourg appliquait cette affirmation à la lettre, ou peut-être qu’il adoptait cette attitude<br />
enfantine qui est de toujours vouloir zappper et qu’il gardera toute sa vie.<br />
IV Un amour pur<br />
Comme nous l’avons dit précédemment, Gainsbourg a parlé de nombreuses fois de l’amour<br />
dans ses chansons. Il était féru de jeux de mots, mais dans la chanson qui va suivre, c’est avec<br />
des lettres qu’il joue. « Elaeudanla teïteïa » est une chanson qu’il a écrite en 1963. Dans cette<br />
chanson, il décrit l’amour qu’il porte à une « femme » nommée Laetitia . Un amour maladif<br />
qui irait, à première vue, jusqu’à l’idée de sacrifice. D’un point de vue musical, cette chanson<br />
est très simple : une guitare, une guitare basse et un thème répété huit fois. Elle est ainsi très<br />
répétitive : lorsque Gainsbourg chante ce qu’on pourrait appeler le leitmotiv de la chanson<br />
(Elaeudanla teïteïa) le guitariste joue une ligne de basse qui reprend le thème chanté. Cet effet<br />
de répétition est amplifié par l’utilisation de deux rimes seulement (« ive » et « a »).<br />
L’assemblage de ces deux éléments (répétition et simplicité) et l’absence de percussion donne<br />
la sensation d’être bercé. Ajoutons encore que, quand les couplets sont chantés, la guitare joue<br />
subitement des accords qui, eux, sont gais et offrent une touche de couleur à la chanson, une<br />
touche de rêve.<br />
Au début, Gainsbourg chante le nom de Laetitia qu’il a tapé sur sa machine à écrire. Le sim-<br />
ple fait d’écrire ce nom va faire ressurgir de sa mémoire tout ce qui se rapporte à sa bien-<br />
aimée. Ainsi, les temps des verbes permettent de voir le point suivant : les couplets numéro<br />
deux, trois, quatre, cinq et six sont en fait les pensées de Gainsbourg tournées vers sa bien-<br />
aimée ; pensées induites par l’écriture du nom de Laetitia <strong>au</strong> début comme à la fin de la chan-<br />
10 Gilles VERLANT, Au bout de la nuit, Paris, Editions Hors Collection, 1996, p. 100<br />
6
son. En effet, dans le premier couplet, le temps des verbes est <strong>au</strong> passé composé ; Gainsbourg<br />
décrit alors ce qu’il a fait. Puis, du passé composé <strong>au</strong> présent, l’<strong>au</strong>diteur saisit que les paroles<br />
dites <strong>au</strong> présent sont le fruit d’une mémoire réveillée par la simple écriture d’un nom. À<br />
l’écriture s’ajoute la parole. Cette manière inlassable de répéter l’épellation d’un prénom nous<br />
montre la force incantatoire de ce prénom (Laetitia) pour Gainsbourg. Une manière scandée,<br />
répétitive et monotone qui sied parfaitement à la musique que nous avons décrite plus h<strong>au</strong>t.<br />
Comme nous l’avons dit plus h<strong>au</strong>t, le premier couplet nous montre implicitement un homme<br />
rêvassant et écrivant le nom de son amour. Le second couplet nous laisse entrevoir que cet<br />
homme est en couple avec une certaine Laetitia. Il aimerait que les jours se suivent et qu’ils<br />
restent comme ils sont sans changement. Le troisième couplet nous apporte un nouvel élé-<br />
ment : le fait de se souvenir de Laetitia est douloureux ; cela nous indique que, soit la<br />
« dulcinée » du narrateur est loin d’un point de vue géographique, soit elle l’a quitté. Rete-<br />
nons la seconde hypothèse. La fleur dont il parle <strong>au</strong> quatrième couplet est la fleur d’amour ici<br />
prise comme symbole de ce h<strong>au</strong>t sentiment. Et l’on voit le jeu <strong>au</strong>quel il se prête. Il sait perti-<br />
nemment que cette fleur est maladive. Cette fleur est malsaine, mais il la touche quand<br />
même ! Provocation, folie ou envie de suicide ? Toujours sur ce même ton monotone, il dé-<br />
clare, dans l’antépénultième paragraphe, qu’il serait prêt à faire n’importe quoi pour elle. Un<br />
amour fou, démesuré. Encore f<strong>au</strong>drait-il définir le terme :« aller à la dérive ». Mais ici il<br />
semblerait que l’in<strong>format</strong>ion réside dans le fait que le narrateur est prêt à tout pour récupérer<br />
son ex-compagne. Dans l’avant-dernière strophe, il avoue qu’il serait irraisonnable de conti-<br />
nuer ainsi à rêver à sa compagne depuis longtemps perdue. Et la dernière strophe nous ramène<br />
à la réalité, à la table sur laquelle il écrivait ce nom, le passé composé reprend, la chanson se<br />
termine.<br />
Cette brève histoire d’amour nous fait penser à un amour d’enfants ou de jeunes adultes. Le<br />
prénom Laetitia n’est d’ailleurs pas anodin. Laetitia est un nom évocateur de joie. Et le p<strong>au</strong>vre<br />
gamin qui voit partir son amour et qui en rêve. Ce rêve propre à l’enfance à laquelle renvoie<br />
le nom en phonétique du titre, cette enfance dans laquelle réside encore un amour pur.<br />
V L’imperfection<br />
En 1963, dans le même album que la chanson précédente, Gainsbourg écrit « la fille <strong>au</strong> ra-<br />
soir ». Cette chanson a pour première symbolique l’incommunicabilité. L’écriture de cette<br />
7
chanson avait été motivée par le plan d’un film dans lequel on voyait une espèce de « garce »<br />
qui se rasait les jambes. Comme <strong>au</strong>tre symbolique on peut voir l’imperfection féminine. En<br />
effet, le simple fait de s’épiler nous rappelle que nous descendons du singe et dans certains<br />
cas, pour certaines personnes (Gainsbourg croyait en une femme parfaite comme nous l’avons<br />
dit plus h<strong>au</strong>t) , cette idée est dérangeante.<br />
La chanson est divisée en quatre couplets. Les trois premiers ont une architecture de rimes<br />
identique: ABABCC. Cette chanson, tout comme la précédente, n’est jouée que par une gui-<br />
tare électrique et une guitare basse. La basse joue de manière continue et soutient ainsi la<br />
chanson ; le guitariste (Elek Bacsik) joue de manière sèche, précise et agressive ce qui crée un<br />
contraste avec la douceur de la voix de Gainsbourg. Dans le premier couplet, le narrateur nous<br />
présente la situation telle qu’il la voit. Une femme (sa compagne) se rasant les jambes. La<br />
« musique créée par le rasoir couvre la chanson dite de Clara. Il y a ici un double sens. Ou<br />
bien le narrateur veut parler d’une chanson s’appelant « la chanson de Clara » 11 qui serait<br />
dans la petite histoire couverte par le bruit du rasoir. Ou bien il parle de la chanson qu’il<br />
chante en la nommant « chanson de Clara » et le rasoir couvrant cette chanson serait la gui-<br />
tare. On peut <strong>au</strong>ssi retenir les deux sens. En fin de paragraphe, la phrase « elle aimait ses ca-<br />
resses » (les caresses du rasoir, évidemment) nous montre une certaine insatisfaction du nar-<br />
rateur. Comme s’il avouait que sa compagne préférait les caresses de son rasoir <strong>au</strong>x siennes.<br />
Ainsi le rasoir prendrait plus d’importance que l’homme dans la vie de Clara. Serait-ce un<br />
amour fétichiste que nous décrit ici Gainsbourg ? Dans l’optique du schéma quinaire, la com-<br />
plication se trouverait dans le second paragraphe. Le narrateur ressent comme une rage in-<br />
duite par le rasoir électrique, mais cette rage qui l’anime, il la garde pour lui, il reste silen-<br />
cieux. Dans le troisième paragraphe, quand il se décide à parler à Clara pour lui dire qu’il est<br />
agacé, il se rend vite compte que cela n’intéresse pas son interlocutrice. Elle continue tran-<br />
quillement ses petites affaires ; et le balancement tranquille de la chanson reflète très bien ce<br />
comportement qu’adopte Clara. Alors le narrateur explose en fin de troisième paragraphe et<br />
déclare son amour. « Sous le rasoir électrique, tu n’as rien entendu Clara … ». Ce dernier pa-<br />
ragraphe nous montre, ou plutôt, sous-entend qu’un homme est en train de bouillir, qu’une<br />
violence contenue, mais qui explosera bientôt, reste pour l’instant à l’intérieur de cet homme.<br />
La guitare accentue cette sensation de rage contenue. Le narrateur, les dents serrées, rumine<br />
son incapacité à se faire entendre.<br />
11 Qui est probablement un clin d’œil à la chanson de Lara de M<strong>au</strong>rice Jarre et de Hubert Ithier<br />
8
Cette deuxième chanson nous montre quelques éléments qui ont fait de Gainsbourg un miso-<br />
gyne : le narcissisme de Clara et sa nature imparfaite. Une imperfection qui peut être compa-<br />
rée à celle que Gainsbourg avait perçu lors de l’épisode de la serviette hygiénique cité plus<br />
h<strong>au</strong>t. On sent alors que cette histoire de rasoir se termine sur une tension qui devra un be<strong>au</strong><br />
jour se résoudre. Mais la suite, nous pouvons la deviner.<br />
VI Un Gainsbourg moqueur<br />
« En relisant ta lettre » est une chanson que Gainsbourg écrivit en 1961 et dans laquelle nous<br />
pouvions voir Gainsbourg commenter une lettre qu’il a reçue d’une de ses compagnes. Cette<br />
dernière semble éperdue d’amour pour cet homme qui, avec l’âge, devient de plus en plus<br />
railleur.<br />
La musique fait sourire et a presque quelques teintes grotesques. Elle est lente et soporifique.<br />
Une batterie, un saxophone baryton, un saxophone ténor, une clarinette et une flûte traversière<br />
jouent de manière posée et continue pour les trois premiers, et en alternance pour les deux<br />
derniers (le premier et le troisième quart de la chanson pour la clarinette et le deuxième et<br />
quatrième quart pour la flûte). L’orchestration et la façon dont chante Gainsbourg le font ap-<br />
paraître comme quelqu’un de dédaigneux voire snob.<br />
La chanson commence par cette constatation, dite d’une voix neutre, à peine dédaigneuse :<br />
« En relisant ta lettre, je m’aperçois que l’orthographe et toi ça fait deux ». Cette lettre com-<br />
prend un très fort message d’amour et de détresse que Gainsbourg ne prend pas <strong>au</strong> sérieux<br />
mais tourne plutôt en ridicule en ponctuant le texte de petites remarques assassines toutes en<br />
rapport avec la manière d’écrire la lettre. Plus une question de forme que de fond en fin de<br />
compte. Et en cela on reconnaît très bien Gainsbourg qui, comme nous l’avons déjà montré,<br />
était très attaché <strong>au</strong>x apparences. Cela s’explique-t-il par le complexe développé en raison de<br />
sa propre laideur ?<br />
Nous avons fractionné la chanson en huit parties ; la phrase d’introduction citée plus h<strong>au</strong>t<br />
n’entrant pas en compte dans ce calcul. Toutes les six lignes commence une nouvelle partie.<br />
Les cinq premières parties présentent toutes le même schéma : quatre des six lignes font par-<br />
ties de la lettre, les deux <strong>au</strong>tres sont des commentaires du narrateur. Lorsque Gainsbourg<br />
chante la lettre à proprement parler, il le fait d’une voix mielleuse comme s’il imitait la voix<br />
9
de sa compagne . Mais lorsqu’il fait ses commentaires liés à l’orthographe, il les dit sur un ton<br />
moqueur.<br />
Dans la première partie, la fille déclare son amour. Dans la deuxième, elle demande à Gains-<br />
bourg de na pas la délaisser. Dans la troisième, elle pose un jugement et expose ses senti-<br />
ments. Elle trouve la perspective d’une rupture ridicule et explique que ça la touche énormé-<br />
ment. Dans la quatrième, elle fait du chantage. En effet, elle déclare qu’en cas de séparation,<br />
elle en finira avec la vie. Dans la cinquième, l’<strong>au</strong>diteur peut voir (ou plutôt entendre) une once<br />
de proposition immédiatement changée en insultes. La dernière partie, dans laquelle on peut<br />
voir directement la lettre, nous montre que la fille menace le narrateur. Gainsbourg écrit cela<br />
comme si ce cursus s’appliquait à toutes les relations et comme s’il n’y avait plus rien à en<br />
retirer étant donné que ce sentiment est connu et répétitif. Cette vision pessimiste est très cer-<br />
tainement l’effet ainsi que la c<strong>au</strong>se de nombreuses expériences amoureuses qui <strong>au</strong>raient mal<br />
tourné.<br />
Dans la sixième partie, on peut voir que le nombre de lignes partagées entre la fille et le nar-<br />
rateur est équilibré (ils en ont trois chacun). Ceci introduit les deux dernière parties qui, telles<br />
que nous les avons interprétées, ne contiennent que du texte dit par le narrateur. De plus,<br />
Gainsbourg qui, durant toute la chanson semble intouchable, « intouché » par les propos de la<br />
fille, paraît presque troublé par le « ça s’ra ta f<strong>au</strong>te » qu’il répète comme pour s’en rendre bien<br />
compte, comme s’il méditait là-dessus. On verrait ainsi Gainsbourg s’émouvoir devant un<br />
éventuel suicide de sa compagne ; suicide dont il serait la c<strong>au</strong>se. Ceci peut évidemment être<br />
interprété d’une <strong>au</strong>tre façon. Gainsbourg semble étonné de ne pas voir de f<strong>au</strong>tes<br />
d’orthographe dans cette phrase c’est pourquoi il croche dessus. Quoi qu’il en soit, il reste sur<br />
cette dernière remarque et ceci le fait réagir.<br />
Les deux dernières parties forment la réponse du narrateur après la lecture de la lettre. Les<br />
parties sept et huit sont chantées d’une manière confondant les deux tons utilisés précédem-<br />
ment. Dans la partie sept, Gainsbourg sous-entend que la fille menaçait de se suicider en pre-<br />
nant plusieurs cachets de gardénal. Le narrateur lui répond nonchalamment qu’elle devrait<br />
n’en prendre qu’un, et, comble de l’ironie, il lui lance que ça la calmera ! Enfin, dans la der-<br />
nière partie, il lui explique qu’après avoir pris son médicament, tout ira mieux (« l’cafard, les<br />
pleurs, les peines de cœurs »). Une <strong>au</strong>tre manière de minimiser l’importance de l’amour :<br />
même après les plus grosses peines, un cachet et ça repart !<br />
10
Cette troisième chanson nous permet de voir un Serge Gainsbourg h<strong>au</strong>tain dont on pourra dire<br />
que : « lui c’est un homme d’expérience », regardant de h<strong>au</strong>t les affres de l’amour.<br />
VII Le misogyne<br />
Le quatrième et dernier texte que nous allons étudier a été écrit avant les trois <strong>au</strong>tres. Cette<br />
chanson, intitulée « ce mortel ennui », écrite en 1958, nous parle du sentiment de Gainsbourg<br />
(comme d’habitude), lorsqu’il est en couple avec une femme. Un rythme lent d’ambiance<br />
nous rappelle ces vieux films de gangsters à la s<strong>au</strong>ce américaine : l’<strong>au</strong>teur <strong>au</strong>rait très bien pu<br />
faire la bande originale d’un film comme les tontons flingueurs. Cette atmosphère feutrée<br />
pourrait laisser croire, comme nous le verrons plus bas, que Gainsbourg se complaît dans cet<br />
ennui.<br />
Musicalement, cette chanson comprend trois thèmes : le premier, dont la première ligne est<br />
toujours ponctuée du mot « ennui », est dit, ainsi que joué (piano, guitare basse, xylophone,<br />
guitare, batterie) d’une manière saccadée et très lente. Ce procédé met en exergue l’« ennui ».<br />
En effet, l’ennui est dû à la répétition de choses, d’événements. Ici, le fait de jouer d’une ma-<br />
nière si « carrée » sous-entend que tout est répétitif. Le deuxième thème, interprété d’une ma-<br />
nière plus fluide, est joué lorsque Gainsbourg se met à s’imaginer en train de faire bouger les<br />
choses (« Le jour où j’<strong>au</strong>rai assez d’estomac » ou encore « Il f<strong>au</strong>dra bien que je me décide un<br />
jour »). Ce thème, joué deux fois dans la chanson, est plus coulant afin d’imager la rêverie du<br />
narrateur. Le troisième thème, que l’on pourrait appeler communément un bridge 12 , est joué<br />
<strong>au</strong> milieu de la chanson. Il est utilisé pour décrire le quotidien du couple, et, de ce fait, se pré-<br />
sente comme étant un peu plus lent que les deux précédents.<br />
Ainsi, Gainsbourg s’ennuie dans toutes ses relations amoureuses (« ce mortel ennui (…) qui<br />
me suit pas à pas »). Mais pourquoi continuerait-il alors de vivre avec des femmes qui sont<br />
selon lui mortellement ennuyeuses ? Sa chanson nous l’explique : la première réponse est tout<br />
simplement physique (« il n’est rien besoin de dire à l’horizontale »). La seconde est plus mo-<br />
rale. Il a peur que l’abandon, plonge sa compagne dans une telle tristesse qu’elle se suicide. Il<br />
serait pourtant possible de croire que Gainsbourg lui-même pu éprouver de l’attachement pour<br />
une femme et ses qualités : ses attraits physiques évidemment mais <strong>au</strong>ssi la sensibilité et la<br />
12 En Français : un pont. Elément (partie) de transition reliant un couplet à un refrain ou deux couplets.<br />
11
tendresse qu’elle lui porte. Mais le dénouement de la chanson est moins poétique : on apprend<br />
que s’il reste avec les femmes, c’est pour ne pas avoir (comble de l’absurde)… d’ennuis.<br />
Nous avions dit précédemment que « la chanson de Clara » portait en elle le symbole de<br />
l’incommunicabilité. Cette dernière se retrouve dans «ce mortel ennui ». Gainsbourg dit qu’ils<br />
ne se disent rien à la verticale (en dehors du lit) et que pour tuer le temps il fait des mots croi-<br />
sés (jeu souvent assimilé, tout comme le solitaire et tetris, à l’ennui). Dans son jeu, il remplit<br />
les lettres « a » et « o » du mot amour (_m_ur). Les trois lettres restantes formant le mot<br />
« mur » représentant ici le signe de l’incommunicabilité. De plus, les phonèmes « a » et « o »<br />
dits ainsi nous rappellent l’expression : Des bas et des h<strong>au</strong>ts (des h<strong>au</strong>ts et des bas). Cela peut<br />
signifier que le narrateur doit remplir lui-même les bas et les h<strong>au</strong>ts du couple étant donné que<br />
jusqu’alors ils étaient inexistants et que cette relation est plate.<br />
Alors, il nous présente la femme qui serait attractive : celle avec qui il pourrait dialoguer.<br />
Paradoxalement, pour se défaire de cette femme ennuyeuse, Gainsbourg ne semble pas vou-<br />
loir adopter la voie du dialogue. Assurément, cette façon d’agir pourrait lui permettre une<br />
séparation sans que, dans un deuxième temps, la femme se suicide. Et Gainsbourg le sait,<br />
avec son intellect supérieur. Mais sa misogynie le pousse à croire que, dans ce cas, le dialogue<br />
ne peut être utile et qu’éternellement il s’ennuiera <strong>au</strong>x côtés de celle qu’il désire. 13<br />
Deux questions se posent alors : croit-il que, même s’il pouvait quitter cette femme, la sui-<br />
vante ne pourrait être mieux ? Ou est-il, somme toute, satisfait de son couple ? Seule la der-<br />
nière phrase de la chanson nous laisse émettre cette hypothèse. Car, s’il se laisse faire c’est<br />
que, dans le fond, cet être caractériel est content de son sort.<br />
VIII Le poète et le provocateur<br />
Gainsbourg, dans sa période jazz, a chanté l’amour tel qu’il le voyait du h<strong>au</strong>t de sa trentaine<br />
d’années. Il s’est souvenu de ses premières amours (Laetitia), ses premières ruptures (Clara)<br />
et la croissance de sa misogynie <strong>au</strong>x dépens de ses illusions (« en relisant ta lettre » « ce<br />
mortel ennui »). Mais il était encore très jeune à l’époque. Que lui a apporté cette perception<br />
d’une certaine aversion pour les femmes puis pour le genre humain sur les trente années qui<br />
13 Ce mortel ennui est la chanson la plus clairement <strong>au</strong>tobiographique : cf. : Gilles VERLANT, Gainsbourg,<br />
Paris, Albin Michel, 2000, p. 148<br />
12
ont précédé sa mort ? En était-il content ? Quelques anecdotes et textes que nous allons par-<br />
courir vont à nouve<strong>au</strong> nous permettre de mieux comprendre un personnage complexe qui<br />
s’était bâti grâce à la musique.<br />
Le poète et le provocateur. Lucien Ginzburg et Gainsbarre. Deux personnages <strong>au</strong>x antipodes<br />
de la moralité et entre eux, un homme : Serge Gainsbourg. Sa musique, son art mineur, a sû-<br />
rement reflété la totalité des épisodes de sa vie. Ses actes et aphorismes furent les connecteurs<br />
articulant la machine de ses pensées, de ses colères, de ses peines, de ses réflexions. Et le<br />
moteur de tout cela : les femmes. Il était misogyne par pudeur. Et sa « gueule » rendait crédi-<br />
ble sa misogynie. Si Gainsbourg avait été un bellâtre éternellement jeune, il n’<strong>au</strong>rait jamais pu<br />
être <strong>au</strong>ssi froid et direct avec les personnes qu’il voyait ou rencontrait. Sa misogynie a tourné<br />
en une misanthropie qui, à son tour, se transforma en provocation permanente. 14<br />
I want to fuck her. Inutile de traduire cette phrase bien connue que Gainsbourg disait sur un<br />
plate<strong>au</strong> de télévision lors d’une entrevue avec Whitney Houston. On reconnaît bien ici Gains-<br />
bourg narguant son monde comme il eut l’habitude de le faire depuis qu’il se fit appeler<br />
Gainsbarre. On le reconnaît également quand il s’insurge contre le système d’imposition fran-<br />
çais en brûlant (encore une fois en direct sur une grande chaîne française !) un billet de cinq<br />
cent francs. Ou encore lorsqu’il fait une attaque cardiaque et qu’on lui prescrit d’arrêter la<br />
cigarette et l’alcool ; il répond que de toute façon, la viande se conserve très bien si on la<br />
fume ou encore si elle reste plongée dans l’alcool 15 . Eternel provocateur dans ses chansons, il<br />
va donner jour à de nombreux titres qui feront jaser la presse bien pensante de Paris tels que :<br />
« Aux armes et caetera », « Lemon inceste », « Rock around the bunker ». Ce dernier titre<br />
sera rejeté par les programmateurs radios (des amateurs en effet) unanimement outragés par la<br />
provocation que représentait cette chanson (voir <strong>au</strong>ssi « S.S. in Uruguay » et « Nazi rock »).<br />
Ces textes sont purement un coup de maître, et l’on pourrait croire que les chaînes radios<br />
avaient alors oublié que le petit Lucien Ginzburg portait l’étoile j<strong>au</strong>ne durant toute la seconde<br />
guerre. Mais Gainsbourg ricane, il rumine sa vengeance. D’ici quelques années, les disques<br />
d’or pleuvront et le nouve<strong>au</strong> Gainsbarre ne s<strong>au</strong>ra plus où les mettre.<br />
14 Gilles VERLANT, Au bout de la nuit, Paris, Editions Hors Collection, 1996, pages 84 à 92. Cette source est la<br />
plus grande c<strong>au</strong>se de ces affirmations. Lesdites affirmations proviennent également du documentaire de Serge<br />
Gainsbourg à Gainsbarre 1958-1991.<br />
15 Gilles VERLANT/ Yves DESNOS/ Yann GRASLAND, De Serge Gainsbourg à Gainsbarre 1958-1991,<br />
France, Universal Picture (France), 1994<br />
13
C’est en ‘79 que Gainsbourg mit à profit son sens de la « provoc » si bien conservé et mesuré<br />
jusqu’alors. Il avait décidé en 1963 de quitter définitivement la scène lorsqu’on lui avait<br />
avoué que lors de l’une de ses représentations, ce n’était pas lui mais un certain Boby La-<br />
pointe faisant l’ouverture qui avait brillé. Un goût amer lui était alors resté dans la bouche<br />
(bel euphémisme). Presque vingt ans plus tard, il revient de Jamaïque avec sous le bras les<br />
bandes de « <strong>au</strong>x armes et caetera ». C’est une réconciliation entre les jeunes et ce quinquagé-<br />
naire toujours intact qui jusqu’ici n’avait jamais été reconnu par les nouvelles générations ! Et<br />
Gainsbourg tellement enchanté de cette réconciliation en a, grand sentimental, les larmes <strong>au</strong>x<br />
yeux. Pour faire taire les critiques « ultra-patriotiques », il achètera à prix fort le manuscrit de<br />
Rouget de Lisle, <strong>au</strong>teur de la Marseillaise.<br />
Ainsi nous avons illustré la vie que mena Gainsbourg par quelques anecdotes. En public, il<br />
était déb<strong>au</strong>ché et rien ne pouvait l’arrêter, mais derrière ce masque qu’il s’était construit, un<br />
homme bien plus sensible et réfléchi voyait le monde d’un œil objectif et agissait en consé-<br />
quence. Par tous ses actes de provocation, il a fait réfléchir ou <strong>au</strong> moins réagir et donc a fait<br />
bouger les choses !<br />
Nous conclurons ce chapitre en posant que nous ne pensons pas que Gainsbourg était misan-<br />
thrope, et encore moins misogyne ; nous pensons qu’<strong>au</strong> contraire, il aimait son monde pour<br />
ses vacheries et qu’il lui pardonnait en lui rendant la pareille et ainsi, en le faisant réagir (cer-<br />
cle vicieux). Le dernier exemple, celui de la Marseillaise, est, de loin, le meilleur : il est allé à<br />
Kingston ; il a réussi à s’y faire accepter ce qui, paraît-il, n’était pas chose aisée, à y pratiquer<br />
sa musique et enfin ramener les meilleurs ragea-men du monde ainsi qu’une très grande chan-<br />
son. Et tout cela pour atteindre les jeunes, une couche de la population qu’il souhaitait avoir<br />
pour public. Finie la musique dite d’intellectuels, place à quelque chose d’accessible, d’ouvert<br />
à tous. Gainsbourg, « musicien-humaniste » des temps modernes, a su utiliser sa misogynie<br />
puis sa misanthropie, deux éléments cultivés avec zèle durant sa vie, dans une démarche qui,<br />
finalement, permit le rapprochement des genres, des couleurs, des époques et des âges.<br />
Dans le fond, les textes qu’écrivit Gainsbourg (<strong>au</strong> premier abord évidemment), ne présentè-<br />
rent jamais rien de bien méchant. À quelques exceptions près, je vous l’accorde. Mais les<br />
tournures que prenait le texte, et cela grâce à une grande capacité à user de l’implicite, pou-<br />
vaient changer un texte d’amour en chanson salace. Ainsi, ce cynique, mais cynique par phi-<br />
lanthropie, a, de son temps, fait crier <strong>au</strong> scandale, a fait pleurer, a scandalisé ou encore boule-<br />
14
versé. Mais c’est le genre d’homme qui, par l’art, fait avancer le monde et, lorsqu’on regarde<br />
le paysage musical français actuel, on ne peut s’empêcher de se dire qu’il manque quand<br />
même un peu.<br />
15
IX Conclusion « Je suis venu te dire que je m’en vais »<br />
Plus qu’un état d’esprit, la misogynie de Gainsbourg fut pour lui un outil, un moyen. Pour se<br />
faire connaître, pour avoir un public, pour se faire aimer, il a su utiliser ce procédé. Lorsqu’il<br />
se comporta tendrement avec l’arrière-petite-fille de Tolstoï, il fut extrêmement déçu.<br />
L’abandonnait-elle pour sa tendresse, pour sa « non-virilité » ? Quoi qu’il en soit, après cela il<br />
se transforma en Serge Gainsbourg (en mâle), et lorsqu’elle revint, les rôles furent inversés.<br />
Rappelons-nous les onze manèges de séduction élaborés par Solal lorsqu’il voulut séduire<br />
Arianne Deume. Ne décrivent-ils pas exactement ce que Gainsbourg fait avec ses compa-<br />
gnes ? Mais n’oublions pas que derrière ce masque de moquerie s’est caché un jour un être<br />
sensible qui a voulu croire en un amour pur (Laetitia). L’expérience lui a fait comprendre<br />
qu’il ne fallait pas, en apparence, être un tendre. Il se créa donc ce personnage provocant :<br />
Gainsbarre. Et lorsqu’il revêtait le costume de Gainsbarre, il faisait crier, il faisait pleurer, il<br />
faisait bouger les choses. « Gainsbourg cache son immense pudeur poétique sous un masque<br />
de bouleversante obscénité » 16 . Mais il fait cela car il aime son public, il lui offre du spectacle.<br />
Est-ce qu’un misanthrope <strong>au</strong>rait fait crier <strong>au</strong> scandale la moitié de l’hexagone dans le dessein<br />
de toucher les jeunes (<strong>au</strong>x armes et caetera) ?<br />
Encore une chose ; Gainsbourg a été décoré du titre d’officier de l’Ordre des Arts et des Let-<br />
tres. Notons que Clint Eastwood et Coluche n’en sont que chevaliers. Comme le dit très bien<br />
Gilles Verlant : « les héros ont de drôles de tronches de nos jours ». Cet homme à tête de chou<br />
est un héros dont la francophonie peut être fière. Il est venu dire qu’il s’en allait. On l’a mis<br />
dans un grand trou car son 6’35 lui avait fait les yeux doux. Un revolver qui lui a fait les yeux<br />
doux toute sa vie. « Le succès et la gloire ne nous griseront jamais que les tempes » disait-il.<br />
Il avait raison. Trente-trois ans de composition et une place dans la postérité. « Le masque<br />
tombe, l’homme reste, (…) » et le héros ne s’évanouit pas 17 .<br />
16 Gilles VERLANT, Gainsbourg ou le garçon s<strong>au</strong>vage, Paris, Albin Michel, p. 180<br />
17 Gilles VERLANT, Au bout de la nuit, Paris, Editions Hors Collection, 1996, p.24<br />
16
X Sources<br />
Bibliographie :<br />
Gilles VERLANT, Gainsbourg ou le garçon s<strong>au</strong>vage, Paris, Albin Michel, 1985, 201 pages<br />
Gilles VERLANT, Au bout de la nuit, Paris, Editions Hors Collection, 1996, 155 pages<br />
Yves SALGUES, Gainsbourg ou la provocation permanente, éditions Jean-Cl<strong>au</strong>de Lattès,<br />
1989, pages 133 à 145<br />
Gilles VERLANT, Gainsbourg, Paris, Albin Michel, 2000, pages 127 à 160<br />
Gilles VERLANT, édition définitive, Paris, Albin Michel, 1985 et 1992, 279 pages<br />
Support vidéo :<br />
Gilles VERLANT/ Yves DESNOS/ Yann GRASLAND, De Serge Gainsbourg à Gainsbarre<br />
1958-1991, France, Universal Picture (France), 1994<br />
Support Audio :<br />
Serge GAINSBOURG, De Gainsbourg à Gainsbarre, France, Phonogram (France), 1994<br />
17
XI Annexes<br />
• Paroles de Elaeudanla Teïtéïa<br />
• Paroles de La fille <strong>au</strong> rasoir<br />
• Paroles de En relisant ta lettre<br />
• Paroles de Ce mortel ennui<br />
• Paroles et musique de Le Gymnasien<br />
18
Serge Gainsbourg<br />
ElaeudanlaTeïtéïa (1963)<br />
Sur ma remington portative<br />
J'ai écrit ton nom Laetitia<br />
Elaeudanla Teïtéïa<br />
Laetitia les jours qui se suivent<br />
Hélas ne se ressemblent pas<br />
Elaeudanla Teïtéïa<br />
C'est ma douleur que je cultive<br />
En frappant ces huit lettres-là<br />
Elaeudanla Teïtéïa<br />
C'est une fleur bien maladive<br />
Je la touche du bout des doigts<br />
Elaeudanla Teïtéïa<br />
S'il f<strong>au</strong>t aller à la dérive<br />
Je veux bien y aller pour toi<br />
Elaeudanla Teïtéïa<br />
Ma raison en définitive<br />
Se perd dans ces huit lettres là<br />
Elaeudanla Teïtéïa<br />
Sur ma remington portative<br />
J'ai écrit ton nom Laetitia<br />
Elaeudanla Teïtéïa<br />
19
Serge Gainsbourg<br />
La fille <strong>au</strong> rasoir (1963)<br />
Le rasoir électrique<br />
Couvrait la chanson de Clara<br />
La jolie musique<br />
Qui sortait de cet engin-là<br />
C'était sa faiblesse<br />
Elle aimait ses caresses<br />
Le rasoir électrique<br />
Frôlait la jambe de Clara<br />
Ce bruit métallique<br />
Avait l'don de me mettre hors de moi<br />
Ce n'était pas drôle<br />
De garder mon self-control<br />
Le rasoir électrique<br />
Me rendait dingue mais Clara<br />
N'prenait <strong>au</strong> tragique<br />
Ni mes angoisses ni mes a-<br />
Mours un jour quand même<br />
Je lui ai dit je t'aime<br />
Sous l'rasoir électrique<br />
Tu n'as rien entendu Clara<br />
Tu n'as rien entendu Clara<br />
Tu n'as rien entendu Clara<br />
20
Serge Gainsbourg<br />
En relisant ta lettre (1961)<br />
En relisant ta lettre je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux<br />
C'est toi que j'aime<br />
Ne prend qu'un M<br />
Par-dessus tout<br />
Ne me dis point<br />
Il en manque un<br />
Que tu t'en fous<br />
Je t'en supplie<br />
Point sur le i<br />
Fais-moi confiance<br />
Je suis l'esclave<br />
Sans accent grave<br />
Des apparences<br />
C'est ridicule<br />
C majuscule<br />
C'était si bien<br />
Tout ça m'affecte<br />
Ça c'est correct<br />
Au plus h<strong>au</strong>t point<br />
Si tu renonces<br />
Comme ça s'prononce<br />
À m'écouter<br />
Avec la vie<br />
Comme ça s'écrit<br />
J'en finirai<br />
Pour me garder<br />
Ne prends qu'un D<br />
Tant de rancune<br />
T'as pas de cœur<br />
Y a pas d'erreur<br />
Là y'en a une<br />
J'en mourrirai<br />
N'est pas français<br />
N'comprends-tu pas ?<br />
Ça s'ra ta f<strong>au</strong>te<br />
Ça s'ra ta f<strong>au</strong>te<br />
Là y'en a pas<br />
Moi j'te signale<br />
Que gardénal<br />
Ne prend pas d'E<br />
Mais n'en prend qu'un<br />
Cachet <strong>au</strong> moins<br />
N'en prend pas deux<br />
Ça t'calmera<br />
Et tu verras<br />
Tout r'tombe à l'e<strong>au</strong><br />
L'cafard, les pleurs<br />
21
les peines de cœur<br />
O E dans l'O<br />
Serge Gainsbourg<br />
Ce mortel ennui (1962)<br />
Ce mortel ennui<br />
Qui me vient<br />
Quand je suis avec toi<br />
Ce mortel ennui<br />
Qui me tient<br />
Et me suis pas à pas<br />
Le jour où j'<strong>au</strong>rai assez d'estomac<br />
Et de toi<br />
Pour te laisser choir<br />
Ce jour-là, oh oui ce jour là, je crois<br />
Oui je crois<br />
Que<br />
Je<br />
Pourrai voir<br />
Ce mortel ennui<br />
Se tailler<br />
À l'anglaise loin de moi<br />
Bien sûr il n'est rien besoin de dire<br />
À l'horizontale<br />
Mais on ne trouve plus rien à se dire<br />
À la verticale<br />
Alors pour tuer le temps<br />
Entre l'amour et l'amour<br />
J'prends l'journal et mon stylo<br />
Et je remplis<br />
Et les a et les o<br />
Il f<strong>au</strong>dra bien que j'me décide un jour<br />
Mon amour<br />
À me faire la malle<br />
Mais j'ai peur qu'tu n'ailles dans la salle de bains<br />
Tendre la main<br />
Vers<br />
Le<br />
Gardénal<br />
Comme je n'veux pas d'ennui<br />
Avec ma<br />
Conscience et ton père<br />
Je m'laisse faire !<br />
22
La chanson jazz française Arn<strong>au</strong>d Nussb<strong>au</strong>mer 3M3<br />
Olivier Piguet 13 nov.2006<br />
Vincenzo Di Marco<br />
<strong>Gymnase</strong> <strong>Auguste</strong> <strong>Piccard</strong><br />
Au-delà du masque de Gainsbourg (fiche résumé)<br />
Regardez-le ! Non mais regardez-le ! Des oreilles de chou, le teint pâle, des valises sous les<br />
yeux, une barbe de plusieurs jours. En public, il est provocant, grossier, parfois aviné ou en-<br />
core sous l’effet de stupéfiants. Toujours la clope <strong>au</strong> bec, il ricane froidement lorsqu’il toise<br />
son monde et se permet les plus grosses vacheries. Eh ouais, c’est lui Gainsbarre ! ou Serge<br />
Gainsbourg pour les non-initiés. Auprès du grand public, ce personnage étonnant est le plus<br />
souvent connu pour ses actes et certains de ses propos. Mais maintenant fermez les yeux et<br />
écoutez sa musique… Ne vous êtes vous jamais posé la question, très cher lecteur, si ce n’est<br />
pas d’abord son immense génie qui l’a mené sous les feux de la scène mondiale ?<br />
Le travail que je vous propose est une étude de la vie de Gainsbourg basée sur l’analyse de<br />
quatre de ses textes. Les quatre chansons étudiées ont été choisies selon les critères suivants :<br />
le thème qu’elles évoquaient (c’est-à-dire, l’évolution de la perception de Gainsbourg pour les<br />
femmes), et leur style (soit le jazz comme le laisse supposer le titre de la présentation). J’ai<br />
donc choisi Elaeudanla teïteïa, la fille <strong>au</strong> rasoir, en relisant ta lettre et ce mortel ennui,<br />
comme princip<strong>au</strong>x supports de ma démarche. Cette dernière se divise en trois parties princi-<br />
pales : la première a pour but de vous faire connaître Gainsbourg grâce à différentes anecdo-<br />
tes ou récits. La deuxième, le cœur du travail, consiste en l’analyse des quatre textes. Et la<br />
troisième est une synthèse des deux premières appuyée par quelques faits et témoignages i .<br />
Cela dans le but de répondre à la question suivante : sous son masque cynique y <strong>au</strong>rait-il une<br />
once d’amour ?<br />
La conclusion est étonnante, et j’espère qu’après la lecture de ce travail, vous <strong>au</strong>rez compris<br />
un peu mieux ce personnage complexe qu’est Serge Gainsbourg. Un personnage encore vi-<br />
vant <strong>au</strong>jourd’hui grâce évidemment à sa personnalité, mais avant tout grâce à sa musique. Si<br />
vous aimez Gainsbourg, alors lisez ce travail et si vous ne l’aimez pas, lisez-le et peut-être<br />
que vous irez acheter l’intégrale de ses albums dans la semaine qui vient. Bonne lecture !<br />
i Sans <strong>au</strong>cun rapport avec la première partie du travail, notons que dans l’annexe figure une composition, une<br />
chanson jazz, que j’ai écrite avec mon ami Séverin Bussy.