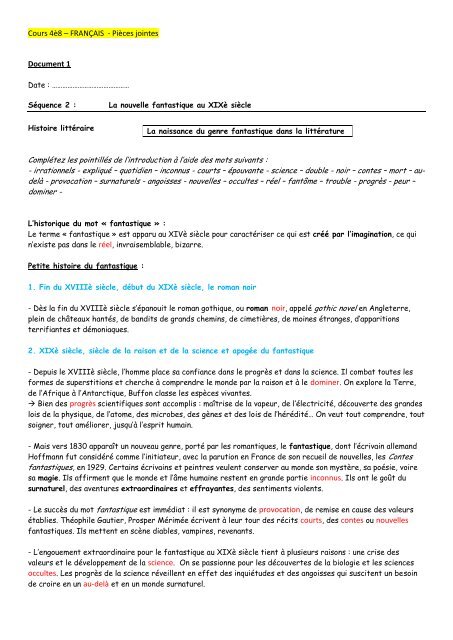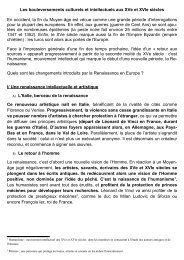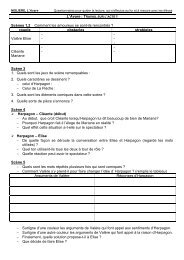Cours 4è8 – FRANÇAIS - Pièces jointes Document 1
Cours 4è8 – FRANÇAIS - Pièces jointes Document 1
Cours 4è8 – FRANÇAIS - Pièces jointes Document 1
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Cours</strong> <strong>4è8</strong> <strong>–</strong> <strong>FRANÇAIS</strong> - <strong>Pièces</strong> <strong>jointes</strong><br />
<strong>Document</strong> 1<br />
Date : ………………………………………<br />
Séquence 2 : La nouvelle fantastique au XIXè siècle<br />
Histoire littéraire<br />
Complétez les pointillés de l’introduction à l’aide des mots suivants :<br />
- irrationnels - expliqué <strong>–</strong> quotidien <strong>–</strong> inconnus - courts <strong>–</strong> épouvante - science <strong>–</strong> double - noir <strong>–</strong> contes <strong>–</strong> mort <strong>–</strong> audelà<br />
- provocation <strong>–</strong> surnaturels - angoisses - nouvelles <strong>–</strong> occultes <strong>–</strong> réel <strong>–</strong> fantôme <strong>–</strong> trouble - progrès - peur <strong>–</strong><br />
dominer -<br />
L’historique du mot « fantastique » :<br />
Le terme « fantastique » est apparu au XIVè siècle pour caractériser ce qui est créé par l’imagination, ce qui<br />
n’existe pas dans le réel, invraisemblable, bizarre.<br />
Petite histoire du fantastique :<br />
La naissance du genre fantastique dans la littérature<br />
1. Fin du XVIIIè siècle, début du XIXè siècle, le roman noir<br />
- Dès la fin du XVIIIè siècle s’épanouit le roman gothique, ou roman noir, appelé gothic novel en Angleterre,<br />
plein de châteaux hantés, de bandits de grands chemins, de cimetières, de moines étranges, d’apparitions<br />
terrifiantes et démoniaques.<br />
2. XIXè siècle, siècle de la raison et de la science et apogée du fantastique<br />
- Depuis le XVIIIè siècle, l’homme place sa confiance dans le progrès et dans la science. Il combat toutes les<br />
formes de superstitions et cherche à comprendre le monde par la raison et à le dominer. On explore la Terre,<br />
de l’Afrique à l’Antarctique, Buffon classe les espèces vivantes.<br />
Bien des progrès scientifiques sont accomplis : maîtrise de la vapeur, de l’électricité, découverte des grandes<br />
lois de la physique, de l’atome, des microbes, des gènes et des lois de l’hérédité… On veut tout comprendre, tout<br />
soigner, tout améliorer, jusqu’à l’esprit humain.<br />
- Mais vers 1830 apparaît un nouveau genre, porté par les romantiques, le fantastique, dont l’écrivain allemand<br />
Hoffmann fut considéré comme l’initiateur, avec la parution en France de son recueil de nouvelles, les Contes<br />
fantastiques, en 1929. Certains écrivains et peintres veulent conserver au monde son mystère, sa poésie, voire<br />
sa magie. Ils affirment que le monde et l’âme humaine restent en grande partie inconnus. Ils ont le goût du<br />
surnaturel, des aventures extraordinaires et effrayantes, des sentiments violents.<br />
- Le succès du mot fantastique est immédiat : il est synonyme de provocation, de remise en cause des valeurs<br />
établies. Théophile Gautier, Prosper Mérimée écrivent à leur tour des récits courts, des contes ou nouvelles<br />
fantastiques. Ils mettent en scène diables, vampires, revenants.<br />
- L’engouement extraordinaire pour le fantastique au XIXè siècle tient à plusieurs raisons : une crise des<br />
valeurs et le développement de la science. On se passionne pour les découvertes de la biologie et les sciences<br />
occultes. Les progrès de la science réveillent en effet des inquiétudes et des angoisses qui suscitent un besoin<br />
de croire en un au-delà et en un monde surnaturel.
- L’homme du XIXè siècle n’y voit aucune contradiction : sa foi dans le progrès de la science est telle, pour lui,<br />
qu’un phénomène « occulte » n’est pas inexplicable, mais tout simplement pas encore expliqué.<br />
- Le fantastique sert l’expression des nouvelles angoisses de l’homme face à lui-même, à la folie, à la mort,<br />
comme dans les nouvelles d’E.A. Poe, de R.L. Stevenson, ou de G. de Maupassant. C’est pourquoi leurs<br />
personnages sont confrontés à d situations étranges, inexplicables qui sèment le trouble dans leur esprit.<br />
Mais surtout, il répond à un besoin fondamental de l’homme, qui aime avoir peur et qui trouve dans ces récits<br />
matière à satisfaire ce plaisir qui remonte à des temps archaïques.<br />
3. XXè siècle, déclin et réapparition<br />
- Au début du XXè siècle, le fantastique décline, considéré comme une para-littérature. La deuxième moitié du<br />
XXè siècle voit le renouveau du genre. Le contexte de l’époque s’y prête : guerre mondiale, dictature…<br />
- Dans les dernières décennies se développe le roman d’épouvante, avec Stephen King.<br />
Aujourd’hui, le roman fantastique est en pleine expansion.<br />
Le réel et l’imaginaire dans le genre fantastique<br />
- Le genre fantastique invite à envisager l’irruption d’événements surnaturels dans l’univers quotidien sans<br />
fournir de véritables explications. Il conduit ainsi les personnages et le lecteur à mettre en doute les lois<br />
naturelles. Reflet de l’inquiétude face au monde, la littérature fantastique a pour effet principal de créer une<br />
atmosphère d’ « inquiétante étrangeté ».<br />
- Le récit à la 1 ère personne permet au lecteur de partager l’inquiétude croissante du narrateur.<br />
Les thèmes privilégiés<br />
- Dans les œuvres appartenant à la littérature fantastique, on retrouve certains motifs comme le fantôme, le<br />
double ou encore le revenant qui vient troubler l’existence d’un personnage qui peut sombrer dans la folie.<br />
- L’animalité et la mort « vivante » sont aussi des thèmes privilégiés du genre fantastique qui permet l’irruption<br />
de phénomènes irrationnels, inconcevables dans le cadre de la banalité quotidienne.
<strong>Document</strong> 2<br />
Date : ………………………………………<br />
Séquence 2 : La nouvelle fantastique au XIXè siècle<br />
Lecture expliquée<br />
Le cadre réaliste d’une nouvelle fantastique<br />
Texte : « De la sérénité à la terreur » (un extrait du Horla de Guy de Maupassant, 1887)<br />
Objectifs<br />
<strong>–</strong> Repérer et justifier la forme du récit, un journal commencé in medias res ;<br />
<strong>–</strong> Faire le portrait psychologique du narrateur-personnage à partir des champs lexicaux, figures de style et procédés d’écriture ;<br />
<strong>–</strong> Récapituler les éléments caractéristiques du fantastique.<br />
De la sérénité à la terreur<br />
Installé dans sa demeure, un homme note dans son journal ce qu’il ressent.<br />
8 mai. <strong>–</strong> Quelle journée admirable ! J’ai passé toute la matinée étendu sur l’herbe, devant ma maison, sous<br />
l’énorme platane qui la couvre, l’abrite et l’ombrage(1) toute entière. J’aime ce pays, et j’aime y vivre parce que<br />
j’y ai mes racines, ces profondes et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts<br />
ses aïeux(2), qui l’attachent à ce qu’on pense et à ce qu’on mange, aux usages comme aux nourritures, aux<br />
locutions locales(3), aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l’air lui-même.<br />
J’aime da maison où j’ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de mon jardin,<br />
derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine, qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui<br />
passent.<br />
A gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils<br />
sont innombrables, frêles(4) ou larges, dominés par la flèche de fonte(5) de la cathédrale, et pleins de cloches<br />
qui sonnent dans l’air bleu des belles matinées, jetant jusqu’à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer,<br />
leur chant d’airain(6) que la brise m’apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu’elle s’éveille ou<br />
s’assoupit.<br />
Comme il faisait bon ce matin ! […]<br />
5 juillet. <strong>–</strong> Ai-je perdu la raison ? Ce qui s’est passé, ce que j’ai vu la nuit dernière est tellement étrange, que ma<br />
tête s’égare quand j’y songe !<br />
Comme je le fais maintenant chaque soir, j’avais fermé ma porte à clef ; puis, ayant soif, je bus un demiverre<br />
d’eau, et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu’au bouchon de cristal.<br />
Je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de<br />
deux heures environ par une secousse plus affreuse encore.<br />
Figurez-vous un homme qui dort, qu’on assassine, et qui se réveille, avec un couteau dans le poumon, et<br />
qui râle(7), couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas <strong>–</strong> voilà.<br />
Ayant enfin reconquis ma raison, j’eus soif de nouveau ; j’allumai une bougie et j’allai vers la table où<br />
était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre ; rien ne coula. <strong>–</strong> Elle était vide ! Elle était<br />
vide complètement ! D’abord, je n’y compris rien ; puis, tout à coup, je ressentis une émotion si terrible, que je<br />
dus m’asseoir, ou plutôt, que je tombai sur une chaise ! puis, je me redressai d’un saut pour regarder autour de<br />
moi ! puis je me rassis, éperdu d’étonnement et de peur(8) devant le cristal transparent ! Je le contemplais avec<br />
des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient ! On avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi ? moi, sans<br />
doute ? Ce ne pouvait être que moi ? Alors, j’étais somnambule, je vivais, sans le savoir, de cette double vie<br />
mystérieuse qui fait douter s’il y a deux êtres en nous, ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime,<br />
par moments, quand notre âme est engourdie(9), notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes,<br />
plus qu’à nous-mêmes.
Ah ! qui comprendra mon angoisse abominable ? Qui comprendra l’émotion d’un homme, sain d’esprit, bien<br />
éveillé, plein de raison et qui regarde épouvanté, à travers le verre d’une carafe, un peu d’eau disparue pendant<br />
qu’il a dormi ! Et je restai là jusqu’au jour, sans oser regagner mon lit.<br />
6 juillet. <strong>–</strong> Je deviens fou. On a encore bu dans ma carafe cette nuit ; - ou plutôt je l’ai bue !<br />
Mais est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui serait-ce ? Qui ? Oh ! Mon Dieu ! Je deviens fou ! Qui me sauvera ?<br />
Vocabulaire<br />
1. l’ombrage : lui fait de l’ombre.<br />
2. aïeux : ancêtres.<br />
3. locutions locales : expressions propres à une région.<br />
4. frêles : fragiles.<br />
5. flèche : aiguille en forme de flèche.<br />
6. airain : métal (bronze).<br />
7. qui râle : qui respire comme quelqu’un qui va mourir.<br />
8. éperdu d’étonnement et de peur : très étonné et effrayé.<br />
9. quand notre âme est engourdie : quand notre conscience est endormie.<br />
Explication du texte<br />
I) Un univers rassurant<br />
Guy de Maupassant, Le Horla, version de 1887.<br />
1. Quelle forme particulière l’auteur a-t-il donnée au récit ? Appuyez-vous pour répondre sur l’indication de<br />
temps donnée au début de l’extrait, ainsi que sur le statut du narrateur (aidez-vous des pronoms personnels et<br />
des déterminants possessifs).<br />
2. a) Relevez, dans les lignes 1 à 17, les adjectifs qui caractérisent la nature et la ville.<br />
b) Les adjectifs qualificatifs employés sont-ils mélioratifs ou péjoratifs ? Justifiez votre réponse.<br />
3. Lignes 1 à 10 : quel verbe est répété ? Que nous révèle cette répétition sur l’état d’esprit du narrateur ?<br />
4. a) Relevez les groupes nominaux introduits par un déterminant possessif.<br />
b) Quelle relation le narrateur entretient-il avec sa région ?<br />
II) Le doute<br />
5. a) Quel événement, en apparence banal, le narrateur rapporte-t-il à la date du 5 juillet ?<br />
b) Quelle conclusion paraît logique ?<br />
6. Quel trait de caractère du narrateur apparaît ? Justifiez votre réponse à l’aide du texte.<br />
III) L’effroi<br />
7. a) A partir du « 5 juillet » (ligne 18), indiquez quels types de phrases dominent et relevez les répétitions.<br />
b) Relevez les mots et expressions qui appartiennent au champ lexical de la peur.<br />
c) Que cherche à souligner Maupassant ?<br />
8. Par quel pronom le narrateur désigne-t-il l’individu qui a bu l’eau (lignes 42 à 52) ? Justifiez le choix de ce<br />
mot.<br />
9. Quelles hypothèses, l’une rationnelle, l’autre surnaturelle, peuvent expliquer la disparition de l’eau ?<br />
Questions de réflexion<br />
A) A l’aide de vos réponses, précisez quel lien s’établit entre le lecteur et le narrateur ? Le lecteur doute-t-il<br />
de la véracité des faits rapportés ? Pourquoi ?<br />
B) Comment définiriez-vous le fantastique ?
<strong>Document</strong> 3<br />
Date : ………………………………………<br />
Séquence 2 : La nouvelle fantastique au XIXè siècle<br />
Orthographe /<br />
Conjugaison<br />
1. Réviser les accords dans le groupe nominal<br />
[Ce gros chien agressif et terrifiant] semblait vouloir dévorer [le jeune marquis, perdu dans le parc].<br />
Observation<br />
1. Quelle est la classe grammaticale : a) des mots en gras ? b) des passages entre crochets ?<br />
2. Réécrivez la phrase en mettant les mots en gras au féminin. Dans les passages entre crochets, quels mots<br />
ont changé : a) de prononciation et d’orthographe ? b) d’orthographe seulement ? c) Quelle est la classe<br />
grammaticale de chacun de ces mots ?<br />
3. Réécrivez la phrase en mettant les mots en gras au pluriel. Dans les passages entre crochets, quels mots ont<br />
changé : a) de prononciation et d’orthographe ? b) d’orthographe seulement ? c) Quelle est la classe<br />
grammaticale de chacun de ces mots ?<br />
Formulez la règle<br />
En vous appuyant sur vos observations, recopiez et complétez la phrase suivante.<br />
Dans un groupe nominal, les adjectifs … et les … employés comme adjectifs s’accordent<br />
en genre et en nombre avec le nom dont ils sont épithètes (collés au nom) ou apposés<br />
(séparés du nom par des virgules).<br />
Un déterminant … de forme en fonction du … et du … du nom qu’il accompagne.<br />
2. Réviser la conjugaison du conditionnel<br />
Réviser les accords dans le groupe nominal ;<br />
Réviser la conjugaison du conditionnel<br />
Observation<br />
1. Observez les formes verbales en italiques et celles en gras : lesquelles sont des temps simples ? des temps<br />
composés ?<br />
La vue de ces arbres ferait frémir une âme sensible et bien courageux seraient les voyageurs qui<br />
oseraient s’aventurer en ces lieux. Oluf avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, comme d’un fer qui<br />
entrerait et chercherait le cœur. On aurait dit qu’Oluf galopait dans un nuage. Il traversa le bois de sapins<br />
qu’on aurait pris pour des spectres.<br />
T. Gautier, Le Chevalier double, 1840.