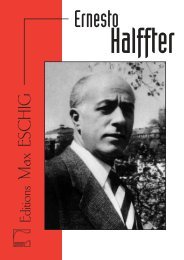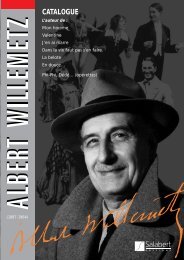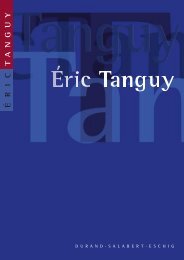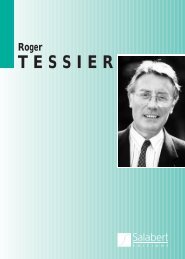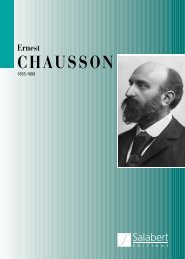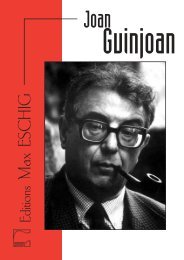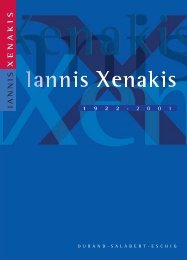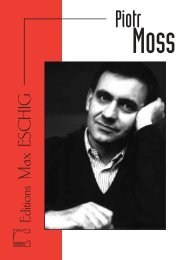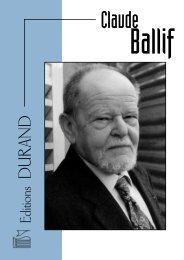Arthur Honegger - durand-salabert-eschig
Arthur Honegger - durand-salabert-eschig
Arthur Honegger - durand-salabert-eschig
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ARTHUR<br />
HONEGGER<br />
(1892-1955)<br />
Né au Havre d’une famille de Suisse alémanique,<br />
<strong>Honegger</strong> est l’héritier de cette double culture, française<br />
et germanique. En ce début du XX e siècle, l’un et l’autre<br />
mondes proposent les solutions les plus riches à toutes sortes<br />
de nouveaux questionnements musicaux : que faire de la<br />
tonalité ? qu’est-ce que l’expression ? que peuvent être les<br />
liens entre la musique et les autres arts, entre musique et<br />
philosophie ? quelles vont être désormais les formes de la<br />
musique ?<br />
Photo : LIDO<br />
À toutes ces questions, <strong>Honegger</strong> semble apporter des<br />
réponses claires mais tolérantes. L’atonalité ne l’intéresse<br />
que comme moyen passager d’exprimer tension ou<br />
chaos (le sérialisme lui semble un décret arbitraire). La<br />
référence à des formes musicales ayant fait leurs preuves<br />
(symphonie, oratorio, quatuor) donne lieu chez lui à<br />
des œuvres originales dans leur esprit comme dans leurs<br />
configurations. L’intérêt pour les arts du spectacle qui<br />
marque les premières décennies du siècle, en particulier<br />
en France, le concerne intensément, y compris dans ses<br />
aspects les plus divertissants, même si son humanisme le<br />
porte à une méditation profonde sur la fonction morale de<br />
l’artiste dans la société.<br />
Musicien ouvert à toutes les rumeurs du siècle, qu’elles<br />
soient d’ordre esthétique, scientifique, social, <strong>Honegger</strong><br />
semble avoir été tout au long de sa carrière à la recherche<br />
de l’expression la plus intense et la plus honnête d’un<br />
élan créateur qui le portait à la composition de pièces très<br />
diverses. Mais l’on constate que la voix et par-dessus tout<br />
le chœur occupent une place de choix dans sa production.<br />
Les grandes collaborations avec René Morax (Le Roi<br />
David, Judith) puis Paul Claudel (Jeanne d’Arc au bûcher,<br />
La Danse des morts) mettent en lumière l’intérêt premier<br />
d’<strong>Honegger</strong> pour des sujets d’inspiration philosophique et<br />
religieuse. Mais il est aussi l’auteur d’une opérette assez<br />
truculente : Les Aventures du Roi Pausole, sur un texte de<br />
Willemetz, ainsi que de nombreuses mélodies.<br />
Si Jeanne d’Arc au bûcher (1935) est considérée comme<br />
son œuvre la plus représentative, c’est probablement<br />
qu’elle mêle la plus grande simplicité (recours à la voix<br />
parlée, beauté paisible des récits de l’enfance de Jeanne,<br />
du folklore français) et l’invention la plus étrange (ondes<br />
Martenot pour exprimer la terreur de l’enfer, martèlement<br />
exalté des chœurs pour évoquer la joie dans la séquence<br />
finale). Mélange de médiévisme et de modernisme, d’un<br />
5