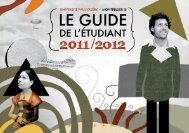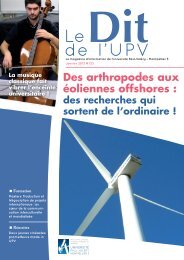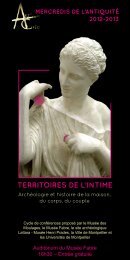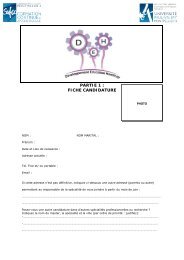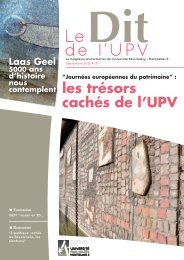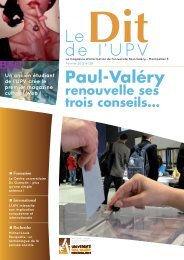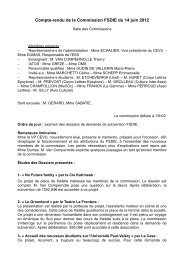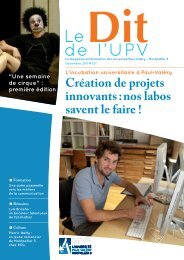DIT DE L'UPV N° 90 - Université Paul Valéry
DIT DE L'UPV N° 90 - Université Paul Valéry
DIT DE L'UPV N° 90 - Université Paul Valéry
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4<br />
■ BON À SAVOIR<br />
Jahrhunderts (1899) de H. S. Chamberlain<br />
(1855-1927), livre qui prônait la renaissance<br />
de la race germanique. L’Essai sur<br />
l’inégalité des races humaines fut du reste<br />
fort peu diffusé et vendu en Allemagne et<br />
n’y eut guère de réception.<br />
J. Boissel rappela enfin que ce Gobineau,<br />
à qui l’on imputait la doctrine des races en<br />
France, avait fait l’éloge des juifs et en rien<br />
contribué à la formation des mythes<br />
fondateurs de l’antisémitisme.<br />
Les historiens du racialisme et du racisme,<br />
surtout P.-A. Taguieff, surent apprécier<br />
la qualité des travaux de J. Boissel, notamment<br />
sa très belle édition de l’Essai sur<br />
l’inégalité des races humaines en Pléiade.<br />
Mais les Gobiniens se sont raréfiés ou<br />
reconvertis. Jean Boissel eut des thésards,<br />
qui enseignent encore à l’<strong>Université</strong> : entre<br />
autres, S. André, en Nouvelle-Calédonie,<br />
T. Sadjedi, à Téhéran.<br />
Mais Gobineau croupit de nos jours dans<br />
son marais : ici, le rédacteur du site www.<br />
mondialisme.org s’en prend à Taguieff, pour<br />
avoir réhabilité Gobineau, et à Jean Boissel,<br />
dont il écrit qu’il était issu de la Nouvelle<br />
Droite et se réclamait de son gourou, A. de<br />
Benoist ; là, une critique, très bien informée<br />
d’ordinaire, affirme encore que le<br />
discours de Jules Verne sur la Chine était<br />
renforcé par « le discours scientifique sur<br />
l’inégalité des races développé alors par des<br />
penseurs tels le comte Gobineau et Gustave<br />
Le Bon » (M. Détrie, France-Chine, Paris,<br />
Gallimard, Découvertes Gallimard, n° 447,<br />
2004, p. 49).<br />
J. Boissel aimait à dire que les Français<br />
cherchaient toujours le lampiste. Et l’injustice<br />
est encore criante. Là où E. Jünger, dont<br />
M. Vanoosthuyse, notre collègue, vient de<br />
montrer qu’il a caché son passé fasciste et<br />
pro-nazi (Fascisme et littérature pure,<br />
Marseille, Agone, 2005), passe pour le grand<br />
écrivain allemand au-dessus de tout soupçon<br />
et connaît une belle réception,<br />
Gobineau continue de passer pour le promoteur<br />
de la pensée racialiste et même raciste.<br />
Des années d’études sur Gobineau n’auront<br />
pas abouti. J. Boissel en était fort<br />
conscient.<br />
4. Un orientaliste à l’ancienne<br />
Jean Boissel étudia aussi l’Iran et écrivit<br />
aussi sur la poésie iranienne dans les pages<br />
de la Revue de littérature comparée. En<br />
1975 parut son Que sais-je ? sur L’Iran<br />
moderne. L’intérêt de ce tableau de l’Iran<br />
moderne tient plus à sa présentation de la<br />
culture persane de la tradition, souvent dense,<br />
concise, sensible, qu’à sa partie économique<br />
et politique, sèche, partielle, partiale.<br />
S’il admet que l’Iran « est devenu, à<br />
l’extérieur, un partenaire avec qui on compte<br />
», Jean Boissel conclut en faisant l’impasse<br />
sur la situation politique réelle du<br />
pays. Ainsi, « la classe dirigeante iranienne<br />
hésite entre les mots et les voies ». Pas<br />
un mot de l’opposition religieuse, et l’Iran<br />
est même dit « excentrique au grand mouvement<br />
politico-religieux qui travaille la<br />
nation arabe ». La classe des technocratesmanagers<br />
est « secondée, souvent mal, par<br />
une masse croissante de diplômés, souvent<br />
inefficaces ». Et l’auteur de se demander,<br />
avec cette arrogance occidentale qu’Edward<br />
Saïd stigmatisera dans Orientalism (1978),<br />
si l’on pouvait « faire crédit aux capacités<br />
intellectuelles et créatrices de [l]a jeunesse<br />
» d’Iran, si elle acceptera, en rentrant au<br />
pays après des années d’études en Europe<br />
et en Amérique, « d’admettre que le rêve<br />
n’a jamais, de lui-même, transformé la<br />
nature d’un pays ou d’un peuple ». L’étude<br />
se clôt par la morale du Laboureur et ses<br />
enfants, à l’adresse de l’Iran moderne…<br />
Jean Boissel ne vécut jamais bien longtemps<br />
en Iran, rarement plus de trois mois.<br />
Il n’en maîtrisait pas la langue. Tel correspondant<br />
m’écrit : « Boissel ne savait pas<br />
beaucoup le persan et il mettait seulement<br />
les mots l’un à côté de l’autre et il en faisait<br />
ainsi de petites phrases. Par exemple<br />
pour dire comment allez-vous ou même<br />
comment ça va. Et il demandait des précisions,<br />
pour ses propres travaux, à Gilbert<br />
Lazard. » Jean Boissel est l’exemple même<br />
de ces lettrés bien français qui, pour s’intéresser<br />
à l’Orient, terme encore usité de<br />
son temps, n’en avaient jamais qu’une<br />
approche de surface. Aujourd’hui, à l’heure<br />
du débat sur l’intégration de la Turquie à<br />
l’Europe, quand on sait combien « les cultures<br />
européennes sont infiniment mieux<br />
connues par les élites turques que les<br />
cultures turques ne le sont par les élites<br />
européennes » (J.-F. Pérouse, « La Turquie<br />
est-elle intégrable ? », in G. Pécout, dir.,<br />
Penser les frontières de l’Europe du XIX e au<br />
XXI e siècle, Paris, PUF, 2004, p. 357), le cas<br />
Boissel peut servir de leçon. Reste que<br />
l’homme fascinait par ses récits d’Iran et<br />
d’Orient et donnait envie d’y aller voir de<br />
plus près – et vraiment, et longtemps, et<br />
dans la langue.<br />
5. Un contempteur de son époque<br />
Malgré une carrière que d’aucuns<br />
jugeraient bien remplie, Jean Boissel<br />
n’estimait pas avoir eu la reconnaissance<br />
qu’il s’estimait en droit d’espérer. Son<br />
édition de la Pléiade, qu’il dut partager avec<br />
Jean Gaulmier, principal maître-d’œuvre,<br />
ne lui avait pas valu la notoriété souhaitée.<br />
Cela le rendait parfois d’un pessimisme<br />
amer qui transpirait dans ses cours et s’alimentait<br />
de la lecture assidue du Canard<br />
enchaîné. Comme Gobineau, Jean Boissel<br />
n’aimait pas son époque. Tel jour, il pestait<br />
contre la grève de pompistes qui n’avaient<br />
pas fait d’études. Tel autre, il écrivait à<br />
Hubert Durt, membre de l’EFEO, qu’il<br />
aurait dû écrire de la pornographie, activité<br />
plus rentable que la recherche. À nous<br />
autres, ses étudiants d’alors, il parlait d’un<br />
livre inédit, Mes relations culturelles, où il<br />
relatait, d’une plume acide, ses impressions<br />
de la carrière diplomatique (sur le ressentiment<br />
en milieu universitaire, voir Pierre<br />
Bourdieu, Homo academicus, Paris,<br />
Éditions de Minuit, 1983).<br />
Il est trop tôt pour dresser le bilan d’une<br />
œuvre de grand savant. Mais les idées<br />
reçues ont la vie dure et l’histoire est<br />
capricieuse. Gobineau pâtit toujours d’une<br />
réputation forgée de toutes pièces par des<br />
idéologues et réactivée par des universitaires<br />
qui ne lisent pas. L’Iran, contre toute attente<br />
d’expert inattentif, a fait sa révolution<br />
islamique, ratée ou réussie, et assumé son<br />
histoire. Si Jean Boissel a peut-être choisi et<br />
le mauvais auteur et le mauvais pays pour<br />
s’attirer la gloire, il nous reste son œuvre<br />
qui se suffit à elle-même et qui lui a valu,<br />
lui vaut toujours l’estime de ses pairs.<br />
Ainsi, bon an mal an, la tradition des<br />
études orientales en littérature comparée<br />
ne s’est pas perdue à Montpellier III.<br />
Aujourd’hui, c’est notre collègue Guy<br />
Dugas, fort de ses vingt années de séjour<br />
en pays musulman, et spécialiste de<br />
littérature maghrébine francophone, qui la<br />
perpétue.<br />
■<br />
Gérard Siary<br />
Professeur de littérature générale<br />
et comparée à l’université <strong>Paul</strong>-<strong>Valéry</strong><br />
■■■ Bibliographie de Jean Boissel<br />
■ Victor Courtet, 1813-1867 : premier théoricien de la hiérarchie<br />
des races. Contribution à l’histoire de la philosophie politique du<br />
romantisme. Paris, PUF, 1972.<br />
■ Gobineau, l’Orient et l’Iran, Paris, Klincksieck, 1974.<br />
■ L’Iran moderne. Paris, PUF, « Que sais-je ? » n° 1617, 1975.<br />
■ Gobineau (1816-1882) : un Don Quichotte tragique. Paris,<br />
Hachette, 1981.<br />
■ Gobineau : biographie :mythes et réalité. Paris, Berg international,<br />
1993.<br />
Éditions de textes<br />
■ Gobineau (Arthur de), Gobineau polémiste. Les Races et la<br />
République. Introduction à une lecture de l’Essai sur l’inégalité des<br />
races humaines et choix de textes par Jean Boissel. Paris, J.J.<br />
Pauvert,1966.<br />
■ Tocqueville (Alexis de), De la démocratie en Amérique. Extraits<br />
avec notice et notes de Jean Boissel. Paris, Larousse, 1970 (rééd.<br />
1975).<br />
■ Maistre (Joseph de), Considérations sur la France. Avant-propos<br />
de Jean Boissel ; texte établi, présenté et annoté par Jean-Louis<br />
Darcel. Genève, Slatkine, 1980.<br />
■ Gobineau (Arthur de), Œuvres. 3 tomes. Sous la direction de<br />
Jean Gaulmier avec la collaboration de Jean Boissel pour les tomes<br />
I et III. Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1983 (I et<br />
II), 1987 (III).<br />
[Directeur de la publication: Jean-Marie Miossec, président de l’université <strong>Paul</strong>-<strong>Valéry</strong>.<br />
Comité de rédaction: Mustapha Bensaada, Jean-Bruno Renard. Conception-réalisation : M. Bensaada. ISSN : 1620-364X.<br />
Contact: Service de la communication. Tél.: 04 67 14 55 10 / Mél. : ledit@univ-montp3.fr]