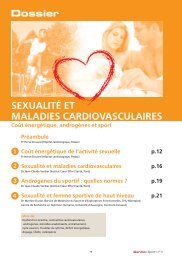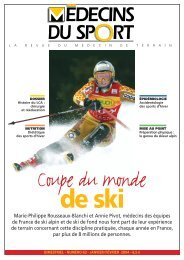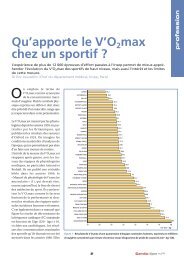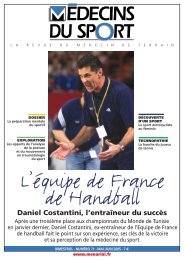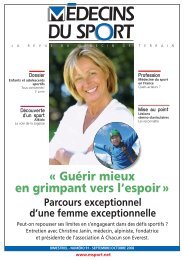Médecins du sport 67 - msport.net
Médecins du sport 67 - msport.net
Médecins du sport 67 - msport.net
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
mds<strong>67</strong>-01une 4/10/04 16:31 Page 1<br />
EDECINS<br />
DU SP RT<br />
L A R E V U E D U M É D E C I N D E T E R R A I N<br />
Jeux Paralympiques :<br />
disciplines, handicaps<br />
et règlements<br />
Matériels et adaptations<br />
techniques : des astuces<br />
aux prototypes<br />
Particularités<br />
<strong>du</strong> suivi des <strong>sport</strong>ifs<br />
handicapés<br />
de haut niveau<br />
Les pathologies<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong>if handi<strong>sport</strong><br />
Aspects spécifiques<br />
<strong>du</strong> dopage en handi<strong>sport</strong><br />
La course en fauteuil :<br />
caractéristiques<br />
physiologiques<br />
et musculaires<br />
Les premiers jeux<br />
Paralympiques grecs<br />
Pour leur 12 e édition, les jeux Paralympiques d’été se sont déroulés<br />
<strong>du</strong> 17 au 28 septembre à Athènes. Existant depuis 1960, ils occupent<br />
le 2 e rang des événements <strong>sport</strong>ifs par le nombre de participants,<br />
suivant de près des jeux Olympiques.<br />
BIMESTRIEL - NUMÉRO <strong>67</strong> - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004 - 7 €<br />
www.menarini.fr
mds<strong>67</strong>-03som 4/10/04 16:40 Page 3<br />
VOUS AVEZ PARLÉ<br />
HANDICAP...<br />
ÉDITO<br />
Lors d’un entraînement de judo auquel<br />
je* participais dans mon club, j’ai invité<br />
un non-voyant. Ce judoka non-voyant<br />
de 100 kg était ceinture noire 2 e dan<br />
et se préparait à participer<br />
aux championnats de France.<br />
Ce combat d’entraînement paraissait<br />
équilibré. Après le salut habituel précédant<br />
la prise <strong>du</strong> judogi, j’avais une certaine<br />
retenue vis-à-vis de mon partenaire, le<br />
laissant prendre l’initiative, je maîtrisais<br />
gentiment la situation avec une certaine<br />
compassion. Puis, au cours <strong>du</strong> combat,<br />
je sentis que la pugnacité de mon adversaire<br />
commençait à se faire sentir, jusqu’au<br />
moment où je faillis chuter,<br />
je laissais donc au vestiaire toute ma<br />
compassion et je poursuivis le combat avec<br />
un engagement total, afin de monter qui était<br />
le plus fort. Finalement, la fin <strong>du</strong> combat<br />
retentit sur un petit avantage en ma faveur.<br />
Depuis cette expérience enrichissante, je me<br />
demande : qui avait le handicap ?<br />
Vous allez donc découvrir, dans ce nouveau<br />
numéro de Médecins <strong>du</strong> Sport, coordonné<br />
par le Dr Jean-Claude Druvert (médecin <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong>, chargé<br />
<strong>du</strong> Haut niveau à la Fédération Française<br />
Handi<strong>sport</strong>, FFH), les aspects de la<br />
médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong> s’appliquant lors des jeux<br />
Paralympiques qui se sont déroulés à<br />
Athènes <strong>du</strong> 17 au<br />
28 septembre 2004, faisant suite<br />
aux JO <strong>du</strong> mois d’août.<br />
Bonne lecture et bonne rentrée,<br />
Dr Didier Rousseau<br />
Rédacteur en chef<br />
*6 e dan, ex-international de judo<br />
P. 5-11 ÉVÉNEMENT<br />
Les premiers jeux<br />
Paralympiques grecs<br />
Pour leur 12 e édition, les jeux Paralympiques d’été<br />
se sont déroulés <strong>du</strong> 17 au 28 septembre à Athènes.<br />
Existant depuis 1960, ils occupent le 2 e rang<br />
des événements <strong>sport</strong>ifs par le nombre de participants,<br />
suivant de près les jeux Olympiques.<br />
< DOSSIER ><br />
P. 13-27<br />
Handi<strong>sport</strong> :<br />
une pratique <strong>sport</strong>ive encore méconnue<br />
Le point sur les pathologies <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if handi<strong>sport</strong> de haut<br />
niveau, les particularités <strong>du</strong> matériel, la classification des<br />
<strong>sport</strong>ifs et les problèmes spécifiques de prévention <strong>du</strong> dopage.<br />
Les particularités <strong>du</strong> suivi<br />
médical <strong>du</strong> haut niveau<br />
handi<strong>sport</strong><br />
Les pathologies<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong>if handi<strong>sport</strong><br />
P. 28-32 PHYSIOLOGIE<br />
Caractéristiques physiologiques<br />
et musculaires des athlètes élites<br />
spécialistes de “course fauteuil”<br />
E<br />
U<br />
Le matériel et<br />
les adaptations<br />
en handi<strong>sport</strong><br />
Problèmes spécifiques de<br />
prévention <strong>du</strong> dopage<br />
et de la classification<br />
P. 34 CONGRÈS/BULLETIN D’ABONNEMENT<br />
Retrouvez Médecins <strong>du</strong> Sport sur Inter<strong>net</strong><br />
www.menarini.fr<br />
Articles, mises au point, banque d’images, formations, événements…<br />
Benjamin Loyseau<br />
Sommaire<br />
Directeur de la publication: Dr Antoine Lolivier - Rédacteur en chef: Dr Didier Rousseau - Rédacteur en chef adjoint: Odile Mathieu - Rédacteurs: Isabelle<br />
Ampart, Yann Cornillier - Secrétaires de rédaction: Annaïg Bévan, Elisabeth Durant - Chef de studio: Michel Haessler - Maquette: Christine Lecomte -<br />
Chef de Pro<strong>du</strong>ction: Gracia Bejjani - Assistante de pro<strong>du</strong>ction: Marianne Bouchard - Comité de rédaction: Dr Gilles Bruyère - Pr François Carré - Pr Pascal<br />
Christel - Dr Jean-Marie Coudreuse - Dr Patrick Djian - Laurence Ducrot - Dr Hervé de Labareyre - Dr Olivier Fichez - Dr Jacques Gueneron - Dr Eric Joussellin -<br />
Dr Pascal Lefèvre - Dr Philippe Le Van - Dr Dominique Lucas - Dr Patrick Middleton - Dr Paule Nathan - Dr Marie-France Oprendek-Roudey - Dr Jacques Parier -<br />
Dr Gérard Porte - Dr Jacques Pruvost - Corinne Sandret - Dr Philippe Thelen - Dr Hervé Zakarian. - Service d’abonnement: Claire Lesaint- Photo de couverture:<br />
B. Loyseau<br />
Cette publication est éditée par Expressions Santé, 2, rue de la Roquette – Passage <strong>du</strong> Cheval Blanc, cour de Mai - 75011 Paris. Tél.: 0149292929.<br />
Fax: 0149292919. E-mail: mds@expressions-sante.fr - N° ISSN: 1279-1334. Imprimeur: Imprimerie de Compiègne, 60205 Compiègne.<br />
Tous les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.<br />
MÉDECINS DU SPORT 3 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-05-11even 4/10/04 16:45 Page 5<br />
Benjamin Loyseau<br />
La philosophie des jeux Paralympiques<br />
maintient les règles des <strong>sport</strong>s olympiques.<br />
Athènes 2004<br />
Les 1 ers jeux Paralympiques grecs<br />
Existant depuis 1960, les jeux Paralympiques occupent le deuxième rang des<br />
événements <strong>sport</strong>ifs par le nombre de participants, suivant de près les jeux<br />
Olympiques. Ils ont toujours eu lieu la même année que ces derniers, mais ce<br />
n’est que depuis 1988 qu’ils sont célébrés sur les mêmes lieux de compétition et<br />
utilisent les mêmes installations que les JO. En quarante-quatre ans, l’évolution<br />
des disciplines, des techniques d’entraînement et <strong>du</strong> matériel a été considérable<br />
et de plus en plus d’athlètes handicapés venant <strong>du</strong> monde entier y ont participé.<br />
Leur niveau de performance ne cesse d’augmenter et se rapproche de celui des<br />
<strong>sport</strong>ifs valides avec qui ils partagent de plus en plus leur préparation.<br />
Cette année, pour leur 12 e édition, les jeux Paralympiques d’été se sont déroulés<br />
à Athènes <strong>du</strong> 17 au 28 septembre dernier, deux semaines après la clôture des<br />
jeux Olympiques.<br />
■<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
MÉDECINS DU SPORT 5 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-05-11even 4/10/04 16:45 Page 6<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
PREMIERS PAS VERS<br />
LES JEUX PARALYMPIQUES<br />
Dans les années 40, le médecin chef de<br />
l’hôpital de Stoke Mandeville (Londres),<br />
soignant de nombreux patients paraplégiques<br />
ou amputés, organisa des<br />
jeux <strong>sport</strong>ifs pour venir en aide à ces<br />
patients et améliorer leur qualité de vie.<br />
En 1948, année des jeux Olympiques<br />
de Londres, les premiers jeux pour personnes<br />
handicapées en fauteuil roulant<br />
furent ainsi fondés et appelés jeux de<br />
La philosophie des jeux Paralympiques vise à<br />
maintenir les règles des <strong>sport</strong>s olympiques.<br />
• Athlétisme : des athlètes paraplégiques,<br />
amputés ou affectés de handicaps moteurs<br />
similaires, des non-voyants (aidés par<br />
un assistant) ou malvoyants. Le règlement est<br />
identique à celui des athlètes valides.<br />
• Basket en fauteuil roulant : blessés<br />
mé<strong>du</strong>llaires, amputés, ou autres handicapés<br />
moteurs. La principale modification<br />
<strong>du</strong> règlement par rapport au basket valide est<br />
que le “marcher” est remplacé par<br />
deux poussées sur les mains courantes.<br />
• Boccia : personnes souffrant de paralysie<br />
cérébrale ou d’autres handicaps moteurs<br />
Stoke Mandeville. Remportant<br />
un franc succès, cet événement<br />
accueillit alors plusieurs<br />
autres pays les années<br />
suivantes et fut rebaptisé<br />
jeux internationaux de Stoke<br />
Mandeville. Mais ce médecin<br />
britannique n’en resta pas là<br />
et envisagea la création<br />
d’une compétition d’envergure<br />
mondiale. L’aventure paralympique<br />
était lancée...<br />
1960-2004 : L’HISTOIRE<br />
PARALYMPIQUE<br />
L’émergence des jeux<br />
Paralympiques<br />
La mise en place de ce projet pour les<br />
handicapés nécessita quelques années<br />
puisque les premiers jeux Paralympiques<br />
furent célébrés en 1960, à Rome, avec<br />
nécessitant l’usage d’un fauteuil. Chaque<br />
épreuve indivi<strong>du</strong>elle comporte 4 tours et<br />
chaque athlète lance six boules. Pour les<br />
couples, il y a 4 tours et six boules par couple,<br />
soit trois chacun. Pour les équipes, il y a 6 tours<br />
et les trois athlètes peuvent avoir chacun<br />
deux boules en leur possession, ou six boules<br />
par équipe. Selon le handicap de chaque joueur,<br />
les balles peuvent être lancées à la main,<br />
au pied ou à l’aide d’un appareil d’appoint.<br />
• Cyclisme :<br />
non-voyants<br />
ou malvoyants<br />
(tandem), infirmes<br />
moteurs cérébraux<br />
(IMC), blessés<br />
mé<strong>du</strong>llaires<br />
(handbike), amputés<br />
et handicapés moteurs divers. Malgré<br />
la similitude des règlements entre cyclisme<br />
olympique et paralympique, des modifications<br />
sont autorisées sur les vélos des athlètes<br />
atteints de certaines déficiences.<br />
• Escrime en<br />
fauteuil roulant :<br />
tireurs paraplégiques,<br />
amputés, atteints<br />
d’hémiplégie.<br />
8 <strong>sport</strong>s, auxquels participèrent 300 athlètes<br />
de 10 pays différents (uniquement<br />
en fauteuil roulant).<br />
Avec le temps, commencèrent à participer<br />
des athlètes ayant d’autres handicaps<br />
(les non-voyants ou les paralysés cérébraux).<br />
En 1972, des tétraplégiques intégrèrent<br />
la compétition. En 1976, la décision<br />
de regrouper différentes catégories<br />
d’athlètes handicapés fut adoptée et des<br />
fauteuils roulants spécialisés dans la<br />
course furent utilisés pour la première<br />
fois. La même année, les jeux Paralympiques<br />
d’hiver firent leur apparition en<br />
Suède. En 1984, apparut le marathon en<br />
fauteuil roulant. Dès 1988, les jeux Paralympiques<br />
et Olympiques furent toujours<br />
célébrés dans le même lieu, ce qui<br />
ne s’était pro<strong>du</strong>it qu’en 1960 et 1964. En<br />
1989, le Comité international olympique<br />
fut créé ; depuis cette date, il organise et<br />
supervise les jeux Paralympiques et coordonne<br />
les calendriers <strong>sport</strong>ifs internationaux.<br />
Les disciplines : quels participants et<br />
L’échange se fait dans un fauteuil roulant fixé<br />
au sol, sans que cela n’entrave la liberté<br />
des mouvements. Cette immobilisation<br />
des fauteuils constitue la seule différence<br />
notable de règlement.<br />
• Football à 5 : participent uniquement<br />
des joueurs déficients visuels (sauf le gardien),<br />
avec un ballon sonorisé. La <strong>du</strong>rée des matchs<br />
est plus courte que chez les valides :<br />
deux mi-temps de 25 minutes ; mais<br />
le règlement est semblable.<br />
• Football à 7 : participent des handicapés<br />
moteurs. Chaque match est composé de<br />
deux mi-temps de 30 minutes. Le football<br />
à 7 diffère des Jeux Olympiques par quelques<br />
modifications de règles comme l’autorisation<br />
<strong>du</strong> renvoi en jeu après touche avec<br />
une seule main.<br />
• Goal-ball : participent uniquement<br />
les non-voyants et malvoyants. Chaque<br />
équipe est composée de trois joueurs<br />
ayant les yeux bandés. Le terrain mesure<br />
18 x 9 mètres et le ballon est sonorisé.<br />
• Haltérophilie : pratiquée par tous<br />
les handicapés de membres inférieurs<br />
et les déficients visuels. Dans toutes<br />
les catég<br />
allongée<br />
• Judo<br />
ou malv<br />
les épre<br />
qu’en ju<br />
• Natat<br />
handicap<br />
• Rugby<br />
essentie<br />
un faute<br />
déroule<br />
basket-<br />
8 minut<br />
de quat<br />
à celui d<br />
• Sport<br />
cavalier<br />
MÉDECINS DU SPORT 6 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-05-11even 4/10/04 16:45 Page 7<br />
t fixé<br />
e<br />
rdien),<br />
atchs<br />
apés<br />
e<br />
all<br />
elques<br />
isation<br />
e<br />
re<br />
Le relais de la flamme<br />
L’allumage de la flamme des jeux Paralympiques<br />
et le relais Paralympique ont<br />
été institutionnalisés depuis les Jeux de<br />
1988.Lors des Jeux suivants,cette tradition<br />
olympique intégra des éléments<br />
culturels caractéristiques de la nation<br />
organisatrice. Depuis cette période,<br />
l’athlète responsable d’allumer la<br />
torche olympique est sélectionné en<br />
vertu de symboliques spécifiques au<br />
pays hôte.<br />
ATHÈNES 2004 :<br />
UNE PREMIÈRE !<br />
Si Athènes 2004 a marqué le retour aux<br />
sources des jeux Olympiques, ce n’est<br />
pas le cas pour ces 12 es jeux Paralympiques<br />
qui étaient les premiers à être<br />
accueillis par les Grecs, <strong>du</strong> 17 au<br />
28 septembre dernier.A cette occasion,<br />
4 000 athlètes handicapés de 145 pays<br />
ts et quels règlements ?<br />
les catégories, ils concourent en position<br />
allongée sur un banc adapté.<br />
• Judo : participent des judokas non-voyants<br />
ou malvoyants. La différence principale entre<br />
les épreuves olympiques et paralympiques est,<br />
qu’en judo paralympique, les athlètes rentrent<br />
en contact avant<br />
le début <strong>du</strong> match :<br />
l’arbitre signale<br />
le début <strong>du</strong> combat<br />
après que les<br />
judokas se soient<br />
saisis par<br />
le kimono.<br />
• Natation : participent toutes les formes de<br />
handicaps. Le départ peut s’effectuer dans l’eau.<br />
• Rugby en fauteuil roulant : participent<br />
essentiellement les tétraplégiques utilisant<br />
un fauteuil roulant manuel. Les matchs se<br />
déroulent en salle, sur des terrains de<br />
basket-ball et en quatre périodes de<br />
8 minutes chacune. Les joueurs, par équipes<br />
de quatre, utilisent un ballon semblable<br />
à celui de volley.<br />
• Sports équestres (épreuve de dressage) :<br />
cavaliers à handicap visuel, moteur ou mental.<br />
se sont affrontés dans 19 <strong>sport</strong>s, pour<br />
1 539 médailles distribuées.<br />
Les épreuves<br />
Parmi les épreuves de cette année,<br />
4 étaient uniquement paralympiques :<br />
la boccia (qui se joue indivi<strong>du</strong>ellement,<br />
par deux ou par trois, sur un terrain de<br />
12,5 x 6 mètres et consiste à lancer une<br />
balle le plus prêt possible de la ballecible<br />
blanche), le goal-ball pour les déficients<br />
visuels (qui se joue en lançant un<br />
ballon sonore avec les mains afin de<br />
marquer des buts), l’haltérophilie et le<br />
rugby. Les 15 autres <strong>sport</strong>s étaient communs<br />
aux programmes des JO et des<br />
jeux Paralympiques.<br />
La délégation française<br />
212 personnes dont 142 athlètes composaient<br />
la délégation française et Joël<br />
Jeannot, célèbre champion d’athlétisme,<br />
en était le porte-drapeau et le capitaine.<br />
L’enjeu était de se maintenir à la 7 e place<br />
Le règlement est quasiment identique à celui<br />
des valides.<br />
• Tennis de table :<br />
paraplégiques,<br />
amputés<br />
et autres déficiences<br />
motrices. Quelques<br />
modifications de<br />
règlement sont<br />
nécessaires aux<br />
pongistes en fauteuil<br />
roulant, pour<br />
des raisons pratiques.<br />
• Tennis en fauteuil roulant : handicapés<br />
moteurs et, dans une catégorie différente,<br />
tétraplégiques et amputés de membres<br />
inférieurs. Au contraire <strong>du</strong> tennis olympique,<br />
la balle peut rebondir deux fois et le 2 e rebond<br />
peut être à l’extérieur <strong>du</strong> terrain.<br />
• Tir <strong>sport</strong>if : tous les handicapés physiques.<br />
La chaise pour l’épreuve peut être un fauteuil<br />
roulant ou un tabouret, et doit répondre aux<br />
normes fixées dans chaque catégorie, pour<br />
le dossier et le support pour l’arme (petite<br />
table ou banc). Pour toutes les épreuves,<br />
les règles sont semblables à celles fixées pour<br />
les valides.<br />
mondiale obtenue aux Jeux de Sydney<br />
en 2000,avec pour objectif 32 médailles<br />
(soit deux de plus qu’à Sydney).Avant<br />
que ne débute la compétition, les<br />
chances de médailles françaises se<br />
situaient en athlétisme et en tennis de<br />
table, disciplines les plus représentées<br />
au sein de la délégation. Le cyclisme,<br />
l’escrime, l’haltérophile, le judo et la<br />
natation étaient également considérés<br />
comme susceptibles de s’ajouter au<br />
palmarès tricolore.<br />
LES DIFFÉRENTS HANDICAPS<br />
Un médecin de la Fédération Française<br />
Handi<strong>sport</strong> peut rencontrer la quasi<br />
totalité des handicaps possibles de l’appareil<br />
locomoteur et des déficiences<br />
visuelles. Mais certains sont plus représentés<br />
et 3 licenciés sur 4 ont un handicap<br />
d’origine neurologique.<br />
• Tir à l’arc :<br />
personnes souffrant<br />
d’un handicap<br />
moteur, de lésions<br />
de la moelle<br />
épinière, de<br />
paralysie cérébrale,<br />
d’amputations ou<br />
autres. Le tétraplégique peut utiliser un arc à<br />
poulie et un décocheur.<br />
• Voile : athlètes non-voyants ou malvoyants<br />
et handicapés moteurs. Quelques<br />
modifications de<br />
règlement sont<br />
apportées afin<br />
de permettre<br />
une meilleure<br />
adaptation<br />
des <strong>sport</strong>ifs à<br />
leurs capacités.<br />
• Volley-ball assis : handicapés moteurs<br />
divers, surtout des membres inférieurs.<br />
Les dimensions <strong>du</strong> terrain sont plus petites<br />
et le filet moins haut que pour le volley<br />
debout ; mais les règles sont par ailleurs<br />
identiques. Au smash, le bassin<br />
de l’attaquant doit rester en contact<br />
avec le sol.<br />
Photos de cette page : The 50th Anniversary of Wheelchair Basketball. Horst Strohkendl. New Yorf : Waxmann, 1996. Benjamin Loyseau.<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
MÉDECINS DU SPORT 7 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-05-11even 4/10/04 16:45 Page 8<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
Les handicaps neurologiques<br />
centraux<br />
● La tétraplégie et la paraplégie par<br />
lésion de la moelle épinière, traumatique<br />
le plus souvent. Le médecin doit<br />
connaître les caractéristiques de cette<br />
atteinte : niveau moteur et sensitif,<br />
lésion complète ou incomplète, flasque<br />
ou spastique, troubles sphinctériens et<br />
complications urinaires, antécédents<br />
d’escarres, rétractions musculaires, fracture<br />
favorisée par l’ostéoporose,<br />
ostéomes...<br />
● L’infirmité motrice cérébrale<br />
(IMC) avec des troubles importants <strong>du</strong><br />
tonus musculaire et de la régulation<br />
automatique des mouvements.La population<br />
des IMC représente le tiers des<br />
licenciés.<br />
● L’hémiplégie, généralement conséquence<br />
d’un traumatisme crânien ou<br />
d’une rupture de malformation vasculaire,<br />
car les victimes d’accident ischémique<br />
pratiquent exceptionnellement<br />
des activités physiques. Les troubles<br />
associés sont importants à analyser :<br />
atteintes <strong>du</strong> champ visuel,<strong>du</strong> langage,de<br />
la mémoire ou <strong>du</strong> caractère, comitialité,<br />
rétractions musculaires et articulaires...<br />
Les handicaps neurologiques<br />
périphériques<br />
● Les séquelles de poliomyélite,<br />
caractérisées par une topographie très<br />
Le fauteuil roulant fixé au sol<br />
constitue la seule différence<br />
de règlement par rapport<br />
aux jeux Olympiques.<br />
variable, l’absence de trouble sensitif et<br />
sphinctérien, une hypotonie et une<br />
amyotrophie importante des muscles<br />
touchés. Même si cette maladie virale<br />
est en voie d’extinction, les porteurs de<br />
séquelles sont encore nombreux à pratiquer<br />
des <strong>sport</strong>s où ils réussissent particulièrement<br />
bien.<br />
● Les paralysies radiculaires et<br />
tronculaires (plexus brachial, atteinte<br />
radiale, atteinte de SPE...).<br />
● Les séquelles de polyradiculonévrite<br />
(Guillain Barré), plus exceptionnelles.<br />
Les handicaps évolutifs<br />
● Les myopathes peuvent pratiquer<br />
des <strong>sport</strong>s qui ne nécessitent pas d’effort<br />
physique.<br />
● Les jeunes atteints d’hérédodégénérescence<br />
spino-cérébelleuse peuvent<br />
aussi se retrouver sur les terrains de<br />
<strong>sport</strong>.<br />
Les amputations et agénésies<br />
(de membre supérieur et/ou de<br />
membre inférieur)<br />
● Acquises,traumatiques le plus souvent.<br />
● Les agénésies congénitales : d’un<br />
ou de plusieurs membres ou d’une partie<br />
seulement, d’origine infectieuse ou<br />
médicamenteuse...<br />
Les problèmes articulaires et<br />
osseux<br />
● L’arthrodèse et les grandes raideurs<br />
séquellaires.<br />
● Les maladies inflammatoires<br />
chroniques dont la polyarthrite rhumatoïde.<br />
● Les anomalies de l’ostéogenèse<br />
comme dans la maladie de Lobstein.<br />
● Le nanisme, le plus souvent dans le<br />
cadre d’une maladie génétique.<br />
troubles de la coordination et de l’équilibre<br />
ne sont que partiellement compensés<br />
par une majoration de la prise<br />
d’information par l’ouie,le toucher et la<br />
proprioception.<br />
L’INTÉRÊT DES<br />
CLASSIFICATIONS<br />
Elles ne sont nécessaires que pour la<br />
compétition afin que les <strong>sport</strong>ifs puissent<br />
concourir à chance égale. Un système<br />
de classification est appliqué à chaque<br />
<strong>sport</strong>, plus ou moins complexe en fonction<br />
des spécificités de celui-ci.<br />
L’approche des classifications est<br />
double : initialement par handicap, elle<br />
est maintenant essentiellement fonctionnelle.<br />
De ce fait, le facteur déterminant<br />
n’est plus le type et le degré d’infirmité,<br />
mais l’aisance gestuelle et l’utilisation<br />
des possibilités restantes,<br />
appréciation qui se fait parfois au détriment<br />
de ceux qui, parce qu’ils s’entraînent<br />
beaucoup, ont développé des<br />
compensations exceptionnelles.<br />
Les classifications par handicap<br />
● La classification pour les <strong>sport</strong>ifs en<br />
fauteuil roulant : cette classification,<br />
de valeur conceptuelle historique car<br />
mise en place il y a maintenant 50 ans,<br />
était réservée aux blessés mé<strong>du</strong>llaires<br />
et basée sur le niveau neurologique<br />
métamérique, avec indivi<strong>du</strong>alisation de<br />
6 classes.<br />
● La classification pour les amputés est<br />
basée suivant le(s) niveau(x) d’amputation.<br />
● La classification pour les infirmes<br />
moteurs cérébraux est fonction de la<br />
localisation de leur déficience et leur<br />
façon de se déplacer.<br />
● La classification pour les handicapés<br />
visuels est basée sur les mesures<br />
d’acuité et/ou de champ visuel.<br />
Benjamin Loyseau<br />
Les déficients visuels<br />
● Les non-voyants qui nécessitent un<br />
guide pour la pratique <strong>sport</strong>ive.<br />
● Les amblyopes profonds (1/30 e sur<br />
le meilleur œil avec correction, champ<br />
visuel inférieur à 5°).<br />
● Les malvoyants (acuité 1/10 e ,<br />
champ visuel inférieur à 20°).<br />
Il est indispensable de savoir que près<br />
de la moitié des malvoyants risque de<br />
devenir aveugle avec l’évolution de leur<br />
pathologie et que les difficultés de<br />
représentation <strong>du</strong> schéma corporel<br />
dans l’espace rendent l’apprentissage<br />
<strong>sport</strong>if long et complexe. En effet, les<br />
Benjamin Loyseau<br />
Les classifications fonctionnelles<br />
Cette classification implique que tous<br />
les athlètes d’une catégorie ont un<br />
niveau d’aptitude fonctionnelle similaire<br />
en matière de mouvement, de coordination<br />
et d’équilibre. Dans chaque discipline,<br />
les besoins gestuels pour s’exprimer<br />
ont été analysés et des tests ont été établis<br />
(Fig.1). Pour la réalisation de chaque<br />
test, le <strong>sport</strong>if se voit attribuer des<br />
points,dont le total détermine sa classification.<br />
Selon ce système, des athlètes<br />
présentant des handicaps différents peuvent<br />
concourir ensemble s’ils présentent<br />
un degré égal d’aptitude fonction-<br />
MÉDECINS DU SPORT 8 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-05-11even 4/10/04 16:45 Page 9<br />
nelle, ce qui a permis de ré<strong>du</strong>ire le<br />
nombre de classes.<br />
Il ne faut pas se laisser impressionner<br />
par la multiplicité des classes. Les catégories<br />
sont désignées par une lettre,<br />
généralement l’initiale <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, et un<br />
nombre (ex.: S5 pour swimming en<br />
natation pour les paraplégiques ou<br />
encore T44 pour track, course en athlétisme<br />
des amputés tibiaux). Les chiffres<br />
inférieurs représentent en général un<br />
handicap plus important.<br />
Les testeurs, habilités à déterminer les<br />
classifications sur le plan international,<br />
sont des techniciens, des médecins, des<br />
kinésithérapeutes ou d’anciens <strong>sport</strong>ifs,agréés<br />
par la commission technique<br />
internationale. Mais une première<br />
approche peut être effectuée par un<br />
médecin ou un kinésithérapeute disposant<br />
des barèmes réglementaires.<br />
Pour chaque <strong>sport</strong>, un handicap minimum<br />
est défini.<br />
Le tennis en fauteuil n’a pas de classification,<br />
en dehors <strong>du</strong> niveau <strong>du</strong> joueur<br />
sur le plan national ou international.<br />
Le judo pour déficients visuels et l’haltérophilie<br />
sont, comme pour les<br />
valides, régis par le poids <strong>du</strong> corps.<br />
LA LOGISTIQUE<br />
DES VOYAGES<br />
TRANSMÉRIDIENS<br />
La longueur des voyages vers les lieux de<br />
compétition est une source de pathologies<br />
pour les <strong>sport</strong>ifs handicapés et particulièrement<br />
pour les blessés mé<strong>du</strong>llaires.<br />
Depuis les jeux Paralympiques de Séoul<br />
en 1988, la commission médicale de la<br />
FFH a acquis une bonne expérience, lui<br />
permettant d’accompagner les déplacements<br />
de grands handicapés (tétraplégiques)<br />
dans de bonnes conditions. Une<br />
délégation paralympique comprend<br />
environ 220 personnes, avec un ratio de<br />
1 cadre pour 2 <strong>sport</strong>ifs. En outre, parmi<br />
les cadres de Sydney,on comptait 10 personnes<br />
handicapées dont 4 paraplégiques<br />
et 1 tétraplégique.<br />
Les principaux points abordés à l’occasion<br />
d’un long déplacement sont les<br />
suivants.<br />
1 - Un contrôle cutané et urinaire<br />
des blessés mé<strong>du</strong>llaires (30 % environ<br />
des <strong>sport</strong>ifs) est effectué dans les<br />
48 heures précédant le départ. Toute<br />
escarre en zone d’appui, quel que soit<br />
son stade d’évolution, est une contreindication<br />
au voyage et à la compétition,<br />
ce qui est stipulé par le règlement<br />
médical de la FFH.<br />
2 - Chaque <strong>sport</strong>if mé<strong>du</strong>llaire se voit<br />
doté d’un support d’assise performant<br />
(coussin de classe IV, à air) qu’il utilise<br />
<strong>du</strong>rant le voyage. Des chaussettes<br />
de contention pour les paraplégiques<br />
et des collants pour les tétraplégiques<br />
sont également fournis. De l’aspirine à<br />
dose anti-agrégante ou une HBPM est<br />
donnée en prévention des accidents<br />
thrombo-emboliques.<br />
3 - On propose la pose de sonde urinaire<br />
aux <strong>sport</strong>ifs qui ont des difficultés<br />
pour effectuer les autosondages ou<br />
ayant des fuites urinaires. Les porteurs<br />
de stimulateurs vésicaux peuvent passer<br />
sans crainte de dérèglement les portiques<br />
de détection métallique.<br />
4 - Les conseils d’hydratation<br />
maximum sont renouvelés car l’air<br />
des cabines pressurisées est particulièrement<br />
sec et le <strong>sport</strong>if a tendance<br />
à se mettre en restriction hydrique<br />
pour éviter les mictions. Or, une peau<br />
déshydratée est fragilisée vis-à-vis des<br />
escarres.<br />
5 - La répartition de l’équipe de France<br />
dans l’avion est sous la responsabilité<br />
de l’équipage, mais nous sollicitons<br />
un regroupement de nos <strong>sport</strong>ifs afin<br />
de ne pas gêner les autres usagers par<br />
les transferts répétés difficiles dans un<br />
espace ré<strong>du</strong>it. Le médecin responsable<br />
de l’équipe est porteur d’une pharmacie<br />
d’urgence.<br />
6 - Les amputés de membres infé-<br />
En athlétisme, la technologie a boosté<br />
les performances, le 100 m se court en<br />
moins de 11’’.<br />
rieurs voyagent souvent sans prothèse<br />
pour éviter tout problème cutané lié<br />
aux modifications de volume <strong>du</strong> moignon<br />
<strong>du</strong>rant le voyage.<br />
Pour les jeux d’Atlanta en 1996, afin<br />
d’éviter un séjour prolongé avant l’ouverture<br />
des Jeux dans des conditions<br />
atmosphériques chaudes et humides,<br />
tout en facilitant la gestion <strong>du</strong> décalage<br />
horaire, la délégation a effectué, en<br />
France, un rattrapage de 4 heures de<br />
décalage. Cette technique, basée sur<br />
l’exposition à la lumière associée au<br />
décalage progressif d’une heure<br />
chaque jour <strong>du</strong> rythme de vie, a<br />
donné de bons résultats. Les nonvoyants<br />
ne peuvent se recaler sur l’horaire<br />
local que par les indicateurs de<br />
la vie sociale. Notre expérience ne<br />
nous permet pas d’affirmer que cette<br />
catégorie de handicapés présente des<br />
phénomènes plus importants de récupération<br />
<strong>du</strong> jet-lag.<br />
En bref, déplacer une équipe de sélectionnés<br />
paralympiques pose les<br />
mêmes problèmes que pour les<br />
valides auxquels se surajoutent les difficultés<br />
liées à leur déficience, notamment<br />
pour les paraplégiques et les<br />
tétraplégiques, population la plus<br />
exposée aux complications. L’équipe<br />
Crédit photos Benjamin Loyseau<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
Figure 1 - La classification<br />
fonctionnelle d’escrime est basée<br />
sur 4 tests d’équilibre <strong>du</strong> tronc.<br />
MÉDECINS DU SPORT 9 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-05-11even 4/10/04 16:45 Page 10<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
médicale d’accompagnement doit<br />
d’abord s’occuper des difficultés liées<br />
au handicap, tâche plus préoccupante<br />
que de résoudre les problèmes liés à<br />
la pratique <strong>sport</strong>ive.<br />
RÉPARTITION PAR ÂGE<br />
ET PAR PATHOLOGIES<br />
Evolution <strong>du</strong> type de handicap<br />
dans les équipes paralympiques<br />
La comparaison des équipes paralympiques<br />
de 1992 à 2000 montre que :<br />
● le nombre des paraplégiques reste<br />
constant,<br />
● les tétraplégiques accèdent de plus en<br />
plus nombreux à la haute compétition,<br />
● le nombre des amputés varie peu,<br />
● les effectifs des déficients visuels augmentent<br />
lentement,<br />
● le nombre des poliomyélitiques diminue<br />
régulièrement,<br />
● la catégorie de handicap qui progresse<br />
le plus en nombre est celle des handicapés<br />
divers, appelés “les autres” sur le<br />
plan international.<br />
Evolution de l’âge dans<br />
les équipes paralympiques<br />
Les <strong>sport</strong>ifs handi<strong>sport</strong> accèdent généralement<br />
assez tard à la compétition,<br />
après la survenue d’un handicap.<br />
Leur carrière internationale est plus<br />
longue que celle des valides <strong>du</strong> fait<br />
d’une moindre concurrence.Asayama a<br />
étudié une population de plusieurs<br />
centaines de marathoniens et estime<br />
que, chez le <strong>sport</strong>if en FR, les activités<br />
quotidiennes de déplacement en fauteuil<br />
maintiennent une bonne condition<br />
physique et retardent les processus<br />
liés à l’âge.<br />
Les maladies chroniques<br />
La population étudiée en 2001 concerne<br />
121 <strong>sport</strong>ifs des équipes de France à<br />
jour de leurs dossiers médicaux et pratiquant,<br />
outre les disciplines d’été, les<br />
skis alpin et nordique.<br />
Hypertension artérielle (HTA)<br />
Suivant le niveau d’entraînement, l’hypertension<br />
artérielle touche de 1 % des<br />
<strong>sport</strong>ifs valides de haut niveau à 5 %<br />
dans les catégories vétérans.<br />
L’HTA semble plus fréquente chez nos<br />
<strong>sport</strong>ifs puisqu’elle touche 4,1 %. Néanmoins,<br />
la moyenne d’âge de nos hyperten<strong>du</strong>s<br />
est de 45,4 ans (38-54 ans), correspondant<br />
à la catégorie des vétérans<br />
chez les valides.<br />
La Fédération française handi<strong>sport</strong> (FFH)<br />
Depuis la première association<br />
<strong>sport</strong>ive pour handicapés physiques,<br />
créée en France en<br />
1954, le mouvement handi<strong>sport</strong><br />
a connu une évolution permanente.<br />
La FFH, présidée par André<br />
Auberger, trésorier <strong>du</strong><br />
CNOSF, rassemble 25 000 pratiquants<br />
dans 550 clubs, répartis<br />
dans 25 comités régionaux.<br />
Elle a proposé 45 <strong>sport</strong>s, dont<br />
17 étaient présents aux jeux<br />
Paralympiques d’Athènes 2004, et s’est classée au 9 e rang mondial sur<br />
136 nations (7 e lors des jeux Paralympiques de Sydney 2000).<br />
En dehors de la haute compétition, elle s’attache particulièrement au<br />
développement <strong>du</strong> <strong>sport</strong> chez les jeunes et pour les grands handicapés<br />
ainsi qu’à la formation.<br />
La commission médicale est pluridisciplinaire : médecins de médecine<br />
physique et de réadaptation, médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, rhumatologues, ophtalmologistes.<br />
Elle travaille avec l’aide essentielle de paramédicaux :<br />
kinésithérapeutes, infirmiers, diététiciens, psychologues <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
Fédération Française Handi<strong>sport</strong> : 42 rue Louis Lumière - 75020 Paris<br />
Tél. : 01 40 31 45 00 - Site : www.handi<strong>sport</strong>.org<br />
Laurent Baheux<br />
Epilepsie<br />
Notre population comprend des IMC et<br />
des porteurs de séquelles de traumatisme<br />
crânien et il est logique de trouver<br />
des chiffres de 2,4 % pour une prévalence<br />
chez les valides de 0,5 à 0,8 %.<br />
Nous n’avons observé qu’un seul cas<br />
de crise comitiale généralisée lors d’un<br />
grand événement, à la cérémonie de<br />
clôture des Jeux de 1996.<br />
Une comitialité mal équilibrée reste<br />
une contre-indication formelle à la pratique<br />
<strong>du</strong> handi<strong>sport</strong>. Une hygiène de<br />
vie et une prise parfaite des médicaments<br />
sont nécessaires chez ces <strong>sport</strong>ifs.<br />
Asthme d’effort<br />
Les études consacrées à ce sujet chez<br />
les <strong>sport</strong>ifs valides de haut niveau<br />
montrent des chiffres extrêmement<br />
variables pouvant atteindre 50 % chez<br />
les skieurs de fond et 76 % chez les<br />
nageurs.<br />
Le pourcentage d’asthme dans le cadre<br />
<strong>du</strong> haut niveau handi<strong>sport</strong> paraît inférieur,<br />
avec seulement 4,9 %, et sans<br />
aucun nageur atteint. Les disciplines<br />
concernées sont le cyclisme (1), le ski<br />
de fond (1), le tennis de table (2) et le<br />
tir à la cible (1).<br />
Chez le blessé mé<strong>du</strong>llaire haut, on<br />
trouve un syndrome restrictif plus ou<br />
moins important en rapport avec l’atteinte<br />
des muscles respiratoires. Singas<br />
trouve une hyperréactivité bronchique<br />
lors <strong>du</strong> test à la métacholine,<br />
tout particulièrement chez le tétraplégique<br />
(40 % des cas) qu’il attribue à la<br />
perte de l’innervation sympathique<br />
des poumons alors que l’activité cholinergique<br />
bronchoconstrictive est<br />
préservée.<br />
Hypercholestérolémie<br />
et hyperuricémie<br />
3,3 % des <strong>sport</strong>ifs présentent une dyslipidémie,<br />
le plus souvent une hypercholestérolémie<br />
par augmentation <strong>du</strong><br />
LDL cholestérol. L’âge moyen dans<br />
cette population est de 38,2 ans. 2,4<br />
% sont porteurs d’une hyperuricémie<br />
avec surpoids et il s’agit surtout de<br />
blessés mé<strong>du</strong>llaires qui pratiquent<br />
des disciplines à faible dépense énergétique.<br />
Ces troubles dyslipidémiques<br />
sont connus chez le blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
et sont inférieurs à ceux d’une population<br />
non <strong>sport</strong>ive. Comme chez le<br />
valide, le bénéfice de l’activité physique<br />
sur le bilan lipidique est<br />
démontré.<br />
MÉDECINS DU SPORT 10 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-05-11even 4/10/04 16:45 Page 11<br />
CONCLUSION<br />
Les <strong>sport</strong>ifs handicapés sélectionnés<br />
aux jeux Paralympiques ont un âge<br />
plus élevé que celui des valides, <strong>du</strong><br />
fait d’un accès plus tardif aux entraînements<br />
et à la compétition, après la<br />
survenue de leur handicap, et de leur<br />
longévité dans leurs pratiques. De<br />
plus, hormis l’épilepsie, ils ne présentent<br />
pas plus de pathologies chroniques.<br />
■<br />
Emilie Lassalle<br />
Dr Jean-Claude Druvert<br />
(Médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, chargé <strong>du</strong> haut niveau à la FFH)<br />
Pour les malvoyants ou les non-voyants,<br />
tout combat doit commencer par une prise<br />
<strong>du</strong> kimono de l’adversaire.<br />
Résultats de la délégation française aux jeux paralympiques d'Athènes 2004<br />
Même si la délégation française n'a pas égalé son record obtenu à Sydney (86 médailles<br />
dont 30 en or et une place au 7 e rang mondial), elle rapporte tout de même, des jeux Paralympiques<br />
d'Athènes, un total de 74 médailles, dont 18 en or, et se place ainsi au 9 e rang<br />
mondial sur les 136 nations participantes (Tab. I).<br />
DES ATHLÈTES EN OR…<br />
Athlétisme<br />
- Assia El Hannouni, médaillée d'or <strong>du</strong> 100 m,<br />
200 m,400 m et 800 m,catégorie T12 (athlètes<br />
malvoyants).<br />
- Joël Jeannot,médaillé d'or <strong>du</strong> 10 000 m,catégorie<br />
T54 (athlètes en fauteuil blessés mé<strong>du</strong>llaires<br />
et avec autres handicaps assimilés).<br />
Cyclisme<br />
- Laurent Thirio<strong>net</strong>, médaillé d'or de poursuite<br />
indivi<strong>du</strong>elle sur piste, catégorie LC3 (athlètes<br />
handicapés de l'un des membres inférieurs,<br />
avec ou sans handicap des membres supérieurs,pédalant<br />
en majorité avec une jambe).<br />
Escrime<br />
- Cyril More, médaillé d'or d'épée, catégorie A<br />
(athlètes dont l'équilibre est assuré en position<br />
assise,qui peuvent bouger le tronc dans toutes<br />
les directions et dont les mouvements de la<br />
main maintenant l'épée ne sont pas limités).<br />
- Robert Citerne,Cyril More,David Maillard et<br />
Alim Latreche,médaillés d'or d'épée par équipe,<br />
toutes catégories A et B (athlètes dont<br />
l'équilibre est limité et qui ont besoin d'un<br />
appui).<br />
Judo<br />
- Karima Medjeded, médaillée d'or catégorie<br />
moins de 48 kg.<br />
- Cyril Jonard, médaillé d'or catégorie moins<br />
de 81 kg.<br />
Tableau I<br />
Classement général des nations aux jeux Paralympiques d’Athènes 2004.<br />
Rang par<br />
Rang par<br />
nombre total<br />
Nation<br />
Total<br />
nombre<br />
de médailles<br />
total de<br />
d’or<br />
médailles<br />
1 Chine 63 46 32 141 1<br />
2 Grande Bretagne 35 30 29 94 3<br />
3 Canada 28 19 25 72 7<br />
4 Etats-Unis 27 22 39 88 4<br />
5 Australie 26 38 36 100 2<br />
6 Ukraine 24 12 19 55 9<br />
7 Espagne 20 27 24 71 8<br />
8 Allemagne 19 28 32 79 5<br />
9 (7*) France 18 (30*) 26 (28*) 30 (30*) 74 (86*) 6<br />
10 Japon 17 15 20 52 11<br />
* Résultats de la délégation française aux jeux Paralympiques de Sydney 2000.<br />
Natation<br />
- Ludivine Loiseau, médaillée d'or <strong>du</strong> 50 m<br />
papillon, catégorie S6 (athlètes handicapés<br />
moteur).<br />
- Béatrice Hess, médaillée d'or <strong>du</strong> 100 m brasse<br />
et 200 m nage libre, catégorie S5 (athlètes<br />
handicapés moteur).<br />
- Pascal Pinard, médaillé d'or <strong>du</strong> 100 m brasse,<br />
catégorie SB4 (athlètes handicapés<br />
moteur).<br />
Tennis de table<br />
- Isabelle Lafaye-Marziou, médaillée d'or, catégories<br />
1 et 2 (athlètes tétraplégiques ou paraplégiques<br />
participant aux compétitions avec<br />
leur fauteuil roulant).<br />
- Isabelle Lafaye-Marziou, Stéphanie Mariage<br />
et Geneviève Clot, médaillées d'or par équipe,<br />
catégories 1, 2 et 3 (athlètes tétraplégiques<br />
ou paraplégiques participant aux compétitions<br />
avec leur fauteuil roulant).<br />
- Stéphane Messi, médaillé d'or, catégorie 7<br />
(athlètes debout présentant une combinaison<br />
de handicaps tels que, par exemple, des difficultés<br />
à déplacer la main qui tient la raquette<br />
ou la perte de l'équilibre).<br />
Voile<br />
- Damien Seguin, médaillé d’or de quillard<br />
solitaire 2,4 mR, toutes catégories.<br />
Benjamin Loyseau<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
Evénement: les premiers jeux Paralympiques grecs<br />
MÉDECINS DU SPORT 11 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 13<br />
< DOSSIER ><br />
Handi<strong>sport</strong><br />
Handi<strong>sport</strong> :<br />
une pratique <strong>sport</strong>ive<br />
encore méconnue<br />
DR JEAN-CLAUDE DRUVERT*, DR DOMINIQUE PAILLER**,<br />
DR CLAUDE BENDERITTER***, DR JEAN-BERNARD PIERA****<br />
Benjamin Loyseau<br />
Mots clés<br />
Handi<strong>sport</strong><br />
Performances<br />
Suivi médical<br />
Prévention<br />
Dopage<br />
Classification<br />
La 12 e édition des jeux Paralympiques<br />
d’été à Athènes, est l’occasion de faire<br />
le point sur l’ensemble des pathologies<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong>if handi<strong>sport</strong> de haut niveau,<br />
ainsi que des particularités <strong>du</strong> matériel,<br />
de la classification des <strong>sport</strong>ifs et des<br />
problèmes spécifiques de prévention<br />
<strong>du</strong> dopage.<br />
* MÉDECIN DU SPORT CHARGÉ DU HAUT NIVEAU À LA FFH<br />
** MÉDECIN DE MPR, MÉDECIN FÉDÉRAL NATIONAL DE LA FFH<br />
*** MÉDECIN DE MPR, MÉDECIN DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE BASKET BALL<br />
**** PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE FFH<br />
Sommaire<br />
Les particularités <strong>du</strong> suivi médical<br />
<strong>du</strong> haut niveau handi<strong>sport</strong> Page 14<br />
● A - Rappels anatomiques et physiologiques<br />
● B - Tests d’effort chez le blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
● C - Poids de forme et taux de masse grasse<br />
● D - Thermorégulation <strong>du</strong> blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
● E - La fatigue et le surentraînement chez le blessé<br />
mé<strong>du</strong>llaire<br />
● F - Les cas particuliers<br />
Les pathologies<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong>if handi<strong>sport</strong> Page 17<br />
● A - Chez le blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
● B - Chez l’amputé de membre inférieur<br />
● C - Chez les <strong>sport</strong>ifs en fauteuil roulant<br />
Le matériel et les adaptations<br />
en handi<strong>sport</strong> Page 21<br />
● A - L’évolution des fauteuils roulants<br />
● B - Les prothèses de <strong>sport</strong><br />
● C - Les autres adaptations<br />
● D - Conclusion<br />
Problèmes spécifiques de prévention<br />
<strong>du</strong> dopage et de la classification Page 24<br />
● A - Les autorisations d’utilisation de médicaments<br />
à des fins thérapeutiques (AUT)<br />
● B - La spécificité <strong>du</strong> contrôle antidopage<br />
● C - Le boosting<br />
● D - Protestations dans le cadre des classifications<br />
Conclusion<br />
Bibliographie<br />
MÉDECINS DU SPORT 13 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 14<br />
Handi<strong>sport</strong><br />
< DOSSIER ><br />
Les particularités <strong>du</strong> suivi médical<br />
<strong>du</strong> haut niveau handi<strong>sport</strong><br />
C’est en 1994 que la pratique <strong>du</strong><br />
handi<strong>sport</strong> comme <strong>sport</strong> de haut<br />
niveau a été reconnue officiellement.<br />
Son suivi médical est codifié,<br />
comme pour les valides, et les derniers<br />
textes datent de février 2004.<br />
La plupart des <strong>sport</strong>ifs handicapés sont<br />
suivis sur un plateau médico-technique<br />
agréé dans leur région, ainsi que par un<br />
spécialiste en médecine physique et de<br />
réadaptation (MPR) pour un bilan annuel<br />
<strong>du</strong> handicap. Le médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> se<br />
trouve parfois confronté à l’impossibilité<br />
de réaliser certains actes techniques ou<br />
à une difficile interprétation de résultats<br />
car les normes ne sont établies que pour<br />
les valides.<br />
■A - Rappels anatomiques<br />
et physiopathologiques<br />
Après une lésion de la moelle épinière,<br />
on distingue 3 niveaux : la moelle suslésionnelle<br />
est saine, en zone lésionnelle<br />
la moelle n’est plus fonctionnelle et en<br />
zone sous-lésionnelle, la moelle, restée<br />
intacte, a un fonctionnement autonome<br />
puisqu’elle est déconnectée des centres<br />
supérieurs. Le système neurovégétatif<br />
gère la thermorégulation, les fonctions<br />
cardio-respiratoires, digestives, urinaires<br />
et génito-sexuelles (Tab. 1). Deux systèmes<br />
sont opposés :<br />
● le système sympathique, adrénergique,<br />
qui a des centres mé<strong>du</strong>llaires situés entre<br />
C8 et L2 avec relais par les chaînes ganglionnaires<br />
paravertébrales ; l’innervation<br />
sympathique <strong>du</strong> cœur est située entre T3<br />
et T5 et celle de la glande mé<strong>du</strong>llosurrénale<br />
entre T3 et L3, la majeure partie<br />
de l’innervation étant entre T6 et T9 ;<br />
● le système parasympathique qui a deux<br />
centres, un dans le tronc cérébral, l’autre<br />
dans la moelle sacrée, en S2-S3-S4 (vessie<br />
et organes génitaux).<br />
L’adaptation à l’effort <strong>du</strong> blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
(BM) est d’autant moins bonne que<br />
son niveau lésionnel est élevé.<br />
L’adaptation <strong>du</strong> tétraplégique se fait par<br />
la levée <strong>du</strong> frein vagal et une plus grande<br />
différence artério-veineuse <strong>du</strong> territoire<br />
actif. La corrélation est faible entre la fréquence<br />
cardiaque (FC) et la VO2, la<br />
masse musculaire mise en jeu est restreinte<br />
chez le tétraplégique. L’atteinte<br />
de la vasomotricité est responsable d’une<br />
séquestration splanchnique et d’une diminution<br />
<strong>du</strong> retour veineux, parfois améliorée<br />
par la spasticité, mais qui gêne le<br />
plus souvent l’activité <strong>sport</strong>ive.<br />
Chez le paraplégique haut, T5 et au-dessus,<br />
l’innervation sympathique cardiaque<br />
est préservée mais pas celle de la mé<strong>du</strong>llosurrénale.<br />
L’adaptation se fait par une<br />
augmentation de l’activité sympathique<br />
de la chaîne ganglionnaire sus-lésionnelle.<br />
L’augmentation <strong>du</strong> débit cardiaque<br />
ne peut se faire que par une plus grande<br />
augmentation de la FC. L’innervation <strong>du</strong><br />
cœur des blessés de niveau T6 à T12 est<br />
intacte et celle de leur mé<strong>du</strong>llosurrénale<br />
est partielle.<br />
Quant aux paraplégiques lombaires, ils<br />
ont une innervation presque intacte de<br />
la surrénale et ne sont pénalisés que par<br />
le retour veineux.<br />
■B - Test d’effort chez<br />
le blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
Le mouvement de pédalage des ergo-<br />
Pour les <strong>sport</strong>ifs qui pratiquent<br />
un <strong>sport</strong> où l’usage <strong>du</strong> fauteuil<br />
est important, la pratique de tests<br />
sur un ergomètre leur permettant<br />
d’utiliser leur propre fauteuil se justifie.<br />
mètres à bras, utilisés généralement dans<br />
les centres médico-<strong>sport</strong>ifs pour les<br />
rameurs ou les kayakistes, ne représente<br />
que très imparfaitement le mouvement<br />
de propulsion <strong>du</strong> fauteuil roulant (FR).<br />
Ces ergomètres sont néanmoins suffisants<br />
pour les <strong>sport</strong>ifs handicapés qui pratiquent<br />
une discipline à faible dépense<br />
énergétique.<br />
Les protocoles ne peuvent être standardisés<br />
car ils doivent s’adapter au niveau<br />
lésionnel et au niveau de pratique. Les<br />
plus utilisés ont des paliers courts avec<br />
des incréments de faible intensité<br />
(10 W/mn). Il faut éviter les protocoles<br />
trop longs qui mettent en jeu une thermorégulation<br />
défaillante et sous-estiment<br />
la VO2 max. Une épreuve avec charge<br />
de départ trop élevée fait intervenir les<br />
filières anaérobies et sous-estime aussi la<br />
VO2 max. D’une manière générale, cette<br />
VO2 diminue en fonction de la hauteur<br />
de la lésion, doublant entre un tétraplégique<br />
et un paraplégique lombaire (de<br />
9 ml/kg/mn à 50 ml/kg/mn pour des<br />
athlètes de valeur mondiale). Sawka et<br />
Rasche, dans deux études, ont montré<br />
l’intérêt d’un protocole continu. Dallmejer,<br />
Woulde préconisent un test de force<br />
maximale isométrique comme base. Le<br />
test est ensuite con<strong>du</strong>it avec une charge<br />
Laurent Baheux<br />
MÉDECINS DU SPORT 14 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 15<br />
< DOSSIER ><br />
Handi<strong>sport</strong><br />
Tableau I<br />
Conséquences <strong>du</strong> dysfonctionnement <strong>du</strong> système neurovégétatif sur l’adaptation cardiovasculaire et métabolique<br />
<strong>du</strong> blessé mé<strong>du</strong>llaire (d’après Schmid et Steinberg).<br />
Niveau lésionnel Physiopathologie Mécanismes compensatoires<br />
Tétraplégie C5- C8<br />
Paraplégie T1-T6<br />
Paraplégie T7-T12<br />
Paraplégie lombaire<br />
- Pas d’innervation sympathique cardiaque<br />
et de la mé<strong>du</strong>llosurrénale : diminution<br />
des réponses chronotropes et inotropes,<br />
mauvais retour veineux (limitation <strong>du</strong> débit<br />
cardiaque et de la FC) ; la corrélation existe<br />
mais est faible entre la VO2 et la FC.<br />
- Tendance à l’hypotension.<br />
- Risque HRA.<br />
- Thermorégulation non efficace avec risque<br />
d’hypo ou d’hyperthermie suivant<br />
l’environnement.<br />
- Innervation cardiaque sympathique<br />
+/- complète.<br />
- Pas d’innervation de la mé<strong>du</strong>llosurrénale.<br />
- Risque HRA.<br />
- Thermorégulation peu efficace.<br />
- Mauvais retour veineux avec séquestration<br />
dans le territoire splanchnique.<br />
- Innervation sympathique cardiaque intacte ;<br />
innervation partielle de la mé<strong>du</strong>llosurrénale.<br />
- Thermorégulation imparfaite.<br />
- Mauvais retour veineux des membres<br />
inférieurs.<br />
- Innervation complète de la mé<strong>du</strong>llosurrénale<br />
(bonne adaptation métabolique,<br />
glycogénolyse et lipolyse).<br />
- Mauvais retour veineux des membres<br />
inférieurs.<br />
- Thermorégulation sub-normale.<br />
- Diminution <strong>du</strong> tonus vagal.<br />
- Augmentation de la différence artério-veineuse<br />
dans le territoire musculaire actif.<br />
- Hyperréactivité de l’adréno-récepteur alpha<br />
périphérique*.<br />
- Augmentation de l’activité sympathique<br />
en territoire sus-lésionnel.<br />
- Augmentation plus grande de la FC/VO2<br />
permettant un débit cardiaque équivalent,<br />
malgré un VES plus faible.<br />
- Quand l’innervation cardiaque est intacte,<br />
la capacité <strong>du</strong> système cardiovasculaire n’est pas<br />
un facteur limitant la VO2, sauf en cas<br />
de conditions extrêmes (chaleur...).<br />
Idem paraplégie T7-T12.<br />
FC = fréquence cardiaque ; VO2 = consommation d’oxygène ; VES = volume d’éjection systolique ; HRA = hyperréflexivité autonome.<br />
* hypersensibilité <strong>du</strong> récepteur ou échec de ré-assimilation présynaptique de la noradrénaline au niveau <strong>du</strong> récepteur, non tranchée par Teasell et coll.<br />
de départ à 10-20 % de cette charge<br />
maximale et les incréments se font toutes<br />
les minutes par palier de 10 % de la puissance<br />
maximale estimée.<br />
Pour ceux qui pratiquent un <strong>sport</strong> où<br />
l’usage <strong>du</strong> fauteuil est plus important<br />
(course en fauteuil, basket ou tennis), la<br />
pratique de tests sur un ergomètre leur<br />
permettant d’utiliser leur propre fauteuil<br />
de <strong>sport</strong> se justifie. Actuellement, le plus<br />
adapté nous semble le VP100 HTE. Outre<br />
la mesure de la VO2 max, cet ergomètre<br />
enregistre la poussée sur chaque main<br />
courante, permettant de dépister des asymétries<br />
de puissance liées à une technique<br />
imparfaite ou à une faiblesse de<br />
muscles de la ceinture scapulaire (étude<br />
iso cinétique). En l’absence d’un VP100,<br />
la vitesse maximale aérobie (VMA) peut<br />
être appréciée chez les coureurs par leurs<br />
meilleures performances sur 5 000 mètres<br />
piste.<br />
Il n’est pas possible de se contenter, chez<br />
les <strong>sport</strong>ifs handicapés, d’effort sous-maximaux<br />
<strong>du</strong> fait de l’absence de tables de<br />
corrélation qui ne peuvent être établies<br />
compte tenu des différents facteurs de<br />
variabilité de population (outre le sexe,<br />
le niveau neurologique, les caractères<br />
spastique ou flasque, complet ou incomplet).<br />
Il faut donc pratiquer des tests maximaux<br />
dont on sait que, pour un exercice<br />
de membres supérieurs, le facteur limitant<br />
n’est pas l’appareil cardiovasculaire<br />
mais la musculature de ces membres<br />
supérieurs. De nombreux auteurs ont<br />
prouvé que, quel que soit le type d’ergomètre,<br />
ces tests pour <strong>sport</strong>ifs en fauteuil<br />
n’étaient ni repro<strong>du</strong>ctibles ni fiables.<br />
■C - Poids de forme et taux<br />
de masse grasse<br />
Le poids de forme <strong>du</strong> blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
est, comme pour le <strong>sport</strong>if valide, le<br />
poids auquel il réalise ses meilleures<br />
performances. Signalons qu’il est<br />
souvent difficile de peser ces athlètes et<br />
qu’il faut utiliser une balance adaptée à<br />
la pesée assise.<br />
Peut-on se fier à la mesure de la masse<br />
grasse et quelles méthodes utiliser ? En<br />
MÉDECINS DU SPORT 15 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 16<br />
Handi<strong>sport</strong><br />
< DOSSIER ><br />
zone sous-lésionnelle, le corps <strong>du</strong> blessé<br />
mé<strong>du</strong>llaire est modifié : diminution de la<br />
masse musculaire, augmentation de la<br />
masse grasse, diminution de la densité<br />
osseuse.<br />
Spungen estime qu’un tétraplégique a<br />
une augmentation de poids de 22 % par<br />
rapport à un sujet valide de même taille.<br />
Il a comparé 8 méthodes de mesure de<br />
la masse grasse (4 méthodes anthropométriques<br />
et 4 techniques sophistiquées)<br />
et conclut que 4 méthodes ne sont pas<br />
significativement différentes : mesure <strong>du</strong><br />
potassium total et de l’eau totale de l’organisme,<br />
impédance bio-électrique et<br />
équation de régression de Steinkamp qui<br />
utilise la mesure de plis cutanés et circonférences<br />
pour apprécier la masse grasse.<br />
Ainsi, pour les hommes de 25-34 ans, on<br />
devrait appliquer l’équation suivante :<br />
Masse grasse en kg = 0,372<br />
(cir. crête iliaque) + 0,249 (pli<br />
triceps ) + 0,449 (cir. cuisse) +<br />
0,38 (plis thorax) - 45,464<br />
La mesure par impédance est donc le<br />
choix le plus simple.<br />
■D - Thermorégulation<br />
<strong>du</strong> blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
Le dysfonctionnement neurovégétatif<br />
implique l’absence de contrôle vasomoteur<br />
et des réponses sudorales en zone<br />
sous-lésionnelle. Le blessé mé<strong>du</strong>llaire, qui<br />
ne transpire pas ou peu dans ce territoire,<br />
est donc particulièrement influencé par<br />
l’environnement extérieur (température<br />
et hygrométrie), pouvant avoir une<br />
hyperthermie à l’exercice ou une hypothermie<br />
en environnement froid.<br />
Hopman a étudié l’adaptation <strong>du</strong> blessé<br />
mé<strong>du</strong>llaire lors d’un effort à 35° C et 70 %<br />
d’hygrométrie. Les pertes d’eau par sudation<br />
sont d’autant moins importantes que<br />
le niveau lésionnel est haut et les tétraplégiques<br />
doivent être très vigilants lors<br />
des compétitions en ambiance chaude<br />
et craindre les coups de chaleur. Il faut<br />
minimiser l’exposition au soleil direct en<br />
privilégiant l’ombre (les coups de soleil<br />
ne sont pas ressentis en zone sous-lésionnelle),<br />
les vêtements adaptés avec couvrechef,<br />
l’hydratation... Les pertes hydriques<br />
sont difficiles à évaluer, toujours par difficulté<br />
à peser le <strong>sport</strong>if, et l’efficacité de<br />
la diurèse en période de récupération<br />
peut être appréciée par la mesure de la<br />
densité urinaire (bandelette réactive <strong>du</strong><br />
commerce ou réfractomètrie) ou plus simplement<br />
par la clarté des urines.<br />
■E - La fatigue et<br />
le surentraînement<br />
chez le blessé mé<strong>du</strong>llaire<br />
Le dysfonctionnement neurovégétatif complique<br />
l’établissement d’un programme<br />
d’entraînement aérobie pour un blessé<br />
mé<strong>du</strong>llaire car la FC n’est plus un indicateur<br />
fiable de l’intensité <strong>du</strong> travail, en particulier<br />
pour les niveaux supérieurs à T5.<br />
Les signes de fatigue, connus sous le nom<br />
de syndrome sympathique ou parasympathique,<br />
ne peuvent donc s’appliquer<br />
que dans les lésions mé<strong>du</strong>llaires lombaires.<br />
On peut utiliser le questionnaire dit “de<br />
forme” de la société française de médecine<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong> (l’item 50 sera modifié et le<br />
mot bras remplacera jambes).<br />
Drory a étudié les symptômes potentiels<br />
de surentraînement chez des blessés<br />
mé<strong>du</strong>llaires <strong>sport</strong>ifs et les 4 items qui lui<br />
paraissent le plus pertinent pour les tétraplégiques<br />
ou paraplégiques thoraciques<br />
hauts sont :<br />
• les vertiges,<br />
• la fatigue,<br />
• les douleurs musculaires,<br />
• l’essoufflement.<br />
Ces symptômes sont d’autant plus présents<br />
que le niveau lésionnel est haut<br />
(Tab. 2).<br />
Le car<strong>net</strong> d’entraînement est important<br />
pour tenter d’équilibrer au mieux les<br />
périodes de préparation et les indispensables<br />
périodes de récupération.<br />
■F - Les cas particuliers<br />
Certains <strong>sport</strong>ifs se voient dispensés d’une<br />
partie <strong>du</strong> bilan médical obligatoire :<br />
• des bilans biologiques pour les amputés<br />
doubles de bras, les agénésiques ou<br />
encore un hémophile arthrodesé de<br />
genou ;<br />
• de l’épreuve d’effort pour les blessés<br />
mé<strong>du</strong>llaires ne pouvant pas accéder à<br />
un ergomètre à bras, pour les agénésiques<br />
asymétriques et pour les <strong>sport</strong>ifs<br />
de petite taille, pour lesquels aucun ergomètre<br />
ne peut être adapté, pour les IMC<br />
dont les dyskinésies bucco-faciales ne permettent<br />
pas d’utiliser un embout de<br />
recueil des gaz.<br />
■<br />
Figure 1 -<br />
Thermorégulation<br />
<strong>du</strong> blessé mé<strong>du</strong>llaire :<br />
le niveau critique est<br />
T6 et au-dessus.<br />
Tableau II<br />
Symptômes potentiels de surentraînement en fonction<br />
<strong>du</strong> niveau lésionnel.<br />
Niveau Vertiges Fatigue Douleurs Sensation<br />
lésionnel % % musculaires d’essoufflement<br />
% %<br />
Cervical 26,7 93,3 20 6,7<br />
T1-T5 15 35 20 5<br />
T6-T12 5,1 33 12,8 0<br />
Lombaire 0 29,4 5,9 0<br />
MÉDECINS DU SPORT 16 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 17<br />
< DOSSIER ><br />
Handi<strong>sport</strong><br />
Les pathologies <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if handi<strong>sport</strong><br />
Les pathologies spécifiques sont peu<br />
nombreuses. Dans chaque <strong>sport</strong>,<br />
on recense les mêmes pathologies<br />
que chez les valides. En revanche, il faut<br />
se souvenir de deux particularités :<br />
• la pratique <strong>sport</strong>ive peut favoriser la<br />
survenue de troubles liés au handicap ;<br />
• une pathologie anodine pour un valide<br />
peut avoir un retentissement fonctionnel<br />
très important pour un handicapé (lésion<br />
de l’unique LCAE d’un amputé tibial, épicondylite<br />
chez un paraplégique lui interdisant<br />
les transferts...).<br />
■A - Chez le blessé<br />
mé<strong>du</strong>llaire<br />
● L’escarre : le diagnostic<br />
à ne pas manquer<br />
Malgré l’évolution technologique des supports<br />
d’assises et l’amélioration de la<br />
connaissance physiopathologique des<br />
escarres, le blessé mé<strong>du</strong>llaire reste un<br />
patient à risque, même s’il est jeune et<br />
<strong>sport</strong>if. Les contraintes mécaniques par<br />
cisaillement et frottement, une compression<br />
tissulaire entre une saillie osseuse et<br />
le plan <strong>du</strong>r <strong>du</strong> fauteuil comme une mauvaise<br />
microcirculation dans le territoire<br />
paralysé en sont les principales causes.<br />
Il faut savoir reconnaître une escarre<br />
débutante, qui peut être réversible. Le<br />
stade 1 est une simple rougeur cutanée,<br />
Benjamin Loyseau<br />
Prothèse fémorale<br />
d’un sprinter.<br />
suivie d’une phlyctène, allant vers la désépidermation<br />
dont l’aspect évoque une<br />
brûlure <strong>du</strong> deuxième degré superficiel.<br />
Les stades suivants évoluent vers une<br />
nécrose noirâtre qui laissera des séquelles<br />
cutanées. On sous-estime souvent le problème<br />
car la peau résiste mieux à l’ischémie<br />
que les tissus profonds et certains<br />
ont comparé l’escarre à un iceberg dont<br />
la partie visible cache parfois des dégâts<br />
considérables.<br />
Toutes les zones de pression peuvent être<br />
concernées. L’escarre ischiatique peut<br />
être trompeuse <strong>du</strong> fait de l’interposition<br />
d’une bourse séreuse entre l’ischion et le<br />
tissu cutané. Elle peut se transformer en<br />
abcès et diffuser, créant une cellulite, voire<br />
un état septicémique.<br />
Sont des facteurs aggravants :<br />
• les antécédents d’escarres,<br />
• l’effort physique qui provoque sudation<br />
et macération accompagnées parfois<br />
de fuites urinaires,<br />
• l’augmentation de la fréquence des<br />
transferts (fauteuil de <strong>sport</strong>-fauteuil de<br />
ville),<br />
• la longueur des déplacements pour les<br />
compétitions,<br />
• l’ambiance humide (piscine),<br />
• la déshydratation...<br />
Concentré sur sa compétition, le <strong>sport</strong>if<br />
qui connaît pourtant parfaitement les<br />
règles d’autosurveillance peut minimiser<br />
les premiers signes cutanés ou souslésionnels<br />
(augmentation de la spasticité).<br />
Comme dans la littérature, environ 80 %<br />
de nos <strong>sport</strong>ifs ont déjà souffert d’escarre<br />
dans leur vie de paraplégique. Suivant<br />
les études, les chiffres, lors de la pratique<br />
<strong>sport</strong>ive et hors <strong>sport</strong>ifs d’élite, vont de 3 %<br />
(Mac Cormack) à 14 % (Wilson).<br />
En cas d’échec d’un traitement médical<br />
correctement effectué, seule la chirurgie<br />
reconstructrice apportera la guérison.<br />
Vis-à-vis de l’escarre, le médecin qui suit<br />
un <strong>sport</strong>if paraplégique doit avoir en<br />
mémoire quelques affirmations :<br />
• elle est un risque potentiel permanent<br />
de tout blessé mé<strong>du</strong>llaire, quelle que soit<br />
sa condition physique ;<br />
• elle peut survenir très vite (en quelques<br />
dizaines de minutes d’un appui intempestif),<br />
mais peut nécessiter de longs mois<br />
de traitement ;<br />
• le revêtement cutané est un capital qu’il<br />
est impératif de sauvegarder précieusement<br />
;<br />
• elle est une contre-indication absolue<br />
à l’appui, donc à la compétition, quelle<br />
que soit l’importance de l’enjeu et de l’investissement<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong>if dans sa préparation,<br />
sauf dans le cas très particulier d’une<br />
lésion en zone de non-appui (par<br />
exemple, la face dorsale d’une phalange<br />
d’orteil).<br />
■B - Les autres pathologies<br />
● L’infection urinaire<br />
L’infection des urines est tellement fréquente<br />
chez le paraplégique qu’elle ne<br />
doit être traitée par antibiotiques qu’en<br />
cas de signes généraux, afin d’éviter les<br />
résistances. Une bonne hydratation et<br />
une acidification par la prise de vitamine C<br />
suffisent. Il ne faut néanmoins pas oublier<br />
la recherche de complications comme les<br />
lithiases vésicales.<br />
● Le coup de chaleur<br />
Le coup de chaleur est un risque <strong>du</strong> tétraplégique<br />
dont les centres de thermoré-<br />
MÉDECINS DU SPORT 17 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 18<br />
Handi<strong>sport</strong><br />
< DOSSIER ><br />
gulation sont atteints, d’autant que sa<br />
zone d’échange cutané par transpiration<br />
est ré<strong>du</strong>ite au territoire sus-lésionnel. Il<br />
devra se méfier de l’atmosphère confinée<br />
d’un gymnase surchauffé.<br />
● L’hyperréfléxie autonome<br />
L’hyperréflexie autonome (HRA) est l’apanage<br />
des blessés mé<strong>du</strong>llaires de niveau<br />
lésionnel supérieur à T5 (cf. problèmes<br />
spécifiques de prévention <strong>du</strong> dopage).<br />
■B - Chez l’amputé<br />
de membre inférieur<br />
● Les pathologies <strong>du</strong> moignon<br />
Le médecin qui examine un amputé de<br />
membre inférieur (AMI) doit être attentif<br />
à plusieurs aspects <strong>du</strong> moignon :<br />
• la peau,<br />
• les parties molles,<br />
• les excroissances osseuses,<br />
• la sensibilité (greffe cutanée),<br />
• un éventuel œdème,<br />
• l’équilibre musculaire des agonistes et<br />
antagonistes...<br />
Il doit également connaître la cause de<br />
l’amputation : traumatique le plus souvent,<br />
mais parfois anomalie congénitale<br />
ou plus rarement tumorale (ostéosarcome).<br />
Les problèmes le plus souvent rencontrés<br />
sont :<br />
• des douleurs par une mauvaise adaptation<br />
de l’emboîture au moignon nécessitant<br />
un avis <strong>du</strong> médecin appareilleur et<br />
<strong>du</strong> prothésiste ;<br />
• un névrome avec ses douleurs caractéristiques<br />
en éclair ;<br />
• des hématomes par impacts répétitifs ;<br />
• une hyperkératose, liée à l’utilisation de<br />
manchon en mousse de polyéthylène ;<br />
• des folliculites, favorisées par la sudation<br />
et un manchon en silicone, qui touchent<br />
essentiellement le moignon de<br />
l’amputé tibial à sa partie distale et postérieure,<br />
dans la région de plicature <strong>du</strong><br />
manchon ;<br />
• un eczéma de contact par allergie aux<br />
matériaux ou à un pro<strong>du</strong>it d’entretien ;<br />
• des plaies ou ulcérations <strong>du</strong> moignon<br />
précédées de rougeurs, puis phlyctènes<br />
qui peuvent s’infecter et doivent faire sup-<br />
primer l’utilisation de la prothèse jusqu’à<br />
cicatrisation ; on recherche alors une<br />
charge exagérée <strong>du</strong> travail <strong>sport</strong>if, une<br />
peau fragile, des parties molles insuffisantes<br />
ou une saillie osseuse ;<br />
• des fractures <strong>du</strong> membre appareillé<br />
lors d’une chute (déminéralisation <strong>du</strong><br />
membre amputé).<br />
L’amélioration des prothèses et des manchons<br />
permet aux amputés de supporter<br />
des contraintes d’entraînement plus<br />
importantes qu’autrefois. Un amputé bien<br />
é<strong>du</strong>qué se connaît parfaitement et effectue<br />
un examen soigneux et quotidien de<br />
son moignon, en particulier après les<br />
entraînements. Un bon moignon est un<br />
moignon indolore et sans lésion cutanée.<br />
● Technopathie : la fracture<br />
de fatigue <strong>du</strong> membre sain<br />
chez l’AMI<br />
Les fractures de fatigue ou de stress sont<br />
connues chez le <strong>sport</strong>if valide, en particulier<br />
chez le coureur de fond (jusqu’à<br />
9 % pour certains auteurs). Cette pathologie<br />
n’est pas décrite chez l’AMI non <strong>sport</strong>if.<br />
Laboute a rapporté 3 cas de fractures de<br />
fatigue <strong>du</strong> membre sain chez des <strong>sport</strong>ifs<br />
français amputés fémoraux pratiquant<br />
le sprint de niveau national et international.<br />
Dans 2 cas, il s’agit d’amputation<br />
de Gritti (désarticulation de genou avec<br />
fixation de la rotule sur la face inférieure<br />
des condyles) et, dans le dernier cas,<br />
d’une amputation sus-condylienne. Deux<br />
fractures de fatigue étaient localisées sur<br />
le tibia (jonction 1/3 moyen - 1/3 inférieur)<br />
et une sur le scaphoïde tarsien.<br />
Une amputée tibiale, spécialiste de la longueur,<br />
prenant son impulsion sur le côté<br />
appareillé, a également présenté une<br />
fracture de fatigue <strong>du</strong> premier métatarsien<br />
(classiquement, plutôt 1 er et<br />
2 e rayons chez le valide).<br />
La population des AMI pratiquant le <strong>sport</strong><br />
à haut niveau est peu importante, mais il<br />
semble que les fractures de fatigue soient<br />
plus fréquentes chez les amputés fémoraux<br />
et qu’elles touchent essentiellement<br />
le membre sain. Le traitement implique<br />
la décharge et l’appui donc uniquement<br />
sur le membre prothésé. L’augmentation<br />
de la <strong>du</strong>rée de la phase d’appui sur le<br />
membre valide et l’augmentation de la<br />
composante verticale des forces de 20 à<br />
30 % chez l’amputé fémoral, doivent<br />
rendre attentif au devenir articulaire <strong>du</strong><br />
genou et de la hanche controlatéraux<br />
des AMI.<br />
● Les autres pathologies<br />
• La pathologie microtraumatique articulaire<br />
et tendineuse de la cheville et <strong>du</strong><br />
genou.<br />
• La périostite tibiale.<br />
• Les rachialgies provoquées par l’asymétrie<br />
de la foulée, surtout chez l’amputé<br />
fémoral.<br />
• La traumatologie <strong>du</strong> membre supérieur<br />
et de la face par chute à l’arrivée, la<br />
décélération étant ren<strong>du</strong>e délicate par<br />
les prothèses actuelles sans talon.<br />
Un amputé<br />
se connaît<br />
parfaitement<br />
et effectue<br />
un examen soigneux<br />
et quotidien<br />
de son moignon.<br />
■C - Chez les <strong>sport</strong>ifs<br />
en fauteuil roulant<br />
● Pathologie de la scapulo-humérale<br />
L’épaule joue un rôle majeur dans la propulsion<br />
<strong>du</strong> fauteuil roulant (FR) et a donc<br />
été étudiée par de nombreux auteurs qui<br />
décrivent des tendinites, bursites et divers<br />
conflits.<br />
Ainsi, Curtis retrouvent 42 % de plaintes<br />
douloureuses chez le paraplégique et<br />
59 % chez le tétraplégique.<br />
Benjamin Loyseau<br />
MÉDECINS DU SPORT 18 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 19<br />
< DOSSIER ><br />
Handi<strong>sport</strong><br />
1996, l’haltérophilie est aussi pratiquée<br />
par les femmes.<br />
● Syndrome <strong>du</strong> canal carpien<br />
D’après Curtis, le syndrome <strong>du</strong> canal carpien<br />
toucherait environ 5 % des coureurs<br />
en FR. Les causes en seraient les chocs<br />
à répétition malgré les gants de protection<br />
et la sollicitation des poig<strong>net</strong>s dans<br />
des positions extrêmes de flexion-extension.<br />
Course : diversité des handicaps regroupés dans une même classe fonctionnelle.<br />
De nombreuses études utilisent un index,<br />
le WUSPI (Wheelchair User Shoulder Pain<br />
Index), qui comprend 15 items, servant à<br />
mesurer l’intensité de la douleur lors des<br />
activités quotidiennes. La corrélation est<br />
forte entre les douleurs d’épaules et la<br />
<strong>du</strong>rée quotidienne d’utilisation <strong>du</strong> FR.<br />
Chez les <strong>sport</strong>ifs utilisateurs de fauteuil<br />
roulant, la littérature retrouve des pathologies<br />
dans la course où la propulsion est<br />
l’essentiel même de la pratique et dans<br />
les <strong>sport</strong>s avec association d’une élévation<br />
<strong>du</strong> bras (44 % de plaintes d’après<br />
Curtis).<br />
Burham a analysé par iso cinétisme les<br />
épaules des paraplégiques pratiquant le<br />
<strong>sport</strong> 13 heures/semaine et suggère le<br />
rôle d’un déséquilibre des muscles rotateurs<br />
de l’épaule. Les <strong>sport</strong>ifs présentant<br />
un impingement syndrom ont une force<br />
plus faible des ad<strong>du</strong>cteurs et des rotateurs<br />
internes et externes.<br />
Powers et Newsam retrouvent des résultats<br />
similaires en particulier sur la faiblesse<br />
des rotateurs internes.<br />
Les enregistrements EMG montrent également<br />
des variations dans l’activation<br />
des groupes musculaires suivant les techniques<br />
utilisées dans la propulsion <strong>du</strong> FR,<br />
ce qui expliquerait la plus grande prévalence<br />
des douleurs d’épaules chez le<br />
tétraplégique/paraplégique. La fréquence<br />
gestuelle et le temps de poussée joueraient<br />
un rôle dans l’importance de cette<br />
pathologie pouvant être considérée<br />
comme un véritable syndrome d’hyperutilisation<br />
(over use syndrome).<br />
Seule l’étude de Ferrara et Davis a étudié<br />
une population de <strong>sport</strong>ifs de haut<br />
niveau mais avec seulement 19 cas et<br />
sans pourcentage de pathologie<br />
d’épaule. Notre expérience semble donner<br />
des chiffres moins importants, s’expliquant<br />
par la qualité de la préparation<br />
athlétique et par la grande technicité gestuelle<br />
des meilleurs <strong>sport</strong>ifs. Néanmoins,<br />
il faut guetter l’émergence future de ce<br />
type de pathologie car le haut niveau n’a<br />
vraiment débuté que depuis une dizaine<br />
d’années.<br />
● Arthropathie de l’articulation<br />
acromio-claviculaire<br />
L’haltérophile handicapé ne pratique<br />
qu’un mouvement, semblable au développé<br />
couché, contrairement à l’haltérophile<br />
valide (3 mouvements différents).<br />
La barre est descen<strong>du</strong>e des supports jusqu’à<br />
la poitrine où le <strong>sport</strong>if doit marquer<br />
un temps d’arrêt avant de la soulever jusqu’à<br />
extension complète des bras. L’articulation<br />
acromio-claviculaire est sollicitée<br />
en compression avec, à la longue, des<br />
lésions dégénératives aboutissant le plus<br />
souvent à un arrêt de carrière <strong>sport</strong>ive<br />
(Monroche, Bontoux). Le profil type est<br />
le <strong>sport</strong>if masculin de très haut niveau,<br />
âgé de 35 à 40 ans, soulevant des barres<br />
à 200 kg et plus. Il faut noter que, depuis<br />
Benjamin Loyseau<br />
● Fractures<br />
Tout territoire paralysé, central ou périphérique,<br />
ainsi que tout membre amputé<br />
présentent une ostéoporose. Les fractures<br />
ne posent un problème de diagnostic<br />
que chez les blessés mé<strong>du</strong>llaires où elles<br />
peuvent passer inaperçues par absence<br />
de sensibilité et de douleur et il faudra<br />
alors avoir l’esprit attiré par une modification<br />
de spasticité ou de mode mictionnel.<br />
Le risque pour les paraplégiques,<br />
dans certains <strong>sport</strong>s où les chutes sont<br />
fréquentes, pourrait être de 2 et 6 % suivant<br />
les auteurs.<br />
● Autres pathologies<br />
• Les plaies des parties molles surtout<br />
aux mains (ampoules ou brûlures par le<br />
contact avec les mains courantes).<br />
• L’entorse au basket, de la MCP <strong>du</strong> pouce<br />
et des IP, surtout des 2 e et 3 e doigts.<br />
• Les cervicalgies chez le tennisman en<br />
fauteuil, contraint, pour suivre la balle<br />
des yeux lors <strong>du</strong> pivot, à un mouvement<br />
rapide <strong>du</strong> rachis cervical en rotation ou<br />
latéroflexion.<br />
• L’atteinte neurologique périphérique<br />
(nerf de Charles Bell, sus-scapulaire) en<br />
tennis et en natation.<br />
• Une tendinite <strong>du</strong> grand palmaire<br />
chez le pongiste utilisant de manière<br />
presque exclusive le revers <strong>du</strong> fait de<br />
son handicap.<br />
• Les entésopathies <strong>du</strong> bras d’arme en<br />
escrime, provoquées par les vibrations<br />
transmises par la lame ou plus rarement<br />
<strong>du</strong> bras arrière, probablement par microtraumatisme<br />
sur les montants arrières <strong>du</strong><br />
fauteuil en retour de fente.<br />
• Une aggravation exceptionnelle d’une<br />
cavité syringomyélique lors de la pratique<br />
de l’haltérophilie chez un traumatisé<br />
mé<strong>du</strong>llaire.<br />
■<br />
MÉDECINS DU SPORT 19 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 21<br />
< DOSSIER ><br />
Handi<strong>sport</strong><br />
Le matériel et les adaptations<br />
en handi<strong>sport</strong><br />
Si certains matériels sont très spécifiques<br />
et de véritables prototypes<br />
pour les meilleurs <strong>sport</strong>ifs comme<br />
les fauteuils roulants d’athlétisme, de basket<br />
ou de tennis, ou encore les prothèses<br />
de course, il faut savoir qu’il suffit bien<br />
souvent de petites adaptations pour permettre<br />
à une personne handicapée de<br />
pratiquer.<br />
■A - L’évolution<br />
des fauteuils roulants<br />
● Le fauteuil roulant d’athlétisme<br />
(FRA)<br />
La course en fauteuil roulant est une discipline<br />
à part entière, sans équivalent<br />
dans le milieu valide. C’est un <strong>sport</strong> mécanique<br />
qui possède des traits communs<br />
avec le cyclisme, par le matériel utilisé, et<br />
avec la course à pied <strong>du</strong> fait <strong>du</strong> programme<br />
paralympique qui s’étend <strong>du</strong><br />
100 mètres au marathon.<br />
L’évolution technologique <strong>du</strong> matériel et<br />
l’amélioration des principes <strong>du</strong> positionnement<br />
de l’athlète dans le fauteuil ont<br />
ré<strong>du</strong>it le nombre de classes de handicap<br />
en compétition.<br />
L’évolution technique <strong>du</strong> fauteuil roulant<br />
d’athlétisme est souvent jalonnée par le<br />
nom d’un grand champion et une amélioration<br />
parfois spectaculaire de la<br />
meilleure performance mondiale sur<br />
marathon.<br />
Le FRA actuel est un tricycle composé de<br />
plusieurs éléments.<br />
La roue avant<br />
D’un diamètre de 400 mm, le plus souvent<br />
en carbone à 3 bâtons, elle est équipée<br />
de boyau. Le point de référence<br />
pour le départ et l’arrivée est l’axe de<br />
cette roue avant et non pas le boyau.<br />
La fourche<br />
Suivant le même principe que celle d’un<br />
vélo, elle est équipée d’un frein, indispensable<br />
avec les vitesses atteintes. Le<br />
fauteuil “piste” est équipé d’un compensateur<br />
de courbe qui permet à l’athlète<br />
de maintenir sa trajectoire en virage. Les<br />
fauteuils “route” possèdent un système<br />
de rappel dit de direction libre qui à pour<br />
objectif de ramener la roue avant en position<br />
droite.<br />
Les roues arrières<br />
Elles ont un diamètre de 700 mm et des<br />
boyaux de 20 mm de section. Légèreté,<br />
rigidité et aérodynamisme sont les qualités<br />
recherchées. Les roues à 4 bâtons<br />
carbone semblent posséder tous les critères<br />
de performance optimale mais ont<br />
un coût élevé. Ces roues arrières ont un<br />
carrossage négatif de 8 à 12° (angle aigu<br />
entre le plan vertical et le plan de la roue),<br />
le but étant d’augmenter la stabilité en<br />
virage et d’améliorer la poussée sur la<br />
main courante en épousant mieux la trajectoire<br />
naturelle de l’avant-bras et de la<br />
main. L’inconvénient de cette angulation<br />
est la tendance à déformer la roue et à<br />
provoquer un effet gyroscopique qui<br />
diminue le rendement.<br />
Les roues lenticulaires, qui ont une<br />
flasque à la place des rayons, offrent une<br />
importante prise au vent latéral.<br />
Les roues arrières sont reliées à la roue<br />
avant par le châssis-poutre central dont<br />
la longueur assure la stabilité <strong>du</strong> fauteuil<br />
en virage.<br />
Les mains courantes<br />
Les mains courantes équivalent au couple<br />
pédalier-chaîne d’un vélo. D’un diamètre<br />
de 360 à 400 mm, variable suivant la<br />
discipline et le handicap <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if, elles<br />
sont recouvertes d’un revêtement en<br />
caoutchouc antidérapant et leur section<br />
de 10 à 12 mm peut être augmentée<br />
chez les tétraplégiques.<br />
Les accessoires<br />
Des accessoires viennent compléter cet<br />
équipement :<br />
• des gants manufacturés jusqu’au 400<br />
mètres, remplacés par des gants “<strong>du</strong>rs”<br />
fabriqués par les <strong>sport</strong>ifs, au moyen de<br />
billes de polystyrène, afin de boxer avec<br />
Benjamin Loyseau<br />
Le cadre<br />
De 3 m de long et rigide, il peut être en<br />
matériaux divers. L’aluminium est léger<br />
mais souple, le carbone est léger, l’acier<br />
peut être plus ou moins léger et rigide<br />
suivant l’alliage retenu.<br />
L’assise<br />
L’assise est une coque moulée sur mesure<br />
avec un dossier court.<br />
L’évolution technique <strong>du</strong> fauteuil roulant d’athlétisme est<br />
souvent jalonnée par le nom d’un grand champion.<br />
MÉDECINS DU SPORT 21 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 22<br />
Handi<strong>sport</strong><br />
< DOSSIER ><br />
puissance la main courante,<br />
• un casque de port obligatoire,<br />
• un compteur de vitesse,<br />
• un cardio-fréquencemètre,<br />
• un porte-bidon avec tubulure pour l’hydratation<br />
pendant un marathon.<br />
● La position dans le fauteuil<br />
roulant d’athlétisme<br />
Le <strong>sport</strong>if prend en compte sa morphologie<br />
et la discipline pratiquée pour trouver<br />
une position aérodynamique et efficace.<br />
• La hauteur des épaules doit être la<br />
plus élevée possible par rapport à l’axe<br />
des roues arrières.<br />
• L’axe des épaules est situé un peu en<br />
avant de la portion la plus antérieure de<br />
la main courante, sauf pour un tétraplégique<br />
où il est plus reculé.<br />
• Le centre de gravité est le plus près<br />
possible de l’axe des roues arrières pour<br />
augmenter la maniabilité et diminuer la<br />
force d’appui au sol de la roue avant.<br />
Le marathonien a un tronc horizontalisé<br />
et très fléchi sur les cuisses. Le sprinter<br />
est beaucoup moins penché vers l’avant<br />
et il peut mobiliser son tronc pour faciliter<br />
le démarrage.<br />
● La cinématique <strong>du</strong> cycle<br />
de poussée<br />
La brassée, qui équivaut à la foulée <strong>du</strong><br />
coureur à pied, se divise en deux phases<br />
distinctes :<br />
• une phase motrice où la main vient<br />
“boxer” la partie antérieure de la main<br />
courante (sauf pour le tétraplégique qui<br />
utilise sa partie supérieure, technique<br />
Mattson) ;<br />
• et une deuxième phase de suspension<br />
où le membre supérieur, en flexion de<br />
coude et en légère rotation interne<br />
d’épaule, effectue une circum<strong>du</strong>ction.<br />
L’amplitude de ce geste augmente la<br />
vitesse d’impact de la main sur la main<br />
courante et améliore l’accélération. Il faut<br />
plusieurs années d’entraînement pour<br />
obtenir un bon rendement vitesse/amplitude<br />
de ce geste très spécifique. Pour<br />
être efficace, une excellente ceinture scapulaire<br />
est nécessaire.<br />
● Le fauteuil de basket<br />
Il est proche <strong>du</strong> fauteuil de vie quotidienne.<br />
Le châssis est à cadre tubulaire<br />
rigide avec des roues à détachage rapide<br />
pour faciliter les réparations. L’assise est<br />
en toile et il n’a pas de frein. Une roulette<br />
anti-bascule à l’arrière (située au maximum<br />
à 2 cm <strong>du</strong> sol) est autorisée et des<br />
fauteuils 3 roues (une seule petite roue<br />
à l’avant) sont utilisés par environ 20 %<br />
des joueurs actuels. La réglementation<br />
internationale codifie les hauteurs <strong>du</strong><br />
châssis (53 cm), des repose-pieds ou parechocs<br />
(11 cm) et <strong>du</strong> coussin (5 cm à 10 cm<br />
suivant le handicap).<br />
Les grandes roues, d’un diamètre maximum<br />
autorisé de <strong>67</strong>0 mm, sont munies<br />
de flasques pour éviter les blessures des<br />
doigts et protéger les rayons lors des<br />
chocs.<br />
● Le fauteuil de tennis<br />
Le tennis en fauteuil est une discipline<br />
“jeune”, puisque née aux USA il y a moins<br />
de 30 ans. La grande mobilité nécessaire<br />
pour la pratique <strong>du</strong> tennis en fauteuil de<br />
ce <strong>sport</strong> ainsi que l’absence de réglementation<br />
ont fait rapidement évoluer le<br />
matériel.<br />
Il s’agit d’un fauteuil à cadre rigide équipé<br />
de 4 roues jusqu’en 1993, date d’apparition<br />
des premiers 3 roues. La petite roue<br />
avant, de type roller, permet une grande<br />
maniabilité lors des pivots. Le diamètre<br />
des mains courantes est légèrement supérieur<br />
à celui de la jante pour améliorer<br />
l’efficacité <strong>du</strong> démarrage. Le carrossage<br />
des roues arrières est très important, jusqu’à<br />
20° d’inclinaison. Des protègevêtements<br />
maintiennent le bassin latéralement<br />
et des cale-genoux amovibles<br />
empêchent les membres inférieurs d’être<br />
éjectés <strong>du</strong> fauteuil lors des pivots. Le<br />
centre de gravité est au plus près de l’axe<br />
des roues arrières pour faciliter la maniabilité<br />
et améliorer le rendement, au détriment<br />
de la stabilité. Le châssis est ramassé<br />
et, pour améliorer cette stabilité lors des<br />
services et des smashes, une roue arrière<br />
anti-bascule est ajoutée.<br />
■B - Les prothèses de <strong>sport</strong><br />
Les amputés de membre supérieur utilisent<br />
rarement une prothèse dans leur<br />
<strong>sport</strong> car elle est plutôt source de gêne.<br />
Les amputés de membre inférieur ont<br />
bénéficié d’une amélioration de leur<br />
appareillage depuis la fin des années<br />
La grande mobilité nécessaire<br />
pour la pratique <strong>du</strong> tennis<br />
ainsi que l’absence<br />
de réglementation ont fait<br />
rapidement évoluer<br />
le matériel.<br />
Benjamin Loyseau<br />
1980, ce qui a permis une amélioration<br />
des performances. Ainsi, un amputé tibial<br />
court le 100 m en un peu moins de 11’’.<br />
Les prothèses de membre inférieur comprennent<br />
plusieurs éléments.<br />
Le moignon est glissé dans un manchon,<br />
fait sur mesure, en gel de silicone ou de<br />
polyuréthane qui moule étroitement les<br />
reliefs et répartit les contraintes.<br />
L’ensemble moignon-manchon est intro<strong>du</strong>it<br />
dans une emboîture, également faite<br />
sur mesure. Pour les amputés tibiaux, elle<br />
est de type “à contact total”, répartissant<br />
les forces sur toute la surface <strong>du</strong> moignon.<br />
Pour les amputés fémoraux, l’emboîture<br />
est souvent à ischion intégré<br />
plutôt que quadrangulaire classique avec<br />
appui sous-ischiatique. Ils utilisent aussi<br />
souvent un manchon fémoral en gel.<br />
La cohésion entre le moignon et l’emboîture<br />
est assurée par un accrochage<br />
distal avec un clip ou par une gaine qui<br />
recouvre l’emboîture et remonte haut sur<br />
le moignon. Les fémoraux utilisent<br />
presque toujours une ceinture de maintien.<br />
Le segment jambier et le pied sont remplacés<br />
par une lame, généralement en<br />
MÉDECINS DU SPORT 22 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 23<br />
< DOSSIER ><br />
Handi<strong>sport</strong><br />
fibre de carbone, ou en fibre de verre,<br />
d’une épaisseur d’environ 7 mm. Cette<br />
lame emmagasine l’énergie à l’appui et<br />
la restitue à l’impulsion avec un rendement<br />
d’environ 100 % (contre près de<br />
250 % pour un pied valide !). Cette lame<br />
n’a pas de pièce talonnière. Elle est montée<br />
sur l’emboîture pour les amputés<br />
tibiaux et sa longueur est déterminée de<br />
telle façon que les 2 membres aient une<br />
longueur identique en appui digitigrade,<br />
position <strong>du</strong> sprint. Pour la marche, cette<br />
prothèse n’est pas adaptée car le pied prothétique<br />
est monté en équin. Des pointes<br />
d’athlétisme sont fixées directement sur<br />
l’extrémité de cette lame et le coureur ne<br />
porte pas de chaussure de ce côté.<br />
La prothèse des amputés fémoraux doit<br />
intégrer un genou prothétique. Il est à<br />
biellettes et muni d’un contrôle d’extension<br />
par vérin hydraulique. Son rôle est<br />
de limiter l’amplitude de flexion passive<br />
<strong>du</strong> genou au début de la phase oscillante<br />
puis, ayant emmagasiné une énergie,<br />
de la restituer pour une extension la<br />
plus rapide possible en fin de phase oscillante<br />
avant le nouvel appui. La <strong>du</strong>reté<br />
de ces genoux est facilement réglable<br />
sur le terrain.<br />
Les courses pour amputés sont limitées<br />
au 400 mètres pour les tibiaux et au 200<br />
mètres pour les fémoraux, mais quelques<br />
amputés participent à des triathlons. Le<br />
saut en longueur est pratiqué avec le<br />
même type de prothèses par des amputés<br />
tibiaux ou fémoraux, avec impulsion<br />
sur le membre valide ou sur le membre<br />
appareillé !<br />
Chez les amputés tibiaux, la cinématique<br />
de la course est voisine de celle des<br />
valides, presque symétrique. Chez les<br />
fémoraux, la cinématique est différente<br />
avec une asymétrie des <strong>du</strong>rées d’appui,<br />
une augmentation <strong>du</strong> travail d’extension<br />
de hanche et une hyperlordose<br />
lombaire. Au démarrage, il ne peut<br />
vaincre la <strong>du</strong>reté de son genou et<br />
fauche sur le côté avant de pouvoir<br />
revenir dans l’axe, une fois la vitesse de<br />
course atteinte.<br />
■C - Les autres adaptations<br />
● En escrime<br />
Le fauteuil, sans particularité, est placé<br />
dans un appareil de fixation réglable. On<br />
écarte les fauteuils en fonction de l’allonge<br />
<strong>du</strong> tireur le plus petit. Certains tétraplégiques<br />
ont une poignée ergonomique<br />
pour tenir leur arme, d’autres se la font<br />
attacher avec un bandage.<br />
● En cyclisme<br />
Les adaptations techniques dépendent<br />
<strong>du</strong> handicap : repose-moignon fémoral<br />
sur le côté de la selle, prothèse tibiale se<br />
terminant par un sabot enclenché directement<br />
dans le pédalier, positionnement<br />
adapté <strong>du</strong> dérailleur ou des freins suivant<br />
les possibilités restantes des membres<br />
supérieurs. En cas de perte de mobilité<br />
totale ou partielle d’un membre inférieur,<br />
Les courses pour amputés sont limitées au 400 mètres pour les tibiaux et au 200 mètres<br />
pour les fémoraux. Les bi-amputés y participent avec succès !<br />
Laurent Baheux<br />
la manivelle est ballante au niveau de<br />
l’axe <strong>du</strong> pédalier ou est modifiée.<br />
● Le tir à la cible<br />
Les grands handicapés utilisent une<br />
potence pour supporter le poids de la<br />
carabine. Les déficients visuels tirent avec<br />
une lu<strong>net</strong>te optronique qui transforme<br />
l’information visuelle de la cible en une<br />
information sonore reçue dans un<br />
casque.<br />
Archet tétraplégique.<br />
● En équitation<br />
L’équilibre des paraplégiques est meilleur<br />
avec une selle “portugaise” qui maintient<br />
la racine des cuisses et le pubis.<br />
● En voile<br />
L’accastillage des voiliers paralympiques<br />
est adapté pour des manœuvres uniquement<br />
manuelles, toutes ramenées<br />
dans le cockpit.<br />
■D - Conclusion<br />
Les matériels techniques ont considérablement<br />
évolué et sont devenus<br />
indispensables à la réalisation de performances<br />
de haut niveau. Ils rendent la<br />
pratique moins contraignante et plus<br />
confortable pour les handicapés. Le matériel<br />
<strong>sport</strong>if constitue un banc d’essai pour<br />
les innovations de compensation <strong>du</strong> handicap.<br />
■<br />
Benjamin Loyseau<br />
MÉDECINS DU SPORT 23 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 24<br />
Handi<strong>sport</strong><br />
< DOSSIER ><br />
Problèmes spécifiques<br />
de prévention <strong>du</strong> dopage<br />
et de la classification<br />
■A - Les autorisations<br />
d’utilisation de<br />
médicaments à des fins<br />
thérapeutiques (AUT)<br />
Les règlements concernant le dopage<br />
des <strong>sport</strong>ifs handicapés sont calqués sur<br />
ceux <strong>du</strong> CIO et maintenant de l’Agence<br />
Mondiale Antidopage (AMA), à commencer<br />
par la liste des pro<strong>du</strong>its interdits.<br />
Souvent, les <strong>sport</strong>ifs handicapés prennent<br />
des traitements <strong>du</strong> fait de leur handicap<br />
ou de ses conséquences. Pour les<br />
jeux Paralympiques, une demande doit<br />
être faite par le médecin fédéral national<br />
auprès de la commission médicale internationale<br />
ad hoc plusieurs mois avant les<br />
épreuves, avant même la sélection <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong>if. Pour la FFH, cela implique la<br />
recherche et l’analyse des prises médicamenteuses<br />
chez près de 200 personnes.<br />
Il faut expliciter le type de<br />
pro<strong>du</strong>it, sa posologie, les raisons de la<br />
prescription avec justification de l’impossibilité<br />
de son remplacement. L’AUT est<br />
accordée pour la <strong>du</strong>rée des Jeux et, éventuellement,<br />
peut être prolongée de 2 ou<br />
4 ans. Le <strong>sport</strong>if doit présenter son document<br />
de justification lors de tout contrôle.<br />
Lors d’un résultat positif, la première<br />
démarche <strong>du</strong> responsable des contrôles<br />
est de vérifier si une AUT a été donnée<br />
pour ce pro<strong>du</strong>it et, dans ce cas, la procé<strong>du</strong>re<br />
est interrompue.<br />
■B - La spécificité<br />
<strong>du</strong> contrôle antidopage<br />
Les procé<strong>du</strong>res d’un contrôle antidopage<br />
sont les mêmes que chez les valides.<br />
Toutefois, quelques particularités ont été<br />
prévues.<br />
Le <strong>sport</strong>if doit fournir son échantillon<br />
d’urine suivant son mode habituel de<br />
miction. S’il pratique des autosondages,<br />
il sera invité à le faire avec son propre<br />
matériel devant le préleveur. S’il est<br />
équipé d’un collecteur ou d’une sonde<br />
à demeure avec poche de collection des<br />
urines, celle-ci sera vidée et le <strong>sport</strong>if restera<br />
sous contrôle visuel <strong>du</strong> préleveur jusqu’à<br />
ce que la poche soit de nouveau<br />
remplie d’une quantité suffisante d’urines.<br />
Dans les compétitions où sont présents<br />
des infirmes moteurs cérébraux, parfois<br />
cérébelleux et/ou athétosiques, il doit<br />
être prévu des flacons de recueil d’urine<br />
à encolure plus large.<br />
Les contrôles sanguins sont peu répan<strong>du</strong>s,<br />
mais leur faisabilité est étudiée au<br />
cas par cas pour certains handicaps : agénésies<br />
ou amputations à moignons courts<br />
des 2 membres supérieurs, raideurs articulaires<br />
des hémophiles...<br />
Les déficients visuels doivent être accompagnés<br />
d’un voyant qui vérifie les étapes de la<br />
procé<strong>du</strong>re, en particulier la validité des codes<br />
et le remplissage <strong>du</strong> procès-verbal (PV).<br />
Les <strong>sport</strong>ifs handicapés ont souvent des<br />
traitements médicamenteux et le préleveur<br />
doit porter une attention particulière<br />
au remplissage <strong>du</strong> cadre correspondant<br />
sur le PV.<br />
■C - Le boosting<br />
Ce phénomène (Fig.2), propre au handi<strong>sport</strong>,<br />
ne concerne potentiellement qu’une<br />
population restreinte. Il est basé sur le<br />
mécanisme physiopathologique de l’hyperréactivité<br />
autonome (HRA), provoquée<br />
chez certains tétraplégiques et paraplégiques<br />
de niveau dorsal supérieur à T5,<br />
par l’atteinte des centres neurovégétatifs.<br />
Ce phénomène se manifeste cliniquement<br />
par un flush vasomoteur avec rougeur <strong>du</strong><br />
visage et est accompagné d’une poussée<br />
tensionnelle importante. On peut également<br />
constater en sus-lésionnel des marbrures<br />
ou des tâches rouges sur la peau,<br />
ainsi qu’une sudation, et en sous-lésionnel<br />
une pilo-érection et une diminution<br />
de la température cutanée. La stimulation<br />
<strong>du</strong> parasympathique, plus rarement observée,<br />
déclenche des nausées et une bradycardie.<br />
Cette HRA est toujours déclenchée par<br />
un stimulus en territoire sous-lésionnel,<br />
le plus souvent un globe vésical, mais<br />
Le règlement concernant le dopage est<br />
calqué sur celui <strong>du</strong> CIO et les procé<strong>du</strong>res<br />
sont les mêmes que pour les valides.<br />
Laurent Baheux<br />
MÉDECINS DU SPORT 24 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 25<br />
< DOSSIER ><br />
Handi<strong>sport</strong><br />
Benjamin Loyseau<br />
d’HRA avant le départ d’une course,<br />
jusque dans la chambre d’appel, peut<br />
demander à faire prendre la TA <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if.<br />
Si cette dernière est élevée (un seuil<br />
de 180 mm Hg a été établi), le <strong>sport</strong>if est<br />
allongé, sa TA est reprise après 10’ de<br />
repos et, en cas de persistance, il est<br />
écarté <strong>du</strong> départ.<br />
Les protestations dans le cadre des classifications concernent souvent les sujets à handicaps<br />
évolutifs ou en limite de classes, mais plus rarement des simulateurs.<br />
parfois une infection urinaire, une petite<br />
lésion cutanée (escarre) ou encore une<br />
mycose interdigitale ou une folliculite...<br />
Ceux qui y sont sujets le savent et sentent<br />
parfois venir la poussée. Cette hypertension<br />
peut entraîner un risque<br />
d’accident vasculaire cérébral et doit être<br />
traitée en urgence. Elle nécessite le repos<br />
allongé et l’intervention médicale avec<br />
injection de clonidine ou utilisation d’atropine<br />
ou de dérivés nitrés. Parallèlement,<br />
il faut rechercher le stimulus responsable<br />
pour le traiter.<br />
Des tétraplégiques marathoniens ont<br />
déclaré, à la fin des années 90, avoir provoqué<br />
ce phénomène pour améliorer<br />
leurs performances. Long et Meredith,<br />
en 1997, ont étudié 8 coureurs tétraplégiques<br />
qui estimaient que 90 % de<br />
leurs pairs utilisaient le boosting, par distension<br />
vésicale volontaire. Ils estimaient<br />
également que leurs performances sur<br />
route s’amélioraient de presque 10 %,<br />
avec une augmentation de l’en<strong>du</strong>rance<br />
et de la force musculaire des membres<br />
supérieurs. Un seul <strong>sport</strong>if notait des effets<br />
secondaires (fatigue et céphalées).<br />
Nul doute qu’une amélioration <strong>du</strong> débit<br />
sanguin et de l’oxygénation musculaire soit<br />
efficace chez des blessés mé<strong>du</strong>llaires hauts,<br />
généralement très hypoten<strong>du</strong>s. Cependant,<br />
il n’existe, à notre connaissance, aucun<br />
moyen de stabiliser cette poussée hypertensive<br />
à un niveau à la fois efficace et non<br />
dangereux, ni inconfortable. En outre, cette<br />
méthode ne peut avoir un intérêt que pour<br />
les courses longues et non pas en escrime<br />
ou au tir à l’arc.<br />
Au total, cette pratique constitue un<br />
dopage, mais sa clientèle représente moins<br />
d’une centaine de <strong>sport</strong>ifs dans le monde.<br />
Elle a été intégrée dans les règlements de<br />
l’International Paralympic Committee et<br />
tout officiel qui remarque des signes<br />
Lésion<br />
mé<strong>du</strong>llaire<br />
T5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Stimulation<br />
<strong>du</strong> SANS*<br />
1<br />
■D - Protestations dans<br />
le cadre des classifications<br />
Les classifications pour la compétition,<br />
spécifiques <strong>du</strong> <strong>sport</strong> pour handicapés,<br />
sont aussi vieilles que lui et ont été source<br />
de contestations. Tel <strong>sport</strong>if s’estime grugé<br />
par sa propre classe ou par celle d’un de<br />
ses adversaires. Le droit à “protestation”<br />
est codifié. Le demandeur ou son encadrement<br />
dépose une caution financière<br />
qui ne sera ren<strong>du</strong>e qu’en cas de jugement<br />
positif sur la contestation, afin d’éviter<br />
les abus. Un groupe de classificateurs<br />
agréés ré-examine le <strong>sport</strong>if incriminé qui<br />
ne peut se soustraire à cet examen si la<br />
demande a été faite par un concurrent.<br />
La décision est entérinée pour les<br />
épreuves à venir. Les difficultés naissent<br />
souvent de handicaps évolutifs qui varient<br />
au cours <strong>du</strong> temps, ou de sujets en limite<br />
de classes et, plus rarement, de simulateurs<br />
qu’il s’agit de démasquer. ■<br />
Hypertension<br />
artérielle<br />
Figure 2 - Schéma de l’HRA<br />
et <strong>du</strong> boosting.<br />
Chez le blessé mé<strong>du</strong>llaire, le message<br />
d’une stimulation douloureuse (ici<br />
la distension vésicale) (1) sera interrompu<br />
au niveau de la lésion mé<strong>du</strong>llaire et non<br />
transmise au cortex cérébral.<br />
La lésion mé<strong>du</strong>llaire stoppe aussi<br />
les 2 branches <strong>du</strong> système nerveux<br />
autonome et déconnecte la boucle<br />
<strong>du</strong> feedback, causant l’indépendance des<br />
2 systèmes sympathique et<br />
parasympathique. Les informations<br />
nociceptives ascendantes vont stimuler<br />
la réponse <strong>du</strong> système nerveux<br />
sympathique dans le territoire<br />
sous-lésionnel (2), entraînant une<br />
vasoconstriction et une hypertension<br />
artérielle. Cette HTA stimule<br />
les barorécepteurs, entraînant,<br />
par l’intermédiaire <strong>du</strong> système<br />
parasympathique une bradycardie<br />
et une vasodilatation sus-lésionelle<br />
(3 et 4).<br />
* SANS = système nerveux autonome<br />
sympathique.<br />
MÉDECINS DU SPORT 25 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-13-26dossier 4/10/04 16:53 Page 26<br />
Handi<strong>sport</strong><br />
< DOSSIER ><br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
1. Aasayama K, Nakamura et al. Physical fitness of paraplegics in full<br />
wheelchair marathon racing. Paraplegia 1985 ; 23 : 277-87.<br />
2. Singas E, Lesser M, Spungen AM et al. Airway hypereponsiveness<br />
to metacholine in subjects with spinal cord injury. Chest 1996 ;<br />
110 (4) : 911-5.<br />
3. Grimm D. Airways hypereactivity in subjects with tetraplegia.<br />
Chest 2000 ; 118 : 1397-404.<br />
4. Bauman WA, Spungen AM. Disorders of carbohydrate and lipid<br />
metabolism in veterans with paraplegia or quadriplegia: a model<br />
of premature aging. Metabolisin 1994 ; 43 : 749-56.<br />
5. Bauman WA et al. Depressed serum high density lipoproitein<br />
cholesterol levels in veterans with spinal cord injury. Paraplegia<br />
1992 ; 30 : 697-703.<br />
6. Blackmer J, Marshall S. Obesity and spinal cord injury. Spinal cord<br />
1997 ; 35 : 245-47.<br />
7. Carré F, Tausig D, Dassonville J, Beillot J. Maladies chroniques et<br />
<strong>sport</strong>. Médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong> 2001 ; 47 : 15-26.<br />
8. Carré F. Hypertension artérielle et pratique <strong>sport</strong>ive. Médecins<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong> 2001 ; 48 : 19-26.<br />
9. Schmid A, Huonker M et al. Catecholamines, heart rate and oxygene<br />
uptake <strong>du</strong>ring exercise in persons with spinal cord injury.<br />
American Psychological Society 1998 ; 635-41.<br />
10. Steinberg LL et al. Plasma level of cathecolamines in Paraplegics.<br />
Medicine & Science in Sports & Exercise 1996 ; 28 : S143.<br />
11. Teasell RW, Arnold JM et al. Cardiovascular consequences of<br />
loss of supraspinal control of the sympathetic nervous system after<br />
spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2000 ; 81 (4) : 506-16.<br />
12. Theisen D, Vanlandewijck Y, Sturbois X, Francaux M. Blood distribution<br />
adaptations in paraplegics <strong>du</strong>ring posture changes: peripheral<br />
and central reflex responses. Eur J Appl Physiol 2000 ; 81 (6) :<br />
463-9.<br />
13. Martin X, Tordi N, Bougenot MP, Rouillon JD. Analyse critique<br />
des matériels et des méthodes d’évaluation de l’aptitude physique<br />
chez le blessé mé<strong>du</strong>llaire en fauteuil roulant. Science et <strong>sport</strong>s 2002 ;<br />
17 : 209-19.<br />
14. Lampert E. Erreurs à ne pas commettre lors de la réalisation<br />
d’un exercice de détermination de la consommation maximale<br />
d’oxygène. Science et Sports 1998 ; 13 : 193-201.<br />
15. Sawwka MN. Determination of maximal aerobic power <strong>du</strong>ring<br />
upper body exercise. J Appll Physiol 1983 ; 54 (1) : 113-7.<br />
16. Rasche W, Janssen TW et al. Responses of subjects with spinal<br />
cord injuries to maximal wheelchair exercise: comparison of discontinous<br />
and continous protocols. Eur J Appl Physiol 1993 ; 66 (4) :<br />
328-31.<br />
17. Dallmeijer AJ, Vanderwoude LHW et al. Application in manual<br />
wheelchair propulsion in persons with spinal cord injuries. Am J of<br />
Phys Med Rehab 1998 : 77 (3) : 213-21.<br />
18. Spungen AM, Baunian WA, Wang J, Plerson RN. Measurement<br />
of body fat in indivi<strong>du</strong>als with tetraplegia: a comparison of eight<br />
clinical methods. Paraplegia 1995 ; 33 : 402-8.<br />
19. Kocina P. Body composition of spinal cord injury a<strong>du</strong>lt. Sport<br />
med 1997 ; 23 : 48-60.<br />
20. Olle MM, Pivarmik JM et al. Body Composition of sedentary<br />
and physically active spinal cord injurred indivi<strong>du</strong>als estimed from<br />
total body electrical con<strong>du</strong>ctivity. Arch Phys Med Rehabil 1993 ; 74 :<br />
706-10.<br />
21. Hopman MT, Oeseburg B, Binkhorst RA. Cardiovascular responses<br />
in persons with paraplegia to prolonged arm exercise and<br />
thermal stress. Med Sci Sports Exerc 1993 ; 25 (5) : 577-83.<br />
22. Drory Y et al. Arm crank ergometry in chronic spinal cord injured<br />
patients. Arch Phys Med Rehabil 1990 ; 71 : 389-92.<br />
23. Carré F, Favre Juvin A, Cazorla G et al. Le surentraînement.<br />
Médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong> 2003 ; 61 : 11-29.<br />
24. Mac Cormack et al. Injury profiles in wheelchair athletes: results<br />
of a retrospective study. Clinical Journal Sports Medecine 1991 ; 1 :<br />
35-40.<br />
25. Wilson PE, Washington RL. Pediatric wheelchair athletes: <strong>sport</strong>s<br />
injuries and prevention. Paraplegia 1993 ; 31 : 330-37.<br />
26. Baux S. Les escarres de décubitus. Le concours médical 2000 ;<br />
Tome 122-39 : 2791-96.<br />
27. Piera JB, Druvert JC. Plaies des paraplégiques et des amputés<br />
dans la pratique <strong>sport</strong>ive. Le journal des plaies et cicatrisation 1999 ;<br />
20 : 7-12.<br />
28. Laboute E et al. Fractures de fatigue chez l’amputé <strong>du</strong> membre<br />
inférieur pratiquant l’athlétisme en handi<strong>sport</strong>. A propos de 3 cas.<br />
J Traumatol Sport 2003 ; 20 : 155-61.<br />
29. Curtis KA et al. Shoulder pain in wheelchair users with tetraplegia<br />
and paraplegia. Arch Phys Med Rehabil 1999 ; 80 (4) : 453-7.<br />
30. Curtis KA, Roach KE. Development of the wheelchair users shoulder<br />
pain index (WUSPI). Paraplegia 1995 ; 33 : 290-93.<br />
31. Powers CM, Newsam CJ et al. Isometric shoulder torque in subjects<br />
with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1994 ; 75 (7) :<br />
761-5.<br />
32. Samuelsson KA, Tropp H, Gerdle B. Shoulder pain and its consequences<br />
in paraplegic spinal cord-injured, wheelchair users. Spinal<br />
Cord 2004 ; 42 (1) : 41-6.<br />
33. Ferrara MS, Davis RW. Injuries to elite wheelchair athletes. Paraplegia<br />
1990 ; 28 (5) : 335-41.<br />
34. Burnham RS et al. Shoulder pain in wheelchair athletes: the<br />
role of muscle imbalance. Am J Sports Med 1993 ; 21 (2) : 238-42.<br />
35. Montroche A, Bontoux L. Pratique de l’haltérophilie chez le<br />
handicapé moteur. Sport et handicap moteur. Rencontres en réé<strong>du</strong>cation.<br />
Masson 1999 ; 14 : 37-44.<br />
36. Burnham RS et al. Acute median nerve dysfunction from wheelchair<br />
propulsion: the development of a model and study of the<br />
effect of hand protection. Arch Phys Med Rehabil 1994 ; 75 : 513-<br />
18.<br />
37. Aljure J. Carpal tunnel syndrome in paraplegics. Paraplegia 1985 ;<br />
23 : 182-86.<br />
38. Druvert JC. L’évolution <strong>du</strong> fauteuil roulant de <strong>sport</strong>. Revue 3R.<br />
La lettre 2000 ; 55 : 14-15.<br />
39. Piera JB, Pailler D, Druvert JC. Encycl Med Chir, kinésithérapie<br />
et médecine Physique. Editions Elsevier Paris 2002 ; 18 p.<br />
40. Weissland T, Masse P, Fourmaux P et al. Intérêts, principes et<br />
limites des techniques de remise à la course chez l’amputé traumatique<br />
de membre inférieur. J Orthop 2000 ; 4 : 338-90.<br />
41. Harris P. Self-in<strong>du</strong>ced autonomic dysreflexia (boosting) practised<br />
by some tetraplegic athletes to enhance their athletic performance.<br />
Paraplegia 1994 ; 32 (5) : 289-91.<br />
42. Burnham R, Wheeler G, Riding M, Steadward R. The implications<br />
of boosting to enhance performance. Athletic Therapy Today<br />
1997 ; 2 (1) : 36-39.<br />
43. Burnham RS, Wheeler G, Bhambhani Y et al. Intentional in<strong>du</strong>ction<br />
of autonomic dysreflexia among quadriplegic roadracers for<br />
performance enhancement: Efficacy, safety and mechanism. Clin J<br />
Sport Med 1994 ; 4 : 1-10.<br />
44. Long K, Meredith S, Bell G. Autonomic dysreflexia and boosting<br />
in wheelchair athletes. Adapted Physical Activity Quaterly 1997 ;<br />
14 : 203-9.<br />
45. Pailler D, Sautreuil P, Piera JB et al. Evolution des prothèses des<br />
sprinters amputés de membre inférieur. Annales de Réadaptation<br />
Médecine Physique 2004 ; 47 : 374-81.<br />
MÉDECINS DU SPORT 26 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
-1<br />
Vitesse (km.h )<br />
mds<strong>67</strong>-26-27-thera 4/10/04 17:02 Page 28<br />
Physiologie<br />
Caractéristiques physiologi q<br />
des athlètes élites spécialis te<br />
La course en fauteuil<br />
roulant (ou “course<br />
fauteuil”) figure<br />
certainement parmi<br />
les plus vieilles disciplines<br />
<strong>sport</strong>ives pratiquées par<br />
les personnes<br />
handicapées physiques<br />
(paraplégiques,<br />
tétraplégiques,<br />
poliomyélites...).<br />
En compétition,les athlètes utilisent<br />
un fauteuil spécifique à trois roues<br />
(2 grandes roues à l’arrière et une<br />
plus petite à l’avant) (Fig. 1), et leur déplacement<br />
(accélération <strong>du</strong> fauteuil) s’effectue<br />
par une poussée simultanée des<br />
mains sur les cerceaux fixés aux roues<br />
arrières (i.e.“mains courantes”).Aujourd’hui,la<br />
course fauteuil constitue une discipline<br />
de “haut niveau”à part entière,et<br />
les exigences des <strong>sport</strong>ifs et entraîneurs<br />
sont celles des <strong>sport</strong>ifs de haut niveau.<br />
Cette évolution pose les problématiques<br />
inhérentes aux exigences de la haute<br />
compétition (développement technologique,suivi<br />
médico-<strong>sport</strong>if...),et en particulier<br />
celles liées à la détermination de<br />
contenus d’entraînement précis reposant<br />
sur une meilleure connaissance des<br />
contraintes de cette activité.<br />
Une “course fauteuil” effectuée sur une<br />
distance de 800 mètres <strong>du</strong>re environ<br />
1 minute 45 secondes (record d’Europe :<br />
1 min 38 sec, Joël Jeannot).Parmi les facteurs<br />
pouvant influencer la performance<br />
en course, les aspects tactiques doivent<br />
être pris en compte.En effet,ce type de<br />
course est disputé en groupe,et l’athlète<br />
a la possibilité de minimiser les résistances<br />
aérodynamiques en se déplaçant<br />
* Laboratoire de Biomécanique et Physiologie, Insep,<br />
Paris.<br />
Benjamin Loyseau<br />
<br />
Figure 1 - Représentation de l’athlète sur l’ergomètre.<br />
<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
2<br />
2<br />
2<br />
0<br />
10<br />
20<br />
TV pic<br />
Vpic (km.h-1)<br />
derrière d’autres athlètes (technique dite<br />
de drafting).Il a été montré,pour d’autres<br />
activités comme le cyclisme, que cette<br />
technique de drafting pouvait permettre<br />
de minimiser la dépense énergétique<br />
pour une même vitesse et améliorer la<br />
performance (1).<br />
30<br />
40<br />
50<br />
60<br />
70<br />
Temps (s)<br />
80<br />
90<br />
T fin<br />
100<br />
Vfin (km.h -1)<br />
110<br />
120<br />
130<br />
Phases d'accélération (m.s ) Phase de décélération (m.s )<br />
-2 -2<br />
Figure 2 - Evolution de la vitesse au cours de l’exercice d’intensité maximale de<br />
1 min 30 sec. La décélération est calculée par le rapport (Vfin - Vpic) / (Tfin - TVpic), où Vfin et<br />
Tfin représentent la vitesse et le temps de fin d’exercice, Vpic et TVpic représentent le pic de<br />
vitesse ainsi que le temps d’atteinte de Vpic.<br />
Dans un cadre d’évaluation des athlètes,<br />
indépendamment des facteurs tactiques,<br />
la performance doit donc être<br />
réalisée de manière indivi<strong>du</strong>elle. Il est<br />
alors possible de mesurer la distance<br />
parcourue sur une période fixe (2).<br />
Dans le cadre de notre étude, nous<br />
MÉDECINS DU SPORT 28 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-26-27-thera 4/10/04 17:02 Page 29<br />
i ques et musculaires<br />
s tes de “course fauteuil”<br />
avons choisi d’évaluer le niveau de performance<br />
des athlètes spécialistes de<br />
course fauteuil lors d’un test similaire<br />
permettant d’évaluer les indices suivants<br />
: l’accélération, le pic de vitesse<br />
et la décélération (Fig. 2).<br />
Dr Jean-Michel Levêque*, Dr Christine Hanon*,<br />
Dr Christophe Hausswirth*<br />
<br />
Mots clés<br />
Course en fauteuil<br />
Paraplégie<br />
Tétraplégie<br />
Poliomyélite<br />
VO2max<br />
Physiologie<br />
Comme pour toute activité <strong>sport</strong>ive, différentes<br />
filières énergétiques (aérobies<br />
et anaérobies) sont mises à contribution<br />
lors d’une course sur 800 mètres. Les<br />
travaux de Spencer et Gastin (3) ou<br />
Bishop et coll. (4) ont respectivement<br />
montré, pour la course à pied (sur<br />
800 mètres) ou le kayak (sur<br />
500 mètres), que la re-synthèse d’énergie<br />
provenait de manière prédominante<br />
<strong>du</strong> métabolisme aérobie. Par exemple,<br />
Spencer et Gastin (3) concluent que la<br />
part <strong>du</strong> métabolisme aérobie est de<br />
66 % lors d’un 800 mètres en course à<br />
pied. Pour des activités sollicitant les<br />
membres supérieurs comme le kayak,<br />
la performance sur 500 mètres (effort<br />
d’environ 1 min 40 sec) est étroitement<br />
dépendante de la puissance maximale<br />
<strong>du</strong> métabolisme aérobie des membres<br />
supérieurs (5).Cette étude devait nous<br />
permettre de vérifier si la puissance<br />
maximale <strong>du</strong> métabolisme aérobie évaluée<br />
au cours d’un exercice en fauteuil,<br />
constitue un facteur de performance sur<br />
800 mètres.<br />
L’objectif de ce travail était d’étudier<br />
les relations entre les caractéristiques<br />
physiques spécifiques des athlètes de<br />
haut niveau (caractéristiques physiologiques<br />
et qualités musculaires spécifiques)<br />
et la performance en fauteuil roulant<br />
sur 800 mètres.Sous l’impulsion de<br />
la Fédération française d’athlétisme Handi<strong>sport</strong><br />
et de son DTN (Patrice Gergès),<br />
cette expérimentation a été réalisée au<br />
Laboratoire de Biomécanique et Physiologie<br />
de l’Institut national <strong>du</strong> <strong>sport</strong> et de<br />
l’é<strong>du</strong>cation physique (Insep). Ce travail<br />
devrait participer à la construction de documents<br />
de formation pour les entraîneurs<br />
pour l’Olympiade 2008.<br />
Figure 3 - Représentation graphique d’une relation Force - Vitesse et Puissance -<br />
vitesse établie, pour un sujet, aux 9 vitesses imposées. Fmax et Pmax représentent<br />
respectivement les valeurs maximales de Force et Puissance. Vmax correspond<br />
à la vitesse maximale d’exécution <strong>du</strong> mouvement de développé-couché<br />
sans résistance opposée.<br />
Benjamin Loyseau<br />
Force (KG)<br />
Vitesse (m.s -1 )<br />
Puissance (kgm.s -1 )<br />
MÉDECINS DU SPORT 29 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-26-27-thera 4/10/04 17:02 Page 30<br />
Physiologie<br />
MÉTHODOLOGIE<br />
Les sujets<br />
Sept athlètes de l’équipe de France masculine<br />
de course en fauteuil ont participé<br />
à cette expérimentation (âge : 34,7<br />
± 4,2 ans ; taille : 178,9 ± 9,7 cm ; masse :<br />
68,7 ± 9,1 kg).Ces athlètes concouraient<br />
dans la catégorie paraplégique (par opposition<br />
à la catégorie tétraplégique).<br />
L’ergomètre<br />
L’ensemble des tests s’est effectué en laboratoire.Les<br />
athlètes étaient évalués dans<br />
leurs fauteuils personnels grâce à l’utilisation<br />
d’un ergomètre à frein électromagnétique<br />
spécialement adapté aux exercices<br />
en fauteuil roulant (Ergomètre VP100<br />
HTE, Medical Developpement, Saint-<br />
Etienne, France). L’ergomètre était composé<br />
d’une plate-forme comportant deux<br />
rouleaux.Le fauteuil était fixé sur la plateforme<br />
de manière à limiter les mouvements<br />
L’épaule joue un rôle majeur dans<br />
la propulsion <strong>du</strong> fauteil roulant,<br />
con<strong>du</strong>isant à de nombreuses plaintes<br />
douloureuses.<br />
sur l’axe antéro-postérieur. Les roues arrières<br />
reposaient sur les deux rouleaux inclinés<br />
de manière à former un angle de 90°<br />
avec la roue dans le plan frontal (Fig.1).<br />
Test d’évaluation des qualités<br />
musculaires maximales<br />
Cette première évaluation était réalisée<br />
sur un ergomètre isocinétique adapté à<br />
l’exercice de développé-couché (DC)<br />
(Ariel Computerized Exercise System<br />
“multifunction exercise”,Ariel Dynamics<br />
Inc., Trabucco Canyon, USA). Le test<br />
consistait en une série de 9 efforts maximaux<br />
en DC effectués de 2,5 à 0,08 m.s -1 .<br />
Cette exploration fonctionnelle permettait<br />
d’apprécier les qualités de force,puissance<br />
et vitesse maximales (Fig. 3).<br />
Test d’évaluation de<br />
la consommation maximale<br />
d’oxygène (VO2max)<br />
Après 5 minutes d’échauffement à<br />
10 km.h -1 ,le test débutait à 15 km.h -1 et<br />
l’incrément de vitesse était de 1 km.h -1 toutes<br />
les minutes, jusqu’à l’arrêt volontaire <strong>du</strong><br />
sujet. Les paramètres gazeux et respiratoires<br />
étaient enregistrés pendant toute la<br />
<strong>du</strong>rée <strong>du</strong> test avec un système télémétrique<br />
de type Cosmed K4 RQ (Rome, Italie).Des<br />
prélèvements sanguins au lobule<br />
de l’oreille étaient réalisés avant,à la fin et<br />
3 minutes après le test afin de mesurer<br />
la lactatémie ([La - ], en mmol.L -1 ).<br />
La consommation d’oxygène (VO 2 ,en<br />
L.min -1 et mL.kg -1 .min -1 ), le débit ventilatoire<br />
(VE, en L.min -1 ), la fréquence respiratoire<br />
(FR,en cycles.min -1 ) et la fréquence<br />
cardiaque (FC, en batt.min -1 ) étaient les<br />
principaux paramètres considérés. Les<br />
seuils ventilatoires (SV 1 et SV 2 ) étaient obtenus<br />
d’après la méthode de calcul proposée<br />
par Wasserman et coll. (6).<br />
Test d’évaluation<br />
de la performance<br />
Les athlètes devaient pro<strong>du</strong>ire le maximum<br />
de vitesse pendant une période de<br />
1 minute 30 secondes.La consigne était<br />
d’atteindre leur vitesse maximale le plus<br />
vite possible.<br />
LES RÉSULTATS<br />
ET DISCUSSION<br />
La performance des athlètes est appréciée<br />
par la distance parcourue (D max ) au<br />
cours de l’effort d’1 min 30 s (730,5<br />
± 64,8 m).Une analyse indivi<strong>du</strong>alisée fait<br />
apparaître des différences en ce qui<br />
concerne les capacités à accélérer le système<br />
“athlète-fauteuil”(accélération :0,35<br />
± 0,06 m.s -2 ),atteindre une vitesse maximale<br />
élevée (V pic : 34,7 ± 3,0 km.h -1 ,<br />
Tableau 1<br />
Sujets Dmax (m) Vmoy (km.h- 1 ) Vpic (km.h- 1 ) D.Vpic (m) D.15s (m) Acc. (m.s -2 ) Dec. (m.s -2 )<br />
Laurent Baheux<br />
S1<br />
S2<br />
S3<br />
S4<br />
S5<br />
S6<br />
S7<br />
Moyenne<br />
Ecart type<br />
628<br />
<strong>67</strong>6<br />
777<br />
827<br />
732<br />
728<br />
747<br />
730,5<br />
64,8<br />
25,1<br />
27,0<br />
31,1<br />
33,1<br />
29,3<br />
29,1<br />
29,9<br />
29,2<br />
2,6<br />
29,9<br />
31,9<br />
36,0<br />
38,5<br />
33,6<br />
34,1<br />
36,8<br />
34,7<br />
3,0<br />
212<br />
222<br />
209<br />
214<br />
224<br />
237<br />
202<br />
217,2<br />
11,4<br />
89,3<br />
91,5<br />
109,3<br />
107,8<br />
86,4<br />
97,0<br />
101,6<br />
97,5<br />
9,0<br />
0,28<br />
0,29<br />
0,39<br />
0,43<br />
0,31<br />
0,32<br />
0,41<br />
0,35<br />
0,06<br />
- 0,028<br />
- 0,038<br />
- 0,034<br />
- 0,034<br />
- 0,025<br />
- 0,041<br />
- 0,045<br />
- 0,035<br />
0,007<br />
Tableau I - Valeurs indivi<strong>du</strong>elles concernant les indices de performance au test d’effort maximal d’1 min 30 sec.<br />
Dmax et Vmoy : distance parcourue (m) et vitesse moyenne de déplacement (km.h -1 ) au cours <strong>du</strong> test.<br />
Vpic et D.Vpic : pic de vitesse (km.h -1 ) et distance parcourue (m) à l’atteinte de Vpic.<br />
D.15s, Acc. et Dec. : distance effectuée (m) après 15 s d’effort, accélération et décélération (m.s -2 ) calculées au cours <strong>du</strong> test.<br />
MÉDECINS DU SPORT 30 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-26-27-thera 4/10/04 17:02 Page 31<br />
Tableau 2<br />
VMA (km.h -1 )<br />
VO 2 max (L.min -1 )<br />
VO 2 max (mL.kg -1 .min -1 )<br />
V E max (L.min -1 )<br />
FRmax (cycles.min -1 )<br />
FCmax (batt.min -1 )<br />
[La-] max (mmol.l -1 )<br />
Q R max<br />
V SV2 (km.h -1 )<br />
% VO 2 max (%)<br />
Test à intensité croissante<br />
29 ±3<br />
3,<strong>67</strong> ± 0,51<br />
53,5 ± 6,2<br />
126 ±15<br />
70 ±20<br />
185 ±6<br />
13,5 ±1,7<br />
1,12 ± 0,06<br />
25 ±2<br />
77 ±3<br />
Test de 1 min 30 sec<br />
----<br />
3,52 ± 0,63<br />
51,4 ± 8,2<br />
141 ± 24<br />
100 ± 17*<br />
186 ± 6<br />
17,3 ± 1,9*<br />
----<br />
Physiologie<br />
Tableau II<br />
Variables physiologiques (moyenne ( écart<br />
type) obtenues lors des 2 tests en fauteuil.<br />
V SV2 et % VO 2 max correspondent<br />
respectivement à la vitesse et à la valeur de<br />
VO 2 (exprimée en pourcentage de VO 2 max)<br />
au deuxième seuil ventilatoire (SV 2 ).<br />
* Différence significative entre les 2 tests<br />
(P < 0,05).<br />
Laurent Baheux<br />
4- Pmax (r = 0,82),le pic de vitesse (V pic )<br />
et l’accélération (Acc) sont significativement<br />
corrélés à V max (r = 0,92 ;<br />
P < 0,01) et P max (r = 0,96 ; P < 0,01).<br />
Chez le blessé mé<strong>du</strong>llaire, une escarre,<br />
une infection urinaire ou un coup de chaleur restent des pathologies fréquentes.<br />
atteinte à 28 ± 3 s) et limiter la décélération<br />
(décélération : -0,035 ± 0,007 m.s -2 )<br />
(Tab. 1). La performance globale (D max )<br />
est positivement corrélée à l’accélération<br />
(r = 0,92 ; P < 0,01) et au pic de vitesse<br />
(r = 0,92 ; P < 0,01), ce qui signifie que<br />
la capacité à atteindre rapidement une<br />
valeur élevée de vitesse est déterminante<br />
de la performance.<br />
Les niveaux de Fmax,Pmax et Vmax obtenus<br />
en DC par l’ensemble des athlètes,<br />
sont respectivement de 125 ± 18 kg,73,9<br />
± 16,4 kgm.s -1 et 2,82 ± 0,23 m.s -1 .<br />
Au cours <strong>du</strong> test triangulaire, les athlètes<br />
ont atteint une vitesse maximale aérobie<br />
(VMA) de 29 ± 3 km.h -1 . Les valeurs de<br />
VO 2 max sont de 3,<strong>67</strong> ± 0,51 L.min -1 soit,<br />
en valeur relative,53,5 ± 6,2 mL.kg -1 .min -1 .Il<br />
existe une corrélation significative<br />
(P < 0,05) entre VMA et VO 2 max exprimée<br />
en L.min -1 (r = 0,80). En fin de test,<br />
les concentrations en lactates sanguins<br />
([La - ] max ) (13,5 ± 1,7 mmol.l -1 ),les quotients<br />
respiratoires (QR max ) (1,12 ± 0,06) et fré-<br />
quences cardiaques (185 ± 6 batt.min -1 )<br />
obtenus par les athlètes confirment<br />
l’atteinte de VO 2 max (Tab.II).<br />
Lors <strong>du</strong> test de 1 min 30 sec, les valeurs<br />
maximales de VO 2 (3,52 ± 0,63 L.min -1<br />
atteintes 40 ± 12 secondes après le début<br />
de l’effort) ne sont pas significativement<br />
différentes des valeurs de VO 2 max<br />
obtenues au test d’intensité progressive<br />
(Tab. II). De plus, il existe une corrélation<br />
significative (r = 0,90) entre ces 2 paramètres,ce<br />
qui signifie que,quel que soit<br />
le test,nous obtenons des différences interindivi<strong>du</strong>elles<br />
identiques.<br />
Nos résultats mettent en évidence une<br />
corrélation positive (P < 0,05) entre la<br />
performance globale (Dmax) et :<br />
1- la VMA obtenue lors <strong>du</strong> test d’intensité<br />
progressive (r = 0,95 ; P < 0,01) ;<br />
2- la valeur de VO 2 à SV 2 exprimée en<br />
pourcentage de (VO 2 max (r = 0,84 ;<br />
P < 0,01) ;<br />
3- les qualités musculaires de V max<br />
(r = 0,78) ;<br />
CONCLUSION<br />
Les valeurs de VO 2 max mesurées avec<br />
cette population de l’équipe de France<br />
sont supérieures à celles relatées dans la<br />
littérature spécifique des athlètes paraplégiques<br />
(7) et comparables aux valeurs<br />
obtenues chez des kayakistes de haut niveau<br />
(5). Ces valeurs sont relativement<br />
élevées compte tenu de la masse musculaire<br />
active (comparativement à un<br />
exercice des membres inférieurs) et<br />
confirment l’importance de la sollicitation<br />
aérobie en course fauteuil.Dans une<br />
perspective d’évaluation de l’aptitude<br />
physique, les résultats montrent l’importance<br />
de l’aptitude aérobie dans la<br />
performance sur 800 mètres, ainsi que<br />
l’intérêt d’évaluer la force en DC aux vitesses<br />
élevées, valeur classiquement<br />
retenue comme un indice d’évaluation<br />
de l’explosivité de la force. ■<br />
Nous tenons à remercier Patrice Gergès<br />
et la Fédération française d’athlétisme<br />
Handi<strong>sport</strong> pour leur collaboration<br />
scientifique dans ce projet, ainsi que<br />
tous les membres <strong>du</strong> laboratoire de biomécanique<br />
de l’Insep.<br />
MÉDECINS DU SPORT 31 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-26-27-thera 4/10/04 17:02 Page 32<br />
Physiologie<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
1. Hausswirth C, Vallier JM, Lehenaff D et al. Effect of two drafting<br />
modalities in cycling on running performance. Med Sci Sports<br />
Exerc 2001 ; 33 : 485-92.<br />
2. Fry RW, Morton AR. Physiological and kinanthropometric attributes<br />
of elite flatwater kayakists. Med Sci Sports Exerc 1991 ; 23 :<br />
1297-301.<br />
3. Spencer MR, Gastin PB. Energy system contribution <strong>du</strong>ring 200-<br />
to 1500- m running in highly trained athletes. Med Sci Sports<br />
Exerc 2001 ; 33 : 157-62.<br />
4. Bishop D, Bo<strong>net</strong>ti D, Dawson B. The influence of pacing strategy<br />
on VO2 and supramaximal kayak performance. Med Sci Sports<br />
Exerc 2002 ; 34 : 1041-7.<br />
5. Tesch PA. Physiological characteristics of elite kayak paddlers.<br />
Can J Appl Sport Sci 1983 ; 8 : 87-91.<br />
6. Wasserman K, Whipp BJ, Koyl SN, Beaver WL. Anaerobic threshold<br />
and respiratory gas exchange <strong>du</strong>ring exercise. J Appl Physiol<br />
1973 ; 35 : 236-43.<br />
7. Veeger HE, Hadj Yahmed M, Van der Woulde LH, Charpentier P.<br />
Peak oxygen uptake and maximal power output of Olympic wheelchair-dependent<br />
athletes. Med Sci Sports Exerc 1991 ; 23 : 1201-9.<br />
KIOSQUE<br />
Handi Guide 06 :<br />
l’activité physique<br />
et <strong>sport</strong>ive<br />
Conçu et édité par la Direction Départementale<br />
de la Jeunesse et des Sports des Alpes-<br />
Maritimes,le Handi Guide 06 présente les informations<br />
et les connaissances liées aux<br />
activités physiques et <strong>sport</strong>ives pratiquées par<br />
les personnes handicapées dans le département.<br />
Plus d’une quarantaine d’activités y sont proposées<br />
par les clubs “ordinaires”ou spécialisés.■<br />
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports des Alpes-Maritimes. Handi Guide 06 : les activités physiques et <strong>sport</strong>ives.<br />
Saint Laurent <strong>du</strong> Var : DDJS des alpes Maritimes, 2004.<br />
Retrouvez la nouvelle version <strong>du</strong> site<br />
http://www.menarini.fr<br />
Le premier site francophone consacré à la médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
><br />
<<br />
Les technologies évoluent,<br />
M<strong>sport</strong> aussi !<br />
La nouvelle version <strong>du</strong> site M<strong>sport</strong> est déjà<br />
en ligne. Elle propose un graphisme original<br />
et une meilleure ergonomie de navigation<br />
au service de la médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
Mise à jour tous les mois<br />
Plus de 1 000 pages de documents consacrées à la médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
Plus de 500 photos classées par localisation anatomique<br />
Des données épidémiologiques sur plus de 7 000 cas<br />
Des articles originaux<br />
Un accès aux moteurs de recherche bibliographique et des liens vers de nombreux sites Inter<strong>net</strong><br />
(Medline, CHU de Rouen, INSEP…)<br />
Une base de données exclusive en médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
Le calendrier des événements <strong>sport</strong>ifs<br />
> > > > > > ><br />
MÉDECINS DU SPORT 32 N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2004
mds<strong>67</strong>-34congres 4/10/04 17:24 Page 34<br />
Congrès<br />
3 ES JOURNÉES<br />
INTERNATIONALES<br />
DES SCIENCES<br />
DU SPORT<br />
24-26 novembre 2004<br />
Paris<br />
■ Renseignements<br />
Les entretiens de l’INSEP<br />
11 Avenue <strong>du</strong> Tremblay<br />
75012 Paris<br />
Tél. : 01 41 74 43 11<br />
Mail : entretiens@insep.fr<br />
didier.lehenaff@insep.fr<br />
79 E RÉUNION ANNUELLE<br />
DE LA SOCIÉTÉ<br />
FRANÇAISE<br />
DE CHIRURGIE<br />
ORTHOPÉDIQUE<br />
ET TRAUMATOLOGIQUE<br />
8-12 novembre 2004<br />
Palais des Congrès,<br />
Paris<br />
■ Renseignements et inscription<br />
Colloquium<br />
SOFCOT 2004<br />
12 rue de la Croix-Faubin<br />
75557 Paris cedex 11<br />
Tél. : 01 44 64 15 15<br />
Fax : 01 44 64 15 16<br />
Mail : colloquium@colloquium.fr<br />
CONGRÈS DE MÉDECINE<br />
DU SPORT ET DE<br />
RÉÉDUCATION<br />
DE BRIANÇON<br />
14-15 janvier 2005<br />
Centre Rhône Azur<br />
■ Thèmes<br />
● Syndrome rotulien<br />
● Con<strong>du</strong>ite à tenir devant une première<br />
luxation d’épaule<br />
■ Renseignements et inscription<br />
Martine Barge<br />
Tél. : 04 92 25 40 15<br />
Mail : mbarge@ugecampacac.com<br />
Site : ugecampacac.com<br />
9 E JOURNÉE RÉGIONALE<br />
DE MÉDECINE<br />
ET KINÉSITHÉRAPIE<br />
DU SPORT<br />
27 novembre 2004<br />
Faculté de médecine de Lille<br />
■ Renseignements<br />
Madame Sylvine Radola<br />
IRBMS<br />
Maison <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
3<strong>67</strong> rue Jules Guesde<br />
59650 Villeneuve d’Ascq<br />
Tél. : 03 20 05 68 32<br />
Fax : 03 20 40 21 43<br />
17 E CONGRÈS FRANÇAIS<br />
DE RHUMATOLOGIE<br />
15-17 novembre 2004<br />
CNIT, La Défense, Paris<br />
■ Renseignements<br />
Tél. : 01 42 50 00 18<br />
DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE<br />
DE PODOLOGIE ANNÉE 2004-2005<br />
Sous la Présidence des Professeurs<br />
Pierre Bourgeois et Maxime Dougados<br />
■ Direction de l’enseignement<br />
Docteur Joël DAMIANO - Docteur Alain Goldcher<br />
Destiné aux médecins généralistes, médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong>,<br />
rhumatologues, réé<strong>du</strong>cateurs, chirurgiens orthopédistes.<br />
■ Renseignements<br />
● Dr Joël Damiano<br />
joel.damiano@wanadoo.fr<br />
Tél. : 06 11 39 19 60<br />
● Dr Alain Goldcher, 131 avenue <strong>du</strong> Centenaire<br />
94210 La Varenne Saint Hilaire<br />
Tél. : 01 48 89 40 40 - Fax : 01 45 11 81 99<br />
alain.goldcher@laposte.<strong>net</strong><br />
■ Inscription<br />
Autorisation préalable <strong>du</strong> directeur d’enseignement à<br />
solliciter auprès <strong>du</strong> Dr Joël Damiano afin de pouvoir<br />
s’inscrire à la faculté.<br />
Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière<br />
91 Bd de l’Hôpital - 75013 Paris<br />
Tél. : 01 40 77 98 03 - Fax : 01 40 77 95 66<br />
B U L L E T I N D ’ A B O N N E M E N T<br />
EDECINS<br />
DU SP RT<br />
6 numéros par an<br />
Prix au numéro: 7 €*<br />
Abonnement: 38 €*<br />
Etudiant: 30 €* (joindre photocopie de la carte d’étudiant)<br />
* + 12,50 € par avion pour les DOM-TOM et la CEE<br />
+ 23,50 € par avion pour l’étranger autre que la CEE<br />
❏ Pr ❏ Dr ❏ M. ❏ M me Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spécialité<br />
❏ Rhumatologue ❏ Réé<strong>du</strong>cateur fonctionnel ❏ Médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> ❏ Médecin généraliste<br />
❏ Autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..❏ Etudiant Année : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse d’expédition : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Adresse et lieux d’exercice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tél. : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ ; Fax : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _<br />
❏ Chèque à l’ordre d’Expressions Santé ❏ Carte bancaire N°<br />
Expire le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature obligatoire :<br />
Suggestions d’articles / commentaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
❏ Je désire recevoir une facture justificative (dé<strong>du</strong>ctible frais professionnels)<br />
MDS <strong>67</strong><br />
Retourner ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre d’Expressions Santé<br />
2, rue de la Roquette - Passage <strong>du</strong> Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris - Tél. : 01 49 29 29 29 - Fax: 01 49 29 29 19.<br />
MÉDECINS DU SPORT Un reçu vous 34 sera N°<strong>67</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE envoyé.<br />
2004
mds<strong>67</strong>-34congres 4/10/04 17:24 Page 36<br />
code pub KETUM : 2KET 081 10/04