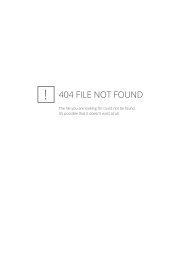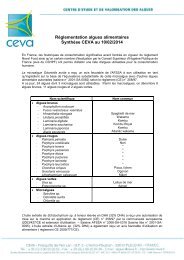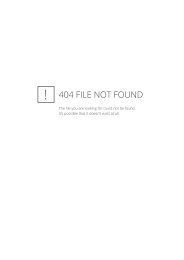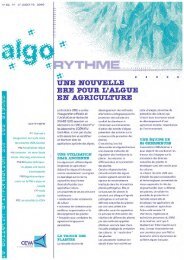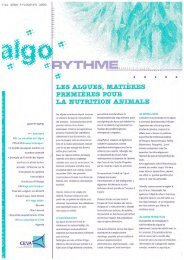Tome 2.pdf - CEVA
Tome 2.pdf - CEVA
Tome 2.pdf - CEVA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CENTRE D’ETUDE &<br />
DE VALORISATION<br />
DES ALGUES<br />
La biodiversité<br />
algale au service<br />
du développement<br />
économique de<br />
Mayotte<br />
<strong>Tome</strong> 2<br />
Proposition de<br />
projets à développer<br />
Syndicat Intercommunal d’Eau<br />
et Assainissement de Mayotte<br />
ZI Kawéni - 97600 Mamoudzou<br />
2012<br />
Centre d’Etude et de Valorisation des Algues<br />
Presqu’île de Pen-Lan - BP3 - 22610 Pleubian -<br />
FRANCE<br />
Tél : +33 (0) 2 96 229.350<br />
Fax : +33 (0)2 96 228 438<br />
algue@ceva.fr - www.ceva.fr
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
SOMMAIRE<br />
Liste des tableaux _______________________________________________ 4<br />
Liste des figures _________________________________________________ 5<br />
A. Introduction _________________________________________________ 7<br />
B. Résultats de l’étude préliminaire ________________________________ 7<br />
C. Etat de l’art sur les algues candidates à la valorisation _____________ 17<br />
1. Macroalgues candidates à la valorisation ________________________________ 17<br />
2. Microalgues candidates à la valorisation _________________________________ 36<br />
3. Productivité potentielle des algues candidates à la valorisation ______________ 45<br />
4. Etat du marché des algues candidates à la valorisation _____________________ 48<br />
5. Synthèse ___________________________________________________________ 56<br />
D. Les projets _________________________________________________ 57<br />
Les conditions générales d’établissement d’une filière algale à Mayotte. ________ 57<br />
Projet 1 – Installations de culture à terre ___________________________________ 62<br />
Axe 1.1 : Ecloserie de macroalgues ______________________________________ 62<br />
Axe 2.1 : Production starter de microalgues ______________________________ 63<br />
Axe 3.1 : Production en masse de microalgues ____________________________ 64<br />
Un axe pédagogique __________________________________________________ 65<br />
Partenaires et Moyens _________________________________________________ 66<br />
Moyens financiers ____________________________________________________ 66<br />
Calendrier des tâches _________________________________________________ 67<br />
Projet 2 – Fermes Algocoles _____________________________________________ 68<br />
Axe 1.2 : La récolte d’algues ___________________________________________ 68<br />
Axe 2.2 : La culture d’algues ___________________________________________ 70<br />
Partenaires et Moyens _________________________________________________ 70<br />
Moyens financiers ____________________________________________________ 71<br />
Calendrier des tâches _________________________________________________ 72<br />
Projet 3 – Transformation, commercialisation et R&D ________________________ 73<br />
Axe 1.3 Transformation ________________________________________________ 73<br />
Axe 2.3 Accès aux marchés ____________________________________________ 73<br />
- 2 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Axe 3.3 R&D et Innovation _____________________________________________ 74<br />
Partenaires et Moyens _________________________________________________ 75<br />
Moyens financiers ____________________________________________________ 75<br />
Calendrier des tâches _________________________________________________ 76<br />
Management des projets ________________________________________________ 77<br />
Axe 1 - Volet Social ____________________________________________________ 79<br />
Axe 2 - Volet Institutionnel - suivi et règlementation ___________________________ 79<br />
E. Conclusion générale __________________________________________ 80<br />
BIBLIOGRAPHIE _____________________________________________ 81<br />
ANNEXES ____________________________________________________ 93<br />
Annexe 1 : Carte hydrologie et qualité de l’eau du lagon de Mayotte (CAREX et al., 2002) . 93<br />
Annexe 2 : Tableau de synthèses des données techniques concernant les 4 macroalgues<br />
retenues ................................................................................................................................. 94<br />
Annexe 3 : Tableau indiquant différents équipement que l’on peut retrouver dans une usine<br />
de transformation des algues ................................................................................................. 95<br />
Annexe 4 : Tableau récapitulatif des principaux textes stratégiques encadrant le<br />
développement du projet. ....................................................................................................... 97<br />
Annexe 5 : matrice RACI Actions / Acteurs .......................................................................... 100<br />
- 3 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Liste des tableaux<br />
Tableau 1 : Liste des macroalgues de Mayotte avec en bleu les algues retenues comme<br />
candidates intéressantes à la valorisation (b = recensées dans la bibliographie, i = identifiées<br />
lors de la mission de collecte d’Avril 2011) .............................................................................. 8<br />
Tableau 2 : Liste des microalgues de Mayotte avec en bleu les algues retenues comme<br />
candidates intéressantes à la valorisation (b = recensées dans la bibliographie, i = identifiées<br />
lors de la mission de collecte d’Avril 2011, en gras = espèces marines) ................................. 9<br />
Tableau 3 : Teneur en azote dans l’algue, évolution de la teneur en azote dans l’algue et<br />
taux de croissance de Padina australis mise en culture pendant 12 jours sous différentes<br />
conditions de température (hiver : faibles températures ; été : fortes températures) et de<br />
disponibilité en nitrates (2 à 40 µM) in Umezawa et al., 2007 ................................................ 18<br />
Tableau 4 : Teneurs en azote et en phosphore des algues Turbinaria récoltées au Sri Lanka,<br />
en g/kg d’algue sèche, in : Mageswaran & Sivasubramaniam, 1984 ..................................... 23<br />
Tableau 5 : Teneurs en phosphates, en nitrates et en ammonium mesurées près du<br />
peuplement de Dictyota dichotoma en Floride, en µM, in : Mason, 2004 .............................. 26<br />
Tableau 6 : Teneurs en azote et en phosphore (en % sec) et ratio N:P des algues prélevées<br />
à Kaneohe Bay à Hawaii, in : Larned, 1998 ........................................................................... 29<br />
Tableau 7 : Teneurs en ammonium, en nitrites+nitrates et en phosphates (en µM) dans la<br />
colonne d’eau et dans le sédiment à proximité directe des peuplements de Caulerpa<br />
racemosa et Caulerpa sertularioides de Kaneohe Bay à Hawaii, in : Larned, 1998 .............. 29<br />
Tableau 8 : Microalgues cultivables à court terme ................................................................. 43<br />
Tableau 9 : Microalgues cultivables à moyen terme .............................................................. 44<br />
Tableau 10 : Productivités connues ou potentielles des espèces d’algues mahoraises<br />
candidates à la valorisation – ou d’autres espèces du même genre – et de la spiruline ....... 45<br />
Tableau 11 : Caractéristiques du marché des algues mahoraises candidates à la valorisation<br />
– ou d’autres espèces du même genre – et de la spiruline (actualisé le 20 mai 2012) ......... 49<br />
Tableau 12 : Exemples de produits ou actifs cosmétiques commercialisés à base d’algues 54<br />
Tableau 13 : Evaluation de l’effort de recherche et de l’effort de commercialisation à fournir<br />
pour la valorisation des algues retenues comme candidates intéressantes + Spiruline ........ 56<br />
Tableau 14 : indication des coûts initiaux au projet de culture à terre ................................... 67<br />
Tableau 15 : indication de coûts initiaux au projet de culture en mer .................................... 72<br />
Tableau 16 : indication des coûts initiaux au projet d’unité de transformation ....................... 76<br />
Tableau 17 : liste (non exhaustive) des acteurs pouvant s’impliquer dans le projet .............. 78<br />
- 4 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Liste des figures<br />
Figure 1 : Padina sp., Caulerpa racemosa et Turbinaria ornata, macroalgues mahoraises<br />
identifiées comme candidates prometteuses à la valorisation ................................................. 8<br />
Figure 2 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en<br />
alimentation humaine ............................................................................................................. 11<br />
Figure 3 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en<br />
alimentation animale (voir légende à la Figure 2) .................................................................. 12<br />
Figure 4 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en<br />
agriculture (voir légende à la Figure 2) ................................................................................... 12<br />
Figure 5 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en<br />
chimie (voir légende à la Figure 2) ......................................................................................... 13<br />
Figure 6 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en<br />
cosmétique (voir légende à la Figure 2) ................................................................................. 14<br />
Figure 7 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en santé<br />
animale (voir légende à la Figure 2) ....................................................................................... 14<br />
Figure 8 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en santé<br />
humaine (voir légende à la Figure 2) ...................................................................................... 15<br />
Figure 9 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en<br />
épuration (voir légende à la Figure 2) .................................................................................... 16<br />
Figure 10 : Carte de la température de surface des océans le 13 Novembre 2010 ............... 17<br />
Figure 11 : Culture et séchage de Padina pavonica par l’ICP à Malte ................................... 19<br />
Figure 12 : Cycle de vie de Dictyota dichotoma, in : Esser, 1982 .......................................... 25<br />
Figure 13 : (à gauche) Développement d’une plantule à partir d’un sporange chez Dictyota<br />
dichotoma sensu ; (à droite) Différents cycles de vie observés chez Dictyota dichotoma en<br />
Corée avec A/ le cycle à reproduction majoritairement asexuée et B/ le cycle classique à<br />
reproduction majoritairement sexuée, in : Hwang et al., 2005 ............................................... 25<br />
Figure 14 : Culture de Dictyopteris membranaceae a/ collecteurs ensemencés par les spores<br />
de D. membranaceae en écloserie, b/ algues en mer, in : Moro et al., 2010 ......................... 28<br />
Figure 15 : Détail de la structure d’une Caulerpa mexicana collectée par le <strong>CEVA</strong> à Mayotte<br />
............................................................................................................................................... 29<br />
Figure 16 : Asparagopsis taxiformis sous sa forme gamétophytique à gauche (photo prise<br />
lors de la mission du <strong>CEVA</strong> à Mayotte) et sous sa forme tétrasporophytique ou Falkenbergia<br />
à droite (Véronique Lamare pour DORIS) .............................................................................. 31<br />
Figure 17 : effet de l’enrichissement en ammonium et en CO2 sur la production<br />
d’Asparagopsis taxiformis incubée au laboratoire. Conditions : (1) 80 µM NH4+, bullage à<br />
l’air, (2) 80 µM NH4+, bullage au CO2, (3) 160 µM NH4+, bullage à l’air, (4) 160 µM NH4+,<br />
bullage au CO2, In : Mata et al., 2011 .................................................................................... 32<br />
- 5 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 18 : Rendement d’Asparagopsis taxiformis en fonction du taux de renouvellement en<br />
eau lors d’un essai de culture sur effluents piscicoles, In : Mata et al., 2011 ......................... 32<br />
Figure 19 : Evolution annuelle de l’aspect morphologique de Hypnea musciformis au Maroc,<br />
In : Mouradi et al., 2008 .......................................................................................................... 34<br />
Figure 20 : Principe de la culture uni-algale de masse .......................................................... 36<br />
Figure 21 : Entretien de souches de microalgues (FAO) ....................................................... 37<br />
Figure 22 : Montée progressive en volume d’une souche de microalgue .............................. 37<br />
Figure 23 : Culture de Chlorella sp. au <strong>CEVA</strong>, petits volumes (à gauche) et volume<br />
élémentaire (à droite) ............................................................................................................. 37<br />
Figure 24 : Raceways de la société israélienne The Israel Electric Co/Seambiotic Ltd (à<br />
gauche) et schéma d’un raceway (à droite) ........................................................................... 39<br />
Figure 25 : processus industriel pour l’épuration des eaux usées ......................................... 40<br />
Figure 26 : production d’algues riche en polymère floculant à partir de coproduits de Step .. 40<br />
Figure 27 : Différents modèles de photobioréacteurs (sources : FAO, à gauche ; Conseil<br />
National de la Recherche du Canada, à droite) ..................................................................... 41<br />
Figure 28 : Fermenteur industriel chez Roquette in : Person et al., 2011 .............................. 42<br />
Figure 29 : Carte de la productivité potentielle de microalgues en tonnes sèches/ha/an,<br />
considérant une efficacité photosynthétique de 5 % (Tredici, 2010 in Flammini, 2011) ........ 47<br />
Figure 30 : Positionnement des technologies solaires de production de biomasse microalgale<br />
(productivité surfacique exprimée en tonnes de matière sèche par hectare et par an). In :<br />
Pruvost et al. 2010 ................................................................................................................. 47<br />
Figure 31 : Un ancrage de la filière de production algale dans un contexte territorial<br />
complexe ................................................................................................................................ 60<br />
Figure 32 : représentation MOFF initial de la filière algue sur Mayotte .................................. 60<br />
Figure 33 : Chaîne de valeur de la filière algale ..................................................................... 61<br />
Figure 34 : Matrice Actions / Acteurs Projet 1 ........................................................................ 66<br />
Figure 35 : chronogramme prévisionnel pour la mise en œuvre du projet 1 .......................... 67<br />
Figure 36 : Matrice Actions / Acteurs Projet 2 ........................................................................ 71<br />
Figure 37 : chronogramme prévisionnel pour la mise en œuvre du projet 2 .......................... 72<br />
Figure 38 : Matrice Actions / Acteurs Projet 2 ........................................................................ 75<br />
Figure 39 : chronogramme prévisionnel pour la mise en œuvre du projet 3 .......................... 76<br />
- 6 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
A. Introduction<br />
Par la convention du 11 mars 2011, le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement<br />
de Mayotte (SIEAM) mandate le Centre d’Etude et de Valorisation des Algues (<strong>CEVA</strong>) pour<br />
une étude de la biodiversité algale mahoraise en vue de développer, à Mayotte, des activités<br />
économiques basées sur cette filière. Une mission d’inventaire de la biodiversité algale<br />
suivie d’une synthèse bibliographique des voies potentielles de valorisation des algues<br />
identifiées ont donné lieu à la rédaction d’un rapport intitulé «La biodiversité algale au service<br />
du développement économique de Mayotte - <strong>Tome</strong> 1 ». Ce rapport fait ressortir certaines<br />
espèces d’algues comme candidates intéressantes à la valorisation à court terme. Pour<br />
l’heure encore inexploitée, la richesse algale de Mayotte pourra sans aucun doute participer<br />
au développement économique de l’île. De nombreuses applications dans les domaines de<br />
l’épuration, de l’alimentation humaine et animale, de l’agriculture, de la cosmétique, de la<br />
chimie et de la santé ont en effet été identifiées.<br />
La prochaine étape consiste en une analyse plus approfondie des voies de développement<br />
d’une filière basée sur les algues à Mayotte. C’est l’objet de ce second tome.<br />
Dans une première partie, les résultats de l’étude préliminaire de la biodiversité algale<br />
mahoraise (voir tome 1) sont repris. Ils permettent de mettre en évidence deux choses : i) les<br />
domaines d’applications qui offrent le plus de potentiel et ii) les espèces d’algues les plus<br />
intéressantes pour la valorisation, au regard du domaine d’applications retenu.<br />
C’est sur cette base que le <strong>CEVA</strong> a identifié et proposé un projet global du développement<br />
d’une filière Algue structuré autour de sous-projets adressés à différents secteurs d’activité<br />
de Mayotte tout en intégrant les défis environnementaux et socio-économiques de l’île.<br />
Avant cela, un chapitre est consacré aux espèces d’algues retenues comme candidates<br />
intéressantes à la valorisation. Dans ce chapitre, les points abordés sont la physiologie de<br />
l’algue, les techniques de production (préconisations de récolte, modes de culture<br />
envisagés) et, le cas échéant, les caractéristiques du marché (prix, tonnages, fournisseurs).<br />
Ces données permettent une première évaluation de l’effort de recherche et de l’effort<br />
commercial à fournir pour mettre en place les projets de développement proposés.<br />
B. Résultats de l’étude préliminaire<br />
Mayotte se caractérise par une relative grande richesse algale. En effet, la revue<br />
bibliographique et la mission de collecte réalisées dans le cadre de l’étude préliminaire ont<br />
permis un recensement de quelques 200 taxons différents (Tableau 1 et Tableau 2).<br />
Toutefois, ces algues ne présentent pas toutes un potentiel égal de valorisation économique.<br />
Sur la base du nombre et du délai de mise en œuvre des applications existantes, un score a<br />
été attribué à chaque taxon. Onze macroalgues et onze microalgues sont alors ressorties<br />
comme les candidates les plus prometteuses pour le développement d’une filière Algue à<br />
Mayotte (en bleu dans les Tableau 1 et Tableau 2).<br />
- 7 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 1 : Liste des macroalgues de Mayotte avec en bleu les algues retenues comme<br />
candidates intéressantes à la valorisation (b = recensées dans la bibliographie, i = identifiées<br />
lors de la mission de collecte d’Avril 2011)<br />
Macroalgues = 86 taxons différents<br />
Acanthophora spicifira (b) Halimeda spp. (i) Neogoniolithon megalocystum (b)<br />
Actinotrichia fragilis (i) Halymenia durvillei (i) Neogoniolithon propinquum (b)<br />
Amansia glomerata (i) Halymenia floresia (b) Neogoniolothon frutescens (b)<br />
Amphiroa anceps (b) Halymenia formosa (i) Neomeris vanbosseae (i)<br />
Amphiroa foliacea (b) Halymenia sp. (i) Padina spp. (i)<br />
Amphiroa fragilissima (b) Hormophora sp. (i) Peyssonnelia capensis (i)<br />
Asparagopsis taxiformis (b, i) Hydrolithon farinosum (b) Peyssonnelia simulans (i)<br />
Avrainvillea erecta (i) Hydrolithon improcerum (b) Peyssonnelia spp. (b,i)<br />
Botryocladia sp. (i) Hydrolithon onkodes (b) Pneophyllum mauritianum (b)<br />
Caulerpa mexicana (i) Hydrolithon reinboldii (b) Polystrata dura (b)<br />
Caulerpa racemosa (i) Hypnea pannosa (i) Portieria harveyi (i)<br />
Caulerpa serrulata (i) Hypnea sp. (b) Portieria hornemannii (b)<br />
Chlorodesmis sp. (i) Jania rubens (b) Ptilophora pinnatifida (i)<br />
Cruoria indica (b) Jania sp. (i) Rhipidosiphon sp. (i)<br />
Cryptonemia undulata (i) Laurencia papillosa (b) Rhipilia sp. (i)<br />
Dasya pilosa (i) Leptophytum ferox (b) Sargassum sp. (i)<br />
Dictyopteris sp. (i) Liagora valida (b) Spongites yendoi (b)<br />
Dictyota spp. (i) Lithophyllum bamleri (b) Sporolithon dimotum (b)<br />
Digenea simplex (b) Lithophyllum kotschyanum (b) sporolithon erythraeum (b)<br />
Dudresnaya sp. (i) Lithophyllum prototypum (b) Sporolithon lemoinei (b)<br />
Fosliella fertilis (b) Lithophyllum pygmaeum (b) Sporolithon sp. (b)<br />
Galaxaura marginata (b) Lithophyllum tamiense (b) Tricleocarpa cylindrica (b)<br />
Galaxaura obtusata (i) Lithoporella melobesioides (b) Turbinaria decurrens (i)<br />
Galaxaura rugosa (b, i) Lithothamnion australe (b) Turbinaria ornata (i)<br />
Galaxaura sp. (b) Lobophora sp. (i) Udotea sp1 (i)<br />
Galaxaura subverticilata (b) Mesophyllum funafutiense (b) Udotea sp2 (i)<br />
Gibsmithia sp. (i) Mesophyllum mesomorphum (b) Ventricaria ventricosa (i)<br />
Gracilaria salicornia (b) Neogoniolithon brassica-florida (b)<br />
Gracilaria sp. (b)<br />
Neogoniolithon caribaeum (b)<br />
Figure 1 : Padina sp., Caulerpa racemosa et Turbinaria ornata, macroalgues mahoraises<br />
identifiées comme candidates prometteuses à la valorisation<br />
- 8 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 2 : Liste des microalgues de Mayotte avec en bleu les algues retenues comme<br />
candidates intéressantes à la valorisation (b = recensées dans la bibliographie, i = identifiées<br />
lors de la mission de collecte d’Avril 2011, en gras = espèces marines)<br />
Microalgues = 116 taxons différents<br />
Achnantes subhudsonis (b) Diplonéis crabro (i) Pleurosigma sp. (i)<br />
Achradina sp. (i) Eunotia minor (b) Prochlorococcus sp. (b)<br />
Actinoptychus sp. (i) Gambierdiscus toxicus (b) Prorocentrum arenarium (b)<br />
Amphora copulata (b) Geitlerinema sp. (b) Prorocentrum belizeanum (b)<br />
Amphora pediculus (b) Gephyrocapsa oceanica (b) Prorocentrum hoffmanianum (b)<br />
Amphora subturgida (b) Gomphonema bourbonense (b) Prorocentrum lima (b)<br />
Anabaena sp. (i) Gomphonema clevei (b) Prorocentrum micans (i)<br />
Anabaena sp. (b) Gomphonema designatum (b) Prorocentrum sp. (b)<br />
Anabaena spiroïdes (i) Gomphonema sp. (i) Protoperidinium pallidum (i)<br />
Ankistrodesmus sp. (i) Guinardia sp. (i) Protoperidinium sp. (i)<br />
Aphanizomenon sp. (b) Gymnodinium sp. (i) Pseudohimantidium pacificum (i)<br />
Asterionella sp. (i) Gymnodinium sp1 (i) Pseudonitzschia delicatissima (i)<br />
Bacteriatrum sp. (i) Gymnodinium sp2 (i) Pseudonitzschia seriata (i)<br />
Botryococcus braunii (i) Gymnodinium sp3 (i) Rhizosolenia sp. (i)<br />
Cerataulina sp. (i) Hemiaulus sp. (i) Rhizosolenia sp1 (i)<br />
Ceratium fusus (i) Hillea fusiformis (i) Rhizosolenia sp2 (i)<br />
Ceratium horridum (i) Hyaloraphidium contortum (i) Rhodomonas sp. (i)<br />
Ceratium sp. (i) Hydrocoleum sp. (b) Richelia sp. (b)<br />
Chaetoceros danicus (i) Licmophora sp. (i) Scenedesmus sp. (i)<br />
Chaetoceros sp. (i) Lyngbya majuscula (b) Scenedesmus sp1 (i)<br />
Chaetoceros sp1 (i) Lyngbya sp. (b) Scenedesmus sp2 (i)<br />
Chaetoceros sp2 (i) Navicula sp. (i) Scenedesmus sp3 (i)<br />
Chlamydomonas sp. (i) Navicula sp. (i) Scripsiella sp. (i)<br />
Chlorella sp. (i) Nitzschia acidoclinata (b) Sphaerocystis shroeteri (i)<br />
Chroococcus sp. (b) Nitzschia amphibia (b) Staurastrum sp. (b,i)<br />
Chroomonas minuta (i) Nitzschia closterium (b) Stephanodiscus sp. (i)<br />
Cocconeis placentula (b) Nitzschia frustulum (b) Symploca sp. (b)<br />
Cocconeis sp. (b) Nitzschia inconspicua (b) Synechococcus sp. (b)<br />
Cocconeis sp. (i) Nitzschia sp. (i) Synechocystis sp. (b)<br />
Coelastrum reticulatum (b) Nitzschia sp. (i) Synedra acus<br />
Coenococcus planctonica (i) Nitzschia tropica (b) Teilingia sp. (b)<br />
Coscinodiscus sp. (i) Nodularia sp. (b) Tetraëdron minimum (b, i)<br />
Cosmarium sp. (b) Oocystis sp. (i) Tetraedron triangulare (b)<br />
Crucigenia tetrapedia (i) Oscillatoria sp. (b, i) Thalassionema frauenfeldii (i)<br />
Cryptomonas ovata (i) Ostreopsis sp. (b) Thalassionema nitzschoïdes (i)<br />
Cyclotella sp. (i) Oxytoxum sp. (b,i) Thalassiothrix frauenfeldii (b)<br />
Cylindrospermopsis raciborskii (b) Peridiniella sp. (i) Trachelomonas hispida (i)<br />
Cylindrotheca closterium (i) Peridinium sp. (i) Trachelomonas sp. (b)<br />
Didymocystis sp. (b) Phormidium sp. (b) Trachelomonas volvocina (i)<br />
Dinophysis acuminata (i) Planktolyngbya sp. (b) Trichodesmium sp. (b)<br />
- 9 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Chacune des algues retenues montre un potentiel de valorisation dans au moins un domaine<br />
d’applications. Ainsi, les macroalgues Caulerpa racemosa et Hypnea pannosa ont un intérêt<br />
pour des applications en alimentation humaine (Figure 2). Padina sp. et Scenedesmus sp.<br />
ressortent pour des applications en alimentation animale (Figure 3). Turbinaria decurrens et<br />
Turbinaria ornata sont plus particulièrement valorisables pour des usages agricoles (Figure<br />
4). Les microalgues Cyclotella sp. et Botryococcus braunii sont intéressantes pour des<br />
applications en chimie (Figure 5). Pour des applications cosmétiques ce sont entre autres<br />
Oscillatoria sp. et Scenedesmus sp. qui ressortent (Figure 6). Oscillatoria sp. a également un<br />
potentiel de valorisation dans le domaine de la santé humaine (Figure 8) tandis que<br />
Chaetoceros sp. est plus intéressante pour des applications en santé animale (Figure 7).<br />
Enfin, Hypnea pannosa, Chlamydomonas sp. et Navicula sp. ont un intérêt particulier pour<br />
des applications dans le domaine de l’épuration (Figure 9) ainsi que Cyclotella sp et<br />
Chaetoceros sp. pour leur capacité à produire naturellement des polymères de type chitosan<br />
utilisabke pour la floculation des boues de station de traitement des eaux. Tous domaines<br />
confondus, c’est la microalgue Chlorella sp. qui ressort comme la plus intéressante pour le<br />
développement de de la filière Algue à Mayotte. Elle fait toujours partie des trois ou quatre<br />
premières de liste par domaine d’application.<br />
D’autre part, dans le cadre d’une réflexion à court et moyen terme et étant donné le contexte<br />
mahorais en termes d’industrialisation et de disponibilité des compétences, certains<br />
domaines d’application apparaissent plus difficiles à implanter sur le territoire. En particulier,<br />
le développement d’applications santé semble risqué car il nécessiterait la mise en œuvre de<br />
techniques et procédés de pointe. Bien que les études et les preuves de concept se<br />
multiplient dans ce domaine, l’exemple métropolitain laisse penser que le marché des<br />
produits pharmaceutiques à base d’algues n’est pas encore suffisamment établi. Ce secteur<br />
d’applications ne sera donc pas abordé en priorité à Mayotte, du moins pas dans un premier<br />
temps. En effet, les solutions de développement proposées doivent être d’une relative facilité<br />
de mise en œuvre tant du point de vue de la technicité que des investissements. De même,<br />
la plupart des applications en chimie fine et dans une moindre mesure des applications<br />
cosmétiques requièrent des procédés lourds de traitement ou d’extraction. Dans un premier<br />
temps, ces voies de développement ne seront donc pas non plus étudiées en priorité. Au<br />
contraire, les domaines de l’alimentation et de l’agriculture qui ne nécessitent pas forcément<br />
une technologie trop pointue semblent des voies prometteuses de développement<br />
économique. De la même manière, l’utilisation des algues dans des procédés d’épuration<br />
apparaît comme une voie prometteuse à explorer.<br />
En résumé, les domaines d’applications les plus prometteurs pour un développement sur<br />
Mayotte à court et moyen terme sont l’alimentation humaine et animale, l’agriculture et<br />
l’épuration des effluents. En revanche, les applications en santé, en cosmétique et en<br />
chimie ne sont pas une priorité à ce stade.<br />
Sur la base de ces résultats, le <strong>CEVA</strong> a identifié et formulé plusieurs projets de<br />
développement économique basés sur l’exploitation des algues locales (voir paragraphe D).<br />
- 10 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 2 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications<br />
en alimentation humaine<br />
Causes<br />
Effects<br />
3.1 Alimentation humaine<br />
algue légume<br />
condiment<br />
aliment fonctionnel<br />
substitut de sel<br />
boisson 'santé'<br />
bonbon pour bonne hygiène bucco-dentaire<br />
complément alimentaire<br />
grande qualité nutritionnelle<br />
source de minéraux<br />
source de protéines<br />
source de vitamines<br />
source de cal ci um<br />
source d'acides gras poly-insaturés<br />
richesse en fucanes<br />
antioxydant<br />
antioxydant<br />
propriété liée à la richesse en polyphénols<br />
bien-être/énergie (contre stress/fatigue)<br />
détoxifiant<br />
hypocholestérolémiant<br />
hypolipidémiant<br />
effet prébiotique<br />
renforcement du système immunitaire<br />
prévention de l'ostéoporose<br />
protection UV<br />
formulation<br />
colloïdes<br />
alginates<br />
carraghénanes<br />
pigment/colorant<br />
conservateur<br />
conservateur<br />
agent stabilisant pour huile de poisson<br />
acide lactique<br />
goût<br />
goût<br />
masquage goût amer<br />
autorisation de consommation en France<br />
Chlorella sp.<br />
Caulerpa racemosa<br />
Hypnea pannosa<br />
Turbinaria ornata<br />
Turbinaria decurrens<br />
Caulerpa serrulata<br />
Caulerpa mexicana<br />
Sargassum sp.<br />
Dictyota spp.<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Chlamydomonas sp.<br />
Scenedesmus sp.<br />
Padina spp.<br />
Botryococcus braunii<br />
Oscillatoria sp.<br />
Navicula sp.<br />
Navicula sp<br />
Cyclotella sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Anabaena sp.<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
Dictyopteris sp.<br />
Nitzschia sp.<br />
Nitzschia sp<br />
Chaetoceros sp.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Weight<br />
5,70<br />
2,53<br />
2,50<br />
1,94<br />
1,94<br />
1,89<br />
1,89<br />
1,89<br />
1,87<br />
1,77<br />
1,69<br />
1,56<br />
1,38<br />
1,25<br />
1,24<br />
1,11<br />
1,11<br />
1,08<br />
1,08<br />
1,04<br />
1,04<br />
1,03<br />
1,02<br />
1,02<br />
1,00<br />
Légende<br />
: Usage identifié pour l’algue considérée – Développement possible à court terme<br />
: Usage identifié pour une autre espèce appartenant au même genre que l’algue considérée –<br />
Développement possible à moyen terme<br />
: Application existante pour l’algue considérée mais sans commercialisation ou brevet à ce jour<br />
(travaux en phase de recherche ou laboratoire) – Développement envisageable à long terme<br />
: Application inexistante pour l’algue considérée – Développement non envisageable à ce jour<br />
- 11 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 3 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications<br />
en alimentation animale (voir légende à la Figure 2)<br />
Causes<br />
Effects<br />
3.2 Alimentation animale<br />
algue fourrage<br />
animaux<br />
aquaculture<br />
complément alimentaire<br />
haute qualité nutritionnelle<br />
animaux domestiques<br />
source de protéines<br />
aquaculture<br />
source de vitamines<br />
animaux domestiques<br />
source de calcium<br />
sources d'acides gras poly-insaturés<br />
aquaculture<br />
œufs de poule enrichis en oméga 3<br />
richesse en fucanes<br />
antioxydant<br />
amélioration de la digestion, stimulation flore intestinale<br />
animaux non ruminants<br />
renforcement du système immunitaire<br />
stimulation des fonctions de reproduction<br />
colorant pour la pigmentation de la chair<br />
source de bromophénols pour la qualité organoleptique du produit fini<br />
aquaculture<br />
complément<br />
chien/chat<br />
formulation<br />
ingrédient<br />
animaux domestiques<br />
Chlorella sp.<br />
Padina spp.<br />
Scenedesmus sp.<br />
Sargassum sp.<br />
Navicula sp.<br />
Nitzschia sp.<br />
Navicula sp<br />
Anabaena sp.<br />
Nitzschia sp<br />
Turbinaria ornata<br />
Turbinaria decurrens<br />
Chlamydomonas sp.<br />
Dictyota spp.<br />
Hypnea pannosa<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Chaetoceros sp.<br />
Oscillatoria sp.<br />
Caulerpa racemosa<br />
Caulerpa serrulata<br />
Caulerpa mexicana<br />
Botryococcus braunii<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Dictyopteris sp.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Weight<br />
5,89<br />
2,96<br />
2,61<br />
2,56<br />
2,45<br />
2,45<br />
2,45<br />
2,45<br />
2,45<br />
2,25<br />
2,25<br />
2,11<br />
2,00<br />
2,00<br />
2,00<br />
1,59<br />
1,45<br />
1,30<br />
1,30<br />
1,30<br />
1,29<br />
1,18<br />
1,11<br />
1,11<br />
1,08<br />
Figure 4 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications<br />
en agriculture (voir légende à la Figure 2)<br />
Causes<br />
Effects<br />
3.3 Agriculture<br />
engrais<br />
engrais<br />
amélioration de la croissance et/ou qualité du végétal<br />
amélioration de la composition et/ou qualité du sol<br />
substrat de revégétalisation<br />
produit phyto-sanitaire<br />
insecticide<br />
anti-bactérien<br />
anti-fongique<br />
éliciteur<br />
Turbinaria decurrens<br />
Turbinaria ornata<br />
Chlorella sp.<br />
Chlamydomonas sp.<br />
Sargassum sp.<br />
Hypnea pannosa<br />
Scenedesmus sp.<br />
Botryococcus braunii<br />
Oscillatoria sp.<br />
Padina spp.<br />
Dictyota spp.<br />
Caulerpa racemosa<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Caulerpa serrulata<br />
Caulerpa mexicana<br />
Dictyopteris sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Navicula sp.<br />
Nitzschia sp.<br />
Chaetoceros sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Navicula sp<br />
Anabaena sp.<br />
Nitzschia sp<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Weight<br />
5,17<br />
4,71<br />
3,05<br />
2,58<br />
2,29<br />
1,62<br />
1,62<br />
1,62<br />
1,37<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
- 12 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 5 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications<br />
en chimie (voir légende à la Figure 2)<br />
Causes<br />
Effects<br />
Cyclotella sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Chlorella sp.<br />
Botryococcus braunii<br />
Anabaena sp.<br />
Navicula sp.<br />
Navicula sp<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
Nitzschia sp.<br />
Nitzschia sp<br />
Chaetoceros sp.<br />
Oscillatoria sp.<br />
Chlamydomonas sp.<br />
Scenedesmus sp.<br />
Hypnea pannosa<br />
Sargassum sp.<br />
Dictyota spp.<br />
Dictyopteris sp.<br />
Padina spp.<br />
Turbinaria ornata<br />
Turbinaria decurrens<br />
Caulerpa racemosa<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Caulerpa serrulata<br />
Caulerpa mexicana<br />
3.4 chimie<br />
chimie fine<br />
propriété antifouling (qui peut être liée à la présence de terpènes)<br />
antifouling<br />
<br />
algicide<br />
<br />
propriété déterrente (qui peut être liée à la présence de terpènes)<br />
<br />
composés originaux<br />
acide lactique<br />
acides acryliques halogénés<br />
<br />
<br />
beta-chitine<br />
caulersine (bis-indole)<br />
<br />
terpènes<br />
<br />
toxines<br />
activité enzymatique<br />
agarolytique<br />
<br />
<br />
<br />
catalysant réaction d'extension d'acide gras à longue chaîne<br />
<br />
flocculant<br />
surfa ctant<br />
richesse en lipides > huile pour lubrifiant<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
pigment<br />
phycobiliprotéines (ex. pour recherche médicale)<br />
<br />
chlorophylle (pour masquer odeur de tabac)<br />
<br />
composé limitant la formation de tartre/dépôt de calcaire<br />
<br />
composé incorporé dans de la glace pour une meilleure conservation des al...<br />
<br />
méthode d'obtention d'oxides métalliques<br />
domaine médical<br />
<br />
<br />
cryoprotecteur pour préparations médicales<br />
<br />
recherche médicale (ex. facteur de croissance)<br />
matériaux<br />
thermoplastique<br />
<br />
<br />
thermoplastique<br />
<br />
PVC contenant des microalgues<br />
enduit contenant des particules microalgales<br />
<br />
<br />
<br />
matériau accumulateur d'énergie solaire<br />
polymère réducteur de frottement<br />
<br />
<br />
cellulose pour traitement pharmaceutique à base de nicotine<br />
<br />
filtre à cigarettes<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Weight<br />
3,01<br />
3,01<br />
2,75<br />
2,28<br />
2,24<br />
2,11<br />
2,11<br />
2,11<br />
2,11<br />
2,11<br />
2,00<br />
1,94<br />
1,92<br />
1,86<br />
1,56<br />
1,17<br />
1,10<br />
1,06<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
- 13 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 6 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications<br />
en cosmétique (voir légende à la Figure 2)<br />
Causes<br />
Effects<br />
3.5 cosmétique<br />
soin anti-âge<br />
soin anti-âge<br />
anti-ride<br />
propriété antioxydante<br />
inhibiteur de la hyaluronidase<br />
stimulation de la production de collagène<br />
soin de la peau<br />
agent cicatrisant<br />
hydratant cutané<br />
soin protecteur, renforcement<br />
soin 'santé' maintenant ou augmentant la teneur en céramides de la peau<br />
pigmentation<br />
agent éclaircissant<br />
stimulation la synthèse de mélanine<br />
protection UV<br />
traitement de l'acné, des imperfections<br />
régénération cellulaire<br />
beauté<br />
soi ns du corps<br />
soi ns du corps<br />
effet volumateur du buste<br />
minceur<br />
traitement et prévention des vergetures<br />
soi ns capil laires<br />
soi ns des cil s<br />
soi ns des lèvres (l issant, repulpant)<br />
sels de bain<br />
boues thermales contenant des microalgues<br />
après-rasage<br />
formulation<br />
richesse en lipides<br />
additif pour préparations cosmétiques<br />
humectant<br />
conservateur (biocide)<br />
anti-inflammatoire<br />
pigment<br />
phycocyanine<br />
Weight<br />
Chlorella sp.<br />
Oscillatoria sp.<br />
Scenedesmus sp.<br />
Caulerpa racemosa<br />
Chlamydomonas sp.<br />
Dictyopteris sp.<br />
Padina spp.<br />
Sargassum sp.<br />
Caulerpa serrulata<br />
Caulerpa mexicana<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Hypnea pannosa<br />
Turbinaria ornata<br />
Anabaena sp.<br />
Dictyota spp.<br />
Nitzschia sp.<br />
Chaetoceros sp.<br />
Nitzschia sp<br />
Cyclotella sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Turbinaria decurrens<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
Navicula sp.<br />
Navicula sp<br />
Botryococcus braunii<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
3,98<br />
<br />
3,47<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
3,18<br />
2,61<br />
2,47<br />
2,16<br />
2,14<br />
2,05<br />
1,94<br />
1,94<br />
1,70<br />
1,61<br />
1,57<br />
1,46<br />
<br />
1,45<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1,37<br />
1,37<br />
1,37<br />
1,36<br />
1,36<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1,21<br />
<br />
<br />
1,17<br />
1,08<br />
1,08<br />
1,08<br />
Figure 7 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications<br />
en santé animale (voir légende à la Figure 2)<br />
Causes<br />
Effects<br />
3.7 santé animale<br />
anti-viral<br />
anti-bactérien en aquaculture<br />
anti-bactérien chez les mammifères<br />
anti-champignon en aquaculture<br />
anti-parasite<br />
insecticide<br />
anti-parasite en aquaculture<br />
stimulation des défenses immunitaires<br />
dépression<br />
Chlorella sp.<br />
Chaetoceros sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Nitzschia sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Botryococcus braunii<br />
Nitzschia sp<br />
Padina spp.<br />
Sargassum sp.<br />
Dictyota spp.<br />
Turbinaria ornata<br />
Turbinaria decurrens<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Caulerpa racemosa<br />
Hypnea pannosa<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Caulerpa serrulata<br />
<br />
Caulerpa mexicana<br />
Dictyopteris sp.<br />
Oscillatoria sp.<br />
Navicula sp.<br />
Chlamydomonas sp.<br />
<br />
<br />
Scenedesmus sp.<br />
Navicula sp<br />
Anabaena sp.<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
<br />
<br />
Weight<br />
3,67<br />
2,78<br />
1,89<br />
1,89<br />
1,89<br />
1,89<br />
1,89<br />
1,22<br />
1,22<br />
1,22<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
- 14 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 8 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications<br />
en santé humaine (voir légende à la Figure 2)<br />
Causes<br />
Effects<br />
Chlorella sp.<br />
Oscillatoria sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Caulerpa racemosa<br />
Caulerpa serrulata<br />
Caulerpa mexicana<br />
Scenedesmus sp.<br />
Chlamydomonas sp.<br />
Padina spp.<br />
Anabaena sp.<br />
Sargassum sp.<br />
Hypnea pannosa<br />
Nitzschia sp.<br />
Nitzschia sp<br />
Navicula sp.<br />
Navicula sp<br />
Dictyopteris sp.<br />
Dictyota spp.<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Chaetoceros sp.<br />
Turbinaria ornata<br />
Turbinaria decurrens<br />
Botryococcus braunii<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
3.6 Santé humaine<br />
action contre les pathogènes<br />
virus<br />
antiviral<br />
<br />
<br />
VIH<br />
<br />
<br />
<br />
virus herpès<br />
<br />
bactérie<br />
<br />
champignon<br />
<br />
<br />
parasite<br />
anti-parasite<br />
<br />
insecticide<br />
<br />
infections nosocomiales<br />
<br />
<br />
<br />
immunostimulation<br />
<br />
<br />
<br />
immuno-supression<br />
<br />
traitement des cancers et tumeurs<br />
anti-cancer<br />
anti-cancer<br />
<br />
<br />
cytotoxique<br />
<br />
<br />
antimitotique<br />
<br />
<br />
apoptotique<br />
<br />
<br />
<br />
anti-tumoral<br />
<br />
<br />
<br />
maladies cardio-vasculaires<br />
artériosclérose<br />
<br />
thrombose<br />
<br />
<br />
<br />
insuffisance cardiaque<br />
<br />
inhibiteur de la sérine protéase (enzyme intervenant dans certains troubles c...<br />
action sur la coagulation<br />
<br />
anti-coagulant<br />
<br />
<br />
hyper-coagulant<br />
<br />
<br />
hypo-tenseur<br />
<br />
<br />
hypocholestérolémiant<br />
<br />
hypolipidémiant<br />
anti-allergique<br />
<br />
<br />
<br />
anti-diabétique<br />
anti-douleur, anesthésiant<br />
anti-inflammatoire<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
anti-oxydant<br />
<br />
<br />
<br />
anti-ulcéreux<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
bronchoconstricteur<br />
caries<br />
<br />
<br />
cicatrisant<br />
<br />
<br />
<br />
contractant utérin<br />
<br />
constipation<br />
<br />
dépression<br />
<br />
douleurs articulaires<br />
<br />
hémorroïdes<br />
<br />
maladies neurologiques<br />
maladies neurologiques<br />
<br />
maladie d'Alzheimer<br />
<br />
<br />
<br />
maladies osseuses ou cartilagineuses<br />
<br />
maladies du foie<br />
<br />
maladies hormonales<br />
<br />
maladies liées à une déficience en iode<br />
<br />
pansement antibactérien<br />
<br />
parodontite (inflammation des tissus de soutien des dents, ex. gencives)<br />
<br />
plaies et brûlures de la cornée<br />
<br />
relaxation musculaire<br />
<br />
médecine traditionnelle chinoise<br />
<br />
<br />
agent améliorant la biodisponibilité de substances médicamenteuses<br />
<br />
richesse en acides gras poly-insaturés<br />
acide lactique<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
composé utilisé pour le diagnostic médical<br />
<br />
<br />
Weight<br />
2,56<br />
2,11<br />
1,76<br />
1,76<br />
1,74<br />
1,72<br />
1,72<br />
1,65<br />
1,49<br />
1,43<br />
1,43<br />
1,34<br />
1,27<br />
1,22<br />
1,22<br />
1,22<br />
1,22<br />
1,15<br />
1,11<br />
1,04<br />
1,04<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
- 15 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 9 : Classement des algues candidates à la valorisation pour des applications en<br />
épuration (voir légende à la Figure 2)<br />
Causes<br />
Effects<br />
3.8 épuration<br />
eaux usées<br />
absorption des nutriments<br />
absorption des polluants<br />
heavy metals<br />
arsenic<br />
cadmium<br />
chrome<br />
cuivre<br />
plomb<br />
mercure<br />
nickel<br />
acetonitrile<br />
cobalt<br />
fluoranthene<br />
manganèse<br />
pétrole<br />
phenanthrene<br />
phenol<br />
p-nitrophenol<br />
rhodamine B<br />
sal icylate<br />
uranium / éléments radioactifs<br />
vert de malachite<br />
zinc<br />
neutralisation des polluants (oxydation)<br />
désulfonation<br />
diminution de la demande biologique en oxygène (BOD)<br />
diminution de la charge bactérienne<br />
déchets solides ou semi-solides<br />
accélération de la fermentation<br />
gaz industriels<br />
absorption des polluants<br />
fixation du CO2<br />
Weight<br />
Hypnea pannosa<br />
Chlamydomonas sp.<br />
Navicula sp.<br />
Navicula sp<br />
Chlorella sp.<br />
Oscillatoria sp.<br />
Nitzschia sp.<br />
Nitzschia sp<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
Scenedesmus sp.<br />
Chaetoceros sp.<br />
Dictyota spp.<br />
Botryococcus braunii<br />
Sargassum sp.<br />
Padina spp.<br />
Turbinaria ornata<br />
Turbinaria decurrens<br />
Caulerpa racemosa<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Caulerpa serrulata<br />
Caulerpa mexicana<br />
Dictyopteris sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Anabaena sp.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
4,00<br />
3,46<br />
<br />
3,00<br />
3,00<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
2,90<br />
<br />
<br />
2,33<br />
<br />
2,33<br />
2,33<br />
<br />
2,33<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
2,01<br />
1,92<br />
<br />
1,70<br />
1,67<br />
<br />
<br />
<br />
1,33<br />
<br />
<br />
1,00<br />
<br />
1,00<br />
1,00<br />
<br />
<br />
1,00<br />
<br />
1,00<br />
<br />
<br />
1,00<br />
1,00<br />
1,00<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1,00<br />
1,00<br />
<br />
<br />
1,00<br />
- 16 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
C. Etat de l’art sur les algues candidates à la valorisation<br />
1. Macroalgues candidates à la valorisation<br />
Padina spp.<br />
Rappel : Les espèces de Padina rencontrées à Mayotte et décrites dans la<br />
bibliographie sont entre autres Padina australis, Padina boergesenii, Padina boryana<br />
et Padina commersoni (voir <strong>Tome</strong> 1).<br />
Physiologie de l’algue<br />
Padina sp. est une des rares algues brunes calcifiées (Geraldino et al., 2005) Son<br />
cycle de vie est caractérisé par une alternance de deux générations semblables<br />
morphologiquement : le gamétophyte haploïde et le sporophyte diploïde (Ni-Ni-Win et<br />
al., 2011). Wichachucherd (2007) a montré que les peuplements de Padina boryana<br />
de la province de Phuket au sud de la Thaïlande (entre 7°N et 8°N) sont dominés par<br />
la génération sporophytique. Seuls quelques gamétophytes sont observés. Il est<br />
possible que les sporophytes soient capables de donner de nouveaux sporophytes<br />
sans passer par le stade gamétophytique (reproduction asexuée). Les sporophytes<br />
produisent des spores tout au long de l’année avec un pic lors du changement de<br />
saison (saison humide ↔ saison sèche). Dans ces conditions tropicales (entre 7°N et<br />
8°N), les algues Padina boryana ont donc la capacité de se reproduire toute l’année,<br />
même à des petites tailles (Whichachucherd et al., 2010). Dans ces populations, un<br />
cycle complet, depuis le recrutement jusqu’à la mort, dure moins de 6 mois. Padina<br />
boryana est une espèce décrite à Mayotte qui connaît également une alternance de<br />
saison humide et de saison sèche (12°N, Figure 10).<br />
Figure 10 : Carte de la température de surface des océans le 13 Novembre 2010<br />
- 17 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Au Nord de la Tunisie, l’espèce Padina pavonica se développe et se reproduit<br />
essentiellement au printemps et en été (Ben Said et al., 2002). Cependant, le climat y<br />
est différent de Mayotte où cette espèce n’a pas été décrite à ce jour.<br />
Concernant les besoins nutritionnels de la Padine, une étude sur Padina australis au<br />
Japon conclut que, dans les conditions testées, l’augmentation de la teneur en<br />
nitrates dans le milieu ne permet pas une augmentation significative du taux de<br />
croissance (Tableau 3). La croissance de Padina australis ne semble donc pas<br />
limitée par les faibles teneurs en nitrates dans le milieu (2 µM). Cette espèce est par<br />
ailleurs décrite à Mayotte où les teneurs en nitrates mesurées en 1992 et 1997 sont<br />
comprises entre 0,4 et 3,5 µM (Annexe 1). Larned (1998) montre d’autre part que le<br />
premier nutriment limitant la croissance de Padina japonica à Kanehoe Bay à Hawaii<br />
(21°N) est l’azote, plutôt que le phosphore.<br />
Tableau 3 : Teneur en azote dans l’algue, évolution de la teneur en azote dans l’algue et<br />
taux de croissance de Padina australis mise en culture pendant 12 jours sous<br />
différentes conditions de température (hiver : faibles températures ; été : fortes<br />
températures) et de disponibilité en nitrates (2 à 40 µM) in Umezawa et al., 2007<br />
Conditions de culture Teneur en N (%) (Δ début-fin) Taux de croissance (mm/j)<br />
hiver, 2 µM NO 3 0,8 (-33,3%) 0,36±0,15 (a)<br />
hiver, 20 µM NO 3 1,4 (+16,7%) 0,38±0,12 (a)<br />
hiver, 40 µM NO 3 2 (+66,7%) 0,54±0,24 (ab)<br />
été, 2 µM NO 3 0,6 (-50%) 0,62±0,24 (ab)<br />
été, 40 µM NO 3 1,2 (0) 0,88±0,20 (b)<br />
Techniques de production<br />
Récolte dans les populations naturelles<br />
Il semblerait qu’il existe des pratiques de récolte de Padina pavonica dans les<br />
champs naturels (Ben Said, 2010). A la demande d’une société tunisienne, l’Institut<br />
National des Sciences et Technologies de la Mer a réalisé une évaluation du potentiel<br />
de production d’un champ de 82 ha situé au Nord-Est de la Tunisie en vue d’une<br />
exploitation raisonnée de cette ressource (Ksouri et al., 2010).<br />
Sur les sites échantillonnés à Mayotte lors de la mission du <strong>CEVA</strong>, les algues du<br />
genre Padina se développaient vers 5 m de fond, en quantité relativement<br />
abondante. Cependant, les algues étaient imbriquées dans les coraux, rendant toute<br />
opération de récolte fastidieuse. Dans l’état actuel des connaissances, la mise en<br />
place d’un plan de récolte de la Padine semble donc peu envisageable à moins<br />
qu’une cartographie plus approfondie des peuplements ne révèle l’existence de<br />
champs facilement exploitables.<br />
Culture<br />
Dans le sud de l’Inde (entre 9°14N et 9°11N), Ganesan et al. (1999) ont montré que<br />
la culture de Padina boergesenii était possible en lagon et en mer ouverte sur des<br />
- 18 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
radeaux, avec un rendement de l’ordre de 2 à 3 kg de matière fraîche par m².<br />
L’ensemencement est réalisé à partir de spores libérées par les individus mâtures. La<br />
méthodologie utilisée est décrite dans Vasuki et al. 2001. Des jours longs et lumineux<br />
favorisent la libération massive puis la germination des spores. Avant de rejoindre la<br />
mer ouverte, les plantules passent quelques temps en écloserie. Les conditions<br />
favorables à leur croissance ont été établies par Vasuki et al. 2001.<br />
Au laboratoire, Liddle (comm. pers. in Wichachucherd et al., 2010) évalue à 100% le<br />
pourcentage de germination des spores libérées par les individus mâtures de Padina<br />
boryana.<br />
A Malte, l’espèce Padina pavonica est cultivée par l’Institute of Cellular Pharmacology<br />
Ltd pour l’extraction d’actifs à usage nutraceutique<br />
(www.healthexceluk.co.uk/dictyolone.php). L’algue est cultivée sur des blocs rocheux<br />
dans des fermes sous-marines. La récolte est réalisée à la main par des plongeurs<br />
professionnels (Aydin, 2011). Les algues récoltées sont rincées et séchées à l’abri du<br />
soleil avant l’étape d’extraction (Figure 11).<br />
Figure 11 : Culture et séchage de Padina pavonica par l’ICP à Malte<br />
Les techniques de culture étant établies pour l’espèce Padina boergesenii, décrite à<br />
Mayotte, nous pensons que la mise en place de la culture de cette algue est envisageable<br />
à court terme. Une phase préalable de Recherche et Développement sera toutefois<br />
nécessaire pour adapter et optimiser les techniques aux conditions locales mahoraises.<br />
Sargassum sp.<br />
Rappel : Parmi les espèces de Sargasse rencontrées aux Comores et décrites dans<br />
la bibliographie on compte Sargassum cristaefolium et Sargassum turbinatifolium<br />
(voir <strong>Tome</strong> 1). Ces espèces sont actuellement considérées comme des synonymes<br />
de Sargassum ilicifolium (Guiry and Guiry, 2012).<br />
Physiologie de l’algue<br />
Les Sargasses sont de grandes algues brunes qui vivent fixées au substrat ou flottant<br />
à la surface des océans. Leur cycle de vie ne comporte qu’une seule génération<br />
diploïde. Elles sont capables de se reproduire par voie sexuée (gamètes) ou<br />
végétative (fractionnement du thalle) (Pratt, 1999). Au Sud de la Mer Rouge (Erythrée<br />
- 15°35’ N), chez Sargassum ilicifolium, la voie végétative semble d’ailleurs<br />
- 19 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
prédominer. La plupart des Sargasses de la zone tropicale Indo-Pacifique atteint son<br />
pic d’abondance et de reproduction durant les mois les plus froids de l’année. La<br />
reproduction est initiée après un pic de croissance. En Erythrée, chez Sargassum<br />
ilicifolium, les croissances les plus fortes sont observées quand la température de<br />
l’eau est à 28-30°C en moyenne, après quoi la reproduction débute. L’algue perd<br />
ensuite ses ramifications et passe l’hiver sous cette forme primaire pérennante<br />
(Ateweberhan et al., 2005). Elle a une durée de vie de 3 à 4 ans (Pratt, 1999).<br />
Aux Philippines, Trono et Tolentino (1992) ont observé plusieurs pics de fertilité au<br />
cours de l’année chez Sargassum cristaefolium dont le principal se situait pendant les<br />
mois les plus froids, entre novembre et février.<br />
Les performances de Sargassum spp. varient selon les conditions du milieu et<br />
notamment selon la disponibilité en nutriments. La croissance est optimale dans des<br />
gammes comprises entre 6 et 15 µM de nitrates + ammonium et entre 0,3 et 0,75 µM<br />
de phosphates. Des concentrations trop élevées en nutriments peuvent générer une<br />
limitation de la croissance de l’algue. Malgré tout, une étude réalisée en Australie<br />
(31°S) met en évidence la capacité de Sargassum sp. à capter les nutriments en<br />
excès dans une culture intégrée de crevettes et d’algues avec un rendement<br />
d’absorption maximal observé de 75±10% pour les nitrates (Mai et al., 2010).<br />
Lapointe (1986) constate pour sa part que le premier facteur limitant la croissance<br />
des espèces pélagiques Sargassum natans et Sargassum fluitans se développant<br />
dans la mer des Sargasses (28°N) pourrait être la disponibilité en phosphates plutôt<br />
qu’en nitrates. Plus généralement, plusieurs auteurs ont constaté que la disponibilité<br />
en phosphore était plus limitante que l’azote pour la croissance des macroalgues<br />
dans les systèmes coralliens. Ce résultat n’est pas toujours vérifié, comme en<br />
témoigne l’exemple de Kaneohe Bay à Hawaii (21°N) où c’est l’azote qui limite en<br />
premier lieu la croissance de 8 macroalgues testées dont Sargassum echinocarpum<br />
(Larned, 1998).<br />
Techniques de production<br />
Récolte dans les populations naturelles<br />
En Asie du Sud, la Sargasse est récoltée pour la production d’alginates (Coppen &<br />
Nambiar, 1991 ; Trono, 1999). Plus de 2000 tonnes fraîches seraient récoltées en<br />
Inde et jusqu’à 5000 tonnes aux Philippines (Seaplant Handbook). Aux Philippines,<br />
elle est récoltée dans les champs naturels intertidaux ou subtidaux ; mais en 1999<br />
émerge une problématique de surexploitation et de régression de ces peuplements.<br />
Des pratiques de bonne gestion sont alors recommandées (Trono, 1999) :<br />
- Champs intertidaux constitués de Sargassum polycystum, S. oligocystum et<br />
Sargassum sp. : récolte annuelle de Novembre à Décembre<br />
- Champs subtidaux constitués de S. crassifolium et S. cristaefolium : récolte<br />
annuelle d’Octobre à Novembre et accessoirement en Juillet.<br />
- Récolte par élagage, en coupant au-dessus de la base des premières<br />
ramifications.<br />
- 20 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
En Inde, le ramassage des algues d’échouage est possible toute l’année avec un<br />
maximum durant les mois de Juillet et Août, quand les vents forts décrochent les<br />
algues de leurs substrats (Coppen & Nambiar, 1991).<br />
Durant la mission du <strong>CEVA</strong> à Mayotte, seules des Sargasses à la dérive ont été<br />
observées, en quantité relativement abondante. L’origine de ces algues reste<br />
inconnue (Comores ?). Les Sargasses étant présentes en quantités relativement<br />
abondantes, la récolte dans ces populations dérivantes semble envisageable. Une<br />
étape préalable d’estimation de la biomasse s’avère cependant nécessaire.<br />
D’autre part, il est possible que des peuplements fixés existent à Mayotte, notamment<br />
sur le récif externe moins fréquenté par les plongeurs. Une cartographie plus<br />
approfondie du lagon permettrait de confirmer leur existence et le cas échéant<br />
d’évaluer la faisabilité de la récolte dans ces peuplements.<br />
Culture<br />
Plusieurs équipes de recherche se sont intéressées à la culture de l’algue brune<br />
Sargassum. Des expériences ont permis de valider la faisabilité de la culture de cette<br />
algue (Chennubhotla et al., 1986 ; Chennubhotla, 1988 ; Kimura & Tanaka, 2006).<br />
Deux modes de culture semblent pouvoir être envisagés :<br />
un mode végétatif avec régénération du thalle à partir d’un fragment basal de<br />
l’algue (avec le crampon). Dans ce cas, la croissance est faible avec des valeurs<br />
observées comprises entre 0,25 et 1 cm/j pour Sargassum wightii, S. cinctum et S.<br />
vulgare<br />
un mode sexué avec libération des gamètes, fécondation et développement du<br />
zygote en un nouveau plant. Les conditions optimales de développement des<br />
plantules sont les suivantes : lumière continue, 600-800 lux, 23-26°C avec<br />
circulation d’un mince filet d’eau de mer filtrée. Les meilleurs substrats de fixation<br />
des plantules sont, dans l’ordre, les blocs de béton, les briques et le papier filtre.<br />
Yoon et al. (2011) utilisent cette technique pour des essais de restauration des<br />
champs naturels de Sargassum fulvellum et Sargassum horneri en Corée. La<br />
reproduction est déclenchée chez des individus mâtures en laboratoire. Les<br />
plantules se fixent sur des blocs de béton. Quand elles ont atteint la taille de 3-5<br />
mm, les blocs sont transférés de l’écloserie à la mer où les plantules continuent de<br />
se développer à l’abri des brouteurs sous un filet de protection. Lors d’un essai<br />
récent, les algues grandirent de 30 à 300 cm en 6 mois, soit une croissance de 5%<br />
par jour.<br />
Malgré tout, la culture commerciale de l’algue Sargassum est inexistante à l’échelle<br />
mondiale (cause possible : faible valeur et disponibilité toute l’année contrairement aux<br />
algues agarophytes de type Gracilaria), la majorité de la production provenant de la<br />
récolte d’algues sauvages. Dans ce contexte, nous pensons que la culture de cette algue<br />
pourrait raisonnablement être mise en place à Mayotte mais après une phase nécessaire<br />
de Recherche et Développement.<br />
- 21 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Turbinaria ornata et Turbinaria decurrens<br />
Rappel : Parmi les espèces de Turbinaria rencontrées à Mayotte et décrites dans la<br />
bibliographie on compte Turbinaria conoides, Turbinaria decurrens et Turbinaria<br />
ornata. L’espèce Turbinaria denudata est décrite aux Comores (voir <strong>Tome</strong> 1).<br />
Physiologie de l’algue<br />
Les algues brunes appartenant au genre Turbinaria sont des organismes pérennes<br />
dont le cycle de vie se compose d’une seule génération diploïde (Lebham ; Ferret,<br />
2008). Les populations de Turbinaria ornata de Polynésie française (17°S) ont une<br />
forte capacité de reproduction, assurée par la coexistence du mode asexué<br />
(multiplication végétative) et sexué (production de gamètes par les parents mâtures)<br />
(Payri, 2006). En Inde, les individus atteignent la maturité à partir de 4-5 cm de haut<br />
(Umamaheswara & Kalimuthu, 1972). Cette algue montre également un fort potentiel<br />
de dispersion : les thalles mâtures et fertiles ont en effet la capacité de se détacher<br />
du substrat et de dériver au gré des courants (Stewart, 2006). A Tahiti (17°S), le<br />
maximum de biomasse de Turbinaria ornata est observé pendant la saison froide. La<br />
reproduction s’étale tout au long de l’année, avec un pic de maturité et de fertilité<br />
pendant la saison chaude (Stiger & Payri, 1999). En Thaïlande (8°N), la reproduction<br />
de Turbinaria ornata a également lieu tout au long de l’année, avec toutefois des<br />
variations saisonnières significatives. La densité des peuplements est plus faible<br />
dans les zones battues, en lien probablement avec la plus grande dispersion des<br />
gamètes (Prathep et al., 2007).<br />
Mageswaran & Sivasubramaniam (1984) donnent des valeurs de composition pour<br />
les algues Turbinaria ornata et Turbinaria conoides récoltées au Sri Lanka (9°N)<br />
(Tableau 4). En Thaïlande, les peuplements de Turbinaria ornata se développent<br />
dans des eaux dont les concentrations en nutriments varient entre 0 et 41 µM de<br />
phosphates et entre 0 et 142 µM de nitrates. Ces variations ne semblent pas être<br />
responsables des différences de croissance, de densité et de fertilité des<br />
peuplements de Turbinaria (Prathep et al., 2007). Payri (2006) constate d’autre part<br />
que les conditions sont probablement moins favorables au développement de l’algue<br />
Turbinaria sur les atolls polynésiens que sur les îles hautes très anthropisées de<br />
l’archipel de la Société où l’apport en nutriments d’origine anthropique est beaucoup<br />
plus important.<br />
A Hawaii, les mouvements de la masse d’eau et l’intensité lumineuse semblent les<br />
principaux facteurs responsables des variations saisonnières de la densité des<br />
peuplements de Turbinaria ornata. La biomasse est maximale pendant l’hiver, quand<br />
l’intensité lumineuse est faible et que les mouvements d’eau s’accélèrent.<br />
Contrairement à d’autres, l’algue Turbinaria montre une bonne résistance mécanique<br />
aux tempêtes. L’influence du facteur « mouvement d’eau » est particulièrement forte<br />
dans les régions où les variations saisonnières des autres paramètres<br />
environnementaux (ex. température) sont faibles (Santellces, 1977).<br />
- 22 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 4 : Teneurs en azote et en phosphore des algues Turbinaria récoltées au Sri<br />
Lanka, en g/kg d’algue sèche, in : Mageswaran & Sivasubramaniam, 1984<br />
Espèce Date de la récolte Teneur en N Teneur en P<br />
Turbinaria conoides Janvier 9,3 0,47<br />
Turbinaria ornata Décembre 13,8 0,25<br />
Schaffelke (1999) a conduit une expérience sur des algues de la grande barrière de<br />
corail en Australie (18°S). Contrairement à Sargassum baccularia ou Padina tenuis<br />
dont le rendement photosynthétique augmente de 30 à 50% quand on ajoute de<br />
l’ammonium ou du phosphate dans le milieu, l’algue Turbinaria ornata ne montre pas<br />
d’augmentation du rendement photosynthétique avec l’augmentation de la<br />
disponibilité en nutriments dans le milieu. Dans les conditions de l’expérience,<br />
l’auteur conclut que les concentrations utilisées comme témoin (0,3 µM pour l’azote ;<br />
0,04 µM phosphates) ne sont pas limitantes pour la croissance de Turbinaria.<br />
Techniques de production<br />
Récolte dans les populations naturelles<br />
En Inde, les algues brunes appartenant au genre Turbinaria constituent une prise<br />
accessoire lors de la récolte des Sargasses. Au total, cela représenterait 300 à 400<br />
tonnes sèches (Seaplant Handbook). Les algues sont récoltées sous forme<br />
d’échouage et sont disponibles toute l’année avec un pic durant les mois de juillet et<br />
août. (Coppen & Nambiar, 1991).<br />
D’après les observations du <strong>CEVA</strong> lors de la mission de collecte en Avril 2011, les<br />
peuplements de Turbinaria peuvent être importants sur la barrière récifale. Les<br />
algues sont relativement abondantes dans la zone des 5 m de fond pour Turbinaria<br />
ornata et dans la zone des 10 m de fond pour Turbinaria decurrens. La seule<br />
objection qui pourrait s’opposer à la récolte de cette algue est qu’elle se trouve dans<br />
une zone de forts courants, rendant les opérations de plongée plus difficiles. La mise<br />
en place d’une récolte raisonnée de ces algues semble toutefois envisageable à<br />
Mayotte. Une étape préalable de cartographie du nombre, de la répartition et de la<br />
taille des peuplements naturels de Turbinaria dans le lagon est cependant<br />
nécessaire.<br />
Culture<br />
Comme pour la Sargasse, une équipe de chercheurs s’est intéressée à la culture de<br />
Turbinaria. Des expériences ont permis de valider la faisabilité de la culture de cette<br />
algue, tant par voie végétative avec régénération du thalle à partir d’un fragment<br />
basal de Turbinaria decurrens, que par voie sexuée avec libération des gamètes,<br />
fécondation et développement du zygote en un nouveau plant chez Turbinaria ornata<br />
(Chennubhotla et al., 1986 ; Chennubhotla, 1988). Cependant, dans les deux cas, la<br />
croissance de l’algue s’est révélée non satisfaisante.<br />
- 23 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Pour l’heure, la majorité de la production de Turbinaria provient de la récolte dans les<br />
populations sauvages. Les techniques de culture de cette algue ne sont pas encore<br />
clairement établies et optimisées. Dans ce contexte, nous pensons que la culture de cette<br />
algue à Mayotte ne peut s’envisager qu’au long terme, après une phase de Recherche et<br />
Développement conséquente.<br />
Dictyota spp.<br />
Rappel : Une des espèces de Dictyota rencontrée à Mayotte et décrite dans la<br />
bibliographie est Dictyota barteyresiana (voir <strong>Tome</strong> 1).<br />
Physiologie de l’algue<br />
Les algues brunes appartenant au genre Dictyota sont généralement difficiles à<br />
identifier. Les espèces montrent peu de différences morphologiques et anatomiques<br />
entre-elles alors que la variabilité au sein de l’espèce est forte. L’espèce la plus<br />
documentée est Dictyota dichotoma qui montre une large distribution géographique<br />
(Hwang et al., 2005), notamment dans l’Océan Indien (Schnetter et al., 1987). Le<br />
cycle de vie de cette algue est constitué de deux générations isomorphes (Figure 12,<br />
Esser, 1982 ; De Clerck et al., date inconnue). A maturité, le sporophyte diploïde<br />
libère des tétraspores (spores groupés par 4) qui germeront en gamétophyte<br />
haploïde (Tronholm et al., 2010 ; Schnetter et al., 1987). L’espèce est remarquable<br />
pour la régularité à laquelle elle libère ses gamètes, à une fréquence bimensuelle. Le<br />
cycle n’étant pas saisonnier, l’algue est présente toute l’année, se développant<br />
souvent comme épiphyte d’autres algues telles que la Sargasse (Trono, 2001).<br />
D’après les observations en Corée et aux Îles Canaries, les populations sont<br />
majoritairement composées de sporophytes. La croissance est maximale pendant le<br />
printemps avec un pic de biomasse observé pendant l’été. La reproduction est<br />
maximale pendant l’été et l’automne en Corée, quand la température de l’eau est la<br />
plus élevée, et pendant l’hiver aux Îles Canaries. L’algue passe la saison froide sous<br />
une forme naine (thalle ≤ 1 cm) voire microscopique (Tronholm et al., 2008 ; Hwang<br />
et al., 2005). En Corée, deux modes de reproduction existent : la voie sexuée<br />
classique et la voie asexuée, dominante dans certaines populations comme sur la<br />
côte Est. Dans ce cas, des plantules se développent sur le thalle-parent à partir d’un<br />
monosporange (Figure 13). Les courants peuvent décrocher le plantule qui se<br />
développe alors sans être fixé au substrat (Hwang et al., 2005). En Inde, la libération<br />
des tétraspores est maximale pour une salinité de 30 ‰ et est accélérée par la<br />
dessiccation (Narashima & Umamaheswara, 1991).<br />
- 24 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 12 : Cycle de vie de Dictyota dichotoma, in : Esser, 1982<br />
Figure 13 : (à gauche) Développement d’une plantule à partir d’un sporange chez<br />
Dictyota dichotoma sensu ; (à droite) Différents cycles de vie observés chez Dictyota<br />
dichotoma en Corée avec A/ le cycle à reproduction majoritairement asexuée et B/ le<br />
cycle classique à reproduction majoritairement sexuée, in : Hwang et al., 2005<br />
Une campagne de prélèvements a permis de mesurer les teneurs en azote et<br />
phosphore dans l’algue Dictyota sp. du récif Little Grecian Reef en Floride (25°N). En<br />
moyenne, les algues contiennent 2,25% MS d’azote N et 0,16% MS de phosphore P.<br />
Les teneurs en nutriments dans l’eau sont détaillées dans le tableau ci-dessous<br />
(Tableau 5). Dans les conditions naturelles, les algues ne sont pas limitées par les<br />
concentrations en azote. En effet, elles ont la capacité de remobiliser l’azote contenu<br />
dans les particules organiques détritiques déposées sur le fond soit 1,5% MS d’azote<br />
au total (Mason, 2004). Kuffner & Paul (2001) observèrent chez Dictyota<br />
barteyresiana des taux de croissance allant de 4 à 8% par jour, confirmés par les<br />
observations de Mason (2004).<br />
- 25 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 5 : Teneurs en phosphates, en nitrates et en ammonium mesurées près du<br />
peuplement de Dictyota dichotoma en Floride, en µM, in : Mason, 2004<br />
Lieu du prélèvement<br />
Teneur en<br />
phosphates<br />
Teneur en<br />
nitrates<br />
Teneur en<br />
ammonium<br />
Près du fond à proximité de<br />
l’algue<br />
Dans la colonne d’eau audessus<br />
de l’algue<br />
0,167 0,459 0,518<br />
0,139 0,269 0,294<br />
Techniques de production<br />
Récolte dans les populations naturelles<br />
L’algue Dictyota, consommée en Asie du Sud-Est et à Hawaii, est récoltée à la main.<br />
Les spécimens fixés aussi bien que dérivants font l’objet d’une collecte. Les algues<br />
sont ensuite utilisées fraîches ou séchées au soleil (De Clerck et al., date inconnue).<br />
A Mayotte, l’algue est abondante mais sa petite taille remet en cause la faisabilité<br />
d’une récolte dans les populations naturelles.<br />
Culture<br />
Il n’existe pas de culture commerciale de Dictyota dans le monde (De Clerck et al.,<br />
date inconnue). Des essais de culture au laboratoire ont été reportés pour l’espèce<br />
Dictyota dichotoma (Russella, 1970 ; Yotsukura, 1995 ; Hwang et al., 2005). Dans le<br />
cas de Hwang et al. (2005), des individus vivants sont récoltés et mis en culture dans<br />
de l’eau de mer stérilisée et enrichie avec le milieu de Provasoli. Les conditions de<br />
culture sont les suivantes : 20 ± 1°C sous une lumière blanche fluorescente avec une<br />
intensité lumineuse de 50-70 µE/m²/s et une photopériode de 14:10LD. Ils réussirent<br />
à induire l’ovulation chez des plants adultes.<br />
Pour l’heure, il semble que la culture de cette algue à Mayotte ne puisse s’envisager<br />
qu’au long terme, après une phase de Recherche et Développement conséquente.<br />
Dictyopteris spp.<br />
Physiologie de l’algue<br />
L’algue brune Dictyopteris sp. est une algue pérennante dont le cycle est constitué de<br />
deux générations isomorphes : le sporophyte et le gamétophyte. (Archipelago wildlife<br />
library, Phillips, 1998). En plus de la reproduction sexuée, plusieurs espèces, telles<br />
que Dictyopteris undulata ou D. divaricata, ont la capacité de se propager par<br />
multiplication végétative (Benson, 1986). Les espèces des mers d’Europe ont un<br />
aspect qui varie au cours de l’année. Les lames bien développées au printemps se<br />
réduisent durant l’été à leur nervure sur laquelle se forment de nouvelles pousses à<br />
l’automne (Floc’h et al., 2006). Aux Philippines, l’espèce Dictyopteris jamaicensis est<br />
présente en abondance de Février à Mai (Trono, 2001). Sur l’île Santa Catalina en<br />
Californie (33°N), le recrutement de la nouvelle génération de Dictyopteris undulata a<br />
généralement lieu en hiver et au début du printemps. La reproduction a lieu 6 à 8<br />
- 26 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
mois après le recrutement, elle est maximale en automne (Benson, 1986). En Israël,<br />
Dictyopteris membranaceae est présente toute l’année, excepté durant la période<br />
Septembre-Novembre. En Août, la température devient trop élevée, entraînant la<br />
désagrégation de l’algue (Friedlander & Ben-Amotz, 1990).<br />
Une étude des algues tropicales des Caraïbes, notamment Dictyopteris justii et<br />
Dictyopteris delicatula, a montré que la croissance est maximale pour des<br />
températures de l’eau comprises entre 25 et 30°C (Pakker et al., 1995). Gaitán-<br />
Espitia (2011) a mis en évidence l’influence de la disponibilité en nutriments dans le<br />
milieu sur la croissance de Dictyopteris delicatula à Tangaka Bay en Colombie<br />
(11°N). La productivité primaire de l’algue est significativement meilleure sur le site<br />
qui se trouve à proximité du déversement des eaux pluviales chargées en nutriments<br />
en comparaison avec un site témoin (24,7 mg C/g MS/h contre 12,3 mg C/g MS/h).<br />
Au contraire, en Israël, Friedlander & Ben-Amotz (1990) ne purent établir de relation<br />
entre la croissance de Dictyopteris membranaceae et la quantité d’azote disponible<br />
dans le milieu (variant de 1 à 20 µM). La croissance est maximale pendant la période<br />
Mai-Juillet (60 à 85% par semaine), quand les intensités lumineuses sont les plus<br />
fortes et que la température est comprise entre 20 et 26°C.<br />
Techniques de production<br />
Récolte dans les populations naturelles<br />
A Hawaii, Dictyopteris plagiogramma ou « limu lïpoa » est traditionnellement utilisée<br />
comme condiment. Elle est récoltée dans les peuplements naturels subtidaux<br />
(Preskitt, 2002 ; Spadling, date inconnue). En France, la récolte de Dictyopteris<br />
membranaceae en plongée est considérée comme difficile (> 80 m). Elle a été<br />
abandonnée au profit de la culture (voir 1.5.2.2) (Moro et al., 2010).<br />
Sur les sites échantillonnés à Mayotte, les algues Dictyopteris spp. ont été observées<br />
couramment, le plus souvent à une profonde d’environ 10 m. Cependant, la petite<br />
taille de l’algue remet en cause la faisabilité d’une récolte dans les peuplements<br />
naturels.<br />
Culture<br />
En France, la société Codif International a mis au point la culture de l’algue<br />
Dictyopteris membranaceae à des fins commerciales (extraction d’un actif utilisé pour<br />
des produits cosmétiques, voir <strong>Tome</strong> 1). L’ensemencement se fait par méthode<br />
directe. Les géniteurs sont choisis parmi des individus mâtures prélevés dans le<br />
milieu naturel. La sporulation est déclenchée en écloserie et les collecteurs sont<br />
ensemencés avec les spores libérés. Les collecteurs sont maintenus en écloserie<br />
jusqu’à ce qu’apparaissent les plantules (Figure 14). Alors, les algues sont<br />
transférées en mer, sur un site de culture de 70 ha dans l’estuaire de la Rance (Moro<br />
et al., 2010).<br />
- 27 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 14 : Culture de Dictyopteris membranaceae a/ collecteurs ensemencés<br />
par les spores de D. membranaceae en écloserie, b/ algues en mer, in : Moro et<br />
al., 2010<br />
En Israël, Friedlander & Ben-Amotz (1990) ont réussi à acclimater l’algue<br />
Dictyopteris membranaceae à la culture en bassin ouvert. L’algue a survécu pendant<br />
9 mois dans le système mis en place (bassin transparent d’une contenance de 36L,<br />
densité 0,4 kg/m², renouvellement en eau continu à un rythme de 24 volumes par<br />
jour, aération et enrichissement en ammonium et phosphate).<br />
Les techniques de culture sont relativement bien établies pour l’espèce Dictyopteris<br />
membranaceae. Par analogie, – Dictyopteris membranaceae n’étant pas décrite à notre<br />
connaissance à Mayotte – la mise en place d’une culture d’une espèce mahoraise de<br />
Dictyopteris peut raisonnablement s’envisager à moyen terme. Une phase préalable de<br />
Recherche et Développement sera nécessaire pour adapter les techniques mises au point<br />
sur D. membranaceae.<br />
Caulerpa racemosa, Caulerpa serrulata et Caulerpa<br />
mexicana<br />
Rappel : D’après la bibliographie, l’espèce Caulerpa peltata est également décrite<br />
aux Comores (voir <strong>Tome</strong> 1).<br />
Physiologie de l’algue<br />
Caulerpa sp. est une algue verte tropicale à sub-tropicale. Elle est constituée d’un<br />
rhizome fixé dans le substrat à partir duquel les frondes se développent (Figure 15)<br />
(Famà et al., 2002). Une étude de Caulerpa paspaloides de Key Largo en Floride<br />
(25°N) a montré que l’énergie de la photosynthèse était préférentiellement allouée au<br />
maintien et à l’élongation du rhizome pendant l’hiver et à l’établissement de nouvelles<br />
frondes pendant l’été (O’Neal & Prince, 1988). Le cycle de vie de Caulerpa sp. est<br />
caractérisé par une seule génération gamétophytique diploïde. La reproduction<br />
sexuée permet la formation de gamètes qui donnent après fécondation un nouveau<br />
gamétophyte (Morrall, 1968 ; Trono, 1988). En plus de la reproduction sexuée, la<br />
Caulerpe a la capacité de se propager par multiplication végétative (Famà et al.,<br />
2002). Cette caractéristique est utilisée pour la culture de Caulerpa lentillifera par<br />
bouturage.<br />
- 28 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 15 : Détail de la structure d’une Caulerpa mexicana collectée par le <strong>CEVA</strong> à<br />
Mayotte<br />
Les algues hawaiiennes de Kaneohe Bay (21°N) Caulerpa racemosa et Caulerpa<br />
sertularioides affichent des ratios N:P très élevés (Tableau 6), suggérant des besoins<br />
très importants en azote pour ces algues (Larned, 1998). Les Caulerpes ont la<br />
capacité d’absorber les nutriments soit par les frondes dans la colonne d’eau soit par<br />
le rhizome dans le sédiment. D’ailleurs, aux Îles Vierges (17°N), le sédiment constitue<br />
la principale source de nutriments pour Caulerpa cupressoides (Williams & Dennison,<br />
1990). Pour cette espèce, la vitesse maximale d’absorption de l’azote est de<br />
8,7 ± 3,0 µmol N/g MS/h à 26°C (Williams & Fisher, 1985). Cette capacité à fixer les<br />
nutriments présents dans le sédiment permet à ces algues de se développer dans<br />
des zones qualifiées d’oligotrophes, i.e. où les concentrations en nutriments dans la<br />
colonne d’eau sont faibles. Par exemple, à Kaneohe Bay à Hawaii, les teneurs en<br />
ammonium, nitrates+nitrites et phosphates dans le sédiment sous les peuplements<br />
de Caulerpa racemosa et C. sertularioides sont respectivement 90, 5,7 et 6,5 fois<br />
plus importantes que dans la colonne d’eau (Tableau 7) (Larned, 1998).<br />
Tableau 6 : Teneurs en azote et en phosphore (en % sec) et ratio N:P des algues<br />
prélevées à Kaneohe Bay à Hawaii, in : Larned, 1998<br />
Espèces N P N:P<br />
Caulerpa racemosa 5,6 ± 3,3 0,08 ± 0,03 148,7:1<br />
Caulerpa sertularioides 12,7 ± 1,1 0,14 ± 0,08 198,9:1<br />
Tableau 7 : Teneurs en ammonium, en nitrites+nitrates et en phosphates (en µM) dans<br />
la colonne d’eau et dans le sédiment à proximité directe des peuplements de Caulerpa<br />
racemosa et Caulerpa sertularioides de Kaneohe Bay à Hawaii, in : Larned, 1998<br />
Colonne d’eau au-dessus du peuplement de<br />
Caulerpes<br />
Sédiment sous le peuplement de<br />
Caulerpes<br />
NH 4 NO 2 + NO 3 PO 4 NH 4 NO 2 + NO 3 PO 4<br />
0,14 ± 0,06 0,13 ± 0,10 0,13 ± 0,11 12,6 ± 12,2 0,74 ± 0,69 0,85 ± 0,83<br />
A Key Largo en Floride (25°N), la croissance de Caulerpa paspaloides est maximale<br />
au printemps et en automne. La température optimale est de 35°C, tandis que la<br />
température létale est de 37-38°C. In situ, les concentrations en azote minéral (0,75 à<br />
- 29 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
1,71 µM selon la saison) et en phosphates (0,04 à 0,09 µM selon la saison) ne sont<br />
pas limitantes pour la croissance de l’algue. Par contre, l’algue est très sensible aux<br />
variations de salinité, même minimes (3‰) (O’Neal & Prince, 1988). Pour Caulerpa<br />
lentillifera aux Philippines, la salinité ne doit pas être en-dessous de 30‰ (Trono,<br />
1988).<br />
Techniques de production<br />
Récolte dans les populations naturelles<br />
En Asie, plusieurs espèces de Caulerpe sont consommées par l’homme. Elles sont<br />
généralement récoltées dans les peuplements naturels, seule l’espèce Caulerpa<br />
lentillifera étant cultivée (Trono, 1988 ; Seaplant Handbook). D’après le site internet<br />
Seaplant Handbook, la récolte est estimée à 10 tonnes par pays soit plus d’une<br />
cinquantaine de tonnes au total (Bangladesh, Japon, Malaysie, Philippines,<br />
Thaïlande, Vietnam).<br />
Sur les sites échantillonnés à Mayotte, l’espèce Caulerpa racemosa était relativement<br />
courante, tandis que Caulerpa serrulata et Caulerpa mexicana étaient moins<br />
présentes. Cette algue a une propension à former des tapis denses et étendus. Nous<br />
pensons qu’une récolte des Caulerpes peut être envisagée à la condition que des<br />
peuplements importants soient clairement identifiés. Une première étape de<br />
cartographie des peuplements de Caulerpa spp. est donc nécessaire.<br />
Culture<br />
L’algue Caulerpa lentillifera est cultivée aux Philippines depuis le début des années<br />
1950 (Trono, 1988). La production est aujourd’hui estimée à 800 tonnes fraîches par<br />
an (Seaplant Handbook). La culture est réalisée par bouturage, dans des bassins<br />
creusés dans le sol au niveau ou légèrement au-dessus du niveau 0 de la mer. Afin<br />
de maintenir un bon niveau de croissance, l’eau des bassins doit être renouvelée<br />
tous les deux jours pour un apport suffisant en nutriments. 100 g d’algues sont<br />
utilisés pour ensemencer 1 m² de bassin. La récolte a lieu 2 à 3 mois après la<br />
plantation. De façon plus anecdotique, Caulerpa lentillifera est cultivée en milieu<br />
ouvert à Catalagan aux Philippines (Trono, 1988). Certaines souches de Caulerpa<br />
racemosa en culture montrent également de bons rendements (McHugh, 2003).<br />
Les techniques de culture étant établies pour Caulerpa lentillifera, la mise en place de la<br />
culture d’une espèce mahoraise de Caulerpe semble envisageable à moyen terme. Une<br />
première étape de Recherche et Développement sera nécessaire pour adapter les<br />
techniques aux espèces mahoraises et éventuellement développer un système de culture<br />
différent (culture en mer plutôt qu’en bassin).<br />
- 30 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Physiologie de l’algue<br />
L’algue rouge Asparagopsis taxiformis possède un cycle de reproduction où<br />
s’alternent trois générations hétéromorphes. Le carposporophyte microscopique est<br />
porté par le gamétophyte femelle. Les carpospores germent en un tétrasporophyte<br />
diploïde aussi appelé Falkenbergia hillebrandii. A ce stade, l’algue ressemble à un<br />
pompon (Figure 16). Les tétraspores donnent alors naissance à de nouveaux<br />
gamétophytes mâles ou femelles. Seule la génération gamétophytique est haploïde.<br />
En plus de la reproduction sexuée, la dissémination et la prolifération de cette algue<br />
sont facilitées par une multiplication végétative importante des gamétophytes et des<br />
tétrasporophytes (DORIS).<br />
Figure 16 : Asparagopsis taxiformis sous sa forme gamétophytique à gauche (photo<br />
prise lors de la mission du <strong>CEVA</strong> à Mayotte) et sous sa forme tétrasporophytique ou<br />
Falkenbergia à droite (Véronique Lamare pour DORIS)<br />
A Hawaii, c’est pendant la saison humique que la croissance d’Asparagopsis<br />
taxiformis est la plus forte (Friedlander et al., 2000). Dans le Sud-Est de l’Inde, la<br />
croissance d’Asparagopsis delilei (synonyme d’Asparagopsis taxiformis) est<br />
maximale de Novembre à Mars (Vasuki et al., 1999). Des expériences d’incubation<br />
en laboratoire ont établi que la température optimale de développement du<br />
Falkenbergia d’Asparagopsis taxiformis est de 25°C pour des souches collectées à<br />
différents endroits du monde, notamment au Vietnam (12°N). Pour les souches<br />
d’Asparagopsis taxiformis isolées aux Caraïbes, la croissance est positive dans un<br />
intervalle de 17-31°C. Les souches du Pacifique supportent des températures<br />
minimales 4 à 8° inférieures (Ni Chualain et al., 2004).<br />
Les espèces d’Asparagopsis taxiformis des Îles Canaries (28°N) contiennent en<br />
moyenne 1,7 ± 0,1 % MS d’azote dans leurs tissus (Garcia-Sanz et al., 2010).<br />
Une expérience conduite en laboratoire sur une souche italienne d’Asparagopsis<br />
taxiformis (40°N) a permis de mettre en évidence l’influence de la disponibilité en<br />
nutriments et en carbone sur la production de l’algue. Il apparaît que l’augmentation<br />
de la concentration en ammonium et en dioxyde de carbone dans le milieu favorise la<br />
croissance (Figure 17). La disponibilité en carbone est le facteur le plus déterminant.<br />
- 31 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Un essai de culture de cette algue sur effluents de ferme piscicole confirme ces<br />
résultats (Figure 18) (Mata et al., 2011).<br />
Figure 17 : effet de l’enrichissement en ammonium et en CO2 sur la production<br />
d’Asparagopsis taxiformis incubée au laboratoire. Conditions : (1) 80 µM NH4+, bullage<br />
à l’air, (2) 80 µM NH4+, bullage au CO2, (3) 160 µM NH4+, bullage à l’air, (4) 160 µM<br />
NH4+, bullage au CO2, In : Mata et al., 2011<br />
Figure 18 : Rendement d’Asparagopsis taxiformis en fonction du taux de<br />
renouvellement en eau lors d’un essai de culture sur effluents piscicoles, In : Mata et<br />
al., 2011<br />
D’autre part, Codomier et al. (1979) in Guiry & Dawes, (1992) ont montré que les<br />
gamétophytes d’Asparagopsis ont besoin d’iode pour leur croissance, une<br />
concentration de 5 µM sous forme d’iodure ou d’iodate de potassium étant optimale.<br />
Techniques de production<br />
Récolte dans les populations naturelles<br />
A Hawaii, l’algue Asparagopsis taxiformis ou « limu kohu » est traditionnellement<br />
consommée par l’homme (Clark, 1990). Dans le district de Pupukea, la récolte est<br />
soumise à certaines règles : les algues doivent être récoltées manuellement, sans<br />
arracher le rhizome. La récolte est limitée à 0,91 kg (2 lbs) essorés par personne et<br />
par jour (Hawaii Administrative Rules, §13-34-1.1).<br />
- 32 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Sur les sites échantillonnés par le <strong>CEVA</strong> lors de la mission de collecte en Avril 2011,<br />
l’algue Asparagopsis taxiformis est présente en quantité abondante dans la zone des<br />
5 m de fond. La mise en place d’une récolte raisonnée de cette algue semble<br />
envisageable. La seule objection qui pourrait se poser est que les peuplements les<br />
plus importants observés se trouvent dans une zone de forts courants, rendant les<br />
opérations de plongée plus difficiles.<br />
Culture<br />
La société bretonne Algues & Mer détient un brevet pour la culture d’Asparagopsis<br />
armata. Le gamétophyte est cultivé par multiplication végétative sur près de 5 ha à<br />
Ouessant. Le bouturage est réalisé chaque année en automne à partir d’algues<br />
sauvages et la récolte a lieu entre février et avril (www.algues-et-mer.com). La<br />
production bretonne serait de 8 tonnes fraîches par an pour 14 km de filières<br />
immergées sur une concession de 2 ha. Les techniques utilisées ont été transférées<br />
à la société Sliogéisc Mhic Dara pour la mise en place de la culture commerciale de<br />
cette algue en Irlande (Kraan & Barrington, 2005). Zemke-White et al. (1999)<br />
reportent également une production d’Asparagopsis armata en Nouvelle-Zélande, la<br />
production ne dépassant pas toutefois 100 kg frais par an sur la période 1994-1995.<br />
Il est également possible de cultiver Asparagopsis armata sous sa forme en pompon<br />
en bassin ou en photobioréacteur clos à terre. Le <strong>CEVA</strong> a participé à la mise au point<br />
de la méthode qui fait d’ailleurs l’objet d’un brevet (Lognone et al., 2005). Les algues<br />
sont mises en suspension et cultivées sous agitation, à une température comprise<br />
entre 10 et 29°C et renouvellement régulier du milieu de culture. Dans ces conditions,<br />
la production peut atteindre 80 g MS/m²/j.<br />
En région froide/tempérée, les techniques de culture sont donc bien établies pour<br />
Asparagopsis armata. De ce point de vue, la mise en place d’une culture d’Asparagopsis<br />
taxiformis à Mayotte semble envisageable à court/moyen terme. Une phase préalable de<br />
Recherche et Développement sera nécessaire pour adapter les techniques connues à<br />
l’espèce et aux conditions climatiques locales.<br />
Hypnea pannosa<br />
Physiologie de l’algue<br />
L’algue rouge Hypnea sp. est largement répandue dans la zone tropicale (Pickering &<br />
Mario, 1999). Son cycle de vie est semblable à celui d’Asparagopsis sp. sauf que<br />
gamétophytes et tétrasporophytes sont identiques (Gonzales, 2006). Le<br />
carposporophyte est porté par le gamétophyte femelle. A maturité, il libère les<br />
carpospores qui germent en tétrasporophytes. A son tour, le tétrasporophyte libère<br />
les spores qui germent en gamétophyte mâle ou femelle. La fécondation des<br />
gamètes donnent alors vie à de nouveaux carposporophytes. En plus de la<br />
reproduction sexuée, Hypnea a la capacité de se propager par multiplication<br />
végétative. Un plant entier peut se reformer à partir d’un fragment d’algue. Il retrouve<br />
également la capacité de se fixer. Certains auteurs considèrent que seule la<br />
génération tétrasporophytique a cette capacité de se multiplier de façon végétative<br />
(Pickering & Mario, 1999). En Inde, les populations de Hypnea musciformis sont<br />
- 33 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
dominées toute l’année par les tétrasporophytes et des individus stériles. Pour<br />
Hypnea valentiae, les tétrasporophytes sont majoritaires pendant les mois d’hiver<br />
tandis que les gamétophytes femelles dominent pendant les mois d’été. Les<br />
gamétophytes mâles sont toujours rares (Rao, 1977 in Pickering & Mario, 1999). Au<br />
Maroc, Hypnea musciformis est fertile toute l’année avec deux pics en été et en<br />
automne. Les tétrasporophytes sont toujours largement dominants (Mouradi et al.,<br />
2008).<br />
L’espèce Hypnea musciformis a fait l’objet de nombreuses études écophysiologiques.<br />
En Floride, on observe que la croissance est faible pendant l’été, tandis que les<br />
algues sont plus grandes et plus abondantes pendant l’hiver. D’autres études<br />
confirment que la croissance de cette algue est corrélée à la température de l’eau.<br />
Par exemple, lors d’expériences de culture en bassin, on constate que la croissance<br />
est forte – environ 20% par jour – quand la température est comprise entre 18 et<br />
24°C et que le milieu est enrichi avec une solution nutritive (N, P) (Pickering & Mario,<br />
1999). Au Maroc, cette espèce présente deux périodes actives de croissance, la<br />
première durant l’été et la seconde de moindre importance pendant l’automne (Figure<br />
19). En Tanzanie, la croissance de Hypnea musciformis est maximale pendant les<br />
mois chauds entre Novembre et Février, quand l’intensité lumineuse est forte et que<br />
les taux de nitrates et de phosphates sont élevés (Mouradi et al., 2008).<br />
Les observations sont différentes pour l’espèce Hypnea pannosa à Mandapam en<br />
Inde où la croissance est meilleure quand la température est faible et que la salinité<br />
est élevée. Pour cette espèce, on constate que la teneur en carraghénanes est plus<br />
forte quand la croissance est élevée (Pickering & Mario, 1999).<br />
Figure 19 : Evolution annuelle de l’aspect morphologique de Hypnea musciformis au<br />
Maroc, In : Mouradi et al., 2008<br />
Techniques de production<br />
Récolte dans les populations naturelles<br />
L’algue Hypnea est récoltée pour l’extraction de ses kappa-carraghénanes. Les<br />
peuplements naturels de Hypnea musciformis sont exploités au Brésil (Pickering &<br />
Mario, 1999). Une évaluation de la biomasse a d’ailleurs été entreprise (Mouradi et<br />
- 34 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
al., 2008). Ces algues sont également récoltées en Birmanie (400 tonnes en 1980,<br />
Win Thin, 1990) et sous forme d’échouage au Sénégal (~100 tonnes par an, Seaplant<br />
Handbook). Une étude des gisements naturels marocains de Hypnea musciformis a<br />
permis de formuler quelques préconisations pour la mise en place d’une récolte<br />
raisonnée de cette algue. La meilleure période d’exploitation serait l’été. Il est<br />
conseillé de limiter la période de récolte à deux mois pour permettre à l’algue de<br />
croître et de se reproduire afin de reconstituer les champs (Mouradi et al., 2008).<br />
Malgré tout, un marché régulier des Hypnea de cueillette ne semble pas clairement<br />
établi (Seaplant Handbook).<br />
Lors de la mission du <strong>CEVA</strong> à Mayotte, Hypnea pannosa a été couramment observée<br />
sur les sites échantillonnés. Cependant, la récolte de cette espèce paraît peu<br />
envisageable tant les algues sont imbriquées dans les coraux.<br />
Culture<br />
L’algue Hypnea peut également être cultivée sur des cordes suspendues en mer<br />
(Seaplant Handbook, Deboer, 1981). Les techniques ont été mises au point<br />
expérimentalement mais l’exploitation commerciale de cette algue repose<br />
essentiellement sur les algues de cueillette. Les techniques de culture validées sont<br />
le bouturage, le captage naturel et l’ensemencement direct par des spores, les<br />
supports de culture étant fixés directement dans le substrat (Pickering & Mario,<br />
1999). La culture de cette algue est généralement conduite à de faibles profondeurs<br />
pour lui permettre de recevoir suffisamment de lumière pour sa croissance.<br />
A Mayotte, les zones peu profondes qui pourraient se prêter à la culture de Hypnea sont<br />
peu nombreuses. De ce point de vue, nous estimons que la mise en place de la culture de<br />
cette algue ne peut s’envisager qu’à moyen terme. Une phase préalable de Recherche et<br />
Développement sera nécessaire pour évaluer la faisabilité de la culture en structure<br />
flottante.<br />
- 35 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
2. Microalgues candidates à la valorisation<br />
Contrairement aux macroalgues qui peuvent faire l’objet d’une récolte dans les<br />
peuplements naturels, le seul moyen de production pour les microalgues est la culture.<br />
Théoriquement, toutes les microalgues peuvent être cultivées. Elles se reproduisent par<br />
multiplication végétative. La cellule-mère se divise et donne naissance à deux cellulesfilles<br />
en un temps de doublement plus ou moins long. Le défi consiste simplement à<br />
déterminer les conditions optimales de culture pour obtenir la meilleure productivité.<br />
Nous décrivons ci-dessous les techniques utilisées et applicables à toutes les espèces,<br />
notamment celles identifiées à Mayotte comme candidates à la valorisation. Le choix de<br />
la technique dépend des objectifs attendus, des conditions du milieu et des moyens<br />
mobilisables. Depuis la culture extensive par enrichissement de bassins à ciel ouvert<br />
jusqu’aux systèmes clos plus performants de type photobioréacteur (PBR), tous les<br />
intermédiaires existent, avec des coûts de production très variables selon le modèle<br />
retenu. La culture en photobioréacteur permet une amélioration de la productivité et de la<br />
qualité de la production (diminution du risque de contamination) mais les coûts restent<br />
très élevés et de nouvelles problématiques techniques en lien avec ce système<br />
apparaissent.<br />
Les étapes de la culture uni‐algale de masse<br />
La culture de masse de microalgues est généralement conduite de façon monospécifique<br />
ou uni-algale. L’objectif est de produire une biomasse importante d’une seule espèce en<br />
un minimum de temps. Le schéma ci-dessous présente les étapes de cette technique<br />
(Figure 20), les étapes étant exposées en détail dans la suite du paragraphe.<br />
Figure 20 : Principe de la culture uni-algale de masse<br />
Il est également possible de cultiver un consortium de plusieurs souches de<br />
microalgues. Le principe décrit ci-dessus s’applique toujours. La difficulté sera de<br />
définir les conditions optimales de croissance à l’échelle du consortium et pas à<br />
l’échelle de l’espèce isolée.<br />
Conservation des souches<br />
En premier lieu, la culture uni-algale nécessite l’obtention et la conservation de<br />
souches de culture clonées sur milieu stérile liquide ou gélosé. Les souches sont<br />
conservées dans des enceintes thermo-régulées et éclairées où les conditions<br />
- 36 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
freinent leur développement. La qualité de ces souches est contrôlée périodiquement<br />
et elles sont entretenues régulièrement par repiquage (Figure 21).<br />
Figure 21 : Entretien de souches de microalgues (FAO)<br />
Amplification de la souche<br />
La souche est le point de départ d’une montée en volume progressive en écloserie<br />
pour obtenir un volume élémentaire qui servira à ensemencer les enceintes de<br />
production, i.e. les bassins ou les photobioréacteurs selon la méthode retenue<br />
(Figure 22 et Figure 23). A cette étape, une densité relativement élevée de la souche<br />
doit être maintenue dans le milieu, pour freiner le développement des contaminants<br />
(microalgues compétitrices). Les milieux sont agités par bullage afin de favoriser les<br />
échanges gazeux et l’accès des cellules à la lumière.<br />
Figure 22 : Montée progressive en volume d’une souche de microalgue<br />
Figure 23 : Culture de Chlorella sp. au <strong>CEVA</strong>, petits volumes (à gauche) et volume<br />
élémentaire (à droite)<br />
Production en grands volumes<br />
- 37 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
A ce stade, le risque principal est la contamination du milieu par d’autres algues<br />
compétitrices. Ce risque est limité pour les microalgues extrêmophiles qui supportent<br />
des conditions de culture non favorables au développement des espèces<br />
compétitrices. C’est les cas par exemple de Dunaliella salina qui supporte des<br />
salinités très élevées. Pour les espèces plus vulnérables et les sites les plus exposés<br />
aux contaminations (ex. courants d’air, végétation proche), il est nécessaire de<br />
protéger au maximum la culture des contacts avec l’environnement extérieur.<br />
La productivité du système dépend de plusieurs facteurs que le cultivateur devra<br />
adapter à chaque espèce ou consortium d’espèces et à chaque environnement :<br />
température<br />
pH<br />
salinité<br />
agitation<br />
intensité lumineuse et photopériode<br />
apport en éléments nutritifs dont N, P et K entre autres. Si l’apport en éléments<br />
nutritifs permet d’améliorer la productivité de la souche, une carence peut être<br />
appliquée volontairement pour stimuler la production de certains composés.<br />
apport en CO 2 . Le CO 2 , qui est la source carbonée de la photosynthèse, permet<br />
non seulement de maximiser la croissance mais aussi de réguler le pH du système<br />
qui augmente naturellement avec la photosynthèse.<br />
fréquence du renouvellement d’eau dans le système.<br />
apport en carbone organique (ex. sucres) dans le cas des cultures en mode<br />
hétérotrophe (i.e. sans lumière).<br />
Production en milieu ouvert : bassin ou raceway<br />
Ce sont les systèmes les plus utilisés à ce jour pour la production de microalgues<br />
commerciales, du fait de leur simplicité d’utilisation et de leur faible coût. Autrefois,<br />
les bassins utilisés pour la culture de microalgues étaient de forme circulaire,<br />
permettant de limiter la consommation d’énergie pour l’agitation du système.<br />
Aujourd’hui, la forme de bassin efficace et peu coûteuse la plus répandue est le<br />
raceway (Figure 24). L’apport en CO 2 se fait généralement grâce à l’agitation de la<br />
culture par une roue à aubes. Dans le cas où l’espèce cultivée est fragile, il peut être<br />
nécessaire de couvrir le bassin pour protéger la culture des contaminations et des<br />
intempéries.<br />
- 38 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 24 : Raceways de la société israélienne The Israel Electric Co/Seambiotic<br />
Ltd (à gauche) et schéma d’un raceway (à droite)<br />
Des systèmes plus rudimentaires consistent simplement à fertiliser les étangs<br />
naturels pour stimuler le développement du consortium de microalgues naturellement<br />
présentes ou volontairement ensemencées dans le milieu.<br />
Dans certains cas, microalgues et macroalgues sont cultivées conjointement dans<br />
ces bassins, sous des conditions bénéficiant aux deux productions. C’est le cas par<br />
exemple de la microalgue Odontella qui est co-cultivée avec Chondrus crispus dans<br />
les raceways de la société Innovalg.<br />
L’un des points critiques de la production en milieu ouvert est la récolte. Celle-ci<br />
passe par la floculation des microalgues. Il existe des techniques d’autofloculation<br />
des bassins en jouant notamment sur le pH du milieu de culture avec un agent<br />
cationique. (Vandamme et al, 2009).<br />
Les inconvénients de la production de microalgues en système ouvert sont listés<br />
dans le Livre Turquoise paru en 2011 (Person et al., 2011).<br />
Production dans le cadre de STEP ou CET :<br />
La capacité d’épuration des plantes et plus particulièrement des algues microphytes<br />
et macrophytes est mise en pratique depuis des siècles dans des systèmes de<br />
lagunages associés à l’épuration des eaux usées de nombreuses villes.<br />
Parallèlement la phytoremédiation est désormais proposé en accompagnement, des<br />
unités de valorisation de déchets (ou co-produits) issus des activités humaines, qu’ils<br />
soient d’origine industrielle, agricole (production de gaz à effet de serre, calories,<br />
effluents) ou du traitement direct des déchets et eaux usées (Station d’épuration –<br />
Step, unités de méthanisation ou centre d’enfouissement technique – CET).<br />
C’est ce modèle qui est proposé par la société Bioalgostral à la Réunion sur la base<br />
d’un brevet détenu par la société. L’objectif étant de réduire le temps nécessaire à<br />
parfaire le traitement des eaux usées et de fait, augmenter le rendement d’épuration<br />
(exprimé en eq.hab).<br />
- 39 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 25 : processus industriel pour l’épuration des eaux usées<br />
Le schéma suivant reprend le processus lié à l’épuration des eaux usées, et met en<br />
avant les « intrants » nécessaires pour faire fonctionner le système et les « coproduits<br />
» élaborés avant la production d’eau potable, objectif du processus.<br />
Le schéma suivant montre comment à partir de deux coproduits (captation de co 2 et<br />
eau riche en azote et phosphore propre à une utilisation agricole) il est possible par<br />
une culture de microalgues (dans le cas présent les algues Cyclotella sp et<br />
Chaetoceros sp. présentent à Mayotte) d’aboutir à la production de floculant (chitosan<br />
naturellement présent dans ces deux microalgues) naturel (non neurotoxique), intrant<br />
indispensable à l’épuration des eaux usées.<br />
Figure 26 : production d’algues riche en polymère floculant à partir de coproduits de Step<br />
Production en milieu fermé : photobioréacteur<br />
Une autre méthode vise à isoler complètement la culture de l’environnement extérieur<br />
tout en maximisant l’accès à la lumière. Il s’agit du photobioréacteur.<br />
Là encore de nombreux systèmes existent. Les photobioréacteurs les moins coûteux<br />
sont de simples poches souples. Les systèmes plus sophistiqués sont constitués de<br />
tubes rigides translucides, disposés verticalement ou horizontalement (Figure 27).<br />
Certains modèles sont entièrement automatisés permettant un monitoring fin des<br />
différents paramètres contrôlant la croissance.<br />
- 40 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 27 : Différents modèles de photobioréacteurs (sources : FAO, à gauche ;<br />
Conseil National de la Recherche du Canada, à droite)<br />
En plus de leur coût élevé, les inconvénients des photobioréacteurs résident<br />
notamment dans les questions d’échanges gazeux, de surchauffe (effet de serre), de<br />
salissures des parois internes et d’accumulation de l’oxygène produit lors de la<br />
photosynthèse à des niveaux inhibiteurs.<br />
Production en mode hétérotrophe<br />
Certaines microalgues ont la capacité de se développer sans lumière, par<br />
hétérotrophie. Elles utilisent le glucose ou d’autres substrats carbonés comme source<br />
d’énergie. La plupart du temps, ces espèces sont également photo-autotrophes et<br />
peuvent passer d’un mode à l’autre selon les conditions du milieu. Ces espèces<br />
peuvent être cultivées selon un mode hétérotrophe strict ou selon un mode<br />
mixotrophe qui combine les deux modes (Person et al., 2011).<br />
La culture en mode hétérotrophe est réalisée en fermenteur (Figure 28) selon des<br />
procédés biotechnologiques classiques. Cette technologie est généralement utilisée<br />
pour la production de produits à haute valeur ajoutée.<br />
Les avantages et les inconvénients de ce système sont listés dans le Livre Turquoise<br />
paru en 2011 (Person et al., 2011).<br />
- 41 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 28 : Fermenteur industriel chez Roquette in : Person et al., 2011<br />
Récolte<br />
La récolte peut être totale ou partielle. Elle peut aussi être réalisée de façon continue<br />
ou discontinue. Elle a pour objectif de séparer les algues du milieu de culture. C’est<br />
un procédé coûteux qu’il faut bien dimensionner financièrement.<br />
Il existe de nombreuses techniques de récolte, notamment (Person et al., 2011) :<br />
Sédimentation<br />
Floculation-décantation<br />
Flottation<br />
Centrifugation<br />
Filtration frontale (tamisage et séparation par exclusion de taille). Cette technique<br />
n’est valable que pour les cellules de grande taille > 40 µm. C’est le cas de la<br />
Spiruline qui est récoltée par simple filtration sur tamis.<br />
Filtration tangentielle membranaire (cellules < 40 µm).<br />
Il n’existe pas de procédé universel, le choix de la technique se fera en fonction de<br />
l’espèce à récolter, de l’objectif d’humidité finale de la biomasse à atteindre, du coût,<br />
du volume à traiter, etc. A ce jour, la floculation et la centrifugation restent les<br />
procédés les plus employés.<br />
Généralement, la récolte se prolonge jusqu’à contamination du milieu ou baisse de la<br />
productivité ou de la qualité de la souche en culture. Une mise à sec et une<br />
décontamination est alors réalisée avant remise en eau et réensemencement.<br />
Focus sur les microalgues candidates<br />
Microalgues dont la culture peut être envisagée à court terme<br />
Pour Chlorella sp., Chlamydomonas sp., Scenedesmus sp., Navicula sp., et<br />
Chaetoceros sp., la mise en place d’une culture à Mayotte peut être envisagée à<br />
court terme. En effet, ces microalgues font déjà l’objet d’une culture à l’échelle<br />
commerciale. Les techniques établies devront simplement être adaptées aux variétés<br />
et aux conditions locales. De plus, la majorité d’entre elles sont considérées comme<br />
faciles à cultiver voire robustes (Tableau 8). Les problèmes éventuels de<br />
- 42 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
contamination seront donc limités, assurant une plus grande facilité de mise en<br />
œuvre de la production.<br />
Tableau 8 : Microalgues cultivables à court terme<br />
Espèce ou Taxon<br />
Commentaires & Références<br />
- C’est la deuxième microalgue la plus cultivée au<br />
monde, derrière la Spiruline. Environ 2000 tonnes<br />
sèches sont produites par an (Spolaore et al., 2006)<br />
- Espèce robuste, facile à cultiver et à maintenir en<br />
bassin ouvert (Chaumont, 1993 ; Quilliam, 2011)<br />
Chlorella sp.<br />
- Espèce qui supporte les fortes concentrations en<br />
nutriments, limitant les risques de contamination<br />
(Milledge, 2011)<br />
- Exemples de producteurs : Tawain Chlorella Industries<br />
(Taïwan), Chlorella Industry, Nihon Chlorella (Japon),<br />
Sewon (Corée), Sun Chlorella Indonesia<br />
Manufacturing Corporation (Indonésie), Taïwan<br />
Chlorella (Chine)<br />
- Navicula sp cultivée en bassin ouvert en Israël par la<br />
société Seambiotic (www.seambiotic.com). Recyclage<br />
des gaz industriels d’une usine d’électricité à charbon.<br />
Navicula sp.<br />
Chlamydomonas sp.<br />
Scenedesmus sp.<br />
Chaetoceros sp.<br />
- Navicula incerta considérée comme relativement facile<br />
à cultiver (Kang et al., 2011)<br />
- Production de Navicula en écloserie d’ormeaux<br />
(Lavens & Sorgeloos, 1996) mais la culture semble<br />
limitée à de petits volumes (process type laboratoire<br />
plutôt qu’industriel) (Ronquillo & Ronquillo, 2010)<br />
- Espèce facile à cultiver, avec des techniques peu<br />
coûteuses (Wagner, 2010)<br />
- Chlamydomonas acidophila, espèce extrêmophile qui<br />
supporte des pH très faibles moins de problèmes<br />
de contamination (Bernard et al., 2010)<br />
- Espèce robuste, facile à cultiver et à maintenir en<br />
bassin ouvert (Chaumont, 1993 ; Quilliam, 2011)<br />
- Une des microalgues les plus cultivées pour<br />
l’aquaculture (Spolaore et al., 2006 (80) )<br />
- Pas d’avantage sélectif, il est préférable de la cultiver<br />
en système clos (Milledge, 2011 (83) )<br />
Bien que la Spiruline Arthrospira plantensis ne soit pas décrite à ce jour à Mayotte, la<br />
culture de cette microalgue peut également être envisagée – à court terme – à<br />
Mayotte. Cette cyanobactérie d’eau douce est la microalgue la plus cultivée dans le<br />
monde. C’est une algue extrêmophile qui supporte des pH élevés et de fortes<br />
- 43 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
concentrations en bicarbonates. Dans ces conditions, les contaminations par des<br />
algues compétitrices sont rares et la culture est généralement conduite en milieu<br />
ouvert. De plus, elle a de faibles besoins en eau et supporte un milieu légèrement<br />
saumâtre (~ 70% eau douce + 30% eau de mer). La fréquence du renouvellement<br />
d’eau peut donc être réduite. Sa richesse en protéines lui confère un atout nutritionnel<br />
qui pourrait être valorisé pour des usages alimentaires ou nutraceutiques.<br />
Microalgues dont la culture ne peut être envisagée qu’à moyen terme<br />
Pour Oscillatoria sp., Anabaena sp., Nitzschia sp., Cyclotella sp., Ankistrodesmus sp.<br />
et Botryococcus braunii, la mise en place d’une culture à Mayotte est envisageable,<br />
mais plutôt dans un second temps. Des essais de culture ont été conduits sur ces<br />
algues à l’échelle laboratoire voire pilote mais rarement à des fins commerciales<br />
(Tableau 9). D’autre part, ces espèces ne présentent pas d’avantage sélectif<br />
particulier et leur culture ne pourra raisonnablement être envisagée que dans des<br />
systèmes clos ou tout du moins protégés des contaminations.<br />
Tableau 9 : Microalgues cultivables à moyen terme<br />
Espèce ou Taxon<br />
Oscillatoria sp.<br />
Anabaena sp.<br />
Cyclotella sp.<br />
Nitzschia sp.<br />
Botryococcus braunii<br />
Ankistrodesmus sp.<br />
Commentaires & Références<br />
- Essais de culture d’Oscillatoria sp. à l’échelle<br />
laboratoire (Chen et al., 2009) et pilote (Mohan et al.,<br />
2010)<br />
- Essais de culture d’Anabaena sp en raceway de 300L<br />
(Chen et al., 2009)<br />
- Essais de culture de Cyclotella en raceways de 100<br />
m², 200 m² et 1000 m² (Jarvis, 2008)<br />
- Production de Nitzschia en écloserie d’ormeaux<br />
(Lavens & Sorgeloos, 1996 ) mais la culture semble<br />
limitée à de petits volumes (process type laboratoire<br />
plutôt qu’industriel) (Ronquillo & Ronquillo, 2010)<br />
- Des cultures commerciales de Botryococcus braunii<br />
sont réalisées et prennent place dans différentes pays<br />
(Association of Biotechnology and Pharmacy, 2010)<br />
- Ne fait pas partie des espèces décrites par Spolaore<br />
et al. (2006) comme produites massivement<br />
- La culture de cette espèce est réalisable mais nous<br />
émettons un doute quant à sa mise en œuvre à court<br />
terme<br />
- Ankistrodesmus braunii est une espèce facile à<br />
cultiver (www.engg.uaeu.ac.ae/)<br />
- Essais de culture d’Ankistrodesmus gracilis en<br />
laboratoire, à grande échelle : 250 et 850L (Sipauba-<br />
Tavares & Pereira, 2008)<br />
- 44 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
3. Productivité potentielle des algues candidates à la valorisation<br />
Le tableau ci-dessous compile les valeurs de productivité connues ou potentielles pour les<br />
algues candidates à la valorisation. Seules quelques espèces font l’objet d’une production<br />
industrielle. Pour celles-ci, les valeurs de productivité peuvent être considérés comme fiables<br />
et servir de base pour des calculs de production. Pour les autres espèces, et en particulier<br />
pour les microalgues, les valeurs de productivité sont à utiliser avec plus de précaution. En<br />
effet, elles résultent le plus souvent de travaux de recherche conduits dans des volumes plus<br />
petits et sur des laps de temps généralement assez courts. L’extrapolation de ces données<br />
de productivité « instantanée » est donc délicate.<br />
Tableau 10 : Productivités connues ou potentielles des espèces d’algues mahoraises<br />
candidates à la valorisation – ou d’autres espèces du même genre – et de la spiruline<br />
Pays<br />
Contexte d’obtention<br />
des résultats<br />
Productivité<br />
Réf.<br />
Padina boergesenii Inde Recherche 2-3 kg frais/m² 1<br />
Sargassum sp. 32-66 tonnes sec/ha/an 2<br />
Sargassum wightii<br />
Inde<br />
Recherche (culture en<br />
mer sur long-lines)<br />
3,5 kg/m/an 9<br />
Dictyota bartayresiana Guam (USA) Recherche 40-80 mg/g/jour 8<br />
Dictyopteris sp. France Culture commerciale<br />
(Société CODIF interrogée,<br />
en attente d’un retour)<br />
15<br />
Caulerpa lentillifera Philippines Ferme de 400 ha 12-15 tonnes frais/ha/an 3<br />
France Société Algues & Mer 4 tonnes frais/ha/an 4<br />
Asparagopsis armata<br />
Portugal<br />
Recherche (culture en<br />
bassin sur effluents<br />
piscicoles)<br />
71-128 g sec/m²/jour<br />
(selon la saison)<br />
14<br />
Asparagopsis taxiformis<br />
Portugal<br />
Recherche (culture en<br />
bassin sur effluents<br />
piscicoles)<br />
118 g sec/m²/jour 14<br />
Inde<br />
Recherche (culture en<br />
mer pendant 21 mois)<br />
8-400 g frais/m/25 jours,<br />
selon la saison<br />
10<br />
Hypnea musciformis<br />
Brésil<br />
Recherche (culture en<br />
mer)<br />
0,54 kg frais/m/mois 11<br />
Brésil<br />
Recherche (culture en<br />
mer)<br />
0,94-9,69 g sec/m²/jour 12<br />
- 45 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Corse<br />
Recherche (culture en<br />
bassin)<br />
340 g frais/m²/jour soit<br />
1241 tonnes frais/ha/an<br />
13<br />
Chlorella vulgaris 5,7-9,5 kg/ha/jour 5<br />
Chlorella emersonii 9,1-9,7 kg/ha/jour 5<br />
Chlorella sp1 16-25 kg/ha/jour 5<br />
Chlorella sp2 35-139 kg/ha/jour 5<br />
Chlorella pyrenoidosa<br />
Recherche (en bassin<br />
de 3,5 m²)<br />
131-141 kg/ha/jour 6<br />
725-1300 kg/ha/jour 5<br />
Scenedesmus sp. 24-135 kg/ha/jour 5<br />
Botryococcus braunii 30 kg/ha/jour 5<br />
Ankistrodesmus sp 115-174 kg/ha/jour 5<br />
Cyclotella sp.<br />
Recherche (en bassin<br />
de 3,5 m²)<br />
260-376 kg/ha/jour 6<br />
Nitzschia sp. 88-126 kg/ha/jour 5<br />
Chaetoceros gracilis<br />
Chaetoceros sp.<br />
Recherche (en bassin<br />
de 3,5 m²)<br />
Recherche (en bassin<br />
de 3,5 m²)<br />
225-291 kg/ha/jour 6<br />
226-243 kg/ha/jour 6<br />
Anabaena sp.<br />
Recherche (culture en<br />
bassin ouvert)<br />
94(hiver)-235(été)<br />
kg/ha/jour<br />
7<br />
Spiruline (A. platensis) 15-510 kg/ha/jour 5<br />
Spiruline (A. maxima) 250 kg/ha/jour 5<br />
Références : (1) Ganesan et al., 1999 ; (2) van Hal J.W. et al., 2011 ; (3) Biological Vietnam Seafood,<br />
2010 ; (4) Kraan & Barrington, 2005 ; (5) Mata et al., 2010 ; (6) Sheehan et al., 1998 ; (7) Florencio,<br />
2011 ; (8) Kuffner & Paul, 2001 ; (9) Kaladharan & Jayasankar, date inconnue ; (10) Ganesan et al.,<br />
2006 ; (11) Berchez et al., 1993 ; (12) Wallner et al., 1992 ; (13) Mollion, 1984 ; (14) Mata & Santos,<br />
2010 ; (15) Moro et al., 2010.<br />
Pour les microalgues, une autre approche tenant compte du rendement photosynthétique<br />
maximum théorique permet d’évaluer la productivité potentielle selon la localisation du site<br />
de production (Figure 29) ou selon la technologie de production de biomasse (Figure 30).<br />
D’après Hartmann et al. (2011), la productivité maximale raisonnable pour une microalgue<br />
cultivée en raceway est de 12 à 20 grammes secs par m² et par jour.<br />
- 46 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Figure 29 : Carte de la productivité potentielle de microalgues en tonnes sèches/ha/an,<br />
considérant une efficacité photosynthétique de 5 % (Tredici, 2010 in Flammini, 2011)<br />
Figure 30 : Positionnement des technologies solaires de production de biomasse microalgale<br />
(productivité surfacique exprimée en tonnes de matière sèche par hectare et par an). In :<br />
Pruvost et al. 2010<br />
- 47 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
4. Etat du marché des algues candidates à la valorisation<br />
Alors que la diversité algale est immense, seules quelques espèces font l’objet d’une<br />
production et d’un commerce véritable dans le monde. De manière générale, les données de<br />
marché des algues sont difficiles d’accès et souvent estimées donc inexactes. Pour la<br />
plupart des algues identifiées à Mayotte et retenues comme candidates à la valorisation, les<br />
données de marché sont rares voire inexistantes et/ou anciennes (Tableau 11). Pourtant, de<br />
nombreux produits manufacturés intègrent des algues dans leur composition (voir <strong>Tome</strong> 1 ou<br />
Tableau 12, pour quelques exemples de produits cosmétiques), mais les prix de la matière<br />
première algale en tant que telle sont rarement dévoilés. C’est le cas notamment des<br />
microalgues-fourrage telles que Chaetoceros sp. ou Navicula sp. qui sont rarement<br />
commercialisées en tant que tel mais le plus souvent cultivées en interne dans les<br />
entreprises aquacoles. Des informations sont disponibles sur les prix des inoculums qui<br />
servent à démarrer les cultures en batch mais elles ne renseignent pas sur la valeur<br />
marchande finale de ces microalgues.<br />
Une opportunité de s’implanter sur un marché à faible concurrence se présente donc pour<br />
Mayotte. Les algues candidates pourront revendiquer une certaine originalité, avec toutefois<br />
quelques espèces plus connues telles que Sargassum sp., Caulerpa sp. ou Hypnea<br />
pannosa. Au contraire, pour les microalgues Chlorella sp. et Arthrospira platensis (Spiruline,<br />
non identifiée à ce jour à Mayotte), le marché est plus clairement établi et les acteurs<br />
relativement bien connus (ex. liste des producteurs de Chlorelle dans <strong>Tome</strong> 1).<br />
Enfin il conviendra d’étudier s’il existe une tradition ancienne pour certains groupes<br />
ethniques de la sous régions (Mayotte, Comores, Madagascar, La Réunion, Maurice) de<br />
consommer des algues comme légumes ou ingrédients afin de permettre l’ajout de ces<br />
espèces dans la liste positive des algues alimentaires françaises comme cela vient d’être fait<br />
en métropole pour l’algue brune Alaria esculenta.<br />
- 48 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 11 : Caractéristiques du marché des algues mahoraises candidates à la valorisation – ou d’autres espèces du même genre – et de la<br />
spiruline (actualisé le 20 mai 2012)<br />
Année<br />
Pays<br />
Tonnes<br />
/an<br />
Type Prix de vente Réf.<br />
Padina sp.<br />
2012 Turque (Fournisseur HEPASAR interrogé via alibaba.com, en<br />
attente d’un retour)<br />
2012 Indonésie 500 Poude Euro 7000/tonne CiF France<br />
8<br />
1980 Birmanie 1000 sec 2<br />
1995 Indes 2249 sec 4<br />
1995 Philippines 5000 sec 4<br />
1995 Vietnam 400 sec 4<br />
Sargassum sp.<br />
1986 Bangladesh 1,5 5<br />
1987 Bangladesh 1 5<br />
1988 Bangladesh 1 5<br />
1989 Bangladesh 2 5<br />
1990 Vietnam 100 sec 5<br />
1999 Inde USD 51-58/tonnes (base 1999) 14<br />
- 49 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Année<br />
Pays<br />
Tonnes<br />
/an<br />
Type Prix de vente Réf.<br />
2012 Indonésie<br />
USD 350-390/tonne frais<br />
USD 300-400/tonne sec (pour des applications<br />
alimentaires et industrielles)<br />
8<br />
Sargassum sp.<br />
2012 Vietnam sec<br />
USD 300-800/tonne, selon la taille du broyage et la<br />
qualité des algues (algues de qualité pour des<br />
applications alimentaires, qualité standard pour<br />
des applications agricoles type fertilisant ou<br />
fourrage)<br />
8<br />
2012 Chine sec<br />
USD 0,5-0,6/kg (extrait de sargasse en poudre)<br />
USD 13-20/kg (feuilles de sargasse grillée type<br />
« nori »)<br />
8<br />
2012 Bahamas sec USD 225-300/tonne sec 8<br />
Turbinaria ornata 1995 Indes 307 sec 4<br />
Turbinaria sp. 1999 Inde USD 51-58/tonnes (base 1999) 14<br />
Dictyopteris sp. 2012 France<br />
extrait<br />
liquide<br />
(Société CODIF qui commercialise un extrait de<br />
Dictyopteris interrogée, en attente d’un retour)<br />
16<br />
Caulerpa racemosa 1989 Bangladesh 1,5 5<br />
- 50 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Année<br />
Pays<br />
Tonnes<br />
/an<br />
Type Prix de vente Réf.<br />
1995 Philippines 810 sec 4<br />
Caulerpa sp.<br />
1986 Bangladesh 0,5 5<br />
1987 Bangladesh 1 5<br />
1988 Bangladesh 1,5 5<br />
Caulerpa lentillifera<br />
2012 Philippines frais<br />
USD 0,2/kg (acheté au récoltant)<br />
USD 2,30/kg (vendu au consommateur, pour<br />
alimentation)<br />
9<br />
2012 Vietnam frais USD 10-13/kg 8<br />
1980 Birmanie 400 sec 2<br />
1986 Bangladesh 1,5 5<br />
Hypnea pannosa<br />
1987 Bangladesh 2 5<br />
1988 Bangladesh 3 5<br />
1989 Bangladesh 3 5<br />
2012 Bangladesh sec<br />
(Fournisseur BANGLADESH SM ENTERPRISE<br />
interrogé via alibaba.com, en attente d’un retour)<br />
8<br />
- 51 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Année<br />
Pays<br />
Tonnes<br />
/an<br />
Type Prix de vente Réf.<br />
2006 Monde 2000 sec 3<br />
1999 Monde sec USD 25/kg 6<br />
2007 Allemagne sec USD 68/kg 7<br />
2007 Chine sec USD 10/kg 7<br />
Chlorella sp.<br />
2008 France sec USD 36/kg (poudre micronisée) 11<br />
2008 USA USD 50/kg (complément alimentaire) 15<br />
2010 sec USD 47/kg (consommation humaine) 10<br />
2010 frais USD 66/L (aquaculture) 10<br />
2012 Chine sec USD 16-35/kg (poudre bio) 8<br />
Chlamydomonas sp. 2008 USA USD 50/kg (complément alimentaire) 15<br />
Scenedesmus obliquus 2012 Pays-Bas<br />
(Fournisseur CRASSUS ADVICE4You interrogé via<br />
alibaba.com, en attente d’un retour)<br />
8<br />
Botryococcus braunii 2012 USA sec USD 50-100/kg (poudre pure) 8<br />
Nitzschia sp. 2008 USA frais USD 70/L (aliment aquaculture) 15<br />
- 52 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Année<br />
Pays<br />
Tonnes<br />
/an<br />
Type Prix de vente Réf.<br />
1999 Monde sec USD 10/kg 6<br />
2003 Tchad sec<br />
USD 1,12/kg (bol de Dihé = préparation de<br />
spiruline séchée pour alimentation humaine)<br />
13<br />
2006 Monde 3000 sec 3<br />
2007 sec USD 5/kg 7<br />
2008 Chili 6000 humide 1<br />
Spiruline<br />
2008 USA USD 50/kg (complément alimentaire) 15<br />
2011 France sec USD 7-14/kg 11<br />
2012 Chine sec USD 9-11/kg (poudre bio) 8<br />
2012 Hawaii sec USD 20-29/kg (complément alimentaire) 8<br />
2012 France sec USD 208-260/kg (complément alimentaire) 12<br />
2012 France frais<br />
USD 140-156/L (extrait liquide de spiruline fraîche<br />
concentré en phycocyanine)<br />
12<br />
Références : (1) Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile, 2010 ; (2) Win Thin, 1990 ; (3) Milledge, 2010 ; (4) Zemke-White & Ohno, 1999 ; (5) <strong>CEVA</strong>, 1990 ;<br />
(6) Borowitzka, 1999 ; (7) Carlsson et al., 2007 ; (8) www.alibaba.com ; (9) Oger, 2012 ; (10) Person et al., 2011 ; (11) donnée <strong>CEVA</strong> ; (12) Alpha Biotech ;<br />
(13) Sorto, 2003 ; (14) Kaladharan & Kaliaperumal, 1999 ; (15) Rosenberg et al., 2008 ; (16) Moro et al., 2010.<br />
- 53 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 12 : Exemples de produits ou actifs cosmétiques commercialisés à base d’algues<br />
Société Produit ou Actif Algue Source<br />
Thalgo Substance initiale marine Padina pavonica donnée <strong>CEVA</strong><br />
Alban Muller International Padinami Padina pavonica (de culture) www.albanmuller.com ; searched on 2008<br />
Alban Muller International Protectami Padina pavonica (de culture) www.albanmuller.com ; searched on 2007<br />
Gelyma Phyactyl Sargassum muticum<br />
Pacific Sud Ingrédients AlgoMonoï Sargassum Sargassum mangarevense<br />
Pacific Sud Ingrédients AlgoMonoï Turbinaria Turbinaria sp.<br />
http://www.gelyma.com/page_produits/produits_fr/phyactyl.html ;<br />
searched on 2007<br />
http://www.pacifiquesud.com/fr/61/plantes/algues.html ; searched on<br />
2009<br />
http://www.pacifiquesud.com/fr/61/plantes/algues.html ; searched on<br />
2009<br />
Beauté Santé Entreprise<br />
(Phytomer/CODIF)<br />
Huile de dictyopteris<br />
Dictyopteris membranacea<br />
http://www.protecingredia.com/products/codif/dictyopteris%20oil.pdf ;<br />
searched on 2009<br />
Exsymol Phykosil 2000 Asparagopsis armata<br />
Biotech Marine Hypneane BG Hypnea musciformis<br />
http://www.exsymol.com/index.php3?frame=products&cat=specif&id=2<br />
8 ; searched on 2007<br />
http://www.specialchem4cosmetics.com/tds/hypneane-bg/presperseincorporated/13238/index.aspx<br />
; searched on 2008<br />
Société Produit ou Actif Algue Source<br />
Biotech Marine Biorestorer Hypnea musciformis http://www.cosmeticingredients.co.uk/products.asp?prod=999 ;<br />
- 54 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
searched on 2005<br />
Biotech Marine Bio-Structurer Hypnea musciformis<br />
http://www.specialchem4cosmetics.com/tds/bio-structurer/presperseincorporated/13412/index.aspx<br />
; searched on 2008<br />
Beauté Santé Entreprise<br />
(Phytomer/CODIF)<br />
DermoChlorella DG<br />
Chlorella vulgaris<br />
http://www.codif-recherche-etnature.com/fr/s06_catalogue/s06p02_fiche.php?prod=8<br />
; searched on<br />
2005<br />
Biotech Marine Bioplasma-FA Scenedesmus<br />
http://www.cosmeticingredients.co.uk/products.asp?prod=1169 ;<br />
searched on 2008<br />
Lessonia Spiruline Spiruline www.lessonia.com ; searched on 2008<br />
Greentech Phytelene Eg718 Bg Spiruline Arthrospira maxima www.chemidex.com ; searched on 2007<br />
Sederma Vitaceane Spiruline et Dunaliella www.chemidex.com ; searched on 2008<br />
Active organics Actiphyte of Spirulina Spiruline<br />
Exsymol Protuline Spiruline<br />
http://www.activeorganics.com/productcd/FI/Spirulina.pdf ; searched<br />
on 2007<br />
http://www.biosiltech.com/sites/default/files/Protulines.pdf ; searched<br />
on 2007<br />
Seaderm Laboratoires<br />
Complexe Pulpacific<br />
Spiruline, Lola ou<br />
Chaetomorpha ou<br />
Rhizoclonium<br />
http://www.seaderm.org/fr/il-etait-une-fois/exclusivites-seaderm ;<br />
searched on 2007<br />
- 55 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
5. Synthèse<br />
Le tableau ci-dessous (Tableau 13) fait la synthèse des éléments développés dans les<br />
chapitres précédents. Selon les renseignements disponibles sur les pratiques de récolte,<br />
l’évaluation des peuplements algaux mahorais, les techniques de culture et les données de<br />
marché, l’effort de recherche et l’effort de commercialisation sont évalués pour chaque algue<br />
candidate retenue, ainsi que pour la Spiruline.<br />
Tableau 13 : Evaluation de l’effort de recherche et de l’effort de commercialisation à fournir<br />
pour la valorisation des algues retenues comme candidates intéressantes + Spiruline<br />
Groupe Famille Taxon<br />
Macroalgues<br />
marines<br />
Microalgues<br />
marines et<br />
d’eau douce<br />
Brunes<br />
Vertes<br />
Rouges<br />
Chlorophycées<br />
Diatomées<br />
Cyanobactéries<br />
Effort de recherche<br />
Récolte<br />
Culture<br />
Padina sp 3 9<br />
Sargassum sp 6 6 6<br />
Turbinaria ornata 3 9 9<br />
Turbinaria decurrens 3 9 9<br />
Dictyota sp 9 9<br />
Dictyopteris sp 6 9<br />
Caulerpa racemosa 9 6 6<br />
Caulerpa serrulata 9 6 6<br />
Caulerpa mexicana 9 6 6<br />
Asparagopsis taxiformis 3 6 9<br />
Hypnea pannosa 6 6<br />
Chlorella sp 3 3<br />
Chlamydomonas sp 3 9<br />
Scenedesmus sp 3 9<br />
Botryococcus braunii 6 9<br />
Ankistrodesmus sp 6 9<br />
Cyclotella sp 6 9<br />
Navicula sp 3 9<br />
Nitzschia sp 6 9<br />
Chaetoceros sp 3 9<br />
Oscillatoria sp 6 9<br />
Anabaena sp 6 9<br />
Arthrospira platensis* 3 3<br />
Effort de<br />
commercialisation<br />
récolte non envisageable<br />
récolte jugée peu envisageable dans l'état actuel des connaissances<br />
* Spiruline: algue non identifiée à ce jour à Mayotte mais qui présente un intérêt de valorisation non négligeable<br />
Sur la base des données présentées dans les chapitres précedents nous proposons une<br />
liste de 8 espèces dont la culture peut être envisagée à court terme sur Mayotte avec<br />
nénamoins un effort pour adapter les techniques décrites par ailleurs au contexte de l’île.<br />
1) Padina sp. 2) Asparagopsis taxiformis 3) Sargassum sp. 4) Hypnea pannosa pour les<br />
macroalgues et 5) Chlorella sp. 6) Scenedesmus sp. 7) Chlamydomonas sp. 8) Arthrospira<br />
platensis.<br />
L’Annexe 2 synthétise pour les macroalgues les principales données techniques rapportées<br />
dans les paragraphes ci-dessus.<br />
- 56 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
D. Les projets<br />
Le chapitre précédent indique qu’il est possible d’exploiter plusieurs algues locales, certaines<br />
d’entre elles rapidement, d’autres avec des efforts de mise au point plus ou moins<br />
importants. Par ailleurs nous avons montré que différents secteurs d’activité sont<br />
potentiellement utilisateurs de la matière première algale ou d’un ingrédient issu de cette<br />
matière première.<br />
Il apparait clairement qu’entre cette matière première disponible pour une exploitation et les<br />
industriels utilisateurs, il est nécessaire de structurer une filière de production d’algue. C’est<br />
le projet global proposé par le Ceva.<br />
Les conditions générales d’établissement d’une filière algale à<br />
Mayotte.<br />
L’étude des conditions d’établissement d’une filière algale à Mayotte s’apparente à une<br />
étude stratégique nécessaire pour évaluer les différents éléments susceptibles d'affecter<br />
l'activité et à identifier les opportunités ou menaces environnant cette nouvelle activité.<br />
Bien que ce ne soit pas l’objet de cette étude il nous apparaît important pour introduire le<br />
projet global d’aborder ce point (qui devra être approfondi par la suite) en utilisant la grille<br />
d’analyse caractéristique de la méthode P.E.S.T.E.L. Cette méthode permet de mettre en<br />
évidence les grandes tendances actuelles ou à venir sur le secteur, et de mettre en<br />
perspective les projets qui pourront se développer autour de la thématique des algues.<br />
L’acronyme de cette méthode permet donc d’évaluer les environnements Politique,<br />
Economique, Socio-culturel, Technique, Ecologique et Législatif du projet. C’est un outil<br />
complémentaire des analyses de positionnement concurrentiel de type MOFF que devra<br />
réaliser en détail chaque entreprise souhaitant s’inscrire dans le développement de l’un des<br />
maillons de cette filière.<br />
L'environnement Politique : Département français depuis 2010, Mayotte dispose d’un<br />
important potentiel issu de la mer et de ses 74 000 Km² de Zone économique exclusive<br />
(ZEE). Entre la pêche industrielle thonière et la pêche artisanale, une aquaculture a su se<br />
mettre en place pour valoriser les potentialités du lagon. A ce titre les représentants de l’Etat<br />
ont décidé, en concertation avec les représentants des collectivités locales, des<br />
établissements publics et des acteurs professionnels, de mettre en place une étude visant à<br />
établir un schéma régional de développement de l’aquaculture de Mayotte. Cette initiative<br />
est donc un signal fort sur la volonté des acteurs locaux à regarder les conditions de mise en<br />
œuvre d’activités tournées vers le milieu aquatique et plus particulièrement vers le lagon de<br />
Mayotte et la mer. L’algoculture fait partie des axes clairement indiqués que devra étudier<br />
le bureau d’étude qui sera désigné pour établir le schéma directeur. Le programme de<br />
développement ciblé pour l’aquaculture sur Mayotte table sur une production à terme de<br />
10 000 tonnes par an toutes espèces confondues.<br />
De plus le projet d’implanter une structure universitaire incluant une composante « Université<br />
de la Mer » avec le soutien de l’Ifremer s’ajoute aux signes positifs déjà évoqués<br />
- 57 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Les algues représenteront une part importante de ce tonnage et devront contribuer à<br />
atteindre cet objectif ambitieux de production. Pour cela les acteurs politiques du<br />
développement local devront mettre en œuvre les outils nécessaires à l’accompagnement de<br />
cette économie de l’aquaculture qu’ils appellent de leurs vœux.<br />
L'environnement Economique : Le statut insulaire de Mayotte, avec un territoire de<br />
dimension réduite, impacte fortement son développement économique. Cette configuration<br />
entraîne des surcoûts, notamment en ce qui concerne l’accès aux marchés et<br />
l’approvisionnement de certains facteurs de production. Néanmoins, la départementalisation<br />
du territoire permet d’accentuer les avancées économiques engagées mais aussi en<br />
contrepartie d’augmenter notablement le coût des facteurs de production. Cette évolution<br />
apporte des contraintes non négligeables en terme de compétitivité, notamment par rapport<br />
aux concurrents de la région. Cette situation ne facilite pas l’autonomisation de l’économie<br />
mahoraise qui reste dépendante des commandes publiques alors que son développement<br />
passe par une appropriation par les mahorais d’une économie entrepreneuriale.<br />
L’émergence d’une nouvelle activité locale permettra d’assurer des liens économiques entre<br />
les acteurs de différentes filières au sein du territoire. Plus cette activité sera ancrée<br />
localement, plus la dépendance vis-à-vis des facteurs de production ou de marché externe<br />
sera moindre augmentant les chances de pérennisation des activités autour de la matière<br />
première algale.<br />
L'environnement Socioculturel :<br />
Les changements profonds qui s’opèrent sur Mayotte, dans un contexte d’accroissement de<br />
la population, accentué par les flux migratoires, engendrent des incertitudes sur le plan<br />
économique et des attentes sociales importantes. Parallèlement à la nécessité de répondre<br />
aux normes internationales, la mise à niveau des investissements productifs, l’élargissement<br />
des marchés constituent un risque important de marginalisation des populations dont le<br />
niveau de formation est insuffisant pour faire face aux nouveaux enjeux. Dans le domaine<br />
des métiers de la mer la structuration professionnelle est nécessaire et doit intégrer dès à<br />
présent toutes les composantes des acteurs de l’exploitation du milieu marin (futurs<br />
récoltants d’algues et algoculteurs). C’est par les organisations professionnelles que pourra<br />
voir le jour la mise en œuvre d’une politique complète de formation (pouvant aller jusqu’à<br />
l’apprentissage de la natation). Cette structuration est également le moyen de prendre en<br />
considération le fonctionnement de la société mahoraise au sein des villages et des familles.<br />
Cependant il faut également intégrer les relations, portées par la tradition, qu’entretiennent<br />
les mahorais avec leur Lagon<br />
La filière algue de Mayotte doit pouvoir se reposer bien entendu sur des initiatives privées de<br />
type industrielles, mais également sur des initiatives plus artisanales qui pourront apporter<br />
une sécurisation des sources de revenus des familles tout en aplanissant les aléas liés à<br />
l’environnement économique en mutation.<br />
L'environnement Technologique : Le dynamisme économique d’une nouvelle activité doit<br />
être poussé en avant par un niveau technologique approprié. La compétitivité de la filière<br />
algale ne dérogera pas à cette règle et son développement doit être supporté à l’échelon du<br />
territoire. Mayotte a déjà su intégrer les apports technologique de l‘aquaculture de poissons<br />
- 58 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
en devenant la région d’Outre-mer où la production piscicole, bien que modeste, est la plus<br />
importante. Les outils de développement (Aquamay) et de support (Ifremer) auprès des<br />
opérateurs privés sont à l’origine de l’introduction de l’ombrine tropicale et ont permis le<br />
transfert technologique.<br />
L’algoculture s’inscrit totalement dans une activité générale d’aquaculture. Bien entendu bon<br />
nombre de spécificités inhérentes aux espèces devront être prises en compte. Mais d’ores et<br />
déjà la vingtaine d’espèces identifiées en première approche font déjà l’objet de culture dans<br />
différentes parties du monde.<br />
Sur le plan de la transformation de la matière première, les techniques à mettre en œuvre<br />
dans un premier temps devront se référer à des choses connues. L’innovation aura sa place<br />
dans un second temps pour répondre aux attentes du marché.<br />
L'environnement Ecologique : Sur le plan maritime, l’environnement écologique est<br />
intimement lié à la présence du lagon et de ses écosystèmes nombreux et variés. A ce titre<br />
de très nombreuses études ont été réalisées dans ce contexte, répertoriées par Thomassin<br />
B.A. (1999). La pression démographique fragilise les équilibres des écosystèmes lagonaires.<br />
La création dès 2010 du parc naturel marin de Mayotte constitue aujourd’hui la plus grande<br />
aire marine protégée française. Le lagon de Mayotte est intégré aux 70 000 km² du parc<br />
naturel. L’objectif du parc est de préserver la biodiversité marine tout assurant un<br />
développement cohérent des différentes activités maritimes en y associant tous les acteurs<br />
proche du lagon.<br />
La production aquacole fait partie des activités déjà présentes et pouvant être développées<br />
au niveau du lagon. Les algues présentes dans le milieu participent activement aux<br />
équilibres des écosystèmes en place, notamment par leur faculté de bioremédiation vis-à-vis<br />
des nutriments, du CO 2 et autres effluents issus des activités humaines. Les algues doivent<br />
donc s’intégrer dans un développement de l’aquaculture basé sur une approche<br />
écosystémique (AEA) (FAO, 2011).<br />
L'environnement Légal : Mayotte doit faire face à l’intégration des normes métropolitaines<br />
mais aussi aux législations en cours concernant tous les domaines encadrant le<br />
développement des activités. Elles concernent bien entendu le droit du travail, les règles<br />
liées à la concurrence, mais plus spécifiquement les règles qui encadrent les activités<br />
aquacoles. Néanmoins les règles métropolitaines doivent pouvoir faire l’objet d’amendement<br />
notamment pour mieux encadrer les activités de récolte et le développement d’activités<br />
multi-trophiques alors qu’en métropole le modèle mono-spécifique prévaut encore et bloque<br />
souvent toutes nouvelles initiatives.<br />
- 59 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Dans un contexte politique favorable au développement d’activités aquacoles, la mise en<br />
place d’une activité économique portée par des initiatives privées et communautaires à<br />
destination prioritaire d’autres filières économique de Mayotte est possible. Ce<br />
développement, encadré par des organismes de transfert et un cadre législatif adapté aux<br />
spécificités locales, possède tous les atouts pour s’inscrire dans une exploitation<br />
raisonnée et durable des algues patrimoniales de Mayotte.<br />
Figure 31 : Un ancrage de la filière de production algale dans un contexte<br />
territorial complexe<br />
L’identification des différents constituants de l’environnement sociologique et technicoéconomique<br />
de Mayotte permet de définir les éléments de son positionnement selon la<br />
classification Forces / Faiblesses et Opportunités / Menaces.<br />
La figure ci-dessous reprend ce qui apparait en première analyse, comme étant les points<br />
marquants autour desquels le positionnement de la filière devra se faire.<br />
Figure 32 : représentation MOFF initial de la filière algue sur Mayotte<br />
- Volonté politique pour<br />
développer l'aquaculture.<br />
- Une biodiversité algale<br />
valorisable.<br />
- La mobilisation possible<br />
de différents acteurs<br />
économiques locaux.<br />
- Une main-d'Oeuvre en<br />
attente d'emplois attractifs<br />
FORCES<br />
FAIBLESSES<br />
- organisation institutionnelle<br />
complexe, encadrée par une<br />
multitude de textes<br />
stratégiques difficiles pour le<br />
montage des projets<br />
- Des facteurs de production<br />
difficilement compétitifs<br />
avec ceux des pays voisins.<br />
- une relation complexe des<br />
mahorais avec la mer<br />
- Un manque de formation<br />
aux métiers de l’aquaculture<br />
- Favoriser la mise en place<br />
d'activités favorisnt<br />
l'économie locale et<br />
l'exportation<br />
- Politique Européenne<br />
favorableau maintient et<br />
l'amélioration de la qualité<br />
des eaux<br />
OPPORTUNITES<br />
MENACES<br />
- Manque de moyens<br />
externes pour développer<br />
les techniques de<br />
production.<br />
- Difficulté de mettre en<br />
œuvre une gestion<br />
cohérente de la filière,<br />
- manque d'investisseurs<br />
à différents niveaux de la<br />
chaîne de valeur<br />
- 60 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
La mise en œuvre d’une filière Algue sur Mayotte se décline selon la chaîne de valeur<br />
suivante :<br />
Figure 33 : Chaîne de valeur de la filière algale<br />
Le développement de la filière algue de Mayotte se fera logiquement autour de trois projets<br />
structurants suivant cette chaîne de valeur et se déclinera autour des projets suivants :<br />
1. Installations de culture à terre<br />
2. Fermes algocoles<br />
3. Transformation de la matière première<br />
- 61 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Projet 1 – Installations de culture à terre<br />
Ce projet a pour objet de mettre en place les outils techniques nécessaires à la production<br />
des plantules pour la production en mer de macroalgues d’une part, et la production en<br />
masse de microalgues d’autre part. De fait ce projet se segmente en 3 axes principaux :<br />
1.1 Ecloserie de macroalgues<br />
2.1 Production starter de microalgues<br />
3.1 Production de microalgues<br />
Axe 1.1 : Ecloserie de macroalgues<br />
Objectif<br />
L’objectif de cet axe est la mise en place d’une production de plantules d’algues nécessaires<br />
à ensemencer les structures de grossissement du projet 2. C’est le début de la chaîne de<br />
valeur sans laquelle la filière ne peut pas se structurer ; il joue donc un rôle primordial.<br />
On retrouve dans le paragraphe suivant le détail des différentes actions à mener pour<br />
installer une écloserie d’algues.<br />
Actions<br />
<br />
Choix du site d’implantation de l’écloserie.<br />
Comme toute écloserie aquacole, le facteur de la qualité de l’eau d’alimentation de<br />
l’écloserie est l’un des facteurs les plus importants. Il convient donc de déterminer les<br />
sites potentiels en intégrant la caractérisation physico-chimique de l’eau, l’impact<br />
potentiel d’activités agro-industrielles avoisinantes et les conditions hydrodynamiques<br />
locales<br />
<br />
Définir la capacité globale de(s) l'écloserie(s) en relation avec le choix des espèces et<br />
l'objectif de production (Dossier d'ingénierie)<br />
o Dimensionnement des installations (Hydraulique, Aéraulique, Energétique,<br />
Equipements, Bâtiments)<br />
o Définition des conditions d'exploitation et cycle de production multi espèces<br />
(Cycle, Personnel).<br />
Le dossier d’ingénierie passe par les phases d’avant-projet sommaire, puis d’avant-projet<br />
détaillé basé sur le plan suivant : i) description générale des techniques pratiquées, ii)<br />
définition de la capacité de production (par espèce), iii) description des différents<br />
éléments constitutifs de la plateforme (pompage, module technique (traitement de l’eau<br />
en entrée, régulation thermique), laboratoires, salles de culture, bureaux et dépendances<br />
pour le personnel, traitement des eaux de rejet, iv) spécifications des bâtiments et des<br />
équipements nécessaires.<br />
<br />
Implantation et installation de(s) écloserie(s)<br />
o Choix des terrains<br />
o Réalisation des dossiers de consultation des entreprises<br />
o Phase de travaux<br />
o Réception et implantation des équipements<br />
- 62 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
<br />
<br />
Formation<br />
Phase de démarrage et de transfert et d'appropriation des techniques de production<br />
Cette phase peut prendre une année entre les opérations de démarrage et d’ajustement<br />
des équipements, de formation du personnel en charge des opérations de production et<br />
de calage des techniques de production.<br />
<br />
Phase de production.<br />
Axe 2.1 : Production starter de microalgues<br />
Objectif<br />
L’objectif de cet axe est la mise en place d’une unité spécialisée dont la mission est de i)<br />
sélectionner les souches de microalgues, ii) mettre en collection les différentes microalgues<br />
locales d’intérêt iii) assurer des cultures intermédiaires toutes opérations nécessaires pour<br />
permettre le démarrage d’une production de masse.<br />
On retrouve dans le paragraphe suivant le détail des différentes actions à mener pour<br />
installer une unité de production starter de microalgues.<br />
Actions<br />
<br />
Choix du site d’implantation.<br />
Cette unité doit pouvoir travailler aussi bien en eau de mer qu’en eau douce ; le site<br />
retenu devra tenir compte de cette contrainte particulière.<br />
<br />
Définir la capacité globale de l'unité en relation avec le choix des espèces et l'objectif<br />
de production (Dossier d'ingénierie)<br />
o Dimensionnement des installations (Hydraulique, Aéraulique, Energétique,<br />
Equipements, Bâtiments)<br />
o Définition des conditions d'exploitation et cycle de production multi espèces<br />
(Cycle, Personnel)<br />
Le dossier d’ingénierie passe par les phases d’avant-projet sommaire, puis d’avant-projet<br />
détaillé basé sur le plan suivant : i) description générale des techniques pratiquées, ii)<br />
définition de la capacité de production, iii) description des différents éléments constitutifs<br />
de la plateforme (pompage, module technique (traitement de l’eau en entrée, régulation<br />
thermique), laboratoires, salles des souches, de culture, bureaux et dépendances pour le<br />
personnel, traitement des eaux de rejet, iv) spécifications des bâtiments et des<br />
équipements nécessaires.<br />
<br />
<br />
<br />
Implantation et installation de l’unité<br />
o Choix du terrain<br />
o Réalisation des dossiers de consultation des entreprises<br />
o Phase de travaux,<br />
o Réception et implantation des équipements<br />
Formation du personnel<br />
Phase de démarrage et de transfert et d'appropriation des techniques de production<br />
- 63 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Cette phase peut prendre une année entre les opérations de démarrage et d’ajustement<br />
des équipements, de formation du personnel en charge des opérations de production et<br />
de calage des techniques de production.<br />
<br />
Phase de production<br />
Axe 3.1 : Production en masse de microalgues<br />
Objectif<br />
L’objectif de cette composante est la mise en place d’unités de production en masse de<br />
microalgues locales. Les types de production sont multiples depuis les cultures en<br />
hétérotrophie à celles autotrophes contrôlée ou non. Cet axe doit pouvoir proposer ces<br />
différentes variantes en fonction des espèces, de leur capacité à s’adapter à ces techniques<br />
de production spécifiques, et aux marchés ciblés (niveau de valeur ajoutée finale).<br />
Il est nécessaire d’indiquer que cet axe intègre également la possibilité de mettre en œuvre<br />
la culture de microalgues dans le cadre de la gestion des STation d’Epuration (Step) des<br />
eaux usées, mais aussi dans un futur proche pour la bio-remédiation des gaz, des lixiviats<br />
issus des centres d’enfouissement technique (CET) des déchets organiques (Données Ceva<br />
non publiées) .<br />
On retrouve dans le paragraphe suivant le détail des différentes actions à mener pour<br />
installer une unité de production de masse de microalgues.<br />
Actions<br />
<br />
Choix du site d’implantation.<br />
Cette unité doit pouvoir travailler aussi bien en eau de mer qu’en eau douce.<br />
Parallèlement la production pouvant être réalisée en réacteur, bassins ouverts ou<br />
système de photo-bioréacteur, le site retenu devra tenir compte de ces contraintes<br />
particulières. Dans le cas d’une association avec une Step ou un CET, il sera nécessaire<br />
de pouvoir disposer de foncier en périphérie pour limiter les distances d’acheminement<br />
des fluides.<br />
<br />
Définir la capacité globale de l'unité en relation avec le choix des espèces et l'objectif<br />
de production (Dossier d'ingénierie)<br />
o Dimensionnement des installations (Hydraulique, Aéraulique, Energétique,<br />
Equipements, Bâtiment)<br />
o Définition des conditions d'exploitation et cycle de production multi espèces<br />
(Cycle, Personnel)<br />
Le dossier d’ingénierie passe par les phases d’avant-projet sommaire, puis d’avant-projet<br />
détaillé basé sur le plan suivant : i) description générale des techniques (notamment<br />
techniques autotrophes intensives ou extensives, hétérotrophes), ii) définition de la<br />
capacité de production, iii) description des différents éléments constitutifs de la<br />
plateforme (pompage, module technique (traitement de l’eau en entrée, régulation<br />
thermique), laboratoires, salles de culture des volumes intermédiaires, bassins de culture<br />
et autres équipements de production, bureaux et dépendances pour le personnel,<br />
traitement des eaux de rejet, iv) disponibilité sur place de fourniture de gaz carbonique<br />
- 64 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
ou d’effluents organiques dans le cas des Step et CET, v) spécifications des bâtiments et<br />
des équipements nécessaires dont ceux notamment nécessaire à la collecte et<br />
concentration de la biomasse.<br />
<br />
<br />
<br />
Implantation et installation de l’unité<br />
o Choix du terrain<br />
o Réalisation des dossiers de consultation des entreprises<br />
o Phase de travaux,<br />
o Réception et implantation des équipements<br />
Formation<br />
Phase de démarrage et de transfert et d'appropriation des techniques de production<br />
Cette phase peut prendre une année entre les opérations de démarrage et d’ajustement<br />
des équipements, de formation du personnel en charge des opérations de production et<br />
de calage des techniques de production.<br />
<br />
Phase de production<br />
Un axe pédagogique<br />
Pour l’ensemble de ce projet, il apparait important de pouvoir intégrer une composante<br />
pédagogique au sein des différents axes. En effet il apparait que la culture mahoraise n’a<br />
pas développé étroite relation avec la mer mais qu’elle reste plutôt tournée vers la terre. Le<br />
premier indicateur est le nombre de personne sachant nager et le nombre de personne qui<br />
fréquente de manière régulière le lagon pour y pratiquer des activités.<br />
Pour cela nous recommandons aux porteurs de projet d’intégrer, lors de la faisabilité et de la<br />
conception des structures de production, les aménagements permettant d’accueillir sans<br />
trouble pour l’activité de la structure, des visiteurs. Cette activité pédagogique doit, pour être<br />
réussie, être supportée par la collectivité afin de supporter les charges de travail liées à<br />
l’activité de visite.<br />
L’objectif de cette activité spécifique est bien de sensibiliser les mahorais sur la richesse<br />
patrimoniale du lagon, des interactions ecosystémiques et de l’intérêt des activités<br />
aquacoles.<br />
- 65 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Partenaires et Moyens<br />
Partenaires ciblés<br />
Le tableau suivant indique par catégorie les acteurs pouvant être intégrés dans le projet.<br />
Nous distinguons ici trois types de partenaires, i) les acteurs investisseurs dans le projet<br />
(notés R ou 1), ii) les acteurs pouvant par l’information ou la position qu’ils ont, intervenir en<br />
support au projet (notés C ou 3) iii) et les acteurs susceptibles de fournir un service au projet<br />
(notés S ou 5).<br />
Figure 34 : Matrice Actions / Acteurs Projet 1<br />
Institutionnels<br />
Ecloserie macro‐algues 3 3 1 3 1 3 3<br />
Moyens de culture à Ecloserie micro‐algues 3 3 1 3 1 3<br />
terre Grossissement micro‐algues 3 3 1 3 3 3 1 3 3<br />
Autres écloseries (SDRAM) 1 3 1 3 1 3<br />
Préfecture de Mayotte<br />
SMIAM ‐ Syndicat Mixte<br />
d'Investissement pour<br />
l'Aménagement de Mayotte<br />
Organisations<br />
de<br />
développement<br />
, R&D,<br />
Formation<br />
Organisation<br />
pour le<br />
développement<br />
Chambre de Commerce<br />
et d"Industrie<br />
Autres investisseurs potentiels<br />
EDM<br />
Entreprises Privées<br />
Décharge publique Hamaha / Star<br />
IBS ‐ Béton, parpaings, ferraillage<br />
Mayotte aquaculture<br />
Océanie piscine ‐ Piscines, bâches<br />
Sogea Mayotte ‐ Eau, distribution,<br />
traitement, station de relevage<br />
Moyens financiers<br />
Les différents axes de ce projet culture à terre nécessitent des études préalables,<br />
notamment études de faisabilité / business plan pour trouver les porteurs du projet.<br />
Il est nécessaire également de réaliser des études de site, notamment pour ce qui concerne<br />
l’analyse des conditions environnementale et la qualité des eaux nécessaire à l’alimentation<br />
des unités de production à terre, unité starter microalgues et unité de production de masse<br />
de microalgues.<br />
Le tableau ci-après donne une fourchette des coûts attachés aux différentes études et coûts<br />
de construction d’écloseries.<br />
- 66 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 14 : indication des coûts initiaux au projet de culture à terre<br />
Item Min (K€) Max (K€)<br />
Etude de faisabilité 50 100<br />
Etude de site 20 50<br />
Etude d’Avant-Projet Détaillé 150 250<br />
Construction d’une écloserie<br />
macroalgues aménagée (2 à<br />
3 000 € le m²)<br />
Construction d’une écloserie<br />
microalgues aménagée<br />
Prix d’un photo-bioréacteur<br />
départ usine<br />
2 000 6 000<br />
1 000 2 500<br />
20 (200 L) ++++++<br />
Raceway (départ usine) 10 50<br />
Calendrier des tâches<br />
Figure 35 : chronogramme prévisionnel pour la mise en œuvre du projet 1<br />
Nº Nom de la tâche<br />
1 Projet 1 Installation de culture à terre<br />
2 Etude de faisabilité<br />
3 Recherche Investisseurs et Financement<br />
4 Etude de site<br />
5 Etude Avant Projet Détaillé<br />
6 Appel d' offre<br />
7 Construction des installations<br />
8 Mise en route et adaptation<br />
9 Production de Routine<br />
10 Formation<br />
A1 A2 A3 A4<br />
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4<br />
BE<br />
Porteurs<br />
BE<br />
BET<br />
Ent. GC<br />
Ceva<br />
- 67 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Projet 2 – Fermes Algocoles<br />
Ce projet a pour objet le développement des unités de production d’algues. Plusieurs options<br />
sont possibles en comptant d’une part la culture unique d’algues ou bien la production<br />
d’algues en association avec d’autres productions aquacoles dans un ensemble dénommé<br />
Aquaculture Multi-Trophique Intégré. Parallèlement à la culture, ce projet intègre l’activité<br />
potentielle de récolte. Ce projet se segmente en 2 axes principaux :<br />
1.2 La récolte d’algues<br />
2.2 La culture d’algues.<br />
Axe 1.2 : La récolte d’algues<br />
Objectif<br />
L’objectif de cette composante est de mettre en œuvre une activité spécifique liée à la<br />
récolte dans le milieu naturel d’algues à destination des utilisateurs de différents domaines<br />
d’activité. Il y a lieu d’organiser cette collecte de manière à ce que cette activité s’inscrive<br />
dans la préservation de la ressource et le développement durable tout en favorisant la<br />
création d’emplois pérennes.<br />
L’objectif de cet axe est de permettre d’accompagner le développement de l’exploitation des<br />
algues marines (et des phanérogames marines) d’un point de vue du management durable<br />
de la ressource naturelle.<br />
Cet axe est particulièrement pertinent compte tenu des projets susceptibles de se<br />
développer tant en ce qui concerne le lagon lui-même (schéma régional de développement<br />
de l’aquaculture) que les activités agricoles ou industrielles en périphérie.<br />
On retrouve dans le paragraphe suivant le détail des différentes actions à mener pour<br />
instaurer une activité de récolte de biomasses algales.<br />
Actions<br />
<br />
Etablir un état des lieux initial sur les peuplements en algues et notamment i) taxons,<br />
ii) évaluation des biomasses (fixées, dérivantes, échouées), iii) évolution au cours de<br />
l’année des peuplements et leurs abondances.<br />
Etablir une cartographie des zones de récolte indiquant par espèce la densité, la<br />
prédominance d’une espèce par rapport aux autres. Cette cartographie doit être<br />
raccordée aux activités impactant le milieu (notamment drainage, rejets agricole ou<br />
industriel ou des zones d’habitation). Elle indiquera également les zones de<br />
recouvrement avec des activités déjà en place (pêcherie, aquacole…).<br />
Mettre en place une cellule de suivi des biomasses. Cette cellule rapportera les<br />
éléments d’évolution des différentes biomasses en place ou cultivées afin de<br />
permettre l’élaboration des plans de récolte (quotas), de production (objectifs) et<br />
d’installations (concessions).<br />
Ces 3 actions constituent le socle de ce que pourrait être un observatoire des algues de<br />
Mayotte (composante de l’observatoire sur la biodiversité), et jouer un rôle important sur<br />
le plan environnemental. En effet les algues sont des indicateurs directs de la qualité du<br />
- 68 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
milieu, et le suivi effectuer par cet observatoire pourra contribuer à réguler les activités<br />
ayant un impact sur le milieu et être un outil dans le cadre de la mise en œuvre de la<br />
Directive Cadre sur l’Eau.<br />
Cet observatoire des algues doit être un outil à la gestion raisonnée de l’exploitation ou<br />
de la culture des algues. Il permettra ainsi de rendre pérenne la production et les filières<br />
dont l’approvisionnement dépendra de la matière première.<br />
Les informations sur l’évolution des différentes espèces d’intérêts économiques<br />
permettra de donner des recommandations sur les niveaux de collecte à respecter, les<br />
périodes favorables à la collecte pour chacune des espèces, les zones exploitables ou à<br />
mettre en jachère. C’est sur la base de ces recommandations que les organismes<br />
compétents établiront les règles d’exploitation du milieu.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Définir les standards de récolte<br />
Notamment la manière de procéder à la récolte en fonction des espèces ciblées, les<br />
périodes à privilégier, les tailles à respecter, les lieux et les quantités alloués à cette<br />
activité.<br />
Définir les moyens nécessaires à la récolte<br />
Il s’agit des moyens à la mer, les moyens de séchage et stockage post-récolte, mais<br />
aussi les structures susceptibles de « porter » l’utilisation collective de certains<br />
équipements dédiés.<br />
Former les acteurs de la récolte<br />
La récolte des algues doit se faire en respectant des règles strictes qui permettent<br />
d’assurer la durabilité de la ressource (coupe plutôt qu’arrachage, laisser des zones<br />
de jachères…) et la qualité de la matière première (prélèvement, nettoyage, stockage<br />
intermédiaire…).<br />
Assurer la traçabilité des récoltes<br />
Indispensable pour permettre de suivre l’évolution de la biomasse naturelle, il s’agit<br />
aussi d’un élément qui peut se révéler très important pour certains utilisateurs de la<br />
matière première.<br />
Conduire les actions correctives pour garantir la durabilité de la récolte<br />
Sur la base de l’analyse du suivi, tracé des résultats de récoltes, les acteurs devront<br />
suivre les recommandations édictées par les organismes de tutelle.<br />
- 69 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Axe 2.2 : La culture d’algues<br />
Objectif<br />
Cet axe a pour objectif de définir les conditions de mise en place d’unités de culture<br />
(« grossissement ») d’algues sur la base de différentes techniques de type radeaux flottants,<br />
culture sur filets horizontaux ou sur cordes.<br />
On retrouve dans le paragraphe suivant le détail des différentes actions à mener pour établir<br />
une ferme algocole.<br />
Actions<br />
<br />
Cartographie des sites d'algoculture (en lien avec le schéma directeur du<br />
développement de l’aquaculture) sur la base d’une activité d'algoculture seule et dans<br />
le cadre d'une aquaculture intégrée multi-trophique.<br />
<br />
Réaliser une étude approfondie du site d’accueil des fermes<br />
L’étude de chaque site s’attache à identifier les caractéristiques hydrodynamique,<br />
bathymétrique, du substrat de fond, de l’environnement immédiat en activité agroindustrielle<br />
ou la nature de l’activité aquacole le cas échéant.<br />
<br />
Définir les moyens nécessaires à mettre en place pour exploiter les concessions (en<br />
fonction du modèle algues seules ou AEA et des espèces)<br />
o Dimensionnement des installations en mer (ancrage, balisage, bouées,<br />
supports de culture...)<br />
o Définir les besoins de moyens d'exploitation (bateau, plongée, stockage...)<br />
Il s’agit de décrire les infrastructures à mettre en place pour rendre opérationnelle la<br />
ferme d’algues en fonction des données environnementales et des espèces ciblées pour<br />
la production.<br />
<br />
Implanter les structures d'exploitation en mer<br />
C’est tâche consiste en la mise en place des structures de la plate-forme de culture<br />
(ancres, corps-morts, blocs de béton, bouées de signalisation de la concession…<br />
<br />
<br />
Former le personnel<br />
Phase de démarrage, de transfert et d'appropriation des techniques de production<br />
Cette phase dure au moins un cycle de production complet de la réception des filières<br />
ensemencées à la récolte des algues et la préparation du cycle suivant.<br />
<br />
Phase de production dans le respect des bonnes pratiques (suivi qualité - traçabilité).<br />
Partenaires et Moyens<br />
Partenaires ciblés<br />
Le tableau suivant indique par catégorie les acteurs pouvant être intégrés dans le projet.<br />
Nous distinguons ici trois types de partenaires, i) les acteurs investisseurs dans le projet<br />
(notés R ou 1), ii) les acteurs pouvant, par l’information ou la position qu’ils ont, intervenir en<br />
- 70 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
support au projet (notés Cou 3) iii) et les acteurs susceptibles de fournir un service au projet<br />
(notés S ou 5).<br />
Figure 36 : Matrice Actions / Acteurs Projet 2<br />
Moyens de culture<br />
en mer<br />
Institutionnels<br />
SMIAM ‐ Syndicat Mixte<br />
d'Investissement pour<br />
l'Aménagement de Mayotte<br />
Organisations<br />
de<br />
développement<br />
, R&D,<br />
Formation<br />
Organisation<br />
pour le<br />
développement<br />
Récolte de macro‐algues sur ressource naturelle<br />
3 3 1 1<br />
Grossissement de macro‐algues 3 3 1 3 3 3 3 1<br />
Chambre de Commerce<br />
et d"Industrie<br />
Autres investisseurs potentiels<br />
Forintech Mayotte ‐ Forage,<br />
Géologie, Géophysique, Travaux<br />
Entreprises Privées<br />
IBS ‐ Béton, parpaings, ferraillage<br />
Isirus ‐ Bureau d'étude<br />
(environnement marin)<br />
Isséo ‐ Ferronnerie, métallerie,<br />
travaux subaquatiques<br />
Mayotte aquaculture<br />
Moyens financiers<br />
Les différents axes de ce projet d’activité en mer (récolte et culture) nécessitent des études<br />
préalables.<br />
Le pré-requis à l’axe récolte est la réalisation d’une étude visant à fournir l’état initial du stock<br />
en place. Cet état des lieux doit être le plus exhaustif, l’étude mobilise des moyens assez<br />
lourds, utilisant dans un premier temps des images ayant déjà été acquises, un plan de<br />
survols aériens complétés par des missions terrain réalisées par des plongeurs visant à caler<br />
l’interprétation des images acquises.<br />
On retrouve les études de faisabilité / business plan nécessaires pour mobiliser les<br />
investisseurs aux projets.<br />
Il est également nécessaire de réaliser des études de site. Elles concernent plus<br />
particulièrement l’analyse des conditions environnementales et la qualité des eaux en lien<br />
avec l’implantation des structures de culture. Ces informations sont nécessaires pour la<br />
réalisation des études d’ingénierie (définition des structures de cultures et autres<br />
équipements d’exploitation).<br />
- 71 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 15 : indication de coûts initiaux au projet de culture en mer<br />
Item Min (K€) Max (K€)<br />
Etat des lieux initial et<br />
cartographie des zones de<br />
récolte<br />
350 700<br />
Cartographie des sites<br />
algocoles (Cf. SDRAM)<br />
pm<br />
pm<br />
Achat des moyens de récolte<br />
(Bateau – Pirogues)<br />
2 20<br />
Etude de faisabilité 50 100<br />
Etude de site 20 50<br />
Etude d’avant-projet détaillé 150 250<br />
Equipements des fermes / Ha 3 6<br />
Calendrier des tâches<br />
Figure 37 : chronogramme prévisionnel pour la mise en œuvre du projet 2<br />
Nº Durée Nom de la tâche<br />
1 1029 j ours Projet 1 : installation de culture à terre<br />
11 1029 j ours Projet 2 : récolte et installation en mer<br />
12 605 j ours Récolte<br />
13 365 jours Etat des lieux initial et cartographie<br />
14 90 jours Définition du plan de récolte<br />
15 90 jours Recrutement et formation des récoltants<br />
16 60 jours Constitution d' une org anisation professionnelle<br />
17 90 jours Achat des moyens de récolte<br />
18 90 jours Mise en place d'une cellule de suivi<br />
19 0 jour exploitation<br />
20 1029 j ours Algoculutre<br />
21 120 jours Etude de faisabilité<br />
22 180 jours Recherche Investisseurs et Financement<br />
23 60 jours Etude de site<br />
24 120 jours Etude Avant Projet Détaillé<br />
25 60 jours Appel d' offre<br />
26 180 jours Construction des installations<br />
27 365 jours Mise en route et adaptation<br />
28 0 jour Production de Routine<br />
29 120 jours Formation<br />
A1 A2 A3 A4<br />
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4<br />
- 72 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Projet 3 – Transformation, commercialisation et R&D<br />
C’est le troisième maillon de la chaîne de valeur qui va permettre la mise sur le marché des<br />
algues produites et accompagner la filière sur des actions d’amélioration des techniques de<br />
production ou l’innovation produit. Ce projet se décline en trois axes principaux :<br />
1.3 La transformation<br />
2.3 Accès aux Marchés<br />
3.3 Recherche et Développement<br />
Axe 1.3 Transformation<br />
Objectifs<br />
L’objectif de cette composante est de doter la filière de production de moyens afin d’apporter<br />
une valeur ajoutée à la matière première produite ou récoltée. La transformation des algues<br />
se décline en différentes opérations simples (stockage / séchage / broyage) à des opérations<br />
beaucoup plus complexes comme des extractions d’actifs ou purification. Il est clair que la<br />
transformation des algues évoluera au fur et à mesure de la maturation de celle-ci.<br />
On retrouve dans le paragraphe suivant le détail des différentes actions à mener pour établir<br />
une plate-forme dédiée au stockage et la transformation des algues.<br />
Actions<br />
Définir les moyens à mettre en œuvre pour transformer la matière première en lien<br />
avec les attentes des cibles marchés<br />
o Stockage (T°c Ambiante Atmosphère contrôlée - froid positif)<br />
o Séchage basse température, déshydrations<br />
o Broyage<br />
o Moyens d'appertisation de stérilisation, de cuisson,<br />
o Surgélation (froid négatif)<br />
o Conditionnement (ensachage, sous vide...)<br />
o Technique d’extraction<br />
Dimensionner et implanter la (les) structure(s) de transformation<br />
Formation des équipes<br />
Phase démarrage, de transfert et d'appropriation des techniques de production<br />
Phase de production dans le respect des cahiers des charges clients.<br />
Axe 2.3 Accès aux marchés<br />
Objectifs<br />
Phase ultime du travail fourni par l’ensemble des acteurs de la filière, cet axe a pour objet<br />
d’organiser les moyens et actions nécessaires à mettre en place pour optimiser la mise sur<br />
le marché des différents produits issus de la matière première.<br />
On retrouve dans le paragraphe suivant le détail des différentes actions à mener pour établir<br />
une cellule de commercialisation pour la filière.<br />
- 73 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Actions<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Marketing (Produits, Place, Prix, Promotion)<br />
o Agriculture<br />
o Alimentation animale<br />
o Alimentation humaine<br />
o Chimie<br />
o Cosmétique<br />
o Epuration<br />
o Santé animale<br />
o Santé humaine<br />
Pilotage de la production<br />
Logistique<br />
Vente<br />
o Agriculture<br />
o Alimentation animale<br />
o Alimentation humaine<br />
o Chimie<br />
o Cosmétique<br />
o Epuration<br />
o Santé animale<br />
o Santé humaine<br />
Qualité<br />
o Cahier des charges & guide des bonnes pratiques<br />
• Ecloserie<br />
• Récolte et culture<br />
• Transformation<br />
• Economique et social<br />
o Contrôle qualité<br />
• Ecloserie<br />
• Récolte et culture<br />
• Transformation<br />
• Economique et social.<br />
Axe 3.3 R&D et Innovation<br />
Objectifs<br />
Il n’est pas envisageable de mettre en œuvre une nouvelle filière sans assurer un appui en<br />
terme d’amélioration des techniques et d’optimisation des procédés à tous les niveaux de la<br />
production.<br />
De même, comme nous l’avons signalé, le niveau de « domestication » des différentes<br />
espèces d’intérêt est variable, il sera donc nécessaire d’adapter ou développer des<br />
techniques nouvelles pour ces algues dont la culture est peu maîtrisée afin d’étoffer<br />
progressivement la gamme à proposer sur le marché.<br />
- 74 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
On retrouve dans le paragraphe suivant le détail des différentes actions à mener pour offrir<br />
un appui technique aux acteurs de la filière.<br />
Actions<br />
Faire progresser la connaissance sur le développement des algues endémiques<br />
exploitées<br />
o Sur le plan biologique<br />
o Sur le plan des techniques de production<br />
o Sur le plan des techniques de transformation<br />
o Sur le plan des coûts de production<br />
Acquérir des connaissances sur les espèces endémiques non maîtrisées<br />
o Espèces<br />
o Techniques<br />
o Economiques et sociales.<br />
La mise à disposition d’une expertise scientifique et technique spécialisée sur les algues doit<br />
se faire dans le cadre général d’accompagnement de l’aquaculture sur Mayotte avec<br />
notamment les productions de poissons, coquillages, crustacés ou échinodermes.<br />
Partenaires et Moyens<br />
Partenaires ciblés<br />
Le tableau suivant indique, par catégorie, les acteurs pouvant être intégrés dans le projet.<br />
Nous distinguons ici trois types de partenaires, i) les acteurs investisseurs dans le projet<br />
(notés R ou 1), ii) les acteurs pouvant, par l’information ou la position qu’ils ont, intervenir en<br />
support au projet (notés Cou 3) iii) et les acteurs susceptibles de fournir un service au projet<br />
(notés S ou 5). Cette catégorisation est reprise pour l’ensemble des projets.<br />
Figure 38 : Matrice Actions / Acteurs Projet 2<br />
Institutionnels<br />
Entreprises Privées<br />
Organisations de développement, R&D, Formation<br />
Moyens de<br />
transformation à<br />
terre<br />
Moyens R&D &<br />
Marketing & Vente<br />
SMIAM ‐ Syndicat Mixte<br />
d'Investissement pour<br />
l'Aménagement de Mayotte<br />
Organisation pour le<br />
développement<br />
Chambre de Commerce<br />
et d"Industrie<br />
Centre d'Affaires de<br />
Mayotte ‐ Domiciliation<br />
d'entreprises<br />
Transformation de macro‐algues 3 3 1 1 3 1<br />
Transformation de micro‐algues 3 3 1 1 3 1<br />
Transformation de végétaux terrestres 3 3 1 1 3 3 3 1 1<br />
Moyens R&D & Marketing & Vente<br />
R&D 3 3 3 3 3 1 1<br />
Vente 3 3 5 1 5 3 5 5 5 1<br />
Aquamay<br />
Instituts de R&D et<br />
transfert<br />
ARDA<br />
Ceva<br />
ADEM ‐ GESAM<br />
(Association des<br />
Autres investisseurs potentiels<br />
AGRIKAGNA ‐ Aliment pour bétail<br />
BEAUTE + ‐ Cosmétiques,<br />
Parfumerie, Fournitures prof.<br />
IBS ‐ Béton, parpaings, ferraillage<br />
Koropa Légumes ‐ agriculteurs,<br />
élevage, coopératives<br />
Laiterie de Mayotte<br />
Mahoraise Légumes<br />
Mayotte aquaculture<br />
Il convient d’ajouter à la liste des acteurs existants, les futurs acteurs du projet de l’université<br />
de la Mer (Aquamay / Ifremer).<br />
Moyens financiers<br />
La construction et l’approvisionnement des équipements de l’unité de transformation<br />
nécessitent des études préalables, en particulier les avant-projets décrivant les différentes<br />
voies de transformation et le dimensionnement des modules unitaire de traitement de la<br />
- 75 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
matière première du stockage à la production d’extraits. La spécification des équipements<br />
est une phase particulièrement importante pour permettre de mener à bien toutes les<br />
opérations unitaires en intégrant si besoin le traitement d’autres matières premières<br />
végétales issues de Mayotte et pouvant entrer en synergie avec le projet.<br />
L’aménagement d’une unité d’appui technique et de R&D devra, pour bénéficier également<br />
de synergie, s’inscrire avec le développement des structures d’appui à l’aquaculture (mise en<br />
œuvre du SDRAM à venir).<br />
Tableau 16 : indication des coûts initiaux au projet d’unité de transformation<br />
Item Min (K€) Max (K€)<br />
Réalisation d’un Avant-Projet<br />
Sommaire définissant les<br />
besoins en terme de<br />
transformation, cet APS<br />
pourra intégrer des<br />
transformations d’autres<br />
végétaux ou produits de la<br />
mer afin d’optimiser la<br />
charge de travail.<br />
Etude préliminaire d’une<br />
unité de soutien technique et<br />
scientifique à la partie Algue<br />
Equipements unité de<br />
transformation<br />
150 250<br />
100 200<br />
Cf. : Annexe 3 exemple d’équipements de base d’une unité<br />
de transformation d’algues<br />
Calendrier des tâches<br />
Figure 39 : chronogramme prévisionnel pour la mise en œuvre du projet 3<br />
Nº Durée Nom de la tâche<br />
1 1029 j ours Projet 1 : installation de culture à terre<br />
11 1205 j ours Projet 2 : récolte et installation en mer<br />
30 792 j ours Proj et 3 : Transformation et R&D<br />
31 792 j ours Usine de transformation<br />
32 90 jours Etude APS<br />
33 60 jours Etude du site d' implantation<br />
34 120 jours Etude APD<br />
35 60 jours Appel d' offres<br />
36 180 jours Construction de l' usine<br />
37 60 jours Approvisionnement des équipements<br />
38 0 jour Mise en route et Production<br />
39 461 j ours Centre Technique et R&D<br />
40 180 jours Etude spécifiq ue algue<br />
41 180 jours Aménagement spécifique<br />
42 0 jour Opérationnalité<br />
A1 A2 A3 A4 A5<br />
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4<br />
- 76 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Management des projets<br />
Le projet global de développement d’une activité de production d’algues sur Mayotte doit se<br />
faire dans un environnement complexe de textes d’orientations stratégiques et<br />
règlementaires dont une liste non exhaustive est présentée en Annexe 4 de ce document.<br />
Parallèlement pour chaque projet nous avons présenté les partenaires pouvant intervenir. Le<br />
Tableau 17 synthétise l’ensemble de ces acteurs identifiés en première approche (et qu’il<br />
conviendra d’enrichir).<br />
Parallèlement nous avons construit une matrice de responsabilité qui indique le niveau<br />
d’implication dans les différents processus du projet global de chaque partenaire. Cette<br />
représentation (structure des actions du projet ou structure de découpage de projet (WBS)<br />
vs structure organisationnelle du projet ou structure organisationnelle du projet (OBS) est<br />
appelée RACI.<br />
La matrice RACI a pour objectif de définir le rôle de chaque partenaire dans le projet, son<br />
niveau de responsabilité dans la conduite d’une action. On distingue notamment les :<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Réalisateurs (R) : entités « propriétaires » ou « moteurs » de l’action. Il doit y avoir au<br />
moins un réalisateur pour chaque action.<br />
Autorité (A) : entité qui doit rendre des comptes sur l’avancement de l’action. Il n’y a<br />
qu’une autorité pour chaque action. R & A sont parfois confondus)<br />
Consultés.(C) : Entités dont l’expertise participe à la mise en œuvre et l’achèvement<br />
du projet. Elles doivent être consultées ; ce sont des personnes ou des groupes<br />
« ressources ».<br />
Informés (I) : entités devant être tenues au courant des résultats.<br />
Supporters (S) : structures apportant un soutien dans la mise en œuvre.<br />
L’Annexe 5 développe cette matrice indiquant pour chaque partenaire son niveau<br />
d’implication dans l’action.<br />
L’analyse de cette matrice montre la complexité sous-jacente qu’un porteur de projet<br />
rencontrera pour mener l’ensemble des actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ceci est<br />
particulièrement vrai pour tout ce qui concerne les relations avec le groupe dénommé<br />
« institutionnel » garant de l’application des règles et recommandations inscrites dans les<br />
documents stratégiques encadrant le développement du département de Mayotte.<br />
Il apparait donc nécessaire de mettre en œuvre une structure spécifique des services de<br />
l’Etat dont l’objectif sera de piloter le développement de cette filière en assurant un rôle<br />
d’interface entre les opérateurs et les différentes administrations ou organisations en charge<br />
du support du développement.<br />
Au-delà du simple pilotage, ce comité de « concertation » (forme de guichet unique)<br />
regroupera les principaux représentants des acteurs publics, politiques, scientifiques,<br />
économiques et citoyens en une sorte de « guichet unique » apte à répondre de façon<br />
concertée à une problématique donnée sans que le porteur du projet s’adresse<br />
individuellement à tous les services ou groupes d’opinion concernés par le déroulement<br />
d’une action spécifique.<br />
- 77 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Tableau 17 : liste (non exhaustive) des acteurs pouvant s’impliquer dans le projet<br />
Institutionnels<br />
Ademe<br />
AFD / OSEO<br />
Caisse de Sécurité Sociale<br />
de Mayotte ‐ Prévention<br />
des risques<br />
professionnels<br />
Centre National de la<br />
Fonction Territoriale<br />
Conseil Economique et<br />
Social de Mayotte<br />
Conseil Général<br />
DAAF ‐ Direction de<br />
l'Agriculture et de la<br />
Forêt<br />
DASS ‐ Direction des<br />
Affaires Sanitaires et<br />
Sociales de Mayotte<br />
DEAL<br />
Délégation au droit des<br />
femmes et à l'égalité<br />
Députés de Mayotte<br />
Medetram ‐ Sist Mayotte ‐<br />
Médecine du travail<br />
Parc naturel marin de<br />
Mayotte<br />
Pôle Emploi Réunion ‐<br />
Mayotte<br />
Préfecture de Mayotte<br />
Sénateurs de Mayotte<br />
Formation<br />
professionnelle<br />
AGEPAC ‐ Formation<br />
professionnelle<br />
ALOALO ‐ Formation<br />
professionnelle<br />
Greta de Mayotte ‐<br />
Formation<br />
professionnelle<br />
Instituts de R&D et<br />
transfert<br />
ADEM ‐ GESAM<br />
(Association des Eleveurs<br />
Mahorais)<br />
Aquamay<br />
ARDA<br />
BRGM ‐ Antenne de<br />
Mayotte<br />
Ceva<br />
Ifremer<br />
Météo France Mayotte<br />
Organisation pour le<br />
développement<br />
ADIE ‐ Aide à la Création<br />
d'Entreprises / Insertion<br />
BGE MAYOTTE ‐ Aide à la<br />
création d'entreprises<br />
Centre d'Affaires de<br />
Mayotte ‐ Domiciliation<br />
d'entreprises<br />
Centre de bilan de<br />
compétences<br />
Chambre de Commerce<br />
et d"Industrie<br />
Chambre de Métiers et<br />
de l'Artisanat de Mayotte<br />
Comité du Tourisme de<br />
Mayotte<br />
Port de commerce de<br />
Longoni<br />
Organisations Non<br />
Gouvernementales<br />
AMMEFLHORC ‐<br />
Association<br />
environnement<br />
Services des Affaires<br />
Maritimes<br />
Media<br />
Croix rouge française<br />
SGAER Caribou FM 107.5 Lion's Club<br />
Sieam ‐ Syndicat<br />
Intercommunal de l'Eau<br />
et d'Assainissement de<br />
Mayotte<br />
SMIAM ‐ Syndicat Mixte<br />
d'Investissement pour<br />
l'Aménagement de<br />
Mayotte<br />
Kwési FM<br />
Le Guide de Mayotte ‐<br />
Presse, ouvrages divers<br />
Naturalistes,<br />
Environnement et<br />
Patrimoine de Mayotte ‐<br />
Association<br />
environnement<br />
Rotary Club<br />
Entreprises Privées<br />
ACHM ‐ Association des<br />
Croiseurs Hauturiers de<br />
AGRIKAGNA ‐ Aliment<br />
pour bétail<br />
Autres investisseurs<br />
potentiels<br />
BEAUTE + ‐ Cosmétiques,<br />
Parfumerie, Fournitures<br />
prof. coiffure<br />
Décharge publique<br />
Hamaha / Star<br />
EDM<br />
Enzo Technic Recyclage<br />
Forintech Mayotte ‐<br />
Forage, Géologie,<br />
Géophysique, Travaux<br />
subaquatiques<br />
Gaz de Mayotte<br />
IBS ‐ Béton, parpaings,<br />
ferraillage<br />
Isirus ‐ Bureau d'étude<br />
(environnement marin)<br />
Isséo ‐ Ferronnerie,<br />
métallerie, travaux<br />
subaquatiques<br />
Koropa Légumes ‐<br />
agriculteurs, élevage,<br />
coopératives<br />
Laiterie de Mayotte<br />
Mahoraise Légumes<br />
Mayotte aquaculture<br />
- 78 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Outre le rôle d’assistance au montage des projets, ce comité de concertation pourra se voir<br />
attribuer deux autres volets :<br />
1.4 Social<br />
2.4 Suivi et règlementaire.<br />
Axe 1 - Volet Social<br />
Objectifs :<br />
S’agissant d’une activité nouvelle pour Mayotte ce volet est particulièrement important car il<br />
convient dès l’établissement de la production, qu’elle se fasse par récolte ou par culture,<br />
d’organiser la chaîne de valeur qui va de la matière première aux utilisateurs de celle-ci. En<br />
effet la forte dépendance entre les différents facteurs de production et leurs acteurs le long<br />
de la chaîne de valeur (production, transformation, qualité / traçabilité, transport et<br />
commercialisation) implique une bonne coordination des actions. Il est reconnu que les<br />
organisations professionnelles (comme les organisations de producteurs ou les<br />
interprofessions) jouent un rôle moteur d’accroissement de la valeur produite.<br />
La structuration de la filière algue de Mayotte autour d’une organisation professionnelle<br />
permettra notamment par ses fonctions spécifiques :<br />
De définir des besoins en formation tant du point de vue de la récolte, de la<br />
production, la transformation mais aussi pour la mise en marché, le contrôle de la<br />
qualité des produits.<br />
D’assurer la représentation des professionnels face aux institutions, tant sur le plan<br />
technique, économique que social en participant aux différentes instances garantes<br />
des politiques de développement.<br />
De jouer un rôle économique dans la mutualisation des moyens.<br />
Actions :<br />
1. Organiser les récoltants (autour d'une organisation professionnelle, d'un système<br />
coopératif pour mutualiser les moyens et les forces de vente).<br />
2. Organiser les algoculteurs.<br />
3. Former les opérateurs aux différents métiers (récoltant, algoculteurs, transformateurs,<br />
contrôle qualité, commerciaux...).<br />
Axe 2 - Volet Institutionnel - suivi et règlementation<br />
Objectifs :<br />
L’activité de chacun des projets fera l’objet d’un suivi concernant l’impact des activités sur le<br />
plan du développement durable. Ces suivis doivent pouvoir être utilisés par le comité de<br />
concertation comme véritables outils du management de cette filière. Plus particulièrement le<br />
comité devra, sur la base des informations, donner des recommandations aux professionnels<br />
ou à leur représentation pour garantir la pérennité de l’activité tant sur le plan<br />
environnemental, social qu’économique.<br />
- 79 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Actions :<br />
1. Etudier les règles d'attribution des licences d'exploitation et des concessions.<br />
2. Mettre en place les outils techniques et financiers pour supporter la filière.<br />
3. Définir un statut du récoltant (avec ses droits et devoirs).<br />
4. Suivre l'état des stocks, contrôler l'activité de récolte et statuer sur les quotas annuels.<br />
5. Assurer le suivi des productions de culture et donner les recommandations pour le<br />
développement.<br />
E. Conclusion générale<br />
Cette étude a permis de montrer que Mayotte dispose d’un patrimoine algale d’une grande<br />
richesse, colonisant différents compartiments de l’écosystème. Parallèlement le<br />
développement d’une économie durable autour du milieu aquatique est souhaité tant par les<br />
collectivités locales que par l’état.<br />
L’inventaire réalisé durant une mission de terrain corrélé avec les éléments bibliographiques<br />
en lien avec les domaines d’applications possibles sur différents marchés montre qu’il est<br />
possible de structurer une véritable filière autour des algues.<br />
Le développement de cette filière algale sur Mayotte doit être déroulé selon la chaîne de<br />
valeur allant de la production en écloserie à terre de plantules ou souches d’algues (macro et<br />
micro) à la mise en marché des produits bruts ou transformés en passant par une phase de<br />
développement de la biomasse en mer. Ce développement devra se faire quand cela est<br />
justifié ou possible avec le développement parallèle de l’aquaculture sur Mayotte ou en<br />
cohérence avec des activités pouvant servir (captage de CO2, utilisation de lixiviats ou<br />
effluents) ou se servir (bioremédiation) des productions de biomasse.<br />
Le développement économique d’une manière générale est encadré par de nombreuses<br />
règles émanantes de différents services de l’état ou des collectivités. Face à la multiplicité<br />
des acteurs il est préconisé la mise en place d’un guichet unique sous la forme d’un comité<br />
de concertation dont l’objet sera d’apporter d’une part des réponses et décisions rapides<br />
aux promoteurs de projets souhaitant s’inscrire dans le développement de cette filière, quel<br />
que soit le niveau de la chaîne de valeur et un appui spécifique sur le plan social et<br />
règlementaire d’autre part.<br />
Face à ce Comité de concertation devront se constituer des groupes porteurs des 3 grands<br />
projets définis dans ce document autour des installations à terre, installations en mer et<br />
installations de transformation et commercialisation pour lesquels les principales actions ont<br />
été développées.<br />
Enfin un volet pédagogique de démonstration doit être développé pour permettre au<br />
Mahorais de se réapproprier le lagon et orienter ainsi les jeunes générations vers des<br />
activités porteuses liées à la gestion des espaces côtiers<br />
- 80 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Publications, ouvrages, brevets<br />
Akimoto K., Higashiyama K., Ishihara T., Kanada T., Tanaka Y. and Arai M. 2002. Domestic<br />
fowl eggs having a high content of highly unsaturated fatty acid, their production process and<br />
their use. US6432468, issued 08/13/2002. http://www.freepatentsonline.com/6432468.html.<br />
Association of Biotechnology and Pharmacy. 2010. Antibacterial properties of Spirulina<br />
platensis, Haematococcus pluvialis, Botryococcus braunii micro algal extracts. Current<br />
Trends in Biotechnology and Pharmacy, vol 4(3). http://abap.co.in/antibacterial-properties-spirulinaplatensis-haematococcus-pluvialis-botryococcus-braunii-micro-alga.<br />
Ateweberhan M., Bruggemann J.H. and Breeman A.M. 2005. Seasonal dynamics of<br />
Sargassum ilicifolium (Phaeophyta) on a shallow reef flat in the southern Red Sea (Eritrea).<br />
Marine Ecology Progress Series, vol 292, p. 159-171. http://personnel.univreunion.fr/ppinet/ECOMAR/papers/2005_Ateweberhan_MEPS.pdf.<br />
Ben Said R., El Abed A. and Romdhane M.S. 2002. Etude d’une population de l’algue brune<br />
Padina pavonica (L) Lamouroux à Cap Zebib (Nord de la Tunisie). Bull. Inst. Natn. Scien.<br />
Tech. Mer de Salammbô, vol 29, p. 95-103.<br />
http://www.oceandocs.net/bitstream/1834/247/1/article11.pdf<br />
Ben Said R. 2010. Premiers résultats sur la culture des spores de padina pavoniva<br />
(Linnaeus) Thivy Lamouroux. In: Proceedings of the 4th Mediterranean Symposium on<br />
marine Vegetation. Yasmine-Hammamet, 2-4 December 2010. http://www.racspa.org/sites/default/files/doc_vegetation/actes_4ieme_sympos_veg_2010.pdf<br />
Benson M.R. 1986. A demographic study of Dictyopteris undulata Holmes (Dictyotales,<br />
Phaeophyta) at Santa Catalina Island, California. Phycologia, vol 25(4), p.448-454.<br />
http://dx.doi.org/10.2216/i0031-8884-25-4-448.1.<br />
Berchez F.A., Pereira R.T.L. and Kamiya N.F. 1993. Culture of Hypnea musciformis<br />
(Rhodophyta, Gigartinales) on artificial substrates attached to linear ropes!; Hydrobiologia,<br />
vol 260/261, p. 415-420. bibliographie\1993_Berchez et al.pdf<br />
Bernard O., Bougaran G., Cadoret J.-P., Kaas R., Latrille E., Sialve B. and Steyer J.-P. 2010.<br />
Method for the fixation of CO2 and for treating organic waste by coupling an anaerobic<br />
digestion system and a phytoplankton microorganism production system. WO/2010/084274,<br />
issued 07/29/2010. http://www.freepatentsonline.com/WO2010084274A1.html.<br />
Borowitzka M.A. 1999. Economic evaluation of microalgal processes and products. In:<br />
Chemicals from Microalgae. Taylor & Francis, London. p. 387-409. (ouvrage).<br />
CAREX, WWF, ARVAM, 2002. Plan de Gestion du Lagon de Mayotte. Rapport réalisé pour<br />
le compte de la DAF Mayotte, 128p. bibliographie\Plan de Gestion du Lagon de Mayotte<br />
2002.<br />
- 81 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Carlsson A.S., van Beilen J.B., Möller R. and Clayton D. 2007. Micro- and macroalgae:<br />
Utility for industrial applications. EPOBIO Project: Realizing the Economic<br />
Potential of Sustainable Resources – Bioproducts from Non-food crops. CPL Press, 86 p.<br />
http://epobio.net/pdfs/0709AquaticReport.pdf.<br />
<strong>CEVA</strong>. 1990. Report on regional workshop on the culture and utilization of seaweeds.<br />
(ouvrage).<br />
Chaumont D. 1993. Biotechnology of algal biomass production: a review of systems for<br />
outdoor mass culture. Journal of Applied Phycology, vol 5, p. 53-604.<br />
http://large.stanford.edu/publications/coal/references/docs/chaumont.pdf.<br />
Chen P., Min M., Chen Y., Wang L., Li Y., Chen Q., Wang C., Wan Y., Wang X., Cheng Y.,<br />
Deng S., Hennessy K., Lin X., Liu Y., Wang Y., Martinez B. and Ruan R. 2009. Review of the<br />
biological and engineering aspects of algae to fuels approach. Int J Agric& Biol Eng, vol 2(4),<br />
p 1-30. http://www.ijabe.org/index.php/ijabe/article/viewFile/200/104.<br />
Chennubhotla V.K.S., Kalimuthu S. and Selvaraj M. 1986. Seaweed culture – its feasibility<br />
and industrial utilization. In: Proceedings of the Symposium on Coastal Aquaculture, Part 4,<br />
MBAI, 12-18 January 1980, Cochin. http ://eprints.cmfri.org.in/2335/1/Article_3<strong>2.pdf</strong>.<br />
Chennubhotla V.S.K. 1988. Status of seaweed culture in India. In Seminar report on the<br />
status of seaweed culture in China, India, Indonesia, ROK, Malaysia, Philippines and<br />
Thailand. Philippines, 2-21 May 1988. FAO, Rome.<br />
http://www.fao.org/docrep/field/003/AB719E/AB719E03.htm.<br />
Clark J.R.K. 1990. Beaches of Kaua’i and Ni’ihau. University of Hawaii Press. 114 p.<br />
http://books.google.fr/books?id=T4Nff4mz8jgC&dq=asparagopsis+limu+harvest&hl=fr&sourc<br />
e=gbs_navlinks_s.<br />
Conseil de Direction du 18 au 21 novembre 2008. 2008. Mayotte. Programme sectoriel<br />
aquacole 2009-2012. 15 p. http://test.odeadom.fr/wp-content/uploads/2009/08/rapports-ps-aquacolemayotte-nov-2008-et-modif-juin-2009.pdf.<br />
Coppen J.J.W. and Nambiar P. 1991. Agar and Alginate production from seaweed in India.<br />
Bay of Bengal Programme. Post-Harvest Fisheries. FAO. 32 p.<br />
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/ae448e/ae448e00.pdf.<br />
Deboer J.A. 1981. The marine plant resource and their aquaculture potential in the<br />
Bahamas. FAO Report, 49 p. http://www.fao.org/docrep/field/003/AC411E/AC411E00.htm.<br />
De Clerck O., Coppejans E. and Prud’homme van Reine W.F. date inconnue. Dictyota J.V.<br />
Lamouroux. In: Cryptogams: Algae. p. 141-145.<br />
www.vliz.be/imisdocs/publications/229900.pdf.<br />
Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile. 2010. Cosechas chilenas por especies y region.<br />
Enero-Diciembre Año 2008.<br />
http://www.directorioaqua.com/contenido/pdf/Acuicola/Directorio/ACUICULTURA-2009.pdf.<br />
- 82 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Esser K. 1982. Cryptogams. Cyanobacteria, algae, fungi, lichens. Cambridge University<br />
Press, Edinburgh. 615 p.<br />
http://books.google.fr/books?id=1P08AAAAIAAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s.<br />
Famà P., Wysor B., Kooistra W.H.C.F. and Zuccarello G.C. 2002. Molecular phylogeny of the<br />
genus Caulerpa (Caulerpales, Chlorophyta) inferred from chloroplast tufA gene. J. Phycol.,<br />
vol 38, p. 1040-1050. bibliographie\Famà et al 200<strong>2.pdf</strong>.<br />
Ferret C. 2008. Etude de la teneur en composés phénoliques et du potentiel antioxydant<br />
ssocié à ces composés, de plusieurs espèces de Sargassaceae du Pacifique Sud. Mémoire<br />
de Master, Université de Bretagne Occidentale, Lebham. 30 p.<br />
http://www.crisponline.net/Portals/0/New%20reports/FR%202008%20Etude%20teneur%20c<br />
omp%20phenoliques%20Sargassaceae.pdf.<br />
Flachmann R., Sauer M., Schopfer C.R. and Klebsattel M. 2005. Method for hydrolyzing<br />
carotenoids esters. US20050255541, issued 11/17/2005.<br />
http://www.freepatentsonline.com/y2005/0255541.html.<br />
Flammini A. 2011. Algae-based biofuels. Perspectives for developed and developing<br />
countries. Workshop “Algen – eine Energiequell für Österreich?”, 16 March 2011. 14 p.<br />
http://www.fao.org/fileadmin/templates/aquaticbiofuels/PPT/Flammini_-Algae_workshop_Graz_16_March_0.<strong>2.pdf</strong>.<br />
Floc’h J.-Y., Cabioc’h J., Le Toquin A., Boudouresque C.-F., Meinesz A. and Verlaque<br />
M. 2006. Guide des algues des mers d’Europe. Delachaux et Niestlé, Paris. 272 p.<br />
(ouvrage).<br />
Florencio F.J. 2011. Cyanobacteria as producers of organic chemicals through metabolic<br />
engineering. Colloque Alg'n'Chem, Montpellier, France, 7-10 Novembre 2011. 44 p.<br />
bibliographie\2011_Florencio.pdf.<br />
Friedlander M. and Ben-Amotz A. 1990. Acclimation of brown seaweeds in an outdoor<br />
cultivation system and their cytokinin-like activity. Journal of Applied Phycology, vol 2, p. 145-<br />
154. bibliographie\1990_Friedlander & Ben-Amotz.pdf.<br />
Friedlander A., Poepoe K., Poepoe K., Helm K., Bartram P., Maragos J. and Abbott I. 2000.<br />
Application of Hawaiian traditions to community-based fishery management. In : Proceedings<br />
of the 9 th International Coral Reef Symposium, Bali, Indonesia, 23-27 Ocotber 2000, vol 2.<br />
6 p. http://www.coremap.or.id/downloads/ICRS9th-Friedlander.pdf.<br />
Gaitán-Espitia J.D. 2011. Metabolic rates and primary productivity of the marine macroalgae<br />
Dictyopteris delicatula in Taganga Bay, Colombian Caribbean. Revista de Biologia Marina y<br />
Oceanografia, vol 46(1), p. 73-77. bibliographie\Gaitan Espitia 2011.pdf.<br />
Ganesan M., Subba Rao P.V., Mairh O. P. 1999. Culture of marine brown alga Padina<br />
boergesenii (Dictyotales, Phaeophyta) at Mandapam coast, southeast coast of India. Indian<br />
journal of marine sciences, vol 28(4), p. 345-415.<br />
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1281706.<br />
Garcia-Sanz T., Ruiz-Fernandez J.M., Ruiz M., Garcia R., Gonzalez M.N. and Pérez M.<br />
2010. An evaluation of a macroalgal bioassay tool for assessing the spatial extent of nutrient<br />
- 83 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
release from offshore fish farms. Marine Environmental Research, vol 70, p. 189-200.<br />
bibliographie\Garcia Sanz et al 2010.pdf.<br />
Geraldino P.J.L., Liao L.M. and Sung Min Boo. 2005. Morphological study of the marine algal<br />
genus Padina (Dictyotales, Phaeophyceae) from Southern Philippines: 3 species new to<br />
Philippines. Algae, vol 20(2), p. 99-112. bibliographie\Geraldino et al 2005.pdf.<br />
Guiry M.D. and Dawes C.J. 1992. Daylength, temperature and nutrient control of<br />
tetrasporogenesis in Asparagopsis armata (Rhodophyta). J. Exp. Mar. Biol. Ecol., vol 158, p.<br />
192-217. http://www.seaweed.ie/guiry/pdfs/Guiry_Dawes_199<strong>2.pdf</strong>.<br />
Hartmann P., Boulanger A.-C., Sainte-marie J., Bristeau M.-O., Ebert K., Sciandra A. and<br />
Bernard O. 2011. Numerical prediction of microalgae productivity and energy requirement<br />
during the cultivation process in raceway. Colloque Alg'n'Chem, Montpellier, France, 7-10<br />
Novembre 2011. 25 p. bibliographie\2011_Hartmann et al.pdf.<br />
Hawaii Administrative Rules. §13-34-1.1. Pupukea marine life conservation district, Oahu.<br />
5 p. http://hawaii.gov/dlnr/dar/rules/ch34.pdf.<br />
Hwang I.-K., Kim H.-S. and Lee W.J. 2005. Polymorphism in the brown alga Dictyota<br />
dichotoma (Dictyotales, Phaeophyceae) from Korea. Marine Biology, vol 147, p. 999-1015.<br />
bibliographie\Hwang et al 2005.pdf.<br />
Jarvis E.E. 2008. Aquatic Species Program (ASP): Lessons Learned (National Renewable<br />
Energy Laboratory). In AFOSR Workshop, Washington, February 19-21, 2008. 29 p.<br />
http://www.nrel.gov/biomass/pdfs/jarvis.pdf.<br />
Kaladharan P. and Kaliaperumal N. 1999. Seaweed industry in India. NAGA, The ICLARM<br />
Quaterly, vol 22(1), p. 11-14. http://eprints.cmfri.org.in/7598/1/616-NAGA____P.KALADHARAN_1999.pdf.<br />
Kaladharan P. and Jayasankar R. Date inconnue. Chapter 29: Seaweeds In Status of<br />
Exploited Marine Fishery Resources of India. p. 228-239. http://eprints.cmfri.org.in/42/1/29.pdf.<br />
Kang K.-H., Qian Z.-J., Ryu B.M. and Kim S.-K. 2011. Characterization of Growth and<br />
Protein Contents from Microalgae Navicula incerta with the Investigation of Antioxidant<br />
activity of Enzymatic Hydrolysates. Food Sci. Biotechnol., vol 20(1), p. 183-191.<br />
http://www.springerlink.com/content/48730qvg164x6p57/.<br />
Kimura S.O. and Tanaka T. 2006. Method for culturing Sargassum. JP2006129833, issued<br />
05/25/2006. http://www.freepatentsonline.com/JP2006129833.html.<br />
Kraan S. and Barrington K.A. 2005. Commercial farming of Asparagopsis armata<br />
(Bonnemaisoniceae, Rhodophyta) in Ireland, maintenance of an introduced species?.<br />
Journal of Applied Phycology, vol 17(2), p. 103-110. bibliographie\Kraan & Barrington<br />
2005.pdf.<br />
Ksouri J., Elferjani H. and Mensi F. 2010. Pour une collecte rationnelle de l’algue brune<br />
Padina pavonica (L) Thivy: Evaluation de ses potentialités naturelles à Cap Zebib (Nord de la<br />
Tunisie). In Proceedings of the 4th Mediterranean Symposium on marine Vegetation.<br />
- 84 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Kuffner I.B. and Paul V.J. 2001. Effects of nitrate, phosphate and iron on the growth of<br />
macroalgae and benthic cyanobacteria from Cocos Lagoon, Guam. Marine Ecology Progress<br />
Series, vol 222, p. 63-72. http://www.int-res.com/articles/meps/222/m222p063.pdf.<br />
Lapointe B.E. 1986. Phosphorus-limited photosynthesis and growth of Sargassum natans<br />
and Sargassum fluitans (Phaeophyceae) in the western North Atlantic. Deep Sea Research<br />
Part A. Oceanographic Research Papers, vol 33(3), p. 391-399.<br />
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0198014986900993.<br />
Larned S.T. 1998. Nitrogen- versus phosphorus-limited growth and sources of nutrients for<br />
coral reef macroalgae. Marine Biology, vol 132, p. 409-421. bibliographie\Larned 1998.pdf.<br />
Lavens P. and Sorgeloos P. 1996. Manual on the Production and Use of Live Food for<br />
Aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper, FAO, Rome. 295 p.<br />
http://www.fao.org/docrep/003/w3732e/w3732e00.htm.<br />
Lognone V., Dion P., Lüning K., Santos R., Da Mata L.F.R., Schünhoff A., Bansemir R. and<br />
Lindequist U. 2005. Procédé de production à terre des algues rouges de la famille des<br />
Bonnemaisoniacées. WO 2005/015983, issued 24/02/2005. bibliographie\Lognone et al<br />
2005.pdf.<br />
Mageswaran R. and Sivasubramaniam S. 1984. Mineral and protein contents of some<br />
marine algae from the coastal areas of Northern Sri Lanka. J. Natn. Sci. Coun. Sri lanka, vol<br />
12(2), p. 179-189. http://thakshana.nsf.ac.lk/pdf/JNSF1-<br />
25/JNSF12_2/JNSF%2012_2_179.pdf.<br />
Mai H., Fotedar R. and Fewtrell J. 2010. Evaluation of Sargassum sp. as a nutrient-sink in an<br />
integrated seaweed-prawn (ISP) culture system. Aquaculture, vol 310, p. 91-98.<br />
bibliographie\Mai et al 2010.pdf.<br />
Mason B. 2004. The importance of detritus and microenvironment nutrient enrichment to the<br />
growth of coral reef macroalgae, Halimeda and Dictyota. Master of Science, University of<br />
North California, Wilmington. 53 p. http://libres.uncg.edu/ir/uncw/listing.aspx?id=1440.<br />
Mata T.M., Martins A.A. and Caetano N.S. 2010. Microalgae for biodiesel production and<br />
other applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 14, p. 217-<br />
232. http://jlakes.org/web/microalgae-for-biodiesel-production-RSER2010.pdf.<br />
Mata L. and Santos R. 2010. Sustainable, integrated semi-intensive aquaculture of<br />
seaweeds and fish in southern Europe. International Workshop on Sustainable Extensive<br />
and Semi-Intensive Coastal Aquaculture in Southern Europe, Tavira, Portugal, 20-21<br />
January 2010. 16 p.<br />
http://www.seacase.org/PDF/WP7/SEACASE%20International%20Workshop%20TAVIRA%20PT/PDF%20Comu<br />
nica%C3%A7%C3%B5es%20Orais/IV/IV_Oral_Mata.pdf.<br />
Mata L., Gaspar H. and Santos R. 2011. Carbon/Nutrient balance in relation to biomass<br />
production and halogenated compound content in the red alga Asparagopsis taxiformis<br />
(Bonnemaisoniaceae). J. Phycol, vol 47, pages inconnues. bibliographie\Mata et al 2011.pdf.<br />
- 85 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
McHugh D.J. 2003. A guide to the seaweed industry. FAO Fisheries Technical Paper, Rome.<br />
118 p. http://www.fao.org/docrep/006/y4765e/y4765e00.htm.<br />
Milledge J. 2010. The potential yield of microalgae oil. Biofuels International, vol 4(1), p. 44-<br />
45. http://eprints.soton.ac.uk/76205/.<br />
Milledge J.J. 2011. Commercial application of microalgae other than as biofuels : a brief<br />
review. Reviews in Environmental Science and Biotechnoly, vol 10(1), p. 31-41.<br />
bibliographie\Milledge 2011.pdf.<br />
Mohan N., Rao H.P., Kumar R.R. and Sivasubramanian V. 2010. Mass Cultivation of<br />
Chroococcus turgidus and Oscillatoria sp. and Effective Harvesting of Biomass by Low-cost<br />
methods. 15 p. http://www.scribd.com/doc/49011257/Mass-Cultivation-of-Chroococcusturgidus-and-Oscillatoria-sp.<br />
Mollion J. 1984. Seaweed cultivation for phycocolloid in the Mediterranean. Hydrobiologia,<br />
vol 116/117, p. 288-291. bibliographie\1984_Mollion.pdf.<br />
Moro G., Gasparatto E., Morvan P.-Y., Vallee R. 2010. Sustainable Marine Actives<br />
from Biotechnology. Personal Care, Septembre 2010, p. 86-87. http://www.codif-rechercheet-nature.com/userfiles/PUBLICATIONS/personalcareseptembre2010030.pdf.<br />
Morrall S. 1968. Distribution and sexual reproduction in species of Caulerpa in Barbados.<br />
Master of Science, McGill University. 212 p.<br />
http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1326894560169~839.<br />
Mouradi A., Chikhoui M/; Fekhaoui M., Bennasser L., Chiadmi N. and Givernaud T. 2008.<br />
Croissance et capacité reproductive d’Hypnea musciformis (Rhodophyceae, Gigartinales) de<br />
la côte atlantique marocaine. Afrique Science, vol 4(1), p. 99-124.<br />
http://www.afriquescience.info/docannexe.php?id=1036.<br />
Narashima R.G.M. and Umamaheswara R. 1991. Spore discharge in the red algae<br />
Bostrychia tenella and Caloglossa leprieurii from the Godavari estuary, India. Journla of<br />
Applied Phycology, vol 3, p. 153-158. bibliographie\Narashima & Umamaheswara 1991.pdf.<br />
Ni Chualain F., Maggs C.A., Saunders G.W. and Guiry M.D. 2004. The invasive genus<br />
Asparagopsis (Bonnemaisoniaceae, Rhodophyta): molecular systematics, morphology and<br />
ecophysiology of Falkenbergia isolates. J. Phycol., vol 40, p. 1112-1126. bibliographie\Ni<br />
Chualain 2004.pdf.<br />
Ni-Ni-Win, Hanyuda T., Arai S., Uchimura M., Prathep A., Draisma S.G.A., Phang S.M.,<br />
Abbott I.A., Millar A.J.K. and Kawai H. 2011. A taxonomic study of the genus Padina<br />
(Dictyotales, Phaeophyceae) including descriptions of four new species from japan, Hawaii<br />
and the Andaman Sea. J. Phycol., vol 47, p. 1193-1209. bibliographie\Ni-Ni-Win et al<br />
2011.pdf.<br />
- 86 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
O’Neal S.W. and Prince J.S. 1988. Seasonal effects of light, temperature, nutrient<br />
concentration and salinity on the physiology and growth of Caulerpa paspaloides<br />
(Chlorophyceae). Marine Biology, vol 97, p. 17-24. bibliographie\O'Neal Prince 1988.pdf.<br />
Pakker H., Breeman A.M., Prud’homme van Reine W.F. and van den Hock C. 1995. A<br />
comparative study of temperature responses of Caribbean seaweeds from different<br />
biogeographic groups. Journal of Phycology, vol 31(4), p. 499-507.<br />
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1529-8817.1995.tb02543.x/abstract.<br />
Payri C. 2006. Invasion des îles basses des Tuamotu (Polynésie française) par l’algue brune<br />
Turbinaria ornata. Etude des flux géniques et de la structuration génétique des populations.<br />
In : Programme de recherche Invasions Biologiques. Colloque de restitution, 17-19 octobre<br />
2006, Moliets, France. p. 213-218.<br />
http://www.crisponline.net/Portals/0/New%20reports/FR%202008%20Etude%20teneur%20c<br />
omp%20phenoliques%20Sargassaceae.pdf.<br />
Person J., Mathieu D., Sassi J.-F., Lecurieux-Belfond L., Gandolfo R., Boyen C., Lépine O.,<br />
Pruvost J., Potin P., Deslandes E., Chagvardieff P., Findeling A., Legrand J., Cadoret J.-P.<br />
and Bernard O. 2011. Livre Turquoise. Algues, filières du futur. Editions Adebiotech,<br />
Romainville, 161 p. http://www.greenunivers.com/wpcontent/uploads/2011/08/LIVRE_TURQUOISE-V.screen.pdf.<br />
Phillips J.A. 1998. Studies of reproduction in Australian Dictyopteris australis and<br />
Dictyopteris muelleri (Dictyotales, Phaeophyceae) identify new taxonomic characters.<br />
European Journal of Phycology, vol 33(4), p. 345-355.<br />
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09670269810001736843.<br />
Pickering T. and Mario S. 1999. Survey of commercial seaweeds in south-east Viti Levu (Fiji<br />
Islands): A preliminary study on farming potential of seaweed species present in Fiji. FAO,<br />
Fisheries and Aquaculture Department, Suva, Fiji. Nombre de pages inconnu.<br />
http://www.fao.org/docrep/005/AC880E/AC880E00.htm#TOC.<br />
Prathep A., Wichachucherd B. and Thongroy P. 2007. Spatial and temporal variation in<br />
density and thallus morphology of Turbinaria ornate in Thailand. Aquatic Botany, vol 86, p.<br />
132-138. bibliographie\Prathep et al 2007.pdf.<br />
Preskitt L. 2002. Edible Limu… Gifts from the Sea. Poster. University of Hawaii.<br />
http://www.hawaii.edu/reefalgae/publications/ediblelimu/.<br />
Pruvost J., Cornet J.-F. and Goetz V. 2010. Production solaire de biomasse microalgale en<br />
photobioréacteurs: enjeux, conception et perspectives. Colloque Adebiotech « Algues, filière<br />
du futur », Romainville, 17-19 Novembre 2010. 15 p. bibliographie\2010_Pruvost.pdf.<br />
Quilliam M.A. 2011. Algal Biotoxins : Chemistry, Biology and Commercial Opportunities. In :<br />
Proceedings of the 4 th Congress of the International Society for Applied Phycology, June 19-<br />
24 2011, Halifax, Canada. http://www.isap2011-halifax.org/docs/ISAP2011-<br />
Program_Abstracts.pdf.<br />
- 87 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Ronquillo B. and Ronquillo J. 2010. Shellfish Aquaculture in Northern Philippines. 46 p.<br />
https://www.was.org/documents/MeetingPresentations/AQ2010/AQ2010_0645.pdf.<br />
Russella G. 1970. Rhizoid production in excised Dictyota dichotoma. British<br />
Phycological Journal, vol 5(2), p.243-245.<br />
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00071617000650301.<br />
Santellces B. 1977. Water movement and seasonal algal growth in Hawaii. Marine Biology,<br />
vol 43, p. 225-235. bibliographie\Santellces 1977.pdf.<br />
Schaffelke B. 1999. Short-term nutrient pulses as tools to assess responses of coral reef<br />
macroalgae to enhanced nutrient availability. Marine Ecology Progress Series, vol 182, p.<br />
305-310. http://www.int-res.com/articles/meps/182/m182p305.pdf.<br />
Schnetter R., Hörnig I. and Weber-Peukert G. 1987. Taxonomy of some North-Atlantic<br />
Dictyota species (Phaeophyta). Hydrobiologia, vol 151/152, p. 193-197.<br />
bibliographie\Schnetter et al 1987.pdf.<br />
SIEAM. 2011. La biodiversité algale au service du développement économique de Mayotte,<br />
<strong>Tome</strong> 1 - Etude préliminaire sur la biodiversité algale existante, p 125.<br />
Sipauba-Tavares L.H. and Pereira A.M.L. 2008. Large scale laboratory cultures of<br />
Ankistrodesmus gracilis (Reisch) Korsikov (Chlorophyta) and Diaphanosoma biergei Korinek,<br />
1981 (Cladocera). Braz. J. Biol., vol 68-4), p. 875-883.<br />
http://www.scielo.br/pdf/bjb/v68n4/25.pdf.<br />
Sorto M. 2003. Utilisation et consommation de la spiruline au Tchad. 2nd International<br />
Workshop Food-based approaches for a healthy nutrition, Ouagadougou, 23-28 November<br />
2003. 8 p. http://spirulinagadez.free.fr/pdfs/Tchad_Sorto.pdf.<br />
Spadling H. date inconnues. Got Limu ? Uses for algae in Hawaii and beyond. University of<br />
Hawaii, 6 p. http://www.hawaii.edu/gk-12/evolution/pdfs/algae.uses.highschool.pdf.<br />
Spolaore P., Joannis-Cassan C., Duran E. and Isambert A. 2006. Commercial applications of<br />
microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering, vol 101(2), p. 87-96.<br />
http://www.aseanbiodiversity.info/Abstract/51005627.pdf.<br />
Stewart H.L. 2006. Ontogenic changes in buoyancy, breaking strength, extensibility, and<br />
reproductive investment in a drifting macroalga Turbinaria ornata (Phaeophyta). J. Phycol.,<br />
vol 42, p. 43-50. http://sbc.lternet.edu/~stewart/Hannah_Stewart_webpage/webpageupdated_files/Stewar2006JPhycol.pdf.<br />
Stiger V. and Payri C.E. 1999. Spatial and seasonal variations in the biological<br />
characteristics of two invasive brown algae, Turbinaria ornata (Turner) J. Agardh and<br />
Sargassum mangarevense (Grunow) Setchell (Sargassaceae, Fucales) spreading on the<br />
reefs of Tahiti (French Polynesia). Botanica Marina, vol 42, p. 295-306. bibliographie\Stiger &<br />
Payri 1999.pdf.<br />
- 88 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Thomassin B. A. 1999. Bibliographie des travaux sur les milieux marins et littoraux de l’île de<br />
Mayotte y compris des bancs coralliens et des fonds adjacents, Mise à jour 1999 GIS Lag-<br />
May, p 39. (http://digitalcorpora.org/corp/nps/files/govdocs1/375/375195.pdf) MaJ 2011, p<br />
118<br />
Tronholm A., Sansón M., Afonso-Carrillo J. and De Clerck O. 2008. Distinctive morphological<br />
features, life-cycle phases and seasonal variations in subtropical populations of Dictyota<br />
dichotoma (Dictyotales, Phaeophyceae). Botanica Marina, vol 51(2), p. 132-144.<br />
http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=208643.<br />
Tronholm A., Steen F., Tyberghein L., Leliaert F., Verbruggen H., Ribera Siguna M.A. and<br />
De Clerck O. 2010. Species delimitation, taxonomy, and biogeography of Dictyota in Europe<br />
(Dictyotales, Phaeophyceae). J. Phycol., vol 46, p. 1301-1321. bibliographie\Tronholm et al<br />
2010.pdf.<br />
Trono G.C.Jr. 1988. Manual on seaweed culture: 2. Pond culture of Caulerpa and 3. Pond<br />
culture of Gracilaria. ASEAN/UNDP/FAO Regional Small-Scale Coastal Fisheries<br />
Development Project, Manila, Philippines. 25 p.<br />
http://www.fao.org/docrep/field/003/ac417e/AC417E00.htm.<br />
Trono G.C.Jr. and Tolentino G.L. 1992. Reproductive phenology of Sargassum spp.<br />
(Fucales, Phaeophyta) in Bolinao, Pangasinan [Philippines]. In Proceedings of the 2nd<br />
Republic of the Philippines-USA Phycology Symposium/Workshop, Philippines, Cebu City;<br />
Dumaguete City, 6-18 Jan 1992. http://agris.fao.org/agrissearch/search/display.do?f=1996/PH/PH96005.xml;PH9511397.<br />
Trono G.C.Jr. 1999. Management studies of Sargassum beds in Bolinao, Pangasinan<br />
[Philippines]. PCAMRD Book Series, vol 24, p. 50-51. http://agris.fao.org/agrissearch/search/display.do?f=2000/PH/PH00005.xml;PH2000100759.<br />
Umamaheswara R.M. and Kalimuthu S. 1972. Changes in mannitol and alginic acid contents<br />
of Turbinaria ornate (Turner) J. Agardh in relation to growth and fruiting. Botanica marina, vol<br />
15(1), p. 57-59.<br />
http://eprints.cmfri.org.in/7842/1/Changes_in_Mannitol_and_Alginic_Acid_Contents_of_Turbi<br />
naria_ornata.pdf.<br />
Umezawa Y., Miyajima T., Tanaka Y. and Koike I. 2007. Variation in internal δ 15 N and δ 13 C<br />
distributions and their bulk values in the brown macroalga Padina australis growing in<br />
subtropical oligotrophic waters. J. Phycol., vol 43, p.437-448. bibliographie\Umezawa et al<br />
2007.pdf.<br />
Vandamme, D., Foubert, I., Muylaert, K. (2009). Microalgal biomass production using<br />
wastewater: optimization and feasibility. In Verberk, J. (Ed.), Ross, P. (Ed.), Research<br />
projects book of IWA Benelux young water professionals. International Water Association<br />
Young Water Professionals Regional Benelux Conference. Eindhoven, 30 September - 2<br />
October 2009 (pp. 138-139) IWA Publishing. http://www.power-<br />
- 89 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
link.ugent.be/sites/default/files/upload/Microalgal%20biomass%20production%20using%20w<br />
astewater%20optimization%20and%20feasibility.pdf<br />
Vasuki S., Ganesan M., Subba Rao P.V. and Mairh O.P. 1999. Seasonal growth and<br />
reproduction of marine red alga Asparagopsis delilei (Rhodophyta/Bonnemaisoniales) from<br />
the Mandapam region, southeast coast of India. Indian Journal of marine sciences, vol 28(1),<br />
p. 60-65. http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1992550.<br />
Vasuki S., Ganesan M. and Subba Rao P.V. 2001. Effect of light intensity, photoperiod, ESP<br />
medium and nitrogen sources on growth of marine brown alga Padina boergesenii<br />
(Dictyotales, Phaeophyta). Indian Journal of Marine Sciences, vol 30(4), p. 228-231.<br />
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/4625/1/IJMS%2030%284%29%20228-<br />
231.pdf.<br />
Wagner R.E. 2010. Dental composition comprising algae and method for producing thereof.<br />
EP2210582, issued 07/28/2010. http://www.freepatentsonline.com/EP2210582A1.html.<br />
Wallner M., Lobo S., Boccanera N. and Mendes Da Silva E. 1992. Biomass, carrageenan<br />
yield and reproductive state of Hypnea musciformis (Rhodophyta: Gigartinales) under natural<br />
and experimental cultivated condition. Aquaculture Research, vol 23(4), p. 443-451.<br />
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2109.1992.tb00788.x/abstract.<br />
Wichachucherd B. 2007. Population structure of Padina boryana Thivy (Dictyotales,<br />
Heterokontophyta) in two locations on Phuket Province in Southern Thailand. Thesis.<br />
bibliographie\Wichachucherd 2007.<br />
Wichachucherd B., Liddle L.B. and Prathep A. 2010. Population structure, recruitment, and<br />
succession of the brown alga, Padina boryana Thivy (Dictyotales, Heterokontophyta), at an<br />
exposed shore of Sirinart National Park and a sheltered area of Tang Khen Bay, Phuket<br />
Province, Thailand. Aquatic Botany, vol 92, p. 93-98. bibliographie\Wichachucherd et al<br />
2010.pdf.<br />
Williams S.L. and Fisher T.R. 1985. Kinetics of nitrogen-15 labelled ammonium uptake by<br />
Caulerpa cupressoides (Chlorophyta). Journal of Phycology, vol 21(2), p. 287-296.<br />
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-3646.1985.00287.x/abstract.<br />
Williams S.L. and Dennison W.C. 1990. Light availability and diurnal growth of a green<br />
macroalga (Caulerpa cupressoides) and a seagrass (Halophila decipiens). Marine Biology,<br />
vol 106, p. 437-443. bibliographie\Williams Dennison 1990.pdf.<br />
Win Thin U. 1990. Current status and utilization of seaweed culture in Myanmar in Report of<br />
the Regional Workshop on the Culture & Utilization of Seaweeds, FAO. 186 p.<br />
http://www.fao.org/docrep/field/003/AB727E/AB727E05.htm.<br />
Yoon J.T., Lee C.H., Yang M.H. and Chung G.H. 2011. Artificial Sargassum bed restoration<br />
by transplanting seedlings grown in protective nets. In: Proceedings of the 4th Congress of<br />
the International Society for Applied Phycology, June 19-24 2011, Halifax, Canada.<br />
http://www.isap2011-halifax.org/docs/ISAP2011-Program_Abstracts.pdf.<br />
- 90 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Yotsukura N. 1995. Spermatozoids of Dictyopteris divaricata and Dictyota dichotoma<br />
(Dictyotales, Phaeophyceae) from Japan. Bulletin of the faculty of Fisheries Hokkaido<br />
University, vol 46(3), p.47-51.<br />
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/24151/1/46(3)_P47-51.pdf.<br />
Zemke-White L.W., Bremner G. and Hurd C.L. 1999. The status of commercial algal<br />
utilization in New Zealand. Hydrobiologia, vol. 398/399, p. 487-494. bibliographie\Zemke et al<br />
1999.pdf.<br />
Zemke-White L. and Ohno M. 1999. World seaweed utilization: An end-of-century summary.<br />
Journal of Applied Phycology, vol 11, p. 369-376. bibliographie\Zemke & Ohno 1999.pdf.<br />
Sites web<br />
Algues et Mer. http://www.algues-et-mer.com/recoltes; searched on 13 April 2011.<br />
Alibaba. www.alibaba.com ; searched on 10 May 2012.<br />
Alpha Biotech. http://www.spirulinet.com/boutique/ ; searched on 09 May 2012.<br />
Archipelago wildlife library. Sweet-Smelling Seaweed (Dictyopteris membranaceae).<br />
http://wildlife-archipelago.gr/wordpress/el/marine-flora/sweet-smelling-seaweed-dictyopterismembranacea/;<br />
searched on 16 January 2012.<br />
Aydin K. 2011. Elemis on QVC.<br />
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150374597325349&id=39699640348;<br />
searched on 05 January 2012.<br />
Biological Vietnam Seafood. 2010. http://www.biological-vietnam-seafoods.com/tag/lato/ ;<br />
searched on 09 May 2012.<br />
Bioalgostral - http://www.bioalgostral.com/ Brevet WO 2011004130 :<br />
http://www.sumobrain.com/patents/wipo/Unit-production-microalgae-coupledwith/WO2011004130.html<br />
DORIS (Données d’observations pour la reconnaissance et l’identification de la faune et de<br />
la flore subaquatique). 2010. Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon.<br />
http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=2074; searched on 18 January 2012.<br />
FAO. (2011). Développement de l'aquaculture : Approche écosystémique de l'aquaculutre.<br />
Directives techniques pour une pêche responsable de la FAO, Organisation des nations<br />
unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome.<br />
http://www.fao.org/docrep/014/i1750f/i1750f.pdf<br />
Gonzales M. 2006. Hypnea musciformis.<br />
http://manuel.gonzales.free.fr/pages/hypnea_musciformis.html; searched on 19 January<br />
2012.<br />
- 91 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2012. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National<br />
University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org ; searched on 06 January 2012.<br />
Laboratoire d’Ecophysiologie et de Biotechnologie des Halophytes et Algues Marines<br />
(Lebham). Modèles végétaux étudiés. http://www.univ-brest.fr/lebham/debut/debutf.html ;<br />
searched on 12 January 2012.<br />
Oger C. 2012. Lato, the strange sea salad. http://www.lemanger.fr/index.php/reportages/latothe-strange-sea-salad/?lang=en<br />
; searched on 10 May 2012<br />
Pratt J. 1999. Marine Botany of Sargassum muticum. Monterey Bay Aquarium Research<br />
Institute. http://www.mbari.org/staff/conn/botany/browns/jacquie/default.htm ; searched on 06<br />
January 2012.<br />
Seambiotic. http://www.seambiotic.com/research/microalgae-speices/; searched on 20 July<br />
2011.<br />
Seaplant Handbook. http://surialink.seaplant.net/HANDBOOK/INDEX.htm ; searched on 05<br />
January 2012.<br />
United Arab Emirates University. Faculty of Engineering.<br />
http://www.engg.uaeu.ac.ae/departments/units/gra/presentation/nd_08_09/finalsss08.09/Male/Mech/MEM2-1/Agae_based_biodiesel/1_choosing.htm;<br />
searched on 20 July<br />
2011.<br />
- 92 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
ANNEXES<br />
Annexe 1 : Carte hydrologie et qualité de l’eau du lagon de Mayotte (CAREX et al., 2002)<br />
- 93 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Annexe 2 : Tableau de synthèses des données techniques concernant les 4 macroalgues retenues<br />
Algue candidate<br />
Padina sp.<br />
Asparagopsis<br />
taxiformis<br />
Techniques de culture<br />
Ensemencement<br />
Grossissement<br />
‐ libération de spores à partir d'individus ‐ radeaux en lagon ou mer ouverte (Ganesan<br />
fertiles sauvages (Vasuki et al., 2001) et al., 1999 )<br />
‐ blocs rocheux posés au fond de l'eau<br />
(www.healthexceluk.co.uk/dictyolone.php)<br />
‐ bouturage à partir de fragments d'algues<br />
sauvages (www.algues‐et‐mer.com)<br />
‐ sur filière en mer ouverte pour la forme<br />
gamétophytique (www. algues‐et‐mer.com)<br />
‐ en bassin à terre ou en photobioréacteur<br />
pour la forme tétrasporophytique<br />
(Falkenbergia) (Lognone et al., 2005)<br />
Conditions requises (selon les exigences des espèces)<br />
‐ une plus grande disponibilité en ammonium dans le milieu<br />
favorise le développement de l'algue. Culture possible sur<br />
effluents piscicoles (Mata et al., 2011)<br />
Profondeur à laquelle l'algue a<br />
été trouvée à Mayotte (en m)<br />
≈ 5<br />
≈ 5<br />
Sargassum sp.<br />
Hypnea pannosa<br />
‐ bouturage à partir du fragment basal<br />
(Chennubhotla et al., 1986 ; Chennubhotla,<br />
1988 ; Kimura & Tanaka, 2006)<br />
‐ libération des gamètes à partir d'individus<br />
mâtures chez lesquels l'homme induit la<br />
reproduction (Yoon et al., 2001)<br />
‐ bouturage (Pickering & Mario, 1999)<br />
‐ captage naturel à partir de fragments<br />
dérivants ou de spores (Pickerin & Mario,<br />
1999)<br />
‐ blocs de béton posés au fond de l'eau (Yoon<br />
et al., 2001)<br />
‐ sur filière en mer ouverte (Seaplant<br />
Handbook, 1981)<br />
‐ en bassin ou lagune (Pickering & Mario,<br />
1999)<br />
‐ malgré une capacité à capter les nutriments en excès, une trop<br />
forte concentration d'azote ou de phosphore peut limiter la<br />
croissance de la l'algue (Mai et al., 2010)<br />
‐ culture à faible profondeur pour que l'intensité lumineuse<br />
reçue par la culture ne soit pas limitante (donnée <strong>CEVA</strong>)<br />
‐ la croissance de cette algue est généralement corrélée à la<br />
température de l'eau (Pickering & Mario, 1999 ; Mouradi et al.,<br />
2008)<br />
‐ une plus grande disponibilité en nutriments favorise le<br />
développement de l'algue (Pickering & Mario, 1999 ; Mouradi et<br />
al., 2008)<br />
≈ 10<br />
≈ 5<br />
- 94 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Annexe 3 : Tableau indiquant différents équipement que l’on peut retrouver dans une usine de<br />
transformation des algues<br />
EQUIPEMENT Specifications Applications Prix indicative depart<br />
usine (euros HT)<br />
BROYEURS<br />
30 000 à 45 000<br />
BROYEUR<br />
COLLOÏDAL<br />
BROYEUR<br />
COUTEAUX<br />
BROYEUR<br />
MARTEAUX<br />
À<br />
À<br />
Broyeur à roue dentée en acier inoxydable<br />
Broyeurs verticaux avec trémie (20l), vis<br />
d'alimentation sans fin<br />
Capacité: 100 -1000 kg / h<br />
Broyeur à couteaux permettant de broyer des<br />
algues fraîches<br />
Obtention de paillettes ayant une taille<br />
comprise entre 3 cm à 0.5 mm<br />
Capacité: 20-80 kg/h<br />
Broyeur à impact (rotor unique), impact sur<br />
lequel deux types d'outils de broyage: lames et<br />
marteaux ou picots peuvent être montés.<br />
Obtention de poudre ayant une taille comprise<br />
entre 100- 1000 µm<br />
Nécessite de broyer des paillettes<br />
Capacité: 5 kg/h to 100 kg/h<br />
MELANGE / HOMOGENEISATION<br />
AGITER Agitateur sur support mobile à mouvement<br />
verticaux, pale à 3 branches, vitesse d’agitation<br />
sur variateur<br />
HOMOGENISER<br />
MÉLANGER<br />
EXTRACTION<br />
REACTEUR 75L<br />
homogénéisation haute-pression<br />
Pression = 100 à 1000 bars<br />
Capacité = 30 à 100 L / h<br />
Le mélangeur conique repose sur une action<br />
tridimensionnelle produite par une vis en<br />
rotation sur la paroi d’un récipient de forme<br />
conique.<br />
Contenance : 690 l<br />
Cuve avec revêtement en verre ou céramique<br />
Double paroi permettant la régulation de la<br />
température par des fluides (vapeur ou d'eau<br />
froide<br />
Pour broyer de la matière première fraîche<br />
humide. Capacité d’homogénéisation<br />
Large sélection de têtes de coupe, les roues<br />
sont disponibles pour des applications<br />
diverses telles que le découpage, le<br />
découpage en paillettes, la granulation,<br />
réduire en purée et émulsionner.<br />
adapté pour traiter différents produits avec<br />
des tailles de particules différentes dans une<br />
seule unité de broyage<br />
Agitateur à faible vitesse<br />
- maintien des particules en suspension<br />
- homogénéisation liquide/poudre<br />
- dilution<br />
- dissolution liquide/poudre<br />
Agitation rapie (vitesse : 750 - 1500 -3000<br />
rpm). Dans cette configuration on obtient<br />
une bonne efficacité de dispersion,<br />
homogénéisation, de dissolution, de<br />
suspension et d’émulsion.<br />
L’homogénéisation est un procédé qui<br />
permet d’émulsifier les liquides en<br />
dispersant de manière homogène les<br />
particules par l’application d’une haute<br />
pression.<br />
Cette méthode est utilisée en<br />
biotechnologie sur les microalgues, levures<br />
ou bactéries<br />
Mélange et l'homogénéisation de poudres,<br />
pâtes et boues.<br />
Ajout ou l'injection de liquides sur poudres<br />
seches.<br />
Granulation ou agglomération de poudres<br />
par l'addition d'un liquide liant.<br />
Cristallisation.<br />
Refroidissement ou chauffage<br />
Permet les opérations d’extraction en milieu<br />
liquides, extraction chimique ou<br />
enzymatique<br />
La taille des cuves se décline de 75 l à<br />
plusieurs m 3<br />
25 000 € à 35 000 €<br />
28 000 à 50 000 €<br />
18 000€ à 25 000 €<br />
42 000 € à 55 000 €<br />
17 000 € à 23 000 e<br />
25 000 € (75L) à 100 000 €<br />
(2500L)<br />
CONCENTRATION<br />
EVAPORATEUR Evaporateur à cuve inox double paroi pour<br />
chauffage récupération des solvants volatile ou<br />
de l’eau condense. (Ex. 50 l/h)<br />
Concentrateur discontinu par batch 20 000 € (20L) à 75 000€<br />
(plusieurs centaine de L)<br />
- 95 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
FILTRATION<br />
FILTRE PRESSE<br />
FILTRATION A<br />
FLUX<br />
TANGENTIEL<br />
SÉCHAGE<br />
FOUR<br />
Filtre presse avec 10 plateaux (40 x 40 cm)<br />
Surface filtrante : 5.7 m 2<br />
Capacité: 50 to 500 L/h<br />
Seuil de coupure entre 1 kD, 10 kD.<br />
Surface filtrated : 36 m 2<br />
Four industriel avec plateaux et convoyeur<br />
(ex. 950 x 950 x 1350) pouvant sécher 1 kg à<br />
50 kg d’algues frâiche par batch<br />
Température regulée entre 20 °C et 200°C<br />
Filtre pour séparation des matières solides<br />
(sortie extraction) permet une filtration fine<br />
et stérilisante.<br />
Utilisé en traitement des eaux permet la<br />
concentration, la désalinisation, la<br />
concentration de protéines ou de<br />
polysaccharides.<br />
Applications: caisson, dégazage, séchage,<br />
polymerisation, sterilisation.. .<br />
25 000 à 30 000 €<br />
1 Module 50 000 € à<br />
60 000€<br />
Cartouchee1 kD 7 à 8 K€<br />
20 à 25 000 €<br />
LYOPHILISATION Lyophilisation des liquids, solides ou 60 000 à 70 000 €<br />
produits sensible (Extraits d’algues)<br />
SPRAY-DRYER 50 to 100 kg eau/h 110 000 € à 150 000 €<br />
- 96 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Annexe 4 : Tableau récapitulatif des principaux textes stratégiques encadrant le<br />
développement du projet.<br />
2002<br />
Plan de gestion du lagon de mayotte<br />
2004<br />
Document unique de programmation de Mayotte<br />
2005<br />
Plan d'Action pour la Biodiversité 2005 ‐ 2010<br />
2006<br />
Plan d’action national de l’IFRECOR pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens.<br />
Deuxième phase 2006‐2010<br />
Le plan cadre d'action établi pour 5 ans par le comité national de l’IFRECOR en faveur des récifs coralliens et des écosystèmes<br />
associés comprend six axes stratégiques : Planifier pour prévenir ; Réduire les effets négatifs dus aux activités humaines tout en<br />
assurant leur développement durable ; Connaître et comprendre pour gérer ; Informer, former et éduquer pour modifier les<br />
comportements ; Développer les moyens d’action ; Développer les échanges et la coopération pour renforcer les synergies et<br />
valoriser les expériences. Il s’articule autour d’actions transversales qui présentent un intérêt pour l’ensemble des collectivités<br />
et nécessitent un travail en réseau : Gouvernance ; Adaptation au changement climatique ; Socio‐économie ; AiresMarines<br />
Protégées ; Biodiversité ; Réseaux d’observation ; Cartographie ; Éducation‐sensibilisation‐communication ; etautourdede<br />
plans d’actions locaux établis dans chacune des collectivités d’outre‐mer par les comités locaux.<br />
2007<br />
Document d'orientation stratégique relatif à la pêche et à l'aquaculture 2007‐2013<br />
2008<br />
Plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte<br />
Mayotte dispose d'un Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) adopté en conseil d'Etat le 15 janvier 2008.<br />
Celui‐ci présente d'une part, les facteurs et les enjeux du développement durable à Mayotte et développe d'autre part, les<br />
orientations fondamentales. Le PADD précise notamment la vocation des différentes parties du territoire, les principes de<br />
localisation des grandes infrastructures et les orientations particulières relatives au littoral et au milieu marin.<br />
Texte légisislatifs et règlementaires concernant la Collectivité départementale de Mayotte<br />
XIIIème Contrat de Projet Etat Mayotte 2008‐2014<br />
Un contrat de projet est un document de programmation unique, global et transversal par lequel l’Etat et la Collectivité<br />
s’engagent à apporter par voie contractuelle leurs concours pour financer les infrastructures nécessaires au développement<br />
économique et social du territoire. Cette démarche a vocation à s’inscrire dans le cadre du PADD élaboré par la collectivité<br />
départementale de Mayotte. La stratégie arrêtée s’articule autour de 5 axes : ouvrir la collectivité sur l’environnement<br />
extérieur ; favoriser un développement économique créateur d’emploi ; favoriser l’égalité des chances et valoriser<br />
l’épanouissement des individus ; mettre en œuvre un aménagement équilibré du territoire ; consolider les bases d’un<br />
développement durable du territoire.<br />
Grenelle de l'Environnement<br />
En attendant l'intervention de ces dispositions, petite revue des principales propositions de Mayotte (issues des groupes de<br />
travail locaux) : 1) Lutte contre les changements climatiques et maîtrise de l'énergie ; 2) Préservation de la biodiversité et des<br />
ressources naturelles ; 3) Instauration d'un environnement respectueux de la santé ; 4) Adoption des modes de production et<br />
de consommation durables ; 5) Construction d'une démocratie écologique ; 6) Promotion des modes de développement<br />
écologiques favorables à la compétitivité et à l'emploi ; 7) Déchets.<br />
Stratégie de croissance pour l'Outre‐Mer<br />
Pour que l’Outre‐Mer relève les défis économiques, écologiques et sociaux, il faut lui donner les moyens d’une<br />
nouvelle compétitivité. Cette stratégie de croissance pour l’Outre‐Mer se décline en 20 programmes d’actions selon 5 objectifs :<br />
(1) Ancrer le développement économique sur des secteurs stratégiques prioritaires propre à chaque territoire ; (2)Mieux<br />
former et mieux insérer professionnellement les ultramarins en favorisant leur mobilité ; (3) Décréter une mobilisation<br />
générale pour le logement impliquant tous les acteurs ; (4) Accélérer le désenclavement aérien, maritime et numérique des<br />
territoires ; (5) Faire de la préservation de la nature un levier de croissance et de l’Outre‐Mer une vitrine du<br />
développement durable.<br />
- 97 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
2009<br />
Plan Départemental d'élimination des Déchets Ménagers et assimilés<br />
Le PEDMA a pour objet de définir une politique de prévention et de gestion des déchets sur un territoire donné, en<br />
l'occurrence le département, sur une période de 10 ans. Ce document est un outil indispensable à Mayotte, car il est élaboré en<br />
vue d'améliorer la salubrité publique, de minimiser l'impact des déchets sur l'environnement, sur la santé des populations. Les<br />
opérations et les équipements mis en œuvre vont générer de l'activité économique et de l'emploi. La mise en œuvre du<br />
plan va également permettre de disposer d'équipements nécessaires au développement économique et touristique de<br />
Mayotte. Le PEDMA présente avant tout un caractère incitatif et informatif. De par la loi, le Conseil Général de Mayotte a<br />
aujourd'hui la compétence pour élaborer et suivre le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés<br />
(appelé par la suite PEDMA).<br />
Etats généraux de l'Outre‐Mer<br />
Les états généraux ont été initiés dans les DOM(Départements d’Outre‐Mer) suite aux événements sociaux de début d’année<br />
aux Antilles et à la Réunion. Les travaux des Etats généraux devaient permettre à Mayotte de faire des propositions concrètes<br />
pour avancer dans des domaines structurants pour le développement du territoire, sans remettre en cause le pacte du<br />
gouvernement pour la départementalisation, qui a déjà fixé des orientations et un calendrier dans un certain nombre de<br />
secteurs. Les Etats généraux ont été une occasion pour les acteurs politiques, économiques et sociaux locaux, mais également<br />
pour la population, de confronter les points de vue et trouver ensemble les solutions à apporter aux problèmes prioritaires<br />
auxquels est confronté le territoire. Huit thèmes de travail ont été retenus : pouvoir d’achat ; productions locales ;coopération<br />
régionale ; culture ; foncier ; emploi ; retraites ; formation au sens large<br />
Grenelle de la Mer<br />
Le Grenelle de la Mer est une émanation du Grenelle de l’Environnement. Il couvre essentiellement les thèmes de la Mer et du<br />
littoral et doit contribuer au développement d’activités soutenables du point de vue environnemental. Le Grenelle de la mer<br />
définira la stratégie nationale pour la mer et le littoral, en identifiant des objectifs et des actions à court, moyen et long termes.<br />
Cette politique maritime qui concernera tous les champs de l’action gouvernementale, formalisera l’ambition de la France<br />
métropolitaine et d’outre‐mer pour la mer et les activités maritimes.<br />
Les orientations du Parc Naturel Marin de Mayotte<br />
Les 7 orientations de gestion, issues de la concertation, constituent les bases du plan de gestion du Parc Marin de Mayotte<br />
2010<br />
Dossier départemental des Risuqes Majeurs<br />
Le DDRM, Dossier Départemental des Risques Majeurs, est un document d’information préventive et de sensibilisation destiné<br />
à l’ensemble des citoyens d’un département. Il comprend la description des risques, technologiques et naturels, prévisibles<br />
dans le département, de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement et les mesures de<br />
prévention et de sauvegarde destinées à limiter leurs effets. Il contient également une liste des communes du département et<br />
la description des risques majeurs auxquelles elles sont soumises. Le DDRM n’est pas un document réglementaire opposable<br />
aux tiers mais un document de sensibilisation destiné à l’ensemble des citoyens et des responsables et acteurs du risque<br />
majeur. Il est établit sous ordre du préfet.<br />
Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des Eaux 2010‐2015<br />
Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un nouvel outil qui répond au besoin de gestion<br />
concertée et durable de l’eau à Mayotte. Le SDAGE de Mayotte énonce une série d’orientations et de dispositions qui<br />
permettront le retour des eaux au bon état et qui viendront répondre globalement aux questions importantes liées à l'eau sur<br />
le territoire, face aux enjeux de développement : la protection de la santé ; l'éducation à l'environnement ; la lutte contre les<br />
pollutions ; la gestion des risques naturels liés à l'eau ; la préservation, la restauration et l'entretien des milieux et de la<br />
biodiversité ; le partage de la ressource en eau ; l'amélioration des connaissances sur les milieux aquatiques. L'ambition des<br />
Mahorais est d'atteindre 74% des masses d'eau en bon ou très bon état en 2015. Le SDAGE est opposable juridiquement aux<br />
décisions administratives depuis le 01/01/10. Le Comité de Bassin est chargé du suivi de sa mise en œuvre. Le Programme De<br />
Mesures (PDM) qui décline les actions concrètes à mettre en œuvre d'ici 2015 s'élève à près de 171 millions d'euros,<br />
essentiellement dévolus à des équipements de traitement des eaux usées, des eaux pluviales et des déchets.<br />
- 98 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Schéma régional de développement de l'économie, de l'emploi et de la formation à Mayotte<br />
Le Conseil Général a effectué une étude sur le "schéma régional de développement de l'économie, de l'emploi et de la<br />
formation à Mayotte". L'objectif est de définir une stratégie explicite de développement qui recherche une cohérence<br />
profonde entre le développement de l'activité et de l'l'emploi, et le développement des compétences et des qualifications<br />
dont les employeurs en ont besoin. Le Conseil Général de Mayotte en collaboration avec Opcalia ont réalisé une étude sur "la<br />
cartographie des acteurs emploi‐formation, de l'offre de formation, et conditions de mise en œuvre de la décentralisation en<br />
matière de formation continue à Mayotte". L'objectif est d'appréhender l'offre de formation présente sur le territoire et<br />
appuyer la prise en main de la compétence générale de coordination de la formation professionnelle.<br />
Rapport d'évaluation des aides agricoles à Mayotte<br />
Projet régional de l'enseignement Agricole 2010‐2015<br />
le Projet Régional de l’Enseignement Agricole (PREA) sert de cadre pour le pilotage de l’enseignement agricole en région. Il a<br />
pour objectifs de répondre aux besoins du territoire en adaptant les orientations nationales aux spécificités régionales,<br />
constituer une référence pour les institutions partenaires, guider l’autorité académique dans l’exercice de ses différentes<br />
missions, et enfin fournir un cadre de référence pour l’élaboration des projets d’établissement<br />
Etude sur les orientations d'aménagement des sites stratégiques de développement touristique inscrit<br />
au PADD de Mayotte<br />
2011<br />
Scénarion énergies renouvelables répondant aux besoins énergétique de Mayotte à l'horizon 2030<br />
Cette étude propose des alternatives Energies Renouvelables à ce scénario en abordant les aspects économiques,<br />
environnementaux, techniques et réglementaires (notamment comparaison des technologies utilisant le bois ou les pellets de<br />
bois plutôt que le diesel pour la centrale thermique).<br />
Stratégie territoriales pour les Outre‐Mer<br />
Création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte<br />
2012<br />
Appel à projets du fonds mahorais de développement économique, social et culturel<br />
Schéma directeur régional du développement de l'aquaculture à Mayotte<br />
Plan d'action national de l'Ifrecor pour 2011 ‐ 2015<br />
Le code rural de la pêche maritime<br />
- 99 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
Annexe 5 : matrice RACI Actions / Acteurs<br />
- 100 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
- 101 -
<strong>Tome</strong> 2 : Propositions de projets<br />
- 102 -