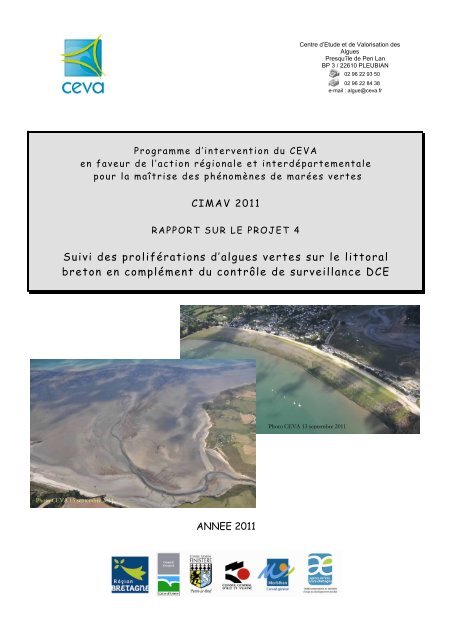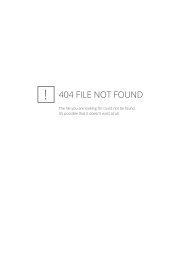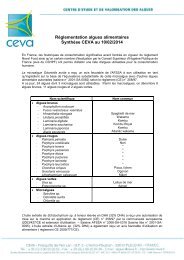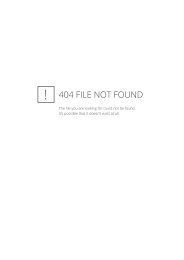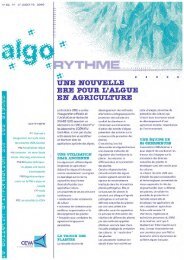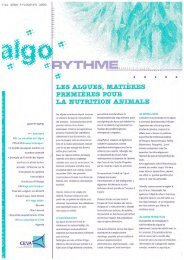Suivi des proliférations d'algues vertes sur le littoral breton ... - Ceva
Suivi des proliférations d'algues vertes sur le littoral breton ... - Ceva
Suivi des proliférations d'algues vertes sur le littoral breton ... - Ceva
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Centre d’Etude et de Valorisation <strong>des</strong>AlguesPresqu’î<strong>le</strong> de Pen LanBP 3 / 22610 PLEUBIAN02 96 22 93 5002 96 22 84 38e-mail : algue@ceva.frProgramme d’intervention du CEVAen faveur de l’action régiona<strong>le</strong> et interdépartementa<strong>le</strong>pour la maîtrise <strong>des</strong> phénomènes de marées <strong>vertes</strong>CIMAV 2011RAPPORT SUR LE PROJET 4<strong>Suivi</strong> <strong>des</strong> proliférations d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong><strong>breton</strong> en complément du contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCEPhoto CEVA 13 septembre 2011Photo CEVA 15 septembre 2011ANNEE 2011
Programme d’intervention du CEVAen faveur de l’action régiona<strong>le</strong> et interdépartementa<strong>le</strong>pour la maîtrise <strong>des</strong> phénomènes de marées <strong>vertes</strong>Dans <strong>le</strong> cadre du GP5, <strong>le</strong> CEVA conduit depuis 2008, en maîtrise d’ouvrage, un programme en faveur de la reconquête de laqualité <strong>des</strong> masses d’eaux littora<strong>le</strong>s dégradées par <strong>le</strong>s phénomènes de marées <strong>vertes</strong>. La poursuite de ce programme était proposéepour 2011.L’action de reconquête de la qualité de l’Eau est aujourd’hui particulièrement engagée en application de la Directive Cadre Eau.El<strong>le</strong> implique <strong>le</strong>s Col<strong>le</strong>ctivités Bretonnes et l’Agence de l’Eau, structures qui sont sollicitées comme partenaires financiers de ceprogramme. Les cinq projets du programme proposé par la cellu<strong>le</strong> d’intervention <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s marées <strong>vertes</strong> (Cimav) du CEVA, sontlistés ci-<strong>des</strong>sous.Projet 1 :Actions d’expertise scientifique, d’information et de conseil technologique en faveur <strong>des</strong> programmes de maîtrise <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong>de Bretagne.Projet 2 :Amélioration du modu<strong>le</strong> biologique et comparaison 2D/3D du modè<strong>le</strong> écologique Mars-ulves à la détermination <strong>des</strong> objectifs dequalité nitrates/ulves <strong>sur</strong> site sab<strong>le</strong>ux.Projet 3 :Compléments d’étu<strong>des</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s processus biologiques, hydrologiques et sédimentologiques impliqués dans la marée verte.Projet 4 :<strong>Suivi</strong> <strong>des</strong> proliférations d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> en complément du contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCE.Projet 5 :Application du modè<strong>le</strong> écologique tri-dimensionnel Mars-Ulves à la détermination <strong>des</strong> objectifs de qualité nitrates/ulves en milieuvaseux (site de la Ria d’Etel).Projet 6 :Evaluation <strong>des</strong> possibilités techniques d’anticipation <strong>des</strong> épiso<strong>des</strong> d’échouages dans <strong>le</strong>s sites à marée verteCimav p4 – rapport final juil<strong>le</strong>t 2011 1
Projet 4 :<strong>Suivi</strong> <strong>des</strong> proliférations d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong>en complément du contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCESOMMAIRE1- CONTEXTE ET OBJECTIFS p.32- METHODES p.82.1- Dénombrement <strong>des</strong> sites p.82.2- Estimation <strong>sur</strong>facique p.102.3. Indice d’eutrophisation p.132.4. Evaluation <strong>des</strong> stocks totaux p.172.5- Missions réalisées p.183. RESULTATS p.203.1- Dénombrement <strong>des</strong> sites en Bretagne p.203.1.1- Inventaire <strong>des</strong> sites touchés par une marée verte à ulves en 20113.1.2- Comparaison inter-annuel<strong>le</strong> 1997-20113.1.3- Mise en évidence de la particularité de sites de vasière3.1.4- Détermination <strong>des</strong> espèces proliférantes3.1.5- Conclusions3.2- Résultats de l’estimation <strong>sur</strong>facique <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes <strong>breton</strong>nes p.413.2.1- L’importance relative <strong>des</strong> sites3.2.2- Evolution annuel<strong>le</strong> de la marée verte3.2.3- Evolution de la marée verte <strong>sur</strong> 2002-20113.2.4- Conclusions3.3- <strong>Suivi</strong> d’indices d’eutrophisation dans une liste étendue de sites touchés p.643.4- Evaluation <strong>des</strong> stocks totaux p.934- CONCLUSION p.97Cimav P4 – rapport final mars 2012 2
1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS :De 2002 à 2006, <strong>le</strong> CEVA a réalisé, pour <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités <strong>breton</strong>nes et l’Agence de l’Eau LoireBretagne, <strong>le</strong> suivi <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes du Mont Saint Michel jusqu’à La Bau<strong>le</strong>, dans <strong>le</strong> cadredu programme Pro<strong>littoral</strong>, programme régional et interdépartemental de lutte contre <strong>le</strong>s marées<strong>vertes</strong>.Depuis 2007, l’Ifremer a chargé <strong>le</strong> CEVA du contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance du Mont Saint Michel à l’I<strong>le</strong> deRé <strong>des</strong> blooms à macroalgues, dans <strong>le</strong> cadre de la DCE. Ce nouveau réseau de suivi comprend trois<strong>sur</strong>vols aériens, en mai, juil<strong>le</strong>t et septembre ainsi que l’enquête <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages et <strong>le</strong>s ramassagesd’algues <strong>vertes</strong>. Ce réseau, avec seu<strong>le</strong>ment trois observations annuel<strong>le</strong>s au lieu <strong>des</strong> sept que comportait<strong>le</strong> suivi de Pro<strong>littoral</strong> parait insuffisant au CEVA comme aux col<strong>le</strong>ctivités et à l’Agence de l’Eau LoireBretagne pour décrire l’évolution saisonnière et interannuel<strong>le</strong> du phénomène <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes <strong>breton</strong>nes.La <strong>des</strong>cription fine du phénomène par site associée aux données climatiques permet en outre decontribuer à la détermination <strong>des</strong> objectifs de qualité de l’eau à atteindre pour limiter <strong>le</strong>sproliférations.Le suivi opérationnel prévu par la DCE concerne <strong>le</strong>s masses d’eau classées en risque de non atteintedu bon état écologique en 2015 en considérant <strong>le</strong>s seu<strong>le</strong>s actions tendanciel<strong>le</strong>s. Pour ce qui est del’altération marées <strong>vertes</strong>, <strong>le</strong> bon état écologique n’est pas encore défini, ni <strong>le</strong>s gril<strong>le</strong>s et protoco<strong>le</strong>s quipermettront de me<strong>sur</strong>er l’atteinte ou non de ce bon état (travail en cours pour <strong>le</strong>s eaux côtières et detransition). Les masses d’eau ont cependant fait l’objet d’un premier classement « à dires d’experts »en décembre 2004 revu en 2007 qui en définit un certain nombre qui pourraient ne pas respecter <strong>le</strong>bon état en 2015 et qui devraient alors faire l’objet d’un « contrô<strong>le</strong> opérationnel ».Le suivi opérationnel prévu comprend, dans sa version actuel<strong>le</strong> pour l’altération marées <strong>vertes</strong>, <strong>des</strong>suivis aériens densifiés (sept <strong>sur</strong>vols annuels), la me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> indices d’eutrophisation (perceptionsuivant <strong>le</strong>s années de la limitation par l’azote, indépendamment <strong>des</strong> biomasses en place ; donnéesd’entrée fondamenta<strong>le</strong> du modè<strong>le</strong>) et <strong>des</strong> biomasses tota<strong>le</strong>s présentes <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites (estran etinfra<strong>littoral</strong> ; donnée d’autant plus importante à acquérir <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites pour <strong>le</strong>squels la partieinfralittora<strong>le</strong> peut représenter une grosse proportion du stock total voire la majorité) ce qui est doncproche <strong>des</strong> suivis qui étaient financés jusque là par <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités et l’Agence de l’Eau dans <strong>le</strong> cadrede Pro<strong>littoral</strong>, seuls suivis existants de ce type de prolifération alga<strong>le</strong>.Dans l’attente d’une consolidation du classement <strong>des</strong> masses d’eau et de la définition plus arrêtée dusuivi opérationnel, <strong>le</strong> suivi opérationnel n’a pas été engagé. Afin d’éviter d’avoir une année manquantedans la série (meil<strong>le</strong>ure connaissance du phénomène par site et réaction aux conditions climatiques) etpour répondre aux attentes <strong>des</strong> col<strong>le</strong>ctivités de connaître l’évolution fine du phénomène, il semb<strong>le</strong>indispensab<strong>le</strong> de compléter <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance par <strong>des</strong> suivis complémentaires <strong>sur</strong> <strong>le</strong>sprincipaux secteurs.Détails <strong>des</strong> suivis proposés :‣ Contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCE :Le programme proposé ici vient en complément du « contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance » de la DCE prévu parail<strong>le</strong>urs <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> Loire Bretagne et comportant :- une enquête auprès <strong>des</strong> communes littora<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s proliférations et <strong>le</strong> ramassage <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong>,- 3 <strong>sur</strong>vols aériens (mai, juil<strong>le</strong>t, septembre) de l’ensemb<strong>le</strong> du <strong>littoral</strong> (du Mont Saint Michel à l’I<strong>le</strong>de Ré), <strong>des</strong> opérations de contrô<strong>le</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain <strong>des</strong> dépôts repérés et la me<strong>sur</strong>e <strong>sur</strong> SIG <strong>des</strong> <strong>sur</strong>facesd’échouages pour chaque dépôt (une seu<strong>le</strong> me<strong>sur</strong>e annuel<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s zones de vasière à une dateproche du maximum annuel attendu ; pour 2011, <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> vasière ne sont prévues que <strong>sur</strong> 10Masses d’Eau).Les données de ce réseau sont indispensab<strong>le</strong>s à l’analyse du réseau « complémentaire » sous maîtrised’ouvrage du CEVA.Cimav P4 – rapport final mars 2012 3
‣ <strong>Suivi</strong>s complémentaires :• <strong>Suivi</strong>s aériens : 4 <strong>sur</strong>vols additionnels (avril, juin, août, octobre), <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux secteurs suivis depuis2002 afin de disposer d’une information mensuel<strong>le</strong> entre avril et octobre (évolutioninterannuel<strong>le</strong>, durée et dynamique de la prolifération). Pour minimiser <strong>le</strong>s coûts, chaque <strong>sur</strong>vo<strong>le</strong>st effectué <strong>sur</strong> une seu<strong>le</strong> journée en partant de la côte sud (Vannes) pour finir au niveau de laRance, comme cela était effectué dans <strong>le</strong>s suivis de Pro<strong>littoral</strong> (induit un calage <strong>sur</strong> la maréebasse un peu moins favorab<strong>le</strong>, notamment dans <strong>le</strong> Golfe du Morbihan, que si <strong>le</strong>s acquisitionsse déroulaient <strong>sur</strong> deux jours comme c’est <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols « DCE <strong>sur</strong>veillance »). Contrô<strong>le</strong>s de terrain : suite aux <strong>sur</strong>vols, tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong> dépôts d’algues <strong>vertes</strong>pour <strong>le</strong>squels la connaissance <strong>des</strong> types d’algue n’est pas établie, font l’objet d’un contrô<strong>le</strong> deterrain dans <strong>le</strong>s jours qui suivent <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>vols (type d’algues présentes, <strong>le</strong>s proportions <strong>des</strong>différentes algues en cas de mélange notamment détermination du taux d’ulve dansl’échouage). Me<strong>sur</strong>e <strong>sur</strong> SIG <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces de dépôts : intégration <strong>des</strong> photos numériques dans <strong>le</strong> SIG,géoréférencement, digitalisation <strong>des</strong> dépôts, gestion <strong>des</strong> données dans <strong>le</strong>s bases. En l’absencede gril<strong>le</strong>s définitives et de protoco<strong>le</strong> arrêté pour <strong>le</strong> suivi opérationnel et <strong>le</strong> classement DCE <strong>des</strong>masses d’eau, <strong>le</strong> suivi <strong>sur</strong>facique proposé ici est conforme aux métho<strong>des</strong> en œuvre pour <strong>le</strong>ssuivis de Pro<strong>littoral</strong> et <strong>le</strong>s suivis « DCE <strong>sur</strong>veillance » et complémentaire de 2007 à 2010. Lesvasières font l’objet d’une digitalisation de <strong>le</strong>urs <strong>sur</strong>faces que dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>facescolonisées visib<strong>le</strong>s semb<strong>le</strong>nt supérieures à cel<strong>le</strong>s prises en compte lors <strong>des</strong> trois <strong>sur</strong>vols <strong>des</strong>urveillance. Cela pourrait se produire en raison d’un « pic » de prolifération lors d’un <strong>des</strong> volsdu suivi complémentaire ou si <strong>le</strong> niveau de marée au moment du passage de l’avion est plusfavorab<strong>le</strong> lors de ces vols. La digitalisation <strong>des</strong> couvertures en algues est réalisée dans <strong>le</strong> cadredu programme « DCE <strong>sur</strong>veillance » pour la date semblant présenter <strong>le</strong> maximum annuel et,pour 2011 uniquement <strong>sur</strong> 10 Masses d’Eau et non <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>s sites classés comme c’était <strong>le</strong>cas jusqu’en 2010. Les données de bases photographiques ont cependant été acquises etpourront faire l’objet de traitements ultérieurement si cela était jugé uti<strong>le</strong> pour déterminer pourtous <strong>le</strong>s sites touchés par <strong>des</strong> proliférations d’ulves <strong>le</strong>urs <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong>. Analyse, rapport.• Indices d’eutrophisation (N et P) : Prélèvement tous <strong>le</strong>s 15 jours <strong>sur</strong> la période de prolifération d’ulves (à partir de fin avril siprésence d’échouage et jusqu’au début septembre soit 10 campagnes de prélèvement), <strong>sur</strong>une liste restreinte de sites (sites faisant l’objet de modélisation <strong>des</strong> objectifs à atteindre et /ou d’actions spécifique dans <strong>le</strong> cadre du plan gouvernemental AV + 3 secteurs de vasières).La liste de sites proposés est la suivante (réintégration de Locquirec et de l’Anse du Dossenen plus <strong>des</strong> 10 sites / 12 prélèvements déterminés en 2010) :Rance / Saint Jouan <strong>des</strong> GuéretsBaie de la Fresnaye (si présence d’ulves en 2010)Baie de Saint BrieucBaie de BinicBaie de Saint Michel en GrèveBaie de LocquirecBaie du Dossen (« Horn/Guil<strong>le</strong>c »)Baie de GuissenyCimav P4 – rapport final mars 2012 4
• Evaluation <strong>des</strong> stocks totaux :Les suivis aériens réalisés permettent, par la me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’échouages, d’apprécierl’importance relative <strong>des</strong> sites et <strong>le</strong> profil <strong>des</strong> proliférations mais ne permettent pas d’estimer <strong>le</strong>sbiomasses présentes (besoin de beaucoup de personnels <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain au moment <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols,autour de la marée basse).Par ail<strong>le</strong>urs comme cela a pu être mis en évidence par <strong>le</strong>s suivis spécifiques en biomasse incluant<strong>des</strong> prospections au-delà de la limite <strong>des</strong> marées basses (par plongées tractées) réalisés dans <strong>le</strong>cadre de Pro<strong>littoral</strong> puis du CIMAV entre 2002 et 2010, certains <strong>des</strong> sites <strong>breton</strong>s comprennentune partie importante de <strong>le</strong>urs algues en infra<strong>littoral</strong>, d’autres échouent la quasi-totalité <strong>sur</strong> l’estranlors de la marée basse. Les données recueillies de 2002 à 2010 montrent que <strong>le</strong> pourcentage <strong>des</strong>algues qui se trouvent en infra<strong>littoral</strong> varie de moins de 5 % pour <strong>le</strong>s sites de l’Est <strong>des</strong> Côtesd’Armor à plus de 95 % pour <strong>le</strong>s sites du Sud Bretagne (baie de la Forêt). Il est donc important,pour chaque site et plus particulièrement pour <strong>le</strong>s sites stockant une grosse proportion eninfra<strong>littoral</strong>, de qualifier cette partie non accessib<strong>le</strong> aux observations aériennes pour déterminerl’importance réel<strong>le</strong> de la marée verte du site mais aussi pour améliorer la connaissance dufonctionnement de celui-ci. De plus, dans l’hypothèse de mise en œuvre de déstockages <strong>des</strong>ites (notamment par prélèvements d’une part importante <strong>des</strong> biomasses d’un site <strong>sur</strong> <strong>des</strong>pério<strong>des</strong> ciblées), il est primordial de pouvoir estimer la biomasse tota<strong>le</strong> du site et de ne pas selimiter à la partie déposée <strong>sur</strong> l’estran.En outre, la marée verte <strong>sur</strong> certains sites semb<strong>le</strong> redémarrer à partir de stocks hivernaux quisubsistent non loin <strong>des</strong> plages et autorisent un démarrage précoce de la prolifération à unepériode où <strong>le</strong>s flux sont encore très importants. D’autre sites redémarrent à partir de stocksbeaucoup plus limités, voire même à partir d’algues d’arrachage ce qui permet d’expliquer <strong>des</strong>marées <strong>vertes</strong> très limitées en début de saison et devenant importantes, en fin de saison, enparticulier <strong>le</strong>s années pluvieuses. La compréhension du fonctionnement <strong>des</strong> sites et la perceptionde l’objectif qu’il faudra atteindre en terme de qualité de l’eau arrivant <strong>des</strong> bassins versantsnécessitent d’évaluer l’importance de ces stocks de reconduction hivernaux. Le programmeproposé pour appréhender ces stocks totaux estivaux et hivernaux comprend :- me<strong>sur</strong>e du stock maximum estival <strong>sur</strong> un site. Les dernières me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> la baie de la Lieuede Grève ont été effectuées en 2006, site <strong>sur</strong> <strong>le</strong>quel <strong>le</strong>s expérimentations de déstockage sontenvisagées. Il était donc proposé d’évaluer la biomasse tota<strong>le</strong> de ce site en période estiva<strong>le</strong>.- <strong>sur</strong>veillance du stock minimum hivernal durant l’hiver 2010-2011 <strong>sur</strong> deux sites (dont unevasière). Les me<strong>sur</strong>es seront, dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s conditions météo <strong>le</strong> permettront, réaliséesentre la mi janvier 2012 et fin février 2012, période du minimum annuel attendu. Les prospections<strong>sur</strong> vasières tenteront de déterminer <strong>le</strong>s lieux de présence d’ulves et de qualifier ponctuel<strong>le</strong>ment<strong>le</strong>s biomasses qui s’y trouvent. Pour ce qui est <strong>des</strong> biomasses hiverna<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> secteur de plage, il estproposé de rechercher, comme cela avait été réalisé en 2009 et 2010 <strong>des</strong> dates pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>sstocks ont <strong>le</strong> plus de chance d’être accessib<strong>le</strong>s à l’observation aérienne et de terrain plutôt que deréaliser <strong>des</strong> plongées, particulièrement diffici<strong>le</strong>s à entreprendre en hiver. Un <strong>sur</strong>vol <strong>des</strong> côtes seraengagé si <strong>le</strong>s conditions semb<strong>le</strong>nt favorab<strong>le</strong>s pour observer <strong>des</strong> dépôts <strong>sur</strong> plage (site de SaintMichel a priori pressenti car présentant <strong>le</strong> plus régulièrement <strong>des</strong> dépôts <strong>sur</strong> plage en hiver dans<strong>le</strong>s conditions de temps calme). Le site de vasière pressenti est l’anse du Lédano ; et <strong>le</strong> sitede plage pressenti est la baie de Saint Michel en Grève, secteur a priori <strong>le</strong> plus susceptib<strong>le</strong> depermettre d’évaluer ces stocks <strong>sur</strong> l’estran. Pour <strong>le</strong>s stocks infralittoraux :- plongées tractées par un bateau (aquaplane) : quadrillage de la zone par <strong>des</strong> transectsgéoréférencés (GPS différentiel). A chaque changement de densité <strong>des</strong> algues <strong>sur</strong> <strong>le</strong>fond est réalisé un prélèvement qui est ensuite pesé.- traitement <strong>des</strong> données : interpolation <strong>des</strong> données ponctuel<strong>le</strong>s issues <strong>des</strong> plongées.Cimav P4 – rapport final mars 2012 6
Pour <strong>le</strong>s stocks <strong>sur</strong> estran :- utilisation <strong>des</strong> données <strong>sur</strong>faciques acquises lors <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols (ou acquisition spécifiquesdans <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es hiverna<strong>le</strong>s)- évaluation sommaires <strong>des</strong> biomasses par type de dépôt : positionnement à l’aide deGPS différentiels de quadrats d’un quart de mètre carré <strong>sur</strong> tous type de dépôtssuffisamment homogènes <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain pour être représentatifs de zone perceptib<strong>le</strong>s<strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les algues, quand el<strong>le</strong>s ne baignent pas dans une lame d’eausont remouillées puis égouttées 1 minutes (référentiel adopté depuis plus de 10 ans carbien corrélé avec la matière sèche alga<strong>le</strong>) puis pesées. L’ensemb<strong>le</strong> de ces donnéesponctuel<strong>le</strong>s est ensuite intégré dans <strong>le</strong> SIG pour affecter à chaque polygone couvert par<strong>le</strong>s algues <strong>des</strong> biomasses par mètre carré. Calcul pour l’ensemb<strong>le</strong> du site de la biomassetota<strong>le</strong> par sommes de biomasses par polygone. analyse, rapport.Cimav P4 – rapport final mars 2012 7
2 - METHODESLes métho<strong>des</strong> et outils employés ici pour suivre <strong>le</strong>s marées <strong>vertes</strong> ont été mis au point par <strong>le</strong> CEVAdans <strong>le</strong> cadre du programme Pro<strong>littoral</strong> ; ce programme ayant lui-même bénéficié <strong>des</strong> acquis d’étu<strong>des</strong>antérieures.2.1. Dénombrement <strong>des</strong> sites (suivi DCE <strong>sur</strong>veillance, financé en dehors de ce programme)Le dénombrement <strong>des</strong> sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves a été réalisé, comme cela était déjà <strong>le</strong>cas <strong>le</strong>s années antérieures pour Pro<strong>littoral</strong>, par <strong>sur</strong>vols aériens au moyen d’un CESSNA. Afin deparcourir <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> à un niveau de marée suffisamment bas, trois jours de vol sont programmés pourchaque mois d’inventaire (Bretagne nord, Bretagne sud et Sud Loire). La carte 1 présente <strong>le</strong> trajetparcouru par l’avion (trajet défini, pour la partie Bretagne lors <strong>des</strong> suivis de Pro<strong>littoral</strong> permettant decouvrir dans <strong>le</strong>s meil<strong>le</strong>ures conditions et à un coût acceptab<strong>le</strong> la majorité du <strong>littoral</strong> et toutes <strong>le</strong>s zones<strong>sur</strong> <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> développements d’ulves ont déjà été mentionnés).Les <strong>sur</strong>vols sont planifiés pour correspondre au mieux aux heures de basse mer <strong>des</strong> zones <strong>sur</strong>voléeset lors de coefficients de marée <strong>le</strong>s plus forts (supérieurs à 75 quand cela est possib<strong>le</strong>) afin de pouvoirobserver de manière optima<strong>le</strong> <strong>le</strong>s dépôts <strong>sur</strong> l’estran. Ces conditions doivent coïncider avec <strong>des</strong>conditions climatiques de bonne visibilité et plafond nuageux suffisamment haut pour acquérir <strong>des</strong>photographies qui soient à <strong>des</strong> échel<strong>le</strong>s convenab<strong>le</strong>s.En plus du pilote, deux observateurs sont à bord : un photographe et un opérateur qui localise <strong>sur</strong>carte <strong>le</strong>s photos prises. C’est dans l’avion éga<strong>le</strong>ment, en fonction de la perception <strong>des</strong> observateurs,que sont décidés <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrain.Une fois <strong>le</strong>s photos acquises, <strong>des</strong> équipes sont rapidement mobilisées et dépêchées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain afinde valider ou non <strong>le</strong> constat de site d’ « échouage d’ulves ». Ces équipes relèvent <strong>le</strong>s proportions <strong>des</strong>différentes algues en présence, en font <strong>des</strong> constats photographiques, recueil<strong>le</strong>nt <strong>des</strong> échantillonsd’algues, si besoin, pour en déterminer la systématique, ainsi que <strong>des</strong> informations relatives au type dedépôt et au mode de croissance (présence de base, morphologie de l’algue, …, indicatrices d’unephase fixée récente dans la vie de l’algue). Ces informations re<strong>le</strong>vées sont ensuite archivées etintégrées dans la base de données « Marées Vertes ».La définition d’un site à « échouage d’ulves » repose <strong>sur</strong> :- un seuil de quantité anorma<strong>le</strong> d’algues <strong>vertes</strong> détectab<strong>le</strong> par avion,- un contrô<strong>le</strong> de terrain qui vérifie que ce sont bien <strong>des</strong> ulves, qu’el<strong>le</strong>s sont libres et représententvisuel<strong>le</strong>ment plus d’un tiers <strong>des</strong> échouages (ou d’un rideau de bas de plage)Pour <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> vasières, <strong>le</strong> classement du site repose <strong>sur</strong> la présence, au moins loca<strong>le</strong>ment de tapiscontinu d’ulves (plutôt qu’un taux d’ulves dans l’échouage).Il n’y a donc pas, à proprement par<strong>le</strong>r, de seuil de superficie minima<strong>le</strong> pour qu’un site soit considéré,si ce n’est <strong>le</strong> fait que celui-ci doit pouvoir être détectab<strong>le</strong> par avion (et dépôts visib<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photosaériennes). Cela permet de considérer <strong>le</strong>s sites émergeants (« a<strong>le</strong>rte précoce »), de petites tail<strong>le</strong>s,comme <strong>le</strong>s sites plus importants. La notion d’importance de la prolifération est, par contre, traitéedans l’approche <strong>sur</strong>facique décrite ci-<strong>des</strong>sous (possibilité alors de faire <strong>des</strong> seuillages <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces).A noter que dans ce dénombrement, l’aspect prépondérant est la présence d’ulves dans l’échouage ou<strong>le</strong> tapis <strong>sur</strong> vasière qui est considérée comme indicatrice d’un dysfonctionnement potentiel del’écosystème.Cimav P4 – rapport final mars 2012 8
Survols réalisés pour <strong>le</strong> suivi <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> en 2011<strong>Suivi</strong>s RCS de la DCE et suivis complémentairesZone P112FINIS TE R EC OTE S -D'AR MORILLE -E T-VILAINEMOR BIHANLOIR E -ATLANTIQUETrajet en avion pour <strong>le</strong> suivi Marée-Vertes- DCE BLOOM Loire-Bretagne,programme de <strong>sur</strong>veillance en mai, juil<strong>le</strong>t, septembre(3 jours de <strong>sur</strong>vol par date d’inventaire)BR E TAGNE NOR DBR E TAGNE S UDS UD LOIR EVE NDE ES urvols complémentaires vasières (1 date)P112 - zone non <strong>sur</strong>volée, contrô<strong>le</strong>s de terrain- Survols complémentaires (CIMAV)en avril, juin, août et octobre (sites principaux)(1 jour de <strong>sur</strong>vol par mois)CIMAV - BRETAGNEC HAR E NTE -MAR ITIME.0 20 40 80 KmRéseau de Contrô<strong>le</strong> de Surveillance DCE : suivi CEVA,pilotage Ifremer, co-financement AELBCarte 1
souvent diffici<strong>le</strong>s à tracer. L’utilité de ces me<strong>sur</strong>es, répétées dans la saison, en <strong>sur</strong>face d’échouagepour ces sites qui présentent généra<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> évolutions de <strong>le</strong>urs couvertures plus <strong>le</strong>ntes que <strong>le</strong>ssites classiques de plage et <strong>le</strong> temps qu’il conviendrait d’y passer ont conduit <strong>le</strong> CEVA en accord avec<strong>le</strong>s partenaires de Pro<strong>littoral</strong> à saisir, pour une année, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces qui semb<strong>le</strong>nt être cou<strong>vertes</strong> par <strong>des</strong>dépôts épais d’ulves <strong>sur</strong> la date pour laquel<strong>le</strong> ces dépôts semb<strong>le</strong>nt à <strong>le</strong>ur maximum. Ce même travail<strong>sur</strong> <strong>le</strong> maximum annuel <strong>des</strong> vasières avait été proposé dans <strong>le</strong> cadre du programme de <strong>sur</strong>veillancepour 2007. Cela permet déjà de donner un poids relatif à chaque site et de comparer <strong>le</strong>s maximumsannuels de chaque site.En 2008, pour converger vers <strong>le</strong>s gril<strong>le</strong>s de classement européennes de la DCE mises au point par <strong>le</strong>sAnglais et <strong>le</strong>s Irlandais <strong>des</strong> masses d’eau de type « abritées » (vasières) <strong>le</strong> CEVA a tracé, toujourspour la date semblant présenter <strong>le</strong> maximum annuel de biomasse / dépôts épais (ou présentant <strong>le</strong>plus de photos exploitab<strong>le</strong>s <strong>des</strong> dépôts), toutes <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong>(filamenteuses ou en lame) pour <strong>le</strong>s sites qui sont classés comme « touchés par <strong>des</strong> échouagesd’ulves ». Cela évite d’avoir à distinguer <strong>le</strong>s deux types d’algue mais cela suppose aussi un travail bienplus important en terme de couverture photographique aérienne, de géoréférencement <strong>des</strong> photos etde digitalisation <strong>des</strong> dépôts (<strong>sur</strong>face beaucoup plus étendue si on ne se cantonne plus aux seulsdépôts épais de morphologie ulve). Ce changement dans <strong>le</strong> traitement <strong>des</strong> proliférations <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sitesen « eaux abritées » rend délicate toute comparaison brute <strong>des</strong> données de 2008 avec <strong>le</strong>s données <strong>des</strong>années précédentes.En 2009 et 2010, <strong>le</strong>s suivis <strong>sur</strong>faciques <strong>des</strong> vasières ont été réalisés avec <strong>le</strong>s mêmes métho<strong>des</strong> qu’en2008 (digitalisation <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong> au maximum annuel de biomasse).En 2010, afin de converger vers <strong>le</strong>s mêmes méthodologies mises au point par <strong>le</strong>s Anglais et <strong>le</strong>sIrlandais dans <strong>le</strong> cadre de la DCE, il a été choisi :- d’une part de s’affranchir de la notion de classement de sites et de digitaliser systématiquementtous <strong>le</strong>s dépôts d’algues <strong>vertes</strong> <strong>des</strong> systèmes vaseux (toutes <strong>le</strong>s FRGT ainsi que <strong>le</strong>s FRGC07,FRGC11, FRGC16 et FRGC39) dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s dépôts semb<strong>le</strong>nt pouvoir représenter 5% de couverture de l’aire potentiel<strong>le</strong>ment colonisab<strong>le</strong>- et d’autre part de choisir <strong>le</strong> mois d’inventaire présentant <strong>le</strong> maximum annuel de <strong>sur</strong>facecouverte par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong> (et non plus seu<strong>le</strong>ment basé <strong>sur</strong> <strong>le</strong> maximum annuel debiomasse).Il est à noter que la notion de classement est tout de même une donnée conservée car la couverturepar <strong>le</strong>s ulves <strong>des</strong> vasières plutôt que par <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong> filamenteuses nous semb<strong>le</strong> indiquer unniveau trophique supérieur et <strong>des</strong> impacts <strong>sur</strong> l’écosystème plus importants (effet colmatant <strong>des</strong>algues en lame). Cela permet en outre de poursuivre avec un même indicateur la chronique antérieureet d’établir <strong>des</strong> cartes présentant ces vasières touchées par <strong>des</strong> proliférations d’ulves en plus <strong>des</strong> cartes<strong>des</strong> sites de baies sab<strong>le</strong>uses.Pour pouvoir faire <strong>des</strong> acquisitions photographiques plus exhaustives <strong>des</strong> vasières sans compromettre<strong>le</strong>s acquisitions <strong>sur</strong> <strong>le</strong> reste du <strong>littoral</strong>, deux <strong>sur</strong>vols spécifiques ont été effectués à <strong>des</strong> dates a prioriproches du maximum annuel (cf. § 2.5.).En 2010 et <strong>le</strong>s années antérieures, la digitalisation <strong>des</strong> dépôts algaux <strong>des</strong> sites vaseux (dits enclavés)était effectuée 1 fois par an, au maximum annuel parmi <strong>le</strong>s trois dates d’acquisition (mai, juil<strong>le</strong>t etseptembre) à condition que cel<strong>le</strong>s-ci soient classées comme étant touchées par une marée verte. En2011, par contre, pour <strong>des</strong> questions de financements disponib<strong>le</strong>s, il a été choisi de travail<strong>le</strong>r àl’échel<strong>le</strong> <strong>des</strong> masses d’eau et de ne procéder à la digitalisation <strong>des</strong> dépôts que pour une dizained’entre el<strong>le</strong>s parmi <strong>le</strong>s FRGT et <strong>le</strong>s FRGC assimilées à <strong>des</strong> FRGT de part la typologie de <strong>le</strong>ursdépôts (FRGC07, FRGC11, FRGC16 et FRGC39). Les digitalisations ont été effectuées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> moisd’inventaire correspondant au maximum annuel du développement algal, <strong>le</strong> choix du maximum étantfait par appréciation visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> dépôts à partir <strong>des</strong> photos aériennes prises lors <strong>des</strong> trois moisCimav P4 – rapport final mars 2012 11
d’inventaire. Ce changement de procédure a pour conséquence l’absence de digitalisation <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sitesenclavés qui appartiennent à une masse d’eau côtière ce qui entraîne une sous-estimation del’importance de la marée verte à l’échel<strong>le</strong> de la masse d’eau. Pour illustrer ce cas, la figure ci-<strong>des</strong>sousillustre la masse d’eau côtière FRGC09 qui contient 9 sites dont 3 enclavés (Anse de Perros, Penvernet Diben) <strong>sur</strong> <strong>le</strong>squels aucune digitalisation n’a été effectuée au cours de l’année 2011. Néanmoins,cela conduit à une homogénéisation <strong>des</strong> données utilisées dans <strong>le</strong> cadre de l’évaluation de la qualitéécologique <strong>des</strong> masses d’eau côtières, <strong>le</strong>s sites enclavés n’étant comptabilisés qu’au maximum annuelde développement <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong> à l’inverse <strong>des</strong> sites ouverts qui peuvent faire l’objet de troisestimations par an (à condition que <strong>le</strong> site soit classé comme touché par une marée verte à ulves).Figure 1 : Découpage <strong>des</strong> masses d’eau <strong>sur</strong> la côte nord de la Bretagne (FRGC en rouge et FRGT en b<strong>le</strong>u) combiné audécoupage par sites à marées <strong>vertes</strong> (vio<strong>le</strong>t). Les trois sites enclavés sont indiqués par <strong>le</strong>s flèchesCimav P4 – rapport final mars 2012 12
Pour une vision complète de l’inventaire 2011 concernant <strong>le</strong>s masses d’eau de transition (FRGT) etassimilées (FRGC07, FRGC11, FRGC16 et FRGC39), la carte ci-<strong>des</strong>sous illustre <strong>le</strong>s masses d’eau <strong>sur</strong><strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s données ont été ou non acquises.Figure 2 : Illustration <strong>des</strong> masses d’eau dont <strong>le</strong>s blooms macroalgaux sont représentatifs <strong>des</strong> milieux vaseux. Lesmasses d’eau pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s données ont été complètement acquises apparaissent en b<strong>le</strong>u. A l’inverse, <strong>le</strong>s massesd’eau pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> données partiel<strong>le</strong>s ou aucune donnée n’ont été acquises apparaissent en noir. Enfin, <strong>le</strong>s sitesenclavés appartenant à une masse d’eau côtière et pour <strong>le</strong>squels aucune donnée n’a été acquise sont représentés en noir etindiqués par une flèche.Les masses d’eau ayant fait l’objet de digitalisation pour l’année 2011 sont <strong>le</strong>s suivantes : FRGT02,FRGT03, FRGT04, FRGT06, FRGT07, FRGT08, FRGT14, FRGT20, FRGT21, FRGT23,FRGT24, FRGT25 et FRGC39. Le choix <strong>des</strong> masses d’eau à digitaliser s’est porté en priorité <strong>sur</strong>cel<strong>le</strong>s étant en dehors du bon état écologique à la suite du classement DCE de 2010. Néanmoins,toutes <strong>le</strong>s acquisitions aériennes ont été effectuées quel<strong>le</strong> que soit la masse d’eau ce qui pourrapermettre, <strong>le</strong> cas échéant, de procéder à <strong>des</strong> digitalisations complémentaires. Les résultats sontactuel<strong>le</strong>ment en cours de finalisation et seront présentés dans <strong>le</strong> rapport DCE Loire-Bretagne 2011.2.3. Indice d’eutrophisationLa me<strong>sur</strong>e d’un « niveau d’eutrophisation » dans différents sites à marées <strong>vertes</strong> est possib<strong>le</strong> par uneanalyse saisonnière de teneurs internes <strong>des</strong> Ulves en azote et phosphore. Le principe d’utilisation decet indicateur biochimique repose <strong>sur</strong> l’existence d’une relation entre ces quotas azotés ouphosphorés et la croissance de l’algue, relation lui conférant un caractère d’indicateur nutritionnel decroissance. Il permet de manière généra<strong>le</strong> d’analyser l’action limitante <strong>des</strong> flux d’azote et dephosphore <strong>sur</strong> la croissance <strong>des</strong> Ulves en période estiva<strong>le</strong>, en relation avec certains facteursclimatiques.Cimav P4 – rapport final mars 2012 13
L’analyse saisonnière <strong>des</strong> quotas internes <strong>des</strong> algues permet plus particulièrement :• d’établir un état de référence nutritionnel pour <strong>le</strong> degré d’eutrophisation atteint dans <strong>le</strong> site, enme<strong>sur</strong>ant <strong>le</strong> niveau de saturation de la croissance <strong>des</strong> algues par <strong>le</strong>s sels nutritifs. Ce niveauexprime aussi la sensibilité du site à <strong>des</strong> apports supplémentaires en sels nutritifs, comme sarésistance potentiel<strong>le</strong> à <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es préventives (en cas de <strong>sur</strong>saturation de la croissance).• de mettre en place un indicateur de suivi pour contrô<strong>le</strong>r en continu l’effet de me<strong>sur</strong>es préventives<strong>sur</strong> <strong>le</strong> bassin versant. Cet effet peut s’observer <strong>sur</strong> la composition chimique <strong>des</strong> algues avantmême de pouvoir être me<strong>sur</strong>é <strong>sur</strong> la croissance ou la quantité d’algues produites.• de mettre en évidence, dans certains sites, une aggravation pluriannuel<strong>le</strong> de la situation alors quela « marée verte apparente » me<strong>sur</strong>ab<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s stocks en place semb<strong>le</strong> ne plus évoluer.Le programme a consisté à me<strong>sur</strong>er <strong>le</strong> niveau de saturation de la croissance <strong>des</strong> algues par ladisponibilité d’azote et de phosphore dans 21 sites touchés (14 points de prélèvements <strong>sur</strong> <strong>des</strong> sites« classiquement suivis » et 8 nouveaux sites n’ayant jamais ou il y a plus de 10 ans fait l’objet deme<strong>sur</strong>es) <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes <strong>breton</strong>nes par l’établissement de profils saisonniers (suivi bimensuel àhebdomadaire selon <strong>le</strong>s sites et la période) de l’évolution <strong>des</strong> quotas internes <strong>des</strong> algues. Lephosphore est intégré (ou plutôt réintégré) depuis 2010 dans <strong>le</strong> suivi <strong>des</strong> de composition chimique<strong>des</strong> ulves, suite la mise en évidence (dans <strong>le</strong> cadre <strong>des</strong> projets P3-2008 et 2009) que <strong>le</strong> phosphorepouvait à la période récente co-limiter avec l’azote la croissance <strong>des</strong> algues dans certains sites.‣ Moyens mis en œuvre :Prélèvements et identification <strong>des</strong> différentes espèces d’Ulves. Tri, conditionnement, analyse <strong>des</strong>échantillons. Traitement <strong>des</strong> données et interprétation <strong>des</strong> profils de composition interne.• Description de l’indicateur :L’indicateur consiste à analyser l’évolution <strong>des</strong> teneurs en azote ou en phosphore <strong>des</strong> Ulves, parrapport aux niveaux Q1N ou Q1P, en <strong>des</strong>sous <strong>des</strong>quels la croissance <strong>des</strong> algues est limitée par N ou P,et Q0N ou Q0P à partir <strong>des</strong>quels la croissance s’annu<strong>le</strong> (cf. Dion et LeBozec, 1997). Ces va<strong>le</strong>urs dequotas ont été consolidées à partir de données de la littérature établies pour <strong>des</strong> ulves (Villares etCabal<strong>le</strong>ira, 2004, Daalsgard et Krause-Jensen, 2006) et à partir d’expérimentations réalisées au CEVA<strong>sur</strong> Ulva armoricana (CIMAV P3 2009, 2010, 2011). La méthode de référence pour <strong>le</strong> dosage de l’azoteest la méthode Kjeldahl. La méthode utilisée pour <strong>le</strong> phosphore est un dosage par ICP.Pour l’azote on retiendra que 80 à 100 % de la croissance maxima<strong>le</strong> est maintenue au-<strong>des</strong>sus d’unquota critique (Q1N) de 2 % de la matière sèche (M.S), et que la croissance s’annu<strong>le</strong> en <strong>des</strong>sous d’unquota de subsistance de 0,9 % de la M.S.Pour <strong>le</strong> phosphore on considèrera que la croissance commence à être limitée en <strong>des</strong>sous 0.12% de laMS et qu’el<strong>le</strong> s’annu<strong>le</strong> à 0.05% de la MS (cf. résultats du projet CIMAV P3 2010).On prendra comme hypothèse que Ulva rotundata, présente dans certains sites, possède <strong>le</strong>s mêmescaractéristiques de quotas limitants que Ulva armoricana, espèce la plus répandue dans <strong>le</strong>s marées<strong>vertes</strong> et qui est la seu<strong>le</strong> à avoir fait l’objet d’investigations précises pour la détermination de sesquotas internes critiques et de subsistance.Cimav P4 – rapport final mars 2012 14
• Prélèvement, traitement et analyse <strong>des</strong> échantillons :Les algues ont été pré<strong>le</strong>vées à une fréquence bimensuel<strong>le</strong> (hebdomadaire <strong>sur</strong> certains sites <strong>sur</strong> lapériode la plus signifiante) à différents points d’échantillonnages (tab<strong>le</strong>au 1), totalisant 251prélèvements effectués dès l’apparition nette et régulière <strong>des</strong> algues <strong>sur</strong> l’estran <strong>des</strong> sites, c’est à dire àpartir du 18 avril pour <strong>le</strong>s premiers touchés et jusqu’au 1 er septembre <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites tardifs. A chaquedate et lieu de prélèvement, <strong>le</strong>s algues ont été échantillonnées à marée basse, au niveau de la massed’algues flottantes de bas de plage. 7 à 10 échantillons de 20 à 50g ont été, à chaque fois que <strong>le</strong>squantités d’algues présentes <strong>le</strong> permettaient, récoltés à une dizaine de mètres <strong>le</strong>s uns <strong>des</strong> autres, puisrassemblés en un seul lot dans un sac plastique. De retour au laboratoire, <strong>le</strong>s lots ont été conditionnés(nettoyage, rinçage, déshydratation) pour stockage avant analyse. Avant chaque analyse, <strong>le</strong>s lots ontété homogénéisés au broyeur à couteaux. Chaque lot a fait l’objet d’une analyse, pour la matière sèche,l’azote Kjeldah (241 dosages N) et, pour <strong>le</strong> phosphore total (241 dosages P). L’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> dosagesest réalisé par In Vivo labs, laboratoire agréé COFRAC, sous traitant du CEVA.• Plan de prélèvements et localisation <strong>des</strong> sites : La liste de sites établie en 2010 a été sensib<strong>le</strong>ment augmentée en 2011 pour prendre en compte :oola totalité <strong>des</strong> « sites principaux », faisant actuel<strong>le</strong>ment l’objet de modélisations d’objectifsde qualité à atteindre aux exutoires et/ou d’actions BV spécifique dans <strong>le</strong> cadre du plangouvernemental AV. Ces critères ont justifié la réintégration de l’Anse de Locquirec etde l’Anse du Dossen dans la liste de sites 2011.un ensemb<strong>le</strong> additionnel de « petits sites », historiquement considérés comme moinsimportants mais ayant présentant <strong>des</strong> proliférations suffisamment importantes lors del’analyse de tous <strong>le</strong>s sites régionaux (travail CEVA de qualification <strong>des</strong> sites pourl’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour soutenir l’action <strong>des</strong> SAGEs) et dont <strong>le</strong>s niveauxnutritionnels ne sont pas connus (au moins pour la période récente).Liste additionnel<strong>le</strong> <strong>des</strong> 8 petits sites :Bréhec,Trestel,Moguéran,Aber Wrac’hFort Bloqué,Larmor Plage,PenvinsMine d’OrTab<strong>le</strong>au 1 : localisation <strong>des</strong> points de prélèvement 20111. Estuaire de la Rance – Mouillage de St Jouan2. Baie de la Fresnaye – Rideau Est : pas d’algues <strong>vertes</strong> en 20113. Baie de St Brieuc – Bouchots de l’Anse de Morieux4. Baie de Binic – Rideau Nord5. Anse de Bréhec – Rideau6. Plage de Trestel – Rideau7. Baie St Michel en Grève – Rideau8. Baie de Locquirec –Plage de Tossenn (rideau)9. Anse de Horn Guil<strong>le</strong>c – Moguériec (rideau)Cimav P4 – rapport final mars 2012 15
10. Anse de Guisseny – Plage du Club nautique (rideau)11. Moguéran – Plage de Koréjou (rideau)12. Aber Wrac’h – Mouillage de Keridaouen13. Baie de Douarnenez – Plage de Ste Anne (rideau)14. Baie de Douarnenez – Plage du Ry (rideau)15. Baie de Concarneau - Plage de Ker<strong>le</strong>ven16. Le Fort Bloqué – Mouillage de Fort Bloqué17. Larmor Plage – Plage de Toulhars (si absence d’algue, prélèvement à La Nourriguel)18. Rade de Port Louis – vasière du Quélisoy19. Rivière de Vannes – Grève de Larmor Gwened – Arcal20. Rivière de Vannes - Vasière de Séné21. Pointe de Penvins – Plage de Penvins - Eco<strong>le</strong> de voi<strong>le</strong>22. Penestin – Mouillage de Poudrantais la fréquence d’échantillonnage a été globa<strong>le</strong>ment bimensuel<strong>le</strong>s dans l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites, généranten moyenne 10 prélèvements par site au cours de la saison de prolifération. Les sites principauxde la première liste ont toutefois fait l’objet de 3 campagnes de prélèvements supplémentaires,afin de consolider à une échel<strong>le</strong> hebdomadaire l’analyse la <strong>des</strong>cente <strong>des</strong> quotas azotés etphosphorés <strong>sur</strong> la période la plus critique du développement du bloom (mi juin à fin juil<strong>le</strong>t).Cimav P4 – rapport final mars 2012 16
2.4. Evaluation <strong>des</strong> stocks totaux‣ Estimation du stock infra<strong>littoral</strong>Les prospections sont réalisées au moyen de plongées tractées par aquaplane. Une équipe de troisplongeurs professionnels, incluant deux ou trois techniciens CEVA, suivant <strong>le</strong>s missions, est utilisée.Les investigations sous-marines se dérou<strong>le</strong>nt entre <strong>le</strong> 0 SHOM et l’isobathe 10 mètres. A chaquechangement de densité d’algue <strong>sur</strong> <strong>le</strong> fond est réalisé un prélèvement de biomasses d’ulves <strong>sur</strong> 1 m²(pesées au retour de mission).Les informations de position sont enregistrées à l’aide d’un GPS différentiel dont <strong>le</strong>s points sontdirectement récupérés <strong>sur</strong> ordinateur au moyen d’un câb<strong>le</strong> de communication. Ces informations sontensuite transférées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Système d’Information Géographique Arcgis. Cette étape permet devisualiser <strong>le</strong>s trajets et <strong>le</strong>s prélèvements réalisés <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la mission.Pour accéder à une estimation du stock immergé d’ulves, <strong>le</strong>s données ponctuel<strong>le</strong>s de prélèvementsont interpolées à l’ensemb<strong>le</strong> de la zone prospectée. Ce traitement est réalisé au moyen du modu<strong>le</strong>Spatial Analyst du logiciel Arcgis. La méthode d’interpolation dite <strong>des</strong> « plus proches voisins » estutilisée avec <strong>le</strong>s mêmes paramètres que lors <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es antérieures ce qui permet de rendre <strong>le</strong>sdonnées plus aisément comparab<strong>le</strong>s. Dans cette méthode, la procédure attribue à un pixel donné lamoyenne arithmétique <strong>des</strong> quatre plus proches points de prélèvements (pondération par la distanceau carré). Le poids <strong>des</strong> points de me<strong>sur</strong>es sera d’autant plus faib<strong>le</strong> que sa distance est grande parrapport au pixel considéré pour l’interpolation. La tail<strong>le</strong> <strong>des</strong> pixels générés (entité à laquel<strong>le</strong> sontrapportées <strong>le</strong>s interpolations) est fixée à 10*10 m².‣ Estimation du stock <strong>sur</strong> estran et dans <strong>le</strong> rideau au moment de la prospection sous marineL’estimation <strong>des</strong> dépôts <strong>sur</strong> plage au maximum estival <strong>des</strong> stocks est réalisée à partir <strong>des</strong> prises devues aériennes acquises dans <strong>le</strong> cadre du suivi <strong>sur</strong>facique <strong>des</strong> sites. Pour <strong>le</strong>s estimations hiverna<strong>le</strong>s <strong>des</strong>vols spécifiques sont déc<strong>le</strong>nchés pour appréhender <strong>le</strong>s dépôts <strong>sur</strong> estran si cela est jugé nécessaire(présence d’algues détectée <strong>sur</strong> estran). Des équipes au sol, sont déployées <strong>le</strong> jour du <strong>sur</strong>vol poureffectuer <strong>le</strong>s prélèvements <strong>sur</strong> l’estran (sauf cas <strong>des</strong> vasières pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> missions décalées deplusieurs jours sont possib<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s algues étant très peu mobi<strong>le</strong>s en conditions météorologiquesstab<strong>le</strong>s). A chaque prélèvement est associé un point GPS et sont re<strong>le</strong>vés : <strong>le</strong> poids de l’échantillon <strong>sur</strong>¼ de mètre carré, l’estimation du taux de recouvrement de l’estran par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong>, <strong>le</strong> type dedépôts, photographie du dépôt et du quadrat de prélèvement. Les me<strong>sur</strong>es de biomasses sonteffectuées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain ou au retour au laboratoire après avoir été remouillées (pour <strong>le</strong>s dépôts secs)puis égouttées une minute, ce qui permet de passer de façon fiab<strong>le</strong> à une estimation de la matièresèche (bonne relation algues égouttées une minute / matière sèche). En ce qui concerne <strong>le</strong> rideau, <strong>le</strong>salgues étant distribuées <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la hauteur d’eau, la quantification de ce dernier est réalisée àl’aide de « quadrats » circulaires spécifiques dotés d’un fi<strong>le</strong>t en forme de « chaussette » afin derécupérer la totalité <strong>des</strong> algues présentes dans la colonne d’eau au moment de la me<strong>sur</strong>e.Les prises de vues aériennes sont ensuite importées sous <strong>le</strong> logiciel SIG Arcgis <strong>le</strong>quel permet ungéoréférencement de l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés numérisés. On obtient ainsi une mosaïque d’imagesgéoréférencées permettant une délimitation précise <strong>des</strong> différents dépôts et <strong>le</strong>urs taux de couverture.A ces informations en couverture sont ajoutées <strong>le</strong>s données de me<strong>sur</strong>e de biomasse / m2 (rapportéesà <strong>des</strong> kg/m2 d’équiva<strong>le</strong>nt 100 % de couverture) pour estimer <strong>le</strong>s biomasses tota<strong>le</strong>s d’algues présentesdans chaque polygone.Cimav P4 – rapport final mars 2012 17
2.5. Missions réalisées‣ Contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCE (financé en dehors de ce programme)Toutes <strong>le</strong>s missions planifiées ont pu être réalisées aux pério<strong>des</strong> prévues. Les contraintes spécifiquesde <strong>sur</strong>vol de la rade de Brest (zone militaire P112) n’ont cependant pas permis de <strong>sur</strong>vo<strong>le</strong>r l’ensemb<strong>le</strong>de la rade de Brest (autorisation de <strong>sur</strong>vol refusée). Les opérations de terrains ont été densifiées <strong>sur</strong>cette zone pour compenser cette impossibilité de <strong>sur</strong>vol (secteur de la presqu’i<strong>le</strong> de Crozonprincipa<strong>le</strong>ment ; <strong>le</strong>s secteurs du fond de rade <strong>sur</strong> la partie Aulne comme Elorn étant accessib<strong>le</strong> en<strong>sur</strong>vol comme <strong>le</strong> présente la carte 1).Les <strong>sur</strong>vols ont été réalisés aux dates et coefficients de marées suivants :Mai :- 16 mai : Sud Loire ; coef. 92- 17 mai : côtes de Bretagne Sud; coef. 99- 18 mai : côtes de Bretagne Nord (exclusion d’une partie de la rade de Brest / autorisation P112refusée) ; coef. 101Juil<strong>le</strong>t :- 14 juil<strong>le</strong>t : côtes de Bretagne Nord (exclusion d’une partie de la rade de Brest / autorisation P112refusée) ; coef. 77- 15 juil<strong>le</strong>t : côtes de Bretagne Sud ; coef. 84- 18 juil<strong>le</strong>t : côtes Sud Loire ; coef. 86- 20 juil<strong>le</strong>t : <strong>sur</strong>vol complémentaire <strong>des</strong> vasières du Sud Bretagne (Estuaire de la Vilaine, de Penerf,de la rivière d’Auray, de la rivière de Crac’h, ria d’Etel, estuaire du Blavet et du Scorff, de la Laïta,de l’Aven et du Belon, de l’Odet) ; coef. 68NB : Les acquisitions <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s autres vasières ont été réalisées en même temps que <strong>le</strong>s acquisitionscôtières <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>vols de juil<strong>le</strong>t, mai ou septembre.Septembre :- 13 septembre : côtes de Bretagne Sud ; coef. 88- 14 septembre : côtes du Sud Loire ; coef. 86- 15 septembre : côtes de Bretagne Nord (exclusion d’une partie de la rade de Brest / autorisationP112 refusée) ; coef. 82Rapidement après chaque vol, l’équipe du CEVA a été mobilisée <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain pour contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong> typed’algue repéré en aérien. L’intervention rapide permet de minimiser <strong>le</strong> risque de ne pas retrouver, lors<strong>des</strong> contrô<strong>le</strong>s de terrain, <strong>le</strong>s algues photographiées lors de la mission aérienne. Ces contrô<strong>le</strong>s ont puêtre réalisés <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>s sites pour <strong>le</strong>squels cela a été jugé nécessaire.‣ <strong>Suivi</strong> aérien complémentaireLes 4 <strong>sur</strong>vols complémentaires se sont déroulés comme prévus, aux dates suivantes :- 19 avril ; coef. 110,- 16 juin ; coef. 91,- 15 août ; coef. 89,- 14 octobre ; coef. 81.Cimav P4 – rapport final mars 2012 18
‣ Missions de prélèvement « indices d’eutrophisation »Les algues ont été pré<strong>le</strong>vées à une fréquence bimensuel<strong>le</strong>, dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>ur présence permettait<strong>le</strong>s prélèvements, <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>s sites présentés dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 1 du paragraphe 2.3., à partir du 18 avrilpour <strong>le</strong>s premiers prélèvements et jusqu’au 1 er septembre pour <strong>le</strong>s derniers. De plus <strong>sur</strong> 12 sites listésdans la première partie <strong>le</strong>s prélèvements ont été hebdomadaires <strong>sur</strong> la période mi juin à fin juil<strong>le</strong>t.‣ Missions d’évaluation <strong>des</strong> stocks totauxDates <strong>des</strong> missions été 2011(estimation stocks maximaux)Secteurs côtiers concernés Biomasse infralittora<strong>le</strong> Biomasse <strong>sur</strong> estranBaie de Saint Michel en Grève 16 juin au 1 er juil<strong>le</strong>t Le 1 er juil<strong>le</strong>t 2011Dates <strong>des</strong> missions hiver 2011-2012(estimation stocks minimaux)Secteurs côtiers concernés Biomasse infralittora<strong>le</strong> Biomasse <strong>sur</strong> estranBaie de Saint Michel en Grève - 7 février 2012Vasières la baie du Lédano (Trieux) -Survol <strong>le</strong> 7 février 2012 etterrain <strong>le</strong> 26 janvier 2012Cimav P4 – rapport final mars 2012 19
3- RESULTATS3.1- Dénombrement <strong>des</strong> sites en Bretagne (suivi DCE <strong>sur</strong>veillance, financé en dehors de ceprogramme)Bien que ne faisant pas parti du programme 2011 « suivis complémentaires » est proposée ici une analyse à l’échel<strong>le</strong> dela Bretagne <strong>des</strong> sites concernés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> observations conduites pour <strong>le</strong> « programmeDCE <strong>sur</strong>veillance » <strong>des</strong> côtes Loire Bretagne (commande Ifremer). Cette analyse permet de poursuivre la série acquisedans <strong>le</strong> cadre de Pro<strong>littoral</strong> et même antérieurement pour <strong>le</strong> compte de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne depuis 1997.Il ne s’agit ici que d’une extraction <strong>des</strong> données acquises à l’échel<strong>le</strong> du <strong>littoral</strong> Loire Bretagne pour l’Ifremer (DCESurveillance).Le premier rô<strong>le</strong> de ce suivi est l’observation loca<strong>le</strong> de la colonisation par <strong>le</strong>s ulves, la mise « sous<strong>sur</strong>veillance » de certains points du <strong>littoral</strong> et l’archivage de ces observations. Cela permetaussi d’évaluer l’évolution de la marée verte au cours de l’année et <strong>sur</strong> une période pluriannuel<strong>le</strong>débutant en 1997, année du premier inventaire régional commandé au CEVA par l’Agence de l’EauLoire-Bretagne (pas d’évaluation <strong>sur</strong>facique disponib<strong>le</strong> avant 2002 à l’échel<strong>le</strong> Bretagne). Par ail<strong>le</strong>urs, lalocalisation précise <strong>des</strong> sites permet de percevoir <strong>le</strong>ur répartition géographique et l’apparition denouveaux sites <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> (vérifier que l’observation concerne un nouveau site et non pasun site préexistant dont <strong>le</strong>s échouages seraient repartis différemment <strong>des</strong> années précédentes). Enfin,<strong>des</strong> premiers éléments de caractérisation <strong>des</strong> sites peuvent être re<strong>le</strong>vés notamment en ce qui concerne<strong>le</strong>ur typologie (sites enclavés développant <strong>des</strong> proliférations <strong>sur</strong> vase ou plus ouverts, <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>) et <strong>le</strong>sespèces d’algues proliférantes à l’origine <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong>.3.1.1- Inventaire <strong>des</strong> sites touchés par une marée verte à ulves en 2011Les sites repérés par avion sont classés comme sites à « échouages d’ulves » à partir du moment où<strong>le</strong>s dépôts sont décelab<strong>le</strong>s par avion et <strong>le</strong>s vérités-terrain mettent en évidence une proportion jugée« anorma<strong>le</strong> » d’ulves (visuel<strong>le</strong>ment un tiers d’ulves dans l’échouage). Une partie de ces sites sont <strong>des</strong>sites d’échouage de goémon, parfois de très petite tail<strong>le</strong> (quelques dizaines ou centaines de mètrescarrés). Dans la me<strong>sur</strong>e où la présence d’ulves est significative, <strong>le</strong> site est classé car on ne peut exclureun lien avec l’eutrophisation du milieu qui provoque une croissance « anorma<strong>le</strong> » <strong>des</strong> algues et <strong>des</strong>algues <strong>vertes</strong> plus particulièrement (croissance rapide de ces algues). Les vasières, si el<strong>le</strong>s sont, en plusou moins grande partie, cou<strong>vertes</strong> par <strong>des</strong> ulves sont éga<strong>le</strong>ment classées comme touchées. Il estimportant de répertorier ces sites (réponses à <strong>des</strong> riverains préoccupés par ces échouages, « a<strong>le</strong>rteprécoce » en cas d’apparition d’échouages plus ou moins importants et devenant réguliers). Ces sitesne peuvent pour autant être tous assimilés aux quelques grands sites régionaux dits à « marées<strong>vertes</strong> », <strong>sur</strong> <strong>le</strong>squels la production d’ulves est considérab<strong>le</strong> et dure plusieurs mois de l’année,provoquant <strong>des</strong> échouages massifs, sources de nuisances pour <strong>le</strong>s riverains et touristes. Aussi, <strong>le</strong>dénombrement de sites est un indicateur qu’il convient d’utiliser avec prudence.L’importance de la marée verte de l’année sera qualifiée de façon plus fine à traversl’indicateur <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves.Notion de « site touché » par <strong>le</strong>s échouages d’ulves :Au fil <strong>des</strong> années de suivis <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> en Bretagne, <strong>le</strong> CEVA a classé comme « sites » <strong>le</strong>s zones dans <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>sapparaissaient <strong>des</strong> échouages d’ulves si ceux-ci étaient distincts de sites préexistants : site pouvant être alimenté par uncours d’eau différent et présentant une discontinuité avec <strong>le</strong>s dépôts de sites voisins (classiquement séparés par une pointerocheuse, ou un secteur côtier indemne d’algues). Le dénombrement <strong>des</strong> sites dépendant largement la définition de « site »doit donc être considéré avec prudence. A titre d’illustration, la baie de Douarnenez qui peut être considérée comme une« baie touchées » est en réalité dans <strong>le</strong>s inventaires décomposée en 11 « sites » distincts.Cimav P4 – rapport final mars 2012 20
L’année 2011 n’ayant comporté, comme c’était déjà <strong>le</strong> cas depuis l’année 2007, que trois inventairesrégionaux, au lieu de 4 entre 2002 et 2006, il n’est pas possib<strong>le</strong> de comparer de façon brute <strong>le</strong>sdonnées de 2011 à la série 2002-2006. Pour pouvoir comparer au mieux <strong>le</strong>s données de l’année, sontisolés <strong>le</strong>s inventaires « d’été » (juil<strong>le</strong>t ou septembre) pour <strong>le</strong>s comparer aux données <strong>des</strong> annéesantérieures.Les sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves pendant la période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>t ou septembre)Afin de pouvoir comparer avec <strong>le</strong>s années 2000 à 2010 concernées par au moins deux <strong>sur</strong>vols enpériode estiva<strong>le</strong>, ne sont considérés ici que <strong>le</strong>s dénombrements de juil<strong>le</strong>t et septembre 2011.On comptabilise alors <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> :• 79 sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves en juil<strong>le</strong>t 2011 (annexe 1)• 55 sites touchés en septembre 2011 (annexe 1)• 84 sites au total touchés en juil<strong>le</strong>t ou en septembre 2011 (carte 2)Pour ce qui est de la période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>t – septembre), l’année 2011 est, avec 84 sitesrecensés, à un niveau nettement plus bas que 2009 mais identique à 2010 (cf. § 3.1.2). Sur ces 84sites « estivaux », 50 sont touchés lors <strong>des</strong> deux inventaires et 34 lors d’un <strong>des</strong> deux inventaires.Nombre de sites touchés en été 2011 (juil<strong>le</strong>t ou septembre)561429592211350total840 20 40 60 80 100Figure 3 : nombre de sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves au moins une fois pour <strong>le</strong>s inventaires estivaux en 2011(juil<strong>le</strong>t ou septembre).La carte 2 et la figure 3 montrent la nette prédominance, en nombre de sites du département duFinistère qui, <strong>sur</strong> cette période de l’année regroupe en 2011 plus <strong>des</strong> deux tiers (70%) du total<strong>des</strong> sites <strong>des</strong> côtes <strong>breton</strong>nes ; suit avec plus de quatre fois moins de sites <strong>le</strong> département duMorbihan puis celui <strong>des</strong> Côtes d’Armor (5 fois moins). En 2011, <strong>sur</strong> cette période de l’année, aucunsite n’a été classé comme touché par <strong>des</strong> échouages d’ulve <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> d’Il<strong>le</strong> et Vilaine (tous <strong>le</strong>s sitesde la Rance étaient d’après nos observations plutôt couverts d’algues <strong>vertes</strong> filamenteuses et nond’ulves à partir de juil<strong>le</strong>t ce qui explique cet absence de classement). A noter l’absence de sitestouchés à l’Est de la baie de Saint Brieuc en 2011 ce qui est exceptionnel. Cet indicateur netient pas compte de l’importance relative <strong>des</strong> sites ; l’analyse <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces <strong>des</strong> sites (cf. § 3.2) donneune image très différente de l’importance du phénomène par département.Cimav P4 – rapport final mars 2012 21
Echouages d'ulves observés en juil<strong>le</strong>t ou septembre 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé àmarée basse de fort coefficient. Les sitessont classés comme touchés à partir dumoment où <strong>le</strong>s dépôts sont décelab<strong>le</strong>sd'avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrainmettent en évidence <strong>des</strong> proportionsanorma<strong>le</strong>s d'ulves. Certains sites sont detrès petite tail<strong>le</strong> et ne correspondent pas àla <strong>des</strong>cription classique de "marée verte".GUISSENYMOGUERAN/COREJOUBRIGNOGAN PORS-GUEN/PORS-MEURHORN/GUILLECKERLOUAN PLOUNEOURTY NOD/RADE DE MORLAIXDIBENPORZ BILIECLOCQUEMEAUANSE DE PERROSTRESTELPELLINECJAUDYLEDANOBINIC/ETABLES-SUR-MERLimite del'inventairePORTSALLABER BENOITMOULIN-BLANCGOULVENABER WRACHKEREMMAELORNKERVALIOU/KERFISSIENPORT NEUFPENZEMOULIN-DE-LA-RIVELOCQUIRECBEG LEGUERSAINT-MICHEL-EN-GREVETINDUFF/MOULIN NEUFDAOULASROSCANVELMORGATHOPITAL CAMFROUTAULNE/FOND DE RADEYFFINIACMORIEUXPOSTOLONNECPORSLOUSABERTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDBAIE DES TREPASSESKERVEL/TREZMALAOUENPORT RHU/TREBOULRYLOCHPORT LA FORET84 sites touchésAUDIERNEPOULDONILE-TUDYODETCAP COZCONCARNEAUCABELLOUSites de type vasièresTREVIGNONAVENFORT-BLOQUEsite classé 1 foisMOUSTERLINPORT LOUISsite classé 2 foissite classé 3 foisSites de type plagessite classé 1 foissite classé 2 foissite classé 3 foisGUILVINECLESCONIL.BEG MEILBEG MEIL NORDANSE DEPOULDOHANKERLEVEN/SAINT-LAURENTPORT-MANECHPOULDUKERPAPELARMOR-PLAGECOUREGANTPOINTE DE GAVRESERDEVENRIA D ETELAURAYNORD OUESTGOLFE 56NORD EST GOLFE 56MINE D OROccurences calculées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 3 inventairesgénéraux de mai, juil<strong>le</strong>t et septembre 20110 30 60KmCarte 2PENVINSLimite del'inventairePOINTE DU BILE
Les sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la saisonLes suivis, avant la mise en place de Pro<strong>littoral</strong> en 2002, ne comportaient que <strong>des</strong> inventaires enpériode estiva<strong>le</strong>, ce qui avait été analysé comme réducteur, certains secteurs étant concernés par <strong>des</strong>échouages très précoces, d’autres par <strong>des</strong> échouages tardifs, d’autres encore par <strong>des</strong> échouagesirréguliers et dépendants <strong>des</strong> conditions météorologiques lors du vol ou dans <strong>le</strong>s jours qui précèdent(<strong>le</strong> fait d’augmenter <strong>le</strong> nombre de <strong>sur</strong>vols permet alors de diminuer <strong>le</strong> « risque » de passer à côté deces sites d’échouage). Afin de percevoir <strong>le</strong> phénomène de façon plus complète et de mieux estimerl’évolution annuel<strong>le</strong> <strong>sur</strong> chaque site, deux <strong>sur</strong>vols supplémentaires, l’un printanier, l’autre automnal,étaient réalisés chaque année de 2002 à 2006. Le paragraphe précédent présentait <strong>le</strong>s suivis au travers<strong>des</strong> deux <strong>sur</strong>vols « estivaux » juil<strong>le</strong>t et septembre. Depuis 2007, en plus de ces deux <strong>sur</strong>vols estivaux« exhaustif » <strong>des</strong> côtes un troisième se dérou<strong>le</strong> en mai. L’exploitation de cet inventaire supplémentairepermet d’améliorer la perception du phénomène.‣ Un dénombrement de sites plus comp<strong>le</strong>tEn mai, 76 sites ont été classés comme touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves, niveau très supérieur à2010 (42 sites) mais proche de celui de l’année 2009 (75 sites). En 2011 (contrairement au cas de2010) l’ajout de cet inventaire de mai augmente beaucoup <strong>le</strong> nombre total de sites touchés <strong>sur</strong>l’ensemb<strong>le</strong> de l’année (+18 sites) pour <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> par rapport à la seu<strong>le</strong> période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>tseptembre).Les sites de l’Est <strong>des</strong> Côtes d’Armor et de l’Il<strong>le</strong> et Vilaine touchés en 2011 <strong>le</strong> sont tousuniquement en mai, ce qui explique qu’ils n’apparaissaient pas <strong>sur</strong> la carte 2 (Rance et Lancieux). Legrand nombre de site en mai, <strong>sur</strong>tout au regard du nombre de sites en juil<strong>le</strong>t ou septembre, indique <strong>le</strong>caractère précoce de l’année ou du moins la moindre prolifération en fin de saison.• 76 sites touchés en mai (annexe 1),• 18 sites repérés uniquement en mai,• 102 sites au total <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de l’année (carte 3).Nombre de sites touchés en 2011 (3 inventaires)561829652215354total1020 20 40 60 80 100 120Figure 4 : nombre de sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves au moins une fois en 2011 (mai, juil<strong>le</strong>t, septembre).Sur <strong>le</strong>s 18 sites qui étaient dénombrés en mai 2011 mais ne l’étaient pas <strong>sur</strong> la seu<strong>le</strong> période estiva<strong>le</strong>(juil<strong>le</strong>t+septembre), on en trouve 6 <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes finistériennes et 4 pour chacun <strong>des</strong> autresdépartements.Sur l’ensemb<strong>le</strong> de l’année, <strong>le</strong> département du Finistère comprend prés <strong>des</strong> deux tiers (64 %) du total<strong>des</strong> sites répertoriés en Bretagne. Viennent ensuite <strong>le</strong>s départements du Morbihan et <strong>des</strong> Côtesd’Armor (avec près de 4 fois moins de sites) et enfin nettement derrière <strong>le</strong> département d’Il<strong>le</strong> etVilaine.Cimav P4 – rapport final mars 2012 23
Cet inventaire <strong>des</strong> « localisations » touchées par <strong>des</strong> échouages d’ulves ne doit pas conduireà conclure <strong>sur</strong> l’importance <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> par département, l’information <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>facescou<strong>vertes</strong> par site (cf. § 3.2) permet de mieux mettre en évidence l’importance <strong>des</strong>proliférations.L’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> 3 inventaires de 2011 est présenté dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au suivant avec <strong>le</strong> rappel<strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> années antérieures (3 inventaires éga<strong>le</strong>ment pour 2007 à 2010, 4 inventaires pour <strong>le</strong>sannées 2002-2006). Les niveaux atteints depuis 2007 sont diffici<strong>le</strong>ment comparab<strong>le</strong>s aux annéesprécédentes dans la me<strong>sur</strong>e où l’on ne dispose plus d’inventaire en octobre (sous estimation dunombre de sites tardifs) ni en août. Par contre on dispose d’un inventaire en septembre plutôtqu’août (deux inventaires proches permettent a priori de moins bien distinguer <strong>des</strong> sites dont <strong>le</strong>sproliférations sont décalées dans <strong>le</strong> temps).Département 35 22 29 56 TotalMai 2010(2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010)Juil<strong>le</strong>t 2010(2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010)Août 2007 à 2010 : pasd’inventaire(2002, 2003, 2004, 2005, 2006)Septembre 2010(pas d’inventaire de 2002 à 2006,2007, 2008, 2009, 210)Octobre 2007 à 2010 :pas d’inventaire(2002, 2003, 2004, 2005, 2006)4(0, 0, 2, 4, 3, 4, 3,4, 1)0(1, 1, 2, 2, 3, 5, 4,5, 1)11(12, 9, 9, 10, 4, 8,12, 10, 5)10(14, 11, 12, 13, 10,11, 17, 16, 11)47(20, 19, 23, 27, 28,23, 28, 41, 27)55(43, 34, 45, 40, 48,46, 50, 51, 41)14(11, 10, 9, 17, 16,7, 9, 20, 9)14(12, 8, 11, 14, 16,13, 13, 20, 15)76(43, 38, 43, 58, 51,42, 52, 75, 42)79(70, 54, 70, 69, 77,75, 84, 92, 68)(0, 1, 2, 1, 3) (12, 9, 11, 11, 9) (34, 35, 34, 31, 32) (10, 2, 6, 9, 11) (56, 47, 53, 52, 55)0(5, 2, 2, 1)7(17, 15, 12, 10)40(45, 38, 43, 46)8(8, 11, 15, 12)55(75, 66, 72, 69)(1, 1, 4, 1, 2) (12, 10, 9, 8, 6) (36, 24, 26, 19, 30) (12, 5, 7, 8, 6) (60, 41, 46, 36, 44)Sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s trois inventaires de 2011 comparés aux années 2002-2010 <strong>sur</strong> 3 ou 4dates d’inventaires. Le site de la Fresnaye, touché par <strong>des</strong> échouages d’Ulvaria (« ulvoïde ») en 2007, 2008 et 2009 aété classé dans ces sites.Chaque constat d’échouage d’ulves fait l’objet d’une fiche qui présente <strong>des</strong> photos de la proliférationobservée (aérienne et terrain) ainsi que diverses informations re<strong>le</strong>vées. Un modè<strong>le</strong> en est présenté enannexe 2 ; l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> fiches fait l’objet d’un CD ROM qui complète <strong>le</strong> présent rapport.Cimav P4 – rapport final mars 2012 24
‣ Perception de l’évolution de la marée verte au cours de la saisonDénombrement <strong>des</strong> sites touchés par <strong>des</strong> échouages d'ulves en Bretagne120100Nombre de sites touchés en 2002 Nombre de sites touchés en 2003Nombre de sites touchés en 2004 Nombre de sites touchés en 2005Nombre de sites touchés en 2006 Nombre de sites touchés en 2007Nombre de sites touchés en 2008 Nombre de sites touchés en 2009Nombre de sites touchés en 2010 Nombre de sites touchés en 2011806040200Mai Juil<strong>le</strong>t Août Septembre Octobre Cumul <strong>sur</strong> l'annéeFigure 5 : Nombre de sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves et par date d’inventaire <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> du linéaire <strong>breton</strong>.On distingue en 2011 un niveau particulièrement é<strong>le</strong>vé en mai (seu<strong>le</strong> 2009 s’en approche), encore soutenu mais moinsexceptionnel en juil<strong>le</strong>t et faib<strong>le</strong> en septembre (plus bas niveau depuis 2007, premier inventaire en septembre). Le site dela Fresnaye, touché par <strong>des</strong> échouages d’Ulvaria (« ulvoïde ») en 2007, 2008 et 2009 a été classé dans ces sites.Pour l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> années, on retrouve globa<strong>le</strong>ment une augmentation forte entre mai et juil<strong>le</strong>t, puisune diminution à partir de cette date jusqu’à octobre. Les me<strong>sur</strong>es depuis 2007 en mi septembreplutôt que mi août et mi octobre semb<strong>le</strong> indiquer un léger rebond après <strong>le</strong> mois d’août et avant ladispersion automna<strong>le</strong>. Cela s’explique par :• La première période allant du milieu du printemps jusqu’au début de l’été est cel<strong>le</strong> où <strong>le</strong>sconditions (de lumière et de température principa<strong>le</strong>ment) deviennent progressivementfavorab<strong>le</strong>s au développement <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> dans un contexte nutritionnel qui demeurepropice. Cela explique l’apparition d’un grand nombre de sites à cette période.• L’étude <strong>des</strong> sites touchés en août pour <strong>le</strong>s années antérieures à 2006 montrait que ladiminution constatée après juil<strong>le</strong>t est principa<strong>le</strong>ment due à une disparition de quelquessites qui n’est pas contrebalancée par l’apparition de nouveaux sites. La disparition de cessites au cours de l’été (<strong>sur</strong>tout en année sèche) est à relier aux conditions nutritionnel<strong>le</strong>squi ne permettent plus à cette saison de soutenir <strong>le</strong>s proliférations.• Le recul en octobre, quant à lui, est principa<strong>le</strong>ment à mettre en relation avec <strong>le</strong>s conditionsmétéorologiques devenant plus dispersives (vent, hou<strong>le</strong>) et <strong>le</strong>s conditions de croissancesmoins favorab<strong>le</strong>s (forte diminution de la lumière à partir de mi septembre).En 2011 on note un profil assez différent avec un nombre presqu’équiva<strong>le</strong>nt de sites en mai et juil<strong>le</strong>t,puis une diminution assez marquée en septembre. Cela peut être mis en relation avec <strong>le</strong>s conditionsparticulières de 2011 : temps calme et sec au printemps induisant <strong>des</strong> conditions favorab<strong>le</strong>s en débutde prolifération puis <strong>des</strong> apports nutritionnels (forte diminution <strong>des</strong> débits) qui deviennent fortementlimitant pour la croissance <strong>des</strong> algues expliquant <strong>le</strong> moins grand nombre de site en fin d’été.Cimav P4 – rapport final mars 2012 25
‣ Fréquences d’apparition et durée de proliférationLa carte <strong>des</strong> occurrences d’échouages d’ulves présente <strong>le</strong>s 102 sites repérés dans l’année (carte 3).L’analyse <strong>des</strong> occurrences par site montre que :- 42 sites sont touchés lors <strong>des</strong> trois inventaires,- 24 sites lors de deux <strong>des</strong> trois inventaires,- 36 uniquement une fois dans l’année.On retrouve en 2011 plus du tiers <strong>des</strong> sites (40%) qui est touché systématiquement lors de chacun<strong>des</strong> trois inventaires. Ces sites sont généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s plus problématiques, la prolifération y étantlongue (probab<strong>le</strong>ment au moins de mai à septembre ; parfois même bien au delà). Au-delà de ces sitestouchés systématiquement, on relève qu’un quart <strong>des</strong> sites est touché deux fois <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s troisinventaires correspondant soit à <strong>des</strong> sites dont la prolifération est un peu moins longue ou dont <strong>le</strong>séchouage détectab<strong>le</strong>s sont plus irréguliers (on peut avoir présence d’ulves <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la saisonmais avec lors de certains épiso<strong>des</strong>, de hou<strong>le</strong> notamment, disparition <strong>des</strong> ulves de la zone debalancement <strong>des</strong> marées, <strong>le</strong>s rendant indétectab<strong>le</strong>s par <strong>le</strong>s moyens aériens et terrain employés ici) Autotal on a donc deux sites <strong>sur</strong> trois qui sont touchés au moins deux fois <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s trois inventaires.Cimav P4 – rapport final mars 2012 26
Sites touchés par <strong>des</strong> échouages d'ulves en 2011(inventaires de mai, juil<strong>le</strong>t ou septembre)L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé àmarée basse de fort coefficient. Les sitessont classés comme touchés à partir dumoment où <strong>le</strong>s dépôts sont décelab<strong>le</strong>sd'avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrainmettent en évidence <strong>des</strong> proportionsanorma<strong>le</strong>s d'ulves. Certains sites sont detrès petite tail<strong>le</strong> et ne correspondent pas àla <strong>des</strong>cription classique de "marée verte".PORTSALLARGENTONCOULOUARNGUISSENYMOGUERAN/COREJOUABER BENOITKERLOUANMOULIN-BLANCBRIGNOGANGOULVENABER WRACHPLOUNEOURKEREMMAELORNPORS-GUEN/PORS-MEURHORN/GUILLECTINDUFF/MOULIN NEUFKERVALIOU/KERFISSIENPORT NEUFPENZETY NOD/RADE DE MORLAIXDIBENPORZ BILIECMOULIN-DE-LA-RIVELOCQUEMEAULOCQUIRECANSE DE PERROSNANTOUARBEG LEGUERTRESTELPELLINECSAINT-MICHEL-EN-GREVEJAUDYLEDANOBREHECBINIC/ETABLES-SUR-MERMINIHIC-SUR-RANCELANCIEUXQUELMERLimite del'inventaireSAINT-JOUAN-DES-GUERETSDAOULASTREZ-HIRROSCANVELMORGATHOPITAL CAMFROUTAULNE/FOND DE RADEYFFINIACMORIEUXLA VILLE GERLA VILLE-ES-NONAISPOSTOLONNECPORSLOUSABERTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDBAIE DES TREPASSESKERVEL/TREZMALAOUENPORT RHU/TREBOULRYLOCHPORT LA FORETAUDIERNEILE-TUDYODETCAP COZCONCARNEAUPOULDONCABELLOUKERFANYAVEN102 sites touchésSAINT-GUENOLEMOUSTERLINTREVIGNONFORT-BLOQUEPORT LOUISSites de type vasièressite classé 1 foissite classé 2 foisGUILVINECLESCONILLODONNECBEG MEILBEG MEIL NORDANSE DEPOULDOHANKERLEVEN/SAINT-LAURENTPOULDUKERPAPECOUREGANTRIA D ETELRIVIERE DE CRAC'HAURAYNORD OUESTGOLFE 56site classé 3 foisSites de type plagessite classé 1 fois.PORT-MANECHLARMOR-PLAGEPOINTE DE GAVRESERDEVENSUD ARZONNORD EST GOLFE 56MINE D ORsite classé 2 foissite classé 3 fois0 30 60KmCarte 3QUIBERONSAINT GILDASDE RHUYSPENVINSLimite del'inventairePOINTE DU BILE
3.1.2. Comparaison inter-annuel<strong>le</strong> 1997-2011Durant 5 années, <strong>le</strong> suivi régional a été réalisé avec <strong>le</strong>s mêmes métho<strong>des</strong> et procédures (Pro<strong>littoral</strong>2002-2006 ; 4 inventaires annuels en mai, juil<strong>le</strong>t, août et octobre). Les années 2007 à 2011 necomportent que trois inventaires « généraux » et ne peuvent être aussi faci<strong>le</strong>ment comparées à cettesérie de référence (nombre d’inventaires annuels différents et dates différentes : mai, juil<strong>le</strong>t etseptembre). Il convient de rappe<strong>le</strong>r que l’intérêt de ce dénombrement réside <strong>sur</strong>tout dans <strong>le</strong> faitde répertorier <strong>le</strong>s échouages locaux et d’archiver ces données (base de données). La somme <strong>des</strong>observations loca<strong>le</strong>s permet tout de même, en plus, de tirer <strong>des</strong> enseignements <strong>sur</strong> <strong>le</strong> phénomènegénéral et son évolution mais il convient de rappe<strong>le</strong>r que <strong>le</strong>s sites sont d’importance très variab<strong>le</strong> cequi n’est pas pris en compte dans ce suivi. Une certaine comparaison inter-annuel<strong>le</strong> est possib<strong>le</strong> dèslors qu’on veil<strong>le</strong> à identifier pour chaque année <strong>le</strong>s métho<strong>des</strong> employées pour établir <strong>le</strong>s inventaires ;en particulier <strong>le</strong> nombre de <strong>sur</strong>vols effectués et <strong>le</strong>urs dates.Sur la période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>t à septembre) :La série de donnée présentée figure 6 est la plus longue présentant deux inventaires <strong>sur</strong> chaque annéeen période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>t à septembre excepté pour 2001, année pour laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong> premier inventaireest un peu plus précoce : <strong>le</strong>s 21 et 22 juin). Cette série permet de distinguer <strong>le</strong>s cinq dernières annéescomme particulières, comportant un nombre de site touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves plus é<strong>le</strong>vé que<strong>le</strong>s années précédentes, ce qui est particulièrement important pour <strong>le</strong>s trois années 2007-2009. Il fautcependant tenir compte <strong>des</strong> dates <strong>des</strong> inventaires qui ne sont pas toujours aux mêmes pério<strong>des</strong>. Lefait que pour <strong>le</strong>s cinq dernières années <strong>le</strong>s inventaires soient relativement éloignés (systématiquementmi juil<strong>le</strong>t et mi septembre) permet probab<strong>le</strong>ment de repérer plus de sites que dans la périodeprécédente (2002-2006) pour laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s inventaires n’étaient séparés que d’un mois (juil<strong>le</strong>t puisaoût). A noter éga<strong>le</strong>ment qu’au cours <strong>des</strong> années, <strong>le</strong> CEVA a amélioré <strong>le</strong>s inventaires incluantnotamment <strong>des</strong> Ria qui auparavant n’étaient pas <strong>sur</strong>volées ce qui peut expliquer aussi enpartie <strong>le</strong> nombre grandissant de sites repérés.110Nombre de site touchés par <strong>des</strong> échouages d'ulves<strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> (inventaire juil<strong>le</strong>t à sept)10210090949084 8480757679717068636060502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Figure 6 : Nombre de sites touchés entre 2000 et 2011 par <strong>des</strong> échouages d’ulves en période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>t et / ouaoût pour 2002-2006 ou pour 2000 début juil<strong>le</strong>t et fin août, pour 2001 fin juin et début septembre, pour 2007 à2011 mi juil<strong>le</strong>t et mi septembre). Le site de la Fresnaye, touché par <strong>des</strong> échouages d’Ulvaria (« ulvoïde ») en 2007,2008 et 2009 a été classé dans ces sites.Les deux histogrammes suivants, permettent de retracer l’évolution du nombre de site depuis 1997,année du premier suivi réalisé pour l’Agence de l’Eau Loire Bretagne par <strong>le</strong> CEVA. Il est importantCimav P4 – rapport final mars 2012 28
de noter <strong>le</strong> nombre de <strong>sur</strong>vol ayant permis d’aboutir à chaque inventaire annuel ainsi que dedistinguer l’année 1997 qui était la première année de l’inventaire et dont l’inventaire en rade de Brestétait jugé incomp<strong>le</strong>t. Il est donc diffici<strong>le</strong> avec une tel<strong>le</strong> série de données de distinguer <strong>des</strong> tendanceslour<strong>des</strong> d’évolution. Afin de rendre mieux compte de la diversité <strong>des</strong> situations, la représentationdistingue <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> sites <strong>sur</strong> plages et <strong>sur</strong> vasières.On constate <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s deux histogrammes de la figure 7 que <strong>le</strong>s 3 années 2007-2009 sont assezsignificativement au <strong>des</strong>sus <strong>des</strong> années précédentes. Cela peut probab<strong>le</strong>ment être mis en relationavec <strong>le</strong>s caractéristiques climatiques de ces années favorab<strong>le</strong>s aux proliférations (en particulier flux denutriments estivaux importants en 2007 et 2008) et à un effet inter annuel cumulatif (cyc<strong>le</strong>sfavorab<strong>le</strong>s). Il faut tout de même rappe<strong>le</strong>r aussi que <strong>le</strong>s dates d’inventaires ont été changées en 2007et sont depuis 2007 aux mois de juil<strong>le</strong>t et septembre ce qui est probab<strong>le</strong>ment particulièrementfavorab<strong>le</strong> pour dénombrer un maximum de sites (dates éloignées pour pouvoir percevoir <strong>le</strong>s sitesprécoces comme <strong>le</strong>s plus tardifs et dans <strong>des</strong> saisons dont <strong>le</strong>s conditions de dépôts sontstatistiquement favorab<strong>le</strong>s). La diminution marquée en nombre de site pour l’année 2010 puis 2011(84 sites) est de ce fait encore plus significative. La diminution en nombre de site était, pour 2010principa<strong>le</strong>ment imputab<strong>le</strong> aux sites sab<strong>le</strong>ux et est <strong>sur</strong>tout liée aux sites de vasières pour l’année 2011.En 2011, <strong>le</strong> département du Finistère a une réaction opposée aux autres puisque <strong>le</strong>s sites classés ysont plus nombreux que <strong>le</strong>s années précédentes alors que <strong>le</strong>s autres départements voient <strong>le</strong>ursnombre de sites diminuer.L’augmentation assez régulière depuis 1997 (et jusqu’en 2009) en nombre de site est <strong>sur</strong>tout due auxsites de vasière ce qui peut être liée à la fois à une réel<strong>le</strong> augmentation de la colonisation <strong>des</strong> cesmilieux, mais aussi à une meil<strong>le</strong>ure perception par <strong>le</strong> CEVA de ces sites, par <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols pluscomp<strong>le</strong>ts <strong>des</strong> Rias et une meil<strong>le</strong>ure connaissance de ces dépôts.Comme précisé plus haut, <strong>le</strong> dénombrement <strong>des</strong> sites, ne concerne pas uniquement <strong>des</strong> sites quipeuvent être qualifiés de « marées <strong>vertes</strong> » et comprend <strong>des</strong> sites dont <strong>le</strong>s dépôts sont peu étendus ; ilconvient donc de relativiser ce résultat et de se reporter à l’analyse <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’échouage pourappréhender complètement <strong>le</strong>s proliférations et <strong>le</strong>ur évolution.Cimav P4 – rapport final mars 2012 29
Rappel : au-delà de l’augmentation du phénomène de prolifération me<strong>sur</strong>é, pour une part,l’augmentation du nombre de sites peut être reliée à l’amélioration <strong>des</strong> connaissances et auxinformations fournies au CEVA pour guider <strong>le</strong>s observations. Ainsi, l’intérieur de la Ria d’Etel etl’amont de la Rance n’étaient pas <strong>sur</strong>volés avant 2002 et <strong>le</strong> sont depuis car notre attention a été attiréepar <strong>des</strong> observations loca<strong>le</strong>s (il semb<strong>le</strong> que <strong>le</strong> développement d’ulves y soit récent ce qui explique quenous ayons été contactés au sujet de ces sites que récemment). Il est probab<strong>le</strong> aussi,qu’inconsciemment, <strong>le</strong>s observations soient plus dirigées <strong>sur</strong> <strong>des</strong> sites ayant déjà par <strong>le</strong> passé faitl’objet d’un classement. D’autre part, il est important de rappe<strong>le</strong>r que <strong>le</strong> dénombrement <strong>des</strong> sitesn’offre qu’une vision tronquée du phénomène, uti<strong>le</strong> à la restitution rapide et continue d’observationsen période de « marée verte » ; l’importance du développement algal <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites n’étant pas prise encompte. L’intérêt de ce suivi en simp<strong>le</strong> dénombrement est <strong>sur</strong>tout d’acquérir <strong>des</strong> références loca<strong>le</strong>s<strong>sur</strong> la colonisation <strong>des</strong> sites par <strong>le</strong>s ulves, informations qui sont archivées avec photos etcommentaires et qui, au fil <strong>des</strong> observations annuel<strong>le</strong>s, permettent l’analyse plus fine du phénomène.La compilation de ces résultats locaux permet néanmoins d’avoir une certaine perception del’évolution du phénomène général.Les sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la saisonFigure 10 : Nombre de sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la saison <strong>sur</strong> départements <strong>breton</strong>sentre 1997 et 2011 (nombre d’inventaires différents selon <strong>le</strong>s années). Le site de la Fresnaye, touché par <strong>des</strong>échouages d’Ulvaria (« ulvoïde ») de 2007 à 2009 a été classé dans ces sites.• L’année 2011, si l’on considère <strong>le</strong>s trois dates d’inventaire, apparait <strong>sur</strong> la figure 10 à un niveaué<strong>le</strong>vé, en deuxième position derrière l’année 2009 et proche du niveau <strong>des</strong> années 2007 et 2008.Les années 2007 à 2011, ne comportant plus que 3 inventaires généraux au lieu de 4 entre 2002 et2006, on aurait pu s’attendre à une diminution du nombre de sites total recensé. Il se peut que,malgré <strong>le</strong> nombre de <strong>sur</strong>vol inférieur, <strong>le</strong> fait d’avoir un inventaire en septembre plutôt que deux(août et octobre précédemment) est plus favorab<strong>le</strong> pour répertorier un maximum de sites. Eneffet, dans <strong>le</strong>s suivis antérieurs l’inventaire d’août, proche de celui de juil<strong>le</strong>t était probab<strong>le</strong>ment unCimav P4 – rapport final mars 2012 32
peu redondant avec <strong>le</strong> précédent et l’inventaire d’octobre, très tardif ne permettait de recenserque <strong>des</strong> sites dont la prolifération est particulièrement longue et qui ne sont pas encore« nettoyés » par <strong>le</strong>s conditions plus agitées à cette période. Le niveau relativement important de2011 par rapport aux années antérieures (2002-2006) est donc à relativiser pour cette raison.• Logiquement, avec <strong>le</strong> nombre d’inventaires qui augmente (passage de 1 à 2 inventaires en 2000puis de 2 à 4 en 2002), <strong>le</strong> nombre total de sites concernés par <strong>des</strong> échouages d’ulves augmente defaçon assez continue. Comme exprimé au point précédent, <strong>le</strong> passage de 4 à 3 inventaires (2007)pourrait ne pas entraîner de minimisation du phénomène voire même permettrait de mieux <strong>le</strong>percevoir.• L’augmentation du nombre de sites répertorié peut éga<strong>le</strong>ment être mis en relation avec lameil<strong>le</strong>ure connaissance <strong>des</strong> sites par <strong>le</strong> CEVA et par <strong>le</strong>s efforts déployés pour visiter tous <strong>le</strong>s sites,même de petite tail<strong>le</strong> et en particulier <strong>le</strong>s vasières.• Aucun nouveau site n’a été répertorié en 2011.La carte 4 présente <strong>le</strong>s 137 sites qui ont été répertoriés au moins une fois <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> suivisréalisés depuis 1997. Parmi ces sites, certains sont concernés régulièrement d’autres ont pu n’êtretouchés que de façon exceptionnel<strong>le</strong>. Pour mieux faire <strong>le</strong> tri dans l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites qui ont pu êtrerépertoriés depuis 1997, la carte 5 ne présente que <strong>le</strong>s sites qui sont régulièrement repérés ; seuls <strong>le</strong>ssites ayant été touchés au moins 10 fois <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 15 années d’inventaires sont représentés (soit deuxannées <strong>sur</strong> trois). 61 sites sont dans ce cas <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> et parmi ces sites 16 ont été touchéschaque année, 11 l’ont été 14 années <strong>sur</strong> 15 et 11 l’ont été 13 années <strong>sur</strong> 15 (soit 38 sites qui ontété touchés au moins 13 années <strong>sur</strong> 15). Il convient de noter que certains points du <strong>littoral</strong> (La Rance,la Ria d’Etel, notamment mais éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s I<strong>le</strong>s du Golfe du Morbihan, …) ne sont <strong>sur</strong>volés quedepuis quelques années et ne peuvent donc entrer dans la catégorie <strong>des</strong> sites touchés« régulièrement » ; pour autant ces sites peuvent apparaître tous <strong>le</strong>s ans depuis qu’ils sont<strong>sur</strong>veillés. Le fait que <strong>des</strong> sites soient classés systématiquement permet de consolider chaqueobservation annuel<strong>le</strong>. Ces sites peuvent être qualifiés de sites récurrents et sont, pour la plupart, <strong>le</strong>ssites <strong>le</strong>s plus problématiques (proliférations longues dans la saison et action de reconquête plusimportante à y mener).Cimav P4 – rapport final mars 2012 33
Sites touchés par <strong>des</strong> échouages d'ulvesau moins une fois depuis 1997LANDRELLECNANTOUARPLEUBIANL'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé àmarée basse de fort coefficient. Les sitessont classés comme touchés à partir dumoment où <strong>le</strong>s dépôts sont décelab<strong>le</strong>sd'avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrainmettent en évidence <strong>des</strong> proportionsanorma<strong>le</strong>s d'ulves. Certains sites sont detrès petite tail<strong>le</strong> et ne correspondent pas àla <strong>des</strong>cription classique de "marée verte".PORTSALLARGENTONABER WRACHABER BENOITCOULOUARNTREOMPANVOUGOTMOGUERAN/COREJOUGUISSENYKERLOUANBRIGNOGANPLOUNEOURGOULVENKEREMMAPORS-GUEN/PORS-MEURKERVALIOU/KERFISSIENPORT NEUFTEVENNHORN/GUILLECPEMPOULPENZETERENEZGUERZITDIBENMOULIN-DELA-RIVEPORZ BILIECTREGASTELBEG LEGUERLOCQUEMEAUSAINT-MICHEL-EN-GREVETRESTELPELLINECANSE DEPERROSJAUDYPAIMPOLBREHECLEDANOSAINT-QUAY-PORTRIEUXBINIC/ETABLES-SUR-MERERQUYFRESNAYEARGUENONLANCIEUXTROCTINQUELMERLimite del'inventaireBAIE DU MONT-SAINT-MICHELABER ILDUTTY NOD/RADE DE MORLAIXLOCQUIRECPORSPAULILLIENMOULIN-BLANCELORNTINDUFF/MOULIN NEUFROSAIRESVAL ANDREMINIHIC-SUR-RANCESAINT-JOUAN-DES-GUERETSROSCANVELDAOULASLA VILLE-ES-NONAISTREZ-HIRHOPITAL CAMFROUTYFFINIACMORIEUXLA VILLE GERMORGATABERPORSLOUSAULNE/FOND DE RADELIEUE-DE-GREVEFINISTERECOTES-D'ARMORPOSTOLONNECTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDBAIE DES TREPASSESKERVEL/TREZMALAOUENPORT RHU/TREBOULRYPORT LA FORETLOCHAUDIERNEODETMOUSTERLINCONCARNEAUILLE-ET-VILAINEPOULDONCAP COZILE-TUDYCABELLOUKERFANYFORT-BLOQUEAVENBELONPORT LOUISRIA D ETELMORBIHANSAINT-GUENOLECOUREGANTBEG MEILGUILVINECLODONNECAURAYLESCONILBEG MEILNORDANSE DEPOULDOHANRAGUENEZPORZ TEGSAINT-PHILIBERTLOCMARIAQUERSites touchés au moins une foisentre1997 et 2011KERLEVEN/SAINT-LAURENTTREVIGNONPORT-MANECHPOULDURIVIERE DECRAC'HNORD OUESTGOLFE 56NORD EST GOLFE 56137 sites touchéssite <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>site <strong>sur</strong> vaseKERPAPELARMOR-PLAGEPOINTE DEGAVRESMER DE GAVRESBARRE D ETELERDEVENLA-TRINITESUR-MERSUD ARZONEST GOLFE 56SUD GOLFE 56DAMGANMINE D OR.0 30 60KmCarte 4QUIBERONPORT NAVALOSAINT GILDASDE RHUYSSAINT-JACQUESPENVINSBANASTERELimite del'inventairePOINTE DU BILE
Sites <strong>le</strong>s plus fréquemment touchés par <strong>des</strong> échouages d'ulves<strong>sur</strong> la période 1997 - 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient. Les sites sont classéscomme touchés à partir du moment où <strong>le</strong>s dépôtssont décelab<strong>le</strong>s d'avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrainmettent en évidence <strong>des</strong> proportions anorma<strong>le</strong>sd'ulves. Certains sites sont de très petite tail<strong>le</strong> et necorrespondent pas à la <strong>des</strong>cription classique de"marée verte".Certains secteurs (ria notamment) n’étaient pas<strong>sur</strong>volés <strong>le</strong>s premières années et sont donc souscomptabilisés (certaines vasières ne sont pasreprésentées ici, alors quel<strong>le</strong>s sont systématiquementtouchées <strong>le</strong>s dernières années du suivi).ABER WRACHABER BENOITMOGUERAN/COREJOUPORTSALLGUISSENYBRIGNOGANGOULVENKEREMMAPORS-GUEN/PORS-MEURKERVALIOU/KERFISSIENPORT NEUFHORN/GUILLECPEMPOULPENZETY NOD/RADE DE MORLAIXPORZ BILIECMOULIN-DE-LA-RIVETRESTELBEG LEGUERSAINT-MICHEL-EN-GREVEJAUDYBREHECLEDANOBINIC/ETABLES-SUR-MERFRESNAYEARGUENONLANCIEUXLimite del'inventaireMOULIN-BLANCELORNTINDUFF/MOULIN NEUFLOCQUIRECDAOULASSAINT-JOUAN-DES-GUERETSHOPITAL CAMFROUTYFFINIACMORIEUXAULNE/FOND DE RADEMORGATLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECSAINTE-ANNE-LA-PALUDKERVEL/TREZMALAOUENRYNombre d’années où <strong>le</strong> site a été concernépar <strong>des</strong> échouages d’ulves au moins une foisdans l’année entre 1997 et 2011POULDONCAP COZCONCARNEAUFORT-BLOQUE61 sites concernés au moins 10 fois / 15PORT LOUISsite concerné 10 années <strong>sur</strong> 15site concerné 11 années <strong>sur</strong> 15KERLEVEN/SAINT-LAURENTPORT-MANECHAURAYNORD EST GOLFE 56site concerné 12 années <strong>sur</strong> 15CABELLOUKERPAPEsite concerné 13 années <strong>sur</strong> 15EST GOLFE 56site concerné 14 années <strong>sur</strong> 15site concerné 15 années <strong>sur</strong> 15.LARMOR-PLAGEERDEVENplagevasière0 30 60KmCarte 5SAINT-JACQUESLimite del'inventairePOINTE DU BILE
3.1.3. Mise en évidence de la particularité <strong>des</strong> sites <strong>sur</strong> vaseDans <strong>le</strong>s sites repérés comme touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves, deux situations distinctes serencontrent. Les sites « classiques » de marées <strong>vertes</strong>, <strong>le</strong>s plus connus du public, sont <strong>des</strong> secteurs deplage relativement ouverts où <strong>le</strong>s ulves prolifèrent en « rideau » et se déposent en partie <strong>sur</strong> l’estransab<strong>le</strong>ux à marée basse. A noter que cette catégorie « sites de plage » est el<strong>le</strong>-même constituée de deuxsous groupes : <strong>le</strong>s sites « classiques » de prolifération d’ulves en suspension dans la masse d’eau (cas<strong>des</strong> gran<strong>des</strong> baies <strong>le</strong>s plus connues comme affectées par <strong>des</strong> « marées <strong>vertes</strong> ») et <strong>des</strong> sites dits« d’arrachages » pour <strong>le</strong>squels une partie importante de la biomasse s’est constituée alors que <strong>le</strong>s ulvesétaient encore fixées <strong>sur</strong> <strong>des</strong> substrats rocheux. Une autre situation coexiste : prolifération d’ulves <strong>sur</strong><strong>des</strong> sites dont l’hydrodynamisme de <strong>sur</strong>face est plus faib<strong>le</strong> et où <strong>le</strong>s ulves ne sont pas remises ensuspension et ne sont transportées que par <strong>le</strong>s courants de marées qui ne sont très actifs que dans <strong>le</strong>schenaux. Ces sites présentent aussi <strong>des</strong> sédimentations plus fines de type vaseuses ; <strong>le</strong>s algues y sontpeu mobi<strong>le</strong>s et sont peu sujettes à la fragmentation. Il n’y a pas de réel brassage de l’eau, ni de remiseen suspension de sorte que <strong>le</strong>s thal<strong>le</strong>s sont souvent piégés dans la vase et ne bénéficient pas <strong>des</strong>conditions de croissance rencontrées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages. On peut ajouter que ces sites « vaseux » sontdifférents aussi par l’utilisation qui est faite de ces milieux. La nuisance peut être écologique (dépôtsd’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s schorres, anoxie sous <strong>le</strong>s dépôts qui induisent peut-être <strong>des</strong> perturbations supérieures àla situation <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites sab<strong>le</strong>ux plus brassés) mais el<strong>le</strong> est probab<strong>le</strong>ment moins ressentie par <strong>le</strong>sriverains et <strong>le</strong>s touristes, ces vasières étant d’une manière généra<strong>le</strong> peu accessib<strong>le</strong>s. On peut cependantnoter dans certains cas <strong>des</strong> nuisances olfactives (donc potentiel<strong>le</strong>ment aussi <strong>des</strong> risques sanitaires)lorsque ces vasières sont proches de zones fréquentées.• La carte 6 positionne <strong>le</strong>s sites de vasières touchés en 2011. Ceux-ci sont localisés principa<strong>le</strong>mentdans <strong>le</strong> Golfe du Morbihan, <strong>le</strong>s baies de Morlaix, ra<strong>des</strong> de Brest ou Lorient ainsi que dans <strong>le</strong>sestuaires profonds et <strong>le</strong>s abers (la Rance mais dont <strong>le</strong>s sites repérés en 2011 ont été classés qu’enmai ; <strong>le</strong>s tapis étant plus tard en saison constitués principa<strong>le</strong>ment d’algues <strong>vertes</strong> filamenteuses).• Sur <strong>le</strong>s trois inventaires de 2011, 35 sites <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 102 sites recensés sont <strong>des</strong> sites de vasière.L’analyse de la proportion de sites de vasière lors <strong>des</strong> inventaires d’été est présentée figure 11 : en2009 près de 40 % <strong>des</strong> sites étaient <strong>des</strong> sites de vasière. L’augmentation régulière de la proportion<strong>des</strong> sites <strong>sur</strong> vasière est probab<strong>le</strong>ment, en partie au moins, liée à l’amélioration <strong>des</strong> suivis de cesmilieu (estuaires plus systématiquement parcourus : cf. <strong>des</strong>cription page 25). La diminution assezmarquée en 2011 s’explique par <strong>le</strong> cas de certains secteurs qui après avoir comporté <strong>des</strong> tapisd’ulves en mai se trouvent à partir de juil<strong>le</strong>t principa<strong>le</strong>ment colonisés par <strong>des</strong> couvertures d’algues<strong>vertes</strong> filamenteuses non prises en compte dans cet inventaire.• La prolifération <strong>sur</strong> ces sites est, pour la plupart, assez longue : <strong>le</strong>s sites qui sont touchésdeux voire trois fois <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s trois inventaires sont <strong>le</strong>s plus nombreux (<strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s algues soientpeu mobi<strong>le</strong>s explique en partie cela). Contrairement à 2009 pour laquel<strong>le</strong> une seu<strong>le</strong> vasière avait étéclassée qu’une fois, en 2010, année de plutôt faib<strong>le</strong> prolifération, el<strong>le</strong>s étaient 10 dans ce cas. En2011, 12 vasières se trouvent dans cette situation (en particulier toutes <strong>le</strong>s vasières de la Rance).Néanmoins, plus de la moitié <strong>des</strong> vasières (18 <strong>sur</strong> 35) a été classé lors <strong>des</strong> trois inventaires.Figure 11 : Proportion de vasières dans <strong>le</strong>ssites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>sannées 1997 à 2011. L’amélioration <strong>des</strong>suivis permet probab<strong>le</strong>ment d’expliquer enpartie au moins l’augmentation de laproportion <strong>des</strong> vasières dans <strong>le</strong> total <strong>des</strong> sitesinventoriés du début de suivis à 2008.45403530252015105Proportion de sites de vasière repérés <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s inventaires d'été01997 1998 1999 2000 2001 2002(été)Cimav P4 – rapport final mars 2012 362003(été)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(été) (été) (été) (été) (été) (été) (été) (été)
Vasières touchées par <strong>des</strong> échouages d'ulvesau cours de la saison 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé àmarée basse de fort coefficient. Les sitessont classés comme touchés à partir dumoment où <strong>le</strong>s dépôts sont décelab<strong>le</strong>sd'avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrainmettent en évidence <strong>des</strong> tapis continusd’ulves. Certains sites sont de très petitetail<strong>le</strong> et ne correspondent pas à la<strong>des</strong>cription classique de "marée verte".ABER BENOITABER WRACHPENZETY NOD/RADEDE MORLAIXDIBENANSE DE PERROSPELLINECJAUDYLEDANOLimite del'inventairePORTSALLGOULVENARGENTONQUELMERMOULIN-BLANCELORNTINDUFF/MOULIN NEUFMINIHIC-SUR-RANCESAINT-JOUAN-DES-GUERETSDAOULASLA VILLE-ES-NONAISROSCANVELHOPITAL CAMFROUTLA VILLE GERAULNE/FOND DE RADEODETPORT LA FORETPOULDONAVENPORT LOUISRIA D ETELSAINT-GUENOLEAURAYOccurence <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s3 inventaires réalisésNORD OUEST GOLFE 56inventaires de mai, juil<strong>le</strong>t, septembre 201135 sites touchésNORD EST GOLFE 56site touché 1 foissite touché 2 foissite touché 3 fois.RIVIERE DE CRAC'H0 30 60KmCarte 6Limite del'inventaire
3.1.4. Détermination <strong>des</strong> espèces proliférantesDans <strong>le</strong> prolongement <strong>des</strong> missions aériennes, <strong>le</strong>s équipes mobilisées pour effectuer <strong>le</strong>s missions de« vérité-terrain » prélèvent <strong>des</strong> échantillons d’algues à l’origine de la prolifération observée <strong>sur</strong> <strong>le</strong> site.En cas de doute <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s espèces rencontrées, <strong>le</strong>s échantillons sont examinés aulaboratoire afin que soit déterminée <strong>le</strong>ur systématique. Une première distinction est opérée selon <strong>le</strong>genre de l’algue. La plupart du temps, il s’agit soit d’Ulva, soit d’Enteromorpha (du moins <strong>des</strong> formesfilamenteuse nommées classiquement entéromorphes, qui maintenant sont considérées commerattachées au genre Ulva), soit, plus rarement, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières, de l’Ulvaria(antérieurement dénommée Monostroma). On a éga<strong>le</strong>ment aujourd’hui <strong>des</strong> proliférations d’ectocarpa<strong>le</strong>s(algues brunes) et d’algues rouges <strong>des</strong> ordres <strong>des</strong> Gigartina<strong>le</strong>s, Ceramia<strong>le</strong>s et Gracilaria<strong>le</strong>s. Onretrouve très souvent une présence plus ou moins marquée de Zostera sp.. Les algues sontdifférenciées selon <strong>le</strong>ur espèce, quand cela est possib<strong>le</strong> sans engager de manipulations trop lour<strong>des</strong>.Les espèces d’ulves proliférantes <strong>le</strong> plus souvent rencontrées sont Ulva armoricana et dans unemoindre me<strong>sur</strong>e Ulva rotondata.L’identification <strong>des</strong> algues est un exercice délicat, car il n’est pas toujours possib<strong>le</strong> d’affirmer aveccertitude quel<strong>le</strong> est l’espèce examinée. Parfois l’incertitude est tel<strong>le</strong> qu’aucune espèce n’est avancée. Lesystématicien est, en outre, capab<strong>le</strong> d’apprécier si l’algue est issue d’un arrachage ou si el<strong>le</strong> a connuune croissance libre.En 2011 comme en 2010, beaucoup d’identifications ont été réalisées directement <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain. Maisnous avons parallè<strong>le</strong>ment renforcé <strong>le</strong>s identifications microscopiques en laboratoire aussi bien pourdéterminer l’espèce que pour apprécier <strong>le</strong> caractère « arraché » ou « libre » <strong>des</strong> algues.Au nord est de la Bretagne, <strong>le</strong> fait marquant dans <strong>le</strong>s gran<strong>des</strong> baies tel<strong>le</strong>s que Lancieux, l’Arguenonet la Fresnaye ou encore Saint Brieuc, est la prolifération du Pylaiella <strong>littoral</strong>is, algue brunefilamenteuse de l’ordre <strong>des</strong> ectocarpa<strong>le</strong>s qui forme <strong>des</strong> pompons sous forme libre. Si <strong>le</strong>s baies del’Est du département <strong>des</strong> Côtes d’Armor sont depuis plusieurs années concernées par cesdéveloppements d’algues brunes (2006 <strong>sur</strong> la Fresnaye était la première année de prolifération duPylaiella sans ulves de la saison), la situation de la baie de Saint Brieuc est une première puisqu’àpartir de septembre <strong>le</strong>s ulves ont presque disparu et <strong>le</strong> Pylaiella est devenu dominant jusqu’àreprésenter en octobre près de 99 % du total <strong>des</strong> algues rencontrées. On notait, déjà au printemps laprésence mais en quantité moindre de Pylaiella et autres algues rouges en mélange aux ulves.Sur ces gran<strong>des</strong> baies, <strong>le</strong>s espèces se sont succédées et <strong>sur</strong> certaines pério<strong>des</strong> ont coexistées. Lesespèces majoritairement rencontrées dans <strong>des</strong> proportions variab<strong>le</strong>s suivant <strong>le</strong>s baies et la saison, sontl’Ulva armoricana l’Ulva rotundata sous formes libre et arrachée en mélange avec du Pylaiella <strong>littoral</strong>is, et<strong>des</strong> algues rouges filamenteuses de l’ordre <strong>des</strong> Ceramia<strong>le</strong>s (Ceramiacea, Polysiphonia et Plocamium).On trouve aussi très souvent <strong>des</strong> entéromorphes mais dans de faib<strong>le</strong>s proportions. En début d’année,l’Ulva armoricana est très largement majoritaire, on note la présence d’Ulvaria obscura en très faib<strong>le</strong>proportion <strong>sur</strong> la Fresnaye et Cladophora rupestris <strong>sur</strong> Lancieux. Polysiphonia sp. apparaît de manièrenotab<strong>le</strong> <strong>sur</strong> Saint-Brieuc Lancieux et la Fresnaye en milieu et fin d’été. Puis, <strong>le</strong>s ulves composent <strong>le</strong>sdépôts à hauteur de 1% à 30%. On trouve principa<strong>le</strong>ment de l’U. armoricana sous forme libre (faib<strong>le</strong>proportion sous forme arrachée). L’Ulva rotundata apparaît souvent sous forme arrachée en juin <strong>sur</strong> laFresnaye (mais en de très faib<strong>le</strong>s quantités). Pylaiella <strong>littoral</strong>is compose environ 50% <strong>des</strong> dépôts etatteint jusqu’à 90% du milieu d’été jusqu’à Octobre, excepté <strong>sur</strong> Bréhec site <strong>sur</strong> <strong>le</strong>quel aucuneobservation de colonisation par ces ectocarpa<strong>le</strong>s n’a été réalisée. A partir de juil<strong>le</strong>t et vers la fin de lasaison, la proportion <strong>des</strong> algues rouges augmente pour atteindre jusqu’à 30% <strong>des</strong> dépôts. On retrouveassez souvent U. rotundata <strong>sur</strong> Bréhec en majorité ou en mélange avec U. armoricana.Sur la côte nord et nord ouest de la Bretagne, on ne voit pas « d’anomalies » au niveau de lacomposition <strong>des</strong> proliférations d’algues. Il y a toujours une grande majorité d’algues <strong>vertes</strong>, et l’espècerencontrée dans presque tous <strong>le</strong>s cas semb<strong>le</strong> être U. armoricana, souvent d’arrachage (dans <strong>le</strong>s cas quiCimav P4 – rapport final mars 2012 38
ont été analysés au laboratoire du <strong>Ceva</strong>). Il y a quelques exceptions, par exemp<strong>le</strong> <strong>sur</strong> Moguéran enavril et en mai, où on trouve de l’U. rotundata en majorité. Sur Bréhec et P<strong>le</strong>ubian en milieu de saison,on constate <strong>des</strong> dépôts composés d’une majorité d’algues rouges type gracilaires. Sur <strong>le</strong> Nord de laBretagne en juil<strong>le</strong>t, la présence d’entéromorphes tubulaires (U. ramulosa, U. compressa) est remarquéedans <strong>le</strong>s dépôts, cette proportion diminuant à la fin de l’été.Au niveau du secteur ouest et sud ouest, l’Ulva armoricana est majoritaire dans <strong>le</strong>s dépôts. Au milieu del’été, <strong>le</strong>s ulves sont principa<strong>le</strong>ment sous forme libre et en confettis, puis, en fin de saison, on trouveplus de formes arrachées. Le fait marquant dans ce secteur est l’apparition d’algues rouges assezmarquée. A partir de L’I<strong>le</strong> Tudy jusqu’au Pouldu, Gracilaria sp. représente environ 1/3 de la plupart<strong>des</strong> dépôts au milieu de l’été. On trouve éga<strong>le</strong>ment en milieu et fin d’été Gracilaria sp. ainsi que duGelidium sp. dans la rade de Brest. En fin d’été, il y a une grande diversité d’algues rouges qui peuventatteindre 70% <strong>des</strong> dépôts (<strong>des</strong> Ceramia<strong>le</strong>s avec par exemp<strong>le</strong> Plumaria plumosa et <strong>des</strong> Ceramiaceae, <strong>des</strong>Gigartina<strong>le</strong>s avec par exemp<strong>le</strong> Solieria sp., <strong>des</strong> Florideophyceae avec par exemp<strong>le</strong> Grateloupia turuturu,<strong>des</strong> Plocamiaceae avec par exemp<strong>le</strong> Plocamium sp.).Enfin, dans <strong>le</strong> secteur sud de la Bretagne, à partir de Fort Bloqué, l’Ulva rotundata est majoritaire dans<strong>le</strong>s échouages. Sur Larmor Plage en mai, <strong>le</strong>s dépôts sont composés de 50% d’Ulvaria sp. et 50% d’U.rotundata, tandis qu’il n’y a que U. armoricana vers fin juil<strong>le</strong>t début août. La proportiond’entéromorphes (Ulva compressa, Ulva intestinali, Ulva. Chlathrata) est au début de 10% <strong>des</strong> algues<strong>vertes</strong> et diminue jusqu’en septembre. L’Ulva pertusa a été trouvé au niveau de la rivière de Crac’h.Vers <strong>le</strong> milieu de l’été, <strong>le</strong>s apparitions d’algues rouges types Ceramia<strong>le</strong>s et Solieria dans <strong>le</strong>s dépôtscommencent à partir de Saint Gildas du Rhuys.A la fin de l’été, à l’ouest d’Erdeven et dans <strong>le</strong> secteur de Quiberon à la Trinité, <strong>le</strong>s dépôts ont uncaractère mélangé avec une majorité d’algues brunes et une forte proportion d’algues rouges. Pour <strong>le</strong>reste <strong>des</strong> sites à l’est d’Erdeven, on voit apparaître en grande majorité <strong>des</strong> algues rouges tel<strong>le</strong>s queSolieria chordalis et quelques ceramia<strong>le</strong>s (Ex : Brongniartella bysoi<strong>des</strong>).Quelques exceptions sont notab<strong>le</strong>s, comme la présence de Pylaiella <strong>littoral</strong>is <strong>sur</strong> Quiberon Sab<strong>le</strong>sblancs.La carte de l’annexe 3 présente <strong>le</strong>s sites ayant été répertoriés pour <strong>des</strong> échouages massifs (endehors <strong>des</strong> débarquements « classiques » de goémon) sans pour autant que l’on puisse garantirl’exhaustivité <strong>des</strong> observations.Cimav P4 – rapport final mars 2012 39
3.1.5 ConclusionsLes inventaires en dénombrement de sites <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> en 2011 ont permis derepérer :• Un nombre é<strong>le</strong>vé de sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves : 102 sites <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong><strong>des</strong> 3 inventaires. L’année 2011 pour ce critère parmi <strong>le</strong>s plus é<strong>le</strong>vées depuis <strong>le</strong>démarrage <strong>des</strong> suivis (deuxième position derrière 2009). Le <strong>littoral</strong> sud Bretagne estrelativement plus touché en 2011 que <strong>le</strong>s années antérieures,• Un nombre de sites <strong>sur</strong>tout déjà très important en mai (76 sites) : niveau <strong>le</strong> plus é<strong>le</strong>vépour ce mois d’inventaire depuis <strong>le</strong> démarrage <strong>des</strong> suivis à cette période (2002)indiquant une année précoce,• Un niveau de juil<strong>le</strong>t qui demeure plutôt é<strong>le</strong>vé (79 sites) mais assez proche <strong>des</strong>dernières années,• Un niveau en septembre (55 sites) par contre qui est en fort retrait par rapport à juil<strong>le</strong>tet est <strong>le</strong> plus bas me<strong>sur</strong>é depuis <strong>le</strong> démarrage <strong>des</strong> inventaires à cette période (2007),• L’analyse <strong>sur</strong> la seu<strong>le</strong> période juil<strong>le</strong>t septembre donne l’image d’une annéerelativement plus basse <strong>sur</strong> <strong>le</strong> critère nombre de sites (84), <strong>sur</strong>tout par rapport auxannée 2007-2009,• Au travers ce dénombrement on perçoit donc une année précoce et <strong>sur</strong>tout dont laprolifération en p<strong>le</strong>in été puis en arrière saison a été fortement limitée (cf. § 3.2analyse <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces qui renseigne mieux <strong>sur</strong> <strong>le</strong> niveau de la prolifération annuel<strong>le</strong>),• Une proportion <strong>des</strong> sites de vasière dans <strong>le</strong> total <strong>des</strong> sites (un tiers) qui, bien qu’enrepli par rapport aux trois dernières années, reste importante ; l’augmentation dunombre de sites de ce type repérés pouvant, en partie au moins, s’expliquer par unsuivi plus approfondi de ces secteurs au fil <strong>des</strong> ans,• Des sites touchés par <strong>des</strong> proliférations d’autres algues que <strong>le</strong>s ulves : Pylaiella en baiede la Fresnaye et Lancieux et à partir du mois de septembre en baie de Saint Brieuc cequi n’avait jamais été noté au cours <strong>des</strong> dernières années de suivi. A noter éga<strong>le</strong>ment<strong>des</strong> échouages massifs d’algues rouge de type Solieria <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sud Bretagne etnotamment la presqu’i<strong>le</strong> de Rhuys et quelques sites du <strong>littoral</strong> nord concernés par <strong>des</strong>proliférations d’algues <strong>vertes</strong> filamenteuses.• Des sites de tail<strong>le</strong>s très inéga<strong>le</strong>s qui sont loin de tous répondre à l’image <strong>des</strong> sites de« marée verte » (cf. § 3.2 pour l’analyse <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces).Cimav P4 – rapport final mars 2012 40
3.2- Résultats de l’estimation <strong>sur</strong>facique <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes <strong>breton</strong>nesLe dénombrement <strong>des</strong> sites, s’il donne <strong>des</strong> résultats intéressants, notamment en ce qui concerne larépartition et la fréquence d’apparition <strong>des</strong> sites présentant <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong><strong>breton</strong>, ne permet pas de quantifier l’importance du développement algal <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites. La méthoded’estimation quantitative <strong>sur</strong>facique mise au point complète l’observation en apportant uneappréciation objective et chiffrée de l’importance de la prolifération. Ces données en « <strong>sur</strong>face » sontcomplétées, dans certains sites, par l’ajout de données de biomasse par unité de <strong>sur</strong>face et deprospections sous marines permettant une approche <strong>des</strong> stocks totaux d’algues.Il est important d’ajouter que, de par la méthode d’estimation de <strong>sur</strong>face employée ici, seu<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s<strong>sur</strong>faces colonisées par <strong>des</strong> ulves (ou algues <strong>vertes</strong> tota<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> estimations <strong>sur</strong> vasières)et accessib<strong>le</strong>s à l’observation aérienne sont comptabilisées. Les stocks infralittoraux ne sontdonc pas estimés par cette approche, ce qui conduit probab<strong>le</strong>ment à sous-estimer l’importance <strong>des</strong>sites du sud Bretagne qui ont tendance à stocker plus d’algues dans l’infra<strong>littoral</strong> que <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages.Cette méthode ne tenant compte que <strong>des</strong> stocks « visib<strong>le</strong>s » (déposés <strong>sur</strong> l’estran ou en rideau)présente l’avantage d’être proche de la perception ou <strong>des</strong> nuisances ressenties par <strong>le</strong>s riverains(mais éventuel<strong>le</strong>ment plus éloignée de la gène occasionnée pour <strong>le</strong>s utilisateurs de la mer…). Les<strong>sur</strong>faces déposées <strong>sur</strong> l’estran ou en rideau sont indicatrices <strong>des</strong> stocks totaux mais cette indicationest moins bonne dans la partie sud de la Bretagne où <strong>le</strong>s stocks infralittoraux sont particulièrementimportants.Les sites de vasière décrits précédemment (§ 3.1.3), n’ont pas tous fait l’objet de me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong>urface en algue cette année, seuls 10 masses d’eau ayant fait l’objet d’estimations<strong>sur</strong>faciques. En tout état de cause, il paraît pas pertinent de représenter ces sites <strong>sur</strong> <strong>le</strong> même planque <strong>le</strong>s sites de type « plage ».En effet, ces sites sont particuliers et ne peuvent être étudiés avec lamême approche que <strong>le</strong>s sites plus ouverts, <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong> : <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces végétalisées sont souvent coloniséesà la fois par <strong>des</strong> enteromorphes fixées et <strong>des</strong> ulves plus ou moins fixées (thal<strong>le</strong>s en partie envasés). Deplus, ces <strong>sur</strong>faces vaseuses sont diffici<strong>le</strong>ment praticab<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrain ne peuvent, biensouvent, concerner que la périphérie <strong>des</strong> dépôts. Pour <strong>le</strong>s vasières ayant fait l’objet d’estimation<strong>sur</strong>facique en 2011, tous <strong>le</strong>s dépôts d’algues <strong>vertes</strong> ont été tracés (ulves « en lame » ou« entéromorphes filamenteuses »), contrairement aux années antérieures à 2008 pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>sseuls <strong>le</strong>s dépôts dont l’aspect et la cou<strong>le</strong>ur permettaient d’estimer qu’il s’agissait bien de couverture enulves étaient tracés. Cette nouvel<strong>le</strong> manière de tracer <strong>le</strong>s dépôts d’algues verte <strong>sur</strong> vasière a étéemployée pour répondre à la DCE qui prévoit notamment comme indicateur la couverture maxima<strong>le</strong>annuel<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong> (et non la couverture par <strong>le</strong>s ulves). Les inventaires pour <strong>le</strong>squels <strong>le</strong>sdépôts semb<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s plus importants sont utilisés pour effectuer <strong>le</strong>s digitalisations <strong>des</strong> <strong>sur</strong>facesd’échouages d’algues <strong>vertes</strong>. La photo-interprétation <strong>sur</strong> ces sites vaseux est plus délicate et <strong>le</strong> résultatest donc moins précis que dans <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> sites sab<strong>le</strong>ux. En 2011 comme en 2009 et 2010, pourpouvoir mieux couvrir l’intégralité <strong>des</strong> vasières, deux vols spécifiques ont été déc<strong>le</strong>nchés pourpouvoir remonter certaines <strong>des</strong> rias qu’il n’était pas possib<strong>le</strong> de couvrir lors <strong>des</strong> acquisitions« généra<strong>le</strong>s » <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong>.En tout état de cause, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôts d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas à mettre <strong>sur</strong> <strong>le</strong> mêmeplan que <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces <strong>des</strong> sites « sab<strong>le</strong>ux » (ni en biomasse ni en nuisance) ; aussi il a été choisi de <strong>le</strong>sreprésenter séparément, comme <strong>le</strong>s années précédentes.3.2.1. L’importance relative <strong>des</strong> sitesSur l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites classés comme touchés en 2011 par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> secteur deplage, et en considérant uniquement <strong>le</strong>s mois d’inventaires « généraux » de l’année (3 données lors <strong>des</strong>trois inventaires « généraux » du <strong>littoral</strong>), <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces maxima<strong>le</strong>s de dépôt d’ulves s’échelonnent, pourCimav P4 – rapport final mars 2012 41
l’année 2011 de 0,02 ha à 110 ha soit dans un rapport de 1 à 5500, ce qui confirme bien la nécessitéd’appréhender la <strong>sur</strong>face <strong>des</strong> dépôts en plus de la simp<strong>le</strong> « présence anorma<strong>le</strong> d’ulves » pourdécrire <strong>le</strong> phénomène (dénombrement <strong>des</strong> sites, § 3.1).L’annexe 4 présente tous <strong>le</strong>s sites <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong> en fonction de <strong>le</strong>ur tail<strong>le</strong> maxima<strong>le</strong> atteinte lors <strong>des</strong> 3inventaires de 2011 (pour que tous <strong>le</strong>s sites aient un chiffre issu du même nombre de me<strong>sur</strong>e) etéga<strong>le</strong>ment, pour <strong>le</strong>s sites faisant l’objet de 7 inventaires, <strong>le</strong> maximum atteint <strong>sur</strong> ces 7 inventaires(permet de percevoir <strong>le</strong> maximum atteint pour <strong>le</strong>s sites <strong>sur</strong>veillés mensuel<strong>le</strong>ment ; <strong>le</strong>s plus grands sitessont dans ce cas et <strong>le</strong> maximum annuel peut être supérieur au maximum <strong>des</strong> trois inventaires« généraux »). On perçoit bien, à travers ces représentations, <strong>le</strong>s gran<strong>des</strong> disparités rencontrées etl’importance d’avoir une perception <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces.Pour <strong>le</strong>s sites de type « plage », cinq classes sont proposées en se basant <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces me<strong>sur</strong>ées lors<strong>des</strong> trois inventaires « généraux » (mai juil<strong>le</strong>t et septembre) :1-2-3-4-5-6-7-Classes de sites par <strong>sur</strong>faces maxima<strong>le</strong>scou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvesmoins de 1 hectareNombre <strong>des</strong>itesEn 2007 encore, <strong>le</strong>s deux premières de 10 à classes 50 hectares sont majoritaires ; à 8 el<strong>le</strong>s deux el<strong>le</strong>s représententplus de 70 % <strong>des</strong> sites classés. de On 50 note à 200 par hectares contre qu’en 2007, <strong>le</strong>s classes de tail<strong>le</strong> de sites plus3é<strong>le</strong>vées (plus de 10 ha) sont supérieures à toutes <strong>le</strong>s années antérieures (sauf pour la catégorie +de 200 ha). On perçoit donc plus <strong>le</strong> caractère de 200 hectares de marée verte massive 0 <strong>sur</strong> ce critère de la <strong>sur</strong>faceRépartition maxima<strong>le</strong> <strong>des</strong> atteinte sites <strong>sur</strong> en secteur 2007. de plage par classe de tail<strong>le</strong> maximum atteinte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 3 inventaires « généraux »(« rideau » + échouage en « équiva<strong>le</strong>nt 100% » de couverture).15de 1 à 10 hectares 4145nombre de sites4035302520nombre de site en 2002nombre de site en 2003nombre de site en 2004nombre de site en 2005nombre de site en 2006nombre de site en 2007nombre de site en 2008nombre de site en 2009nombre de site en 2010nombre de site en 2011151050moins de 1 ha de 1 à 10 ha de 10 à 50 ha de 50 à 200 ha plus de 200 haFigure 12 : Répartition par classe de tail<strong>le</strong> (maximum annuel <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s trois inventaires « généraux ») <strong>des</strong> sitesprésentant <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> secteur de plage entre 2002 et 2011 ) ; <strong>le</strong> site de la Fresnaye, touché par <strong>des</strong>échouages d’Ulvaria (« ulvoïde ») de 2007 à 2009 a été classé dans ces sitesCimav P4 – rapport final mars 2012 42
Catégorie \ Département 35 22 29 56 Totalmoins de 1 ha 0 0 12 3 15de 1 à 10 ha 0 7 25 9 41de 10 à 50 ha 0 0 8 0 8de 50 à 200 ha 0 3 0 0 3plus de 200 ha 0 0 0 0 0Répartition <strong>des</strong> sites <strong>sur</strong> secteur de plage touchés en 2011 par <strong>des</strong> échouages d'ulves par département et par classe detail<strong>le</strong> (tail<strong>le</strong> maxima<strong>le</strong> atteinte <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 3 inventaires générauxL’analyse de la figure 12 et <strong>des</strong> deux tab<strong>le</strong>aux permet de conclure pour la saison 2011 :• Une majorité de sites (plus de 60 %) qui se trouve entre 1 et 10 ha (maximum annuel <strong>sur</strong> 3inventaires) ; catégorie qui rassemb<strong>le</strong> en 2011, comme c’était déjà <strong>le</strong> cas en 2010 beaucoup plus <strong>des</strong>ites que toutes <strong>le</strong>s années précédentes (en moyenne 44 % <strong>des</strong> sites étaient dans cette catégorie <strong>sur</strong>2002-2009),• Des sites, classés comme touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves, de très petites tail<strong>le</strong>s qui sontcependant nombreux puisque <strong>le</strong>s sites de moins de 1 ha représentent près 25 % du total <strong>des</strong> sitesde plage. En 2011 <strong>le</strong>s sites de cette catégorie sont, en pourcentage du total <strong>des</strong> sites annuelscomparab<strong>le</strong> aux années 2008-2010 mais assez nettement inférieur aux années antérieures(moyenne <strong>sur</strong> 2002-2009 de 34 %),• En 2011, comme c’était déjà <strong>le</strong> cas en 2010, aucun site ne figure dans la classe <strong>des</strong> plus de 200ha. Le nombre de sites dans la catégorie 50 à 200 ha n’est pour autant pas plus important que <strong>le</strong>sannées précédentes (3 en 2010 contre 4 en moyenne 2002-2009 et même 4.5 si on comptabilise <strong>le</strong>ssites de plus de 200 ha éga<strong>le</strong>ment). Par contre <strong>le</strong>s sites de la catégorie 10-50 ha sont un peu plusnombreux qu’en 2010 mais proche du niveau moyen <strong>des</strong> années antérieures (8 en 2011 contre 6sites en 2010 et 8.75 en moyenne 2002-2009). Au total, <strong>le</strong>s sites de plus grande tail<strong>le</strong> (plus de10ha) sont en 2011 un peu plus nombreux qu’en 2010 mais à un niveau inférieur auxannées précédentes (11 sont dans cette catégorie en 2011, contre 9 en 2010 et 13.5 en moyenne2002-2009),• Le Finistère qui apparaît comme <strong>le</strong> département <strong>le</strong> plus touché en nombre de sites recensés aucours de la saison (cf. 3.1.1) est <strong>sur</strong>tout concerné par <strong>des</strong> sites de petites ou moyennes tail<strong>le</strong>spuisqu’aucun site n’atteint <strong>le</strong>s 50 ha. Il est important de noter que <strong>le</strong> fond de baie de Douarnenezest constituée de 5 sites distincts (en liaison avec <strong>des</strong> secteurs de plages alimentés par <strong>des</strong> coursd’eau différents) et que, si l’on cumu<strong>le</strong> <strong>le</strong>s dépôts <strong>sur</strong> ces 5 sites, on atteint la classe de plus de 50ha (100 ha pour la somme <strong>des</strong> maximums <strong>des</strong> 5 sites). A noter cependant : <strong>le</strong>s sites du sudBretagne comportant régulièrement <strong>des</strong> quantités plus importantes dans l’infra<strong>littoral</strong> sontici comptabilisés pour une partie seu<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> algues présentes (exemp<strong>le</strong> de la baie de laForêt dont <strong>le</strong>s échouages n’atteignent pas 50 ha pour la somme <strong>des</strong> maximum annuel <strong>des</strong>différentes plages alors que la biomasse tota<strong>le</strong> du site est régulièrement me<strong>sur</strong>ée autour de 5 000 à10 000 T et semb<strong>le</strong> particulièrement importante en 2011).• En revanche, <strong>le</strong>s Côtes d’Armor, où un nombre plus réduit de sites est inventorié, connaissent <strong>le</strong>ssites d’échouage <strong>le</strong>s plus importantes de la région en terme de <strong>sur</strong>face d’échouage. Tous<strong>le</strong>s sites de plus grande <strong>sur</strong>face d’échouage (3 sites dans la catégorie de plus de 50 ha : SaintMichel, Yffiniac, Morieux) se trouvent <strong>sur</strong> ce département. A noter que Saint Michel en GrèveCimav P4 – rapport final mars 2012 43
est pour <strong>le</strong> maximum d’échouage <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 3 inventaires « généraux » au <strong>des</strong>sus d’Yffiniac mais esttrès légèrement inférieur (identique) si l’on prend <strong>le</strong> maximum <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 7 inventaires annuels(maximum d’Yffiniac en juin). Suivent ensuite dix sites finistériens, tous situés <strong>sur</strong> <strong>le</strong> FinistèreNord, la baie de Douarnenez ou de la Forêt (cf. Annexe 4). La présence <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s Côtes d’Armor <strong>des</strong>sites dont la <strong>sur</strong>face est la plus importante peut être mise en parallè<strong>le</strong> avec la tail<strong>le</strong> <strong>des</strong> estransconcernés qui constituent <strong>des</strong> espaces potentiels de prolifération très vastes et de « bonneconfiguration » (<strong>sur</strong>face tota<strong>le</strong> de l’estran d’Yffiniac supérieure à 1500 ha ; presqu’autant pourl’estran de Morieux).• En 2011 <strong>le</strong> département du Morbihan ne compte aucun site (site sab<strong>le</strong>ux uniquement ici) dans <strong>le</strong>scatégorie de <strong>sur</strong>face <strong>le</strong>s plus importantes : 9 sites entre 1 et 10 ha (<strong>le</strong> plus important en maximumannuel, Erdeven est proche de 9 ha) et 3 sites de moins de 1 ha. A noter la présence, non analyséeici, de vastes <strong>sur</strong>faces d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> vasières.• Le département d’Il<strong>le</strong> et Vilaine ne comprend encore en 2011 aucun site « sab<strong>le</strong>ux » classé pour<strong>des</strong> échouages d’ulves mais uniquement <strong>des</strong> vasières, toutes dans <strong>le</strong> secteur de la Rance.Les cartes 7 et 8 présentent <strong>le</strong> cumul <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces en ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s trois inventaires « généraux »,concernant l’ensemb<strong>le</strong> du linéaire <strong>breton</strong> (mai, juil<strong>le</strong>t et septembre). Les trois plus grands sitescostarmoricains se démarquent nettement ainsi que <strong>le</strong>s nombreux sites finistériens, de tail<strong>le</strong>légèrement plus mo<strong>des</strong>te mais en plus grand nombre (nord Léon, baie de Douarnenez et de laForêt). Les sites morbihannais se distinguent par <strong>des</strong> sites dont la <strong>sur</strong>face peut être qualifiée demoyenne (mais <strong>le</strong> plus souvent <strong>sur</strong> <strong>des</strong> plages el<strong>le</strong>s aussi de <strong>sur</strong>face mo<strong>des</strong>te ce qui peut engendrerune perception d’atteinte plus importante que <strong>sur</strong> certaines gran<strong>des</strong> baies). On peut noter en 2011, àl’image de la situation 2010, que l’Est <strong>des</strong> Côtes d’Armor est très peu touchés (seul apparaît pour unéchouage d’ulves limité en baie de Lancieux ; <strong>le</strong>s colonisations, parfois importnates par d’autres algueset plus particulièrement par<strong>le</strong> Pylaiella <strong>littoral</strong>is, <strong>sur</strong> la baie de la Fresnaye, de Lancieux et dans unemoindre me<strong>sur</strong>e de l’Arguenon et Erquy ne sont pas intégrées ici). Sur ces cartes, l’importance <strong>des</strong>dépôts d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites <strong>sur</strong> vase n’est pas représentée, seu<strong>le</strong> la position de ces sites est reportée.Ces cartes permettent de faire la synthèse entre <strong>le</strong> nombre de sites touchés et <strong>le</strong>ur importance<strong>sur</strong>facique.Le découpage du linéaire côtier en « sites » étant parfois délicat (cf. mises en garde en 3.1.1), la carte 9se propose de représenter <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces d’échouage <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies sab<strong>le</strong>uses par Masse d’Eau de la DCE.Les Masses d’Eau ont été délimitées d’après <strong>le</strong>ur homogénéité et permettent alors de regrouper <strong>le</strong>ssites de façon pertinente. Cela permet, par exemp<strong>le</strong>, de regrouper l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces de la baiede Douarnenez ou du Léon. Pour cette carte, afin d’être homogène, seuls <strong>le</strong>s données de <strong>sur</strong>face enalgue (équiva<strong>le</strong>nt 100% + rideau) <strong>sur</strong> sites sab<strong>le</strong>ux et pour <strong>le</strong>s trois inventaires communs à l’ensemb<strong>le</strong>du linéaires ont été cumulées. Les <strong>sur</strong>faces de vasières colonisées par <strong>le</strong>s ulves n’y sont pas incluses.On y distingue la prédominance de la ME du fond de baie de Saint Brieuc, puis <strong>le</strong>s ME de la baie deLannion, du Léon – Trégor large, de la baie de Douarnenez et de la baie de la Forêt. Viennent ensuite<strong>le</strong>s ME de la façade sud de la Bretagne. Cette représentation par ME permet de confirmer <strong>le</strong> statutparticulier ces dernières années <strong>des</strong> baie de l’Est du département <strong>des</strong> Côtes d’Armor (ME Rance –Fresnaye) qui présente moins de 5 ha d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 3 inventaires (mais présence de Pylaiella, algueproliférante, non pris en compte dans cette estimation qui ne traite que <strong>des</strong> échouages d’ulves).Cimav P4 – rapport final mars 2012 44
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvescumulées lors <strong>des</strong> 3 inventaires de <strong>sur</strong>veillance de la saison 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.PORTSALLARGENTONCOULOUARNGUISSENYMOGUERAN/COREJOUABER BENOITKERLOUANMOULIN-BLANCBRIGNOGANGOULVENABER WRACHPLOUNEOURKEREMMAELORNPORS-GUEN/PORS-MEURHORN/GUILLECTINDUFF/MOULIN NEUFKERVALIOU/KERFISSIENPORT NEUFPENZETY NOD/RADE DE MORLAIXDIBENPORZ BILIECMOULIN-DE-LA-RIVELOCQUEMEAULOCQUIRECANSE DE PERROSNANTOUARBEG LEGUERTRESTELPELLINECSAINT-MICHEL-EN-GREVEJAUDYLEDANOBREHECBINIC/ETABLES-SUR-MERFRESNAYE ***ARGUENON ***MINIHIC-SUR-RANCELANCIEUX ***QUELMERLimite del'inventaireSAINT-JOUAN-DES-GUERETSDAOULASTREZ-HIRROSCANVELMORGAT**POSTOLONNEC**HOPITAL CAMFROUTAULNE/FOND DE RADEFINISTEREYFFINIAC ***MORIEUX ***LA VILLE GERLA VILLE-ES-NONAISABER **TREZ-BIHAN/TREZ-BELLEC **PORSLOUS **LIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDCOTES-D'ARMORSurfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves en 2011(cumul <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 3 inventaires mai juil<strong>le</strong>t septembre)
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvescumulées lors <strong>des</strong> 3 inventaires de <strong>sur</strong>veillancede la saison 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.PORTSALLARGENTONCOULOUARNGUISSENYMOGUERAN/COREJOUABER BENOITKERLOUANMOULIN-BLANCBRIGNOGANGOULVENABER WRACHPLOUNEOURKEREMMAELORNPORS-GUEN/PORS-MEURHORN/GUILLECTINDUFF/MOULIN NEUFKERVALIOU/KERFISSIENPORT NEUFPENZETY NOD/RADE DE MORLAIXDIBENPORZ BILIECMOULIN-DE-LA-RIVELOCQUEMEAULOCQUIRECANSE DE PERROSNANTOUARBEG LEGUERTRESTELPELLINECSAINT-MICHEL-EN-GREVEJAUDYLEDANOBREHECBINIC/ETABLES-SUR-MERFRESNAYE ***ARGUENON ***MINIHIC-SUR-RANCELANCIEUX ***QUELMERLimite del'inventaireSAINT-JOUAN-DES-GUERETSDAOULASTREZ-HIRROSCANVELMORGAT**HOPITAL CAMFROUTAULNE/FOND DE RADEYFFINIAC ***MORIEUX ***LA VILLE GERLA VILLE-ES-NONAISABER**TREZ-BIHAN/TREZ-BELLEC**POSTOLONNEC**PORSLOUS**LIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDFINISTERECOTES-D'ARMORBAIE DES TREPASSESKERVEL/TREZMALAOUENPORT RHU/TREBOULRYLOCHAUDIERNEILE-TUDYODETCAP COZPORT LA FORETCONCARNEAUILLE-ET-VILAINESurfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves en 2011Plages : cumul <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 3 inventairesreprésentation avec <strong>des</strong> symbo<strong>le</strong>s proportionnelsSAINT-GUENOLEPOULDONMOUSTERLINCABELLOUTREVIGNONKERFANYAVENFORT-BLOQUEPORT LOUISMORBIHAN1 ha10 ha50 haGUILVINECLESCONILLODONNECBEG MEILBEG MEIL NORDANSE DEPOULDOHANKERLEVEN/SAINT-LAURENTPOULDUKERPAPECOUREGANTRIA D ETELRIVIERE DE CRAC'HAURAYNORD OUESTGOLFE 56PORT-MANECHPOINTE DE GAVRESNORD EST GOLFE 56160 ha.LARMOR-PLAGEERDEVENSUD ARZONMINE D ORsite <strong>sur</strong> vase (<strong>sur</strong>face non représentée)* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + dépôt estran en équiva<strong>le</strong>nt 100% de couverture** Estimations plus approximatives en zone militaire P112 (non <strong>sur</strong>volée)*** Sites touchés au moins une partie de la saison par <strong>des</strong> proliférations d’algues brunesfilamenteuses0 30 60KmCarte 8QUIBERONSAINT GILDASDE RHUYSPENVINSLimite del'inventairePOINTE DU BILE
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plagesCumul par Masse d'Eau en 2011(contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCE)L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les<strong>sur</strong>faces de dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pasreprésentées. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.FRGC13FRGC12FRGC09FRGC10FRGC08FRGT05FRGT04FRGT03FRGC07FRGC06FRGC11FRGC03FRGC05FRGC01FRGC18FRGC16**FRGC17**FINISTERECOTES-D'ARMORFRGC20**Seuls <strong>le</strong>s échouages <strong>sur</strong> plage sontreportés ici à l’échel<strong>le</strong> de la massed’eau. Les échouages <strong>sur</strong> vasièressont comptabilisés par ail<strong>le</strong>urs.FRGC24FRGC26ILLE-ET-VILAINECumul <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d‛ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages *<strong>sur</strong> <strong>le</strong>s Masses d‛eau DCEinventaires de mai, juil<strong>le</strong>t et septembre 20111 haFRGC29MORBIHANFRGC28100 haFRGC33FRGC32FRGC34FRGC39300 haMasses d’Eau pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>facesme<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> plage sont non nul<strong>le</strong>s* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + dépôt estran en équiva<strong>le</strong>nt 100% de couverture.0 30 60KmFRGC37FRGC35FRGC42FRGC36FRGC38FRGC45FRGC44Carte 9** Estimations plus approximatives en zone militaire P112 (non <strong>sur</strong>volée)
3.2.2. Evolution annuel<strong>le</strong> de la marée verteLa cartographie <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves à chaque mois d’inventaire (annexe 5) permet depercevoir <strong>le</strong> phénomène à différentes pério<strong>des</strong> de l’année, mais aussi d’en saisir l’évolution au coursde la saison <strong>sur</strong> <strong>le</strong> plan régional. La représentation proposée <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> (« équiva<strong>le</strong>nt100% » + rideau) utilise <strong>des</strong> cerc<strong>le</strong>s proportionnels selon une échel<strong>le</strong> de va<strong>le</strong>urs fixe permettant degarder pour l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> cartes, <strong>le</strong>s mêmes tail<strong>le</strong>s de cerc<strong>le</strong>s pour <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs identiques. On note :• En avril, <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces <strong>sur</strong>tout importantes <strong>sur</strong> la baie de Saint Michel en Grève. Viennent ensuite<strong>le</strong>s sites de la Baie de Douarnenez puis de la baie de la Forêt et à un niveau moindre la baie deSaint Brieuc. A noter la <strong>sur</strong>face relativement importante <strong>sur</strong> Bréhec par rapport à la tail<strong>le</strong> du site.• En mai, la baie de Saint Michel est toujours prédominante (maximum annuel de ce site pour2011), suivie <strong>des</strong> deux sites de la baie de Saint Brieuc (dont la somme dépasse de 30 % <strong>le</strong> niveaude la baie de Saint Michel en Grève). Viennent ensuite <strong>le</strong>s sites de la baie de Douarnenez, puis dela baie de la Forêt et <strong>le</strong>s sites de moindre superficie du <strong>littoral</strong> du Léon. On note aussi un nombrede site assez important et de tail<strong>le</strong> moyenne <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> Sud, <strong>le</strong> plus important en <strong>sur</strong>face étant laPointe du Bi<strong>le</strong> à l’extrême Est du département du Morbihan.• En Juin, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces progressent peu par rapport à mai au niveau régional mais diminuentfortement en baie de Saint Michel et Douarnenez (en lien avec <strong>des</strong> conditions relativementdéfavorab<strong>le</strong>s aux dépôts <strong>le</strong>s jours ayant précédés <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol) alors qu’el<strong>le</strong>s augmentent <strong>sur</strong> la baie deSaint Brieuc de près de 70 %.• En juil<strong>le</strong>t, la situation évolue assez peu à l’échel<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong> avec une légère diminution de la baiede Saint Brieuc et de la baie de Douarnenez et une augmentation de la plupart <strong>des</strong> sites du <strong>littoral</strong>du Léon. Cette date étant une date d’inventaire « général » on peut distinguer, <strong>sur</strong> la côte sud de laBretagne un nombre important de sites touchés, <strong>le</strong> plus important en <strong>sur</strong>face (en dehors <strong>des</strong> sitesde suivi renforcé) étant celui d’Erdeven.• En août <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces régiona<strong>le</strong>s sont en nette diminution (-35 %). Cela est en grande partie lié à labaie de Saint Brieuc qui voit une diminution sensib<strong>le</strong> (-60 %) ce qui est éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> cas de la baiede Saint Michel en Grève et de la baie de Douarnenez. L’augmentation parfois importante <strong>des</strong><strong>sur</strong>faces <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites du Finistère nord (Locquirec, Pors Guen, Keremma, Guisseny) ou de Binic /Etab<strong>le</strong>s-<strong>sur</strong>-Mer n’est pas en me<strong>sur</strong>e de compenser la forte diminution <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s gran<strong>des</strong> baies.• Les <strong>sur</strong>faces régressent encore fortement en septembre (-50 %) ce qui est en grande partie lié àl’effondrement de <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves en baie de Saint Brieuc (-70% ; présencedevenant majoritaire de Pylaiella, algue brune filamenteuse qui représente près de 90 % <strong>des</strong> alguesprésentes) à la forte diminution <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces en baie de Binic/Etab<strong>le</strong>s-<strong>sur</strong>-Mer et dans unemoindre me<strong>sur</strong>e aux diminutions <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces de la baie de Saint Michel en Grève et Douarnenez.A l’opposé, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces augmentent sensib<strong>le</strong>ment <strong>sur</strong> Guisseny (+20 %) et fortement <strong>sur</strong> la baiede la Forêt (trip<strong>le</strong>ment <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites de Cap Coz + Ker<strong>le</strong>ven). Excepté la Pointe du Bi<strong>le</strong>, on noteen Septembre qu’aucun site de type « plage » n’est touché par <strong>des</strong> échouages d’ulves significatif àl’Est de Lamor. Certains de ces secteurs sont à cette même date concernés par <strong>des</strong> échouagesparfois massifs d’autres algues (notamment Solieria <strong>sur</strong> la presqu’i<strong>le</strong> de Rhuys et jusqu’àBanastère) ce qui peut masquer une présence d’ulves plus limitée et devenant non perceptib<strong>le</strong>.• En Octobre la diminution <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces régiona<strong>le</strong> se poursuit. La plupart <strong>des</strong> sites régressent maisc’est <strong>sur</strong>tout la diminution <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces en baie de Saint Brieuc qui provoque la diminutionrégiona<strong>le</strong>. A cette date on estime à environ 1% <strong>le</strong> taux d’ulves parmi l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> algues en baiede Saint Brieuc (principa<strong>le</strong>ment couverte par du Pylaiella à cette date).Cimav P4 – rapport final mars 2012 48
‣ Des profils de sites différentsLes sites se distinguent par l’évolution, au cours de la saison, <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces en algues <strong>vertes</strong> estimées.Ces profils de sites permettent de mieux comprendre <strong>le</strong> fonctionnement <strong>des</strong> sites et <strong>le</strong>urs réactionsaux caractéristiques climatiques. Les fiches de chaque site ayant fait l’objet d’estimations <strong>sur</strong>faciquesmensuel<strong>le</strong>s synthétisent l’évolution <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> observées loca<strong>le</strong>ment et permettent d’en saisirla typologie (annexe 6).La carte 10 présente la synthèse annuel<strong>le</strong> de l’évolution de la marée verte <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sites<strong>breton</strong>s ; cela permet pour ces sites de percevoir <strong>le</strong> profil de la prolifération et de comparer <strong>le</strong>s<strong>sur</strong>faces d’échouages mois par mois. Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s histogrammes parce qu’ils gardent <strong>des</strong>proportions conformes, nous permettent d’évaluer visuel<strong>le</strong>ment l’importance relative <strong>des</strong> sites <strong>le</strong>s unspar rapport aux autres.Cela permet en outre de distinguer :• Les sites précoces :Les sites costarmoricains sont habituel<strong>le</strong>ment plutôt précoces ainsi que la baie de Douarnenez. En2011, comme c’était déjà noté en 2010, <strong>le</strong>s baies de Saint Michel en Grève et de Douarnenez peuventêtre considérées comme <strong>le</strong>s plus précoces, la baie de Saint Brieuc ayant un démarrage un peu plusretardé mais un maximum annuel tout de même précoce (juin). La baie de la Forêt peut éga<strong>le</strong>mentêtre placée dans la catégorie <strong>des</strong> sites précoces (la prolifération y démarre tôt et s’y maintient à unniveau é<strong>le</strong>vé durant toute la saison).La précocité <strong>des</strong> sites est très probab<strong>le</strong>ment à relier avec <strong>des</strong> stocks infralittoraux hivernauximportants mais éga<strong>le</strong>ment aux conditions hiverna<strong>le</strong>s (cf. paragraphe 3.2.3). Ainsi, auprintemps lorsque <strong>le</strong>s conditions de lumière et de température deviennent progressivementfavorab<strong>le</strong>s, l’existence de stocks résiduels importants provoque une explosion <strong>des</strong> quantités d’ulves ensituation environnementa<strong>le</strong> saisonnière de non limitation de la croissance <strong>des</strong> algues par l’azote. Laconfiguration de ces sites constitués de gran<strong>des</strong> baies peu profon<strong>des</strong> provoque probab<strong>le</strong>mentéga<strong>le</strong>ment un réchauffement de l’eau plus important qu’ail<strong>le</strong>urs ce qui est favorab<strong>le</strong> à la croissance <strong>des</strong>ulves en début de saison.• Les sites tardifs :Les sites du nord Finistère sont dans l’ensemb<strong>le</strong> concernés par <strong>des</strong> échouages que l’on peut qualifierde tardifs (Horn/Guil<strong>le</strong>c, Guissény, Pors Guen, Keremma et de Locquirec, principa<strong>le</strong>ment). Lespremiers mois du suivi y sont caractérisés par une augmentation <strong>le</strong>nte <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>sulves. Sur cette côtes nord Finistère, <strong>le</strong> site de Moguéran / Coréjou est celui qui peut être considérécomme <strong>le</strong> plus « précoce ». A noter en 2011 encore <strong>des</strong> échouages assez tardifs <strong>sur</strong> <strong>le</strong> site de BinicEtab<strong>le</strong>s (très peu d’ulves en avril et mai, niveau encore mo<strong>des</strong>te en juin et juil<strong>le</strong>t et devenant maxima<strong>le</strong>n août). Contrairement aux sites précoces, la marée verte <strong>des</strong> sites tardifs se reconstitue trèsprobab<strong>le</strong>ment à partir de stocks hivernaux réduits ; la température de l’eau semb<strong>le</strong> pouvoiréga<strong>le</strong>ment jouer un rô<strong>le</strong> important dans ce démarrage retardé.Une piste complémentaire peut être avancée pour expliquer <strong>le</strong>s marées <strong>vertes</strong> tardives. Les séquencesde démarrage de sites voisins – <strong>le</strong> fait qu’une marée verte relativement importante apparaisse aprèsune marée verte observée <strong>sur</strong> un site voisin lors de l’inventaire précédent – peut nous permettre depenser que certains sites subissent un ensemencement provenant d’un site proche. Certainesobservations (masse d’algues dérivantes au gré <strong>des</strong> courants) lors <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols viennent étayer cettehypothèse. Des sites tels que Locquirec ou Binic/Etab<strong>le</strong>s-<strong>sur</strong>-Mer ainsi que Guissény (qui apparaîtaprès <strong>le</strong> site de Moguéran/Coréjou) sont concernés par cette hypothèse d’ensemencement par un sitevoisin plus précoce. Leurs marées <strong>vertes</strong> seraient donc dépendantes, au moins en début de saison, <strong>des</strong>proliférations <strong>des</strong> sites voisins (Saint-Michel-en-Grève pour Locquirec et Yffiniac/Morieux pourBinic). L’approche sous marine de ces relations entre sites apparaît ainsi une nécessité. En terme delutte contre <strong>le</strong>s proliférations, tant préventive que curative, de tel<strong>le</strong>s hypothèses ont bien sûr <strong>des</strong>implications très importantes.Cimav P4 – rapport final mars 2012 49
Variation <strong>des</strong> échouages d'ulves en 2011entre avril et octobreLes sites principaux sont <strong>sur</strong>volés à marée bassede fort coefficient mensuel<strong>le</strong>ment d’avril à octobre.Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong> échouagesd'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôt sontme<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pasreprésentées ici. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.Quelques sites ont présenté <strong>des</strong> proliférationsd’algues brunes filamenteuses non comptabilisées.MOGUERAN/COREJOUGUISSENYKEREMMAPORS-GUEN/PORS-MEURHORN/GUILLECBEG LEGUERTRESTELBINIC/ETABLES-SUR-MERERQUY **FRESNAYE **ARGUENON **LANCIEUX **BREHECFINISTERELOCQUIRECCOTES-D'ARMORVAL ANDREBAIE DU MONT-SAINT-MICHELTREZ-HIRSAINT-MICHEL-EN-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERLIEUE-DE-GREVESAINTE-ANNE-LA-PALUDSurfaces* cou<strong>vertes</strong> (en hectares) par <strong>le</strong>s ulvespour <strong>le</strong>s 7 inventaires de 2011 :100 ha* Surface tota<strong>le</strong> = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%** Sites touchés au moins une partie de la saison par<strong>des</strong> proliférations d’algues brunes filamenteusesRYKERVEL/TREZMALAOUENYFFINIAC **MORIEUX **ILLE-ET-VILAINELégendeMORBIHANAvril75 haMaiJuinJuil<strong>le</strong>t50 haKERLEVEN/SAINT-LAURENTAoûtSeptembreOctobre10 ha25 haSeuls <strong>le</strong>s sites de “plage” faisant l’objet d’un suivi mensue<strong>le</strong>ntre avril et octobre sont représentés.Surfaces <strong>des</strong> sites de vasière non représentées.55CABELLOU.0 30 60KmLARMOR-PLAGEQUIBERON/SABLES BLANCSCarte 10T_2011_CIMAV_tous_sites_sab<strong>le</strong>s_sf_mois_2002_2011.SF_2011_04
3.2.3. Evolutions de la marée verte <strong>sur</strong> la période 2002-2011De 2002 à 2006 <strong>le</strong>s suivis réalisés par <strong>le</strong> CEVA pour Pro<strong>littoral</strong> se sont déroulés avec <strong>le</strong>s mêmesoutils et métho<strong>des</strong>. De 2007 à 2011, <strong>le</strong>s suivis Cimav (suivis complémentaires du CEVA) / DCE<strong>sur</strong>veillance combinés permettent <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites principaux de Bretagne une perception identique à cel<strong>le</strong>permise par <strong>le</strong>s suivis 2002-2006. Il est donc possib<strong>le</strong> de comparer <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces me<strong>sur</strong>ées aux me<strong>sur</strong>es<strong>des</strong> années antérieures, acquises avec <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> et une résolution identique. Sans que cela puisseêtre quantifié au niveau régional, faute de me<strong>sur</strong>es antérieures de même nature, l’année 2002 semblaitêtre une année de relativement faib<strong>le</strong> prolifération (si on la compare, pour certains sites mieuxconnus, aux photos <strong>des</strong> années antérieures de la fin <strong>des</strong> années 90 début 2000).L’année 2003, année plutôt sèche, nous avait permis de conclure, à une diminution, <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong>de la saison (cumul <strong>des</strong> dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 7 inventaires, pour <strong>le</strong>s sites sab<strong>le</strong>ux) de près de 25 % <strong>des</strong><strong>sur</strong>faces en algues par rapport à la première « année de référence ».L’année 2004, dont <strong>le</strong>s conditions climatiques étaient plutôt favorab<strong>le</strong>s à <strong>des</strong> proliférations longues(mois d’été arrosés soutenant <strong>le</strong>s étiages et <strong>le</strong>s flux de nutriments à une période favorab<strong>le</strong> à lacroissance <strong>des</strong> algues au moins devant la plupart <strong>des</strong> sites de prolifération majeurs). Le résultat del’année 2004 avait été :- une marée verte assez précoce et qui est restée à un niveau é<strong>le</strong>vé jusqu’en fin de saison,- <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> en 2004 en augmentation de 44 % par rapport à 2003,- <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> en 2004 en augmentation de 11 % par rapport à 2002.En 2005 (été sec voire très sec suivant <strong>le</strong>s secteurs) on avait me<strong>sur</strong>é :- un démarrage très précoce de la saison, un maximum annuel intense (juin) puis une diminutionmarquée <strong>des</strong> échouages,- 28 % de <strong>sur</strong>face en moins qu’en 2004,- 16 % de moins que la moyenne 2002-2004.L’année 2006, très particulière d’un point de vue climatique (température de l’eau très basse enhiver ; réchauffement printanier de l’eau retardé d’un mois environ), avait permis de mettre enévidence :- Une marée verte très retardée, puis un certain rattrapage en fin de saison,- <strong>sur</strong>face cumulée <strong>sur</strong> l’année minima<strong>le</strong> depuis 2002, première année de référence,- 32 % de <strong>sur</strong>face en moins que la moyenne 2002-2005,- 21 % de moins que l’année 2005,- 44 % de moins que l’année 2004, année maxima<strong>le</strong> de la série 2002-2006.L’année 2007 était marquée :- par un démarrage encore plus tardif qu’en 2006, avec très peu d’algue lors <strong>des</strong> deux premiersinventaires,- une prolifération très soutenue en fin de saison avec, dès juil<strong>le</strong>t, <strong>des</strong> échouages qui étaientsupérieurs à la moyenne <strong>des</strong> années antérieures ; à partir d’août et jusqu’en octobre <strong>le</strong> niveau<strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces est très supérieur à la moyenne interannuel<strong>le</strong> et à toute <strong>le</strong>s années précédentes (+90 % en septembre et + 80 % en octobre par rapport à 2002-2006).- un cumul de 15 % supérieur à la moyenne 2002-2006,- un cumul 10 % inférieur à l’année 2004, année du cumul maximalCimav P4 – rapport final mars 2012 51
Pour l’année 2008 avaient été constatés :- un démarrage très précoce : en avril, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces me<strong>sur</strong>ées sont <strong>le</strong> doub<strong>le</strong> de la série 2002-2007, en mai el<strong>le</strong> sont encore de 50 % supérieure,- un niveau en juil<strong>le</strong>t maximal et très supérieur aux années antérieures (+60% par rapport à2002-2007),- un niveau en septembre puis octobre très supérieur à la moyenne 2002-2007, proche de lasituation exceptionnel<strong>le</strong> de 2007 (respectivement + 60 % et + 30 % par rapport à la série 2002-2007),- ce démarrage précoce associé à cette fin de saison soutenue conduit à un niveau cumulépour l’année 2008 exceptionnel avec 40 % de plus que la moyenne 2002-2007 et plus de 100% de plus que l’année 2006, année minima<strong>le</strong> en terme de cumul annuel de la série 2002-2006.Pour l’année 2009 avaient été me<strong>sur</strong>és :- un démarrage extrêmement précoce avec 200 % de plus pour <strong>le</strong> mois d’avril qu’en moyenne2002-2008 et 50 % pour <strong>le</strong> mois de mai,- un niveau maximal en juin jamais atteint depuis <strong>le</strong> début de la série en 2002 (et de 50 %supérieur à la moyenne 2002-2008),- un niveau en fin de saison plus mo<strong>des</strong>te avec 50 % de moins que la moyenne pourseptembre et 7 % de moins <strong>sur</strong> <strong>le</strong> mois d’octobre (<strong>le</strong>s conditions ayant précédé <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol <strong>des</strong>eptembre particulièrement défavorab<strong>le</strong>s aux dépôts <strong>des</strong> algues expliquent, en partie au moins, ceretrait en fin de saison),- un niveau cumulé de 20 % supérieur à la moyenne 2002-2008 et en deuxième positionderrière l’année record 2008 (presqu’identique à 2004 classé en rang 3).L’année 2010 se caractérisait par :- un démarrage régional particulièrement tardif : <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces cumulées régiona<strong>le</strong>s sont en avrilde 70 % inférieures à la moyenne 2002-2009 et en mai encore de près de 60 % inférieures,- un maximum annuel en juin – juil<strong>le</strong>t (va<strong>le</strong>urs identiques) qui est peu intense par rapport auxannées antérieures : plus basse va<strong>le</strong>ur de la série et inférieur de 35 à 40 % par rapport à lamoyenne interannuel<strong>le</strong>,- une diminution à partir de la va<strong>le</strong>ur de juil<strong>le</strong>t qui est <strong>le</strong>nte et amène l’année 2010 à un niveauinférieur de 30 % environ en septembre et octobre.- un niveau cumulé <strong>sur</strong> la saison qui est <strong>le</strong> plus bas de toute la série et de 40 % inférieur lamoyenne 2002-2010. L’année 2010 arrivant après trois années 2007 à 2009 de forte prolifération,apparaît d’autant plus fortement en retrait.Cimav P4 – rapport final mars 2012 52
Figure 13 : évolutions mensuel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces en ulves <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites sab<strong>le</strong>ux en Bretagne faisant l’objet <strong>des</strong>uivis mensuels <strong>sur</strong> la période 2002-2011L’année 2011 se caractérise par :- un démarrage à l’échel<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong> qui est proche de la moyenne interannuel<strong>le</strong>. Cettesituation régiona<strong>le</strong> masque cependant de forte disparités (très faib<strong>le</strong> niveau en baie de SaintBrieuc et <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baie de l’est <strong>des</strong> Côtes d’Armor, niveau plutôt important en baie de Saint Miche<strong>le</strong>n Grève et <strong>sur</strong> la Baie de la Forêt et très supérieur à la norma<strong>le</strong> pour la baie de Douarnenez)- un maximum annuel atteint en mai jusqu’en juil<strong>le</strong>t, peu é<strong>le</strong>vé (-45 % en juin et – 40 % en juil<strong>le</strong>tpar rapport aux même mois de la moyenne 2002-2010),- une diminution marquée à partir de l’inventaire de juil<strong>le</strong>t (facteur trois entre <strong>le</strong> niveau de juil<strong>le</strong>t etcelui de septembre) et un niveau d’arrière saison particulièrement bas (respectivement -70 % et –75 % <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s mois de septembre et octobre)L’analyse de la prolifération par « saison », permet de mettre en évidence <strong>le</strong>s caractéristiquesde l’année en dissociant <strong>le</strong> début de saison en lien avec <strong>le</strong>s conditions hiverna<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>sproliférations de l’année précédente de la fin de saison en lien majoritairement avec <strong>le</strong> niveaunutritionnel de l’année.Cimav P4 – rapport final mars 2012 53
Figure 14 : évolutions annuel<strong>le</strong> et par saison <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces en ulves <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites sab<strong>le</strong>ux en Bretagne faisantl’objet de suivis mensuels <strong>sur</strong> la période 2002-2011L’analyse du cumul annuel (figure 14) et par saison indique pour 2011 :- un début de saison proche du niveau moyen pluriannuel (- 6 % <strong>sur</strong> avril+mai par rapport à2002-2010),- <strong>le</strong> niveau en fin de saison <strong>le</strong> plus bas depuis <strong>le</strong> démarrage <strong>des</strong> suivis (- 60 % <strong>sur</strong>août+septembre),- un niveau cumulé <strong>sur</strong> la saison qui est <strong>le</strong> plus bas de toute la série 2002-2011, plus basmême que 2010 précédent « record ». Sur l’année, <strong>le</strong> cumul 2011 est de 50 % inférieur à lamoyenne 2002-2010. Les deux années 2010 et 2011 apparaissent en très forte rupture parrapport aux trois années antérieures de prolifération très forte. Ces caractéristiques régiona<strong>le</strong>ssont en grande partie liées à la situation de la baie de Saint Brieuc qui a réagit fortement auxdeux dernières années climatiques et qui représente environ 50 % de la <strong>sur</strong>face régiona<strong>le</strong> <strong>sur</strong> sitessab<strong>le</strong>ux.Eléments d’explication <strong>des</strong> caractéristiques régiona<strong>le</strong>s de la marée verte observée en 2011 :Les suivis régionaux mis en place en 2002 mettent en évidence <strong>des</strong> différences très marquées entre <strong>le</strong>sannées de prolifération. Ainsi <strong>sur</strong> la prolifération tota<strong>le</strong> (cumul <strong>des</strong> 7 inventaires <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principauxsites) <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces d’échouage me<strong>sur</strong>ées en 2011 sont plus de deux fois et demi moins importantes (61% de moins) que cel<strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>ées en 2008. L’analyse de la marée verte par saison permet de distinguer<strong>des</strong> variations encore plus importantes : pour <strong>le</strong>s inventaires de fin de saison (août + septembre prisen référence pour indiquer l’importance de la prolifération pendant la période potentiel<strong>le</strong>ment la pluslimitante) l’année 2007 pour laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces <strong>sur</strong> cette période sont <strong>le</strong>s plus fortes est quatre foisplus chargée que 2011, année la plus basse. Pour ce qui est de la précocité de la marée verte (estiméeCimav P4 – rapport final mars 2012 54
en sommant <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> en avril+mai) l’année 2009, année la plus précoce présente 8 foisplus de <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> que l’année 2007, année la moins précoce.Ces variations importantes peuvent être mises en lien avec <strong>le</strong>s caractéristiques climatiques <strong>des</strong>différentes années. Pour cela, il convient de distinguer :- la partie liée aux stocks de début de saison nécessaires au démarrage de la prolifération(« ensemencement ») et à la température de l’eau- la partie liée aux nutriments qui ne peuvent être limitants, dans <strong>le</strong> contexte actuel de niveautrophique, que relativement tard en saison (la précocité de la limitation dépend <strong>des</strong> sites et <strong>des</strong>caractéristiques <strong>des</strong> bassins versants provoquant <strong>des</strong> étiages plus ou moins précoces).Reconduction interannuel<strong>le</strong> et dispersion hiverna<strong>le</strong> :Les suivis depuis 2002 permettent de corré<strong>le</strong>r <strong>le</strong> démarrage de la marée verte d’une année avec <strong>le</strong>niveau atteint en fin d’année précédente.1000Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves en début de saison en fonction <strong>des</strong> <strong>sur</strong>facesatteintes en octobre précédent au niveau régional600<strong>sur</strong>face avril + mai (ha)900800700600500400300200100500400300200100<strong>sur</strong>face octobre n-102002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012somme (avril mai) octobre n-10Figure 15 : Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves en début de saison (avril+mai) et lien avec <strong>le</strong> niveau de couverture de la finde l’année n-1. Les niveaux plus faib<strong>le</strong>s qu’attendus en 2006, 2007 et 2010 s’expliquent par : pour 2006 et 2010<strong>des</strong> températures de l’eau beaucoup plus froi<strong>des</strong> en hiver et en début de saison que la moyenne (environ 1 mois de retard<strong>sur</strong> <strong>le</strong>s températures de l’eau <strong>sur</strong> avril-mai-juin) et pour 2007 <strong>le</strong> côté particulièrement dispersif de l’hiver (3 fois plus dejours de hou<strong>le</strong> de plus de 3 mètres que <strong>le</strong>s 3 années précédentes). Le niveau plus é<strong>le</strong>vé en début 2011 qu’attendupourrait être lié aux caractéristiques de la fin de l’hiver / début de printemps (cf. ci-<strong>des</strong>sous).Le niveau de la fin 2001 a été estimé en se basant <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s suivis qui ne portaient, à cette époque, que <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>des</strong>Côtes d’Armor (suivis réalisés par <strong>le</strong> CEVA <strong>sur</strong> financement du Conseil Général <strong>des</strong> Côtes d’Armor). La méthoded’estimation était différente : pour rendre compatib<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s métho<strong>des</strong>, c’est <strong>le</strong> ratio de la me<strong>sur</strong>e de mi octobre 2001 <strong>sur</strong> <strong>le</strong>maximum annuel de 2001 qui a été utilisé.L’année 2011, montre un démarrage de la prolifération plus précoce que ce que <strong>le</strong> niveaud’octobre laissait attendre. Cette anomalie peut être mise en relation avec <strong>le</strong>s caractéristiques dela fin de l’hiver/début de printemps exceptionnels : temps calme, lumière abondante(données Météo France à Saint Brieuc : 235 heures de so<strong>le</strong>il en avril 2011 contre 136 pour la norma<strong>le</strong>d’avril), température de l’eau supérieure aux norma<strong>le</strong>s à partir de fin mars et débits <strong>des</strong> coursd’eau anorma<strong>le</strong>ment bas impliquant probab<strong>le</strong>ment une moindre turbidité <strong>des</strong> masses d’eau littora<strong>le</strong>sce qui est favorab<strong>le</strong> en cette saison à la croissance <strong>des</strong> algues pour <strong>le</strong>s sites ayant bien conservé <strong>le</strong>ursalgues <strong>sur</strong> <strong>le</strong> début de l’hiver. Tous <strong>le</strong>s sites pour autant n’ont pas eu la même précocité, cel<strong>le</strong>-cidépendant de la situation du stock en début d’hiver et de la réaction pour un site donné auxCimav P4 – rapport final mars 2012 55
caractéristiques hiverna<strong>le</strong>s et printanières. Ainsi <strong>le</strong>s baies de Douarnenez ou Saint Michel en Grèvepar exemp<strong>le</strong> ont vu un démarrage très précoce ce qui n’était pas <strong>le</strong> cas de la baie de Saint Brieuc (dont<strong>le</strong>s stocks en octobre 2010 étaient plutôt bas).La relation de report <strong>des</strong> proliférations entre années, bonne à l’échel<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong> (sous influence <strong>des</strong>quelques gran<strong>des</strong> baies <strong>des</strong> Côtes d’Armor et du Finistère) n’est cependant pas valab<strong>le</strong> <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>ssites, certains redémarrant chaque année de stocks très faib<strong>le</strong>s (ex. Guisseny) ou dont <strong>le</strong> démarragedépend de stocks de sites voisins (ex. Binic).Figures 16 : enso<strong>le</strong>il<strong>le</strong>ment me<strong>sur</strong>é à Saint Brieuc en avril 2011 et norma<strong>le</strong> du mois d’avril (donnée Météo France) etsynthèse annuel<strong>le</strong> enso<strong>le</strong>il<strong>le</strong>ment et pluviométrieSur la figure 15, <strong>le</strong>s années 2006 et 2010 se situent en <strong>des</strong>sous du « niveau attendu ». Cela avait étéexpliqué par <strong>le</strong> niveau de température de début de saison particulièrement bas qui aurait étédéterminant dans <strong>le</strong> retard pris par la prolifération (<strong>le</strong> caractère dispersif de l’hiver / début deprintemps permettait éga<strong>le</strong>ment d’expliquer une partie de ce retard, notamment la hou<strong>le</strong> en mars).Cimav P4 – rapport final mars 2012 56
18.0Situation Référence ESTACADETempératures16.014.012.010.08.0TempératuresT 20066.0JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinMoisJuil<strong>le</strong>tAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreReference Situation ESTACADE2.0Temperature (°C)1.00.0-1.0-0.67-0.99-1.75-0.90-1.55-0.36-0.40-0.45-0.110.861.612.07-2.0JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuil<strong>le</strong>tMonthFigure 17 : données de température de l’eau en baie de Morlaix en 2006 par rapport à la moyenne 1985-2006(données SOMLIT fournies par la Station Biologique de Roscoff)AoûtSeptembreOctobreδT 2006NovembreDécembreFigure 18 : données de température de l’eau en baie de Morlaix entre 2000 et 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> point Astan au fond -60m(données SOMLIT fournies par la Station Biologique de Roscoff). On distingue l’année 2010 dont <strong>le</strong> profil estquasiment identique à l’année 2006 <strong>sur</strong> mars à juil<strong>le</strong>t et même plus froide <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s mois de janvier et février.L’hiver 2010-2011 est pour ce paramètre température de l’eau très atypique : après un débutd’hiver froid (décembre-janvier) <strong>le</strong>s températures sont proches de la moyenne en février puis marset deviennent très supérieures aux norma<strong>le</strong>s à partir d’avril (lien avec <strong>le</strong>s données <strong>des</strong> figures 16).Pour 2007, pour expliquer <strong>le</strong> démarrage retardé de la saison, nous avons recherché <strong>le</strong>s éléments decaractérisation de l’aspect dispersif de l’hiver. Des statistiques de hauteur de hou<strong>le</strong> ont été produites.Cimav P4 – rapport final mars 2012 57
Figure 19 : Statistiques de hou<strong>le</strong> du site Internet Windguru pour <strong>le</strong> site de Lannion (archivage de la dernière prévision dumodè<strong>le</strong> GFS)1009080Hou<strong>le</strong> hiverna<strong>le</strong> <strong>sur</strong> la baie de Lanniondonnées GFS-Windguru-Lannion-Synthèse-novembre à marsnb jour hou<strong>le</strong> > 4,5mnb jour hou<strong>le</strong> entre 3,5 et 4,5mnb jour hou<strong>le</strong> entre 2,5 et 3,57060504030201002003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008* 2008-2009 2009-2010 2010-2011* mars très dispersif : 18 j >2,5 dont 10 >3,5Figure 20 : statistiques de hou<strong>le</strong> du site Internet Windguru pour <strong>le</strong> site de Lannion (archivage de la dernière prévision dumodè<strong>le</strong> GFS) et compilation par catégorie de hauteur de vague. On distingue l’hier 2006-2007 particulièrement dispersif.L’hiver 2009-2010 peut éga<strong>le</strong>ment être considéré comme dispersif <strong>sur</strong>tout si on <strong>le</strong> compare aux années 2003 à 2006.Il ressort de ces données un hiver 2006/2007 particulièrement dispersif : trois fois plus de jours dehou<strong>le</strong> supérieure à 3 m <strong>sur</strong> la période novembre 2006-mars 2007 que pour <strong>le</strong>s trois hivers précédents.Dès <strong>le</strong> mois de novembre on enregistrait un nombre de jour de forte hou<strong>le</strong> important. Le caractèretrès dispersif du mois de mars est probab<strong>le</strong>ment aussi à prendre en compte (contrarie <strong>le</strong> retour ou <strong>le</strong>maintien <strong>des</strong> algues <strong>sur</strong> la zone estran favorab<strong>le</strong> à la croissance). Le caractère dispersif de l’hiver 2009-2010, sans être au même niveau que l’hiver 2006-2007, peut permettre d’expliquer en partie <strong>le</strong>caractère tardif de la prolifération me<strong>sur</strong>ée en 2010. L’hiver 2010-2011 est proche de la« moyenne » et apparaît moins dispersif que <strong>le</strong>s cinq hivers précédents.Cimav P4 – rapport final mars 2012 58
Les flux de nutriments :Jusqu’en 2009, seuls <strong>le</strong>s sites du précédent programme de lutte « Pro<strong>littoral</strong> » faisaient l’objet de suivide <strong>le</strong>ur qualité de l’eau et flux au <strong>littoral</strong>. En 2010, en plus de ces bassins versants a été ajoutée lacompilation <strong>des</strong> données <strong>des</strong> 3 cours d’eau (Gouet Urne Gouessant) se jetant en fond de baie deSaint Brieuc, avec <strong>le</strong>s mêmes métho<strong>des</strong> (calcul <strong>des</strong> débits journaliers, interpolation <strong>des</strong> concentrationsjournalières puis calcul <strong>des</strong> flux journaliers). En 2011, en plus <strong>des</strong> cours d’eau précédents, ont étéajoutés l’Horn et <strong>le</strong> Guil<strong>le</strong>c. Les débits du Frémur ont été recalculés (d’après <strong>le</strong>s débits nouvel<strong>le</strong>mentacquis station liminigraphique de la DREAL, opérationnel<strong>le</strong> depuis mars 2010 ce qui permet d’avoirune chronique de près de 2 ans qui peut être corrélée aux va<strong>le</strong>urs du Frémur de P<strong>le</strong>slin Trigavou).Flux mensuels moyens <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s BV AVmoyenne tous BV <strong>des</strong> sommes mensuel<strong>le</strong>s de flux kg/mois140 000120 000100 00080 00060 00040 00020 00002002*2003*20042005200620072008200920102011moyenne(02-06)moyenne(02-10)Octobre Novembre Décembre Janvier Février M ars Avril M ai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembremoyenne tous BV <strong>des</strong> sommes mensuel<strong>le</strong>s de flux kg/mois60 00050 00040 00030 00020 00010 0000Flux mensuels moyens <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s BV AV2002*2003*20042005200620072008200920102011moyenne(02-06)moyenne(02-10)Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août SeptembreFigure 21 (a) et (b) : Flux moyens mensuels à l’exutoire <strong>des</strong> bassins versants concernés par <strong>le</strong>s proliférations (moyenne<strong>des</strong> flux mensuels <strong>des</strong> 7 cours d’eau alimentant <strong>le</strong>s sites du programme « Pro<strong>littoral</strong> 2002-2006 » + flux <strong>des</strong> trois coursd’eau du fond de baie de Saint Brieuc : Gouessant Urne Gouet + flux de l’Horn + Guil<strong>le</strong>c). La première figure met enévidence <strong>des</strong> flux hivernaux plutôt bas devenant exceptionnel<strong>le</strong>ment bas à partir de février (année la plus basse de lasérie). La deuxième figure présente <strong>des</strong> flux <strong>sur</strong> la période sensib<strong>le</strong> : ces flux sont <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>s mois inférieurs auxdeux séries de référence interannuel<strong>le</strong>s 2002-2009 et 2002-2006 (série de flux plutôt faib<strong>le</strong>s) et à toutes <strong>le</strong>s annéesdepuis 2002.* pour <strong>le</strong>s années 2002 et 2003, <strong>le</strong>s flux ont été calculés sans intégrer <strong>le</strong>s données du Quillimadec (débits manquants).Cimav P4 – rapport final mars 2012 59
Figure 22 : écart de flux mensuel, annuel et saisonnier aux exutoires <strong>des</strong> BV AV par rapport aux années antérieures(moyenne <strong>des</strong> sommes mensuel<strong>le</strong>s pour tous <strong>le</strong>s BV). Sur l’ensemb<strong>le</strong> de la période annuel<strong>le</strong> <strong>le</strong> défaut de flux est de 30 %environ et <strong>sur</strong> la période sensib<strong>le</strong> <strong>le</strong> défaut de flux est de 50 % par rapport à 2002-2006 et 55 % par rapport à 2002-2010.* pour <strong>le</strong>s années 2002 et 2003, <strong>le</strong>s flux ont été calculés sans intégrer <strong>le</strong>s données du Quillimadec (débits manquants).L’année 2011, pour ce qui est de l’estimation <strong>des</strong> flux présentés en figures 21 (a) et (b) apparaîtcomme très exceptionnel<strong>le</strong> : <strong>le</strong>s flux y sont, à partir de février, tous <strong>le</strong>s mois inférieurs auxmoyennes pluriannuel<strong>le</strong> et à toutes <strong>le</strong>s années. Sur la période « sensib<strong>le</strong> » <strong>le</strong>s flux sont de 55 %inférieurs à la moyenne 200-2010. Cependant tous <strong>le</strong>s secteurs n’ont pas connu <strong>des</strong> écarts de fluxaussi importants comme <strong>le</strong> présente l’annexe 6 ce qui s’explique par <strong>le</strong>s fonctionnements de bassinsversants (<strong>sur</strong> <strong>le</strong>s BV schisteux <strong>le</strong>s apports sont très limités <strong>le</strong>s années sèches alors qu’ils sont plus« tamponnés » <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s BV granitiques), éventuel<strong>le</strong>ment la pluviométrie et l’évolution <strong>des</strong>concentrations en nitrates <strong>des</strong> dernières années. A noter aussi <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc <strong>le</strong> fait que laSTEP depuis 2006 rejette beaucoup moins d’azote (NH4) implique <strong>des</strong> apports très inférieurs <strong>le</strong>sannées sèches aux années antérieurs à 2006 (environ 550 kg N/jour en moins <strong>sur</strong> la moyenne 2000-2004 <strong>sur</strong> mai-septembre et 700 kg/jour <strong>sur</strong> l’année).35 000Flux d'azote moyen pour <strong>le</strong>s années 2002 à 2011 et niveau demarée verte annuel (fin saison)160030 0001400Flux (kg/mois)25 00020 00015 00010 0005 00002002* 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Flux moyen N BV AV mai-août<strong>sur</strong>face couverte sites sab<strong>le</strong>ux août+sept (ha)12001000800600400200<strong>sur</strong>face août+sept (ha)1600140012001000800600400Relation Fux N inorganique moyen mai-août et niveau demarée verte en fin de saison (<strong>sur</strong>faces août+sept)y = 0.0432x + 36.588R 2 = 0.91235000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000flux moyen N inorga mai-août (kg/mois)Figures 23 (a) et (b) : Figure 6 a et b : Flux d’azote <strong>sur</strong> la période sensib<strong>le</strong> (moyenne <strong>des</strong> flux de mai à août <strong>sur</strong> <strong>le</strong>sBV de « Pro<strong>littoral</strong> » + baie de Saint Brieuc+ Horn Guil<strong>le</strong>c) et niveau de marée verte atteint en fin de saison (<strong>sur</strong>faceen août+septembre <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages <strong>breton</strong>nes). Les <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>des</strong> algues brunes filamenteuses notamment en2011 en baie de Saint Brieuc (mais aussi depuis plusieurs années <strong>sur</strong> l’est du département <strong>des</strong> Côtes d’Armor) ne sontpas comptabilisées ici.* pour <strong>le</strong>s années 2002 et 2003, <strong>le</strong>s flux ont été calculés sans intégrer <strong>le</strong>s données du Quillimadec (débits manquants).<strong>sur</strong>faces régiona<strong>le</strong> cou<strong>vertes</strong> (ha)Cimav P4 – rapport final mars 2012 60
La carte 11 présente, <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites de type « plage » faisant l’objet d’un suivi mensuel, <strong>le</strong> cumul annuelpar site pour chacune <strong>des</strong> années de suivi depuis 2002 ce qui permet de comparer rapidement laprolifération 2011 pour chaque site aux années antérieures. Si au niveau régional la prolifération 2011est la plus faib<strong>le</strong> depuis <strong>le</strong> début <strong>des</strong> suivis en 2002, la carte permet de visualiser <strong>le</strong>s réactionsdifférenciées <strong>des</strong> sites :- certains sites montre une prolifération très diminuée voire nul<strong>le</strong> en 2011 : pas ou peu d’ulves <strong>sur</strong><strong>le</strong>s baies de l’est <strong>des</strong> Côtes d’Armor, forte régression en 2011 <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc. Anoter <strong>sur</strong> ces secteurs la présence parfois massive d’algues brunes filamenteuses non prises encompte dans <strong>le</strong>s estimations <strong>sur</strong>faciques (cas de la baie de Saint Brieuc qui en cours de saison a vu <strong>le</strong>sulves décliner et <strong>le</strong> Pylaiella s’instal<strong>le</strong>r pour devenir quasiment seul présent en fin de saison). La baiede Saint Michel en Grève et <strong>le</strong> site de Binic/Etab<strong>le</strong>s font partie <strong>des</strong> sites ayant présenté un cumulnettement déficitaire en 2011,- d’autres secteurs par contre présentent une prolifération proche de la moyenne pluriannuel<strong>le</strong> : cas<strong>des</strong> sites du Finistère Nord,- enfin deux secteurs présentent <strong>des</strong> cumuls de couvertures supérieures à très supérieures auxannées moyennes : cas de la baie de Douarnenez et de la baie de la Forêt. Il convient de signa<strong>le</strong>r quedans ces deux baies dont <strong>le</strong> fonctionnement est largement infra<strong>littoral</strong>, la prolifération était déjà trèsfortement installée en avril (quatre fois plus de <strong>sur</strong>faces en avril en fond de baie de Douarnenez etdeux fois plus <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s deux plages du fond de baie de la Forêt). Les caractéristiques très exceptinnel<strong>le</strong>sde la fin de l’hiver / printemps (lumière, faib<strong>le</strong> dispersion et température de l’eau) permettent trèsprobab<strong>le</strong>ment d’expliquer cette implantation précoce au printemps 2011. A noter que <strong>le</strong> site deLarmor Plage dont <strong>le</strong> niveau absolu est très en <strong>des</strong>sous <strong>des</strong> deux sites précédent présente lui aussi uncumul <strong>sur</strong> l’année fortement supérieur à la moyenne <strong>des</strong> années antérieures (quatre fois supérieur).Les fiches de l’annexe 6 permettent pour chaque site de visualiser en quelques photos <strong>le</strong>scaractéristiques de l’année et par <strong>le</strong>s histogrammes <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> de distinguer la part quirevient au démarrage de la saison (précocité) de ce qui est lié à la croissance estiva<strong>le</strong>. L’annexe 7reprend <strong>le</strong>s éléments de caractérisation par secteurs proposés après <strong>le</strong> dernier <strong>sur</strong>vol de 2011(« bul<strong>le</strong>tin d’information au 19 octobre 2011).Cimav P4 – rapport final mars 2012 61
Variation <strong>des</strong> échouages d'ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sitesentre 2002 et 2011 (cumul annuel)TRESTELGUISSENYPORS-GUEN/PORS-MEURBEG LEGUERFRESNAYE**KEREMMABINIC/ETABLES-SUR-MERERQUYLANCIEUXBREHECMOGUERAN/COREJOUHORN/GUILLECLOCQUIRECVAL ANDRESAINT-MICHEL-EN-GREVEBAIE DU MONT-SAINT-MICHELTREZ-HIRFINISTERELes sites principaux sont <strong>sur</strong>volés à marée bassede fort coefficient mensuel<strong>le</strong>ment d’avril à octobre.Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong> échouagesd'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôt sontme<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pasreprésentées ici. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.Quelques sites ont présenté, certaines années(2011 notamment) <strong>des</strong> proliférations d’alguesbrunes filamenteuses non comptabilisées.LIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDKERVEL/TREZMALAOUENCOTES-D'ARMORYFFINIACARGUENONSomme <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces* cou<strong>vertes</strong> (en hectares)par <strong>le</strong>s ulves pour <strong>le</strong>s 7 inventairesde 2002 à 2011 :700 haRYILLE-ET-VILAINE500 haMORBIHANMORIEUX250 ha100 haKERLEVEN/SAINT-LAURENT2002 2003 2004 2005 2006 20072008 2009 2010 2011CABELLOULARMOR-PLAGE* <strong>sur</strong>face tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%** dépôts d’Ulvaria (”ulvoïde”) <strong>sur</strong> la baie de la Fresnaye en2007, 2008 et 2009 intégrés ici comme <strong>sur</strong>faces en ulvesQUIBERON/SABLES BLANCSSeuls <strong>le</strong>s sites de “plage” faisant l’objet d’un suivi mensue<strong>le</strong>ntre avril et octobre sont représentés.Surfaces <strong>des</strong> sites de vasière non représentées.Carte 11
3.2.4. ConclusionsAu niveau régional, <strong>le</strong>s suivis <strong>sur</strong>faciques <strong>des</strong> sites de plage ont montré pour 2011 :- un début de saison proche du niveau moyen pluriannuel (- 6 % <strong>sur</strong> avril+mai par rapport à2002-2010), certains démarrant très précocement (baie de Douarnenez, de Saint Michel en Grèveou de la Forêt) et d’autres plutôt tardivement (Baie de Saint Brieuc),- <strong>le</strong> niveau en fin de saison <strong>le</strong> plus bas depuis <strong>le</strong> démarrage <strong>des</strong> suivis (- 60 % <strong>sur</strong>août+septembre), avec là aussi <strong>des</strong> disparités suivant <strong>le</strong>s secteurs,- un niveau cumulé <strong>sur</strong> la saison qui est <strong>le</strong> plus bas de toute la série 2002-2011, plus basmême que 2010 précédent « record ». Sur l’année, <strong>le</strong> cumul 2011 est de 50 % inférieur à lamoyenne 2002-2010. Les deux années 2010 et 2011 apparaissent en très forte rupture parrapport aux trois années antérieures de très forte prolifération. Ces caractéristiques régiona<strong>le</strong>ssont en grande partie liées à la situation de la baie de Saint Brieuc qui a réagit fortement auxdeux dernières années climatiques et qui représente environ 50 % de la <strong>sur</strong>face régiona<strong>le</strong> <strong>sur</strong> sitessab<strong>le</strong>ux.- Les flux d’azote parvenant au <strong>littoral</strong>, <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites sont en très forte diminution<strong>sur</strong> <strong>le</strong> printemps/été 2011 par rapport à la moyenne <strong>des</strong> années antérieures. Ces diminutions deflux, <strong>sur</strong> certains secteurs et en premier lieu <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc expliquent l’effondrement<strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves (à noter la présence, non prise en compte dans <strong>le</strong>sévaluations <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’ulves, d’algues brunes filamenteuse Pyaliella, comme c’est éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>cas <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies de l’Est du département <strong>des</strong> Côtes d’Armor ; ces algues semb<strong>le</strong> par el<strong>le</strong>-mêmeconfirmer <strong>le</strong> niveau nutritionnel inférieur, l’ulves étant beaucoup plus adaptée aux milieu plusriches en azote). D’autres secteurs, plus saturés par l’azote (cas de l’anse du Dossen, parexemp<strong>le</strong>) n’ont pas été affectés par <strong>le</strong>s moindres flux d’azote de 2011. Enfin certains secteurs aufonctionnement différent (Baie de la Forêt dont la biomasse est largement infralittora<strong>le</strong> et baiede Douarnenez dont une proportion importante peut éga<strong>le</strong>ment se trouver en infra<strong>littoral</strong>) auraitprofité du caractère atypique de la fin de l’hiver/ début du printemps (très lumineux, peudispersif, température de l’eau é<strong>le</strong>vées en début de saison) pour instal<strong>le</strong>r dès <strong>le</strong> début duprintemps une prolifération importante, qui ensuite <strong>sur</strong> ces secteurs à fonctionnement infra<strong>littoral</strong>aurait plutôt mieux supporté <strong>le</strong>s conditions de faib<strong>le</strong>s flux d’azote que <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s gran<strong>des</strong> baiesdécouvrantes.- Pour <strong>le</strong>s secteurs de vasières, <strong>le</strong>s acquisitions réalisées ont été partiel<strong>le</strong>ment validées et <strong>le</strong>srésultats, acquis <strong>sur</strong> 10 masses d’eau et non <strong>sur</strong> toutes <strong>le</strong>s vasières comme <strong>le</strong>s années antérieures,ne seront présentés qu’après validation, dans <strong>le</strong> rapport DCE <strong>sur</strong>veillance (action d’évaluation <strong>des</strong><strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> vasières intégra<strong>le</strong>ment incluse dans ce programme). La simp<strong>le</strong> analysevisuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> photos et <strong>le</strong>s évaluations de <strong>sur</strong>faces (provisoires) semb<strong>le</strong>nt confirmer uneprolifération éga<strong>le</strong>ment en repli <strong>sur</strong> ces milieux, <strong>sur</strong> la saison 2011, et plus particulièrement pour ladeuxième partie de la saison (cas de la Rance, du Go<strong>le</strong> du Morbihan notamment).Cimav P4 – rapport final mars 2012 63
3.3. <strong>Suivi</strong> d’indices d’eutrophisation dans une liste étendue de sites touchés3.3.1- Résultats de suivi <strong>des</strong> quotas azotés dans <strong>le</strong>s différents sitesLes profils saisonniers d’évolution <strong>des</strong> quotas azotés et phosphorés <strong>des</strong> ulves, tels qu’obtenus pour<strong>le</strong>s 21 stations échantillonnées pour l’azote et <strong>le</strong> phosphore, constituent par eux même <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>ursd’indicateur recherchées pour <strong>le</strong> suivi. Ces profils sont présentés dans <strong>le</strong>s graphiques <strong>des</strong> figures 1 à37.3.3.2- Eléments d’interprétation <strong>des</strong> profils saisonniersPour l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites, on observe un profil type de variation saisonnière <strong>des</strong> quotas en azote. Cesquotas sont d’abord, d’une manière généra<strong>le</strong>, toujours é<strong>le</strong>vés en tout début de saison de prolifération(plus de 4 % de la M.S. jusqu’aux premiers jours de mai) : cette situation est norma<strong>le</strong>, résultant (1)d’une disponibilité naturel<strong>le</strong>ment é<strong>le</strong>vée <strong>des</strong> sels nutritifs à la sortie de l’hiver en tout point du <strong>littoral</strong>,(2) d’une demande de la croissance alga<strong>le</strong> encore limitée par la température et la lumière. Les quotasazotés vont ensuite chuter de manière plus ou moins nette et régulière pour atteindre un minimumannuel plus ou moins précoce (de juin à août) et plus ou moins accusé selon <strong>le</strong> site (entre 3% et 1%de la M.S) : cette diminution généralisée <strong>des</strong> quotas internes est norma<strong>le</strong> et attendue en périodeestiva<strong>le</strong> car el<strong>le</strong> correspond à l’augmentation naturel<strong>le</strong> <strong>des</strong> besoins de la croissance <strong>des</strong> algues(photopériode, température) dans un contexte de raréfaction de la ressource nutritive en mer(consommation par <strong>le</strong> bloom phytoplanctonique côtier et baisse saisonnière du flux d’azote pénétrantdans <strong>le</strong>s baies). A partir de la fin août, <strong>le</strong>s quotas azotés augmentent rapidement pour atteindre, dès lafin septembre, <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs hiverna<strong>le</strong>s de plus de 4 % de la matière sèche, en relation essentiel<strong>le</strong>mentavec la diminution norma<strong>le</strong> <strong>des</strong> besoins en sels nutritifs <strong>des</strong> algues (baisse progressive de la croissanceen relation avec cel<strong>le</strong>s de la lumière et de la température) ainsi qu’avec <strong>le</strong> début de reminéralisation enmer de la production phytoplanctonique de l’été.Ce qui variera d’un site à l’autre, c’est la précocité, l’amplitude et la durée de la baisse estiva<strong>le</strong> <strong>des</strong>quotas azotés <strong>des</strong> Ulves. En milieu non eutrophisé, ce minimum estival est norma<strong>le</strong>ment précoce(début mai) et accusé (proche du quota de subsistance), témoignant de la limitation naturel<strong>le</strong> sévèrepar <strong>le</strong>s flux d’azote qui s’applique norma<strong>le</strong>ment à la croissance <strong>des</strong> algues. L’eutrophisation d’un siteest liée à un retard et à un affaiblissement de cet effet limitant naturel (par la persistance de flux quipermettent aux algues de poursuivre <strong>le</strong>ur phase de croissance dans <strong>des</strong> conditions saisonnières delumière et de température de plus en plus favorab<strong>le</strong>s). La nature géologique du sous-sol et <strong>le</strong> typed’occupation <strong>des</strong> sols du bassin versant peuvent jouer un rô<strong>le</strong> aggravant dans <strong>le</strong>s modalitéssaisonnières de restitution <strong>des</strong> pluviosités hiverna<strong>le</strong>s et de transfert de l’azote vers <strong>le</strong> site à marées<strong>vertes</strong>.Le degré d’eutrophisation d’un site (ainsi matérialisé par un profil saisonnier de quotas azotés de sesUlves) pourra donc être caractérisé par l’importance de ces retards saisonniers et affaiblissementsestivaux de l’effet limitant naturel de l’azote <strong>sur</strong> la croissance <strong>des</strong> algues (évolution <strong>des</strong> quotas de Q 0vers Q 1 N, puis au delà…). L’état de saturation (et <strong>sur</strong>saturation) progressive de cette croissance par <strong>le</strong>flux d’azote sera par ail<strong>le</strong>urs un élément important de la résistance potentiel<strong>le</strong> d’un site aux me<strong>sur</strong>espréventives.Les niveaux et tendances saisonnières globa<strong>le</strong>s <strong>des</strong> quotas azotés sont guidés, pour chaque site, parl’évolution, el<strong>le</strong> aussi saisonnière, <strong>des</strong> flux d’azote à l’estuaire. Mais il est aussi possib<strong>le</strong> d’observerparfois, dans un site ou dans un autre, <strong>des</strong> pics dans la composition azotée <strong>des</strong> Ulves pré<strong>le</strong>vées,impossib<strong>le</strong>s à mettre en relation directe avec une baisse momentanée de lumière (contrôlant lacroissance et l’utilisation de l’azote interne), comme avec une augmentation ponctuel<strong>le</strong> de fluxCimav P4 – rapport final mars 2012 64
d’azote. Comme <strong>le</strong>s années précédentes, il est possib<strong>le</strong> de considérer deux hypothèsesprincipa<strong>le</strong>s pour expliquer ces pics de quotas azotés : (1) cel<strong>le</strong> d’une alimentation momentanée enazote de la marée verte par d’autres sources que <strong>le</strong>s rivières débouchant dans la baie (en particulierrelargage de nutriments azotés par <strong>le</strong> sédiment) ; (2) cel<strong>le</strong>, beaucoup plus probab<strong>le</strong>, d’invasion de laplage par <strong>des</strong> Ulves à contenu interne plus é<strong>le</strong>vé car venant de stocks infra littoraux à croissance plus<strong>le</strong>nte sous faib<strong>le</strong> luminosité. Des différences de densité dans <strong>le</strong> rideau même (source d’auto ombrage)pourraient aussi participer à ces irrégularités de composition, en particulier à St Michel en Grève où ila été montré <strong>sur</strong> plusieurs années qu’un pic d’azote interrompait souvent vers juin la <strong>des</strong>centesaisonnière <strong>des</strong> quotas, en relation avec l’existence d’un rideau particulièrement épais.En définitive, l’indicateur nutritionnel de croissance <strong>des</strong> algues (par <strong>le</strong>ur composition chimique),proposé comme base de suivi pour l’évolution pluriannuel<strong>le</strong> de l’eutrophisation, doit avoir unesignification plus large, intégrant deux aspects du niveau d’eutrophisation du site qui évoluent dans <strong>le</strong>même sens :‣ d’une part, la saturation de la croissance <strong>des</strong> algues par <strong>le</strong>s flux d’azote et,‣ d’autre part, <strong>le</strong>s quantités d’algues stockées dans <strong>le</strong> site, en particulier dans l’infra<strong>littoral</strong> etdans <strong>le</strong> rideau, qui engendrent un auto-ombrage favorab<strong>le</strong> au maintien de quotas é<strong>le</strong>vés.Un troisième facteur contrôlant la lumière pourrait être intervenu <strong>sur</strong> <strong>le</strong> long terme : la turbidité <strong>des</strong>eaux côtières, mais nous n’avons actuel<strong>le</strong>ment pas de suivi de ce paramètre.Quoiqu’il en soit, ces « algues d’ombre » à quotas azotés é<strong>le</strong>vés sont en position de consommerrapidement ces quotas dans de la croissance si el<strong>le</strong>s accèdent au cours de la saison à de meil<strong>le</strong>uresconditions de lumière (remontée <strong>des</strong> algues, dispersion du rideau, diminution de turbidité). Ainsi, cesont <strong>des</strong> évolutions à court terme de ces conditions de lumière pour la croissance <strong>des</strong> algues qui sontprobab<strong>le</strong>ment à l’origine principa<strong>le</strong> <strong>des</strong> irrégularités enregistrées dans l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> profilssaisonniers de quotas azotés <strong>des</strong> sites suivis.Les évolutions de quotas phosphorés obéissent en partie aux règ<strong>le</strong>s environnementa<strong>le</strong>s généra<strong>le</strong>s quigouvernent <strong>le</strong>s profils de quotas azotés, expliquant notamment un passage plus ou moins marqué parun minimum de concentration interne en saison de croissance. Les deux paramètres QN et QPpourront aussi présenter <strong>des</strong> oscillations parallè<strong>le</strong>s au grès de variations court terme de la disponibilitéde lumière pour la croissance <strong>des</strong> algues : <strong>le</strong>s quotas phosphorés vont comme <strong>le</strong>s quotas azotésintégrer <strong>le</strong>s variations récentes de luminosité extérieure, <strong>le</strong>s facteurs profondeur et densité de labiomasse…. Les différences de comportement saisonnier de QN et QP seront plutôt à mettre enrelation avec à la nature <strong>des</strong> sources pour <strong>le</strong>s deux éléments. Le phosphore utilisé par <strong>le</strong>s ulves enpériode potentiel<strong>le</strong> de limitation est, en effet, largement d’origine sédimentaire et la progression <strong>des</strong>températures estiva<strong>le</strong>s va d’une manière généra<strong>le</strong> favoriser son flux de relargage. Il peut en résulter<strong>des</strong> remontées très forte de quotas phosphorés <strong>des</strong> ulves en fin de saison estiva<strong>le</strong>, et <strong>des</strong> minimaprécoces, au mois de mai, en situation de flux terrigènes déclinant fortement et de températuresencore proches <strong>des</strong> températures hiverna<strong>le</strong>s. D’autre part, <strong>le</strong>s quotas phosphorés, plus que <strong>le</strong>s quotasazotés, pourront être sensib<strong>le</strong>s aux épiso<strong>des</strong> pluviométriques intenses, <strong>le</strong>squels sont capab<strong>le</strong>sd’entraîner vers la mer <strong>des</strong> quantités de phosphore biodisponib<strong>le</strong> lié au particulaire, et d’engendrer<strong>des</strong> pics de phosphore dans <strong>le</strong>s tissus <strong>des</strong> ulves.3.3.3- Résultats :Les profils saisonniers de composition interne <strong>des</strong> ulves pré<strong>le</strong>vées dans <strong>le</strong>s différents sites sontprésentés figures 1 à 19 pour l’azote, et 20 à 37 pour <strong>le</strong> phosphore.Cimav P4 – rapport final mars 2012 65
3.3.4- Caractéristiques de l’année 2011 :Sur <strong>le</strong> plan <strong>des</strong> flux d’azote en période de croissance <strong>des</strong> algues, l’année 2011 présente à l’échel<strong>le</strong><strong>breton</strong>nes (cf. CIMAV P1 et annexe 9), un profil saisonnier de flux encore plus à la baisse par rapportà la moyenne, que ne l’était déjà celui de 2010. Le cumul de flux d’azote entre mai et août del’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> BVAV n’atteint pas la moitié <strong>des</strong> cumuls de flux moyens enregistrés depuis 2002 pourcette même période. Cette baisse est largement liée aux débits qui ont connus <strong>des</strong> minimashistoriques liés à la faib<strong>le</strong>sse <strong>des</strong> précipitations en fin d’hiver/printemps 2011. Des disparitéssensib<strong>le</strong>s sont cependant à noter entre BV, avec <strong>des</strong> réductions de flux d’azote estivaux par rapport à<strong>le</strong>ur moyenne atteignant 80-85% <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s tributaires de la baie de Saint Brieuc, 70-75% <strong>sur</strong> l’Ic (baie deBinic), 75-85% <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Kerharo (baie de Douarnenez) mais n’étant que de 50-60% <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Yar (baie deSaint Michel en Grève) et <strong>le</strong> Douron (anse de Locquirec), et ne dépassant pas 45-50% <strong>sur</strong> l’Horn-Guil<strong>le</strong>c (anse du Dossen) et 30-35% <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Quillimadec (anse de Guissény).Les conditions de luminosité de l’année 2011 (annexe 8) semb<strong>le</strong>nt présenter deux faits marquantssusceptib<strong>le</strong>s d’influencer <strong>des</strong> courbes de quotas par rapport aux deux années précédentes : un trèsbon éclairement au mois de mai (culminant à plus de 2700 J/cm²/jour), probab<strong>le</strong>ment proche dumaximum possib<strong>le</strong>, suivi d’un très fort déficit dans en première partie de juin, avec une périodeprésentant une irradiation inférieure à 600 J/cm²/jour.Profils de quotas azotés :L’azote est en situation nettement limitante <strong>sur</strong> la durée de la période estiva<strong>le</strong> dans un certain nombrede sites : anse de Moguéran (Fig.10), plage de Fort-Bloqué (Fig.14), Rivière de Vannes/secteurd’Arcal (Fig.8), plage de Penvins (Fig.18), et plus particulièrement dans <strong>le</strong>s deux grands sites à marées<strong>vertes</strong> que sont <strong>le</strong>s baies de Saint Brieuc (Fig.2) et de Concarneau (Fig.13) qui ont toutes deuxprésenté <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs minima<strong>le</strong>s de quotas azotés atteintes dès <strong>le</strong> mois de mai et régulièrementinférieures à 1,5% MS. Les très faib<strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs de quotas, maintenues <strong>sur</strong> une longue période dans <strong>le</strong>sulves de la baie de Saint Brieuc-Lermot (en <strong>des</strong>sous de 1,5 % MS) sont en cohérence avec une annéeclimatique de baisse record <strong>des</strong> flux <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s bassins versants de la baie (Annexe 9), <strong>des</strong> <strong>sur</strong>facesd’échouages (voir projet P4) et <strong>des</strong> besoins de ramassage très en retrait (encore plus qu’en 2010) parrapport à ceux <strong>des</strong> années précédentes. On notera au passage qu’une réduction <strong>des</strong> flux d’azote de80% par rapport à la moyenne pluriannuel<strong>le</strong> donne, comme en 2010 une réponse très nette etimmédiate du système de marée verte, avec même, pour 2011, un remplacement partiel <strong>des</strong> ulves parl’algue brune filamenteuse Piylaiella <strong>littoral</strong>is. Les sites de Binic (Fig.3) et de Brehec (Fig.4), peuventêtre rattachés à ce groupe de sites dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s quotas azotés <strong>des</strong> algues sont sublimitants àlimitants dès <strong>le</strong> mois de mai, tout en présentant <strong>des</strong> niveaux de fin de saison qui deviennent bas etnettement limitants. Le site de Penestin (Fig.19) pourrait être apparenté à cette famil<strong>le</strong> de sites parson profil de quotas qui montre une tendance limitante précoce, mais sans toutefois qu’el<strong>le</strong> ne sepoursuive durant <strong>le</strong> reste de la saison.Les sites de Trestel (Fig.5), Saint Michel en Grève (Fig.6), Dournenez/Sainte-Anne (Fig.12) montrentaussi une période nette de limitation de la croissance <strong>des</strong> algues par l’azote, mais qui s’instal<strong>le</strong> plustardivement, avec passages réguliers sous <strong>le</strong>s quotas critiques seu<strong>le</strong>ment en fin de saison (août).L’azote apparait seu<strong>le</strong>ment en situation sub-limitante (pour cette même période) à Locquirec, (Fig.7),Guissény (Fig.9), l’Aber Wrac’h (Fig.11), Larmor-Plage, (Fig.15), Port Louis – Quélisoy (Fig.16),rivière de Vannes/Séné(Fig.17), avec <strong>des</strong> profils de quotas azotés dans <strong>le</strong>s ulves se rapprochant de2% MS. A noter comme en 2010 une limitation en rade de Port-Louis – Quélisoy assez nette maisrelativement courte.Cimav P4 – rapport final mars 2012 66
La disponibilité de l’azote tout au long de période estiva<strong>le</strong> reste nettement supérieure aux besoins dela croissance <strong>des</strong> algues dans <strong>le</strong>s seuls sites de Rance/Saint Jouan (Fig.1), anse du Dossen (Fig.8) etbaie de Douarnenez/Ry (Fig. 12).Pour l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites suivis, <strong>le</strong>s niveaux de quotas azotés atteints en 2011 par rapport aux autresannées sont cohérents avec <strong>le</strong>s différents niveaux de réductions de flux observés (Annexe 9), saufpeut-être encore pour la baie de Binic où, comme en 2011, la très forte réduction de flux ne s’est pastraduite, comme en baie de Saint Brieuc, par une baisse aussi exceptionnel<strong>le</strong> <strong>des</strong> quotas azotés. Unrégime de lumière particulier pourrait expliquer cette situation de quotas plus é<strong>le</strong>vés qu’attendus(origine profonde <strong>des</strong> algues ou effet d’auto-ombrage d’accumulations). Cette explication pourraitaussi valoir pour comprendre la différence sensib<strong>le</strong> observab<strong>le</strong> entre profils de quotas observab<strong>le</strong>spour l’anse du Ry et la plage Sainte Anne la Palud en baie de Douarnenez (Fig. 13). En l’absence dedonnées de flux à mettre en face <strong>des</strong> fortes va<strong>le</strong>urs de quotas azotés régulièrement enregistrés pourRance/Saint Jouan (Fig. 1), Vannes/Séné (Fig. 12) et dans une certaine me<strong>sur</strong>e pour Rade de Lorient-Port Louis/vasière de Quelisoy (Fig. 16), on peut garder l’hypothèse à priori d’un « effet vasière »,avec relargage de sels nutritifs par <strong>le</strong> sédiment, pour expliquer ces résultats.Profils de quotas phosphorés :Un premier lot de sites présente <strong>des</strong> profils de quotas phosphorés qui sont régulièrement etnettement limitant pour la croissance <strong>des</strong> algues : Moguéran-Coréjou (Fig. 29), Aber Wrac’h (Fig. 30),Concarneau (Fig. 32), Fort-Bloqué (Fig. 33) et Penvins (Fig. 37).Un deuxième lot de sites présente <strong>des</strong> profils régulièrement sublimitants (proches de la barre de quotacritique), avec existence de phases de limitation plus nettes mais ponctuel<strong>le</strong>s : Binic (Fig. 22), Trestel(Fig. 24), Locquirec (Fig. 26), Guissény (Fig. 28), Baie de Douarnenez/Ry (Fig. 31), Larmor-Plage(Fig. 34), et Penestin (Fig. 38).Un dernier lot de sites présente <strong>des</strong> profils globa<strong>le</strong>ment non limitants, même si persistent pourcertains sites <strong>des</strong> possibilités ponctuel<strong>le</strong>s de situations sublimitantes à limitantes au cours de la saison :Rance/Saint Jouan (Fig. 20), Saint Brieuc (Fig. 21), Saint Michel en Grève (Fig. 25), Dossen (Fig. 27),Douarnenez/Saint Anne (Fig. 31), Rade de Lorient-Port Louis (Fig. 35), Vannes/Arcal (Fig. 36),Vannes/Séné (Fig. 36). La baie de Saint Brieuc est <strong>le</strong> seul site dont <strong>le</strong> profil de quotas dépasserégulièrement la barre <strong>des</strong> 0,25% MS, pour atteindre même en fin de saison la va<strong>le</strong>ur de 0,4 %.Toutes <strong>le</strong>s vasières enclavées à sédimentation fine sont aussi présentes dans <strong>le</strong> lot de sites neprésentant pas de limitation en phosphore.On peut observer que seuls <strong>le</strong>s grands sites sab<strong>le</strong>ux historiques de la côte nord présentent <strong>des</strong> profilsde quotas phosphorés s’éloignant franchement <strong>des</strong> niveaux critiques pour la croissance, alors quel’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> petits sites nouvel<strong>le</strong>ment pris en compte (et re<strong>le</strong>vant sans doute plus de marées <strong>vertes</strong>de type 2 – cf projet 3 du CIMAV 2012) présentent <strong>des</strong> limitations phosphorées très nettes. Des sitesun peu plus grands mais à fort environnement rocheux, comme Guisseny (Fig.28), pourraient êtrerattachés à cette catégorie.Pour <strong>le</strong>s sites où <strong>des</strong> données interannuel<strong>le</strong>s de profils de quotas phosphorés sont disponib<strong>le</strong>s (CimavP3 2008, 2009, Cimav P4 2010), il est possib<strong>le</strong> de faire un certain nombre d’observations.o Comme en 2010, autre année basse de flux hydrauliques estivaux, la composition interne enphosphore <strong>des</strong> ulves dans l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites n’a pas présenté en 2011 de profilssensib<strong>le</strong>ment plus bas que ceux <strong>des</strong> années précédentes (2008-2009), alors que ce fut <strong>le</strong> caspour la composition en azote (cf Cimav P4 2010, P4 2011). Cette observation généra<strong>le</strong> tend àCimav P4 – rapport final mars 2012 67
confirmer que la disponibilité de phosphore pour <strong>le</strong>s ulves doit être largement indépendante<strong>des</strong> flux terrigènes de la saison de croissance, et qu’el<strong>le</strong> est plutôt liée à une sourcesédimentaire plus stab<strong>le</strong> d’une année <strong>sur</strong> l’autre. Ainsi, en Baie de Saint Brieuc (Fig.21), <strong>le</strong>squotas phosphorés <strong>des</strong> ulves en saison de marée verte 2011 sont, comme en 2010, équiva<strong>le</strong>ntsà ceux de 2008, et même supérieurs à ceux de 2009 (rapports Cimav P3 2008 et 2009),approchant régulièrement la barre <strong>des</strong> 0,30 % MS en fin de période estiva<strong>le</strong>.o Baie de Binic : on se retrouve en 2011, comme en 2008, en situation sublimitante à limitantepour l’ensemb<strong>le</strong> du profil (Fig.22), mais après être repassé en 2010 par un profil non limitantet globa<strong>le</strong>ment supérieur à 0,2 % MS (il n’y a pas de données pour 2009). Les profils dequotas phosphorés peuvent donc varier d’une année <strong>sur</strong> l’autre, de manière irrégulière etindépendante <strong>des</strong> flux hydrauliques moyens en période estiva<strong>le</strong>, dans <strong>des</strong> conditions defourniture de phosphore par <strong>le</strong> sédiment el<strong>le</strong>s même probab<strong>le</strong>ment variab<strong>le</strong>s et qui ne sontpas aujourd’hui établies.o Baie de Saint Michel en Grève : <strong>le</strong>s profils de quotas internes à sont assez irréguliers àl’échel<strong>le</strong> saisonnière mais comparab<strong>le</strong>s d’une année <strong>sur</strong> l’autre (2008, 2009, 2010 et 2011-Fig.25)o Anse du Dossen : <strong>le</strong> profil montré en 2011 (Fig.27) est différent de celui obtenu en 2008. Cedernier a en effet présenté un minimum sublimitant fin mai, mais a connu par la suite uneélévation progressive et nette, avec <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs atteignant 0,30% MS en fin de saison (finaoût). Peuvent ainsi varier, d’une année <strong>sur</strong> l’autre, non seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s niveaux moyens dequotas (comme en baie de Binic), mais aussi la forme <strong>des</strong> profils.o Baie de Guissény : <strong>le</strong>s profils disponib<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong>s années 2008, 2009 et 2011 (Fig.28), sontcomparab<strong>le</strong>s, évoluant de manière irrégulière de part et d’autre de quotas critiques, sauf pourla fin de saison 2008 où ces quotas ont fortement augmenté (comme dans l’anse du Dossen)o Baie de Douarnenez : <strong>le</strong>s profils disponib<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong>s années 2008, 2009, 2010 et 2011(Fig.31), sont comparab<strong>le</strong>s dans l’anse du Ry, évoluant de manière irrégulière de part etd’autre de quotas critiques au cours de la saison. Le profil correspondant à la plage de SaintAnne, s’est montré assez comparab<strong>le</strong> à celui de l’anse du Ry en 2008 et 2009, mais assezdifférent par la suite, à partir de 2010 et jusqu’en 2011. A partir du mois de juil<strong>le</strong>t en 2010 etdès juin en 2011, on observe à Saint Anne une élévation relative importante <strong>des</strong> quotasphosphorés par rapport au Ry.. Ce découplage est aujourd’hui diffici<strong>le</strong> à interpréter. Il estaussi à noter qu’il est inverse à celui observé depuis 2009 pour <strong>le</strong>s quotas azotés qui sontlimitants en fin de saison <strong>sur</strong> la plage de Saint Anne et pas dans l’anse du Ry (Fig.12).o Baie de Concarneau/Ker<strong>le</strong>ven : <strong>le</strong>s profils disponib<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong>s années 2008, 2009, 2010 et2011 (Fig.32), sont comparab<strong>le</strong>s, évoluant de manière régulière à un niveau très inférieur auxquotas critiques. Cette limitation phosphorée chronique se doub<strong>le</strong> depuis 2008, mais <strong>sur</strong>touten 2010 et 2011 (Fig.13), années de forte réduction de flux terrigènes, d’une limitation azotéeel<strong>le</strong> aussi très nette de la croissance <strong>des</strong> algues <strong>sur</strong> une partie importante de la saison decroissance. Dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s quantités d’algues accessib<strong>le</strong>s à l’observation aérienne sontrestées importante en 2010 et <strong>sur</strong>tout 2011 en baie de Concarneau (Cimav P4), on peut seposer la question de l’effet réel <strong>des</strong> limitations nutritionnel<strong>le</strong>s que font apparaître <strong>le</strong>s quotasinternes azotés comme phosphorés <strong>sur</strong> la production d’algues <strong>vertes</strong>. L’explication tientprobab<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> stock d’algue de la baie de Concarneau est essentiel<strong>le</strong>mentinfra<strong>littoral</strong> (contrairement à la situation observée dans <strong>le</strong>s sites de Nord Bretagne oul’essentiel du stock se trouve dans la zone de balancement <strong>des</strong> marées) et qu’une stratification<strong>des</strong> quotas en fonction de la profondeur (= lumière) a déjà été mise en évidence pour l’azotedans ce site, témoignant d’un faib<strong>le</strong> mélange <strong>des</strong> algues dans la baie en saison de croissance etd’une situation de quotas internes é<strong>le</strong>vés dans <strong>le</strong>s algues de la strate de fond (qui est trèsétendue). Ce gradient n’a pas été vérifié pour <strong>le</strong> phosphore, mais il devrait exister dans lame<strong>sur</strong>e où il est, comme pour l’azote, régulab<strong>le</strong> par <strong>des</strong> dépenses de croissance liées à ladisponibilité de lumière. Les prélèvements pour analyses de quotas se faisant par la plage, ilsCimav P4 – rapport final mars 2012 68
concerneront donc la strate la plus éclairée et la plus appauvrie en N et P de la biomasse dusite. Si <strong>le</strong> stock initial de la marée verte au départ du bloom, comme au cours de la saison, estsuffisamment important et qu’un flux d’algues est possib<strong>le</strong> (sans conduire à la <strong>des</strong>truction dugradient de composition interne) vers <strong>le</strong>s couches supérieures, une biomasse pourra êtreproduite en <strong>sur</strong>face au gré de ce flux, à partir <strong>des</strong> sources d’azote ou de phosphoreparticulières que constituent <strong>le</strong>s quotas é<strong>le</strong>vés <strong>des</strong> algues de profondeurs. Ceux-ci serontimmédiatement mobilisés (ou progressivement érodés en cas de transfert <strong>le</strong>nt vers la <strong>sur</strong>face)avec l’amélioration (bruta<strong>le</strong> ou progressive) <strong>des</strong> conditions lumineuses dans un processus deproduction de biomasse rapidement limité par la faib<strong>le</strong> disponibilité de sels nutritifs dans lamasse d’eau.Cimav P4 – rapport final mars 2012 69
Sites de prélèvements d'UlvesQuotas Azotés et Phosphorés 2011HORN/GUILLECSaint-Pol-de-LeonGUISSENY !
sites courbe N courbe P1 La Rance-St-Jouan-<strong>le</strong>s-guêrets(35) fig1 fig202 Fresnaye (22) - -3 Morieux-Lermot (22) fig2 fig214 Binic (22) fig3 fig225 Brehec (22) fig4 fig236 Trestel (22) fig5 fig247 Saint-Michel en grèves (22) fig6 fig258 Locquirec (29) fig7 fig269 Horn Guil<strong>le</strong>c (29) fig8 fig2710 Guissény(29) fig9 fig2811 Mogueran(29) fig10 fig2912 Aber Wrac'h (22) fig11 fig3013 Douarnenez-Ste-Anne(29)14 Douarnenez-Le Ry(29)fig12 fig3115 Concarneau-ker<strong>le</strong>ven(29) fig13 fig3216 Fort Bloqué (56) fig14 fig3317 Larmor Plage (56) fig15 fig3418 Lorient - Port louis(56) fig16 fig3519 Vannes-Arcal(56)20 Vannes-Séné(56)fig17 fig3621 Penvins (56) fig18 fig3722 Penestin - La Mine d'Or (56) fig19 fig38255 prélèvements réalisés du 18/04/2011 au 31/08/201110 tournées de prélèvements, avec 20 sites et 22 prélèvements3 tournées avec 12 sites et 14 prélèvements
Azote kjeldahl en % de MSUlva armoricana5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 1 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves dans l'estuaire de La Rance - mouillage de St Jouan en 2011Azote kjeldahl en % de MSUlva armoricana5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 2 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves en baie de St Brieuc - plage de Lermot en 2011.
Azote kjeldahl en % de MS5.0Ulva armoricanaBinic4.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 3 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves à Binic en 2011.Azote kjeldahl en % de MS5.04.5Ulva armoricanaUlva rotundataBréhec4.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 4 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves dans l'anse de Bréhec en 2011.
Azote kjeldahl en % de MSUlva armoricana5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 5 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves à Trestel en 2011.Azote kjeldahl en % de MSulva armoricana5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 6 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves en baie de Saint Michel-en-Grève en 2011.Jour
Azote kjeldahl en % de MSUlva armoricana5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 7 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves dans l'anse deLocquirec en 2011.Azote kjeldahl en % de MSUlva armoricana - Horn-Guil<strong>le</strong>c5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 8 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves dans l'anse du Dossen en 2011.
Azote kjeldahl en % de MS5.04.5Ulva armoricanaUlva rotundataGuissény4.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 9 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves dans l'anse de Guissény - plage du club nautique en 2011Azote kjeldahl en % de MSUlva armoricana5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 10 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves dans l'anse de Moguéran-Coréjou en 2011.Jour
Azote kjeldahl en % de MSUlva armoricana5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 11 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves dansl'estuaire de l'Aber Wrac'h (baie de Keridaouen) en 2011.Azote kjeldahl en % de MS5.0Ulva armoricana - Le RyUlva armoricana - Sainte-Anne La Palud4.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 12 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés<strong>des</strong> Ulves en baie de Douarnenez en 2011.Jour
Azote kjeldahl en % de MS5.04.5Ulva armoricanaUlva rotundataConcarneau4.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 13 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves dansl'estuaire en Baie de Concarneau - plage de Ker<strong>le</strong>ven en 2011.Azote kjeldahl en % de MS5.0Ulva armoricanaUlva rotundataFort Bloqué4.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 14 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves de la plagede Fort Bloqué en 2011.
Azote kjeldahl en % de MS5.0Ulva armoricanaUlva rotundataLarmor-Plage4.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 15 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves àLarmor-Plage (plage de Toulhars-Nourriguel) en 2011.Azote kjeldahl en % de MSUlva armoricana5.04.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 16 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves dans la Radede Lorient-Port Louis - vasière du Quélisoy en 2011.Jour
Azote kjeldahl en % de MS5.0Ulva armoricana - ArcalUlva armoricana - Séné4.54.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 17 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves dans larivière de Vannes en 2011Azote kjeldahl en % de MS5.04.5Ulva rotundataUlva rigidaPenvins4.03.53.02.52.0Q 1 N1.51.0Q 0 N0.50.091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 18 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves à la pointe dePenvins (plage de Penvins) en 2011Jour
Azote kjeldahl en % de MS5.004.50Ulva rotundataUlva sp.Penestin4.003.503.002.502.00Q 1 N1.501.00Q 0 N0.500.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 19 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas azotés <strong>des</strong> Ulves àPenestin - plage du Poudrantais en 2011
Phosphore total en % de MSUlva armoricana0.500.450.400.350.300.250.200.150.10Q 1 P0.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 20 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves dans l'estuaire de La Rance - mouillage de St Jouan en 2011Phosphore total en % de MSUlva armoricana0.500.450.400.350.300.250.200.15Q 1 P0.100.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 21 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves en baie de St Brieuc - plage de Lermot en 2011.
Phosphore total en % de MS0.55Ulva armoricanaBinic0.500.450.400.350.300.250.200.15Q 1 P0.100.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 22 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves à Binic en 2011.Phosphore total en % de MS0.500.45Ulva armoricanaUlva rotundataBréhec0.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 23 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves dans l'anse de Bréhec en 2011.
Phosphore total en % de MSUlva armoricana0.500.450.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 24 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves à Trestel en 2011.Phosphore total en % de MSulva armoricana0.500.450.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 25 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves en baie de Saint Michel-en-Grève en 2011.Jour
Phosphore total en % de MSUlva armoricana0.500.450.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 26 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves dansl'anse de Locquirec en 2011.Phosphore total en % de MSUlva armoricana - Horn-Guil<strong>le</strong>c0.500.450.400.350.300.250.200.15Q 1 P0.100.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 27 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves dans l'anse du Dossen en 2011.
Phosphore total en % de MS0.50Ulva armoricanaUlva rotundata0.450.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 28 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves dans l'anse de Guissény - plage du club nautique en 2011Phosphore total en % de MSUlva armoricana0.500.450.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 29 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves dans l'anse de Moguéran-Coréjou en 2011.Jour
Phosphore total en % de MSUlva armoricana0.500.450.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 30 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves dansl'estuaire de l'Aber Wrac'h (baie de Keridaouen) en 2011.Phosphore total en % de MS0.50Ulva armoricana - Le RyUlva armoricana - Sainte-Anne La Palud0.450.400.350.300.250.200.15Q 1 P0.100.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 31 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés<strong>des</strong> Ulves en baie de Douarnenez en 2011.Jour
Phosphore total en % de MS0.500.45Ulva armoricanaUlva rotundataConcarneau0.400.350.300.250.200.15Q 1 P0.100.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 32 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves dansl'estuaire en Baie de Concarneau - plage de Ker<strong>le</strong>ven en 2011.JourPhosphore total en % de MS0.50Ulva armoricanaUlva rotundataFort Bloqué0.450.400.350.300.250.200.15Q 1 P0.100.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 33 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves de laplage de Fort Bloqué en 2011.
Phosphore total en % de MS0.50Ulva armoricanaUlva rotundataLarmor-Plage0.450.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 34 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves àLarmor-Plage (plage de Toulhars-Nourriguel) en 2011.Phosphore total en % de MSUlva armoricana0.500.450.400.350.300.250.200.15Q 1 P0.100.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 35 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves dans laRade de Lorient-Port Louis - vasière du Quélisoy en 2011.Jour
Phosphore total en % de MS0.50Ulva armoricana - ArcalUlva armoricana - Séné0.450.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 36 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves dans larivière de Vannes en 2011Phosphore total en % de MS0.500.45Ulva rotundataUlva rigidaPenvins0.400.350.300.250.200.15Q 1 P0.100.05Q 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 37 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves à lapointe de Penvins (plage de Penvins) en 2011Jour
Phosphore total en % de MS0.500.45Ulva rotundataUlva sp.Penestin0.400.350.300.250.200.150.100.05Q 1 PQ 0 P0.0091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREFigure 38 : Evolution saisonnière <strong>des</strong> quotas phosphorés <strong>des</strong> Ulves àPenestin - plage du Poudrantais en 2011
3.4. Evaluation <strong>des</strong> stocks totauxLes dates de missions <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s différents sites sont synthétisées dans la partie 2.5. - Missions réalisées.‣ Biomasses estiva<strong>le</strong>s maxima<strong>le</strong>s :L’annexe 10 présente <strong>le</strong> détail de l’évaluation réalisée en été <strong>sur</strong> la baie Saint Michel en Grève.Le tab<strong>le</strong>au ci-<strong>des</strong>sous synthétise l’estimation de biomasses :Secteurs côtiers concernés Infra<strong>littoral</strong> Estran Rideau TotalBaie de Saint Michel en Grève100 T 1850 850 2 800 TEstimation en 2011 <strong>des</strong> stocks totaux estivaux du seul secteur prospecté (en Tonnes d’algues égouttées 1 minute)Les me<strong>sur</strong>es infralittora<strong>le</strong>s ont été réalisées du 27 juin au 1 er juil<strong>le</strong>t 2011. Le détail <strong>des</strong> points deprélèvements et <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs ponctuel<strong>le</strong>s re<strong>le</strong>vées est présenté <strong>sur</strong> la première carte de l’annexe 10. Onpeut voir <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs nul<strong>le</strong>s ou très faib<strong>le</strong>s (- de 10 g) <strong>sur</strong> la plupart <strong>des</strong> points échantillonnés. Lesbiomasses ne sont notab<strong>le</strong> (10 à 100 g) que dans la continuation <strong>des</strong> dépôts de plage et du rideau,plutôt côté est <strong>sur</strong> la baie de Saint Michel en Grève et au nord, nord-ouest <strong>sur</strong> l’anse de Locquirec.Les interpolations de ces va<strong>le</strong>urs ponctuel<strong>le</strong>s à l’échel<strong>le</strong> de la masse prospectée conduisent à un stocktotal estimé <strong>sur</strong> la baie pour la partie infra<strong>littoral</strong> autour de 100 T (biomasses fraiche, algues égouttée1 minute). Cette estimation est en retrait par rapport aux deux estimations précédentes qui étaient de400 et 300 T (respectivement en septembre 2006 et juil<strong>le</strong>t 2003).Le 1 er juil<strong>le</strong>t l’estimation <strong>sur</strong> estran conduit à un stock de 2 700 T (en incluant <strong>le</strong> rideau à la va<strong>le</strong>ur« estran »). La carte en annexe 10 présente la position <strong>des</strong> dépôts ainsi que <strong>le</strong>s densités moyennes partypologie re<strong>le</strong>vées.Ce niveau est proche de celui re<strong>le</strong>vé en 2010 (évaluation pour LTA <strong>le</strong> 28 juin à 2 700T pour la partestran, biomasse infra<strong>littoral</strong> non estimée) qui était plutôt une année de faib<strong>le</strong> prolifération, et lors <strong>des</strong>deux me<strong>sur</strong>es de 2003 et 2006 (me<strong>sur</strong>es pour Pro<strong>littoral</strong> respectivement de 2 400 T et 2 500 T pourjuil<strong>le</strong>t 2003 et septembre 2006) éga<strong>le</strong>ment à <strong>des</strong> période de prolifération plutôt modérée. Par contrece niveau est nettement inférieur aux me<strong>sur</strong>es antérieures (95 à 2001) pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s biomassesétaient <strong>le</strong> plus souvent estimées entre 3 500 et 4 000T.D’après ces estimations la part <strong>des</strong> biomasses infra<strong>littoral</strong> du site <strong>sur</strong> <strong>le</strong> total (<strong>sur</strong>estimée dans lame<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s biomasses en dépôts <strong>sur</strong> Locquirec ne sont pas intégrées ; cependant d’après <strong>le</strong>urs<strong>sur</strong>faces à cette date <strong>le</strong>ur intégration ne modifierait pas fondamenta<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> résultat) serait de moinsde 5 % ce qui est inférieur aux me<strong>sur</strong>es antérieures (autour de 15 %). Trois hypothèses peuventêtre avancées :- <strong>le</strong> niveau plutôt limité <strong>des</strong> biomasses tota<strong>le</strong>s qui engendre une fraction infralittora<strong>le</strong> inférieure(moins de « débordement » du site),- <strong>des</strong> conditions lors de ce <strong>sur</strong>vol particulièrement favorab<strong>le</strong>s aux dépôts donc peu favorab<strong>le</strong>s àl’éloignement <strong>des</strong> algues vers l’infra<strong>littoral</strong>,- <strong>le</strong> ramassage accru <strong>des</strong> algues et notamment <strong>le</strong>s expérimentations de prélèvement <strong>des</strong> algues dans <strong>le</strong>rideau, en cours <strong>le</strong> jour de l’estimation et <strong>le</strong>s jours l’ayant précédée, qui pourrait limiter la dispersion<strong>des</strong> algues dans l’infra <strong>littoral</strong>.Cimav P4 – rapport final mars 2012 93
‣ Biomasses hiverna<strong>le</strong>s minima<strong>le</strong>s :L’annexe 11 présente <strong>le</strong>s résultats <strong>des</strong> deux missions réalisées.Secteurs côtiers concernés Infra<strong>littoral</strong> Estran Rideau TotalSite de type « plage »Site de vasièreBaie de SaintMichel en Grève- * 90 T 10 T 100 T**Anse du Lédano Pas de me<strong>sur</strong>e 30-75 T ***0 (pas de rideau<strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières)30-75 T ***Estimation en hiver 2011-2012 <strong>des</strong> stocks totaux hivernaux <strong>des</strong> différents secteurs (en Tonnes d’algues égouttées 1 minute).* prospection prévue uniquement <strong>sur</strong> plage <strong>sur</strong> ce secteur à une période où <strong>le</strong>s stocks semb<strong>le</strong>nt largement échoués ce qui était <strong>le</strong> cas <strong>le</strong> 7 février 2011** <strong>le</strong> 12 mars, dans <strong>des</strong> conditions relativement favorab<strong>le</strong>s au dépôt <strong>le</strong>s stocks perceptib<strong>le</strong>s étaient très inférieurs, de l’ordre de 35 T.*** prospections sommaires <strong>sur</strong> l’anse du Lédano <strong>le</strong> 26 janvier puis <strong>sur</strong>vol <strong>le</strong> 7 février dans <strong>le</strong> but de déterminer <strong>des</strong> lieux de présence + idée de biomasse ponctuel<strong>le</strong>mais pas d’évaluation à l’échel<strong>le</strong> du site prévue initia<strong>le</strong>ment. Les me<strong>sur</strong>es effectuées permettent cependant d’évaluer une biomasse qui se situerait entre 30 et 75 TLa réalisation <strong>des</strong> plongées est généra<strong>le</strong>ment délicate l’hiver (température de l’eau mais <strong>sur</strong>toutconditions de plongée délicates : hou<strong>le</strong> + turbidité forte de l’eau). IL a été proposé dans <strong>le</strong> cadre duprogramme 2011 de réaliser une évaluation <strong>des</strong> seuls stocks échoués <strong>sur</strong> l’estran + rideau de la baiede Saint Michel en Grève dans <strong>des</strong> conditions météorologiques particulièrement favorab<strong>le</strong>s à ceséchouages estimant qu’alors <strong>le</strong>s part infra littora<strong>le</strong>s devraient être relativement faib<strong>le</strong>s. Baie de Saint Michel en Grève :Le 7 février <strong>des</strong> acquisitions aériennes et de terrain simultanées ont permis d’évaluer un stock totaldans la baie autour de 100 T dont 10 en rideau. L’annexe 11 reporte <strong>le</strong>s résultats de cette évaluation.A cette date, <strong>le</strong>s algues sont de très petite tail<strong>le</strong> (moins d’un cm pour la plupart <strong>des</strong> fragments), enmélange avec du goémon et autres débris végétaux terrestres. Les algues brunes majoritaires en hautd’estran deviennent plus faib<strong>le</strong>s vers <strong>le</strong> bas de l’estran et <strong>le</strong> rideau (autour de 70 % d’ulves en basd’estran). Ce stock semb<strong>le</strong> du même ordre qu’en février 2011 (estimation <strong>le</strong> 18 février 2011 entre 50et 100 T alors que <strong>le</strong> 24 janvier 2011 <strong>le</strong> stock semblait beaucoup plus important, de l’ordre de 500 à1000 T), très inférieur au niveau de février 2009 (autour de 1000T <strong>le</strong> 27 février 2009) et de 2004(environ 500 T dont 100 en infra<strong>littoral</strong> <strong>le</strong> 3 mars 2004).A noter que la biomasse estimée <strong>le</strong> 7 février 2012 semb<strong>le</strong> encore en diminution et ne serait pas <strong>le</strong>stock minimal de reconduction : une évaluation sommaire (sans l’appui de <strong>sur</strong>vol) réalisée un moisplus tard, <strong>le</strong> 13 mars 2012 conduit à une évaluation de l’ordre de 35 T au lieu de 100 T estimée <strong>le</strong> 7février. Un <strong>sur</strong>vol (mais sans évaluation de biomasse) réalisé <strong>le</strong> 3 mars 2010 montre une situation quisemb<strong>le</strong> assez comparab<strong>le</strong> à cel<strong>le</strong> perçue <strong>le</strong> 12 mars 2012. La perception hiverna<strong>le</strong> est donc rendued’autant plus délicate que <strong>le</strong>s minimums hivernaux ne sont pas forcément aux mêmes pério<strong>des</strong>, ladiminution / l’augmentation <strong>des</strong> stocks étant très dépendantes <strong>des</strong> conditions hiverna<strong>le</strong>s (dispersionplus ou moins grande, température de l’eau, éventuel<strong>le</strong>ment lumière).De plus, il convient de rappe<strong>le</strong>r que la seu<strong>le</strong> perception <strong>des</strong> stocks visib<strong>le</strong>s en aérien (estran + rideau)ne peut garantir que l’on évalue réel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> stock total minimum ; la part infra<strong>littoral</strong> pouvant êtreimportantes en hiver. On peut néanmoins estimer que la me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> stocks estran + rideau donneune idée de l’importance relative de ces stocks si <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es sont bien engagées dans <strong>des</strong> pério<strong>des</strong>calmes, favorab<strong>le</strong> au dépôt <strong>des</strong> algues. Vasière du Lédano :Pour la première fois une évaluation de la situation hiverna<strong>le</strong> était proposée pour cette vasière. Desprospections de terrain se sont déroulées <strong>le</strong> 26 janvier 2012 et <strong>le</strong>s photos du <strong>sur</strong>vol du 7 février ontété utilisées pour mieux évaluer <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> (après validation que la situation du 7 févrierCimav P4 – rapport final mars 2012 94
était semblab<strong>le</strong> en position et apparence <strong>des</strong> dépôts que ce qui avait été me<strong>sur</strong>é <strong>le</strong> 26 janvier). Lesprospections envisagées initia<strong>le</strong>ment devaient permettre de localiser d’éventuels stocks et de qualifier<strong>le</strong>s biomasses ponctuel<strong>le</strong>s de ces dépôts. Cependant, <strong>le</strong>s zones cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves ont étélocalisées aisément et se sont avérées suffisamment homogènes pour qu’une évaluation de labiomasse tota<strong>le</strong> soit proposée. Sur <strong>le</strong> secteur, <strong>le</strong>s tapis d’ulves libres ont été identifiés en haut devasières, proches <strong>des</strong> schorres <strong>sur</strong> la partie sud de l’anse, en rive droite et gauche. Les dépôts sontlocalisés et de relativement faib<strong>le</strong> extension (environ 1 ha) mais épais (biomasses de 2 à 7 kg/m2). Labiomasse tota<strong>le</strong> est estimée entre 30 et 75 T pour l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> dépôts d’ulves. A noter, en plus <strong>des</strong>tapis d’ulves, la présence d’algues <strong>vertes</strong> filamenteuse et de plantu<strong>le</strong>s d’Ulvaria obscurum sous formefixée à <strong>des</strong> cailloutis. Eléments complémentaires <strong>sur</strong> la situation hiverna<strong>le</strong> :En plus <strong>des</strong> évaluations présentées ci <strong>des</strong>sus <strong>le</strong> CEVA a réalisé un <strong>sur</strong>vol <strong>le</strong> 7 février <strong>sur</strong> certainssecteurs complémentaires : baie de Douarnenez, baie de Locquirec, de Saint Michel en Grève, deBinic/Etab<strong>le</strong>s, de Saint Brieuc et de la Fresnaye – Lancieux. Sur l’ensemb<strong>le</strong> de ces secteurs, seu<strong>le</strong> labaie de Saint Michel en Grève comportait <strong>des</strong> quantités d’ulves notab<strong>le</strong>s. A noter (mais nous avonspeu de référence de suivi l’hiver) qu’il est habituel que <strong>le</strong>s sites ne présentent pas d’algues à cettepériode de l’année. Le fait <strong>le</strong> plus marquant est la présence encore massive à cette période de Pylaiella<strong>littoral</strong>is <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc. La baie de la Fresnaye en comportait éga<strong>le</strong>ment de grossesquantités mais c’est depuis plusieurs années <strong>le</strong> cas, donc moins <strong>sur</strong>prenant.Des prospections complémentaires de terrain ont été régulièrement réalisées à partir de la fin janvieret jusqu’au 12 mars <strong>sur</strong> la baie de la Fresnaye, de Saint Brieuc et une mission fin février a concernéeéga<strong>le</strong>ment la baie de la Forêt et cel<strong>le</strong> de Douarnenez. Il en ressort :- en baie de Saint Brieuc : <strong>le</strong>s gros stocks de Pylaiella re<strong>le</strong>vés en fin janvier et jusqu’en fin févriersont au début mars (mission <strong>le</strong> 8 mars 2012) beaucoup plus limités ce qui est probab<strong>le</strong>ment enlien avec <strong>des</strong> conditions moins favorab<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> maintien <strong>des</strong> biomasses dans la baie,- en baie de la Fresnaye, <strong>le</strong> Pylaiella est largement présent jusqu’à la dernière prospection <strong>le</strong> 12 mars,- en baie de la Forêt, <strong>le</strong> 27 février <strong>le</strong>s échouages d’ulve sont très massifs <strong>sur</strong>tout <strong>sur</strong> Ker<strong>le</strong>ven maiséga<strong>le</strong>ment <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Cabellou. Par ail<strong>le</strong>urs <strong>des</strong> témoignages et de nombreuses photos nous sontparvenues de riverains attestant la présence très marquée d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Fond de baie y compris endébut mars. Ces stocks importants sont à mettre en relation avec <strong>le</strong> très fort niveau re<strong>le</strong>vé <strong>sur</strong> labaie durant toute la saison 2011, jusqu’en octobre et aux conditions hiverna<strong>le</strong>s 2011-2012 très peudispersives <strong>sur</strong> la baie,- en baie de Douarnenez, <strong>le</strong>s propection du 27 févier ont permis de re<strong>le</strong>ver la présence à un faib<strong>le</strong>niveau d’ulve <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Ry et dans l’anse de Ty Mark (tapis et rideau assez dense mais <strong>sur</strong> un secteurde faib<strong>le</strong> superficie). Le fait de trouver <strong>des</strong> échouages <strong>sur</strong> cette pointe pourrait témoigner <strong>des</strong>tocks infralittoraux non échoués <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s gran<strong>des</strong> plages dé couvrantes.En l’absence de références pluri annuel<strong>le</strong>s ces observations ponctuel<strong>le</strong>s sont assez diffici<strong>le</strong> à exploiterpour la prévision du démarrage de la saison 2012.Cimav P4 – rapport final mars 2012 95
‣ ConclusionLes évaluations en biomasse en 2011 permettent de re<strong>le</strong>ver :- Des stocks totaux en été 2011 <strong>sur</strong> la baie de Saint Michel en Grève de 2 800 T dont moins de 5 %en infra<strong>littoral</strong>. Ce niveau de biomasse est équiva<strong>le</strong>nt à celui me<strong>sur</strong>é à la même période de 2010 etinférieur aux me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong> années 95-2001 confirmant un niveau plutôt en retrait <strong>sur</strong> la baie, ce quipeut être relié aux ramassages accrus et aux niveaux de flux bas en 2011,- Le niveau de stock résiduel hivernal estimé <strong>sur</strong> la baie de Saint Michel en Grève autour de100 T <strong>le</strong> 7 février pour sa partie déposée ou en rideau est comparab<strong>le</strong> à la me<strong>sur</strong>e de 2010 (18février) et très inférieur à la me<strong>sur</strong>e 2009 qui conduisait à un chiffre de l’ordre de 10 foissupérieur. Cependant une évaluation « rapide » début mars conduisait à un chiffre nettement plusbas, probab<strong>le</strong>ment de l’ordre de 35 T ce qui serait proche du niveau perceptib<strong>le</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos demars 2010.- L’évaluation <strong>sur</strong> la baie du Lédano indique <strong>des</strong> biomasses d’ulves très localisées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Sud del’anse, en tapis épais. A l’échel<strong>le</strong> de l’anse la biomasse est estimée entre 30 et 75 T.- Un <strong>sur</strong>vol et <strong>des</strong> contrô<strong>le</strong>s de terrain <strong>sur</strong> certains sites <strong>breton</strong>s montrent <strong>des</strong> situationscontrastées : <strong>le</strong>s baies de Saint Brieuc et de la Fresnaye ne présentent pas, jusqu’en débutmars, d’ulve en quantité significative mais sont encore touchées par <strong>des</strong> échouages massifs dePylaiella (beaucoup plus faib<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> Saint Brieuc lors de la dernière me<strong>sur</strong>e du 8 mars que lors <strong>des</strong>évaluations de février). La baie de Douarnenez ne présente pas jusqu’en fin février de quantitétrès notab<strong>le</strong>s d’ulves ce qui est, a priori, plutôt habituel <strong>sur</strong> ce secteur. Tandis que <strong>le</strong> secteur de labaie de la Forêt est massivement touché par <strong>des</strong> échouages d’ulves (jamais noté à un telniveau <strong>sur</strong> la baie d’après <strong>le</strong>s riverains), reliquat de la forte prolifération de 2011.Cimav P4 – rapport final mars 2012 96
4. CONCLUSIONLes différents suivis réalisés <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> permettent de caractériser l’année 2011.• Les dénombrements <strong>des</strong> sites mettent en évidence une prolifération précoce (76 sites enmai), relativement peu intense en nombre de sites maximum en juil<strong>le</strong>t (79) et particulièrementbas en septembre (55). Cette situation, avec notamment beaucoup de sites en mai et juil<strong>le</strong>tgénère pour l’indicateur « nombre total de sites <strong>sur</strong> l’année » un niveau plutôt é<strong>le</strong>vé (102),mais un niveau plus mo<strong>des</strong>te (84) si on se concentre <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 2 inventaires d’été. On note, enoutre, que <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> sud est plutôt plus représenté en 2011 que <strong>le</strong>s lors <strong>des</strong> annéesantérieures.• Les suivis <strong>sur</strong>faciques permettent d’affiner la perception de l’année : après un démarrage<strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites sab<strong>le</strong>ux qui est proche de la moyenne pluri annuel<strong>le</strong> (- 6 %pour la somme avril+mai), <strong>le</strong> niveau maximal en juin et juil<strong>le</strong>t est resté beaucoup plusmodéré que la moyenne <strong>des</strong> années 2002-2010 et même inférieur au niveau particulièrementbas me<strong>sur</strong>é en 2010. Après ce maximum annuel, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces s’effondrent (divisées par troisentre juil<strong>le</strong>t et septembre) amenant <strong>le</strong> niveau d’août + septembre à son plus bas niveaudepuis <strong>le</strong> démarrage <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es (-60% par rapport à la moyenne). Le niveau cumulé <strong>sur</strong>l’année est alors <strong>le</strong> plus bas <strong>sur</strong> la série 2002-2011 et est 50 % inférieur à la moyenne2002-2010. Cela est en grande partie lié à la situation de la baie de Saint Brieuc dont laprolifération d’ulves n’est pas monté très haut puis s’est effondrée ; <strong>le</strong>s ulves étant en fin <strong>des</strong>aison quasiment absentes et <strong>le</strong> Pylaiella <strong>littoral</strong>is, algue brune filamenteuse largementdominante (non prise en compte dans <strong>le</strong>s évaluations de <strong>sur</strong>faces). Cette situation est inédite(au moins pour ce qui est <strong>des</strong> 10 ou 20 dernières années). A noter <strong>des</strong> réactionsdifférenciées par secteurs, certaines baies (baie de la Forêt, de Douarnenez) étant en 2011touchées par <strong>des</strong> échouages nettement plus importants que la moyenne <strong>des</strong> années antérieures.Le fonctionnement particulier de ces baies dont la biomasse est largement infralittora<strong>le</strong> et <strong>le</strong>scaractéristiques très particulières de la fin de l’hiver / début du printemps expliquentprobab<strong>le</strong>ment ces particularités.• La prolifération 2011 peut être mise en relation avec <strong>le</strong>s caractéristiques climatiques de2011 : fin d’hiver/printemps très lumineux, peu dispersif (vent/hou<strong>le</strong>), très peu pluvieux etavec <strong>des</strong> températures de l’eau supérieures aux norma<strong>le</strong>s. Ces conditions sont favorab<strong>le</strong>s à lacroissance <strong>des</strong> algues très tôt en saison pour <strong>le</strong>s sites ayant bien conservé <strong>le</strong>urs alguesmais deviennent défavorab<strong>le</strong> à la croissance <strong>des</strong> algues en p<strong>le</strong>in été (flux très bas parrapport à la moyenne inter annuel<strong>le</strong> en lien avec <strong>des</strong> débits très bas) <strong>sur</strong>tout pour <strong>le</strong>s sites <strong>le</strong>smoins saturés en azote. Cela explique la forte réaction de la baie de Saint Brieuc dont <strong>le</strong>sflux estimés <strong>sur</strong> mai-août sont de plus de 80 % inférieurs à la moyenne <strong>des</strong> annéesantérieures.• L’analyse <strong>des</strong> teneurs internes en azote montre <strong>des</strong> situations très différentes <strong>des</strong> algues visà-visde <strong>le</strong>ur nutrition azotée. Certains secteurs ont été en 2011 fortement et précocementlimités par l’azote (baie de Saint Brieuc, Baie de la Forêt, Binic), d’autres secteurs ont connuune période de limitation marquée mais plus tardive en saison (Saint Michel en Grève,Trestel, Sainte Anne la Palud) ou <strong>des</strong> niveaux peu limitants (entre autre, Locquirec, Guisseny,Larmor Plage). Enfin certains sites sont restés toute la saison nettement au <strong>des</strong>sus <strong>des</strong>limitations par l’azote (Rance / Saint Jouan, Horn Guil<strong>le</strong>c Douranenez / Le Ry). On peutnoter, qu’excepté pour <strong>le</strong> secteur de la baie de la Forêt dont <strong>le</strong> fonctionnement est particulier(infra<strong>littoral</strong>), l’analyse <strong>des</strong> courbes de quotas azoté permet de bien expliquer <strong>le</strong>s évolutions<strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’échouages me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s différents secteurs de plage (notamment la fortediminution <strong>des</strong> ulves <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc, ou Binic, <strong>le</strong> niveau plutôt modéré en aoûtpuis septembre <strong>sur</strong> la baie de Saint Michel en Grève, …).Cimav P4 – rapport final mars 2012 97
• L’analyse <strong>des</strong> teneurs en Phosphore montre el<strong>le</strong> aussi <strong>des</strong> situations différentes selon <strong>le</strong>ssecteurs qui doivent donc chacun faire l’objet d’une analyse particulière. On peut tout demême noter que <strong>sur</strong> certains secteurs <strong>le</strong> phosphore est nettement et durab<strong>le</strong>ment limitant(Mogéran/Coréjou, Aber Wrac’h, Concarneau, Fort Bloqué et Penvins), d’autres sontproches <strong>des</strong> limitations et ponctuel<strong>le</strong>ment nettement limités (Binic, Trestel, Locquirec,Guisseny, Douarnenez/ <strong>le</strong> Ry, Larmor Plage et Penestin). Enfin un dernier groupe de secteursapparaît comme non limité ou très ponctuel<strong>le</strong>ment limités (Baie de Saint Brieuc, Baie deSaint Michel en Grève, du Dossen, de Douarnenez/Sainte Anne et <strong>le</strong>s différents secteurs devasière). La baie de Saint Brieuc est <strong>le</strong> seul site dont <strong>le</strong> profil de quotas dépasserégulièrement la barre <strong>des</strong> 0,25% MS, pour atteindre même en fin de saison la va<strong>le</strong>ur de 0,4%. Les me<strong>sur</strong>es en 2011 <strong>sur</strong> un nombre étendu de sites montrent que seuls <strong>le</strong>s grands sitessab<strong>le</strong>ux historiques de la côte nord présentent <strong>des</strong> profils de quotas phosphoréss’éloignant franchement <strong>des</strong> niveaux critiques pour la croissance, alors que l’ensemb<strong>le</strong><strong>des</strong> petits sites nouvel<strong>le</strong>ment pris en compte (et re<strong>le</strong>vant sans doute plus de marées <strong>vertes</strong>de type « arrachage ») présentent <strong>des</strong> limitations phosphorées très nettes. Des sites un peuplus grands mais à fort environnement rocheux, comme Guisseny, pourraient être rattachés àcette catégorie. Enfin, la me<strong>sur</strong>e en 2011 (comme déjà noté <strong>sur</strong> certains sites en 2010), pourune année de débit particulièrement bas, de teneurs internes en phosphore assez proches decel<strong>le</strong>s re<strong>le</strong>vées lors d’années de plus forts débits (contrairement à ce que l’on relève pourl’azote), indique une disponibilité pour cet élément indépendante <strong>des</strong> apports terrigènede la période confirmant une origine sédimentaire du phosphore disponib<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>salgues.• La me<strong>sur</strong>e de la biomasse maxima<strong>le</strong> <strong>sur</strong> la baie de Saint Michel en Grève indique un niveaupour 2011 proche de celui me<strong>sur</strong>é en 2010 et significativement inférieur à ceux me<strong>sur</strong>ésdans <strong>le</strong>s années 95-2001. La faib<strong>le</strong> part que représente à cette date la biomasse infralittora<strong>le</strong>(moins de 5 %) pourrait être liée à ce moindre niveau de biomasse tota<strong>le</strong> dans la baie, auxconditions plutôt favorab<strong>le</strong>s aux échouages lors <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es et aux opérations de ramassage<strong>des</strong> algues dans <strong>le</strong> rideau, en cours lors de l’évaluation. Les me<strong>sur</strong>es hiverna<strong>le</strong>s réalisées <strong>sur</strong>la même baie permettent d’améliorer nos références <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s situations hiverna<strong>le</strong>s et tendent àindiquer un niveau en 2011 plutôt bas <strong>des</strong> stocks de reconduction (encore en diminutionau cours du mois de février). La me<strong>sur</strong>e hiverna<strong>le</strong> <strong>sur</strong> l’anse du Lédano a permis de localiser<strong>des</strong> tapis denses d’ulves, qui pourraient être à l’origine de la reconduction pluri annuel<strong>le</strong>, defaib<strong>le</strong> extension (1ha) et même d’évaluer la biomasse tota<strong>le</strong> de l’anse (moins de 75 Tonnes)ce qui constitue une première donnée de référence <strong>sur</strong> ce secteur. Les contrô<strong>le</strong>s plus rapi<strong>des</strong><strong>sur</strong> d’autres secteurs montrent de situations loca<strong>le</strong>s qui peuvent être très différentespuisque la baie de la baie de la Forêt est encore en février et début mars très chargéed’ulves (jamais vu à ce niveau) alors que <strong>le</strong>s baies de Saint Brieuc et Fresnaye semb<strong>le</strong>nttota<strong>le</strong>ment exemptes d’ulves mais relativement fortement chargées de Pylaiella, alguesbrune filamenteuse qui pourrait se maintenir dans ces baies, au détriment <strong>des</strong> ulves, jusqu’auprintemps 2012Cimav P4 – rapport final mars 2012 98
ANNEXESCimav P4 – rapport final mars 2012 99
ANNEXE 1SITES TOUCHES PAR DES ECHOUAGES D’ULVES EN MAI, JUILLET, SEPTEMBRE 2011Cimav P4 – rapport final mars 2012 100
Sites touchés par <strong>des</strong> échouages d'ulvesmai 2011BRIGNOGANPORS-GUEN/PORS-MEURNANTOUARGUISSENYKERVALIOU/KERFISSIENTY NOD/RADE DE MORLAIXTRESTELLEDANOABER WRACHPLOUNEOURPENZEABER BENOITBEG LEGUERLANCIEUXLimite del'inventaireCOULOUARNMOGUERAN/COREJOUHORN/GUILLECLOCQUEMEAUBREHECQUELMERARGENTONMOULIN-BLANCELORNTINDUFF/MOULIN NEUFLOCQUIRECSAINT-MICHEL-EN-GREVEDAOULASMINIHIC-SUR-RANCESAINT-JOUAN-DES-GUERETSTREZ-HIRPOSTOLONNECMORGATHOPITAL CAMFROUTAULNE/FOND DE RADELIEUE-DE-GREVEFINISTEREYFFINIACCOTES-D'ARMORMORIEUXLA VILLE GERLA VILLE-ES-NONAISKERVIJEN/TY AN QUERTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECSAINTE-ANNE-LA-PALUDKERVEL/TREZMALAOUENRYPOULDONILE-TUDYODETCAP COZPORT LA FORETCONCARNEAUCABELLOUILLE-ET-VILAINEANSE DE POULDOHANL'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient. Les sites sont classéscomme touchés à partir du moment où <strong>le</strong>s dépôtssont décelab<strong>le</strong>s d’avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s deterrain mettent en évidence <strong>des</strong> proportionsanorma<strong>le</strong>s d’ulves. Certains sites sont de trèspetite tail<strong>le</strong> et ne correspondent pas à la<strong>des</strong>cription classique de “marée verte”.SAINT-GUENOLEGUILVINECLESCONILLODONNECMOUSTERLINBEG MEILKERLEVEN/SAINT-LAURENTAVENKERFANYFORT-BLOQUEKERPAPEPORT LOUISRIA D ETELMORBIHANAURAYRIVIERE DE CRAC'HNORD OUEST GOLFE 56BEG MEIL NORDSites touchés par <strong>des</strong> ulveslors de l’inventaire de mai(76 sites)site <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>LARMOR-PLAGESUD ARZONMINE D ORsite <strong>sur</strong> vase.0 30 60KmQUIBERONSAINT GILDASDE RHUYSPENVINSPOINTE DU BILELimite del'inventaire
Sites touchés par <strong>des</strong> échouages d'ulvesjuil<strong>le</strong>t 2011KERLOUANBRIGNOGANPLOUNEOURPORS-GUEN/PORS-MEURKERVALIOU/KERFISSIENHORN/GUILLECTY NOD/RADE DE MORLAIXPORZ BILIECTRESTELPELLINECJAUDYLEDANOGUISSENYABER WRACHKEREMMAPENZEABER BENOITBEG LEGUERLimite del'inventaireMOGUERAN/COREJOUPORT NEUFLOCQUEMEAUMOULIN-BLANCELORNMOULIN-DE-LA-RIVELOCQUIRECTINDUFF/MOULIN NEUFSAINT-MICHEL-EN-GREVEBINIC/ETABLES-SUR-MERDAOULASROSCANVELHOPITAL CAMFROUTMORIEUXPOSTOLONNECMORGATAULNE/FOND DE RADEPORSLOUSLIEUE-DE-GREVEFINISTEREYFFINIACCOTES-D'ARMORABERTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDKERVEL/TREZMALAOUENBAIE DES TREPASSESPORT RHU/TREBOULRYLOCHAUDIERNEODETPORT LA FORETKERLEVEN/SAINT-LAURENTILE-TUDYCAP COZCONCARNEAUILLE-ET-VILAINEPOULDONCABELLOUANSE DE POULDOHANFORT-BLOQUEL'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient. Les sites sont classéscomme touchés à partir du moment où <strong>le</strong>s dépôtssont décelab<strong>le</strong>s d’avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s deterrain mettent en évidence <strong>des</strong> proportionsanorma<strong>le</strong>s d’ulves. Certains sites sont de trèspetite tail<strong>le</strong> et ne correspondent pas à la<strong>des</strong>cription classique de “marée verte”.GUILVINECMOUSTERLINBEG MEILTREVIGNONAVENPORT-MANECHPOULDUCOUREGANTPORT LOUISRIA D ETELMORBIHANBEG MEIL NORDAURAYNORD EST GOLFE 56NORD OUEST GOLFE 56Sites touchés par <strong>des</strong> ulveslors de l’inventaire de juil<strong>le</strong>t(79 sites)site <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>.KERPAPELARMOR-PLAGEERDEVENPOINTE DE GAVRESMINE D ORsite <strong>sur</strong> vase0 30 60KmPENVINSPOINTE DU BILELimite del'inventaire
Sites touchés par <strong>des</strong> échouages d'ulvesseptembre 2011HORN/GUILLECANSE DE PERROSTRESTELJAUDYLEDANOPORS-GUEN/PORS-MEURDIBENPELLINECTY NOD/RADE DE MORLAIXGUISSENYABER WRACHMOGUERAN/COREJOUPENZEABER BENOITBINIC/ETABLES-SUR-MERLimite del'inventairePORTSALLGOULVENPORT NEUFMOULIN-BLANCELORNTINDUFF/MOULIN NEUFLOCQUIRECDAOULASHOPITAL CAMFROUTPOSTOLONNECAULNE/FOND DE RADESAINT-MICHEL-EN-GREVEMORGATLIEUE-DE-GREVEFINISTEREKERVIJEN/TY AN QUERCOTES-D'ARMORTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECBAIE DES TREPASSESSAINTE-ANNE-LA-PALUDKERVEL/TREZMALAOUENRYAUDIERNEODETCAP COZPORT LA FORETCONCARNEAUILLE-ET-VILAINEPOULDONAVENL'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient. Les sites sont classéscomme touchés à partir du moment où <strong>le</strong>s dépôtssont décelab<strong>le</strong>s d’avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s deterrain mettent en évidence <strong>des</strong> proportionsanorma<strong>le</strong>s d’ulves. Certains sites sont de trèspetite tail<strong>le</strong> et ne correspondent pas à la<strong>des</strong>cription classique de “marée verte”.LESCONILBEG MEIL NORDCABELLOUFORT-BLOQUEPORT LOUISRIA D ETELMORBIHANNORD OUEST GOLFE 56KERLEVEN/SAINT-LAURENTPORT-MANECHKERPAPENORD EST GOLFE 56Sites touchés par <strong>des</strong> ulveslors de l’inventaire de septembre(55 sites)site <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>.LARMOR-PLAGEsite <strong>sur</strong> vase0 30 60KmPOINTE DU BILELimite del'inventaire
ANNEXE 2EXEMPLE DE FICHE POUR UN SITE TOUCHE PAR DES ECHOUAGES D’ULVESCimav P4 – rapport final mars 2012 101
<strong>Suivi</strong> <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> la BretagneSEPTEMBRE 2011MORIEUX (22)Aérien <strong>le</strong> 15/09/2011Terrain <strong>le</strong> 13/09/2011Identification <strong>des</strong> échantillons:1- 90%: Pylaeilla libre, pompoms, très abîmé10%: U. (armoricana) libre2- 85%: Même Pyla10%: Même ulve5%: Gracilaires3- 80%: Pyla plus en longueur, comme s’il était d’arrachage10%: Même ulve5%: Même GracilairePrésence d’une algue rouge filamenteuse.4- 70%: Pylaeilla libre très abîmé30%: Ulva sp. D’arrachageDépôts de couverturesvariab<strong>le</strong>s mais decomposition homogène :90 à 100% de Pylaiella et0 à 10% d’ulves de petitestail<strong>le</strong>s (fragments).
ANNEXE 3SITES TOUCHES PAR DES PROLIFERATIONS D’AUTRES ALGUES EN 2011Cimav P4 – rapport final mars 2012 102
Sites touchés par <strong>des</strong> proliférations d‛algues en 2011autre que <strong>le</strong>s ulves(3 inventaires de contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCE)L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé àmarée basse de fort coefficient. Le CEVAest “mandaté” pour suivre <strong>le</strong>s échouagesd’ulves. En plus <strong>des</strong> proliférations d’ulves,certains secteurs présentent <strong>des</strong>proliférations d’autres algues (a priori autreque simp<strong>le</strong> “goémon” d’échouage). Cesobservations sont répertoriées <strong>sur</strong> cettecarte sans pouvoir prétendre àl’exhausivité <strong>des</strong> observations.TEVENNmai!(!(LANDRELLECmai-juil<strong>le</strong>tBINIC/ETABLES-SUR-MERmaiFRESNAYEmai-juil<strong>le</strong>t et septembreLANCIEUXmai-juil<strong>le</strong>t et septembreLimite del'inventaire!(!( !(!( !(YFFINIACseptembreMORIEUXmai et septembre!(MOUSTERLINseptembreQUIBERON/SABLES BLANCSjuil<strong>le</strong>tProliférations observéesautres que ulves en 2011ENTERO MORPHESO LIERIAERDEVENseptembreSAINT-PIERRE-QUIBERONjuil<strong>le</strong>t!(!( !( !(SUD ARZON!( !( !( !( !(juil<strong>le</strong>t et septembreSAINT GILDASDE RHUYSjuil<strong>le</strong>t et septembreBANASTEREseptembrePYLAIELLA.0 30 60KmQUIBERONseptembreSAINT-JACQUESseptembrePENVINSseptembreLimite del'inventaire
ANNEXE 4TAILLE MAXIMUM DES SITES A ULVES SUR PLAGE EN 2011Cimav P4 – rapport final mars 2012 103
Surface maxima<strong>le</strong> <strong>des</strong> dépôts d'ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong> en 2011 (3 inventaires)150Surface de dépôt (équi 100% + rideau) en ha100500PORT RHU/TREBOULMOUSTERLINPLOUNEOURMINE D ORNANTOUARABERPORSLOUSSUD ARZONPORT-MANECHGUILVINECLOCQUEMEAUPOINTE DE GAVRESAUDIERNECOULOUARNMOGUERAN/COREJOUKERVALIOU/KERFISSIENBAIE DES TREPASSESPORT NEUFPENVINSBEG MEILMORGATPORZ BILIECBREHECKERPAPEFORT-BLOQUETREZ-BIHAN/TREZ-BELLECLARMOR-PLAGELANCIEUXPOULDUTRESTELPORS-GUEN/PORS-MEURBRIGNOGANLODONNECRYPOINTE DU BILEBEG MEIL NORDBEG LEGUERBINIC/ETABLES-SUR-MERLOCQUIRECKERLEVEN/SAINT-LAURENTERDEVENCONCARNEAUCAP COZKEREMMACABELLOUKERVIJEN/TY AN QUERKERVEL/TREZMALAOUENGUISSENYHORN/GUILLECLIEUE-DE-GREVESAINTE-ANNE-LA-PALUDYFFINIACSAINT-MICHEL-EN-GREVEMORIEUXSurface maxima<strong>le</strong> <strong>des</strong> dépôts d'ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong> en 2011 (3 inventaires)30Surface de dépôt (équi 100% + rideau) en ha20100PORT RHU/TREBOULMOUSTERLINPLOUNEOURMINE D ORNANTOUARABERPORSLOUSSUD ARZONPORT-MANECHGUILVINECLOCQUEMEAUPOINTE DE GAVRESAUDIERNECOULOUARNMOGUERAN/COREJOUKERVALIOU/KERFISSIENBAIE DES TREPASSESPORT NEUFPENVINSBEG MEILMORGATPORZ BILIECBREHECKERPAPEFORT-BLOQUETREZ-BIHAN/TREZ-BELLECLARMOR-PLAGELANCIEUXPOULDUTRESTELPORS-GUEN/PORS-MEURBRIGNOGANLODONNECRYPOINTE DU BILEBEG MEIL NORDBEG LEGUERBINIC/ETABLES-SUR-MERLOCQUIRECKERLEVEN/SAINT-LAURENTERDEVENCONCARNEAUCAP COZKEREMMACABELLOUKERVIJEN/TY AN QUERKERVEL/TREZMALAOUENGUISSENYHORN/GUILLECLIEUE-DE-GREVESAINTE-ANNE-LA-PALUDYFFINIACSAINT-MICHEL-EN-GREVEMORIEUXSurface maxima<strong>le</strong> <strong>des</strong> dépôts d'ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong> en 2011 (7 inventaires)150Surface de dépôt (équi 100% + rideau) en ha100500ERQUYFRESNAYEVAL ANDREARGUENONTREZ-HIRMOGUERAN/COREJOULANCIEUXTRESTELLARMOR-PLAGEBREHECPORS-GUEN/PORS-MEURRYBEG LEGUERKERLEVEN/SAINT-LAURENTLOCQUIRECKEREMMAKERVIJEN/TY AN QUERKERVEL/TREZMALAOUENGUISSENYCABELLOUHORN/GUILLECLIEUE-DE-GREVEBINIC/ETABLES-SUR-MERSAINTE-ANNE-LA-PALUDSAINT-MICHEL-EN-GREVEYFFINIACMORIEUX
ANNEXE 5SURFACES COUVERTES PAR SITE POUR LES MISSIONS D’AVRIL A OCTOBRE 2011Cimav P4 – rapport final mars 2012 104
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvesavril 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. En avril, juin, août et octobre, seuls <strong>le</strong>ssites princiupaux faont l’objet d’estimations<strong>sur</strong>faciques. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.MOGUERAN/COREJOUGUISSENYHORN/GUILLECPORS-GUEN/PORS-MEURLOCQUIRECBEG LEGUERTRESTELBREHECLimite del'inventaireSAINT-MICHEL-EN-GREVELANCIEUXYFFINIACMORIEUXFINISTERECOTES-D'ARMORLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDA noter : en avril, juin, août et octobre,seuls <strong>le</strong>s sites principaux font l’objetd’évaluation <strong>sur</strong>facique (liste prédéfinie)Surfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves(en hectares)RYKERVEL/TREZMALAOUENCAP COZKERLEVEN/SAINT-LAURENTCABELLOUMORBIHANILLE-ET-VILAINE4002001002020,5site <strong>sur</strong> vase classé au moinsune fois lors d’un <strong>des</strong> inventaire(<strong>sur</strong>face non estimée)* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%.0 30 60KmLimite del'inventaire
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvesmai 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. En avril, juin, août et octobre, seuls <strong>le</strong>ssites princiupaux faont l’objet d’estimations<strong>sur</strong>faciques. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.COULOUARNGUISSENYMOGUERAN/COREJOUBRIGNOGANPLOUNEOURPORS-GUEN/PORS-MEURKERVALIOU/KERFISSIENHORN/GUILLECLOCQUIRECLOCQUEMEAUNANTOUARTRESTELBEG LEGUERSAINT-MICHEL-EN-GREVEBREHECBINIC/ETABLES-SUR-MERLANCIEUXLimite del'inventaireYFFINIACMORIEUXTREZ-HIRMORGATPOSTOLONNECFINISTERECOTES-D'ARMORLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDRYKERVEL/TREZMALAOUENILLE-ET-VILAINECAP COZKERLEVEN/SAINT-LAURENTSurfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves(en hectares)ILE-TUDYBEG MEILLESCONILMOUSTERLINCONCARNEAUCABELLOUMORBIHAN400200GUILVINECLODONNECBEG MEILNORDANSE DEPOULDOHANKERFANYKERPAPE100FORT-BLOQUELARMOR-PLAGE2020,5site <strong>sur</strong> vase classé au moinsune fois lors d’un <strong>des</strong> inventaire(<strong>sur</strong>face non estimée)* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%.QUIBERONSUD ARZONSAINT GILDASDE RHUYSPENVINSMINE D OR0 30 60KmLimite del'inventairePOINTE DU BILE
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvesjuin 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. En avril, juin, août et octobre, seuls <strong>le</strong>ssites princiupaux faont l’objet d’estimations<strong>sur</strong>faciques. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.MOGUERANCOREJOUGUISSENYKEREMMAHORN/GUILLECPORS-GUEN/PORS-MEURLOCQUIRECBEG LEGUERTRESTELSAINT-MICHEL-EN-GREVEBREHECBINIC/ETABLES-SUR-MERARGUENONLimite del'inventaireLANCIEUXYFFINIACMORIEUXTREZ-HIRFINISTERECOTES-D'ARMORLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDKERVEL/TREZMALAOUENRYA noter : en avril, juin, août et octobre,seuls <strong>le</strong>s sites principaux font l’objetd’évaluation <strong>sur</strong>facique (liste prédéfinie)KERLEVENSAINT-LAURENTILLE-ET-VILAINESurfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves(en hectares)CAP COZCABELLOUMORBIHAN400200100KERPAPELARMOR-PLAGE2020,5site <strong>sur</strong> vase classé au moinsune fois lors d’un <strong>des</strong> inventaire(<strong>sur</strong>face non estimée)* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%.0 30 60KmLimite del'inventaire
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvesjuil<strong>le</strong>t 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. En avril, juin, août et octobre, seuls <strong>le</strong>ssites princiupaux faont l’objet d’estimations<strong>sur</strong>faciques. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.MOGUERAN/COREJOUBRIGNOGANGUISSENYKERLOUANPLOUNEOURPORS-GUEN/PORS-MEURKERVALIOU/KERFISSIENPORT NEUFHORN/GUILLECMOULIN-DE-LA-RIVELOCQUEMEAUPORZ BILIECBEG LEGUERTRESTELSAINT-MICHEL-EN-GREVEBREHECBINIC/ETABLES-SUR-MERLimite del'inventaireKEREMMALOCQUIRECMORIEUXYFFINIACMORGATPOSTOLONNECTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECFINISTERECOTES-D'ARMORABERPORSLOUSLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDBAIE DES TREPASSESKERVEL/TREZMALAOUENLOCHPORT RHU/TREBOULRYKERLEVEN/SAINT-LAURENTILLE-ET-VILAINEAUDIERNECAP COZSurfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves(en hectares)ILE-TUDYBEG MEILMOUSTERLINCONCARNEAUCABELLOUTREVIGNONPOULDUMORBIHAN400200GUILVINECBEG MEILNORDANSE DEPOULDOHANPORT-MANECHCOUREGANT100FORT-BLOQUE20KERPAPEPOINTE DEGAVRES20,5LARMOR-PLAGEsite <strong>sur</strong> vase classé au moinsune fois lors d’un <strong>des</strong> inventaire(<strong>sur</strong>face non estimée)* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%.ERDEVENMINE D ORPENVINS0 30 60KmPOINTE DU BILELimite del'inventaire
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvesaoût 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. En avril, juin, août et octobre, seuls <strong>le</strong>ssites princiupaux faont l’objet d’estimations<strong>sur</strong>faciques. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.GUISSENYMOGUERAN/COREJOUPORS-GUEN/PORS-MEURKEREMMAHORN/GUILLECLOCQUIRECBEG LEGUERSAINT-MICHEL-EN-GREVETRESTELBINIC/ETABLES-SUR-MERLimite del'inventaireYFFINIACMORIEUXTREZ-HIRFINISTERECOTES-D'ARMORLIEUE-DE-GREVESAINTE-ANNE-LA-PALUDKERVIJEN/TY AN QUERKERVEL/TREZMALAOUENA noter : en avril, juin, août et octobre,seuls <strong>le</strong>s sites principaux font l’objetd’évaluation <strong>sur</strong>facique (liste prédéfinie)Surfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves(en hectares)RYCAP COZKERLEVEN/SAINT-LAURENTCABELLOUMORBIHANILLE-ET-VILAINE400200100LARMOR-PLAGE2020,5site <strong>sur</strong> vase classé au moinsune fois lors d’un <strong>des</strong> inventaire(<strong>sur</strong>face non estimée)* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%.0 30 60KmLimite del'inventaire
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvesseptembre 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. En avril, juin, août et octobre, seuls <strong>le</strong>ssites princiupaux faont l’objet d’estimations<strong>sur</strong>faciques. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.MOGUERAN/COREJOUPORS-GUEN/PORS-MEURPORT NEUFHORN/GUILLECLOCQUIRECTRESTELSAINT-MICHEL-EN-GREVEBINIC/ETABLES-SUR-MERLimite del'inventaireGUISSENYYFFINIACMORIEUXMORGATPOSTOLONNECTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECFINISTERECOTES-D'ARMORLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDBAIE DES TREPASSESKERVEL/TREZMALAOUENRYILLE-ET-VILAINEAUDIERNEKERLEVEN/SAINT-LAURENTSurfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves(en hectares)CAP COZBEG MEILNORDCONCARNEAUCABELLOUMORBIHAN400LESCONILPORT-MANECH200FORT-BLOQUE100KERPAPE20LARMOR-PLAGE20,5site <strong>sur</strong> vase classé au moinsune fois lors d’un <strong>des</strong> inventaire(<strong>sur</strong>face non estimée)* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%.0 30 60KmLimite del'inventairePOINTE DU BILE
Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulvesoctobre 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé à maréebasse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juil<strong>le</strong>t,mi-septembre. En avril, juin, août et octobre, seuls <strong>le</strong>ssites princiupaux faont l’objet d’estimations<strong>sur</strong>faciques. Pour tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong>échouages d'ulves <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces de dépôtsont me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les <strong>sur</strong>facesde dépôts <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières ne sont pas représentées<strong>sur</strong> cette carte. Certains sites, en particulier <strong>sur</strong> <strong>le</strong><strong>littoral</strong> sud, comportent une part importante d'ulvessituée plus au large et non comptabilisée ici.MOGUERAN/COREJOUGUISSENYHORN/GUILLECPORS-GUEN/PORS-MEURSAINT-MICHEL-EN-GREVEBINIC/ETABLES-SUR-MERLimite del'inventaireFINISTERECOTES-D'ARMORLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDKERVEL/TREZMALAOUENRYA noter : en avril, juin, août et octobre,seuls <strong>le</strong>s sites principaux font l’objetd’évaluation <strong>sur</strong>facique (liste prédéfinie)KERLEVEN/SAINT-LAURENTILLE-ET-VILAINESurfaces cou<strong>vertes</strong>* par <strong>le</strong>s ulves(en hectares)CAP COZCABELLOUMORBIHAN400200100LARMOR-PLAGE2020,5site <strong>sur</strong> vase classé au moinsune fois lors d’un <strong>des</strong> inventaire(<strong>sur</strong>face non estimée)* Surface tota<strong>le</strong> couverte = <strong>sur</strong>face rideau + <strong>sur</strong>face équi 100%.0 30 60KmLimite del'inventaire
ANNEXE 6FICHES DE SYNTHESE POUR LES PRINCIPAUX SITES POUR 2011Cimav P4 – rapport final mars 2012 105
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitedu Mont-Saint-Michel (35)19/04/2011 18/05/201101/07/201115/08/2011 15/09/2011 14/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Saint-Jouan-<strong>le</strong>s-Guerets (35)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011Identification <strong>des</strong> espèces:Entéromorphes filamenteuses recou<strong>vertes</strong> par tapied’Ulva armoricana. Présence de Gracilaires et Fucus.
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Troctin (35)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011Identification <strong>des</strong> espèces:Tapis d’entéromorphes filamenteuses et très peu d’U. armoricana
hectaresÉvolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Lancieux (22)19/04/2011 16/06/201118/05/2011 : 60% Pyla + 40% U. armoricana + Présence Cladophora rupestris01/07/2011 : Rideau avec 99% Pyla + Algues diverses avec quelquesU. sp d’arrachage15/08/2011 : 95% Pyla + 4% Ulva sp. arrachage + 1% AR 15/09/2011 : 60% Pyla + 20% AR + 15% zostères et goémons + 5%U. (rotundata) d’arrachage14/10/2011 : 40% Pyla + 30% AR filamenteuses + 15% zostères +Présence Ulva sp. d’arrachage8070602002200320042005200620072008200920102011Moyenne 02-10Baie de Lancieux : <strong>sur</strong>faces d'échouages <strong>des</strong> ulves en hectares(rideau + échouage en équiva<strong>le</strong>nt 100%)50403020100avril mai juin juil<strong>le</strong>t août septembre octobre
hectaresÉvolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Arguenon (22)19/04/2011 18/05/2011 : 80% Pyla + 15% U. (rotundata) 50/50 libre/arrachage + 16/06/2011 : Semb<strong>le</strong> être du Pyla et <strong>des</strong> algues rouges, mais pas de VTPrésence d’AR ( Polysiphonia sp. et Ceramium sp)14/07/2011 : Semb<strong>le</strong> être du Pyla, mais pas de VT 15/08/2011 15/09/201114/10/20112520Baie de l'Arguenon : <strong>sur</strong>faces d'échouages <strong>des</strong> ulves en hectares(rideau + échouage en équiva<strong>le</strong>nt 100%)2002200320042005200620072008200920102011Moyenne 02-10151050avril mai juin juil<strong>le</strong>t août septembre octobre
<strong>sur</strong>face couverte (ha)Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede La Fresnaye (22)19/04/2011 : 80% Pyla + 10% Goémons + 5% U. sp. + 5% AR 18/05/2011 : 90% Pyla + 5% U. sp. + Présence Ulvaria obscura 16/06/2011 : 99% Pyla + U. sp. + ARCladophora rupestris, Polysiphonia sp. et AR filamenteuses14/07/2011 : 99% Pyla + quelques U. sp. 15/08/2011 15/09/2011: 90% Pyla + 5% U. sp. libre + Polysiphonia14/10/2011 : 60% Pyla + 20% Polysiphonia sp. + 15% Fucus/laminaires + quelques U. sp. libes160140120Baie de la Fresnaye : <strong>sur</strong>faces d'échouages <strong>des</strong> ulves ou ulvaria en hectares(rideau + échouage en équiva<strong>le</strong>nt 100%)2002200320042005200620072008200920102011Moyenne 02-09100806040200avril mai juin juil<strong>le</strong>t août septembre octobre
hectaresÉvolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Erquy (22)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/201115/09/201114/10/2011 : 70% Pyla d’arrachage et en très bon état + Quelques U.(armoricana) d’arrachage et Porphyra sp. Fucus Gracilaires1412108Erquy : <strong>sur</strong>faces d'échouages <strong>des</strong> ulves en hectares(rideau + échouage en équiva<strong>le</strong>nt 100%)2002200320042005200620072008200920102011Moyenne 02-106420avril mai juin juil<strong>le</strong>t août septembre octobre
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Val André (22)18/05/2011 : 50% Pyla + 30% AR (Ex: Ceramium sp.) + 20% U. (rotundata)arrachage16/06/2011 14/07/201115/08/2011 15/09/2011 14/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Morieux (22)19/04/2011 : U. armoricana 18/05/2011 : Alternance zones avec tendance à AV jusqu’à 50% avec 16/06/2011 : U. Armoricana + 10% PolysiphoniaU. armoricana et U. rotundata d’arrachage et zones avec tendance à ABjusqu’à 85% avec du Pyla. Présence d’AR filamenteuses.01/07/2011 : En haut, 70% U. armoricana + 15% Polysiphonia + PylaRideau: 50/50 U. armoricana /Pyla15/08/2011 : En haut, 50/50 AR (Polysiphonia)/PylaEn bas, 50% Ulva sp. reste Polysiphonia/Pyla15/09/2011 : 95% Pyla + Quelques gracilaires et U. (armoricana) libre14/10/2011 : 80% Pyla + 20% AR filamenteuses (Ceramiaceae)
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Yffiniac (22)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011Identification <strong>des</strong> espèces : Voir Morieux
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Binic-Etab<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> Mer (22)19/04/2011 18/05/201116/06/201101/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Bréhec (22)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Ledano (22)18/05/2011 16/06/201114/07/201115/08/201115/09/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Trestel (22)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Beg Leguer (22)19/04/2011 18/05/201116/06/201101/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Saint-Michel-en-Grève (22)19/04/2011 18/05/201116/06/201101/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Locquirec (29)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Horn-Guil<strong>le</strong>c (29)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Pors Guen (29)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Keremma (29)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Guisseny (29)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Mogueran Corejou (29)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Portsall (29)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Trez-Hir (29)13/04/2011 18/05/2011 16/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitedu Moulin-Blanc (29)19/04/2011 18/05/201116/06/201114/07/2011 15/08/2011 15/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Pentrez – Lieue de Greve (29)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/2011 13/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Sainte-Anne-la-Palud (29)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/2011 13/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Kervel-Trezmalaouen (29)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/2011 13/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Douarnenez – Le Ry (29)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/2011 13/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Ker<strong>le</strong>ven-Saint-Laurent (29)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/2011 13/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Cabellou (29)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/201113/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Larmor-Plage (56)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/2011 13/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Lorient - Rade de Port Louis (56)19/04/201117/05/201116/06/201115/07/201115/08/201113/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede la Ria d’Etel (56)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/2011 13/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Quiberon – Sab<strong>le</strong>s Blancs (56)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011: Pyla + Fucus 15/08/2011 13/09/2011: 50% AR filamenteuses et en lame + 30% Fucus+ 15% U. rotundata d’arrachage14/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede la Rivière d’Auray (56)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/2011 15/08/2011 13/09/201114/10/2011
Évolution <strong>sur</strong>facique de la marée verte en 2010 <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sitede Vannes - Arcal (56)19/04/2011 17/05/2011 16/06/201115/07/201115/08/2011 13/09/201114/10/2011
ANNEXE 7ELEMENTS DE CARACTERISTIQUES DE LA PROLIFERATION 2011 PAR SECTEUR(« avis marée verte » du 19 octobre 2011)Cimav P4 – rapport final mars 2012 106
Marée verte 2011 <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s baies <strong>breton</strong>nes.Eléments provisoires, <strong>le</strong> 19 octobre 2011Durant la saison de prolifération, la priorité <strong>des</strong> équipes du CEVA est donnée aux acquisitions aériennes et deterrain, opérations qui ne peuvent être différées. L’analyse chiffrée <strong>des</strong> échouages peut diffici<strong>le</strong>ment être menéetota<strong>le</strong>ment durant la même période. Cependant, même avant <strong>le</strong>s estimations chiffrées de tous <strong>le</strong>s sites(traitement lourd, sous Système d’Information Géographiques, de géoréférencement <strong>des</strong> photos acquises puisdigitalisation de tous <strong>le</strong>s dépôts), il est possib<strong>le</strong> de fournir <strong>des</strong> indications <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s tendances observées àl’échelon régional et par secteur. Ces estimations sont établies à partir de premières me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> certains sitesou pour d’autres, <strong>sur</strong> la simp<strong>le</strong> analyse visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> photos par rapport aux photos <strong>des</strong> années antérieures. Lesrésultats annuels sont synthétisés une fois toutes <strong>le</strong>s données acquises, traitées et validées dans <strong>le</strong> rapport debilan. L’objectif du présent document est de mettre à disposition régulièrement de premières informationsmême si cel<strong>le</strong>s-ci doivent encore être considérées comme provisoires.1) Rappels <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s suivis réalisés1.1) Réseaux de suivis : Pro<strong>littoral</strong> 2002-2006 :Mise en place par <strong>le</strong> CEVA en 2002 d’un réseau de suivi dans ma cadre de Pro<strong>littoral</strong> . Ce réseau de suivi,en place de 2002 à 2006 comportait à l’échel<strong>le</strong> « régiona<strong>le</strong> » (Mont Saint Michel - La Bau<strong>le</strong>) 4 inventairesannuels « exhaustifs » (mai, juil<strong>le</strong>t, août et octobre) <strong>des</strong> sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves, 3 <strong>sur</strong>vols(avril, juin et septembre) plus partiels <strong>des</strong> sites principaux, la me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong> niveaux d’eutrophisation <strong>sur</strong> 25sites (« quotas azotés »), et <strong>des</strong> prospections en biomasse <strong>sur</strong> 8 grands secteurs (biomasse <strong>sur</strong> estran + eninfra<strong>littoral</strong>). Depuis 2007 :A l’échel<strong>le</strong> <strong>breton</strong>ne, <strong>le</strong>s suivis réalisés par <strong>le</strong> CEVA sont partagés entre deux réseaux : Réseau de Contrô<strong>le</strong> de Surveillance (RCS) de la DCE, sous maitrise d’ouvrage del’Ifremer et cofinancement AELB (mise en œuvre CEVA). Les côtes <strong>breton</strong>nes sont,dans <strong>le</strong> cadre de ce réseau, concernées par 3 dates d’inventaire général « exhaustif» :mi mai, mi juil<strong>le</strong>t, mi septembre (<strong>sur</strong>vol <strong>des</strong> côtes <strong>breton</strong>nes en 2 jours, à marée bassede fort coefficient). Suite à ces <strong>sur</strong>vols, <strong>des</strong> contrô<strong>le</strong>s de terrain sont réalisés pourdéterminer <strong>le</strong>s algues constituant l’échouage observé. En fonction de la part d’ulves dansl’échouage (30 % fixé comme va<strong>le</strong>ur limite pour <strong>le</strong>s sites de plage, depuis <strong>le</strong> démarrage<strong>des</strong> suivis en 1997, pour distinguer <strong>le</strong>s échouages naturels de goémon <strong>des</strong> proliférationsd’ulves ; notion de tapis continus d’ulves pour <strong>le</strong>s vasières) <strong>le</strong>s sites sont « classés »comme touchés par <strong>des</strong> « échouages d’ulves » (à noter que ce classement ne signifie pas« marée verte ») et feront alors l’objet d’estimation <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong>. <strong>Suivi</strong>s complémentaires réalisés dans <strong>le</strong> cadre du Grand Projet 5 (programme CIMAV :maitrise d’ouvrage CEVA, cofinancement Région, 4 Départements, AELB). Ces suiviscomplémentaires comportent 4 <strong>sur</strong>vols supplémentaires <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sites <strong>breton</strong>s(<strong>sur</strong>vol en 1 jour, à marée basse de fort coefficient de Vannes à la Rance <strong>sur</strong> la listeprédéfinie <strong>des</strong> sites principaux à suivre) : mi avril , mi juin, mi août et mi octobre. Anoter qu’outre ces suivis en <strong>sur</strong>face d’échouage, <strong>le</strong> CEVA suit <strong>le</strong>s indices nutritionnelsde certains sites (en azote et phosphore) pour caractériser, indépendamment <strong>des</strong>biomasses accumulées, <strong>le</strong> statut nutritionnel <strong>des</strong> algues de ces sites (limitation plus oumoins forte et précoce de la croissance par <strong>le</strong>s nutriments). Enfin, <strong>des</strong> suivis enbiomasse tota<strong>le</strong> (estran+infra<strong>littoral</strong>) permettent de préciser l’amp<strong>le</strong>ur <strong>des</strong> proliférationsde certaines baies.premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 1 /20
Les principaux sites sont donc, dans <strong>le</strong> cadre de ces deux réseaux, <strong>sur</strong>volés 7 fois par an entre la miavril et la mi octobre (1 fois par mois). Cette information en <strong>sur</strong>face d’échouage étant la plusrapidement disponib<strong>le</strong> et la plus « exhaustives » est cel<strong>le</strong> qui est exploitée ici pour caractériser laprolifération annuel<strong>le</strong>. Pour toutes <strong>le</strong>s dates pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> dépôts d’ulves sont présents <strong>sur</strong>secteur de plage, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces d’échouage sont me<strong>sur</strong>ées (géoréférencement <strong>des</strong> photos etdigitalisation <strong>des</strong> dépôts sous SIG). Pour <strong>le</strong>s vasières, <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es ne sont effectuées que <strong>sur</strong> la datedu maximum annuel.1.2) Caractérisations <strong>des</strong> proliférations par <strong>le</strong>s suivis : Les données utilisab<strong>le</strong>s comme indicateur :Le suivi <strong>des</strong> proliférations en <strong>sur</strong>face d’échouage, réalisé par <strong>le</strong> CEVA depuis 2002, permet de chiffrer,mois par mois, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces d’algues en « rideau » ou échouées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites de type « plage » (baiessab<strong>le</strong>uses). La colonisation <strong>des</strong> vasières fait éga<strong>le</strong>ment l’objet d’un suivi non reporté ici (me<strong>sur</strong>e en fin <strong>des</strong>aison du maximum annuel). Par ail<strong>le</strong>urs, certains secteurs (plus particulièrement en Sud Bretagne)stockent une partie importante de <strong>le</strong>ur biomasse au-delà de la zone de balancement <strong>des</strong> marées. Cesstocks infralittoraux, souvent non accessib<strong>le</strong>s à l’observation aérienne, font l’objet de suivis plusponctuels non reportés ici (sous estimation, par la seu<strong>le</strong> me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces accessib<strong>le</strong>s à l’observationaérienne, <strong>des</strong> secteurs comportant une plus forte part infralittora<strong>le</strong>, notamment en sud Bretagne).Les suivis de la marée verte en <strong>sur</strong>face colonisée doivent être bien distingués <strong>des</strong> suivis <strong>des</strong>volumes de ramassage. En effet <strong>le</strong>s volumes de ramassage dépendent <strong>des</strong> politiques communa<strong>le</strong>s et <strong>des</strong>moyens qu’el<strong>le</strong>s engagent (moyens nettement accrus en 2009 puis 2010 suite aux recommandationspréfectora<strong>le</strong>s et à la pression <strong>des</strong> médias et du public). De plus, ces ramassages ne concernent, avec<strong>le</strong>s outils actuel<strong>le</strong>ment à disposition <strong>des</strong> communes (outils de type travaux publics ou agrico<strong>le</strong>s) qu’unefraction de la biomasse <strong>des</strong> sites (la part échouée en haut de plage et en dépôt épais de type « andain »).L’indicateur ramassage est, de ce fait, plus un indicateur de la nuisance ressentie et <strong>des</strong> effortsconsentis par <strong>le</strong>s communes qu’un indicateur du niveau réel de la prolifération. A noter enfin queplus <strong>le</strong>s quantités d’algues sont importantes pour un site donné plus l’accumulation de haut de plagesera forte (pression d’échouage accrue). De ce fait, une diminution <strong>des</strong> quantités dans un site se traduirapar une diminution accentuée <strong>des</strong> quantités ramassab<strong>le</strong>s en haut de plage (exemp<strong>le</strong> de la Baie de SaintBrieuc 2010 avec <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’échouages limitées par rapport aux années antérieures mais encoreimportantes « en va<strong>le</strong>ur absolue » et <strong>des</strong> ramassages très inférieurs). Caractérisation <strong>des</strong> proliférations par <strong>le</strong>s suivis en <strong>sur</strong>face d’échouage :Les suivis en <strong>sur</strong>face d’échouage depuis 2002 ont permis de caractériser de façon objective lamarée verte régiona<strong>le</strong> et son évolution. Il en ressort que :- <strong>le</strong> démarrage <strong>des</strong> proliférations est très variab<strong>le</strong> d’un secteur côtier à un autre (plus ou moinsgrande précocité suivant <strong>le</strong>s secteurs). Cette plus ou moins grande précocité dépend largement de laconfiguration <strong>des</strong> baies (qui gardent plus ou moins bien <strong>le</strong>s algues de la prolifération précédente),- <strong>le</strong> démarrage <strong>des</strong> proliférations est très variab<strong>le</strong> suivant <strong>le</strong>s années (certaines années sontprécoces ou au contraire tardives). Cette précocité annuel<strong>le</strong> dépend à la fois <strong>des</strong> quantités présentes enfin de prolifération précédente (cf. Figure 1) et <strong>des</strong> conditions hiverna<strong>le</strong>s plus ou moins favorab<strong>le</strong>s aumaintien de ces algues voire à <strong>le</strong>ur croissance (en fonction principa<strong>le</strong>ment de l’agitation hiverna<strong>le</strong>, dela température de l’eau en hiver et au printemps),- <strong>le</strong> niveau atteint en « p<strong>le</strong>ine saison » (juil<strong>le</strong>t-août), et encore plus en arrière saison, (« aoûtseptembre») est très variab<strong>le</strong>. Ce niveau est bien corrélé avec <strong>le</strong>s apports de nutriments lorsde la période sensib<strong>le</strong> (mai-août), lui-même étroitement lié à la pluviosité printanière et estiva<strong>le</strong> (cf.Figure 2). A noter toutefois que la réaction perçue à l’échel<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong> est liée à la réaction <strong>des</strong> plusgrands sites (baie de Saint Brieuc notamment) mais que certains secteurs ont <strong>des</strong> réactions différentes,opposées parfois.premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 2 /20
1000900800700<strong>sur</strong>face avril + mai (ha)600500400300200100Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves en début de saison en fonction <strong>des</strong> <strong>sur</strong>facesatteintes en octobre précédent au niveau régional600500400300200100<strong>sur</strong>face octobre n-102002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011somme (avril mai) octobre n-1Figure 1 : précocité <strong>des</strong> échouages à l’échel<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong> (estimée par la somme <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> en avril+mai) et lienavec <strong>le</strong> niveau <strong>des</strong> stocks d’algue de l’année n-1 (estimé par <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces en octobre n-1). Les années 2006 et 2010 sonten outre caractérisées par <strong>des</strong> températures de l’eau anorma<strong>le</strong>ment basses (cf. ci-<strong>des</strong>sous) et l’hiver 2007 par un caractèreparticulièrement dispersif (cf. ci-<strong>des</strong>sous) ce qui explique <strong>le</strong>s retards me<strong>sur</strong>és par rapport à l’attendu.030 000Flux d'azote moyen pour <strong>le</strong>s années 2002 à 2010 et niveau demarée verte annuel (fin saison)160025 0001400Flux (kg/mois)20 00015 00010 0005 00012001000800600400<strong>sur</strong>face août+sept (ha)02002* 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Flux moyen N BV AV mai-août<strong>sur</strong>face couverte sites sab<strong>le</strong>ux août+sept (ha)Figure 2 : Surfaces d’échouages me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sites <strong>breton</strong>s de type plage au cours <strong>des</strong> années 2002-2010 enfin de saison et flux d’azote arrivant au <strong>littoral</strong> (moyenne <strong>des</strong> flux N de mai à août <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s BV de « Pro<strong>littoral</strong> » + baie deSaint Brieuc ; flux de phosphate non analysés car <strong>le</strong> phosphore utilisé par <strong>le</strong>s algues pour <strong>le</strong>ur croissance provient en trèsgrande majorité du sédiment et non directement <strong>des</strong> rivières comme c’est <strong>le</strong> cas pour l’azote). Pour <strong>le</strong>s années 2002 et 2003,<strong>le</strong>s flux ont été calculés sans intégrer <strong>le</strong>s données du Quillimadec (débits manquants).2001000900800700Surfaces d'échouages <strong>des</strong> ulves <strong>sur</strong> l'ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites sab<strong>le</strong>ux <strong>breton</strong>s(rideau + échouage en équiva<strong>le</strong>nt 100%)200220032004200520062007200820092010Moyenne 02- 09hectares6005004003002001000avril mai juin juil<strong>le</strong>t août septembre octobreFigure 3 : Surfaces d’échouages me<strong>sur</strong>ées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sites <strong>breton</strong>s de type plage au cours <strong>des</strong> années 2002-2010. Anoter, <strong>le</strong>s très fortes variations interannuel<strong>le</strong>s pour ce qui est du démarrage de la saison (2006, 2007 ou 2010 tardives/2009 ou 2008 précoces) comme de son niveau atteint en « arrière saison » (2005 ou 2010 par exemp<strong>le</strong> relativement peuchargées /2004, 2007 ou 2008 très chargées).premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 3 /20
2) Situation de l’année 20112.1) Inventaires réalisés :Deux <strong>sur</strong>vols partiels du <strong>littoral</strong> ont été déc<strong>le</strong>nchés par <strong>le</strong> CEVA, en plus <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols de <strong>sur</strong>veillanceprévus, lors d’épiso<strong>des</strong> de temps favorab<strong>le</strong> et de grand coefficient (18 février pour évaluation sommairede biomasse <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies de la Lieue de Grève et de Morlaix et 21 mars : baie de Douarnenez puisLocquirec – Saint Michel- Binic-St Brieuc-Fresnaye-Lancieux).Le premier inventaire <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites principaux s’est déroulé : <strong>le</strong> 19 avril,Le premier inventaire « général » à la mi-mai : sud Bretagne <strong>le</strong> 17 mai et Nord Bretagne <strong>le</strong> 18 mai,Le deuxième inventaire <strong>des</strong> sites principaux : <strong>le</strong> 16 juin,Le deuxième inventaire « général » à la mi-juil<strong>le</strong>t : Nord Bretagne <strong>le</strong> 14 juil<strong>le</strong>t ; sud Bretagne <strong>le</strong> 16 juil<strong>le</strong>t,Le troisième inventaire <strong>des</strong> sites principaux : <strong>le</strong> 15 août,Le troisième inventaire « général » à la mi-septembre : Sud Bretagne <strong>le</strong> 13 et Nord Bretagne <strong>le</strong> 15septembreLe quatrième et dernier inventaire <strong>des</strong> sites principaux : <strong>le</strong> 14 octobre2.2) Résultats <strong>des</strong> observations : Relation stocks automne n-1 et précocitéL’analyse <strong>des</strong> suivis <strong>des</strong> années précédentes permet, à l’échel<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong> de mettre en relation laprécocité de la marée verte avec <strong>le</strong>s niveaux de stocks à l’automne (ce niveau d’automne étant de soncôté conditionné par <strong>le</strong>s flux azotés de printemps été, cf. Figure 2).1000900800700<strong>sur</strong>face avril + mai (ha)600500400300200100Surfaces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves en début de saison en fonction <strong>des</strong> <strong>sur</strong>facesatteintes en octobre précédent au niveau régional600500400300200100<strong>sur</strong>face octobre n-102002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011somme (avril mai) octobre n-1Figure 4 : précocité <strong>des</strong> échouages à l’échel<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong> (estimée par la somme <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> en avril+mai) et lienavec <strong>le</strong> niveau <strong>des</strong> stocks d’algue de l’année n-1 (estimé par <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces en octobre n-1). Sur ce premier critère, <strong>le</strong>s stocksétant plutôt bas (lien notamment avec la situation de la Baie de Saint Brieuc) l’année 2011 serait plutôt attenduemoyenne à tardive.0A noter que tous <strong>le</strong>s sites ne réagissent pas de la même manière et que certains sites montrent uneindépendance entre <strong>le</strong> niveau de stocks à l’automne et la précocité de la marée verte suivante(notamment sites du Finistère Nord, ces sites, tous <strong>le</strong>s ans tardifs, reconstituant <strong>le</strong>urs proliférations àpartir de stocks nuls ou quasi nuls).D’après cette analyse on peut attendre pour 2011 une prolifération « régiona<strong>le</strong> » plutôt tardive. Anoter cependant que pour certains sites (notamment baie de la Lieue de Grève), <strong>le</strong>s échouages en finde saison, en octobre et encore d’avantage en novembre étaient relativement importants par rapportaux années moyennes contrairement au niveau régional (qui est très dépendant de la situation de laBaie de Saint Brieuc et dans une moindre me<strong>sur</strong>e de la Fresnaye).premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 4 /20
Caractéristiques hiverna<strong>le</strong>s / début du printemps :o Température de l’eau :Des températures de l’eau basse en hiver et au printemps engendrent <strong>des</strong> proliférations retardées auprintemps comme ça a été particulièrement <strong>le</strong> cas en 2006 ou 2010.1716151413Données Somlit Astan en <strong>sur</strong>face - 1m (Roscoff)200020012002200320042005200620072008200920102011moyenne2000-200912111098janvierfevriermarsavrilmaijuinFigure 5 : Températures de l’eau re<strong>le</strong>vées à Roscoff par la Station Biologique de Roscoff dans <strong>le</strong> cadre de SOMLIT(données mensuel<strong>le</strong>s issues de la moyenne <strong>des</strong> deux va<strong>le</strong>urs de mortes eaux mensuel<strong>le</strong>s à 1 m sous la <strong>sur</strong>face <strong>sur</strong>Astan).On note, fin 2010, début 2011<strong>des</strong> températures de l’eau particulièrement basses, devenant moyennes en marspuis supérieures à la moyenne en avril.juil<strong>le</strong>taoûtseptembreoctobrenovembredécembreOn note <strong>des</strong> températures très basses en entrée d’hiver (décembre et janvier) un peu plus é<strong>le</strong>vées enfévrier et devenant même moyennes pour mars à la faveur probab<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> conditions calmes etenso<strong>le</strong>illées. Ce paramètre plutôt défavorab<strong>le</strong> à la précocité <strong>des</strong> proliférations en début d’hiver estdevenu relativement favorab<strong>le</strong> ensuite ; il est donc diffici<strong>le</strong> de conclure <strong>sur</strong> ce point.o Caractère dispersif de l’hiver :Le caractère perturbé de l’hiver (vent, hou<strong>le</strong>) tend à disperser <strong>le</strong>s biomasses automna<strong>le</strong>saccumulées et donc à diminuer la précocité de la prolifération suivante. Pour apprécier <strong>le</strong> caractèredispersif sont représentés, en Figure 6, <strong>le</strong> nombre de jours de hou<strong>le</strong> supérieur à un certain seuil d’après<strong>le</strong> modè<strong>le</strong> GFS à Lannion (indicatrices <strong>des</strong> tendances régiona<strong>le</strong>s).1009080Hou<strong>le</strong> hiverna<strong>le</strong> <strong>sur</strong> la baie de Lanniondonnées GFS-Windguru-Lannion-Synthèse-novembre à marsnb jour hou<strong>le</strong> > 4,5mnb jour hou<strong>le</strong> entre 3,5 et 4,5mnb jour hou<strong>le</strong> entre 2,5 et 3,57060504030201002003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008* 2008-2009 2009-2010 2010-2011* mars très dispersif : 18 j >2,5 dont 10 >3,5Figure 6 : dispersion hiverna<strong>le</strong> estimée <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> jours de hou<strong>le</strong> modélisés par GFS et archivées <strong>sur</strong> Windguru pour<strong>le</strong> site de Lannion (indication du caractère dispersif à l’échel<strong>le</strong> de la région).On peut re<strong>le</strong>ver d’après la figure 6 un hiver très peu dispersif (proche de l’hiver 2003-2004particulièrement peu dispersif et légèrement plus dispersif que l’hiver <strong>le</strong> plus calme 2004-2005). Anoter <strong>le</strong> mois de mars particulièrement peu dispersif, pour <strong>le</strong>quel, excepté en début de mois (<strong>le</strong>s 2et 3) et fin de mois (<strong>le</strong> 31) tous <strong>le</strong>s jours présentaient un niveau moyen inférieur à 2.5 m. Ce paramètreest donc plutôt favorab<strong>le</strong> (comme 2003-2004 puis 2004-2005) à une prolifération précoce.premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 5 /20
Synthèse :L’analyse <strong>des</strong> trois paramètres (stocks en fin de saison, température de l’eau, aspect dispersif del’hiver) a permis <strong>le</strong>s années précédentes au CEVA de prévoir la précocité de la marée verte defaçon satisfaisante (en particulier a<strong>le</strong>rte dès décembre 2008 <strong>sur</strong> <strong>des</strong> échouages attendus très massifsau printemps 2009, prévision du caractère tardif de la prolifération 2010).Pour ce qui est de l’année 2011 quant à sa précocité, il est particulièrement diffici<strong>le</strong> de statuer étantdonnés <strong>le</strong>s divergences entre <strong>le</strong>s différents paramètres impliqués :- stocks automnaux plutôt bas à l’échel<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong> (particulièrement <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc etdans une moindre me<strong>sur</strong>e baie de la Fresnaye) induisant a priori une prolifération tardive,- température de l’eau basse jusqu’en février plaidant plutôt pour une marée verte tardive maisdevenant moyenne en mars annulant quelque peu la tendance hiverna<strong>le</strong>,- hiver peu dispersif <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> jours de hou<strong>le</strong> supérieurs à différents seuils et très peudispersif pour <strong>le</strong> mois de mars ce qui tend à provoquer une précocité plus marquée <strong>des</strong>proliférations.Les conditions météorologiques <strong>des</strong> semaines à venir pourraient donc être crucia<strong>le</strong>s pourgénérer une année plutôt précoce ou au contraire retardée (en particulier si <strong>le</strong> début avril estparticulièrement agité la prolifération pourra être moyenne à tardive, par contre si <strong>le</strong> temps resteplutôt calme et enso<strong>le</strong>illé, <strong>le</strong>s échouages pourraient être plutôt précoces, sans l’être autant tout demême que <strong>le</strong>s années <strong>le</strong>s plus précoces comme 2008 ou 2009).On peut envisager en outre, qu’en fonction <strong>des</strong> sites l’influence relative de ces trois paramètres<strong>sur</strong> la précocité d’un site donné soit plus ou moins forte (pour certains sites très confinant <strong>le</strong>paramètre stock en sortie d’hier pourrait être primordial alors que pour <strong>des</strong> sites exposés à la hou<strong>le</strong> cepourrait être <strong>le</strong> caractère dispersion hivernal qui jouerait davantage, …). On pourrait donc avoir <strong>des</strong>démarrages plus ou moins précoces en fonction <strong>des</strong> sites sans que l’on s’attende à une situation2011 « extrême » en terme de précocité (exception envisagée pour la baie de la Fresnaye et la baie deSaint Brieuc pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s stocks en automnes étaient respectivement nuls ou particulièrementbas et qui pourraient donc être tardifs). A noter que <strong>le</strong> CEVA se propose de développer à partir de2011 <strong>des</strong> outils permettant, pour certains sites, d’approfondir <strong>le</strong>s connaissances <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s relationsentre <strong>le</strong>s différents paramètres de milieu pour mieux prédire la précocité <strong>des</strong> proliférations (etéga<strong>le</strong>ment l’échouage <strong>des</strong> biomasses <strong>des</strong> sites dans la saison). Eléments d’appréciation <strong>des</strong> stocks en mars 2011 (<strong>sur</strong>vol très partiel <strong>des</strong> côtes)Afin de tenter de mieux cerner la situation du début de saison 2011 et sans attendre <strong>le</strong> premier vol dela mi avril, un <strong>sur</strong>vol <strong>sur</strong> quelques sites a été planifié <strong>le</strong> 21 mars 2011 (dans <strong>des</strong> conditions quiétaient très favorab<strong>le</strong>s pour d’éventuel<strong>le</strong>s échouages et pour un <strong>sur</strong>vol en cette période souvent peupropice). L’analyse <strong>des</strong> photos est délicate dans la me<strong>sur</strong>e où nous ne disposons que de très peu dedonnées de référence à cette période de l’année (pas de suivi établi mais quelques donnéesfragmentaires <strong>le</strong>s années précédentes).Le <strong>sur</strong>vol met en évidence :- <strong>des</strong> quantités déjà importantes en baie de Douarnenez (stocks infralittoraux visib<strong>le</strong>s, et rideauximposants pour la saison et même <strong>des</strong> échouages <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages de Lestrevet, Kervijen/Ty an Quer,Trezmalaouen et <strong>le</strong> Ry). A noter que <strong>le</strong>s conditions lors du vol étaient particulièrement favorab<strong>le</strong>saux dépôts/mise en rideau <strong>des</strong> algues et que nous ne disposons d’aucune année de comparaisonpour la fin mars qui permettrait de valider <strong>le</strong> côté précoce de l’année 2011 au vu de ces observations.L’année 2011 pourrait donc être précoce <strong>sur</strong> ce site (si <strong>le</strong>s conditions début avril sont peudispersives et enso<strong>le</strong>illées),- Baie de Saint Michel en Grève : <strong>le</strong>s échouages sont à cette date en forte augmentation par rapportà ce qui avait été photographié <strong>le</strong> 18 février (évaluation sommaire de biomasse de moins de 100T).Les quantités sont apparemment nettement inférieurs à ceux re<strong>le</strong>vés <strong>le</strong> 27 février 2009 (autour de1000T et ayant conduit à une marée verte très précoce) et assez proches d’avril 2010 (annéemoyennement précoce <strong>sur</strong> ce site). L’année 2011 pourrait donc être précoce <strong>sur</strong> ce site (si <strong>le</strong>sconditions début avril sont peu dispersives et enso<strong>le</strong>illées),premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 6 /20
- Binic/Etab<strong>le</strong>s : très peu d’algues dans <strong>le</strong> site (et apparemment pas d’ulves mais plutôt <strong>des</strong> alguesrouges). Peu de référence <strong>sur</strong> ce site, mais la situation semb<strong>le</strong> norma<strong>le</strong> (rarement <strong>des</strong> ulves en débutde saison), donc perception aérienne diffici<strong>le</strong>ment exploitab<strong>le</strong> pour juger de la précocité de l’année,- Baie de Saint Brieuc : lors du vol il n’a pas été possib<strong>le</strong> de voir la moindre trace d’algue verte (niautre). Cette situation semb<strong>le</strong> plutôt habituel<strong>le</strong> et conforme aux années antérieures exception faitede l’année 2008 (année qui, d’après quelques observations, de terrain uniquement, semb<strong>le</strong> avoirprésenté <strong>des</strong> algues durant tout l’hiver). Le CEVA dispose de peu voire pas de donnée decomparaison à la fin mars pour valider <strong>le</strong> caractère « ordinaire » de la situation 2011. L’absenced’algue <strong>le</strong> 21 mars malgré <strong>le</strong>s conditions plutôt favorab<strong>le</strong>s à l’échouage, associé à la faib<strong>le</strong>prolifération 2010 permet d’envisager une prolifération retardée <strong>sur</strong> ce site, mais l’absence deréférence antérieure ne permet pas de garantir cette prédiction,- Baie de la Fresnaye : à cette date la baie est déjà (encore) très chargée d’algue brune (trèsprobab<strong>le</strong>ment Pylaïella comme <strong>le</strong>s années antérieures). Cette situation est, depuis 2006, devenue« classique » pour cette baie et on peut s’attendre à un début de saison dominé par cette algue.- Baie de Lancieux : très peu d’algue lors du <strong>sur</strong>vol et a priori <strong>sur</strong>tout <strong>des</strong> algues brunes et / ourouges. Situation qui serait a priori habituel<strong>le</strong> pour ce site (mais pas de référence par <strong>des</strong> suivisantérieurs à cette période) ne permet pas de prédire <strong>le</strong> caractère précoce de l’année. Il semb<strong>le</strong> tout demême que l’absence de stocks associé à la situation de la Fresnaye et à une fin d’hiver / début deprintemps peu arrosée (baie tous <strong>le</strong>s ans fortement limitée par l’azote précocement) pourrait induireune faib<strong>le</strong> prolifération <strong>sur</strong> cette baie. Eléments issus du premier <strong>sur</strong>vol du 19 avril 2011,Depuis <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol partiel du 21 mars, <strong>le</strong>s conditions climatiques semb<strong>le</strong>nt (<strong>le</strong>s données n’ont pas faitl’objet d’analyse chiffrée pour tous <strong>le</strong>s paramètres ; l’enso<strong>le</strong>il<strong>le</strong>ment à St Brieuc par exemp<strong>le</strong> est d’après<strong>le</strong>s re<strong>le</strong>vés de Météo France presque 2 fois plus important que la norma<strong>le</strong> pour avril 2011) globa<strong>le</strong>menttrès favorab<strong>le</strong>s à la forte croissance <strong>des</strong> algues : conditions peu dispersives (peu de vent/hou<strong>le</strong>),lumineuses (peu de couverture nuageuse et probab<strong>le</strong>ment turbidité <strong>des</strong> masses d’eau côtières plusfaib<strong>le</strong> qu’habituel<strong>le</strong>ment en lien avec <strong>des</strong> débits <strong>des</strong> cours d’eau très bas) et <strong>des</strong> températures de l’eauqui seraient devenues plutôt propices après un début d’hiver plus froid que la moyenne (températuremoyenne de l’eau me<strong>sur</strong>ée par SOMLIT à Roscoff de 11.4°C contre 10.7 pour la moyenne <strong>des</strong> années2000-2009). Il faut donc s’attendre à <strong>des</strong> quantités d’algues importantes <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s secteurs qui ontplutôt bien maintenu <strong>le</strong>urs algues durant l’hiver et à de très fortes croissances <strong>des</strong> algues <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s secteursqui en sont pourvus.Ce premier <strong>sur</strong>vol ne concerne pas l’ensemb<strong>le</strong> de la côte <strong>breton</strong>ne mais <strong>le</strong>s sites prédéfinis (cf 1.1).Afin d’être réactif, <strong>le</strong>s informations proposées ici sont issues de l’analyse visuel<strong>le</strong> comparée <strong>des</strong>clichés acquis <strong>le</strong> 19 avril par rapport à la connaissance du CEVA <strong>des</strong> années antérieures et <strong>sur</strong> <strong>le</strong>ssecteurs principaux de la me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces échouées (données partiel<strong>le</strong>ment validées).L’analyse visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés et <strong>le</strong>s premières me<strong>sur</strong>es indiquent :- Une couverture encore faib<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> Nord Est du Golfe du Morbihan (Arcal-Séné) et <strong>sur</strong> la rivièred’Auray, plutôt inférieure aux années antérieures,- Des figures mo<strong>des</strong>tes d’échouages d’algues (apparemment <strong>des</strong> algues brunes filamenteuses) <strong>sur</strong> labaie de Quiberon et <strong>sur</strong> l’ouest de l’Isthme mais très en deçà <strong>des</strong> gros échouages qui étaientconstatés, par exemp<strong>le</strong>, en avril 2009 <strong>sur</strong> la baie de Quiberon et en avril 2010 <strong>sur</strong> l’ouest del’Isthme,- Des tapis apparemment épais en Ria d’Etel <strong>sur</strong> la partie <strong>sur</strong>volée (Sud de la Ria, au nord de Beltz)ce qui est habituel <strong>sur</strong> ce site très précoce (apparemment couvertures plus importantes qu’en avril2009 et comparab<strong>le</strong>s aux années 2008 et 2010 <strong>sur</strong> la partie sud de la ria <strong>sur</strong>volée),- Des couvertures déjà importantes <strong>sur</strong> la rade de Lorient (comparab<strong>le</strong>s à 2008 et 2009 années quiétaient très chargées dès <strong>le</strong> début de saison et bien supérieures à 2010 qui était peu précoce), maistrès peu <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages de Larmor Plage et Kerpape (<strong>sur</strong>tout en comparaison de 2008 ou 2009), unpetit rideau apparemment d’algues <strong>vertes</strong> détecté à l’ouest de Fort Bloqué,premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 7 /20
- Des échouages déjà très importants <strong>sur</strong> la baie de la Forêt, très nettement supérieurs à ceuxme<strong>sur</strong>és en 2010 et même 2008 ou 2009 (plus particulièrement <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s « sites » de Cabellou : niveaunettement supérieur à 2010 mais proche de 2008 ou 2009, Ker<strong>le</strong>ven : couvertures très supérieuresà 2010 et 2008 et légèrement inférieure à 2009 : avril 2011 est de 60 % supérieur à la moyenne2002-2010, Cap Coz : niveau nettement supérieur aux années 2008 à 2010 ; la me<strong>sur</strong>e d’avril est deplus du trip<strong>le</strong> de la moyenne 2002-2010 et inférieure à une seu<strong>le</strong> va<strong>le</strong>ur d’avril, cel<strong>le</strong> de l’année2005) et constitués majoritairement d’ulves. A noter lors du vol <strong>des</strong> conditions permettant devisualiser <strong>des</strong> stocks infralittoraux importants.- De grosses quantités visib<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> la baie de Douarnenez, majoritairement en rideau et eninfra<strong>littoral</strong> mais avec même <strong>des</strong> échouages importants <strong>sur</strong> certaines plages (Trezmalaouen enpremier lieu, Cameros et Sainte Anne la Palud éga<strong>le</strong>ment). L’analyse rapide <strong>des</strong> clichés 2011comparée aux années antérieures semb<strong>le</strong>nt placer l’année 2011 au même niveau voire au <strong>des</strong>susque 2009, année particulièrement précoce et nettement au <strong>des</strong>sus de 2008 et 2010. Les me<strong>sur</strong>esréalisées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s clichés d’avril placent effectivement l’année 2011 très au <strong>des</strong>sus <strong>des</strong> annéesantérieures : année dont <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces sont <strong>le</strong>s plus importantes <strong>sur</strong> la série, de 50 % supérieurà l’année 2009 qui était particulièrement précoce et supérieur d’un facteur 4 à la moyenned’avril 2002-2010. Le <strong>sur</strong>vol d’avril semb<strong>le</strong> confirmer la perception lors du <strong>sur</strong>vol du 21 mars ; <strong>le</strong>sconditions particulièrement peu dispersives et lumineuses seraient donc à mettre au premier planpour expliquer la précocité de la prolifération <strong>sur</strong> ce secteur,- Les quantités échouées ou visib<strong>le</strong>s en infra<strong>littoral</strong> devant <strong>le</strong> Moulin Blanc semb<strong>le</strong>nt là aussisupérieures aux années antérieures (et très nettement par rapport à 2010 qui ne comportait à cettepériode presque pas d’algue). A noter une colonisation qui semb<strong>le</strong>, plus au large, dominée par <strong>des</strong>algues rouges.- Des échouages importants <strong>sur</strong> <strong>le</strong> secteur du Quistillic (plage de la presqu’i<strong>le</strong> Sainte Marguerite, àl’exutoire de l’Aber Wrac’h),- Des quantités (en rideau) plutôt mo<strong>des</strong>tes à cette date <strong>sur</strong> Moguéran / Coréjou, visib<strong>le</strong>mentinférieure à 2009 année la plus précoce de la série,- Très peu d’algues <strong>vertes</strong> apparemment <strong>sur</strong> Guisseny, <strong>des</strong> dépôts constitués d’une majorité degoémon (taux d’ulves important seu<strong>le</strong>ment au niveau du rideau) comme c’est <strong>le</strong> cas en général àcette période (exception faite de l’année 2009 qui en avril comportait déjà <strong>des</strong> ulves en quantitéimportante et qui occultait la présence de goémon)- Très peu d’algues <strong>vertes</strong> apparemment <strong>sur</strong> Keremma/Porz Guen ce qui est habituel à cettepériode de l’année (toutefois présence d’ulves probab<strong>le</strong> devant Pors Meur en léger dépôt et rideauainsi que dans <strong>le</strong> port de Porz Guen),- Peu d’échouage <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Dossen (Horn/Guil<strong>le</strong>c), dominés par <strong>le</strong> goémon (présence de quelquesulves en rideau) ce qui est habituel <strong>sur</strong> ce site tardif,- Très léger rideau contenant <strong>des</strong> ulves <strong>sur</strong> l’Est de Locquirec ce qui est conforme aux annéesantérieures <strong>sur</strong> ce site plutôt tardif,- Des couvertures (dépôts et rideau) déjà importantes <strong>sur</strong> la baie de la Lieue de Grève. A noterque <strong>le</strong>s algues lors du vol étaient situés en partie inférieure de l’estran, <strong>le</strong> haut de plage étantépargné par <strong>le</strong>s échouages ce qui est très probab<strong>le</strong>ment à mettre en relation avec la tail<strong>le</strong> encorelimitée <strong>des</strong> algues qui évite <strong>le</strong>ur transport en haut de plage. Les échouages perceptib<strong>le</strong>s <strong>le</strong> 19 avrilsont supérieurs de 70 % à la moyenne d’avril 2002-2010 (donc supérieurs du mêmepourcentage à 2010, année proche de la moyenne <strong>sur</strong> ce site), très inférieurs à 2009 ou 2005 (année« records » en précocité) et nettement supérieurs à 2008, 2007 ou 2006 qui comportaient peud’algues en avril,- Des échouages (composition non estimée) assez importants <strong>sur</strong> Nantouar,- Un rideau et de légers échouages perceptib<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> Trestel (mélange avec du goémon maiscomportant <strong>des</strong> ulves en rideau), ce qui est assez peu significatif <strong>sur</strong> ce site habituel<strong>le</strong> tardif (maisce stocks de départ pourrait bien profiter de conditions qui resteraient stab<strong>le</strong>s et lumineuses),- Des échouages massifs <strong>sur</strong> Bréhec composés très majoritairement d’ulves. Ces échouagessont très supérieurs à ceux me<strong>sur</strong>és en moyenne <strong>le</strong>s années précédentes (près de 3 fois pluspremiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 8 /20
que la moyenne 2002-2010) et proche de 2007 qui comportait beaucoup d’algues déjà en avril maisinférieurs de 30 % à 2003, année la plus précoce de la série. Ce site est assez classiquement« chargé » d’ulves en début de saison et voit ensuite ses quantités rapidement diminuer exceptées<strong>le</strong>s années pluvieuses (comme 2007 qui comportait <strong>des</strong> échouages massifs encore en juin et juil<strong>le</strong>t).Si <strong>le</strong>s conditions de très faib<strong>le</strong> débit se maintenaient, <strong>le</strong>s niveaux de couverture pourraientdiminuer fortement dans <strong>le</strong>s semaines à venir.- Des échouages mo<strong>des</strong>tes <strong>sur</strong> Binic/Etab<strong>le</strong>s (principa<strong>le</strong>ment <strong>sur</strong> <strong>le</strong> secteur <strong>des</strong> Godelins)composés à cette date de part d’ulves faib<strong>le</strong>s (<strong>sur</strong>tout présence de Pylaïella, algue brunefilamenteuse). Cette quasi absence d’ulves en début de saison est habituel<strong>le</strong> <strong>sur</strong> ce site (exceptionfaite de 2004 qui comportait déjà <strong>des</strong> couvertures d’ulves importantes en avril),- Sur la Baie de Saint Brieuc, on constate la présence d’algues en rideau et en petits dépôts enpartie basse de l’estran. La comparaison avec <strong>le</strong>s années antérieures place l’année 2011 trèslargement en <strong>des</strong>sous <strong>des</strong> deux années exceptionnel<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong>ur précocité qu’étaient 2008 et2009. Les quantités, par contre, sont nettement supérieures à l’année 2010 exceptionnel<strong>le</strong>menttardive (comme l’étaient éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s années 2006 et 2007). L’année 2011 est donc tardive parrapport aux années « moyenne » puisque la me<strong>sur</strong>e d’avril est de 75 % inférieure à la moyenne2002-2010 (mais <strong>le</strong>s démarrages sont très variab<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> ce site rendant la notion de moyennediffici<strong>le</strong> à utiliser). A noter que <strong>le</strong>s stocks estimés en fin 2010 <strong>sur</strong> cette baie étaient faib<strong>le</strong>s ce quin’est pas <strong>le</strong> cas <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>s sites (50 % de moins en octobre 2010 par rapport à la moyenne 2002-2009). Les conditions d’éclairement et de calme sont très favorab<strong>le</strong>s à la croissance <strong>des</strong> algues encette période ; cependant si <strong>le</strong>s débits donc <strong>le</strong>s flux d’azote restaient anorma<strong>le</strong>ment bas comme ils<strong>le</strong> sont actuel<strong>le</strong>ment la prolifération pourrait être précocement limitée, y compris dans soninstallation complète,- La baie de la Fresnaye est toujours concernée, à cette date, par <strong>des</strong> proliférations de Pylaïella,algue brune filamenteuse, et autres algues rouges, en diminution assez sensib<strong>le</strong> par rapport à lasituation au 21 mars et à un niveau inférieur à 2010. A noter une figure localisée, assez diffuse, unpeu au-delà de la zone de rideau qui pourraient être due à la présence d’algues <strong>vertes</strong> (lorsd’opération de contrô<strong>le</strong>s de terrain, <strong>des</strong> ulves d’arrachage ont été retrouvées en mélanges avec <strong>le</strong>salgues brunes et rouges filamenteuses mais à <strong>des</strong> taux restant faib<strong>le</strong>s, inférieurs à 10 %),- La baie de l’Arguenon semb<strong>le</strong> indemne à cette date ; la baie de Lancieux est concernée par unrideau important et <strong>des</strong> échouages de bas de plage dominés par <strong>des</strong> algues brunes (Pylaïella, etquelques algues rouges filamenteuses) mais présentant une proportion non négligeab<strong>le</strong> d’ulves(loca<strong>le</strong>ment 20 – 30 %). Les couvertures à cette date semb<strong>le</strong>nt supérieures aux années antérieuresmais <strong>le</strong>ur composition est dominée par d’autres algues que <strong>le</strong>s ulves qui représentent <strong>sur</strong> la baie <strong>des</strong>quantités tota<strong>le</strong>s mo<strong>des</strong>tes,- Des couvertures <strong>sur</strong> la Rance (Vil<strong>le</strong> Ger, Vil<strong>le</strong> es Nonais, Saint Jouan de Guérets) qui semb<strong>le</strong>ntdéjà importantes pour la période.Ces observations rapi<strong>des</strong> consolidées par <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’échouage <strong>sur</strong> la plupart <strong>des</strong> sites(validation partiel<strong>le</strong>) peuvent être confrontées aux séries historiques pour positionner la précocité del’année 2011. Au niveau régional la <strong>sur</strong>face tota<strong>le</strong> me<strong>sur</strong>ée est à la mi-avril proche de lamoyenne interannuel<strong>le</strong> 2002-2010 mais cela résulte de situations contradictoires avec <strong>des</strong>échouages importants <strong>sur</strong> la plupart <strong>des</strong> secteurs et plus faib<strong>le</strong>s à inexistants <strong>sur</strong> la baie deSaint Brieuc et <strong>le</strong>s baies de l’est et du centre <strong>des</strong> Côtes d’Armor (Binic, baie de Saint Brieuc, de laFresnaye, de la Lancieux) :- une année précoces avec déjà beaucoup d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s secteurs de la baie de laForêt, baie de Douarnenez et Bréhec,- une situation assez proche de la « moyenne » <strong>sur</strong> la baie de la Lieue de Grève,- plutôt tardive <strong>sur</strong> la Baie de Saint Brieuc (mais <strong>le</strong> démarrage très irrégulier <strong>des</strong>proliférations de ce site rend diffici<strong>le</strong> <strong>le</strong> positionnement de l’année <strong>sur</strong> <strong>le</strong> seul mois d’avril)et en baie de Binic (situation habituel<strong>le</strong> <strong>sur</strong> ce secteur). A noter que la baie de la Fresnayesemb<strong>le</strong> encore à cette date pas ou peu concernée par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong>,premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 9 /20
Eléments issus du deuxième <strong>sur</strong>vol de la mi-mai 2011 (17 et 18 mai),Entre <strong>le</strong> dernier <strong>sur</strong>vol d’avril et <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>vols de mai, <strong>le</strong>s conditions climatiques sont restées dansl’ensemb<strong>le</strong> favorab<strong>le</strong>s à la croissance <strong>des</strong> algues (enso<strong>le</strong>il<strong>le</strong>ment supérieur, presque 2 fois à la norma<strong>le</strong>,température de l’eau au <strong>des</strong>sus de la moyenne, conditions peu dispersives et peu de précipitationsexceptés <strong>le</strong>s épiso<strong>des</strong> d’orage du début mai qui ont loca<strong>le</strong>ment apporté beaucoup d’eau).Afin d’être réactif, <strong>le</strong>s informations proposées ici sont issues d’une simp<strong>le</strong> analyse visuel<strong>le</strong>comparée <strong>des</strong> clichés acquis <strong>le</strong>s 17 et 18 mai par rapport à la connaissance du CEVA <strong>des</strong> annéesantérieures ; pour <strong>le</strong>s sites majeurs, ont depuis la dernière synthèse pu être ajoutées <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong>urfaces d’échouages et de rideau.L’analyse visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés et <strong>le</strong>s premières me<strong>sur</strong>es indiquent, pour <strong>le</strong>s secteurs principaux :- Des couvertures <strong>sur</strong> la Rance (Vil<strong>le</strong> Ger avec putréfaction loca<strong>le</strong>ment notée, Vil<strong>le</strong> es Nonais, SaintJouan de Guérets, Minihic <strong>sur</strong> Rance) qui semb<strong>le</strong>nt déjà importantes pour la période saufvisib<strong>le</strong>ment <strong>sur</strong> certaines anses (Troctin, Quelmer, Richardais),- Peu d’échouages <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies de Lancieux et Arguenon (<strong>sur</strong> Lancieux, <strong>le</strong>s échouages sontmo<strong>des</strong>tes et composés d’algues brunes filamenteuses en majorité ; d’ulves pour environ 40 % etd’algues <strong>vertes</strong> filamenteuse, Cladophora probab<strong>le</strong>ment pour mois de 10 %),- Des échouages relativement peu importants <strong>sur</strong> la Fresnaye, principa<strong>le</strong>ment <strong>sur</strong> <strong>le</strong> bas de l’estran eten rideau dense, dominés par <strong>des</strong> algues filamenteuses brunes et rouges mais avec <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong>en proportion non négligeab<strong>le</strong> de 5 à 10 %. Les premières analyses de ces algues <strong>vertes</strong> indiquentla présence de quelques ulves d’arrachage et de petits fragments identifiés comme étant del’Ulvaria (présents en quantité <strong>sur</strong> cette baie en 2007, 2008 et 2009),- Des <strong>sur</strong>faces d’échouage en forte augmentation <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc par rapport à avril (X12, passant de 10 à 120 ha). La <strong>sur</strong>face estimée à cette date se rapproche de la moyenneinterannuel<strong>le</strong> mais reste inférieure (de près de 20 %). Les échouages sont <strong>sur</strong>tout importants dansl’anse d’Yffiniac (près de 60 % supérieurs à la moyenne interannuel<strong>le</strong>, proche mais inférieur à 2008et 2009) et plus mo<strong>des</strong>tes dans l’anse de Morieux (très peu en haut de plage ; 50 % inférieur àla moyenne interannuel<strong>le</strong> et 4 fois inférieur à mai 2009) avec <strong>sur</strong>tout la particularité d’êtrecomposés d’une proportion d’algues brunes filamenteuses (Pyalïella probab<strong>le</strong>ment) qui estlargement majoritaire dans la partie Est de la baie et plus proche de la parité vers <strong>le</strong> centre de labaie. Cette situation est assez exceptionnel<strong>le</strong> et pourrait être liée au niveau nutritionnel trèsprobab<strong>le</strong>ment exceptionnel<strong>le</strong>ment bas cette année (plus particulièrement du côté anse de Morieux,<strong>le</strong> Gouessant dont <strong>le</strong> BV est schisteux ayant <strong>des</strong> flux très bas en année sèche : débits <strong>sur</strong> avril 4 foisinférieurs à la norma<strong>le</strong>, <strong>sur</strong> mai 5 fois inférieurs à la norma<strong>le</strong>),- Des échouages non négligeab<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> l’anse de Binic (côté Etab<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> Mer, plage <strong>des</strong> Godelins, etplage de la banche) mais sont composés d’une proportion d’ulves faib<strong>le</strong> (autour de 10 %) etdominés par <strong>des</strong> algues brunes et rouges filamenteuses (ce qui est habituel <strong>sur</strong> ce site en début <strong>des</strong>aison),- Le site de Bréhec qui était très chargé en avril est, en mai, à un niveau d’échouage relativementmo<strong>des</strong>te sensib<strong>le</strong>ment inférieur à la moyenne <strong>des</strong> années antérieures,- Sur <strong>le</strong> secteur de Trestel <strong>le</strong>s échouages semb<strong>le</strong>nt plutôt supérieurs aux années antérieures mais sontencore mo<strong>des</strong>tes <strong>sur</strong> ce site classiquement tardif,- Sur la baie de la Lieue de Grève, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces échouées sont en forte augmentation et concernentmassivement <strong>le</strong> haut de plage contrairement à ce qui était noté <strong>le</strong> 19 avril (cela était déjà noté <strong>le</strong> 2mai). La <strong>sur</strong>face d’échouage en mai est très légèrement supérieure (5 %) à la moyenne <strong>des</strong> annéesantérieures (mais inférieure de 30 % environ aux très fortes <strong>sur</strong>faces me<strong>sur</strong>ées en mai 2008 et2010),- Sur l’anse de Locquirec, <strong>le</strong>s échouages sont en mai encore très mo<strong>des</strong>tes ce qui est habituel <strong>sur</strong> cesite tardif (exception faites <strong>des</strong> années 2002, 2003 ou 2010 qui présentaient déjà, en mai, <strong>des</strong><strong>sur</strong>faces importantes),- Des échouages (mixte, comportant en haut de plage une part importante de Goémon) encoremo<strong>des</strong>tes <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Dossen (Horn / Guil<strong>le</strong>c), mais probab<strong>le</strong>ment supérieurs aux années moyennes <strong>sur</strong>premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 10 /20
ce site habituel<strong>le</strong>ment très tardif. A noter <strong>des</strong> échouages massifs <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages de Tevenn plus auNord probab<strong>le</strong>ment constitués d’algues <strong>vertes</strong> filamenteuses,- Les sites de Pors Guen et Keremma qui présentent <strong>des</strong> échouages relativement importants pour lasaison en partie constitués de goémon mais comportant très probab<strong>le</strong>ment une part importanted’ulve s(retours de terrain non encore disponib<strong>le</strong>s). Pour ce secteur habituel<strong>le</strong>ment tardif, 2011semb<strong>le</strong> donc particulièrement précoce,- La baie de Guisseny, secteur habituel<strong>le</strong>ment tardif est en 2011 plus précoces. Les échouages, <strong>sur</strong>l’anse du Club Nautique et Neiz Vran sont importants, <strong>sur</strong>tout composés d’ulves ; <strong>le</strong> reste de labaie est indemne d’algues,- Sur l’anse de Moguéran/Corejou, <strong>le</strong>s échouages sont probab<strong>le</strong>ment à un niveau proche voireinférieur à la moyenne, assez nettement inférieurs à 2009, 2007 ou 2002,- Le secteur <strong>des</strong> Aber est particulièrement concerné par <strong>des</strong> échouages parfois mixte (Coulouarn ouTréompan) et semblant constitués uniquement d’ulve <strong>sur</strong> l’Aber Wrac’h (Quistillic, baie <strong>des</strong> Anges,<strong>le</strong> Port) ou Benoit,- La baie de Douarnenez est fortement touchée par <strong>le</strong>s échouages, plus particulièrement la plage deTrezmalaouen, de Sainte Anne la Palud et de la Lieue de Grève (Lestrevet et Cameros). Les<strong>sur</strong>faces estimées sont en mai près de 3 fois supérieur à la moyenne interannuel<strong>le</strong> (+150 %) etmême légèrement supérieures (+10%) à l’année « record » 2009,- Des échouages importants sont notés <strong>sur</strong> <strong>le</strong> secteur de Lodonnec/Loctudy ,- La baie de la Forêt voit ses échouages diminuer par rapport au 19 avril mais ceux –ci restentimportants tout particulièrement <strong>sur</strong> Ker<strong>le</strong>ven, Cabellou et plusieurs <strong>des</strong> plages de Concarneau.Malgré cette diminution, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces sont probab<strong>le</strong>ment assez nettement supérieures à la norma<strong>le</strong>,à l’échel<strong>le</strong> de la baie et même <strong>sur</strong> Cap Coz malgré une situation plus favorab<strong>le</strong> qu’en avril.- La rade de Lorient est en mai très chargée, ainsi que certaines <strong>des</strong> plages à l’extérieur de la rade(<strong>littoral</strong> de Larmor Plage et Ploemeur). Le secteur de Fort Bloqué présentait éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong>échouages importants apparemment mixtes (composition non encore estimée mais manifestementcomportant beaucoup de goémons),- Des échouages relativement impressionnants mais apparemment dominés par <strong>des</strong> algues brunesou rouges (composition non encore déterminée) sont notés de part et d’autre de l’Isthme deQuiberon,- Le Sud d’Arzon, Port Saint Jacques et Penvins sont touchés par <strong>des</strong> échouages de compostionmixte, non encore établie,- Enfin vers, l’est, <strong>le</strong>s secteurs de la Mine d’Or, de la pointe du Bi<strong>le</strong>, de Mesquer, Piriac et <strong>le</strong> Croisicsont touchés par <strong>des</strong> échouages particulièrement importants pour <strong>le</strong> mois de mai,- Les vasières du Golfe du Morbihan et de la ria d’Etel sont éga<strong>le</strong>ment concernées par <strong>des</strong>échouages importants en mai (échouages qui semb<strong>le</strong>nt tout particulièrement importants <strong>sur</strong> l’Estdu Golfe et <strong>sur</strong> la plupart <strong>des</strong> vasières de la Ria d’Etel). Eléments issus du troisième <strong>sur</strong>vol de la mi-juin 2011 (16 juin),Contrairement à ce qui était noté pour <strong>le</strong>s deux précédents <strong>sur</strong>vols, <strong>le</strong>s conditions du début juin ontété plutôt défavorab<strong>le</strong>s à la croissance <strong>des</strong> algues et <strong>sur</strong>tout à <strong>le</strong>ur échouage <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies, au moinspour <strong>le</strong>s plus exposées. Les conditions de couverture nuageuse, de pluie et aussi de vent et hou<strong>le</strong> ontrendues diffici<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s acquisitions aériennes et <strong>le</strong>s données recueillies ne rendent pas forcément compte<strong>le</strong> plus fidè<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> stocks d’algues <strong>des</strong> baies. Cependant ces conditions défavorab<strong>le</strong>s, au moins <strong>sur</strong>certaines baies aux acquisitions aériennes sont réel<strong>le</strong>ment défavorab<strong>le</strong>s aux échouages et <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>esde <strong>sur</strong>faces qui seront réalisées traduiront donc cet éventuel moindre niveau d’algues <strong>sur</strong> ces premièressemaines de juin.Afin d’être réactif, <strong>le</strong>s informations proposées ici ne sont issues que d’une simp<strong>le</strong> analyse visuel<strong>le</strong>comparée <strong>des</strong> clichés acquis <strong>le</strong> 16 juin par rapport à la connaissance du CEVA <strong>des</strong> années antérieures.Depuis la dernière synthèse, <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’échouages de certains <strong>des</strong> plus importants sitespremiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 11 /20
ont pu être ajoutées, mais toutes ne sont pas encore validées. Les validations ainsi que la poursuite <strong>des</strong>digitalisations seront réalisées ultérieurement.L’analyse visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés et <strong>le</strong>s premières me<strong>sur</strong>es de <strong>sur</strong>face indiquent, pour <strong>le</strong>s secteursprincipaux :- Des couvertures plutôt mo<strong>des</strong>tes <strong>sur</strong> la partie du Golfe <strong>sur</strong>volée (nord ouest) <strong>sur</strong>tout par rapportaux années antérieures et tout particulièrement à 2007 ou 2008 années pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>scouvertures étaient déjà très fortes à cette date. Situation porche de 2010 qui présentait éga<strong>le</strong>mentpeu d’algues en début de saison.- Le Sud de la Ria d’Etel (seu<strong>le</strong> partie <strong>sur</strong>volée à cette date) présente éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> couverturesmodérées <strong>sur</strong>tout si on <strong>le</strong>s compare à cel<strong>le</strong>s de 2007 ou 2008 (et, dans une moindre me<strong>sur</strong>e 2010),- Des échouages en rade de Lorient déjà bien établis et plutôt supérieurs aux années antérieurespour ce mois de juin. On note même en certains point <strong>des</strong> figures de putréfaction (notamment <strong>sur</strong>la vasière du Ter et de Locmiquelic). Le jour du vol, <strong>le</strong>s dépôts étaient très importants éga<strong>le</strong>ment<strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages en sortie de rade (notamment <strong>sur</strong> la Nourriguel, <strong>le</strong>s plages de Locqueltas etLomener),- De très gros dépôts <strong>sur</strong> Fort Bloqué,- Des échouages importants <strong>sur</strong> la baie de la Forêt, dans l’anse du Cabellou, <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s différentesplages de Concarneau et <strong>sur</strong> Ker<strong>le</strong>ven, Cap Coz et jusqu’à Beg Meil (2 fois la moyenneinterannuel<strong>le</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s secteurs de Cap Coz et Ker<strong>le</strong>ven ayant fait l’objet de me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong>faciques). Anoter aussi de très importants stocks infra littoraux visib<strong>le</strong>s lors du <strong>sur</strong>vol,- Une quasi absence d’échouages <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages de la baie de Douarnenez. Par contre on perçoit lorsdu <strong>sur</strong>vol <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’algues en rideau qui sont importantes (rideau étirés par <strong>le</strong>s conditions dehou<strong>le</strong>) : légèrement inférieures aux <strong>sur</strong>faces tota<strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>ées en mai mais supérieures (de 15 %) àla moyenne interannuel<strong>le</strong> pour juin (mais inférieur à 2009 et 2010). Les conditions ayant précédées<strong>le</strong> vol (temps perturbé d’ouest) expliquent cette situation et un retour à <strong>des</strong> conditions propicesaux échouages entrainera un retour sous quelques jours <strong>des</strong> échouages <strong>sur</strong> plage.- Des échouages importants <strong>sur</strong> l’anse du Moulin Blanc et <strong>des</strong> stocks infralittoraux perceptib<strong>le</strong>s,- Des <strong>sur</strong>faces (<strong>sur</strong>tout en rideau) qui restent limitées <strong>sur</strong> Moguéran Corréjou proche de 2010 et trsinférieures notamment aux années 207 à 2009,- Des <strong>sur</strong>faces limitées <strong>sur</strong> l’anse de Guissény, en très faib<strong>le</strong> évolution par rapport à la situationre<strong>le</strong>vée en mai et nettement inférieures à la moyenne pluriannuel<strong>le</strong> et très inférieures aux <strong>sur</strong>facesme<strong>sur</strong>ées en juin 2008 ou 2009 (moins de la moitié de la <strong>sur</strong>face interannuel<strong>le</strong> pour juin ; donnéeprovisoire),- Des <strong>sur</strong>faces probab<strong>le</strong>ment proches du niveau <strong>des</strong> dernières années <strong>sur</strong> Keremma et Pors Guen(mais bien inférieur à 2009 <strong>sur</strong> Pors Guen),- Des échouages probab<strong>le</strong>ment légèrement inférieurs à la moyenne <strong>des</strong> dernières années <strong>sur</strong>l’Horn/Guil<strong>le</strong>c, site habituel<strong>le</strong>ment tardif, et très nettement inférieur au niveau me<strong>sur</strong>é en 2009 (etprobab<strong>le</strong>ment même 2010). A noter que <strong>sur</strong> ce site très exposé à la hou<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s conditions ayantprécédées <strong>le</strong> vol sont probab<strong>le</strong>ment, en partie au moins, responsab<strong>le</strong> de ce moindre niveau. Anoter éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> échouages importants <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages au Nord de Santec (TEvenn et Pouldu),- Un niveau plutôt inférieur à la moyenne <strong>sur</strong> Locquirec et très inférieur aux trois annéesprécédentes,- Des échouages en forte régression par rapport à mai <strong>sur</strong> la baie de la Lieue de Grève (à noter toutde même <strong>des</strong> putréfactions apparentes <strong>sur</strong> Toul ar Vilin). La superficie lors du vol, principa<strong>le</strong>mentconstituée d’algues en rideau, est la plus basse de la série 2002-2011 pour un mois de juin (60 %inférieure à la situation moyenne de juin). Les conditions <strong>des</strong> jours précédents <strong>le</strong> vol sont bien sûren bonne partie responsab<strong>le</strong> de ce niveau,- Des échouages modérés <strong>sur</strong> Trestel mais stocks total plus important (rideau et <strong>des</strong> alguesinfralittora<strong>le</strong>s),- Très peu d’algues perceptib<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> Bréhec en juin (contrairement à la situation d’avril),premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 12 /20
- Des couvertures relativement importantes <strong>sur</strong> Binic, mais encore à cette date, dominées par <strong>des</strong>algues brunes de type Pylaïella, ce qui n’est pas habituel pour ce site pour cette date déjà avancée,- Une forte progression <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> la Baie de Saint Brieuc depuis mai, mais uncumul de <strong>sur</strong>faces qui est inférieur à la moyenne interannuel<strong>le</strong> (-35%) et nettement inférieur àl’année 2009 de très forte intensité pour juin (2 fois moindre). Les <strong>sur</strong>faces me<strong>sur</strong>ées en juin 2011,sont de l’ordre de cel<strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>ées en 2010, année de particulièrement faib<strong>le</strong> prolifération (environ25 % supérieure). Des putréfactions sont notées en certains points de la baie. A noter, malgrél’augmentation <strong>des</strong> parts d’ulves, <strong>le</strong> maintien, <strong>sur</strong> l’Est de la baie, d’une proportion non négligeab<strong>le</strong>d’algues brunes en mélange. A noter éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces dans l’anse d’Yffiniac sontconformes à la moyenne interannuel<strong>le</strong> alors qu’el<strong>le</strong>s sont de 50 % inférieure <strong>sur</strong> la partie baie deMorieux.- La baie de la Fresnaye est en juin concernée presqu’exclusivement par <strong>des</strong> algues brunes de typePylaïella, <strong>sur</strong>tout en rideau,- La baie de Lancieux semb<strong>le</strong> en juin encore concernée principa<strong>le</strong>ment par <strong>des</strong> algues brunes de typePylaïella (mais pas encore de retours de terrain pour valider <strong>le</strong>s compositions alga<strong>le</strong>s),- Enfin, <strong>sur</strong> la Rance, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces semb<strong>le</strong> encore importantes en juin avec, par endroit (Vil<strong>le</strong> esNonais, Saint Jouan), <strong>des</strong> plaques putréfiantes. Eléments issus du quatrième <strong>sur</strong>vol de la mi-juil<strong>le</strong>t 2011 (14 et 15 juil<strong>le</strong>t),Depuis <strong>le</strong> dernier <strong>sur</strong>vol de la mi juin, <strong>le</strong>s conditions climatiques ont été variab<strong>le</strong>s avec alternance detemps relativement calme et de passages plus perturbés entrainant vent et hou<strong>le</strong> (moins favorab<strong>le</strong>s aumaintien <strong>des</strong> algues dans <strong>le</strong>s sites). Les débits <strong>des</strong> cours d’eau, d’après <strong>le</strong>s données analysées de quelquesstations limnigraphiques, demeurent inférieurs à très inférieurs aux norma<strong>le</strong>s (par ex. près de 5 foismoins que la norma<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> Gouessant en juin et 3 fois en juil<strong>le</strong>t, situation proche pour <strong>le</strong> Gouet ;débits 2 à 3 fois inférieurs <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Yar pour Juin et juil<strong>le</strong>t).L’analyse visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés et <strong>le</strong>s premières me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sites permettent dedécrire :- <strong>des</strong> colonisations plutôt mo<strong>des</strong>tes à cette date <strong>sur</strong> la Rance (apparemment peu d’épaisseur). Anoter quelques points de putréfaction <strong>sur</strong> la Vil<strong>le</strong> Ger et la Vil<strong>le</strong> es Nonais,- peu ou pas d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies de l’Est <strong>des</strong> Côtes d’Armor alors que quelquesannées auparavant ce secteur était parmi <strong>le</strong>s plus important en <strong>sur</strong>face d’échouage d’ulves : rideauet échouages apparemment 100 % brun (Pyalaïella) <strong>sur</strong> la baie de Lancieux et la Fresnaye,- une situation inédite en baie de Saint Brieuc : <strong>le</strong>s échouages sont dominés par <strong>le</strong>s ulves maiscomportent encore à cette date une part importante d’autres algues (algues brunes filamenteusesde type Pylaïella et diverses algues rouges filamenteuses). Par ail<strong>le</strong>urs <strong>le</strong>s ulves présentes sont decou<strong>le</strong>ur pâ<strong>le</strong> et sont largement épiphytées par de petites algues rouges (signe d’un mauvais étatphysiologique). Les me<strong>sur</strong>es de <strong>sur</strong>face (rendues comp<strong>le</strong>xes par <strong>le</strong> mélanges ulves/autres algues)indique un niveau de <strong>sur</strong>face d’algues <strong>vertes</strong> légèrement en retrait par rapport à juin doncnettement en <strong>des</strong>sous de la moyenne <strong>des</strong> années antérieure (près de 40 % inférieur) et proche(légèrement inférieur) de la situation exceptionnel<strong>le</strong>ment basse de 2010. A noter, encore à cettedate, <strong>des</strong> lieux de putréfaction identifiab<strong>le</strong>s (Saint Maurice, pointe <strong>des</strong> Guettes, port du Légué,…).A cette date et encore davantage lors d’observations aériennes réalisées <strong>le</strong> 1 er juil<strong>le</strong>t, on note <strong>des</strong>écou<strong>le</strong>ments noirs dans la filière du Gouessant et ce depuis l’amont (barrage de Pont Rolland), trèsmanifestement signe de putréfaction intense dans l’estuaire.- Binic/Etab<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> Mer : augmentation <strong>des</strong> ulves par rapport à la situation de juin, mais tout demême très peu d’algues <strong>sur</strong> <strong>le</strong> site par rapport aux années antérieures : <strong>sur</strong>face estimée 6 foisinférieur à la moyenne interannuel<strong>le</strong> et au niveau de l’année 2006 particulièrement basse. On noteencore beaucoup d’algues brunes filamenteuses <strong>sur</strong> <strong>le</strong> site, <strong>le</strong>s ulves ne sont majoritaires que <strong>sur</strong> lapartie ouest de la baie en bas de l’estran et en rideau,- Très peu d’algues <strong>sur</strong> <strong>le</strong> site de Bréhec (mélange), site qui était très touché en avril,premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 13 /20
- Des échouages importants <strong>sur</strong> <strong>le</strong> petit site de l’anse de Trestel ; <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces sont à cette date dudoub<strong>le</strong> de la me<strong>sur</strong>e interannuel<strong>le</strong>,- Des échouages très inférieurs (de 35 %) à la moyenne <strong>des</strong> années antérieures <strong>sur</strong> la baie de la Lieuede Grève, du même ordre que <strong>le</strong> niveau me<strong>sur</strong>é en juin. On note toujours à cette date unesituation de putréfaction <strong>sur</strong> la partie Est de la baie (Toul er Vilin),- Anse de Locquirec : <strong>des</strong> échouages en forte progression par rapport à juin et probab<strong>le</strong>ment asseznettement supérieurs à la moyenne <strong>des</strong> années antérieures (non me<strong>sur</strong>és),- Horn/Guil<strong>le</strong>c (Anse du Dossen) : échouages en nette progression depuis juin. Les <strong>sur</strong>facescou<strong>vertes</strong> sont proches mais inférieures aux trois années précédentes et légèrement supérieures à lamoyenne interannuel<strong>le</strong> de juil<strong>le</strong>t (+ 10 %),- Keremma : forte augmentation depuis juin <strong>sur</strong> <strong>le</strong> site. Les échouages sont lors du vol importants,probab<strong>le</strong>ment supérieurs aux dernières années (et à la moyenne interannuel<strong>le</strong> ?) mais inférieurs àjuil<strong>le</strong>t 2008 qui constituait une situation « record »,- Guisseny : <strong>sur</strong> cette baie éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s échouages sont plus importants qu’en juin et plus verts. Les<strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> sont proches de cel<strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>ées en juil<strong>le</strong>t 2010 (légèrement supérieures) pourlaquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s dépôts étaient particulièrement bas et très inférieures (facteur plus que 2) aux <strong>sur</strong>facesme<strong>sur</strong>ées en 2007, 2008 et 2009. Les <strong>sur</strong>faces sont, à cette date assez nettement inférieures, à lasituation moyenne (de 40 % environ),- Mogeran/Coréjou : peu d’évolution par rapport à juin. Les <strong>sur</strong>faces semb<strong>le</strong>nt proches de cel<strong>le</strong>sme<strong>sur</strong>ées en 2010 (donc autour de 30 % inférieures à la moyenne interannuel<strong>le</strong> et très inférieuresaux trois années précédentes 2007 à 2009 qui étaient très chargées <strong>sur</strong> ce site : 2 voire 3 fois moinsde <strong>sur</strong>faces),- Sur la baie de Douarnenez, <strong>le</strong>s échouages très peu présents à la mi juin (algues en rideau /conditions de vent/hou<strong>le</strong>) sont un peu plus présents lors du <strong>sur</strong>vol, notamment <strong>sur</strong> Kervijen / Tyan Quer et dans une moindre me<strong>sur</strong>e <strong>sur</strong> Lieue de Grève. Très peu d’algues lors du vol <strong>sur</strong> SainteAnne la Palud et <strong>le</strong> Ry. Sur l’ensemb<strong>le</strong> de la baie la <strong>sur</strong>face tota<strong>le</strong> est en retrait de 20 % environ parrapport à juin (rideau) et est légèrement supérieur à la moyenne interannuel<strong>le</strong> (+15%),- Baie de la Forêt : <strong>le</strong>s échouages lors du <strong>sur</strong>vol sont plutôt inférieurs à juin et probab<strong>le</strong>ment mêmeà la moyenne interannuel<strong>le</strong>. A noter <strong>des</strong> couvertures importantes <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Saint Laurent et <strong>le</strong> SaintJean et <strong>des</strong> stocks infralittoraux qui sont bien visib<strong>le</strong>s et semb<strong>le</strong>nt particulièrement importants àcette date,- On note <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Pouldu (estuaire de la Laïta) <strong>des</strong> échouages et <strong>des</strong> algues en rideau ce qui est assezinhabituel <strong>sur</strong> ce secteur ; de très fortes couvertures <strong>sur</strong> <strong>le</strong> site voisin de Fort Bloqué encore à cettedate,- Des couvertures apparemment importantes <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s différentes vasières de la rade de Lorient(putréfactions visib<strong>le</strong>s en plusieurs secteurs). Présences d’algues en rideau et échouage <strong>sur</strong> <strong>le</strong>splages de Larmor Plage et de la pointe de Gâvres éga<strong>le</strong>ment,- Isthme de Quiberon et plus au Nord <strong>le</strong> secteur « Erdeven » présentent <strong>des</strong> tapis et rideau (enpartie verts mais dont la composition n’a pas encore été analysée),- Sur la baie de Quiberon et plus à l’Est la presqu’i<strong>le</strong> de Rhuys, <strong>le</strong>s échouages loca<strong>le</strong>ment assezmassifs sont apparemment dominés par <strong>des</strong> algues brunes ou rouges (composition non analysée,probab<strong>le</strong>ment algues de type Cladophora ou pylaïela en baie de Quiberon et plutôt Soléria plus àl’Est de la presqu’i<strong>le</strong> de Rhuys),- Plusieurs sites encore concernés par <strong>des</strong> ulves dans <strong>le</strong> secteur de la Vilaine mais pas de façonparticulièrement intense, en première analyse. Eléments issus du cinquième <strong>sur</strong>vol de la mi-août 2011,Les débits <strong>des</strong> cours d’eau, d’après <strong>le</strong>s données disponib<strong>le</strong>s de quelques stations limnigraphiques etmalgré <strong>le</strong>s pluies de juil<strong>le</strong>t et début août entrainant de reprises de débit de courte durée, demeurentinférieurs aux norma<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> juil<strong>le</strong>t et début août (par ex. environ 3 fois moins que la norma<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>Gouessant <strong>sur</strong> juil<strong>le</strong>t et 2 fois moins <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Gouet ou <strong>le</strong> Yar).premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 14 /20
L’analyse visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés et <strong>le</strong>s premières me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sites permettent dedécrire :- Des couvertures qui restent très limitées <strong>sur</strong> la partie du Golfe <strong>sur</strong>volée (nord ouest) <strong>sur</strong>tout parrapport aux années antérieures (mais traces manifestement de putréfaction <strong>sur</strong> l’amont de lavasière de Séné) ,- L’ouest de L’isthme de Quiberon concerné par <strong>des</strong> dépôts d’un mélange d’algues (près d’un tiersd’ulves dans l’échouage) alors que la partie Est est concernée par de petites algues brunesfilamenteuses (dépôts mo<strong>des</strong>tes lors du <strong>sur</strong>vol),- Dépôts qui sont encore en août importants <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la Rade de Lorient avec par endroit<strong>des</strong> putréfactions. Les plages de Larmor Plage sont el<strong>le</strong>s aussi concernées en août par <strong>des</strong> dépôtsd’ulves importants, supérieurs manifestement aux années antérieures. Fort Bloqué est encore enaoût très touché par <strong>des</strong> dépôts épais d’ulves.- Le fond de baie de la Forêt est peu touché par <strong>le</strong>s échouages au 15 août (environ 50 % de lamoyenne interannuel<strong>le</strong>) mais <strong>des</strong> stocks infralittoraux importants sont visib<strong>le</strong>s lors du <strong>sur</strong>vol,- Fond de baie de Douarnenez : lors du <strong>sur</strong>vol, <strong>sur</strong>tout <strong>des</strong> algues en rideau, peu de dépôts exceptés<strong>sur</strong> Kervijen et Ty an Quer et dans une moindre me<strong>sur</strong>e Lestrevet (+ <strong>des</strong> figures de putréfaction<strong>sur</strong> l’estuaire du Lapic). A noter la présence de quelques algues rouges en mélanges aux ulves. La<strong>sur</strong>face tota<strong>le</strong> couverte (principa<strong>le</strong>ment rideau), en net retrait par rapport à juin (près de 50 % demoins), est proche mais légèrement supérieure à la moyenne <strong>des</strong> années antérieures (10 % de plusmais près de 40 % de moins qu’août 2007, année de plus fort échouage pour août),- Mogeran/Coréjou : <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces diminuent par rapport à juil<strong>le</strong>t et sont nettement inférieures auxmoyennes interannuel<strong>le</strong>s (- 60 %),- Guisseny : forte augmentation <strong>des</strong> échouages <strong>sur</strong> cette baie depuis <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol de juil<strong>le</strong>t (quasidoub<strong>le</strong>ment). Les <strong>sur</strong>faces en août retrouvent une niveau plus conforme aux années antérieuresmais légèrement en <strong>des</strong>sous de la moyenne interannuel<strong>le</strong> (-25%),- Keremma : <strong>le</strong> 15 août <strong>le</strong>s échouages sont très importants <strong>sur</strong> ce site, supérieurs de 25 % à lamoyenne <strong>des</strong> années antérieures. A noter aussi <strong>des</strong> échouages importants <strong>sur</strong> PorsMeur alors que<strong>le</strong> Port de Pors Guen semb<strong>le</strong> moins chargé que <strong>le</strong>s années antérieures,- Horn/Guil<strong>le</strong>c : <strong>le</strong>s échouages diminuent de 25 % par rapport à juil<strong>le</strong>t ce qui place <strong>le</strong> mois d’août2011 en retrait assez sensib<strong>le</strong> par rapport à la moyenne <strong>des</strong> années antérieures (-30 %). Lesconditions relativement perturbés depuis la mi juil<strong>le</strong>t pourraient, <strong>sur</strong> ce site exposé à la hou<strong>le</strong>,expliquer ce recul,- L’anse de Locquirec présente <strong>des</strong> couvertures assez proches de la situation de juil<strong>le</strong>t et un niveauqui est légèrement supérieur à la moyenne interannuel<strong>le</strong> (+10%),- La baie de la Lieue de Grève présente, malgré <strong>des</strong> conditions favorab<strong>le</strong>s aux dépôts lors du <strong>sur</strong>vol,un niveau de <strong>sur</strong>face extrêmement bas, jamais me<strong>sur</strong>é pour un mois d’août avec <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces troisfois moins importantes que la moyenne interannuel (-66 %),- La baie de Trestel est encore en août concerné par <strong>des</strong> dépôts importants, supérieurs auxmoyennes interannuel<strong>le</strong>s,- Aucun échouage lors du vol <strong>sur</strong> Bréhec,- Forte augmentation <strong>des</strong> couvertures <strong>sur</strong> Binic Eta<strong>le</strong>s depuis juil<strong>le</strong>t (x 3). Les échouages <strong>sur</strong>tout enbas d’estran sont, à cette date, majoritairement verts (ulves mais aussi petites entéromorphesfilamenteuses). Le niveau d’août, bien qu’en augmentation, reste inférieur à la moyenneinterannuel<strong>le</strong> de 25 %.- Une situation atypique <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc pour cette date : <strong>le</strong>s ulves sont en minorité parrapport aux autres algues (filamenteuses rouge de type Polysiphonia et filamenteuses brunes detype Pylaïella) <strong>sur</strong> une bonne partie <strong>des</strong> secteurs d’échouage. Les quantités d’ulve sont endiminution forte par rapport au mois de juil<strong>le</strong>t (-60 %). L’année 2011 est donc à un niveauhistoriquement bas, nettement inférieur (près de 2 fois moins) même à 2010 qui était déjà uneannée particulièrement basse pour <strong>le</strong> mois d’août. On note, encore à cette date <strong>des</strong> putréfactions,notamment dans l’estuaire du Gouessant.premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 15 /20
- Toujours aucune prolifération d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies de l’Est <strong>des</strong> Côtes d’Armor (Fresnaye etLancieux). En plus <strong>des</strong> algues brunes filamenteuses <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s deux baies (Pylaïella) on note laprésence de petites algues <strong>vertes</strong> filamenteuses apparemment de type Cladophora.- La Rance semb<strong>le</strong> en août peu touchées par <strong>le</strong>s proliférations ulves. Eléments issus du sixième <strong>sur</strong>vol de la mi-septembre 2011,Depuis <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol de mi août, plusieurs épiso<strong>des</strong> perturbés (vent + hou<strong>le</strong>) ont concerné la région. Malgré<strong>le</strong>s pluies associées à ces épiso<strong>des</strong>, <strong>le</strong>s débits <strong>des</strong> cours d’eau (donc <strong>le</strong>s flux d’azote) restent à <strong>des</strong> niveauxinférieurs à la norma<strong>le</strong>. Les quelques jours ayant précédés <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>vols ont été particulièrement agités cequi peut provoquer <strong>sur</strong> certains secteurs (par exemp<strong>le</strong> la baie de la Forêt/Concarneau) <strong>des</strong>débarquements d’algues infralittora<strong>le</strong>s et donc <strong>des</strong> échouages supérieurs et <strong>sur</strong> d’autres plutôt unereprises <strong>des</strong> algues <strong>des</strong> plages vers l’infra<strong>littoral</strong> (exemp<strong>le</strong> fond de baie de Douarnenez).L’analyse visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés et <strong>le</strong>s premières me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sites permettent dedécrire :- La Rance plutôt peu chargée encore à cette date (la Vil<strong>le</strong> Ger et Vil<strong>le</strong> es Nonais semb<strong>le</strong>nt plutôtplus chargés que <strong>le</strong>s autres secteurs ; à confirmer lors <strong>des</strong> contrô<strong>le</strong>s de terrain),- Les baies de l’est <strong>des</strong> Côtes d’Armor (Fresnaye, Lancieux) concernées par <strong>des</strong> dépôts mo<strong>des</strong>tesd’algues brunes (Pylaïella) ou rouges, plutôt <strong>sur</strong> <strong>le</strong> bas <strong>des</strong> estrans, mais pas ou peu d’algues <strong>vertes</strong><strong>sur</strong> ces sites,- La baie de Saint Brieuc, qui dans la continuation <strong>des</strong> observations <strong>des</strong> mois précédents ne présentepresque plus d’algues <strong>vertes</strong>. Les re<strong>le</strong>vés de terrain mettent en évidence <strong>des</strong> dépôts assez massifsd’algues brunes de type Pylaïella et <strong>des</strong> taux d’ulves en mélange qui atteignent <strong>sur</strong> certains secteurs10 % <strong>des</strong> algues présentes mais souvent moins voire pas d’ulves du tout. Les algues brunessemb<strong>le</strong>nt s’être globa<strong>le</strong>ment maintenues dans la baie et <strong>le</strong>s ulves avoir « fondues » pour presquedisparaître. Les quantités tota<strong>le</strong>s d’ulves sont historiquement basses avec <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces me<strong>sur</strong>ées quisont 8 fois inférieures à la moyenne 2002-2010 (près de 90 % de moins) et 3 fois inférieur à laprécédente plus basse va<strong>le</strong>ur me<strong>sur</strong>ée (sept 2005),- Binic/Etab<strong>le</strong>s : échouages en fort replis par rapport à août et très peu d’algues <strong>vertes</strong> lors du<strong>sur</strong>vol. Le niveau de septembre serait environ de 5 fois moins d’algues <strong>vertes</strong> qu’en moyenneinterannuel<strong>le</strong>. Cette situation doit être probab<strong>le</strong>ment reliée avec <strong>le</strong>s conditions dispersives <strong>le</strong>squelques jours ayant précédés <strong>le</strong> vol (dispersion <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong> et débarquement d’alguesrouges ; ceci semb<strong>le</strong> confirmé par un <strong>sur</strong>vol <strong>le</strong> 30 août qui montrait <strong>des</strong> échouages d’ulves encoreimportants),- Peu d’échouage <strong>sur</strong> Bréhec et Trestel et de composition apparemment peu verte,- Baie de la Lieue de Grève : échouages qui est à un niveau proche de celui me<strong>sur</strong>é en août, mêmelégèrement inférieur et donc très inférieur à la moyenne pluri annuel<strong>le</strong> (4 fois inférieur ; va<strong>le</strong>ur laplus basse de la série). On note un peu de goémon en mélange parmi <strong>le</strong>s ulves,- Locquirec : très peu d’échouage, un petit rideau. Les <strong>sur</strong>faces seront <strong>sur</strong> ce site éga<strong>le</strong>ment très en<strong>des</strong>sous de la moyenne pluri annuel<strong>le</strong>, ce qui s’explique probab<strong>le</strong>ment en bonne partie par <strong>le</strong>sconditions ayant précédées <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol,- Horn/Guil<strong>le</strong>c : <strong>des</strong> échouages qui sont un peu en replis par rapport à août et sont à cette dateinférieurs à la moyenne pluri annuel<strong>le</strong> (35 % ; donnée à valider),- Keremma : <strong>des</strong> échouages en replis par rapport à août et composés de goémon en majorité (autourde 5 % seu<strong>le</strong>ment d’ulves lors <strong>des</strong> contrô<strong>le</strong>s de terrain),- Guisseny : <strong>le</strong>s échouages sont en replis par rapport à août et comporte <strong>sur</strong> l’anse du Club Nautiqueune part plus importante de goémon. Le niveau me<strong>sur</strong>é en septembre est inférieur à la moyennepluri annuel<strong>le</strong> (-35 %),- Moguéran/Coréjou : <strong>le</strong>s échouages sont à cette date dominés par <strong>le</strong> goémon (autour de 80 % <strong>des</strong>algues tota<strong>le</strong>s),- Des échouages relativement importants <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s Abers (Wrac’h et Benoit),premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 16 /20
- Le Moulin Blanc concerné par <strong>des</strong> dépôts importants et <strong>des</strong> stocks infralittoraux devant la plagebien perceptib<strong>le</strong>s,- Fond de baie de Douarnenez : <strong>le</strong>s échouages sont <strong>sur</strong> la plupart <strong>des</strong> plages en recul par rapport àaoût ce qui peut, en partie au moins être relié avec <strong>le</strong>s conditions dispersives ayant précédées <strong>le</strong><strong>sur</strong>vol (<strong>le</strong>s photos prises <strong>le</strong> 13 présentaient très peu d’algues et ont été refaites <strong>le</strong> 15 pour limiterl’impact de ces conditions <strong>sur</strong> la me<strong>sur</strong>e de septembre). Les me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol du 15 indique unniveau inférieur à la moyenne interannuel<strong>le</strong> (30 % de moins) avec une faib<strong>le</strong> part <strong>des</strong> alguesdéposées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s estran (rideau majoritaire),- Baie <strong>des</strong> Trépassés : lors du vol, pas d’échouages mais <strong>des</strong> algues encore visib<strong>le</strong>s en rideau (retoursde terrain mettent en évidence la présence d’ulves présentant <strong>des</strong> morphologies d’algues ayant euesune phase fixée récente avec possib<strong>le</strong> reprise de croissance libre dans l’eau ; algues analyséescomme étant de l’Ulva armoricana),- Baie de la Forêt / Concarneau : <strong>le</strong>s échouages sont particulièrement massifs <strong>sur</strong> Cap Coz,supérieurs au maximum me<strong>sur</strong>é en août 2008. Echouages éga<strong>le</strong>ment importants (mais dans unemoindre me<strong>sur</strong>e) <strong>sur</strong> Ker<strong>le</strong>ven. A noter de plus <strong>des</strong> échouages très importants de part et d’autre dela baie (de Cap Coz à Beg Meil et de Ker<strong>le</strong>ven à Concarneau). Les conditions perturbées(« automna<strong>le</strong>s) ayant précédées <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol expliquent ces débarquements massifs d’algues qui étaientvisib<strong>le</strong>s en infra<strong>littoral</strong> lors <strong>des</strong> précédents <strong>sur</strong>vols (débarquements souvent massifs à l’automne<strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages de la baie avec l’arrivée <strong>des</strong> premiers coups de vent),- Les échouages <strong>sur</strong> Larmor Plage et Kerpape sont importants, en partie constitués de goémons. Onnote, <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières de la rade de Lorient, encore <strong>des</strong> tapis importants bien qu’en repli par rapportà août.- Des échouages très massifs <strong>sur</strong> <strong>le</strong> sud de la presqu’î<strong>le</strong> de Rhuys, du Sud d’Arzon à Banastèred’algues rouges (en majorité de type Soléria avec selon <strong>le</strong>s sites présence d’autres algues rouges, dequelques fuca<strong>le</strong>s et zostère et très peu d’ulves). Eléments issus du septième <strong>sur</strong>vol de la mi-octobre 2011,Les éléments proposés dans cette partie ne sont issus que de l’analyse visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés d’octobre2011 comparés aux clichés <strong>des</strong> années antérieures afin de donner une première tendance. Les me<strong>sur</strong>esde <strong>sur</strong>faces d’échouages qui seront réalisées ensuite permettront de valider ou modifier <strong>le</strong>s élémentsproposés ici :- Des échouages relativement important pour <strong>le</strong> site <strong>sur</strong> Larmor Plage (La Nouriguel, Toulhars etouest de Port Maria), ainsi que <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s vasières de la Rade de Lorient- Des échouages encore importants <strong>sur</strong> la baie de la Forêt Concarneau (plus particulièrement <strong>sur</strong> laplage de Ker<strong>le</strong>ven, mais éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s plages de Concarneau et Fouesnant) entrainant <strong>des</strong>ramassages <strong>le</strong> jour du <strong>sur</strong>vol,- Les échouages <strong>sur</strong> la baie de Douarnenez étaient peu importants lors du <strong>sur</strong>vol ; <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces enrideau sont par contre encore bien présentes et la <strong>sur</strong>face tota<strong>le</strong> pourrait être au <strong>des</strong>sus de lamoyenne interannuel<strong>le</strong> encore à cette date,- Sur <strong>le</strong>s Abers, <strong>le</strong>s tapis restent importants,- Moguéran est, par contre <strong>sur</strong>tout concerné par <strong>des</strong> échouages de goémon (ulves largementminoritaires, autour de 10 à 20 % du total),- Les échouages <strong>sur</strong> Guisseny restent très largement dominés par <strong>le</strong>s ulves (moins de goémonapparemment qu’en septembre) et semb<strong>le</strong>nt se maintenir à un niveau proche de celui <strong>des</strong>eptembre (pas encore me<strong>sur</strong>é) ce qui amènerait à un niveau supérieur à la moyenne pluriannuel<strong>le</strong>(de 30 % environ ?),- Sur Keremma, <strong>le</strong>s échouages sont <strong>sur</strong>tout constitués de goémons à cette date ; <strong>sur</strong> Pors Guen <strong>le</strong>sulves, bien qu’en nette diminution par rapport à septembre, sont encore bien présentes,premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 17 /20
- Sur <strong>le</strong> Dossen (Horn/Guil<strong>le</strong>c) <strong>le</strong>s échouages semb<strong>le</strong>nt en octobre à un niveau proche voiresupérieur à la me<strong>sur</strong>e de septembre ce qui amènerait à une <strong>sur</strong>face supérieure à la moyenne interannuel<strong>le</strong> (de près de 100 % ; à confirmer par <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es),- Quasi absence d’algues <strong>sur</strong> l’anse de Locquirec,- Sur la baie de la Lieue de Grève, <strong>le</strong>s échouages restent à un niveau limité, probab<strong>le</strong>ment proche decelui me<strong>sur</strong>é en août et septembre mais peut-être légèrement supérieur. Le niveau serait alors deprès de 60 % inférieur au niveau moyen pluri annuel,- Sur Binic et Etab<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s échouages sont encore présents (non encore me<strong>sur</strong>és) plus importants quelors du <strong>sur</strong>vol de septembre et constitués majoritairement d’algues filamenteuses rouges (autour de30 % lors <strong>des</strong> opérations de terrain mais <strong>sur</strong> <strong>des</strong> échouages qui sont nettement en retrait parrapport au jour de vol et visib<strong>le</strong>ment comportant plus d’algues <strong>vertes</strong>),- La baie de Saint Brieuc comporte <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> importantes mais presque sans ulves.Aucun <strong>des</strong> dépôts lors du vol n’apparaît vert et <strong>le</strong> parcours de l’estran met en évidence <strong>des</strong> tauxd’ulves estimé à environ 1 % <strong>des</strong> algues tota<strong>le</strong>s. Le Pylaïella est majoritaire (de 65 à 85 % <strong>des</strong>algues) ; présence aussi d’algues filamenteuses rouges (15 à 35 %),- Erquy <strong>le</strong> jour du vol était concerné par <strong>des</strong> échouages bruns + rideau non négligeab<strong>le</strong>s (lors <strong>des</strong>contrô<strong>le</strong>s de terrain, <strong>le</strong>s dépôts étaient absents et <strong>le</strong> rideau constitué en partie de Pylaïella avecéga<strong>le</strong>ment quelques ulves éparses, identifications <strong>des</strong> différentes algues en cours)- La baie de la Fresnaye est peu chargée à cette date et <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrain montrent uneprésence de Pylaïella largement dominante (estimation de 98 % de Pylaïella dans <strong>le</strong> total <strong>des</strong>algues), la baie de Lancieux est el<strong>le</strong> aussi peu chargée mais avec une composition plus mélangée(autour de 40 % de Pylaïella, 35 % diverses algues rouges et <strong>le</strong> reste en fuca<strong>le</strong>s ou zostères),- La situation <strong>sur</strong> la Rance semb<strong>le</strong> très proche de ce qui avait été noté en septembre,premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 18 /20
Synthèse <strong>sur</strong> la situation de la saison 2011 :Evaluation <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’échouage <strong>sur</strong> 9 baies indicatrices du niveau régional (Fresnaye, Saint Brieuc, Binic/Etab<strong>le</strong>s,Lieue de Grève, Locquirec, Horn/Guil<strong>le</strong>c, Guisseny, Douarnenez, Forêt/Concarneau : 94 % de la <strong>sur</strong>face régiona<strong>le</strong> enmoyenne <strong>sur</strong> 2002-2010)- au niveau régional la <strong>sur</strong>face tota<strong>le</strong> couverte <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s secteurs de plage (me<strong>sur</strong>es encore partiel<strong>le</strong>s)pour <strong>le</strong> mois d’avril est proche de la moyenne interannuel<strong>le</strong> mais avec <strong>des</strong> différencesmarquées par secteurs : la plupart <strong>des</strong> sites ont <strong>des</strong> échouages supérieurs à la moyenneinterannuel<strong>le</strong> ce qui est compensé par une situation de retard <strong>sur</strong> <strong>le</strong> secteur de la baie de SaintBrieuc et <strong>le</strong>s baies de l’Est <strong>des</strong> Côtes d’Armor quasiment exemptes d’ulves,- en mai la situation suit la tendance me<strong>sur</strong>ée en avril. Les <strong>sur</strong>faces augmentent <strong>sur</strong>quasiment tous <strong>le</strong>s secteurs ce qui est attendu à cette saison. Les <strong>sur</strong>faces déjà me<strong>sur</strong>ées (unepartie <strong>des</strong> sites) semb<strong>le</strong>nt indiquer un niveau total <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s secteurs de plages qui serait proche dela moyenne interannuel<strong>le</strong> pour ce mois malgré la situation <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> baies du centre et del’Est <strong>des</strong> Côtes d’Armor (peu ou pas d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> Fresnaye et Lancieux et <strong>des</strong> échouages <strong>sur</strong>l’anse de Morieux inférieurs à ce qu’ils sont habituel<strong>le</strong>ment à cette saison et étonnammentcomposés en grande partie <strong>sur</strong> l’est de cette anse d’algues brunes filamenteuses de type Pylaëlla).On peut noter que la baie de Douarnenez est, en mai, fortement touchée (<strong>sur</strong>face près de 3 foisplus importante qu’en moyenne interannuel<strong>le</strong>) comme <strong>le</strong> sont éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s baies de la Lieue deGrève (proche de la moyenne) et de la Forêt (non me<strong>sur</strong>ée),- <strong>le</strong>s caractéristiques très particulières du printemps 2011 (peu de pluie, débits très nettementinférieurs aux norma<strong>le</strong>s, fort enso<strong>le</strong>il<strong>le</strong>ment, peu de vent/hou<strong>le</strong>, température de l’eau plutôtsupérieure à la moyenne) expliquent ce démarrage particulier <strong>des</strong> proliférations. Cesconditions sont favorab<strong>le</strong>s à une croissance forte en début de saison <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s secteurs présentant<strong>des</strong> ulves en quantité et étant classiquement saturés en azote car cet élément peut diffici<strong>le</strong>ment êtrelimitant à cette période de l’année (débits encore é<strong>le</strong>vés par rapport à ce qu’ils sont au cœur de l’été<strong>sur</strong>tout en année sèche).- Le début du mois de juin plus « chaotique » rend <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es du 16 juin moins faci<strong>le</strong>s à exploiter :une partie <strong>des</strong> algues, au moins <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites <strong>le</strong>s plus exposés, a été reprise par la marée et n’est plusperceptib<strong>le</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. En parallè<strong>le</strong>, ces conditions plus dispersives, en éloignant <strong>le</strong>salgues <strong>des</strong> lieux de croissances <strong>le</strong>s plus favorab<strong>le</strong>s, limitent la croissance du stock et aussi <strong>le</strong>snuisances liées à la présence <strong>des</strong> algues <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s plages (dont la simp<strong>le</strong> perception visuel<strong>le</strong> de cesalgues). Les <strong>sur</strong>faces d’échouages n’ont pu encore faire l’objet de me<strong>sur</strong>es, mais la simp<strong>le</strong> analysevisuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés permet de conclure à un niveau régional qui sera pour juin bien inférieurà la moyenne interannuel<strong>le</strong>. A noter cependant <strong>des</strong> situations contrastées avec la baie de SaintBrieuc dont <strong>le</strong>s échouages augmentent fortement par rapport à mai tout en restant nettementinférieurs à la moyenne interannuel<strong>le</strong> (-35%), et <strong>des</strong> situations de forte diminution <strong>des</strong> échouageset stocks visib<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> la Baie de Douarnenez et la baie de la Lieue de Grève.premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 19 /20
- A la mi juil<strong>le</strong>t la situation reste proche de cel<strong>le</strong> décrite en juin : l’échouage cumulé (validationpartiel<strong>le</strong>) serait de 40 % inférieur à la moyenne interannuel<strong>le</strong>, donc à un niveau proche etlégèrement inférieur à 2010 année de particulièrement faib<strong>le</strong> prolifération. La situation globa<strong>le</strong>résulte pourtant de situations contrastées : peu ou pas d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies de l’est dudépartement <strong>des</strong> Côtes d’Armor, une situation atypique en baie de Saint Brieuc (et <strong>sur</strong> Binic) avec<strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces moins importantes qu’en moyenne interannuel<strong>le</strong> et <strong>des</strong> ulves apparemment enmauvais état physiologique qui cohabitent encore à cette date avec <strong>des</strong> algues brunes filamenteusede type Pylaïella, <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces éga<strong>le</strong>ment inférieures à la moyenne <strong>sur</strong> la baie de la Lieue de Grève.Par contre on note <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces plutôt supérieures à la moyenne interannuel<strong>le</strong> <strong>sur</strong> d’autres secteurstels l’Horn / Guil<strong>le</strong>c ou Keremma.- En août la situation est dans <strong>le</strong> prolongement de juil<strong>le</strong>t. Les <strong>sur</strong>faces cumulées régiona<strong>le</strong>s(me<strong>sur</strong>es partiel<strong>le</strong>ment validées) sont en recul par rapport à juil<strong>le</strong>t de plus de 40 %. Cela placel’année 2011 au niveau <strong>le</strong> plus bas me<strong>sur</strong>é depuis de début <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es (2002) pour août etde plus de 50 % inférieur à la moyenne pluriannuel<strong>le</strong>. Cette moyenne régiona<strong>le</strong> résulte <strong>des</strong>ituations contrastées : absence d’algue <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s baies de l’est <strong>des</strong> Côtes d’Armor (alguesbrunes filamenteuses présentes <strong>sur</strong> ces baies avec <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong> filamenteuse <strong>sur</strong> la Fresnaye),peu d’ulves <strong>sur</strong> la Baie de Saint Brieuc et en mélange avec <strong>des</strong> algues brunes et rougesfilamenteuse (situation jamais notée par <strong>le</strong> passé à cette saison), peu d’échouage éga<strong>le</strong>ment <strong>sur</strong> labaie de la Lieue de Grève mais beaucoup d’algues <strong>sur</strong> certains sites du Finistère nord (Keremmanotamment mais dans une moindre me<strong>sur</strong>e Guisseny, Locquirec) et une situation proche de lamoyenne interannuel<strong>le</strong> <strong>sur</strong> la baie de Douarnenez.- Septembre est dans <strong>le</strong> prolongement <strong>des</strong> observations <strong>des</strong> mois précédents : <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>facescumulées (me<strong>sur</strong>es partiel<strong>le</strong>ment validées) sont encore plus faib<strong>le</strong>s qu’en août et trèsnettement inférieures à la moyenne pluri annuel<strong>le</strong> (autour de 4 fois moins). Cela est dû, enpremier lieu, à la situation très exceptionnel<strong>le</strong> de la baie de Saint Brieuc qui ne présente enseptembre presque plus d’ulves (mais présence d’algues brunes filamenteuses). Mais éga<strong>le</strong>mentà la situation <strong>des</strong> baies de l’est du département <strong>des</strong> Côtes d’Armor, toujours indemnesd’ulves, aux <strong>sur</strong>faces particulièrement peu é<strong>le</strong>vées <strong>sur</strong> la baie de La lieue de Grève et dansune moindre me<strong>sur</strong>e <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s autres sites régionaux (Binic, Locquirec, Horn / Guil<strong>le</strong>c,Keremma, Guisseny, baie de Douarnenez). A noter l’exception de la baie de la Forêt /Concarneau touchée par <strong>des</strong> échouages massifs lors du <strong>sur</strong>vol. Les conditions perturbéesnotamment dans <strong>le</strong>s quelques jours ayant précédés <strong>le</strong> <strong>sur</strong>vol expliquent en partie <strong>le</strong>s fortséchouages de cette baie et <strong>le</strong>s échouages en retrait <strong>sur</strong> d’autres secteurs.- La situation d’octobre est dans <strong>le</strong> prolongement de cel<strong>le</strong> de septembre : la baie de Saint Brieucvoit <strong>le</strong>s ulves encore diminuer et peut être considérée comme indemne d’ulves (présencemajoritairement de Pylaïella, et d’algues rouges filamenteuses ; autour de 1 % d’ulves). C’est <strong>le</strong> caséga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> baies de l’Est <strong>des</strong> Côtes d’Armor. Les échouages <strong>sur</strong> la baie de la Lieue de Grèverestent limités et inférieurs à la moyenne interannuel<strong>le</strong>. Les baies de Douarnenez, la Forêt,Guisseny et du Dossen seraient par contre à un niveau supérieur au niveau moyeninterannuel pour cette date (à confirmer par <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es de <strong>sur</strong>face).- Le cumul annuel <strong>des</strong> échouages <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux sites sab<strong>le</strong>ux place l’année 2011(me<strong>sur</strong>es partiel<strong>le</strong>s) au plus bas niveau de <strong>sur</strong>face me<strong>sur</strong>é depuis 2002 (démarrage <strong>des</strong> suivisen <strong>sur</strong>face d’échouage) et à près de 50 % de moins que <strong>le</strong> niveau moyen interannuel. Lesdébits <strong>des</strong> cours d’eau particulièrement bas <strong>sur</strong> la plupart <strong>des</strong> secteurs et <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de lasaison de prolifération (<strong>le</strong>s flux qui en décou<strong>le</strong>nt, par exemp<strong>le</strong> <strong>sur</strong> la baie de Saint Brieuc seraient<strong>sur</strong> mai-août 2011 de 6 fois inférieurs à la moyenne <strong>des</strong> années 99-2010, en lien avec <strong>le</strong>s très basdébits <strong>des</strong> cours d’eau et <strong>le</strong> traitement de l’azote par la Step de St Brieuc depuis 2005), sont lapremière explication de la situation régiona<strong>le</strong> à partir du mois de juil<strong>le</strong>t. Le démarrage dela prolifération tardif <strong>sur</strong> certains secteurs (baie de Saint Brieuc avec peu d’ulves en début <strong>des</strong>aison et est <strong>des</strong> Côtes d’Armor avec pas d’ulves du tout) est éga<strong>le</strong>ment à prendre en compte dansl’analyse de la saison 2011, ainsi que <strong>le</strong>s conditions plutôt perturbées du début septembre.premiers éléments <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages de la saison 2011 CEVA, <strong>le</strong> 19 octobre 2011, 20 /20
ANNEXE 8DONNEES METEOCimav P4 – rapport final mars 2012 107
Rayonnement global (J/cm²/jour)30002700240020092010201121001800150012009006003000Jour1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301 316 331 346 361Evolution annuel<strong>le</strong> du rayonnement solaire global journalier (moyenné par semaine) à la station deSaint-Cast-<strong>le</strong>-Guildo pour <strong>le</strong>s années 2009, 2010, et 2011.Force du vent (m/s)1514131211109876543212009201020110Jour1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301 316 331 346 361Evolution annuel<strong>le</strong> de la force du vent journalière (moyenné par semaine) au niveau de la stationmétéorologique de Lannion pour <strong>le</strong>s années 2009, 2010, et 2011.
Rayonnement global (J/cm²/jour)3000270024002009201020112100180015001200900600300091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREEvolution saisonnière du rayonnement solaire global journalier (moyenné par semaine)à la station de Saint-Cast-<strong>le</strong>-Guildo en 2009, 2010, et 2011.Force du vent (m/s)151413122009201020111110987654321091 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301JourAVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBREEvolution saisonnière de la force du vent journalière (moyenné par semaine) au niveau de lastation météorologique de Lannion en 2009, 2010, et 2011.
ANNEXE 9FLUX D’AZOTECimav P4 – rapport final mars 2012 108
800700Estimation <strong>des</strong> flux d'azote <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Frémur (kg/j)200220032004200520060-10Ecart en flux entre 2011 du Frémur et moyennes interannuel<strong>le</strong>s2011/moy 93-10Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre2011/moyenne (02-06)60050020072008-20-30-24400300écart en %-40-50-50-48200-60-70-56-55-63-57-61-66100-80-79-76-750Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-90120001000080006000Gouet Urne Gouessant : estimation <strong>des</strong> flux journaliers d'azote inorganique total (kg/j)200020012002200320042005200620072008200920102011moyenne 99-2010écart en %0-10-20-30-40-50Gouet Urne Gouessant : écart entre <strong>le</strong>s flux d'azote inorganique (NO3+NH4) 2010 ou 2011 etmoyennes interannuel<strong>le</strong>s 99-2010-44Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre4000-60-70-65-62-69-6020000Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-80écart 2010/moy -81 99--90 2010écart 2011/moy 99-2010-100-83-85-76-86-84-81160014001200Ic : estimation <strong>des</strong> flux d'azote Nitrique (kg/j)200220032004200520062007200820092010moyenne 00-1020110-10-20-30Ic : Ecart en flux entre 2011 et moyennes interannuel<strong>le</strong>sAvril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre1000800600écart en %-40-50-49-51-60400200-70-80-71-64-76-72-72-63-62-66écart 11/moyenne 00-10écart 11/moyenne 02-06 -79-700Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-90700600500Yar : estimation <strong>des</strong> flux d'azote Nitrique (kg/j)19961997200220032004200520062007200820092010moyenne 93-09moyenne 02-0620110-10-20Yar : Ecart en flux entre 2011 et moyenne 93-10 et moyenne 2002-2006écart 2011/moyenne93-10Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t écart 2011/moyenne02-06Août Septembre400-23 -23300écart en %-30-40-40-37-30-29200-50-50-45-49100-60-59-56-540Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-701600140012001000Douron : estimation <strong>des</strong> flux d'azote Nitrique (kg/j)200220032004200520062007200820092010moyenne 93-10moyenne 02-062011Douron : Ecart en flux entre 2011 et moyennes inter annuel<strong>le</strong>sécart 0 2011/moyenne 02-06Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembreécart 2011/moyenne 93-11-10-20800600écart en %-30-40-34-35-28400200-50-60-58-47-54-44-49-54-42-52-500Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-70
flux moyen journalier (kgN/j)60005000400030002000Horn + Guil<strong>le</strong>c (HO13+Gui11) : estimation <strong>des</strong> flux d'azote Nitrique (kg/j)19961997200220032004200520062007200820092010moyenne 93-102011écart en %0-10-20-30-40Horn +Guil<strong>le</strong>c : Ecart en flux entre 2011 et moyenne 93-10 et moyenne 2002-2006écart 2011/moy 93-10Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembreécart 2011/moy 02-06-30-31-33 -33-39 -391000-44-45-43-42-50-490Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-60-5314001200Quillimadec : estimation <strong>des</strong> flux d'azote Nitrique (kg/j)200320042005200620070-5Quillimadec : Ecart en flux entre 2011 et moyennes interannuel<strong>le</strong>sAvril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre100020082009-10800-15600écart en %-20-21400-25-25-26-25-30-28-292000Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-35écart 2011/moyenne(04-10)écart 2011/moyenne(04-06)-40-32-31-34-36-34-315004002002Kerharo: estimation <strong>des</strong> flux d'azote Nitrique (kg/j)20032004200520062007200820092010moyenne 2001-1020110-10-20-30Kerharo : Ecart en flux entre 2011 et moyennes interannuel<strong>le</strong>sAvril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre300200écart en %-40-50-60100-70-71 -71-80 -77 -77écart 2011/moyenne 2000-2010écart 2011 -90 / moyenne(2002-2006)-74-68-76-82 -82-75-85-710Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-100500400300200100Lapic : estimation <strong>des</strong> flux d'azote Nitrique (kg/j)200220032004200520062007200820092010moyenne 2001-102011écart en %Lapic : Ecart en flux entre 2011 et moyennes interannuel<strong>le</strong>s0Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-20-40-60-58-67-67-70-73-80-78-81écart 2011/moyenne 2000-2010-86-90-89écart -100 2011 / moyenne(2002-2006)-100 -990Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-120800700600500Lesnevard : estimation <strong>des</strong> flux d'azote Nitrique (kg/j)19992000200220032004200520062007200820092010moyenne 99-10moyenne 02-0620110-5-10-15Lesnevard : Ecart en flux entre 2011 et moyennes interannuel<strong>le</strong>sAvril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-14400300écart en %-20-25-30-25-26-22-27-18-24200-35-34-33-311000Avril Mai Juin Juil<strong>le</strong>t Août Septembre-40-45-50-40-46écart 2010/moyenne99-09écart 2010/moyenne02-06
ANNEXE 10BIOMASSES ESTIVALES MAXIMALES,Baie de Saint Michel en GrèveCimav P4 – rapport final mars 2012 109
ANNEXE 11BIOMASSES HIVERNALES MINIMALES,Secteurs de la baie de Saint Michel en Grève et vasière du LédanoCimav P4 – rapport final mars 2012 110
Estimation de la biomasse d’ulves <strong>sur</strong> l’estran dansla baie de Saint Michel en Grève, <strong>le</strong> 07 février 2012Total me<strong>sur</strong>é:Biomasse d’ulves:106 Tonnes (égouttées 1 minute)Dont rideau: 13 TonnesSurface <strong>des</strong> dépôts:On observe deux types de rideau avec <strong>des</strong> compositions très distinctes (aspects vert et brun)4.8 hectares de rideau tot (3.5 équiva<strong>le</strong>nt 100%)1 hectares de rideau brun (0.45 équiva<strong>le</strong>nt 100%)3.8 hectares de rideau vert (3 équiva<strong>le</strong>nt 100%)56 hectares de dépôt (9.8 équiva<strong>le</strong>nt 100%)Pas d’estimation du stock infra<strong>littoral</strong>
Estimation de la biomasse d’ulves <strong>sur</strong> l’estran dansla baie de Saint Michel en Grève, <strong>le</strong> 07 février 2012En haut de la plage, très peu d’algues<strong>vertes</strong> (environ 5-10% du dépôt).Principa<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> AB (Fucus), <strong>le</strong>urproportion dans <strong>le</strong>s dépôts diminuefortement en <strong>des</strong>cendant vers <strong>le</strong> rideauDans <strong>le</strong>s dépôts <strong>le</strong> long <strong>des</strong> falaises à l’Est versToul ar Vilin, on observe <strong>des</strong> dépôts allantjusqu’à 90% de couverture, dont <strong>le</strong> taux enalgues <strong>vertes</strong> est d’environ 50 à 60%.
Estimation de la biomasse d’ulves <strong>sur</strong> l’estran dansla baie de Saint Michel en Grève, <strong>le</strong> 07 février 2012Identification <strong>des</strong>échantillons:U. (armoricana) sous formelibre (confettis)Il y a quelques algues rouges(Ceramia<strong>le</strong>s) partout et <strong>des</strong>algues brunes (Fucus) plus enhaut de plageMême composition entrerideau et dépôts. Les alguesdans <strong>le</strong> rideau sont peut-êtreun peu plus épiphytées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>smarges de croissance.Dans <strong>le</strong>s dépôts <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la baie, la composition est assezidentique avec environ 70% de vert. Les taux de recouvrement <strong>des</strong>dépôts sont assez variab<strong>le</strong>s, allant de 10 à 90%
<strong>Suivi</strong> de la biomasse hiverna<strong>le</strong> en ulves <strong>sur</strong> lavasière du Lédano (22) - <strong>le</strong> 26 janvier 2012Observations terrain et estimation de la biomasse tota<strong>le</strong>
<strong>Suivi</strong> hivernal <strong>des</strong> vasières BretonnesJanvier 2012 - LEDANO (22)Gros dépôt composé de 90% d’ulva sp. (ressemblant beaucoup àulva armoricana) trouées, boursouflées, en partie enfouies, et de10% Ulva chlathrata ou Ulva compressa. 90% de couverture.individus de 1 à 5 cm de long – sédiment très noir. Présenced’hydrobiesPrésencede plantu<strong>le</strong>sd’Ulvariaobscurumfixées auxcailloutisDépôt d’ulva sp. (probab<strong>le</strong>ment Ulvaarmoricana) de 1 à 0,5 cmd’épaisseur, avec enfouissement etputréfaction, de 98% de couverture.Dépôt d’ulva sp. (probab<strong>le</strong>ment Ulvaarmoricana) de 98% de couverture, de1cm d’épaisseur, enchevêtré dans <strong>le</strong>sschorres. 25% d’Entéromorphes ensuperposition
<strong>Suivi</strong> hivernal <strong>des</strong> vasières BretonnesJanvier 2012 - LEDANO (22)Dépôt d’ulves à 95%(Ulva armoricanaprobab<strong>le</strong>ment à 98% etUlva Chlatrata oucompressa à 2% ),d’environ 10 cm delongueur, etd’Entéromorphes à 5%.Le recouvrement du dépôtd’ulves à cet endroit estde 70%, et d’uneépaisseur de 0,5 cm.Sous <strong>le</strong> dépôt la vase estpropre, sansenfouissement et sansodeur.Tapis d’ulves de même compositionque précédemment, de 85% decouverture d’ulves <strong>sur</strong> l’estran. Peud’enfouissement