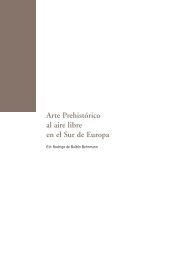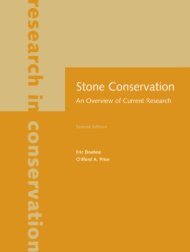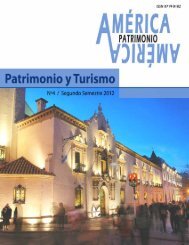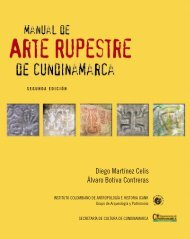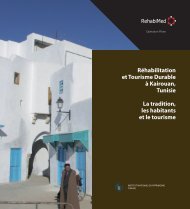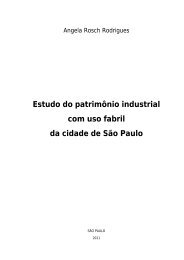La définition d'une stratégie d'intervention - ICOMOS Open Archive
La définition d'une stratégie d'intervention - ICOMOS Open Archive
La définition d'une stratégie d'intervention - ICOMOS Open Archive
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>La</strong> définition d’une stratégie d’intervention.<br />
<strong>La</strong> definición de una estrategia de intervención<br />
Defining a strategy for intervention<br />
Culturels met en relief; les interventions de sauvegarde et valorisation<br />
des architectures traditionnelles se montrent être le levier décisif pour<br />
permettre non seulement la conservation d’un patrimoine historique,<br />
mais aussi la revitalisation des économies locales et la reconstruction<br />
d’un tissu social souvent désagrégé<br />
De la culture de “projet” à la détermination de “systèmes” de biens<br />
culturels<br />
Le secteur des biens culturels présente sa forme physique intrinsèque,<br />
lié au territoire et à son histoire au point de sous-entendre aujourd’hui<br />
un ensemble de relations contextuelles à déterminer. Il présente une<br />
“forme relationnelle” qui concerne l’usage qui s’en fait. Si le sens du<br />
“système de support” apparaît évident quand on pense à la jouissance<br />
du patrimoine (jouissance touristique, didactique, apport cognitif ),<br />
moins évidents sont les effets d’une “industrie” qui offre aujourd’hui un<br />
usage différé dans le lieu et dans le temps des biens culturels.<br />
Nous anticipons ici une proposition de système intégrant, en premier<br />
lieu, la reconnaissance du système des émergences culturelles à<br />
rayonnement transnational, celles ensuite à la grande échelle territoriale<br />
comme les émergences de consistance “interrégionale”. Enfin, à l’échelle<br />
régionale ou sous- régionale, les pôles de réseaux culturels. Système<br />
représentant en fait une lecture organique du territoire, conformément<br />
à la philosophie et à la pratique de l’entretien programmé de son<br />
patrimoine diffus.<br />
Les fortifications d’Alger comme système (de biens culturels)<br />
<strong>La</strong> pérennité des éléments qui témoignent du rapport séculaire entre<br />
implantations humaines et morphologie de la baie d’Alger permet de<br />
redécouvrir les relations qui ont permis d’implanter et de donner un sens<br />
au système de côte que forme Alger avec sa baie depuis des millénaires.<br />
Parmi tous les autres témoignages d’une structure territoriale élaborée<br />
à travers le temps par sédimentation lente d’une utilisation incessante<br />
de l’espace de la ligne de côte le système de fortification ottoman dont<br />
les éléments disséminés le long de la côte trahit le lien étroit entre<br />
Alger et sa baie.<br />
Ces postes de défense, fort ou batteries que l’on voit émerger de place<br />
en place au milieu des habitations, doivent, pour être reconnus être<br />
replacés dans le contexte relationnel dans lequel ils furent construits et<br />
suivant lequel ils évoluèrent.<br />
<strong>La</strong> conscience des relations qu’engendre celui-ci permet de mieux<br />
lire, sauvegarder et mettre en valeur les différents éléments qui le<br />
composent. Ainsi la reconstitution des relations affaiblies ou effacées<br />
de chaque fort avec les autres composants du double système auquel<br />
il est lié, constitue une condition indispensable pour son identification,<br />
son rôle et sa faculté d’être reconnu.<br />
les forts s’organisant à deux ou à trois pour défendre des lieux bien<br />
déterminés.<br />
L’urbanisation de la baie d’Alger détermina par la suite de nouvelles<br />
composantes territoriales autour des forts qui changèrent leur rapport<br />
à leur environnement. Les fortifications furent détruites ou préservées<br />
selon le rôle qui leur fut attribué dans cette nouvelle gestion des lieux.<br />
Aujourd’hui malgré les multiples destructions qu’a subit le système<br />
défensif ottoman d’Alger depuis 1830, il reste une structure historique<br />
presque intacte en particulier en ce qui concerne la chaîne des forts<br />
établis le long de la baie et les fortifications du port. Sur un total de 19<br />
forts, on en dénombre encore 14 dont 8 pour le port sans oublier les<br />
fortifications de la Citadelle, deux batteries extra muros et deux intramuros.<br />
<strong>La</strong> mise en valeur de l’ensemble des forts ne peut être effective que si<br />
elle prenait en compte trois échelles d’intervention:<br />
<br />
<br />
<br />
Chaque fort doit en premier lieu faire l’objet d’une mise en valeur<br />
à l’échelle de l’édifice lui-même en tant qu’objet empreint de<br />
valeurs historique et esthétique qui le différencient des autres<br />
constructions.<br />
à l’échelle du quartier la mise en valeur du fort en tant que<br />
composante particulière ne pourrait être effective que si les<br />
opérations urbaines tiennent compte du sens du lieu tel qu’il est<br />
donné par la présence physique de la forteresse.<br />
à l’échelle de la baie, la prise en charge de la structure défensive<br />
historique territoriale comprenant les forts et batteries extérieurs, les<br />
fortifications du port, ainsi que tous les lieux et parcours portant la<br />
mémoire des remparts, portes, batteries et forts aujourd’hui disparus<br />
entreraient dans un projet global de mise en valeur de toute la<br />
bande côtière d’Alger en liaison avec les autres valeurs historiques,<br />
paysagères à travers les parcours historiques.<br />
Plusieurs fortifications, un seul système : quelle mise en valeur ?<br />
Chaque fort est lié au système historique des fortifications ottomanes<br />
d’Alger et au système urbain du quartier dans lequel il se trouve. Le<br />
premier qui est interne ou bien spécialisé parce que spécifique à la<br />
nature de ses composants, à leur type, à leur caractère historique, est<br />
lui-même divisé en sous systèmes suivant la situation territoriale de ses<br />
éléments le long de la baie.<br />
En effet malgré l’apparente organisation en trois niveaux de défense<br />
(interne, rapprochée, éloignée), la défense de la baie était plus<br />
affinée car elle subdivisait ces niveaux en fronts de défense suivant<br />
la morphologie des micro sites qui se présentaient le long de la baie,<br />
157