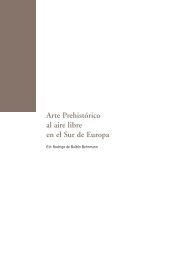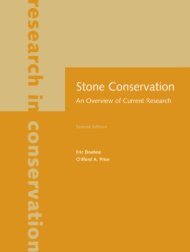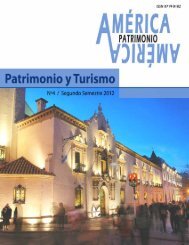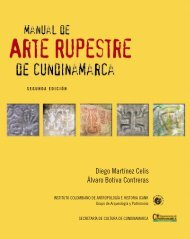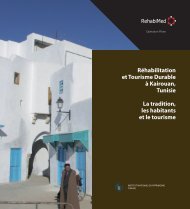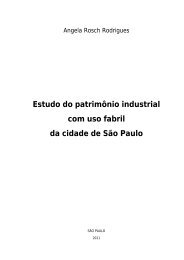La définition d'une stratégie d'intervention - ICOMOS Open Archive
La définition d'une stratégie d'intervention - ICOMOS Open Archive
La définition d'une stratégie d'intervention - ICOMOS Open Archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> définition d’une stratégie d’intervention.<br />
<strong>La</strong> definición de una estrategia de intervención<br />
Defining a strategy for intervention<br />
Régénération urbaine: enjeux d’une<br />
revalorisation du cadre bâti ancien dans<br />
le Sud Ouest algérien<br />
Sandra Guinand<br />
Politologue et urbaniste, collaboratrice scientifique- doctorante à<br />
l’Observatoire de la ville et du développement durable, Institut de<br />
Géographie, Université de <strong>La</strong>usanne, et chargée de projet pour ABApartenaires,<br />
Pully<br />
Adresse postale:<br />
Institut de Géographie, Université de <strong>La</strong>usanne, bâtiment Anthropole,<br />
Dorigny, 1015 <strong>La</strong>usanne, Suisse<br />
Adresse courrier électronique:<br />
sandra.guinand@unil.ch<br />
Téléphone:<br />
0041 21 692 30 76<br />
Les stratégies de régénération urbaine répondent à des enjeux qui<br />
aujourd’hui concernent la plupart des villes, y compris celles des pays<br />
méditerranéens. En effet, prenant l’exemple de la ville d’Ain-Sefra, en<br />
Algérie – ville où nous avons eu l’occasion de mener des recherches<br />
– un des premiers constats qui peut être établi est l’avancée continuelle<br />
de son urbanisation vers l’Est, par la construction de lotissements, au<br />
détriment d’une préoccupation du cadre bâti de son centre-ville<br />
d’architecture coloniale. Le même phénomène se retrouve en d’autres<br />
villes algériennes, telle Oran notamment. Les conséquences de ce choix<br />
d’orientation se traduit alors (et c’est le cas pour beaucoup de villes<br />
dans cette situation) par un degré avancé de dégradation du cadre bâti<br />
ayant souvent valeur patrimoniale, entraînant ainsi un déplacement<br />
des commerces, des services et des populations vers l’extérieur. Le<br />
centre-ville perd alors sa fonction première : celle du point de centralité<br />
et de convergence de la ville.<br />
Ce constat pose une série de questions. Quelles sont les causes<br />
menant à ce délaissement ? Le cadre bâti ancien n’a-t-il plus de rôle<br />
à jouer ? Sa revalorisation ne peut-elle pas au contraire répondre à<br />
certaines problématiques majeures rencontrées par les villes ? Dans<br />
le sud algérien, pourtant, à échelle urbaine beaucoup plus réduite,<br />
des stratégies de réhabilitation et de valorisation du cadre bâti<br />
commencent à se dessiner : la restauration des ksour (anciens villages<br />
berbères fortifiés) participent d’une volonté de redynamisation axée<br />
sur une prise de conscience de leur valeur patrimoniale.<br />
L’objet de la communication sera dans une première partie de définir<br />
ce qui est entendu par régénération urbaine. Puis, à partir des exemples<br />
de la ville d’Ain-Sefra et des ksour du sud algérien, de mettre en exergue<br />
les enjeux socio-économiques et culturels liés à une prise en compte<br />
d’une restauration du cadre bâti ancien.<br />
Régénération urbaine : cadrage théorique succinct<br />
De Barcelone à Londres en passant par Bologne, nombreuses sont<br />
les villes ayant mis au point de nouvelles méthodes de « faire la ville<br />
». Résultant pour la majorité des cas d’une sortie de l’ère industrielle<br />
mêlant fonctionnalisme et rationalisme dans la mise en œuvre de leurs<br />
politiques urbaines. Ces villes tentent aujourd’hui au travers d’une<br />
approche plus organique de répondre à leurs nouveaux besoins.<br />
C’est à partir des années 70 que les changements structurels mettent<br />
en exergue l’obsolescence de cette organisation spatiale et amènent<br />
les techniciens et politiques à se poser la question du devenir de<br />
ces espaces vides au cœur de la ville ainsi que de leur rôle dans la<br />
restructuration du territoire. En effet, la présence de constructions<br />
héritées de l’ère industrielle apparaît comme inappropriée en centre<br />
ville et est considérée comme consommatrice de trop d’espace.<br />
De plus, au même moment, les acteurs contemporains prennent<br />
également conscience de l’étalement toujours plus prégnant de<br />
l’espace urbain et des difficultés à le maintenir de manière cohérente et<br />
structurée. De fait, se dessine lentement dans les esprits un processus<br />
de retour et de reconquête de ces espaces en désuétude. A l’origine<br />
même de ce phénomène de pensée, découlent et se développent des<br />
pratiques urbaines précises sous les titres de « régénération urbaine ».<br />
Un rapide tour d’Europe nous montre que ce nouveau référentiel en<br />
terme d’aménagement urbain se retrouve un peu partout sous des<br />
dénominations différentes : « réparation urbaine » en Italie (Bologne,<br />
1960), « recyclage urbain » aux Pays-Bas (1970) et « renouvellement<br />
urbain » en France. Ces nouvelles méthodes de faire la ville se réfèrent<br />
à l’idée d’une transformation de la ville sur elle-même, marquée<br />
spécifiquement par son héritage industriel ou patrimonial et de fait à la<br />
recherche d’une nouvelle identité.<br />
Les enjeux d’une restauration du cadre bâti : éclairage d’une<br />
négligence<br />
Bien que la majorité des villes algériennes ne souffrent pas d’une<br />
sortie de l’ère industrielle profonde, ces dernières, mais également le<br />
reste des villes du Maghreb, ont suivi et suivent encore les référentiels<br />
modernistes et fonctionnalistes qui ont prévalu en Europe et ailleurs.<br />
Cette politique de construction et de modernisation tout azimut<br />
au nom du progrès (technique et social) menace le patrimoine<br />
bâti et la santé même des villes et de leurs territoires. En effet, les<br />
villes algériennes, soumises à un taux d’urbanisation très fort – on le<br />
sait peu mais c’est particulièrement le cas des villes sahariennes et<br />
présahariennes – subissent une extension de leurs espaces urbains<br />
vers l’extérieur au détriment d’une préoccupation du cadre bâti des<br />
centres-villes. Les conséquences sont diverses : dégradation du cadre<br />
bâti (ayant pourtant valeur patrimoniale et historique), délaissement<br />
de celui-ci par les couches plus aisées, paupérisation, difficulté du tissu<br />
urbain à se renouveler naturellement, valeur historique et patrimoniale<br />
négligée et avec elle la perte de repères et de mémoire des lieux,<br />
déplacement des commerces et des services vers l’extérieur, réduction<br />
du potentiel de centralité, de dynamisme et croissance de l’étalement<br />
urbain. Ces effets, sont aujourd’hui très visible pour la ville d’Ain Sefra,<br />
où, en fin de semaine, le centre-ville est déserté à l’inverse des deux<br />
grands boulevards. Cette ville qui a déjà rasé son ksar, ne semble que<br />
peu s’intéresser à son identité historique pourtant non négligeable.<br />
Aujourd’hui, l’attention semble se porter vers la périphérie : extension<br />
de la ville par la construction de lotissements et d’une nouvelle gare.<br />
Le même phénomène se retrouve également à Alger et sa casbah,<br />
163