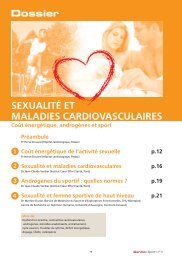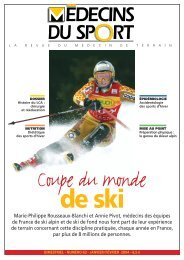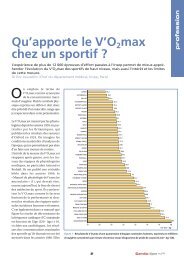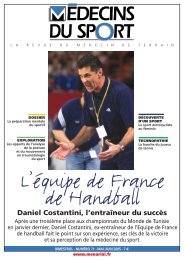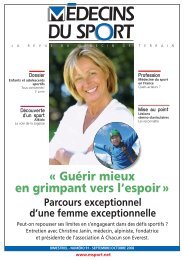Médecins du sport 48 - msport.net
Médecins du sport 48 - msport.net
Médecins du sport 48 - msport.net
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
EDECINS<br />
DU SP RT<br />
L A R E V U E D U M É D E C I N D E T E R R A I N<br />
FICHE TECHNIQUE<br />
Traitement de la<br />
tendinite d’Achille :<br />
place <strong>du</strong> Laser CO 2<br />
Pages 12-13<br />
CAS CLINIQUE<br />
Une fausse méralgie<br />
Pages 28-29<br />
DOSSIER<br />
Maladies chroniques<br />
et <strong>sport</strong><br />
2 e partie<br />
Pages 15-26<br />
MATÉRIEL<br />
Examen de la chaussure<br />
de type Running<br />
Pages 30-31<br />
Gymnastique<br />
1 re coupe d’Europe des clubs<br />
Force, souplesse, envergure, rythme, précision, équilibre, voltige…<br />
La gymnastique joue avec nos émotions et décline ses disciplines<br />
spectaculaires. Médecins <strong>du</strong> Sport saisit cette occasion pour<br />
faire le point sur la santé des gymnastes et les idées reçues<br />
qui entourent ce <strong>sport</strong>.<br />
BIMESTRIEL - NUMÉRO <strong>48</strong> - DÉCEMBRE 2001 - 36 F / 5,5 E
ÉDITO<br />
CONTINUER…<br />
POUR LA PASSION<br />
Quand on est médecin<br />
d’une équipe<br />
depuis de longues<br />
années, comment peut-on imaginer que la mort<br />
soit un jour au rendez-vous ?<br />
Pourtant, on a déjà vu des accidents graves<br />
dans le ski ; mes pensées vont vers Nathalie<br />
Bouvier, victime d’une chute au Japon en 91 ;<br />
je ne pensais pas connaître un jour un accident<br />
plus grave. On sait que la mort peut survenir<br />
dans cette discipline et la presse sait bien<br />
nous rappeler les accidents tragiques, mais<br />
jamais on ne l’imagine pour l’une des nôtres!<br />
Alors… A quoi ça sert ? Telle est la question qui<br />
nous revient sans cesse à l’esprit…<br />
On fait tout pour aider les skieurs à accéder<br />
au plus haut niveau, on les accompagne dans<br />
leur passion, dans leurs doutes, on essaie de<br />
les aider à être à l’optimum de leurs possibilités<br />
en leur garantissant leur santé, en essayant<br />
de limiter les blessures par une prévention<br />
soutenue. Et ils y adhèrent presque tous…<br />
Parce qu’ils ont compris que c’était important,<br />
même s’il faut compter d’abord sur soi-même.<br />
Régine était au sommet de son art, mature, sans<br />
peur ni retenue parce qu’elle était sûre d’elle,<br />
comme d’autres grands skieurs l’ont été avant<br />
elle, qui se blessent beaucoup jusqu’au moment<br />
où on a l’impression que plus rien ne peut leur<br />
arriver, où le ski paraîtfacile à les voir skier.<br />
Et puis avec Régine, il y a toute une équipe<br />
(filles et entraîneurs) qui depuis plus de 10 ans<br />
travaille <strong>du</strong>r. Une équipe qui ne se forme pas en<br />
un jour, parce que la confiance ne s’acquiert pas<br />
facilement. Une équipe très motivée qui accepte<br />
les risques dans une discipline oh combien<br />
belle, mais tellement exigeante pour des filles.<br />
Une équipe chez qui on ressentait, jusqu’à ce<br />
29 octobre 2001, comme un vent de “baracca”.<br />
Ilnefaut pas admettre que c’est fini !<br />
Pour Régine et pour les autres, nous devons<br />
continuer, parce que c’est leur passion…<br />
L’accident de Régine a montré, à ceux qui<br />
ne le savaient pas, que le ski alpin est très<br />
différent des autres <strong>sport</strong>s.<br />
Il est soumis au milieu naturel, aux conditions<br />
de terrain, à la météo… Ce n’est pas un stade,<br />
on ne peut pas tout y diligenter. Ce <strong>sport</strong><br />
ressemble plutôt à l’alpinisme où il existe<br />
aussi une forme de rivalité avec la nature.<br />
Ilfaut donc accepter le risque et aider<br />
les <strong>sport</strong>ifs à vivre leur passion…<br />
Ou alors, ce sera peut-être la mort des disciplines<br />
de vitesses. Régine l’aurait-elle souhaité ?<br />
D.R.<br />
P. 4-5 PROFESSION<br />
Actualités professionnelles<br />
P. 7-10 ÉVÉNEMENT<br />
GYMNASTIQUE :<br />
1 RE COUPE D’EUROPE DES CLUBS<br />
Le Dr Leglise, président de la commission médicale de<br />
la Fédération internationale de gymnastique, et<br />
Laurent Barbiéri, responsable technique des équipes<br />
de France à l’Insep, nous éclairent sur ce <strong>sport</strong>, la<br />
complexité de ses disciplines, de ses agréés et les<br />
enjeux médicaux qui en résultent.<br />
P. 11-13 FICHE TECHNIQUE<br />
Traitement de la tendinite d’Achille :<br />
place <strong>du</strong> Laser CO 2<br />
< DOSSIER ><br />
P.15-26<br />
Maladies chroniques<br />
et <strong>sport</strong><br />
2 e partie<br />
La deuxième partie de ce dossier est<br />
consacrée à la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> chez<br />
des patients souffrant d’arthrose et<br />
d’hypertension artérielle.<br />
P. 28-29 CAS CLINIQUE<br />
Une fausse méralgie<br />
P. 30-31 MATÉRIEL<br />
Examen “clinique” de la chaussure<br />
de course à pied<br />
P. 32-33 MISE AU POINT<br />
Etude clinique : cycle menstruel<br />
et performances <strong>sport</strong>ives<br />
Sommaire<br />
D R M ARIE-PHILIPPE ROUSSEAU-BLANCHI<br />
Médecin des équipes de France de ski, Albertville.<br />
P. 34 ABONNEMENT<br />
Directeur de la publication :Dr Antoine Lolivier - Rédacteur en chef :Dr Didier Rousseau - Rédacteur en chef adjoint :Odile Mathieu -Secrétaire de rédaction :<br />
Isabelle Ampart - Maquette :Christine Lecomte - Pro<strong>du</strong>ction :Gracia Bejjani - Comité de rédaction :Dr Gilles Bruyère- Pr François Carré - Pr Pascal Christel - Dr Jean-<br />
Marie Coudreuse - Laurence Ducrot - Dr Hervé de Labareyre - Dr Olivier Fichez - Dr Jacques Gueneron - Dr Eric Joussellin - Dr Pascal Lefèvre - Dr Philippe Le Van-<br />
Dr Dominique Lucas - Dr Patrick Middleton - Dr Paule Nathan - Dr Marie-France Oprendek-Roudey - Dr Jacques Parier - Dr Gérard Porte - Dr Jacques Pruvost - Dr Philippe<br />
Thelen - Dr Hervé Zakarian. - Service d’abonnement :Ghislaine Chih - Photos de couverture :FFTRI<br />
Cette publication est éditée par Expressions Santé, 2, rue de la Roquette – Passage <strong>du</strong> Cheval Blanc, cour de Mai - 75011 Paris.Tél.: 01 49 29 29 29. Fax : 0149292919.<br />
E-mail : mds@expressions-sante.fr - N °ISSN : 1279-1334. Imprimeur :Imprimerie de Compiègne, 60205 Compiègne.<br />
Tous les articles sont sous la responsabilité de leurs auteurs.<br />
MÉDECINS DU SPORT 3 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Profession<br />
Profession<br />
ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES<br />
Mention<br />
d’adresses<br />
Inter<strong>net</strong><br />
sur les<br />
ordonnances<br />
Le Conseil national de<br />
l’Ordre des médecins<br />
vient de publier sur son<br />
site Inter<strong>net</strong> une “note<br />
à propos des<br />
inscriptions à caractère<br />
informatique sur les<br />
ordonnances des<br />
médecins”.<br />
Cette note distingue<br />
deux types<br />
d’indications<br />
électroniques: l’adresse<br />
mail professionnelle qui<br />
permet de recevoir <strong>du</strong><br />
courrier électronique et<br />
l’adresse de type URL<br />
qui permet d’accéder à<br />
un site web. Un<br />
médecin peut donc les<br />
faire figurer sur une<br />
ordonnance à<br />
condition toutefois que<br />
l’URL concerne un site<br />
d’information ou de<br />
contact dans le cadre<br />
strict de son activité<br />
professionnelle.<br />
www.conseilnational.medecin.fr<br />
Les droits<br />
des malades<br />
renforcés<br />
Le projet de loi relatif<br />
aux droits des malades<br />
et à la qualité <strong>du</strong><br />
système de santé<br />
a été adopté fin<br />
septembre par la<br />
commission des<br />
Affaires sociales de<br />
l’Assemblée nationale.<br />
Ce texte de loi<br />
instaure le principe<br />
d’accès direct <strong>du</strong><br />
patient à son dossier<br />
médical ou par<br />
l’intermédiaire d’un<br />
praticien (qu’il<br />
désigne). Ce projet<br />
garantit aux malades<br />
le respect de leur<br />
dignité et <strong>du</strong> secret<br />
médical ainsi que<br />
l’accès au soin sans<br />
discrimination.<br />
ÉTUDE<br />
Radiographie et traumatismes cervicaux<br />
Une étude canadienne parue dans JAMA au<br />
mois d’octobre a tenté d’établir une procé<strong>du</strong>re<br />
pour déceler un traumatisme aigu<br />
de vertèbres cervicales afin de permettre une<br />
sélection plus précise des prescriptions, notamment<br />
en ce qui concerne les radiographies.<br />
Durant 4 ans,8 924 a<strong>du</strong>ltes âgés,en moyenne de<br />
37 ans,victimes de traumatisme léger de la tête et<br />
<strong>du</strong> cou et ayant des signes vitaux stables (pression<br />
artérielle > 90 mm Hg, fréquence respiratoire<br />
entre 10 et 24/min) ont été auscultés par<br />
des médecins, avant de pratiquer une radiographie.<br />
Ces derniers ont évalué leur état selon<br />
20 paramètres standard.<br />
En évaluant les réponses de ce questionnaire par<br />
rapport aux diagnostics établis,le modèle obtient<br />
une sensibilité de 100 % et une spécificité<br />
de 42,5 %.<br />
D’après ces résultats,le taux de prescription pour<br />
une radiographie aurait dû être,selon les auteurs,<br />
de 58,2 %.<br />
Une procé<strong>du</strong>re qui,si elle est validée,devrait permettre<br />
de ré<strong>du</strong>ire considérablement les abus de<br />
prescription de radiographies cervicales. ■<br />
Pour en Savoir plus:<br />
Stiell IG, Wells GA, Vandemheen KL et al.<br />
The Canadian C-spine rule for radiography in<br />
alert and stable trauma patients. JAMA2001 ;<br />
286 (15): 1893-4.<br />
CONGRÈS<br />
Echos de la Sofcot<br />
Du 6 au 9 novembre dernier, se déroulait, à Paris, la 76 e réunion annuelle de<br />
la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique.<br />
Entorses de la base <strong>du</strong> pouce<br />
Les articulations métacarpo-phalangiennes<br />
sont très exposées aux entorses. Fréquentes<br />
chez les gardiens de but et les skieurs maladroits,<br />
les lésions ligamentaires de la métacarpo-phalangienne<br />
concernent surtout le<br />
ligament collatéral interne (ulnaire ou cubital),dont<br />
on connaît les difficultés de cicatrisation<br />
en cas de non réparation chirurgicale.<br />
L’équipe <strong>du</strong> Pr Alnot (Bichat, Paris) souligne<br />
qu’il en est de même pour les atteintes <strong>du</strong><br />
côté radial. Ils dénoncent la sous-estimation<br />
de ces lésions développant secondairement<br />
des instabilités rési<strong>du</strong>elles. Souvent associée<br />
à des lésions propagées dorsales et <strong>du</strong> court La pratique <strong>du</strong> ski expose souvent les <strong>sport</strong>ifs aux<br />
ad<strong>du</strong>cteur <strong>du</strong> pouce, l’atteinte <strong>du</strong> plan ligamentaire<br />
radial doit faire l’objet d’une attention particulière lors de la prise en charge<br />
entorses de la base <strong>du</strong> pouce.<br />
au stade aigu, d’autant que la réparation de ces combinaisons lésionnelles est moins satisfaisante<br />
lorsqu’elles sont anciennes.<br />
■<br />
Rupture <strong>du</strong> LCA chez l’enfant<br />
Lésions fréquentes chez l’enfant <strong>sport</strong>if, la rupture <strong>du</strong> ligament croisé antérieur pose le<br />
problème d’une thérapeutique adaptée à un organisme en pleine croissance. La réparation<br />
chirurgicale reste l’indication la plus courante, malgré l’immaturité squelettique des<br />
patients et les risques de perturbation des plaques de croissance. Deux équipes (Pr Bonnard<br />
et Pr Jaeger) font part de leur expérience satisfaisante auprès de 30 enfants opérés.<br />
L’équipe <strong>du</strong> Pr Bonnard se base sur la technique de référence intra-articulaire pratiquée<br />
chez l’a<strong>du</strong>lte, soulignant l’importance <strong>du</strong> respect de règles techniques très strictes chez<br />
l’enfant. L’équipe <strong>du</strong> Pr Jaeger est plutôt partisane d’une technique stabilisante, écartant<br />
le risque d’agression des zones de croissance.<br />
Le meilleur moyen d’éviter ce genre de complication étant encore d’éviter ces lésions ;<br />
la prévention reste de mise pour ces jeunes populations à risque (préparation, échauffement…).<br />
■<br />
D.R.<br />
D.R.<br />
MÉDECINS DU SPORT 4 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
ÉPIDÉMIOLOGIE<br />
La recherche clinique<br />
sur Inter<strong>net</strong><br />
Utiliser l’outil Inter<strong>net</strong> pour la<br />
recherche clinique,c’est possible!<br />
C’est en tout cas l’objectif de MedicAweb,<br />
une jeune société fondée par des médecins<br />
et des informaticiens issus de l'in<strong>du</strong>strie<br />
pharmaceutique,spécialisée dans<br />
la conception,le développement,le suivi<br />
et l’exploitation d’études spécifiques au domaine de la santé.<br />
Avec l’étude Epiloc,qui avait pour objectif d’analyser les troubles<br />
de la locomotion vus en médecine générale.Transparence,facilité<br />
d’utilisation, adaptation des questionnaires destinés au personnel<br />
médical, absence de donnée aberrante, ce système semble<br />
être un réel succès auprès des médecins qui se sentent près pour<br />
les enquêtes en ligne.<br />
http://www.medicaweb.<strong>net</strong><br />
CARDIOLOGIE<br />
L’exercice régulier contre<br />
l’athérosclérose<br />
Une étude finlandaise,menée sur 128 hommes âgés de 50 à<br />
60 ans,présentée dans le cadre <strong>du</strong> congrès de l’American<br />
heart association,montre que l’exercice physique régulier permet<br />
de lutter contre l’athérosclérose en abaissant les taux<br />
sériques de protéine C Réactive (marqueur inflammatoire et<br />
puissant prédicteur <strong>du</strong> risque cardiovasculaire). Un effet qui<br />
semble être plus marqué chez les patients génétiquement susceptibles<br />
aux maladies cardiovasculaires, chez lesquels l’activité<br />
physique régulière implique une ré<strong>du</strong>ction de 49 % <strong>du</strong><br />
taux sérique de la protéine.<br />
■<br />
PRÉVENTION<br />
Mort subite chez<br />
les jeunes <strong>sport</strong>ifs<br />
On en parlait déjà lors des 22 e Jeux mondiaux de la médecine<br />
et le sujet revient lors <strong>du</strong> congrès de l’AHA (American<br />
heart association). Si les taux de survenue de mort subite restent<br />
peu élevés dans l’absolu,une étude italienne menée <strong>du</strong>rant<br />
20 ans sur des sujets âgés de 12 à 35 ans,montre que le risque<br />
de mort subite est 2,5 fois plus élevé chez les jeunes <strong>sport</strong>ifs en<br />
compétition par rapport aux autres indivi<strong>du</strong>s. Elles sont souvent<br />
la conséquence d’anomalies congénitales des coronaires<br />
et de dysplasie ventriculaire droite arythmogène, des pathologies<br />
qui peuvent passer inaperçues chez les sujets jeunes, y<br />
compris lors d’un ECG (pour les cardiomyopathies hypertrophiques).<br />
C’est pourquoi il est important d’insister sur les<br />
mesures de prévention lors <strong>du</strong> bilan d’aptitude de l’enfant:un<br />
examen physique soigneux, une étude poussée des antécédents<br />
familiaux et un bilan plus poussé avec ECG, échographie<br />
ou épreuve d’effort.L’autre volet de la prévention consiste<br />
à ne pas négliger les signes d’alerte (malaises,perte de connaissance)<br />
et à former le personnel encadrant les <strong>sport</strong>ifs, afin de<br />
leur donner les moyens d’agir au plus vite.<br />
■<br />
■<br />
Tapez<br />
www.menarini.fr<br />
et découvrez le premier site francophone<br />
consacré à la médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
Mise à jour<br />
tous les mois<br />
Demandez votre code d’accès<br />
par e-mail à :<br />
menarini@expressions-sante.fr<br />
•Plus de 1 000 pages de documents consacrés à la<br />
médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
•Plus de 500 photos classées par localisation anatomique<br />
•Des données épidémiologiques sur plus de 7 000 cas<br />
•Des articles originaux<br />
•Un accès aux moteurs de recherche bibliographiques<br />
et des liens vers de nombreux sites inter<strong>net</strong> (Medline,<br />
CHU de Rouen, INSEP…)<br />
•Une base de données exclusive en médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
•Le calendrier des événements <strong>sport</strong>ifs<br />
et l’index de tous les articles<br />
de Médecins <strong>du</strong> Sport,<br />
référencés depuis sa création.<br />
MÉDECINS DU SPORT 5 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Gymnastique<br />
I re coupe d’Europe des clubs<br />
C’est la ville de Nantes qui a été choisie pour accueillir, les 7 et<br />
8 décembre, la toute première coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />
artistique (masculine et féminine) et rythmique (féminine). Au total,<br />
quatre clubs, plus le club invitant, y ont participé. En gymnastique artistique,<br />
il s’agit, chez les hommes, des clubs d’Epinay-sur-Senard,<br />
d’Orléans, de Hanovre (Allemagne), d’Antibes et Nantes. Chez les filles<br />
ont été sélectionnés : Charleroi (Belgique), Brixia (Italie), Dijon et<br />
Lissonne (Italie). En gymnastique rythmique féminine les clubs de Fano<br />
(Italie), Strasbourg, Gallarete (Italie) et Montpellier. Au total, 13 équipes<br />
de 5 gymnastes, dont des internationaux, étaient présentes au Palais des<br />
Sports de Beaulieu. L’occasion pour le docteur Michel Leglise, président<br />
de la commission médicale de la Fédération internationale de gymnastique<br />
et Laurent Barbiéri, responsable technique des équipes de<br />
France à l’Insep de faire le point sur une discipline souvent méconnue et<br />
parfois sujette à controverse.<br />
■<br />
DPPI<br />
Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />
Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />
MÉDECINS DU SPORT 7 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />
Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />
Pratiquée dans l’Antiquité (Chine,Inde,<br />
Égypte, Grèce, Rome) pour la santé<br />
et comme entraînement militaire, la<br />
gymnastique est abandonnée au Moyen-<br />
Âge sous la pression de l’Eglise,sauf par la<br />
noblesse et les saltimbanques. Elle réapparaît<br />
en France en tant que discipline <strong>sport</strong>ive<br />
grâce à Philippe Tissié qui intro<strong>du</strong>it,à<br />
partir de 1890, les principes de la gymnastique<br />
suédoise formulés par Ling et à<br />
Georges Hébert qui élabore,en 1910,une<br />
méthode “d’exercices naturels”à partir de<br />
l’observation des peuples primitifs.<br />
Créée en 1873, l’Union des sociétés de<br />
gymnastique de France, la première <strong>du</strong><br />
genre, aura pour devise “patrie, courage,<br />
moralité”.<br />
A cette époque, les programmes mêlent<br />
les exercices gymniques et des performances<br />
athlétiques,comme par exemple<br />
le grimper à la corde lisse, le saut à la<br />
perche, le lever de la “gueuse” de pierre<br />
le plus souvent possible.Mais les compétitions<br />
vont laisser la place à un nombre<br />
limité d’exercices,pour atteindre aujourd’hui<br />
six épreuves pour les hommes et<br />
quatre pour les femmes. La gymnastique<br />
est inscrite aux Jeux Olympiques depuis<br />
1896 pour les hommes et depuis 1928<br />
pour les femmes.<br />
La Fédération française de gymnastique<br />
(FFGym) est le seul organisme français<br />
affilié à la Fédération internationale de<br />
gymnastique et à l’Union européenne de<br />
gymnastique, créée le 27 mars 1982.<br />
Les championnats <strong>du</strong> Monde sont créés<br />
en 1903,la coupe <strong>du</strong> Monde,en 1975 (elle<br />
a lieu tous les 2 ans) et, depuis 1982, les<br />
championnats d’Europe qui se déroulent<br />
tous les 2 ans.<br />
LA GYMNASTIQUE<br />
ARTISTIQUE<br />
Six épreuves caractérisent la gymnastique<br />
artistique masculine (Cf.encadré p.10):<br />
le sol, le cheval d’Arçons, les anneaux, le<br />
saut de cheval, les barres parallèles et la<br />
barre fixe.<br />
« Le gymnaste s’exprime au sol en enchaînant<br />
technique et difficultés, au cheval<br />
d’Arçons et aux anneaux pour un véritable<br />
travail de puissance, à la barre fixe<br />
et aux barres parallèles en se jouant<br />
d’équilibre, de voltige et au saut de cheval<br />
en s’envolant,explique-t-on à la Fédération<br />
française de gymnastique. Des<br />
sorties de plus en plus complexes,des difficultés<br />
grandissantes, une recherche de<br />
l’élégance permanente,sont les tendances<br />
actuelles de cette discipline.» Un code de<br />
pointage publié tous les 4 ans par la Fédération<br />
internationale de gymnastique définit<br />
les normes de notation des athlètes<br />
par les juges. Les notes vont de 0 à 10<br />
points.<br />
La gymnastique artistique féminine<br />
se décline en 4 épreuves: le saut de cheval,<br />
la poutre, les barres asymétriques et<br />
le sol (Cf. encadré p. 9).<br />
LA GYMNASTIQUE<br />
RYTHMIQUE<br />
Depuis 1984, la gymnastique rythmique<br />
a rejoint la gymnastique artistique,en tant<br />
que <strong>sport</strong> olympique. Particulièrement<br />
axée sur la chorégraphie,elle se pratique<br />
avec différents éléments.<br />
● La corde, dont la longueur et la souplesse<br />
permettent un travail spécifique,<br />
basé sur les sauts et une chorégraphie très<br />
riche,permet d’apprécier la vitesse d’exécution<br />
des gymnastes.<br />
● Le ruban est l’appareil le plus spectaculaire.<br />
Attaché à une baguette (la hampe)<br />
avec des anneaux et un joint flexible, il<br />
doit être en mouvement permanent. Les<br />
figures sont exécutées à des amplitudes<br />
différentes,représentant chacune des dessins<br />
dans l’espace (serpentins,spirales et<br />
lancers de ruban).<br />
● Le cerceau permet à la gymnaste de<br />
jouer avec son volume. La manipulation<br />
nécessite de fréquents changements de<br />
prise et de très bonnes capacités de coordination.Sa<br />
forme favorise les roulers,les<br />
rétros, les passages dans l’engin, les rotations<br />
et les renversements.<br />
● Le ballon est en symbiose avec le corps<br />
et permet d’exprimer la sensibilité de la<br />
gymnaste.Très chorégraphique,il n’autorise<br />
aucune erreur.<br />
● Les massues nécessitent une très<br />
grande dextérité <strong>du</strong>rant les exercices.Les<br />
gymnastes peuvent exécuter des mouli<strong>net</strong>s,des<br />
petits cercles,des rouleaux,des<br />
lancers et des figures asymétriques en<br />
combinaison avec des figures variées.L’utilisation<br />
des massues privilégie le travail<br />
rythmique.<br />
LE TRAMPOLINE<br />
« Le trampoline, explique-t-on à la Fédération<br />
française de gymnastique, permet<br />
de réaliser un enchaînement de 10 sauts<br />
consécutifs. A chaque saut,l’enjeu est de<br />
multiplier et de diversifier les rotations<br />
<strong>du</strong> corps dans l’espace,à une hauteur supérieure<br />
à 7 mètres.Au niveau international,<br />
DPPI<br />
les hommes réalisent, en 10 sauts environ,<br />
23 rotations de type “salto” combinées<br />
à environ 16 rotations de type<br />
“vrille”,soit,en tenant compte de la valorisation<br />
<strong>du</strong>e aux positions carpées et ten<strong>du</strong>es,<br />
une difficulté d’environ 14 points.<br />
Les femmes à une hauteur un peu<br />
moindre réalisent, en 10 sauts environ,<br />
21 rotations de type “salto”combinées à<br />
environ 13 rotations de type “vrille”qui,<br />
valorisées par les positions carpées<br />
et ten<strong>du</strong>es les con<strong>du</strong>isent à près de<br />
12 points de difficultés. Chaque trampoliniste<br />
réalise, lors des épreuves qualificatives,<br />
un mouvement imposé puis<br />
un mouvement libre. »<br />
MÉDECINS DU SPORT 8 N° <strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
PATHOLOGIES<br />
ACCIDENTELLES<br />
Aujourd’hui, avec plus de 200000 licenciés<br />
(au 31 août 2001,la Fédération Française<br />
de gymnastique comptabilisait<br />
221 579 licenciés et 1 656 clubs affiliés,<br />
soit 6,82 % de plus qu’en fin de saison<br />
1999),la gymnastique bénéficie d’un suivi<br />
médical particulièrement renforcé. « Au<br />
total, explique le docteur Michel Leglise,<br />
président de la commission médicale de<br />
la Fédération internationale de gymnastique,l’accident<br />
le plus fréquent,tous sexes<br />
confon<strong>du</strong>s,est incontestablement l’entorse<br />
de cheville.Viennent ensuite des pathologies<br />
lombaires de type lombalgies,des fractures<br />
liées à des chutes aux agrès ou au<br />
saut de cheval.<br />
Mais en ce qui concerne plus particulièrement<br />
le cheval de saut,le risque de blessures<br />
après la réalisation d’un salto avant<br />
a été considérablement ré<strong>du</strong>it dernièrement.<br />
En effet, le cheval de saut a été<br />
modifié de façon à éviter ce type d’accidents.<br />
S’ajoute à cela, et pour l’ensemble<br />
des agrès,un renforcement permanent de<br />
la qualité des tapis.Toutefois,le risque de<br />
mal tomber demeure.<br />
Signalons aussi une pathologie cutanée très<br />
spécifique des gymnastes:le décollement<br />
accidentel des cals lors d’exercices aux agrès.<br />
D’une façon générale, les accidents qui<br />
nécessitent des solutions chirurgicales<br />
sont rares. Citons cependant la rupture<br />
des croisés antérieurs <strong>du</strong> genou et, bien<br />
que cela soit devenu exceptionnel<br />
DPPI<br />
DDPI<br />
aujourd’hui,<strong>du</strong> tendon d’Achille.Peuvent<br />
également survenir des luxations <strong>du</strong><br />
coude, des chevilles et des entorses des<br />
doigts. A la poutre,sont notamment observés<br />
des accidents au niveau des chevilles<br />
et des genoux, résultant principalement<br />
de chutes ou d’erreurs d’ordre technique.<br />
Mais en dépit de ces éléments statistiques,<br />
la gymnastique peut être considérée<br />
comme un <strong>sport</strong> peu traumatique et cela<br />
même à haut niveau. Malheureusement<br />
ce <strong>sport</strong> doit aussi déplorer de très rares<br />
accidents au niveau des cervicales, avec<br />
un risque mortel ou tétraplégique. »<br />
PATHOLOGIES<br />
DE CROISSANCE<br />
« En fait,précise le Dr Leglise,il convient<br />
surtout de distinguer les pathologies liées<br />
à des accidents et les pathologies in<strong>du</strong>ites<br />
à la croissance. Car la particularité de la<br />
gymnastique est le jeune âge des pratiquants;<br />
les filles peuvent commencer le<br />
haut niveau vers 12-13 ans et s’arrêter vers<br />
20 ans, tandis que les garçons s’arrêtent<br />
vers 27-28 ans.<br />
Citons, à cet égard, des ostéochondroses<br />
au niveau <strong>du</strong> genou,<strong>du</strong> coude et <strong>du</strong> rachis<br />
(lombalgies,spondilombalgies).Sont également<br />
à signaler des pathologies chroniques<br />
au niveau des poig<strong>net</strong>s.<br />
Et si ces pathologies de croissance ne sont<br />
pas diagnostiquées tôt et corrigées à travers<br />
une réforme de l’entraînement, certains<br />
sujets peuvent garder des séquelles.»<br />
HALTE AUX IDÉES REÇUES<br />
« Il est d’ailleurs important de faire un<br />
point raisonné, poursuit le Dr Leglise, en<br />
particulier face à certaines polémiques<br />
fondées sur des scandales médiatiques<br />
sans la moindre base scientifique sérieuse.<br />
La gymnastique artistique<br />
au féminin<br />
Le sol<br />
Sur un plancher de bois dynamique recouvert d’un tapis de<br />
mousse et d’une moquette, la gymnaste effectue trois séries acrobatiques<br />
accompagnées de passages chorégraphiques où l’expression et<br />
l’émotion conditionnent la notation. Un enchaînement actuel comporte de<br />
trois à quatre diagonales. L’exercice <strong>du</strong>re 1,10 minutes.<br />
Le saut de cheval<br />
Après une course d’élan de 25 mètres (maximum), la gymnaste<br />
prend appel sur le tremplin, puis s’envole pour exécuter une figure<br />
acrobatique avant d’assurer une réception la plus stable possible. Sont<br />
jugés : la complexité <strong>du</strong> saut, l’envol, la tenue <strong>du</strong> corps et la réception. Avant<br />
l’impulsion des deux pieds sur le tremplin, la gymnaste peut effectuer,si<br />
elle le désire, un élément préparatoire comme une rondade.<br />
La poutre<br />
Pendant plus de 70 secondes, sur une bande large<br />
de 10 cm, la gymnaste doit associer acrobaties, souplesse,<br />
équilibre, rythme et expression. Avec une technique de précision et<br />
un grand pouvoir de concentration, elle alterne sauts, mouvements acrobatiques<br />
et d’équilibre selon un déroulement chorégraphique.<br />
Les barres asymétriques<br />
La gymnaste doit alterner des phases d’appui et de<br />
suspension, des saltos, des changements de face<br />
et des grands tours. La sortie est une combinaison de rotations, avant, arrière<br />
ou longitudinale. On ne peut enchaîner plus de 4 figures à<br />
la même barre. Des enchaînements qui comportent, au minimum,<br />
10 éléments en suspension, en appui ou en libre, avec élan. Les barres asymétriques<br />
sont en bois avec armatures en fibre de verre<br />
ou d’acier.L’écartement des barres est réglable selon la taille de la<br />
gymnaste.<br />
Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />
MÉDECINS DU SPORT 9 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />
Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />
La gymnastique artistique<br />
au masculin<br />
Le sol<br />
Sur une surface de 12 mètres sur 12, appelée praticable, les<br />
gymnastes ont entre 50 et 70 secondes pour alterner des mouvements<br />
d’acrobatie pure et de chorégraphie. 3 à 4 séries acrobatiques<br />
sont exécutées dans au moins deux directions (avant, arrière et latérale)<br />
incluant des mouvements d’équilibre, de souplesse (comme le grand<br />
écart) et de force. Pas d’accompagnement musical.<br />
Le cheval d’Arçons<br />
C’est un travail en appui. Seules les mains peuvent toucher<br />
le cheval d’une hauteur d’1,5 m et les figures doivent être réalisées<br />
sans rupture de rythme. Les cercles jambes serrées prédominent<br />
sur ceux jambes écartées. Seuls quelques ciseaux entrecoupent l’harmonie<br />
<strong>du</strong> mouvement.<br />
Les anneaux<br />
C’est l’appareil qui sollicite le plus de force musculaire ; en<br />
suspension et en appui, le gymnaste démontre tant sa force<br />
que son équilibre. Le balancement est source de pénalisation. L’exercice<br />
est composé d’éléments d’élan, de force et de maintien. La sortie met en<br />
valeur la maîtrise acrobatique <strong>du</strong> gymnaste. L’épreuve doit compter au<br />
moins deux appuis renversés, dont l’un est exécuté en force et l’autre en<br />
élan. Les éléments de force maintenus au moins deux secondes. A haut<br />
niveau, les gymnastes effectuent cinq, voire six éléments de force.<br />
Le saut de cheval<br />
Après une course de 25 mètres et un appel sur un tremplin,<br />
le gymnaste pose une, ou deux, mains sur le cheval, placé dans<br />
le sens de la longueur. Cette impulsion, lui permet de réaliser une figure<br />
avec une ou plusieurs rotations autour des différents axes <strong>du</strong> corps. La<br />
diversité des sauts inclut la double rotation ou double vrille. La réception<br />
doit être stable dans l’alignement <strong>du</strong> cheval. Des lignes sur le sol permettent<br />
d’évaluer l’éloignement <strong>du</strong> gymnaste et sa position par rapport à<br />
l’axe de l’élan.<br />
Les barres parallèles<br />
Il s’agit d’une combinaison de suspension, d’équilibre, d’élan,<br />
de voltige et de maintien. La variation permanente et dynamique<br />
demande un travail au-dessus et en dessous des barres avec de<br />
grands tours arrière ou des doubles saltos entre les barres. Les sorties,<br />
complexes, sont exécutées avec une grande amplitude. Une, deux ou trois<br />
rotations composent les exercices.<br />
La barre fixe<br />
A 2,55 mètres <strong>du</strong> sol, le gymnaste, toujours en mouvement,<br />
exécute des lunes et des soleils en combinés avec des rotations<br />
longitudinales en appui ou en suspension, parfois avec un seul bras.<br />
Un exercice en suspension dorsale et un lâcher de barre sont obligatoires.<br />
La sortie permet d’apprécier le sens acrobatique <strong>du</strong> gymnaste qui<br />
combine les rotations dans tous les axes. L’exercice peut comprendre<br />
des bascules, des tours d’appui, des grands tours ainsi que des pirouettes.<br />
Au plus haut niveau, les gymnastes réalisent dans leur mouvement trois,<br />
voire quatre, lâchers de barre, parfois enchaînés ou avec une pirouette.<br />
Ilstravaillent également sur un bras et la sortie comprend souvent un<br />
triple salto arrière.<br />
Car le respect de l’enfant,de sa santé physique<br />
et psychique et de son avenir, doivent<br />
être notre unique préoccupation en<br />
tant que médecin. Même si l’apprentissage<br />
très jeune de la gymnastique ne doit<br />
pas être remis en question, sa pratique à<br />
haut niveau est à considérer comme un<br />
mode de vie.Ce qui signifie concrètement<br />
que les jeunes gymnastes qui rejoignent le<br />
haut niveau doivent être sélectionnés sur<br />
des critères de grande rigueur et ne doivent<br />
pas être sollicités et poussés par des<br />
entraîneurs ou des médecins peu scrupuleux,voire<br />
par des parents irresponsables.<br />
D’autre part,à la question:la pratique spécifique<br />
et intensive de la gymnastique limitet-elle<br />
la croissance et par là même la taille<br />
définitive? Je répondrais non ! Cette discipline<br />
n’empêche pas de grandir et en terme<br />
de retard d’âge osseux,d’apparition ou de<br />
troubles des règles,la gymnastique n’a pas<br />
d’effet spécifique. En revanche, l’exercice<br />
physique intense,quel qu’il soit,peut provoquer<br />
des troubles.Et dans tous les cas,la<br />
croissance se poursuit plus longtemps.<br />
Outre le suivi médical classique et le travail<br />
de soin,le rôle <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>,en partenariat<br />
avec les entraîneurs, allie prévention<br />
et conseils. Car de bonnes règles de<br />
diététique,d’hygiène physique et mentale<br />
sont au moins aussi importantes que le suivi<br />
d’un entraînement de bonne qualité.»<br />
MOINS DE FORCE,<br />
PLUS DE SOUPLESSE<br />
«A la gymnastique “en puissance”d’autrefois<br />
a succédé une recherche de dynamisme et<br />
de souplesse toujours intensifiée,explique<br />
Laurent Barbiéri,responsable technique des<br />
équipes de France à l’Insep.Avant,les gymnastes<br />
travaillaient plutôt en force alors qu’aujourd’hui,c’est<br />
l’élan qui est privilégié.Les<br />
athlètes sont ainsi plus minces et leurs<br />
muscles sont plus longs.Au niveau des gabarits,les<br />
filles sont également plus grandes.<br />
Les entraînements ont lieu deux fois par<br />
jour et <strong>du</strong>rent entre quatre et six heures.<br />
La charge de travail par semaine varie de<br />
22 à 25 heures par semaine.Le suivi médical<br />
est donc très important car il permet<br />
d’affiner le travail technique et de renforcer<br />
la qualité des entraînements pour le<br />
bien-être des gymnastes.Nous bénéficions<br />
désormais à l’Insep des conseils de nutritionnistes<br />
et de diététiciens car le temps <strong>du</strong><br />
surentraînement aveugle et de la poursuite<br />
<strong>du</strong> résultat coûte que coûte est désormais<br />
révolu.»<br />
Propos recueillis par Cyril Hofstein<br />
MÉDECINS DU SPORT 10 N° <strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Fiche technique<br />
Traitement de la tendinite d’<br />
place <strong>du</strong> Laser CO 2<br />
Il a mauvaise réputation<br />
et pourtant !<br />
Le Laser CO 2,<br />
à différencier<br />
des “soft Lasers”, mérite<br />
toute notre attention,<br />
et peut s’avérer un<br />
excellent complément,<br />
voire une alternative,<br />
aux traitements<br />
classiques des tendinites.<br />
Nous ne développerons pas ici les<br />
traitements classiques de la<br />
tendinite d’Achille, que chacun<br />
connaît parfaitement.<br />
Citons brièvement :<br />
● le repos absolu,relatif,une modification<br />
de l’entraînement ;<br />
● le glaçage ;<br />
● les anti-inflammatoires locaux ;<br />
● les AINS, voire la corticothérapie par<br />
voie générale ;<br />
● les traitements Kiné,en particulier :MTP,<br />
ultrasons, électrothérapie, réé<strong>du</strong>cation,<br />
étirements ;<br />
● la mésothérapie, quasi admise dans les<br />
protocoles classiques ;<br />
● la talon<strong>net</strong>te amortissante, les semelles<br />
correctrices ;<br />
● la correction d’un désordre métabolique,<br />
les règles hygiéno-diètétiques ;<br />
● l’élimination d’une cause iatrogène (fluoroquinolones,<br />
statines…).<br />
Nous nous intéresserons plus particulièrement<br />
à la Laserthérapie,et précisément<br />
au Laser CO 2 .<br />
Cette technique est utilisée depuis maintenant<br />
17 ans. Encore très peu développée,<br />
et même décriée, elle mérite<br />
cependant toute notre attention.<br />
La mauvaise réputation <strong>du</strong> Laser s’est<br />
basée sur un certain type d’appareils,dits<br />
“soft-Lasers”ven<strong>du</strong>s dans les années 85-90.<br />
* Médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, Puteaux.<br />
QU’EST-CE QU’UN LASER ?<br />
La définition <strong>du</strong> mot Laser tient dans les<br />
5 lettres qui le compose : Lumière<br />
Amplifiée par Stimulation d’une Emission<br />
de Radiations.<br />
Cette lumière possède 3 caractéristiques<br />
essentielles :<br />
● monochromaticité,<br />
● cohérence,<br />
● directivité.<br />
Le Laser est composé schématiquement<br />
de 3 éléments (Fig. 1) :<br />
● une cavité de résonance (tube en verre<br />
fermé à chaque extrémité par un miroir<br />
dont l’un est semi-transparent,permettant<br />
ainsi la sortie <strong>du</strong> rayon) ;<br />
● un milieu actif (gaz,solide,ou liquide) ;<br />
● un dispositif de pompage (électrique,<br />
optique).<br />
A chaque milieu actif correspond une longueur<br />
d’onde.<br />
THÉRAPEUTIQUE AU LASER<br />
Les effets biologiques <strong>du</strong> Laser sont fonction<br />
de la longueur d’onde,de la puissance<br />
et <strong>du</strong> mode (continu ou pulsé) de l’émission.<br />
Trois types de Lasers sont utilisés en thérapeutique<br />
(Tab. I).<br />
1 - Le Laser Hélium-Néon (HeNe),qui<br />
émet dans le rouge,à très faible puissance,<br />
quelques mW,avec une pénétration d’environ<br />
20-30 mm.<br />
2 - Les Lasers à diode infrarouge<br />
(AsGa), émettant dans l’invisible entre<br />
800 et 1 100 nm, ont à peu près la<br />
même pénétration que l’HeNe, avec une<br />
action antalgique et modérément antiinflammatoire.<br />
Ils ont un certain intérêt<br />
dans la pathologie fraîche bénigne,lorsque<br />
leur puissance atteint au moins 3-4 W.<br />
Ces 2 premiers types de Lasers sont<br />
qualifiés de “soft-Lasers”.<br />
3 - Le Laser CO 2 est un Laser chirurgical<br />
(chirurgie ORL, dermato, gynéco). Il est<br />
transformé en Laser thérapeutique par un<br />
système de dispersion par des miroirs<br />
créant un balayage. Sa longueur d’onde<br />
est de 10 600 nm (IR lointain, invisible),<br />
Dr Tania Bellot*<br />
Figure 1 : composition d’un laser.<br />
sa pénétration n’est que de 2 mm, mais<br />
sa puissance peut atteindre 50 W en application<br />
thérapeutique. Il est utilisé en<br />
France depuis 1983,dans le domaine de la<br />
rhumatologie et de la traumatologie.<br />
Par ses actions antalgiques, anti-inflammatoires,<br />
décontracturantes, régénératrices<br />
et défibrosantes, le Laser CO 2<br />
présente un grand intérêt dans le traitement<br />
des pathologies musculo-tendineuses<br />
chroniques.<br />
GROS PLAN<br />
SUR LE LASER CO 2<br />
L’étude<br />
Une étude présentée aux journées de<br />
médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong> des Entretiens de<br />
Bichat dévoile les résultats <strong>du</strong> traitement<br />
de 300 cas de tendinite d’Achille en<br />
monothérapie Laser CO 2 exclusive.<br />
Nous avons utilisé un Laser CO 2 à<br />
balayage de 30 W,émettant en continu ou<br />
en pulsé,suivant des fréquences variables<br />
de 50 à 500 Hz et couplé à un Laser HeNe<br />
de 3 MW pour le rendre visible. On peu<br />
également employer une pièce à main,<br />
qui amène le rayon ponctuellement jusqu’à<br />
la zone cible.<br />
Le protocole fut le suivant :<br />
● 10 minutes d’exposition ;<br />
● 3 fois par semaine pour les tendinites<br />
fraîches, récentes ;<br />
● 2 fois par semaine pour les tendinites<br />
chroniques ;<br />
MÉDECINS DU SPORT 12 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Achille :<br />
Mots clés<br />
Cheville<br />
Tendinite<br />
Laser<br />
Thérapeutique<br />
Tableau I : principales caractéristiques<br />
des lasers utilisés en thérapeutique<br />
(Laser helium-néon (HeNe) ; Laser à diode infrarouge<br />
(As Gra) ; Laser CO 2 ).<br />
dérouillage et/ou d’une douleur à la palpation<br />
et/ou d’un no<strong>du</strong>le ;<br />
3 - enfin, les résultats classés nuls ou<br />
insuffisants (N ou I) lorsqu’il n’y a pas<br />
de reprise <strong>sport</strong>ive possible,même s’il existe<br />
une amélioration dans la vie courante.<br />
Tendinites corporéales<br />
Sur 167 cas traités, les résultats sont les<br />
suivants :<br />
● 81 (TB),<br />
● 62 (B),<br />
● 24 (N ou I),<br />
soit 85 % de succès (143 B et TB).<br />
43 des 95 no<strong>du</strong>les ont totalement disparu<br />
au cours ou au décours immédiat <strong>du</strong> traitement.<br />
122 cas étaient des échecs des traitements<br />
habituels que nous avons évoqués plus<br />
haut, avec une moyenne de 7 mois d’ancien<strong>net</strong>é.<br />
L’effet est rémanent sur 4 à<br />
8 semaines,sans traitement associé,et avec<br />
une reprise progressive de l’entraînement.<br />
Péritendinites<br />
Sur 46 cas traités, les résultats sont les<br />
suivants :<br />
● 27 (TB),<br />
● 12 (B),<br />
● 7 (N ou I),<br />
soit 85 % de succès (39 B et TB).<br />
secondaires après peignage,pour lesquels<br />
les résultats sont équivalents aux chapitres<br />
qui s’y rapportent. Par ailleurs, le Laser<br />
s’avère peu efficace en phase aiguë dans<br />
les algodystrophies ;l’intérêt spectaculaire<br />
<strong>du</strong> Laser CO 2 se situe dans les cas de<br />
fibroses et d’adhérences cicatricielles,<br />
même à distance de l’intervention (plusieurs<br />
années).<br />
Citons également les atrophies postcortisoniques,avec<br />
dépigmentation,après<br />
infiltration d’une bursite,qui régénère en<br />
quelques 3 à 5 séances.<br />
Précautions d’emploi<br />
Le Laser CO 2 est un Laser de forte puissance<br />
dont les dangers de brûlures sont<br />
réels,particulièrement lors de l’utilisation<br />
de la pièce à main.<br />
Utilisé normalement, le Laser CO 2 provoque<br />
une chaleur agréable et l’antalgie<br />
existe dès la fin de la séance.<br />
Signalons toutefois que, même si une<br />
brûlure est provoquée, elle reste superficielle<br />
<strong>du</strong> fait de la très faible pénétration<br />
des rayons.<br />
Effets secondaires<br />
Le seul effet secondaire indéniable est la<br />
recrudescence de la douleur, qui peut<br />
apparaître autant dans les premières<br />
séances qu’en fin de traitement.<br />
Fiche technique<br />
Figure 2 : le Laser CO 2 provoque une<br />
chaleur agréable et l’antalgie apparaît<br />
dès les dix premières minutes.<br />
● au total 5 à 15 séances, soit 10 jours à<br />
8 semaines de traitement.<br />
Le recul minimum pour juger des résultats<br />
fut de 3 mois.<br />
Nous avons classé les résultats en<br />
3 catégories :<br />
1 - les très bon résultats (TB) correspondent<br />
à la disparition de la douleur et<br />
à la reprise de l’activité <strong>sport</strong>ive au niveau<br />
antérieur ;<br />
2 - les bons résultats (B) sont accordés<br />
à une reprise normale de l’activité <strong>sport</strong>ive,<br />
avec persistance d’une douleur de<br />
L’ancien<strong>net</strong>é moyenne est de 3 mois,avec<br />
un nombre moyen de 7 à 8 séances, en<br />
3 à 4 semaines.<br />
Enthésopathies/bursites<br />
Sur 68 cas traités, les résultats sont les<br />
suivants :<br />
● 39 (TB),<br />
● 13 (B),<br />
● 16 (N ou I),<br />
soit 76 % de succès (52 B et TB).<br />
Ces résultats, inférieurs aux précédents,<br />
semblent en fait optimisés actuellement<br />
avec l’utilisation de la pièce à main depuis<br />
1996, en travaillant plus ponctuellement<br />
sur la zone douloureuse.<br />
Douleurs post-chirurgicales<br />
Sur 19 cas traités, les résultats sont les<br />
suivants :<br />
● 10 (TB),<br />
● 4 (B),<br />
● 5 (N ou I),<br />
soit 73 % de succès (14 B et TB).<br />
Cette partie regroupe les cas de récidive<br />
no<strong>du</strong>laire,les bursites ou enthésopathies<br />
Il conviendra alors :<br />
● d’espacer les séances ;<br />
● et/ou de diminuer l’énergie délivrée par<br />
séance, en abaissant le temps d’exposition<br />
ou la puissance utilisée.<br />
On peut aussi être amené à suspendre le<br />
traitement au Laser ;il n’est pas rare alors<br />
d’observer, dans les jours suivants, une<br />
amélioration notable que la poursuite des<br />
séances aurait compromise.<br />
CONCLUSION<br />
Le Laser CO 2 devrait faire partie de<br />
l’arsenal thérapeutique proposé dans les<br />
tendinites Achilléennes comme nous<br />
venons de l’exposer,mais également dans<br />
toute autre localisation,dont les tendinites<br />
rotuliennes qui feront l’objet de la prochaine<br />
étude.<br />
Malheureusement, l’image <strong>du</strong> Laser dans<br />
le milieu médical, ternie par les déceptions<br />
des résultats des “soft-Lasers”,<br />
implique une rareté de fabrication dans<br />
l’Hexagone, puisqu’à ce jour, moins de<br />
10 appareils de ce type sont en service<br />
en France.<br />
■<br />
MÉDECINS DU SPORT 13 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
DOSSIER ><br />
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
Maladies chroniques<br />
et <strong>sport</strong><br />
2 e partie<br />
PR FRANÇOIS CARRÉ*<br />
DR JACQUELINE JAN**<br />
D.R.<br />
La seconde partie de<br />
ce dossier s’intéresse<br />
à la santé des <strong>sport</strong>ifs<br />
vétérans, au travers<br />
de deux pathologies<br />
courantes : l’arthrose et<br />
l’hypertension artérielle ;<br />
la première nécessitant<br />
une orientation au cas<br />
par cas ;<br />
la deuxième trouvant<br />
souvent un bénéfice dans<br />
la pratique <strong>sport</strong>ive.<br />
Mots clés<br />
Arthrose<br />
Hypertension artérielle<br />
Population à risque<br />
Traitement<br />
*SERVICE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES,<br />
UNITÉ DE BIOLOGIE ET DE MÉDECINE<br />
DU SPORT, HÔPITAL PONTCHAILLOU,<br />
RENNES.<br />
** MÉDECIN DU SPORT, RENNES.<br />
D.R.<br />
Sommaire<br />
Intro<strong>du</strong>ction Page 16<br />
Arthrose et <strong>sport</strong><br />
Physiopathologie Page 16<br />
Diagnostic des arthropathies<br />
arthrosiques Page 17<br />
● A - Critères radiologiques<br />
● B - Marqueurs biologiques<br />
Influence <strong>du</strong> <strong>sport</strong> dans<br />
la survenue de l’arthrose Page 17<br />
Quels facteurs favorisent<br />
l’apparition d’arthrose chez<br />
le <strong>sport</strong>if ? Page 18<br />
● A - Age de début de pratique<br />
● B - Intensité de la pratique<br />
● C - Facteurs biomécaniques<br />
● D - Répétition de microtraumatismes<br />
● E - Antécédents chirurgicaux<br />
● F - Poids<br />
● G - Hérédité<br />
● H - Maladies métaboliques<br />
Con<strong>du</strong>ite à tenir<br />
Hypertension artérielle<br />
et pratiques <strong>sport</strong>ives<br />
Pression artérielle<br />
et HTA : rappels<br />
physiopathologiques Page 19<br />
● A - Au repos<br />
● B - A l’effort<br />
Affirmer l’hypertension<br />
artérielle chez le <strong>sport</strong>if Page 21<br />
● A - Mesure de la pression artérielle<br />
chez le <strong>sport</strong>if<br />
● B - Mesure ambulatoire de<br />
la pression artérielle<br />
● C - Profil tensionnel d’effort<br />
Traiter l’hypertension<br />
artérielle <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if Page 22<br />
● A - L’activité physique régulière :<br />
traitement de l’HTA ?<br />
● B - L’activité physique présente-elle<br />
un risque pour l’hyperten<strong>du</strong> ?<br />
● C - Quel traitement pharmacologique pour<br />
le <strong>sport</strong>if hyperten<strong>du</strong> ?<br />
Quelle pratique <strong>sport</strong>ive ?<br />
Pour quel hyperten<strong>du</strong> ? Page 24<br />
● A - Prescription d’une activité physique<br />
modérée chez l’hyperten<strong>du</strong><br />
● B - Le certificat d’aptitude de non-contreindication<br />
à la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> de<br />
l’hyperten<strong>du</strong><br />
Conclusion Page 25<br />
Bibliographie Page 26<br />
MÉDECINS DU SPORT 15 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
< DOSSIER ><br />
D.R.<br />
Intro<strong>du</strong>ction<br />
La première partie de ce dossier concernant la pratique <strong>sport</strong>ive chez des<br />
patients porteurs de maladies chroniques s’était intéressée à des<br />
affections se révélant généralement dans le jeune âge : l’épilepsie et<br />
l’asthme d’effort. La seconde partie qui vous est maintenant proposée<br />
concerne des affections qui touchent plutôt des <strong>sport</strong>ifs “vétérans” :<br />
l’arthrose et l’hypertension artérielle.<br />
L’apparition d’arthrose chez un <strong>sport</strong>if pose un double problème, le rôle<br />
favorisant, voire aggravant, éventuel de la discipline <strong>sport</strong>ive pratiquée<br />
et l’autorisation à la poursuite d’une activité physique régulière, qui<br />
devra être orientée et adaptée à chaque cas. Ces deux aspects sont<br />
abordés par le Docteur Jacqueline Jan, médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, spécialisée<br />
en traumatologie.<br />
L’hypertension artérielle est la pathologie cardiovasculaire le plus<br />
fréquemment rencontrée chez les <strong>sport</strong>ifs. Nous verrons qu’elle<br />
représente exceptionnellement une contre-indication à la pratique<br />
<strong>sport</strong>ive. Au contraire, celle-ci constitue un outil thérapeutique reconnu<br />
de ce facteur de risque cardiovasculaire majeur.<br />
L’arthrose est en passe de devenir un<br />
important problème de santé<br />
publique. Aux Etats-Unis, Parker (1)<br />
note une incidence de 32 millions de<br />
cas en 2000 et l’évalue à 60 millions<br />
en 2020, ce qui représentera un coût de<br />
Arthrose et <strong>sport</strong><br />
1,1 % <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it national brut. L’intérêt<br />
bénéfique de l’activité physique est largement<br />
reconnu dans la prévention de<br />
l’ostéoporose et des pathologies cardiovasculaires,<br />
ainsi que pour la conservation<br />
de la masse musculaire et le bien-être<br />
Physiopathologie<br />
Dr Jacqueline Jan**<br />
psychologique. Toutefois, à côté de ces<br />
apports positifs, le <strong>sport</strong> est souvent accusé<br />
d’avoir un rôle néfaste sur le cartilage articulaire.<br />
Existe-t-il une corrélation entre la<br />
pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> et l’apparition de dégénérescence<br />
arthrosique?<br />
Les lésions arthrosiques sont des atteintes<br />
dégénératives <strong>du</strong> cartilage, résultant de<br />
phénomènes mécaniques (surcharge) et<br />
biologiques (résistance <strong>du</strong> cartilage) qui<br />
déstabilisent l’équilibre entre la synthèse<br />
et la dégradation.<br />
Lorsque le cartilage articulaire ne joue plus<br />
son rôle “d’amortisseur”, les contraintes<br />
mécaniques sont intégralement transmises<br />
à l’os spongieux sous-chondral et in<strong>du</strong>isent<br />
des réactions d’ostéo-formation et<br />
d’ostéo-résorption accrues, qui con<strong>du</strong>isent<br />
à une ostéo-sclérose sous-chondrale<br />
et à la formation d’ostéophytes prolongeant<br />
et élargissant l’articulation (2).<br />
Pour Radin (3), les contraintes mécaniques<br />
répétées seraient à l’origine de<br />
microfractures trabéculaires de l’os épiphysaire,<br />
responsables d’une perte d’élasticité<br />
<strong>du</strong> socle osseux sous-chondral. Cette<br />
perte d’élasticité favoriserait la dégénérescence<br />
arthrosique (Tab. I).<br />
Il existe différentes hypothèses pathogéniques<br />
permettant d’expliquer l’altération<br />
arthrosique <strong>du</strong> cartilage articulaire:<br />
● la mauvaise répartition des pressions<br />
secondaires à des déformations articulaires<br />
congénitales (mauvais alignement<br />
articulaire) ou acquises (post-traumatiques<br />
ou chirurgicales) ;<br />
● le cartilage articulaire de mauvaise qualité,<br />
les contraintes mécaniques ne faisant<br />
alors qu’accélérer un processus déjà<br />
programmé; ce qui expliquerait le caractère<br />
héréditaire de l’arthropathie arthrosique<br />
chez certaines familles (2) ;<br />
● les contraintes mécaniques trop<br />
intenses liées à l’hypersollicitation répétée<br />
d’une articulation saine; Husson (4) a<br />
Tableau I: la dégénérescence<br />
arthrosique d’après Radin (3).<br />
Charge mécanique<br />
Microfracture trabéculaire<br />
Remodelage osseux<br />
Epaississement osseux<br />
Contrainte articulaire accrue<br />
Lésion cartilagineuse<br />
Dégénérescence articulaire<br />
MÉDECINS DU SPORT 16 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
DOSSIER ><br />
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
démontré qu’une <strong>du</strong>rée de mobilisation<br />
trop longue de 2 surfaces articulaires,<br />
sans repos compensateur, in<strong>du</strong>it des altérations<br />
des cartilages ; ce mécanisme<br />
pourrait expliquer la survenue d’arthrose<br />
lors <strong>du</strong> surmenage articulaire professionnel<br />
ou <strong>sport</strong>if ;<br />
● des troubles métaboliques ou hormonaux<br />
favoriseraient la survenue d’arthropathie<br />
arthrosique dans le cadre de maladies de<br />
surcharge, telles que la maladie de Wilson,<br />
l’hémochromatose, l’acromégalie (2)… ;<br />
● des antécédents de fracture ostéochondrale<br />
ou de contusion peuvent être<br />
à l’origine de lésions dégénératives <strong>du</strong><br />
cartilage (5) (Tab. II).<br />
Tableau II: évolution schématique des lésions en fonction de l’intensité de la contusion.<br />
Contusion Contusion Contusion<br />
“minime” “moyenne” “majeure”<br />
Absence de lésion Chondronécrose Chondronécrose<br />
localisée partielle<br />
éten<strong>du</strong>e majeure<br />
Cicatrisation<br />
Chondromalacie<br />
post-contusive<br />
Stabilisation<br />
Arthrose<br />
post-contusive<br />
Diagnostic<br />
des arthropathies arthrosiques<br />
Le diagnostic des arthropathies arthrosiques<br />
repose essentiellement sur des<br />
critères cliniques :<br />
● douleur d’allure mécanique au début<br />
de la maladie, qui évolue vers un<br />
rythme mixte lors des arthropathies<br />
évoluées en raison de l’atteinte synoviale<br />
;<br />
● raideur matinale ;<br />
● limitations articulaires ;<br />
● “crépitement” articulaire lors de la<br />
mobilisation ;<br />
● déformations articulaires à un stade<br />
évolué de la maladie.<br />
■A - Critères<br />
radiologiques<br />
● Pincement de l’interligne articulaire.<br />
● Sclérose sous-chondrale.<br />
● Présence des ostéophytes marginaux.<br />
Toutefois, il ne faut pas oublier la discordance<br />
fréquente entre la clinique et les images radiologiques<br />
; Parker (1) note une prévalence de<br />
50 % d’arthropathie arthrosique chez une<br />
population de plus de 65 ans, mais seulement<br />
33 % de signes radiologiques.<br />
■B - Marqueurs<br />
biologiques<br />
Des études ont montré une augmentation<br />
<strong>du</strong> taux sanguin de kératane sulfate. Elle<br />
précéderait le développement d’altération<br />
cliniquement mesurable (6), ce qui aurait<br />
pour intérêt la mise en évidence d’altération<br />
cartilagineuse précoce après traumatisme<br />
ou intervention chirurgicale.<br />
Influence <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />
dans la survenue de l’arthrose<br />
Si l’on soupçonne l’existence d’une corrélation<br />
entre l’arthrose et le <strong>sport</strong>, sa mise en<br />
évidence se heurte à des difficultés. Les<br />
résultats des différentes études sont souvent<br />
discordants. Certains affirment l’absence<br />
de lien entre l’activité physique et<br />
l’apparition d’arthrose. Pour d’autres auteurs,<br />
au contraire, cette corrélation existe.<br />
Ces divergences peuvent s’expliquer par<br />
la difficulté d’effectuer une étude comparative<br />
fiable entre des sujets <strong>sport</strong>ifs et non<br />
<strong>sport</strong>ifs. En effet, de nombreux facteurs<br />
interviennent tels que la profession, l’âge,<br />
le poids, les malformations articulaires, le<br />
mauvais alignement des membres inférieurs,<br />
les antécédents traumatiques et <strong>sport</strong>ifs<br />
(type de <strong>sport</strong>, intensité, ancien<strong>net</strong>é).<br />
Boyer (7,8) a effectué une étude rétrospective<br />
sur 375 sujets de plus de 40 ans.<br />
Il a trouvé une corrélation significative<br />
entre la pratique d’une activité <strong>sport</strong>ive<br />
et la présence d’arthrose symptomatique.<br />
Dans une étude suisse comparant 27 coureurs<br />
de fonds internationaux versus<br />
23 sujets non <strong>sport</strong>ifs suivis sur une période<br />
de quinze ans, Marti (9) notait l’apparition<br />
de coxarthrose chez 5 coureurs, contre 0<br />
dans le groupe des non <strong>sport</strong>ifs.<br />
D’autres études concluent également à<br />
un risque prématuré d’arthrose lors de<br />
MÉDECINS DU SPORT 17 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
< DOSSIER ><br />
la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, notamment chez<br />
les footballeurs (gonarthrose (8), coxarthrose<br />
(3)) et chez les haltérophiles<br />
(arthrose fémoro-patellaire (8)).<br />
Vingard (10) estime que le risque de déve-<br />
lopper une coxarthrose est de 4,5 lorsque<br />
l’on associe la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> et un travail<br />
physique. Il passe à 8,5 lors de la pratique<br />
de l’athlétisme ou d’un <strong>sport</strong> de raquette<br />
associé à un travail physique intense.<br />
Au contraire, pour Konradsen (11) et<br />
Panush (12), la pratique de la course à<br />
pied de loisir (20 à 40 km/semaine) n’a<br />
pas de conséquence articulaire au niveau<br />
des membres inférieurs.<br />
Quels facteurs favorisent<br />
l’apparition d’arthrose<br />
chez le <strong>sport</strong>if ?<br />
■A - Age de début<br />
de pratique<br />
De nombreux auteurs cités par Panush (13)<br />
rapportent une relation entre la pratique<br />
précoce d’une activité physique intensive<br />
et la survenue d’arthrose, notamment au<br />
niveau des épaules chez les “pitchers” au<br />
base-ball, des poig<strong>net</strong>s et des hanches<br />
chez les gymnastes…<br />
■B - Intensité<br />
de la pratique<br />
Lors de la pratique de la course à pied,<br />
le kilométrage semble jouer un rôle<br />
important. Pour Konradsen (11) et<br />
Panush (12), il n’y pas de coxarthrose<br />
chez le coureur de loisir (20 à<br />
40 km/semaine), mais Marti (9) retrouve<br />
une corrélation lors d’une pratique plus<br />
intensive (96 km/semaine).<br />
Lors de la pratique <strong>du</strong> football, Borderie<br />
(14) rapporte une prévalence de gonarthrose<br />
de 15,5 % chez les professionnels,<br />
4,2 % chez les amateurs et 1,6 % chez<br />
les sujets témoins.<br />
■C - Facteurs<br />
biomécaniques<br />
Le mauvais alignement des membres infé-<br />
rieurs, surtout s’il est supérieur à 5 %, favorise<br />
l’apparition de gonarthrose (15). De<br />
même, la pratique de la course à pied présente<br />
un facteur de risque de coxarthrose<br />
lorsqu’il existe une dysplasie de hanche.<br />
■D - Répétition de<br />
microtraumatismes<br />
Si l’on se réfère aux études de Husson (4)<br />
et de Gedeon (5), il existe un lien étroit<br />
entre la dégénérescence cartilagineuse<br />
et la répétition des traumatismes. Ceci<br />
permet d’expliquer l’importante prévalence<br />
de l’arthrose chez les <strong>sport</strong>ifs professionnels.<br />
■E - Antécédents<br />
chirurgicaux<br />
La méniscectomie augmente le risque de<br />
gonarthrose (16). Chez des footballeurs,<br />
Chantraine (17) retrouve 100 % de gonarthrose<br />
10 à 20 ans après une méniscectomie.<br />
De la même façon, une ligamentoplastie,<br />
surtout si elle s’accompagne<br />
d’une atteinte méniscale, con<strong>du</strong>it à une<br />
gonarthrose ultérieure (15, 18, 19).<br />
■F - Poids<br />
La surcharge pondérale est un facteur<br />
Con<strong>du</strong>ite à tenir<br />
D.R.<br />
D.R.<br />
Les poig<strong>net</strong>s des<br />
gymnastes : cibles<br />
de l’arthrose.<br />
de risque non négligeable dans la survenue<br />
d’arthrose des membres inférieurs.<br />
■G - Hérédité<br />
Il existe des familles qui développent des<br />
arthropathies arthrosiques en dehors de<br />
tout contexte traumatique et <strong>sport</strong>if (15).<br />
La pratique <strong>sport</strong>ive peut alors constituer<br />
un facteur de risque supplémentaire.<br />
■H - Maladies<br />
métaboliques<br />
Les maladies métaboliques telles que<br />
l’hémochromatose, la maladie de Wilson,<br />
l’acromégalie… (2), peuvent être à l’origine<br />
d’arthropathies d’allure arthrosique.<br />
Dans ces cas, la pratique intensive d’un<br />
<strong>sport</strong> peut favoriser l’apparition de dégénérescences<br />
cartilagineuses. ■<br />
La pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> de loisir ne semble<br />
pas être seule responsable de la survenue<br />
de lésions arthrosiques. Toutefois, si cette<br />
pratique est trop intensive ou s’accompagne<br />
d’un, ou de plusieurs, facteurs de<br />
risque, elle peut alors favoriser l’apparition<br />
de lésions dégénératives <strong>du</strong> cartilage<br />
ou aggraver des lésions pré-existantes.<br />
Il est important, avant de conseiller la pratique<br />
d’un <strong>sport</strong>, d’effectuer un interrogatoire<br />
et un bilan morphologique à la<br />
recherche d’anomalies qui pourraient accélérer<br />
l’évolution vers une arthropathie<br />
arthrosique. En fonction de l’examen clinique,<br />
on orientera le patient vers le <strong>sport</strong><br />
le moins nocif, comme par exemple le vélo<br />
et la natation en cas de coxarthrose. ■<br />
MÉDECINS DU SPORT 18 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
DOSSIER ><br />
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
Hypertension artérielle<br />
et pratiques <strong>sport</strong>ives<br />
Pr François Carré *<br />
artérielle (HTA) est<br />
un facteur de risque cardiovasculaire<br />
majeur qui favorise la sur-<br />
L’hypertension<br />
venue de complications cardiaques<br />
(maladie coronaire et insuffisance cardiaque),<br />
vasculaires (artérite et accidents<br />
vasculaires cérébraux) et rénales (insuffisance<br />
rénale). La prévalence de l’HTA est<br />
L’HTA est la pathologie<br />
cardiovasculaire<br />
le plus souvent<br />
rencontrée chez<br />
les <strong>sport</strong>ifs amateurs.<br />
très importante puisque comprise, dans<br />
les pays in<strong>du</strong>strialisés, entre 15 et 25 %<br />
de la population. Bien que sa prévalence<br />
soit moins élevée chez les <strong>sport</strong>ifs de haut<br />
niveau d’entraînement (1-5 %), l’HTA reste<br />
la pathologie cardiovasculaire le plus souvent<br />
rencontrée chez les pratiquants d’activités<br />
physiques.<br />
Pression artérielle et HTA :<br />
rappels physiopathologiques<br />
■A - Au repos<br />
La pression artérielle (PA) est la variable<br />
circulatoire régulée de l’organisme, elle<br />
est égale au pro<strong>du</strong>it <strong>du</strong> débit cardiaque<br />
par les résistances vasculaires. La pression<br />
artérielle moyenne représente la pression<br />
de perfusion efficace des organes, son<br />
maintien est donc indispensable pour leur<br />
bon fonctionnement. Chez l’a<strong>du</strong>lte jeune,<br />
au repos, en position couchée, la PA systolique<br />
(PAS) est comprise entre 110 et<br />
140 mm Hg, la PA diastolique (PAD) entre<br />
60 et 90 mm Hg et la PA moyenne (PAM)<br />
entre 70 et 95 mm Hg. Ces valeurs qui<br />
sont un peu plus basses chez la femme<br />
ont tendance à augmenter avec l’âge, en<br />
particulier la PAS.<br />
L’HTA est classiquement définie chez<br />
l’a<strong>du</strong>lte par une PA supérieure ou égale<br />
à 140 et/ou 90 mm Hg, retrouvée à plusieurs<br />
reprises au cabi<strong>net</strong> lors d’une<br />
consultation chez un sujet au repos, assis<br />
ou allongé. Il existe une classification de<br />
l’HTA (Tab. III) récemment revue (21).<br />
L’HTA de l’a<strong>du</strong>lte est le plus souvent essentielle,<br />
le mécanisme sous-jacent étant, en<br />
règle générale, une élévation anormale<br />
des résistances périphériques.<br />
Tableau III: classification de la tension artérielle chez l’a<strong>du</strong>lte (21).<br />
PA systolique<br />
(mm Hg)<br />
PA diastolique<br />
(mm Hg)<br />
Tension artérielle<br />
Optimale < 120 < 80<br />
Normale 120-129 80-84<br />
Normale haute 130-139 85-89<br />
Hypertension<br />
Stade 1 (HTA légère) 140-159 90-99<br />
Stade 2 (HTA modérée) 160-179 100-109<br />
Stade 3 (HTA sévère) > 180 > 110<br />
Tableau IV: valeurs normales de la pression artérielle<br />
en fonction de l’âge chez l’enfant (22).<br />
Tranche d’âge PA systolique PA diastolique<br />
(ans) (mm Hg) (mm Hg)<br />
Nouveau-né < 110 < 70<br />
4 - 9 < 125 < 75<br />
10 - 12 < 125 < 80<br />
13 - 15 < 135 < 85<br />
16 - 18 < 140 < 90<br />
MÉDECINS DU SPORT 19 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
< DOSSIER ><br />
Chez l’enfant, il existe aussi des valeurs<br />
normales à connaître (Tab. IV et Fig. 1). Il<br />
nous semble important d’insister sur la<br />
mesure de la PA chez l’enfant (22) car<br />
dans cette population, la visite médicale<br />
de non-contre-indication à la pratique <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong> joue un grand rôle préventif. Au<br />
contraire de l’a<strong>du</strong>lte, l’HTA essentielle chez<br />
l’enfant est exceptionnelle. Il faut d’abord<br />
éliminer une coarctation de l’aorte, puis<br />
réaliser des examens complémentaires<br />
qui, dans plus de 95 % des cas, révéleront<br />
une cause rénale. La mesure de la<br />
PA chez l’enfant requiert l’utilisation d’un<br />
brassard de taille adaptée, recouvrant<br />
toute la circonférence et les deux tiers <strong>du</strong><br />
bras. La mesure de la PAD se fait sur la<br />
disparition des bruits (phase V de Kortokoff)<br />
et non sur leur assourdissement. Vue<br />
la repro<strong>du</strong>ctibilité médiocre de la mesure,<br />
celle-ci devra être répétée.<br />
■B - A l’effort<br />
Les trois composantes de la PA sont modifiées<br />
lors d’un exercice musculaire (23).<br />
Mais l’amplitude et la cinétique d’évolution<br />
de ces paramètres varient selon le<br />
type, l’intensité et la <strong>du</strong>rée de l’exercice.<br />
Le profil tensionnel d’effort (PTE) illustre<br />
les cinétiques d’évolution des PAS et PAD<br />
à l’exercice (24).<br />
Figure 1: les critères d’hypertension artérielle chez l’enfant (22).<br />
(mn/Hg)<br />
240<br />
220<br />
200<br />
Systolique<br />
Diastolique<br />
Tension artérielle en fonction de la taille<br />
garçons de 4 à 18 ans<br />
Nom :<br />
Prénom :<br />
97,5%<br />
Date de naissance :<br />
+ 30 mmHg<br />
HTA<br />
immédiatement<br />
TA<br />
menaçante<br />
97,5%<br />
mmHg<br />
+ 10 mmHg<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
HTA confirmée<br />
HTA limitée<br />
95 105 115 125 135 145 155 165 175<br />
TAILLE (cm)<br />
HTA<br />
immédiatement<br />
menaçante<br />
HTA confirmée<br />
HTA limitée<br />
180<br />
170<br />
160<br />
97,5%<br />
95% 150<br />
90%<br />
140<br />
75%<br />
130<br />
50%<br />
120<br />
185<br />
Percentiles : mmHg<br />
97,5%<br />
+ 30 mmHg<br />
97,5%<br />
+ 10 mmHg<br />
40<br />
95 105 115 125 135 145 155 165 175<br />
TAILLE (cm)<br />
100<br />
90<br />
97,5%<br />
95% 80<br />
90%<br />
75% 70<br />
50% 60<br />
185<br />
120<br />
110<br />
50<br />
40<br />
Systolique<br />
Diastolique<br />
Tension artérielle en fonction de la taille<br />
filles de 4 à 18 ans<br />
Nom :<br />
Prénom :<br />
Date de naissance :<br />
97,5%<br />
+ 30 mmHg<br />
TA<br />
HTA<br />
mmHg<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
immédiatement<br />
menaçante<br />
HTA confirmée<br />
HTA limitée<br />
95 105 115 125 135 145 155 165 175<br />
TAILLE (cm)<br />
HTA<br />
immédiatement<br />
menaçante<br />
HTA confirmée<br />
HTA limitée<br />
97,5%<br />
+ 10 mmHg<br />
97,5%<br />
170<br />
160<br />
150<br />
140<br />
95%<br />
90% 130<br />
75%<br />
120<br />
50%<br />
185<br />
Percentiles : mmHg<br />
97,5%<br />
+ 30 mmHg<br />
97,5%<br />
+ 10 mmHg<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
97,5%<br />
95% 80<br />
90%<br />
75% 70<br />
50% 60<br />
40<br />
40<br />
95 105 115 125 135 145 155 165 175 185<br />
TAILLE (cm)<br />
50<br />
● Chez le sujet sain, lors d’un exercice<br />
dynamique (course à pied,<br />
cyclisme, ski de fond), le débit cardiaque<br />
augmente beaucoup et les résistances<br />
vasculaires périphériques diminuent. La<br />
PAS s’élève proportionnellement à l’intensité<br />
de l’effort (Fig. 2). Ainsi, l’élévation<br />
de la PAS, qui est de 2-3 mm Hg pour<br />
une augmentation de la fréquence cardiaque<br />
de 10 battements, peut être multipliée<br />
par deux pour un effort maximal.<br />
Pour une même puissance d’exercice, les<br />
chiffres augmentent avec l’âge (plus<br />
5 mm Hg par tranche de 10 ans), ceci<br />
étant surtout liée à l’élévation de la rigidité<br />
artérielle. La PAD varie peu et peut<br />
rester stable, voire diminuer. Si l’exercice<br />
est prolongé à une intensité stable sousmaximale,<br />
un nouvel équilibre tensionnel<br />
est observé à un niveau inférieur aux<br />
valeurs initiales (25). En récupération, la<br />
PA de repos pré-effort doit être récupérée<br />
en 6 minutes. Le plus souvent, il y a<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
90<br />
40<br />
10<br />
PAS<br />
PAD<br />
71-80 ans<br />
61-70 ans<br />
51-60 ans<br />
31-40 ans<br />
41-50 ans<br />
11-36 ans<br />
(batt/mn)<br />
70 90 110 130 150 170 190<br />
Fréequence cardiaque<br />
'<br />
Figure 2:<br />
évolution<br />
des pressions<br />
artérielles<br />
systoliques (PAS) et<br />
diastoliques (PAD)<br />
lors d’un exercice<br />
progressivement<br />
maximal, réalisé<br />
sur ergocycle.<br />
La population<br />
étudiée concerne<br />
des hommes de<br />
différentes<br />
tranches d’âge.<br />
Modifiée d’après<br />
Douard (24).<br />
MÉDECINS DU SPORT 20 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
DOSSIER ><br />
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
même une hypotension post-exercice<br />
prolongée (8-12 mm Hg pendant 2 à<br />
7 heures selon les études) plus systolique<br />
que diastolique (26).<br />
● Chez le sujet sain, lors d’un exercice<br />
purement statique (isométrique),<br />
le débit cardiaque s’élève modérément,<br />
mais les résistances ne baissent pas (23).<br />
Il existe donc une élévation rapide et<br />
importante des trois composantes tensionnelles<br />
sans phase de plateau ; l’augmentation<br />
se poursuivant tant que l’effort<br />
est maintenu. L’hypertension est d’autant<br />
plus <strong>net</strong>te que l’effort est intense (pourcentage<br />
de la force maximale volontaire),<br />
prolongé et réalisé avec une respiration<br />
bloquée (manœuvre de Vasalva). L’élévation<br />
tensionnelle disparaît dès l’arrêt<br />
de l’effort et l’importance de la réponse<br />
pressive initiale est diminuée avec un<br />
entraînement spécifique.<br />
● Chez le sujet sain, lors d’un exercice<br />
mixte (dynamique et statique<br />
comme l’aviron), les adaptations tensionnelles<br />
sont intermédiaires et assez<br />
proches, en moyenne, des adaptations<br />
de l’effort dynamiques (23). On voit ainsi<br />
tout l’intérêt de connaître les participations<br />
respectives de ces deux types d’effort<br />
(27) dans les différentes disciplines<br />
<strong>sport</strong>ives (Tab. V).<br />
Tableau V: classification des <strong>sport</strong>s de Mitchell (27), modifié par Brian 1998.<br />
Les <strong>sport</strong>s sont classés en fonction de leur nature (dynamique ou statique)<br />
et de leur intensité.<br />
Composante Dynamique faible Dynamique moyenne Dynamique forte<br />
Isométrique faible Billard Base-ball Badminton<br />
Bowling Tennis de table Ski de fond<br />
Cricket Tennis en double (technique classique)<br />
Curling Volley-ball Hockey sur gazon ✪<br />
Golf<br />
Tir<br />
Course d’orientation<br />
Marche (athlétisme)<br />
Squash<br />
Course de fond<br />
Football ✪<br />
Tennis (simple)<br />
Isométrique moyenne Tir à l’arc Escrime Basket-ball ✪<br />
Course automobile ✪▼ Sauts (athlétisme) Hockey sur glace ✪<br />
Plongeon ✪▼ Patinage artistique ✪ Ski de fond<br />
Motocyclisme ✪▼ Football américain (pas <strong>du</strong> patineur)<br />
Equitation ✪▼ Rugby ✪ Course de demi-fond<br />
Course de vitesse<br />
Natation<br />
Surf ✪▼<br />
Handball<br />
Natation synchronisée ▼<br />
Isométrique forte Luge, bobsleg ✪▼ Body-building ✪▼ Boxe ✪<br />
Lancers (athlétisme) Ski de descente ✪▼ Canoë cayak<br />
Gymnastique ✪▼ Lutte ✪ Cyclisme ✪<br />
Judo, karaté ✪<br />
Décathlon<br />
Voile<br />
Aviron<br />
Escalade ✪▼<br />
Patinage de vitesse<br />
Ski nautique ✪▼<br />
Haltérophilie ✪▼<br />
Planche à voile ✪▼<br />
✪ Risque de traumatisme.<br />
▼ Risque lié à l’environnement en cas de syncope.<br />
● Chez l’hyperten<strong>du</strong> non traité, la<br />
puissance maximale développée est souvent<br />
plus faible que chez le sujet sain,<br />
sans que les valeurs maximales de la<br />
fréquence cardiaque, ni de la concentration<br />
de lactate ne soient altérées.<br />
Chez l’hyperten<strong>du</strong> modéré, la cinétique<br />
d’évolution de la PAS lors d’un exercice<br />
dynamique est parallèle à celle <strong>du</strong><br />
normoten<strong>du</strong>, mais à un niveau plus<br />
élevé. Ce n’est qu’en cas d’HTA sévère<br />
que la pente d’élévation de la PAS est<br />
majorée. La PAD ne diminue pas, voire<br />
augmente, probablement à cause d’un<br />
défaut de vasodilatation périphérique.<br />
Le premier retentissement myocardique<br />
de l’HTA touche la fonction diastolique.<br />
Ainsi, lors de l’exercice chez le jeune<br />
hyperten<strong>du</strong> sans hypertrophie ventriculaire<br />
gauche (HVG), l’augmentation<br />
de la contractilité liée à la stimulation<br />
catécholergique compense cette baisse<br />
des capacités de remplissage ventriculaire<br />
et un débit cardiaque adapté est<br />
conservé. Le développement ultérieur<br />
d’une HVG, peut in<strong>du</strong>ire une baisse de<br />
la fonction systolique avec altération des<br />
capacités d’effort (25). L’hypotension<br />
post-exercice, souvent plus <strong>net</strong>te chez<br />
ces patients, serait <strong>du</strong>e à une baisse <strong>du</strong><br />
débit cardiaque, peut-être à cause d’un<br />
défaut de retour veineux. Lors d’un exercice<br />
statique la réponse pressive de l’HTA<br />
non entraîné est souvent plus explosive<br />
que chez le normoten<strong>du</strong>.<br />
● Le syndrome hyperkinétique est<br />
différent de l’hypertension labile. Anciennement<br />
appelé “névrose tachycardique”<br />
ou “asthénie neuro-circulatoire”, le syndrome<br />
hyperkinétique est défini par un<br />
cœur rapide et un débit cardiaque<br />
élevé. Il s’y associe une tendance hypertensive<br />
systolique, la diastolique étant<br />
épargnée (28). Sa physiopathologie<br />
reste mal connue, elle semble résulter<br />
d’une atteinte périphérique (musculaire<br />
squelettique ?) à l’origine d’une augmentation<br />
de la vitesse de circulation<br />
sanguine.<br />
Au repos, la consommation d’oxygène<br />
est augmentée et, à l’exercice, les résistances<br />
périphériques s’abaissent peu, le<br />
débit cardiaque est normal, mais avec<br />
une tachycardie relative et un volume<br />
d’éjection systolique faible. Le syndrome<br />
hyperkinétique s’observe chez des sédentaires<br />
pouvant présenter une surcharge<br />
pondérale. Vu le risque de développement<br />
d’une insulino-résistance et le mauvais<br />
pronostic connu de la tachycardie<br />
de repos, ce syndrome doit être pris en<br />
charge.<br />
MÉDECINS DU SPORT 21 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
< DOSSIER ><br />
Affirmer l’hypertension<br />
artérielle chez le <strong>sport</strong>if<br />
Si les cas d’HTA sévères posent peu de<br />
problèmes, les diagnostics d’HTA légère<br />
ou modérée peuvent être plus difficiles.<br />
Ils reposent, bien sûr, sur la mesure de la<br />
PA au cabi<strong>net</strong>, mais il faudra savoir s’aider<br />
de deux autres examens : la mesure<br />
ambulatoire de la PA (MAPA) et le PTE.<br />
■A - Mesure de la<br />
pression artérielle<br />
chez le <strong>sport</strong>if<br />
Quel geste plus routinier pour le médecin<br />
que la prise de PA avec un sphygmomanomètre<br />
?<br />
Pourtant, vues les imperfections de cette<br />
mesure et les décisions importantes qui<br />
peuvent en découler, cette mesure doit<br />
être la plus rigoureuse possible.<br />
Chez le <strong>sport</strong>if, des précautions supplémentaires<br />
doivent être prises. Il faut veiller<br />
à utiliser un brassard dont la taille est adaptée<br />
aux masses musculaires. La recherche<br />
de symptômes à type de céphalées, vertiges,<br />
acouphènes, palpitations, douleur<br />
thoracique lors de la pratique <strong>sport</strong>ive doit<br />
être systématique. Il est recommandé de<br />
mesurer la PA à distance (au moins<br />
24 heures) d’un entraînement. Les chiffres<br />
devront être interprétés en fonction de la<br />
charge d’entraînement. On sait, en effet,<br />
que lors des périodes “d’affutâge” pré-compétition,<br />
le niveau adrénergique de l’athlète<br />
est élevé, ce qui peut favoriser une<br />
discrète élévation tensionnelle. Il faudra<br />
parfois imposer l’interruption momentanée<br />
de l’entraînement.<br />
Traiter l’hypertension artérielle<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong>if<br />
Toute hypertension artérielle affirmée doit<br />
être traitée.<br />
Plusieurs études ont montré l’efficacité de<br />
ce traitement sur la survenue de complications<br />
liées à l’HTA. Ainsi, on sait qu’une<br />
baisse de la PA de repos de 5 mm Hg,<br />
Chez l’enfant <strong>sport</strong>if, les valeurs limites proposées<br />
en fonction de l’âge (Tab. IV) peuvent<br />
être prises en défaut, il vaut donc<br />
mieux se référer aux abaques de PA en<br />
fonction de la croissance staturo-pondérale<br />
(Fig. 1), très utiles <strong>du</strong> fait <strong>du</strong> développement<br />
morphologique parfois particulier de<br />
l’enfant ou de l’adolescent <strong>sport</strong>if.<br />
■B - Mesure<br />
ambulatoire de la<br />
pression artérielle<br />
La MAPA peut être d’un grand secours<br />
pour affirmer l’HTA chez le jeune <strong>sport</strong>if.<br />
Des valeurs de normalité ont récemment<br />
été publiées, les chiffres nocturnes doivent<br />
être inférieurs de 10 % aux valeurs<br />
diurnes et les valeurs limites sont de<br />
135/85 en activité et 120/75 lors <strong>du</strong> sommeil<br />
(29). L’enregistrement de la PA lors<br />
d’une séance d’entraînement est plus difficile<br />
de réalisation que lors d’un Holter<br />
rythmique et elle ne pourra pas être systématique.<br />
Celle-ci peut cependant être<br />
intéressante pour étudier les chiffres de PA<br />
à son décours, permettant de préjuger<br />
<strong>du</strong> caractère “répondeur” ou non, <strong>du</strong><br />
patient à l’activité physique.<br />
obtenue avec les traitements pharmacologiques,<br />
s’accompagne d’une baisse<br />
de la fréquence de survenue des accidents<br />
vasculaires cérébraux de 40 % et<br />
de celle des infarctus <strong>du</strong> myocarde de<br />
15 % (30). Le traitement de l’HTA repose<br />
■C - Profil tensionnel<br />
d’effort<br />
Sa place réelle dans le diagnostic positif<br />
de l’hypertension artérielle est actuellement<br />
discutée. Plusieurs faits peuvent expliquer<br />
cette réticence:<br />
● tout d’abord la difficulté de mesurer précisément<br />
la PA diastolique, mais aussi la PA systolique,<br />
en particulier à l’acmé de l’effort;<br />
● ensuite, l’absence de critères de normalité<br />
indiscutables <strong>du</strong> PTE avec de très<br />
nombreux protocoles d’exercices sousmaximaux<br />
ou maximaux qui proposent<br />
autant de valeurs limites;<br />
● enfin, la relation très médiocre qui existe<br />
entre la PA systolique mesurée lors d’un<br />
PTE et celle obtenue lors d’un exercice prolongé<br />
sur le “terrain” (25).<br />
Ainsi, actuellement, il n’est pas licite de<br />
proposer une thérapeutique pharmacologique<br />
à un sujet normoten<strong>du</strong> avec un<br />
PTE “anormal”. De même, des chiffres tensionnels<br />
de repos limites bénéficieront<br />
plus d’une MAPA que d’un PTE pour affirmer<br />
le diagnostic d’HTA. Le PTE conserve,<br />
malgré tout, plusieurs intérêts. Une élévation<br />
des chiffres diastoliques à l’effort inquiétera<br />
plus qu’une HTA systolique d’effort<br />
isolée. Plusieurs études (25) ont montré sa<br />
valeur prédictive dans la survenue d’une<br />
HTA ultérieure chez les sujets présentant des<br />
chiffres systoliques anormalement élevés,<br />
ce qui incitera à les surveiller régulièrement.<br />
Chez l’hyperten<strong>du</strong> <strong>sport</strong>if traité, il permet<br />
de vérifier le bon équilibre tensionnel. Enfin,<br />
la réalisation d’une épreuve d’effort permet<br />
de contrôler d’autres paramètres que la PA,<br />
et en premier lieu, l’électrocardiogramme qui<br />
peut révéler des arythmies cardiaques et/ou<br />
des modifications de la repolarisation en<br />
faveur d’une insuffisance coronaire. Le PTE<br />
occupe ainsi une place particulière dans la<br />
surveillance <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if hyperten<strong>du</strong>.<br />
surtout sur l’emploi de molécules pharmaceutiques,<br />
mais l’utilisation des interventions<br />
non pharmacologiques (règles<br />
hygiéno-diététiques et activité physique)<br />
ne doit pas être oubliée (21, 31). En<br />
effet, l’une des limites actuelles majeures<br />
MÉDECINS DU SPORT 22 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
DOSSIER ><br />
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
D.R.<br />
L’exercice physique peut<br />
avoir un effet hypotenseur.<br />
■B - L’activité<br />
physique présentet-elle<br />
un risque pour<br />
l’hyperten<strong>du</strong> ?<br />
Aucune étude n’a mis en évidence<br />
un risque plus élevé de mort subite ou<br />
d’hémorragies cérébrales lors de la pratique<br />
<strong>sport</strong>ive chez les hyperten<strong>du</strong>s (38,<br />
39). Cependant, la présence d’atteinte<br />
des organes cibles de l’HTA doit inciter à<br />
la prudence. Il est en effet possible que<br />
les poussées tensionnelles d’effort ne<br />
représentent pas un effet direct, mais<br />
puissent favoriser la survenue d’un acci<strong>du</strong><br />
traitement de l’HTA repose sur son<br />
observance qui est très médiocre, en<br />
particulier chez les patients jeunes, ceci<br />
étant <strong>du</strong>, pour une large part, aux effets<br />
secondaires des traitements pharmacologiques.<br />
En cas d’HTA de stade 1 ou<br />
2 (Tab. III) sans retentissement sur<br />
les organes cibles, elles peuvent même<br />
être proposées en première intention<br />
(21, 31).<br />
■A - L’activité<br />
physique régulière :<br />
traitement de l’HTA ?<br />
A ce jour, plus de 60 études décrivant les<br />
effets de l’exercice physique sur l’HTA ont<br />
été publiées. Dans une revue très<br />
récente (32), les auteurs ont conclu qu’en<br />
moyenne, au repos, la PAS était diminuée<br />
de près de 11 mm Hg et la PAD de<br />
8 mm Hg par la pratique régulière et<br />
modérée d’une activité physique. Ces<br />
effets bénéfiques, observés chez les normoten<strong>du</strong>s,<br />
comme chez les hyperten<strong>du</strong>s,<br />
quelle que soit leur race, sont plus <strong>net</strong>s<br />
chez les femmes et après 40 ans. Ils apparaissent<br />
au bout de quelques semaines<br />
et disparaissent en cas d’abandon de l’activité<br />
physique. L’efficacité de l’exercice<br />
physique est d’autant plus <strong>net</strong>te que son<br />
intensité est modérée, que les patients<br />
sont sédentaires et que le niveau initial<br />
d’HTA est élevé.<br />
Bien que cet effet hypotenseur de l’exercice<br />
physique soit indépendant de la<br />
perte de poids souvent associée (33), il<br />
est recommandé d’y associer des règles<br />
hygiéno-diététiques (21, 31). Ainsi, même<br />
si l’efficacité de l’activité physique semble<br />
plus <strong>net</strong> sur les chiffres diastoliques (32),<br />
chez près de 60 % des hyperten<strong>du</strong>s de<br />
stades 1 et 2 le seul traitement par les<br />
interventions non pharmacologiques est<br />
suffisant (34).<br />
Les exercices qui ont prouvé leur efficacité<br />
sont les exercices dynamiques aérobies<br />
d’intensité modérée (50 à 70 % de la<br />
VO 2 max.), réalisés à raison d’au moins<br />
30 à 60 minutes trois fois par semaine.<br />
En ce qui concerne la musculation, les<br />
exercices de type musculation lourde<br />
pure ne sont pas recommandés et semblent<br />
inefficaces sur les chiffres tensionnels<br />
sans toutefois aggraver l’HTA. En<br />
revanche, il semble que la pratique des<br />
exercices de musculation légère réalisés<br />
de façon dynamique avec utilisation dans<br />
la même séance de grands groupes musculaires<br />
variés puisse aussi avoir un effet<br />
bénéfique (35). Bien sûr, les résultats de<br />
ces études récentes demandent confirmation<br />
avant d’être conseillés chez l’hyperten<strong>du</strong>.<br />
Les mécanismes de ces effets bénéfiques<br />
restent discutés mais les plus évoqués<br />
sont une baisse <strong>du</strong> tonus sympathique<br />
et des catécholamines circulantes (effet<br />
“bêtabloquant like”) et surtout une baisse<br />
des résistances périphériques (36). Cette<br />
dernière serait en partie liée aux modifications<br />
<strong>du</strong> niveau adrénergique, mais<br />
surtout à l’amélioration de la relaxation<br />
vasculaire endothélium-dépendante<br />
grâce à une augmentation de la pro<strong>du</strong>ction<br />
de monoxyde d’azote (NO), sous<br />
l’effet <strong>du</strong> cisaillement tangentiel de la<br />
paroi vasculaire qui est majoré lors de<br />
l’exercice physique (37).<br />
dent lié aux capacités d’adaptation diminuées<br />
de ces organes.<br />
Ainsi, l’HTA peut in<strong>du</strong>ire une HVG qui,<br />
associée aux altérations de vasodilatation<br />
coronaire, va favoriser la survenue<br />
d’arythmies cardiaques et/ou d’insuffisance<br />
coronaire aiguë lors de l’exercice.<br />
La pratique régulière d’une activité physique<br />
modérée n’aggrave pas cette<br />
HVG, au contraire, elle peut favoriser<br />
une dilatation cavitaire qui équilibrera<br />
l’hypertrophie pariétale liée à l’HTA. De<br />
plus, la baisse de la fréquence cardiaque<br />
secondaire à l’entraînement va<br />
diminuer le travail cardiaque à l’exercice<br />
sous-maximal et ainsi améliorer la<br />
capacité d’effort de ces patients. Enfin,<br />
des cas d’accidents hémorragiques cérébraux<br />
lors d’exercices de musculation<br />
lourde ont été rapportés chez des sujets<br />
normoten<strong>du</strong>s présentant vraisemblablement<br />
des anomalies vasculaires<br />
méconnues (38). Ce type de pratique<br />
<strong>sport</strong>ive doit donc être évité par les<br />
hyperten<strong>du</strong>s.<br />
■C - Quel traitement<br />
pharmacologique<br />
pour le <strong>sport</strong>if<br />
hyperten<strong>du</strong> ?<br />
L’idéal est de proposer une molécule ne provoquant<br />
pas d’effet secondaire péjoratif sur<br />
la performance <strong>sport</strong>ive, seul garant d’une<br />
bonne observance dans cette population.<br />
De plus, chez le <strong>sport</strong>if de compétition, il faut<br />
tenir compte des règles antidopage et de la<br />
liste des pro<strong>du</strong>its interdits chez ces sujets.<br />
● Les diurétiques peuvent majorer une<br />
déshydratation et des troubles électrolytiques,<br />
favorisant ainsi la survenue de<br />
troubles <strong>du</strong> rythme cardiaque. Enfin, vu<br />
leurs propriétés “masquantes”, ils figurent<br />
sur la liste des pro<strong>du</strong>its interdits.<br />
● Les bêtabloquants limitent bien l’HTA<br />
d’effort. Les pro<strong>du</strong>its cardio-sélectifs diminuent<br />
peu la performance aérobie <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong>if “moyen”, mais altèrent celles <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong>if de haut niveau d’entraînement (39).<br />
Ils sont sans effet sur la performance de<br />
type anaérobie, mais améliorent celle des<br />
<strong>sport</strong>s de précision (tir…) ou à haut niveau<br />
de stress (<strong>sport</strong>s mécaniques, sauts à<br />
skis…), ce qui explique leur inscription sur<br />
la liste des pro<strong>du</strong>its interdits. Dans ce<br />
cadre, vues les autres possibilités<br />
MÉDECINS DU SPORT 23 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
< DOSSIER ><br />
thérapeutiques à notre disposition, leur utilisation<br />
dans l’HTA pourra difficilement bénéficier<br />
d’une justification thérapeutique. Pour<br />
le pratiquant de loisir, il faut savoir que<br />
ces molécules sont pénalisantes pour les<br />
<strong>sport</strong>s de montagne d’en<strong>du</strong>rance comme<br />
la randonnée ou le trekking et que leur utilisation<br />
est interdite par certaines fédérations<br />
(plongée et <strong>sport</strong>s subaquatiques en particulier).<br />
En cas de risque cardiovasculaire<br />
absolu élevé, et en particulier de pathologie<br />
coronaire associée, leur prescription<br />
devient cependant indispensable.<br />
● Les inhibiteurs calciques ont peu d’effets<br />
négatifs sur la performance <strong>sport</strong>ive.<br />
Dans cette classe, le choix se portera sur<br />
les molécules les moins tachycardisantes<br />
et tiendra compte de l’état veineux des<br />
membres inférieurs <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if.<br />
● Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion<br />
ne limitent pas la performance, ils peuvent<br />
donc être prescrits, tout comme<br />
les inhibiteurs des récepteurs à<br />
l’angiotensine 2.<br />
● Les alphabloquants et les autres anti-hypertenseurs<br />
centraux récents, peuvent être<br />
prescrits s’ils sont bien tolérés par le sujet.<br />
Quelle pratique <strong>sport</strong>ive ?<br />
Pour quel hyperten<strong>du</strong> ?<br />
■A - Prescription<br />
d’une activité<br />
physique modérée<br />
chez l’hyperten<strong>du</strong><br />
Devant la découverte d’une HTA, dans<br />
tous les cas, la décision thérapeutique<br />
doit être prise après estimation <strong>du</strong> risque<br />
cardiovasculaire absolu indivi<strong>du</strong>el (retentissement<br />
de l’HTA sur les organes cibles<br />
et autres facteurs de risque associés).<br />
Selon les récentes recommandations de<br />
l’ANAES (30), en cas d’HTA de stade 1 ou<br />
2 avec risque cardiovasculaire absolu<br />
faible ou modéré, le traitement doit débuter<br />
par les interventions non-pharmacologiques<br />
(Tab. VI), dont l’activité physique<br />
plus ou moins associée à un travail de<br />
relaxation (39), en veillant à ce que tous<br />
les facteurs de risque soient efficacement<br />
corrigés. Ceci pendant 6 à 12 mois, avec<br />
réévaluation tous les 3 à 6 mois, le but<br />
étant d’obtenir une TA de repos inférieure<br />
à 140/90 mm Hg.<br />
Chez le sédentaire, l’efficacité de ce traitement<br />
est vérifiée par la ré<strong>du</strong>ction de la<br />
surcharge pondérale, la normalisation<br />
des chiffres tensionnels au repos et sur<br />
la MAPA. La réalisation d’une épreuve<br />
d’effort permet d’objectiver une amélioration<br />
de la capacité physique et une normalisation<br />
<strong>du</strong> PTE.<br />
Le traitement <strong>du</strong> syndrome hyperkinétique<br />
repose sur la prescription d’une activité<br />
physique aérobie régulière, dont la réalisation<br />
sera favorisée par l’association d’une<br />
prise de bêtabloquants cardio-sélectifs.<br />
L’HTA de l’enfant est une cause de contreindication<br />
à la pratique <strong>sport</strong>ive tant que<br />
la cause n’a pas été traitée. Enfin, en cas<br />
de chiffres tensionnels limites, il faudra<br />
toujours réaliser une enquête familiale et<br />
lutter contre une surcharge pondérale<br />
souvent associée. La prescription d’une<br />
Tableau VI: interventions thérapeutiques non pharmacologiques<br />
dans l’hypertension artérielle (ANAES 2000).<br />
1 - Lutte contre la surcharge pondérale.<br />
2 - Augmentation “raisonnée“ de l’activité physique aérobie.<br />
3 - Ré<strong>du</strong>ction de la consommation journalière d’alcool.<br />
(< 25 cl de vin ou équivalent chez l’homme et < 15 cl chez la femme)<br />
4 - Ré<strong>du</strong>ction de l’apport sodé (5-6 g/jour).<br />
5 - Ré<strong>du</strong>ction de l’apport en lipides saturés.<br />
Tableau VII: recommandations de prescription d’exercices<br />
chez le sédentaire hyperten<strong>du</strong> (19).<br />
1 - Intro<strong>du</strong>ction de périodes brèves et multiples d’activités physiques dans les occupations<br />
journalières (marche, montée d’escaliers…).<br />
2 - Activités de type aérobie :<br />
● sollicitant de grosses masses musculaires ;<br />
● au moins 3 fois par semaine ;<br />
● <strong>du</strong>rée : 20 à 6 minutes ;<br />
● intensité: 40 à 60 % de la VO 2 max ou de la réserve de fréquence cardiaque (FC max.-<br />
FC repos) ou 55 à 75 % de la fréquence cardiaque maximale théorique (220 - âge).<br />
3 - Activités de musculation dynamique :<br />
● éventuellement associées ;<br />
● pas plus de 2 fois par semaine ;<br />
● sollicitation de masses musculaires importantes et variées ;<br />
● charges légères (30 à 50 % de la force maximale volontaire) ;<br />
● 8 à 10 séries de 10 répétitions.<br />
activité physique régulière et adaptée aux<br />
désirs de l’enfant étant la meilleure intervention<br />
thérapeutique à proposer.<br />
Le rôle <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> est de<br />
convaincre son patient de la nécessité de<br />
modifier son mode de vie (Tab. VII). L’intensité<br />
des activités aérobies doit rester<br />
MÉDECINS DU SPORT 24 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
DOSSIER ><br />
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
modérée, avec équilibre ventilatoire et<br />
possibilité de parler avec des phrases<br />
courtes et simples. Des activités de musculation<br />
dynamique pourront être associées<br />
si le patient le désire. Le but est<br />
d’obtenir une adhérence et une bonne<br />
observance, la perturbation tensionnelle<br />
risquant de réapparaître en cas d’interruption<br />
de ces efforts.<br />
■B - Le certificat<br />
de non contreindication<br />
à la<br />
pratique <strong>sport</strong>ive<br />
de l’hyperten<strong>du</strong><br />
Des recommandations nord-américaines<br />
récentes sont à notre disposition (38, 40).<br />
Associées au bon sens et à la raison, elles<br />
permettent de proposer une attitude qui<br />
variera en fonction de l’âge et de la sévérité<br />
de l’HTA (Tab. VIII). On sera, bien sûr,<br />
plus prudent chez le patient âgé de plus<br />
de 35 ans, chez qui la prévalence de la<br />
maladie coronaire est augmentée.<br />
L’épreuve d’effort avec PTE doit être largement<br />
utilisée pour surveiller ces<br />
patients.<br />
Dans tous les cas, la découverte récente<br />
d’une HTA minime ou modérée chez un<br />
<strong>sport</strong>if connu <strong>du</strong> médecin impose l’analyse<br />
<strong>du</strong> programme d’entraînement pour<br />
rechercher un déséquilibre avec risque<br />
de surentraînement. De même, l’éventualité<br />
de la prise de pro<strong>du</strong>its dopants ne<br />
doit pas être omise. Quelques activités<br />
<strong>sport</strong>ives posent des problèmes particuliers<br />
comme l’exposition à l’altitude, qui<br />
entraîne des réponses indivi<strong>du</strong>elles très<br />
variables avec possibilités de poussées<br />
d’HTA. Un équilibre tensionnel parfait doit<br />
donc être obtenu avant d’autoriser un<br />
hyperten<strong>du</strong> à la pratique d’un <strong>sport</strong> en<br />
haute altitude.<br />
■<br />
D.R.<br />
Tableau VIII: quel <strong>sport</strong> et quel traitement pour quel hyperten<strong>du</strong>?<br />
1 - HTA isolée d’effort<br />
● Lutte contre les facteurs de risque.<br />
● Pas de traitement pharmacologique.<br />
● Pas de contre-indication au <strong>sport</strong> de compétition.<br />
● Surveillance tensionnelle de repos et d’effort régulière.<br />
2 - HTA chez l’enfant ou l’adolescent<br />
● Règles hygiéno-diététiques.<br />
● Pas de traitement pharmacologique.<br />
● Pas de contre-indication au <strong>sport</strong> de compétition.<br />
● Surveillance jusqu’à l’âge a<strong>du</strong>lte.<br />
3 - HTA de stade 3 ou HTA avec atteinte organique<br />
● Lutte contre les facteurs de risque.<br />
● Obtention d’un équilibre par traitement pharmacologique.<br />
● Compétition contre-indiquée sauf dans les <strong>sport</strong>s d’intensité faible.<br />
● Activités physiques de loisir autorisées.<br />
● Sports à composante statique importante à éviter.<br />
4 - HTA de stade 1 ou 2 sans atteinte organique<br />
● Lutte contre les facteurs de risque.<br />
● Pas de traitement pharmacologique (6-12 mois, bilan trimestriel).<br />
● Si traitement non pharmacologique insuffisant : monothérapie.<br />
● Pas de contre-indication au <strong>sport</strong> de compétition.<br />
● Si nécéssité de bithérapie ou de trithérapie : autorisation de compétitions dans<br />
les <strong>sport</strong>s dynamiques à discuter au cas par cas.<br />
Le traitement <strong>du</strong> syndrome<br />
hyperkinétique repose, entre<br />
autres, sur la prescription<br />
d’une activité physique<br />
aérobie régulière.<br />
Conclusion<br />
Quatre pathologies chroniques (asthme, épilepsie, arthrose et hypertension artérielle), plus ou moins fréquentes, mais<br />
posant toutes des problèmes d’aptitude à la pratique <strong>sport</strong>ive ont été abordées dans ce nouveau dossier. Pour chacune<br />
d’entre elles, le diagnostic, le bilan <strong>du</strong> retentissement ainsi que les thérapeutiques adaptées au <strong>sport</strong>if ont été abordés.<br />
Surtout, l’intérêt de la pratique d’une activité physique régulière a été souligné, permettant de poser des limites<br />
mais aussi des autorisations, voire des indications, à celle-ci. Ainsi, le médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> ne doit plus se contenter d’interdire<br />
la pratique <strong>sport</strong>ive à ces malades. Au contraire, pour chacune de ces affections, il devra conseiller, suivre et encourager<br />
son patient dans la réalisation d’une pratique <strong>sport</strong>ive adaptée.<br />
MÉDECINS DU SPORT 25 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />
< DOSSIER ><br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
1 - Parker R. Arthritis of knee in the<br />
active person. Communication<br />
AOSSM Mai 2001.<br />
2 - Mitrovic D. Physiopathologie de l’arthrose<br />
et hypothèses pathogéniques. Rev<br />
Rhum 1984 ; 51 (5) : 289-294.<br />
3 - Radin E. Role of mechanical factors<br />
in the pathogenesis of primary osteoarthritis.<br />
Lancet 1972 ; 1 : 519-522.<br />
4 - Husson JL. Hyperfriction articulaire<br />
isolée et dégénérescence cartilagineuse<br />
initiale : applications <strong>sport</strong>ives d’une<br />
étude expérimentale. J Traumato Sport<br />
1991 ; 8 : 198-201.<br />
5 - Gedeon P. Un nouveau modèle d’arthrose<br />
expérimentale : la contusion <strong>du</strong><br />
cartilage. Etude expérimentale et clinique.<br />
Rev Rhum 1978 ; 45 : 401-408.<br />
6 - Thonar EJ. Les marqueurs biologiques<br />
de l’arthrose. Rev Rhum 1994; 61: 99-102.<br />
7 - Boyer T. Fréquence des antécédents<br />
de pratique <strong>sport</strong>ive chez les sujets<br />
atteints d’arthrose symptomatique ; Rev<br />
Rhum 1981 ; <strong>48</strong> (12) : 793-797.<br />
8 - Boyer T. Quels liens entre arthrose et<br />
<strong>sport</strong>. Réflexions Rhumatologiques 2001;<br />
38 (5) : 31-34.<br />
9 - Marti B. Is excessive running predictive<br />
of degenerative hip disease ?<br />
Controlled study of former elite athletes.<br />
Brit Med J 1989 ; 299 : 91-93.<br />
10 - Vingard E. Sports and osteoarthrosis<br />
of the hip. Am J Sports Med 1993; 21 (2):<br />
195-200.<br />
11 - Konradsen L. Long distance running<br />
and osteoarthrosis. Am J Sports Med<br />
1990 ; 18 (4) : 379-381.<br />
12 - Panush RS. Recreationnal activitie<br />
and degeration joint disease. Sports Med<br />
1994 ; 17 (1) : 1-5.<br />
13 - Panush RS. Exercise and arthritis<br />
Sports Med 1987 ; 4 : 54-64.<br />
14 - Borderie. Arthrose et <strong>sport</strong>. J Traumato<br />
Sport 1995 ; 12 : 194-195.<br />
15 - Saxon L. Sports participation, <strong>sport</strong>s<br />
injuries and osteoarthritis. Sports Med<br />
1999 ; 28 (2) : 123-135.<br />
16 - Messner K. Radiographic joint space<br />
narrowing and histologic changes in a<br />
rabbit meniscectomie mode of early<br />
knee osteoarthrosis. Am J Sports Med<br />
2001 ; 29 (2) : 151-160.<br />
D.R.<br />
17 - Chantraine A. Knee joint in soccer<br />
player osteoarthritis and axe deviation<br />
Med Sci Sport Exerc 1985 ; 17 (4) : 434-<br />
439.<br />
18 - Kujala U. Knee osteoarthritis in former<br />
runners, soccer players, weight lifters<br />
and shooters arthritis. Rheum 1995 ; 38<br />
(4) : 539-546.<br />
19 - Moretz JA. Long-term follow-up of<br />
knee injuries in high school football<br />
players. Am J Sports Med 1984 ; 12 (4) :<br />
298-300.<br />
20 - Sharma L. Knee alignement linked<br />
to progression of knee osteoarthritis<br />
JAMA 2001 ; 286 ; 188-195.<br />
21 - Joint National Comittee on the Prevention,<br />
Detection, Evaluation, and<br />
Treatment of High Blood Pressure. Sixth<br />
report of the Joint National Comittee.<br />
Washington, DC : National Institutes of<br />
Health 1997.<br />
22 - Broyer M, André JL. New aspects of<br />
hypertension in children. Arch Fr Péd<br />
1980 ; 37 : 429-432.<br />
23 - Carré F. Adaptations cardiovasculaires<br />
et respiratoires au cours de l’effort.<br />
In : Cardiologie <strong>du</strong> Sport. Paris : Masson<br />
2000 ; pp 15-22.<br />
24 - Douard H, Vuillemin C, Bordier P<br />
et al. Profils tensionnels normaux à l’effort<br />
selon l’âge, le sexe et les protocoles.<br />
Arch Mal Cœur 1994 ; 87 : 311-318.<br />
25 - Palatini P. Exagerated blood pressure<br />
response to exercise pathophysiologic<br />
mechanisms and clinical relevance.<br />
J Sports Phys Fitness 1998 ; 38 : 1-9.<br />
26 - Kenny MJ, Seals DR. Post exercise<br />
hypotension : key features, mechanisms,<br />
and clinical significance. Hypertension<br />
1993 ; 22 : 653-664.<br />
27 - Brion R, Amoretti R, Godon P. Aptitude<br />
à la compétition des athlètes porteurs<br />
de cardiopathies : les conseils de la<br />
26 e conférence de Bethesda. In : Cardiologie<br />
<strong>du</strong> Sport. Paris : Masson 2000 ; pp<br />
235-244.<br />
28 - Guazzi MD. The heart in systolic<br />
hypertension. Cardiology 1994 ; 39<br />
(Suppl. 1) : 241-246.<br />
29 - Herpin D. Valeurs de référence<br />
actuelles de la mesure ambulatoire de la<br />
pression artérielle. La lettre <strong>du</strong> cardiologue<br />
1999 ; 22-27.<br />
30 - Collins R, Peto R, MacMahon R et al.<br />
Blood pressure, stroke, and coronary<br />
heart disease. Short term re<strong>du</strong>ctions in<br />
blood pressure: overview of randomised<br />
drug trials (Pt. 2). Lancet 1990; 335: 827-<br />
838.<br />
31 - The guidelines sub-committee of the<br />
WHO/JSH. J Hypertens 1993; 11: 905-918.<br />
32 - Hagberg JM, Park JJ, Brown MD. The<br />
role of exercise training in the treatment<br />
of hypertension. An update. Sports Med<br />
2000 ; 30 : 193-206.<br />
33 - Gordon NF, Scott CB, Levine BD.<br />
Comparison of single versus multiple lifestyle<br />
interventions : are the antihypertensive<br />
effects of exercise training and<br />
diet-in<strong>du</strong>ced weight loss additive ? Am J<br />
Cardiol 1997 ; 79 : 763-767.<br />
34 - Noaton JD. TOHMS : treatment of<br />
mild hypertension study. JAMA 1993 ;<br />
270 : 713-724.<br />
35 - Kelley G. Dynamic resistance exercise<br />
and resting blood pressure in a<strong>du</strong>lts : a<br />
meta-analysis. J Appl Physiol 1997 ; 82 :<br />
1559-565.<br />
36 - Arakawa K. Antihypertensive<br />
mechanism of exercise. J Hypertens 1993;<br />
11 : 223-229.<br />
37 - Higashi Y, Sasaaki S et al. Regular<br />
aerobic exercise augments endothelium<br />
dependent vascular relaxation in normotensive<br />
as well as hypertensive subjects<br />
: role of endothelium derived nitric<br />
oxide. Circulation 1999 ; 100 : 1194-202.<br />
38 - Kaplan NM, Deveraux RB, Miller HS.<br />
26th Bethesda conference : recommendations<br />
for determining eligibility for<br />
competition in athletes with cardiovascular<br />
abnormalities. Task force 4; systemic<br />
hypertension. J Am Coll Cardiol 1994 ;<br />
24 : 5-888.<br />
39 - American College of Sports Medicine<br />
position stand: physical activity, physical<br />
fitness and hypertension. Med Sci<br />
Sports Exerc 1993 ; 25.<br />
40 - Rapport de l’ANAES: prise en charge<br />
des patients a<strong>du</strong>ltes atteints d’hypertension<br />
artérielle essentielle. Recommandations<br />
cliniques et données<br />
économiques - Avril 2000. www.<br />
anaes.fr-rubrique : “publications” ou<br />
www.sante.fr<br />
MÉDECINS DU SPORT 26 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Cas clinique<br />
Une fausse méralgie<br />
Dr Michel Ducasse*<br />
<br />
<br />
Mots clés<br />
Cuisse<br />
Imagerie<br />
Scintigraphie<br />
Examen<br />
tomodensitométrique<br />
Ostéome ostéoïde<br />
Figure 2 : hyperfixation scintigraphique <strong>du</strong> fémur.<br />
D.R.<br />
Une douleur persistante<br />
de la face antéro-externe<br />
de la cuisse gauche. Une<br />
mauvaise orientation<br />
diagnostique pour cause<br />
d’antécédents lombaires.<br />
Ce cas clinique souligne<br />
l’importance de la<br />
scintigraphie osseuse et<br />
de la tomodensitométrie<br />
à la recherche d’un<br />
ostéome ostéoïde<br />
souvent masqué par une<br />
condensation<br />
réactionnelle<br />
périphérique intense.<br />
* Centre de rhumatologie, réé<strong>du</strong>cation et médecine <strong>du</strong> Sport,<br />
St Raphaël.<br />
D.R.<br />
Figure 1 : radiographie <strong>du</strong> fémur<br />
normale.<br />
Jeune athlète de niveau régional,<br />
Laurence S., 22 ans, s’apprête à prendre<br />
des vacances bien méritées et prévues de<br />
longue date au Brésil.<br />
APPARITION<br />
D’UNE DOULEUR<br />
En septembre 2000, elle consulte en raison<br />
de l’apparition d’une douleur avec<br />
sensation de brûlure de la face antéroexterne<br />
de la cuisse gauche,diurne et nocturne,remontant<br />
vers la région inguinale<br />
et l’EIAS, mal calmée par les AINS.<br />
L’existence d’antécédents de lombalgie<br />
aiguë en 1997 oriente vers un diagnostic<br />
de cruralgie.Le bilan radiographique,effectué<br />
le 15 septembre 2000, explorant le<br />
bassin, le rachis lombaire et le fémur<br />
gauche (Fig. 1) est normal.<br />
Devant l’augmentation des douleurs et la<br />
résistance au traitement,un scanner lombaire<br />
est réalisé en urgence la veille de<br />
son départ au Brésil.<br />
Sa normalité l’encourage donc à partir,<br />
malgré les douleurs. Elle y reste 3 mois<br />
avec toujours les mêmes symptômes,plus<br />
ou moins calmés par les AINS et antalgiques.<br />
Mais <strong>du</strong>rant son séjour, apparaît<br />
une hypoesthésie cutanée dans le territoire<br />
en “raquette”à la face antéro-externe<br />
de la cuisse,ce qui la con<strong>du</strong>it à consulter<br />
dès son retour,après avis de son médecin<br />
traitant, un neurologue.<br />
PERSISTANCE<br />
AUX TRAITEMENTS<br />
L’EMG pratiqué le 27 mars 2001 est normal<br />
ce qui, corroboré au résultat <strong>du</strong> scanner,<br />
MÉDECINS DU SPORT 28 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
D.R.<br />
<br />
D.R.<br />
Plusieurs facteurs peuvent<br />
contribuer à expliquer ce<br />
retard de diagnostic :<br />
● les antécédents lombaires,<br />
qui ont orienté au<br />
début vers un diagnostic<br />
de cruralgie ;<br />
● un voyage de trois mois<br />
au Brésil ;<br />
● une symptomatologie<br />
non spécifique avec diffusion<br />
des phénomènes douloureux<br />
et troubles<br />
sensitifs d’accompagnement.<br />
Cas clinique<br />
Cas clinique<br />
Figure 3 et 4 : TDM objectivant le ni<strong>du</strong>s au cœur de la réaction ostéopériostée.<br />
incite ce praticien à éliminer le diagnostic<br />
de cruralgie et fait évoquer celui de<br />
névralgie fémoro-cutanée, d’autant plus<br />
qu’il existe une zone très précise en<br />
dedans de l’EIAS,dont la pression semble<br />
exacerber les douleurs habituelles (zone<br />
gâchette).<br />
Une infiltration est pratiquée à ce niveau<br />
sans aucune amélioration.<br />
Le 2 mai, elle consulte en milieu spécialisé.La<br />
douleur est très intense dans toute<br />
la face antéro-externe de la cuisse gauche,<br />
mal systématisée, diurne et nocturne,<br />
avec toujours une zone d’hypoesthésie<br />
cutanée en raquette.<br />
UN EXAMEN CLINIQUE<br />
DIFFICILE<br />
L’examen clinique est difficile à réaliser,<br />
étant donnée l’intensité de la douleur.<br />
La mobilité de la hanche est normale.<br />
L’examen lombaire est normal.<br />
La pression de l’EIAS reste toujours très<br />
douloureuse.<br />
Enfin, le bilan neurologique est normal,<br />
en dehors des troubles de la sensibilité<br />
(hypoesthésie) déjà décrits par la patiente.<br />
Nous décidons de faire pratiquer deux<br />
bilans complémentaires, biologique et<br />
scintigraphique.<br />
diaphyse fémorale gauche fortement évocateur<br />
d’ostéome ostéoïde.<br />
Le scanner,réalisé le 23 mai 2001,centré<br />
sur le foyer d’hyperfixation (Fig. 3 et 4)<br />
permet de retrouver la présence<br />
d’un épaississement<br />
cortical <strong>du</strong> bord latéral<br />
gauche <strong>du</strong> fémur, au<br />
contact d’une lacune hypodense<br />
régulière, bien circonscrite,<br />
avec image dans<br />
l’os tout à fait évocatrice<br />
d’une niche d’ostéome<br />
ostéoïde et reconstruction<br />
osseuse au contact.<br />
Un nouveau cliché radiographique “à titre<br />
iconographique”objective un renflement<br />
cortical très différent de la radiologie<br />
initiale normale (Fig. 5).<br />
UN OSTÉOME OSTÉOÏDE<br />
DIFFICILE<br />
À DIAGNOSTIQUER<br />
Entre le 15 septembre<br />
2000, date de la première<br />
radio et le<br />
<br />
15 mai 2001,date de la<br />
scintigraphie, et donc<br />
<strong>du</strong> diagnostic, il s’est<br />
écoulé 8 mois.<br />
Si les<br />
radiographies<br />
standard ne sont<br />
pas concluantes,<br />
il faut demander<br />
une scintigraphie<br />
osseuse<br />
à la recherche<br />
d’une hyperfixation<br />
localisée.<br />
La démarche diagnostique<br />
doit donc obéir à un<br />
schéma bien précis :<br />
● une radiculalgie persistante, chez un<br />
enfant ou un a<strong>du</strong>lte jeune, surtout si elle<br />
est d’horaire nocturne,doit faire évoquer<br />
le diagnostic d’ostéome ostéoïde ;<br />
● le test à l’aspirine n’est<br />
positif que dans 50 à 70 %<br />
des cas.Il ne l’était pas dans<br />
le cas présent ;<br />
● si les radiographies<br />
standard ne sont pas<br />
concluantes, il faut demander<br />
une scintigraphie<br />
osseuse à la recherche d’une<br />
hyperfixation localisée,puis<br />
un examen tomodensitométrique,<br />
qui est l’examen<br />
de choix pour localiser précisément le<br />
ni<strong>du</strong>s hypodense masqué par la condensation<br />
réactionnelle périphérique souvent<br />
intense.<br />
La démarche thérapeutique envisagée est<br />
univoque,nous avons orienté la patiente<br />
vers un service de radiologie interventionnelle<br />
pour ablation <strong>du</strong> ni<strong>du</strong>s. ■<br />
UNE SCINTIGRAPHIE<br />
RÉVÉLATRICE<br />
Le bilan biologique s’est avéré normal.<br />
La scintigraphie (Fig. 2), pratiquée le<br />
15 mai 2001, révèle un foyer d’hyperfixation<br />
intense sur la face latérale de la<br />
Figure 5 : radiographie,<br />
6 mois plus tard,<br />
objectivant<br />
l’épaississement<br />
cortical fémoral.<br />
D.R.<br />
MÉDECINS DU SPORT 29 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Matériel<br />
Examen “clinique”<br />
de la chaussure<br />
de course à pied<br />
Mots clés<br />
Matériel<br />
Chaussures<br />
Pied<br />
Technopathie<br />
Dr Max Lafargue*<br />
Beaucoup de modèles,<br />
de marques, de couleurs,<br />
de design et de prix…<br />
L’achat d’une paire de<br />
Running n’est pas simple.<br />
Afin d’éviter les mauvaises<br />
surprises lors de la<br />
pratique <strong>sport</strong>ive,<br />
il est souvent préférable<br />
d’allier confort et solidité<br />
au coup de cœur esthétique.<br />
D.R.<br />
<br />
<br />
D.R.<br />
Rien n’est plus délicat que d’acheter une<br />
paire de chaussures de course à pied<br />
lorsque l’on se trouve devant une multitude<br />
de modèles,de marques,de couleurs<br />
et de design.Il faut reconnaître que les prix<br />
sont aussi bien différents et, par conséquent,<br />
le pouvoir d’achat de la personne,<br />
<strong>sport</strong>if émérite ou encore <strong>du</strong> dimanche,<br />
interviendra dans la décision d’achat.Sans<br />
être directif ou élitiste,cet article peut aider<br />
dans ce choix, en simplifiant l’examen<br />
manuel et visuel de la chaussure.<br />
LES TESTS MANUELS :<br />
CRITÈRES DE STABILITÉ<br />
Stabilité <strong>du</strong> talon<br />
Pour tester la stabilité <strong>du</strong> talon,il s’agit d’essayer,en<br />
empoignant des deux mains la partie<br />
postérieure de la chaussure,de retrouver<br />
une dissociation entre semelle et partie<br />
supérieure et,bien sûr,de l’évaluer par comparaison<br />
entre les modèles (Fig.1).<br />
lors de la course,est en regard.Il convient<br />
d’éviter les flexions de chaussures trop<br />
antérieures ou médio-tarsiennes (Fig.3).<br />
Test de torsion<br />
Exercer un mouvement de torsion entre<br />
la partie antérieure et la partie postérieure,de<br />
façon à évaluer le degré de stabilité<br />
; une trop grande souplesse étant<br />
délétère par effet de cisaillement (Fig.4).<br />
Stabilité latérale antérieure<br />
Pour tester la stabilité latérale antérieure,<br />
il suffit d’enfiler la main dans la chaussure,<br />
d’essayer de déplacer latéralement la partie<br />
supérieure par rapport à la semelle,en<br />
regard de la métacarpo-phalangienne <strong>du</strong><br />
5 e rayon vers l’extérieur, et en regard de<br />
la métacarpo-phalangienne <strong>du</strong> 1 er rayon<br />
vers l’intérieur ; ce dernier critère étant<br />
bien moins important de part la prépondérance<br />
de la “fuite” <strong>du</strong> pied vers l’extérieur<br />
lors de la course.<br />
<br />
D.R.<br />
D.R.<br />
Test de flexion<br />
Le test de flexion consiste à faire “plier”la<br />
chaussure sur sa longueur (Fig.2) et à évaluer<br />
la localisation de la flexion.Il est indispensable<br />
que cette zone de flexion se situe<br />
en regard de la métatarso-phalangienne <strong>du</strong><br />
premier rayon, puisque l’appui antérieur,<br />
* Médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, Montauban.<br />
LES TESTS VISUELS :<br />
CRITÈRES DE SEMELLES<br />
Différences de densité<br />
Il faut vérifier la présence d’une structure<br />
de haute densité dans la partie postérointerne<br />
de la semelle.En effet,le premier<br />
contact avec le sol est primordial pour le<br />
<br />
Figure 1 : test de stabilité <strong>du</strong> talon.<br />
Figure 2 : test de flexion.<br />
Flexion optimale.<br />
Figure 3 : test de flexion.<br />
Flexion médio-tarsienne, à éviter.<br />
Figure 4 : test de torsion.<br />
MÉDECINS DU SPORT 30 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
D.R.<br />
peut être modifié facilement lors d’un<br />
effort, si une gêne apparaît. Il offre une<br />
garantie de fiabilité,le lacet lui-même étant<br />
remplaçable. Les autres modes de laçage<br />
sont plutôt esthétiques ou le reflet d’une<br />
sophistication excessive n’ayant d’intérêt<br />
que lors d’utilisations spécifiques.<br />
Matériel<br />
Figure 5 : test visuel. Evaluation des structures de haute densité.<br />
positionnement secondaire <strong>du</strong> pied,<br />
l’amortissement doit être maximal au<br />
niveau de la partie postéro-externe,mais<br />
ferme <strong>du</strong> côté postéro-interne (Fig. 5).<br />
Présence de structures<br />
amortissantes<br />
Tous les modèles haut de gamme sont<br />
équipés de structures amortissantes ; les<br />
différences de matériau importent peu<br />
dans le choix final (air, liquide et poche<br />
d’expansion, mixtes…), pourvu que ces<br />
structures soient présentes. Rappelons<br />
tout de même que plus on les voit, plus<br />
elles sont fragiles,à portée d’une punaise,<br />
d’une écharde ou d’un clou. Le “tape-àl’œil”qui<br />
est souvent de règle,n’est donc<br />
pas un gage de longévité.<br />
D.R.<br />
<br />
Coûture semelle et<br />
partie supérieure<br />
Le bon compromis semble être la couture<br />
en point d’interrogation (Fig.6),avec une<br />
couture latérale antérieure et une couture<br />
centrale postérieure (partie postérieure<br />
souvent masquée par une structure collée),<br />
afin d’éviter le contact de la sûture<br />
avec le talon. La raison réside certainement<br />
dans le fait que la stabilité<br />
semelle-chaussure antérieure est essentielle<br />
(bloc moteur <strong>du</strong> pied),et que la partie<br />
postérieure doit subir un phénomène<br />
de torsion lors <strong>du</strong> déroulé qui “tirerait”<br />
sur les bords latéraux de la chaussure, si<br />
la couture était latérale.<br />
Présence d’une sur-semelle<br />
amovible<br />
Axe de la semelle<br />
Le fonctionnement <strong>du</strong> pied est important<br />
par rapport au choix de la forme de la<br />
semelle.Etes-vous supinateur,pronateur ou<br />
“normal” ? Sachez pour cela regarder vos<br />
vieilles chaussures et étudier leur aspect<br />
(Fig.7).<br />
Si vous êtes supinateurs,il conviendra plutôt<br />
de prendre un axe courbe.<br />
Si vous êtes pronateurs, optez pour un<br />
axe droit (Fig. 8).<br />
Et si vous êtes normal, un axe droit vous<br />
conviendra aussi.<br />
LES AUTRES CRITÈRES<br />
Le laçage<br />
Le laçage classique semble convenir à tous<br />
les types de pieds,à toutes les activités.Il<br />
Vieilles chaussures posées à plat au sol en vue postérieure<br />
<br />
Vous êtes normal Vous êtes pronateur Vous êtes supinateur<br />
Le matériau<br />
Les tissus synthétiques prennent le pas<br />
sur les autres tissus en ce qui concerne<br />
les activités de type Running.<br />
Les chaussures en cuir ont,en général,la<br />
faveur des <strong>sport</strong>s de balle.<br />
Il est indéniable que l’écoulement de l’air<br />
et de la sueur est meilleur dans des tissus<br />
synthétiques qui contribuent,par ailleurs,<br />
à l’allègement de la chaussure.<br />
La couleur<br />
Courir en plein soleil avec des chaussures<br />
noires paraît stupide ;on peut comprendre<br />
aisément que l’augmentation de la température<br />
à l’intérieur de la chaussure va de<br />
pair avec la diminution <strong>du</strong> confort.<br />
Le poids<br />
Le poids est normalement indiqué par le<br />
vendeur. Il peut devenir un argument de<br />
vente,mais quelques grammes ou dizaine<br />
de grammes de différence seront peu<br />
influants sur le confort de la chaussure.<br />
ÉVITER LES MAUVAISES<br />
SURPRISES<br />
Aujourd’hui, la grande majorité des<br />
marques de chaussures tente de maintenir<br />
le niveau de confort, d’esthétique et<br />
de solidité.<br />
Cependant,ce simple examen clinique de la<br />
chaussure peut éviter de mauvaises surprises,<br />
en testant et en anticipant le “bon comportement”d’une<br />
chaussure au fil <strong>du</strong> temps.<br />
Rappelons également qu’une paire de<br />
chaussures doit être essayée :<br />
- avec les chaussettes utilisées habituellement,<br />
- sur les deux pieds ;<br />
- de préférence en fin de journée ou, au<br />
mieux, à la suite d’un entraînement ;<br />
- et que le critère le plus important reste<br />
la pointure.<br />
<br />
Figure 6 :<br />
visualisation de la couture semelle.<br />
Axes droits<br />
Axes courbes<br />
Figure 7 : détermination<br />
<strong>du</strong> fonctionnement <strong>du</strong> pied<br />
(normal, pronateur, supinateur).<br />
Figure 8 : choix d’un axe de semelle.<br />
<br />
Soulignons encore que la constitution de<br />
la chaussette est essentielle dans le confort<br />
et que l’apparition de nouveaux concepts<br />
et de nouvelles fibres accroît la protection<br />
<strong>du</strong> pied.Mais ce dernier point constitue<br />
à lui seul un autre débat... ■<br />
MÉDECINS DU SPORT 31 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
Mise au point<br />
Cycle menstruel et<br />
performances physiques<br />
Le cycle menstruel<br />
influence-t-il les<br />
performances <strong>sport</strong>ives?<br />
Les taux des hormones<br />
sont-ils modifiés par<br />
l’intensité de l’effort<br />
physique?<br />
Quelles peuvent être les<br />
conséquences de telles<br />
modifications?<br />
Peut-on établir des<br />
éléments de prévention et<br />
préserver l’effort <strong>sport</strong>if?<br />
Quatre questions<br />
auxquelles les Drs Bady,<br />
Rousseau et Saint-Marc<br />
ont tenté de répondre<br />
lors d’une étude menée<br />
sur des femmes judokas<br />
de l’équipe de France.<br />
Etre <strong>sport</strong>if de haut niveau,c’est savoir<br />
faire face à un emploi <strong>du</strong> temps plutôt…<br />
dense!<br />
La gestion de l’alternance entre l’entraînement<br />
spécifique,l’activité physique générale,les<br />
moments de repos,l’amélioration<br />
des techniques, l’affinement tactique, le<br />
calendrier <strong>sport</strong>if et les grandes compétitions<br />
(championnats d’Europe, championnats<br />
<strong>du</strong> Monde, Jeux Olympiques)<br />
n’est pas chose facile.<br />
UN NOUVEL INTÉRÊT<br />
SCIENTIFIQUE<br />
Aujourd’hui,plus d’un tiers des <strong>sport</strong>ifs de<br />
haut niveau sont des femmes;un nombre<br />
qui devrait encore augmenter depuis que<br />
la Commission nationale <strong>du</strong> <strong>sport</strong> de haut<br />
niveau s’est prononcée,en janvier dernier,<br />
pour la suppression de la distinction entre<br />
les pratiques masculines et féminines dans<br />
la procé<strong>du</strong>re de reconnaissance des disciplines<br />
de haut niveau.<br />
Des disciplines qui, en pratique, nécessitent<br />
une activité bi-quotidienne à raison de<br />
5 jours par semaine. Chaque séance est<br />
d’une <strong>du</strong>rée de 1 h à 2 h et son intensité<br />
est très variable en fonction de la charge<br />
de travail demandée par l’entraîneur (elle<br />
peut varier d’une dominante anaérobie lactique<br />
à une dominante aérobie).<br />
Un certain nombre de désordres hormonaux<br />
a déjà été observé chez les femmes<br />
<strong>sport</strong>ives. Une véritable spécificité médicale<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong> de haut niveau féminin voit<br />
donc peu à peu le jour.<br />
RÉPONSE HORMONALE À<br />
L’EXERCICE PHYSIQUE<br />
INTENSE<br />
Une étude récemment menée sur des<br />
femmes judokas de l’équipe de France s’est<br />
intéressée aux modifications des cycles<br />
menstruels et aux taux d’hormones plasmatiques<br />
aux divers temps de l’exercice<br />
<strong>sport</strong>if de haut niveau.<br />
Ses principaux objectifs étaient d’identifier<br />
et de révéler les éventuels désordres<br />
hormonaux in<strong>du</strong>its par un effort physique<br />
intense afin d’en prévenir,ou d’en ré<strong>du</strong>ire,<br />
les effets négatifs.Pour cela,les auteurs ont<br />
tenté d’apporter des éléments de réponse<br />
aux quatre questions suivantes:<br />
● le cycle menstruel influence-t-il les performances<br />
<strong>sport</strong>ives?<br />
● les taux d’hormones sont-ils modifiés par<br />
l’intensité de l’effort physique?<br />
Mots clés<br />
Endocrinologie<br />
Hormones<br />
Judo<br />
Sport de haut niveau<br />
Performances <strong>sport</strong>ives<br />
D.R.<br />
● quelles peuvent être les conséquences<br />
de telles modifications?<br />
● peut-on établir des éléments de prévention<br />
et préserver l’effort <strong>sport</strong>if?<br />
Protocole<br />
L’étude s’est déroulée à l’Insep,au sein de<br />
la FFJDA (Fédération française de judo et<br />
disciplines associées). Menée par les<br />
Drs Bady (chirurgien gynécologue et médecin<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong>), Rousseau (médecin des<br />
équipes de France) et Saint-Marc (pharmacien<br />
biologiste), elle inclut 51 femmes<br />
judokas,toutes catégories de poids confon<strong>du</strong>es,âgées<br />
de 18 à 32 ans.<br />
Les <strong>sport</strong>ives se sont soumises à plusieurs<br />
séries de dosages notamment lors de<br />
la période d’entraînement initiale,sans compétition<br />
(premier bilan de référence<br />
<strong>du</strong> recrutement de l’athlète) et lors de<br />
la période d’entraînement intense, précompétitive.<br />
Dans certains cas (25 % des <strong>sport</strong>ives),un<br />
troisième bilan fut pratiqué afin d’apprécier<br />
la capacité de récupération à distance<br />
des compétitions.<br />
Les dosages hormonaux (FSH, LH, prolactine,<br />
estradiol 17ß, progestérone) ont<br />
été effectués en fonction de la date <strong>du</strong><br />
cycle et de la prise ou non d’estro-progestatifs<br />
(EP).<br />
Les événements inhérents au cycle (caractère<br />
régulier ou non,apparition et accompagnement<br />
de douleurs, tension<br />
mammaire,céphalées),ainsi que les modifications<br />
qui auraient pu se manifester dès<br />
MÉDECINS DU SPORT 32 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001
l’intro<strong>du</strong>ction dans un programme <strong>sport</strong>if<br />
de haut niveau ont été notés.<br />
Les examens réalisés aux différentes phases<br />
<strong>du</strong> calendrier <strong>sport</strong>if ont aussi permis d’évaluer<br />
les éventuelles modifications biologiques<br />
et hormonales qui auraient pu<br />
apparaître lors des efforts physiques<br />
intenses.<br />
CYCLE MENSTRUEL ET<br />
PERFORMANCES SPORTIVES<br />
Cette première étape “clinique”révèle que<br />
l’anamnèse des judokas diffère peu des<br />
contradictions relevées dans les études précédentes<br />
concernant l’implication menstruelle<br />
sur le niveau des performances.<br />
Chez les femmes sans contraception, ils<br />
retrouvent 50 % de désordres menstruels<br />
(oligospanioménorrhée,algies pelviennes<br />
et/ou mammaires) marqués par le début<br />
<strong>du</strong> programme d’entraînement de haut<br />
niveau.Ces troubles,largement décrits lors<br />
des entraînements, semblent minorés en<br />
périodes de compétition.<br />
Des modifications hormonales,essentiellement<br />
<strong>du</strong>es à des anomalies de la sécrétion<br />
de LH et <strong>du</strong> contrôle pulsatile de la LH-RH,<br />
pourraient être responsables,à long terme,<br />
d’ostéoporose,de troubles de la fertilité,<strong>du</strong><br />
fonctionnement ovarien et mammaire.<br />
TAUX HORMONAUX ET<br />
INTENSITÉ DE L’EFFORT<br />
Bilan initial<br />
Concernant la première série de dosages<br />
hormonaux, pratiquée en début de cycle<br />
<strong>sport</strong>if (bilan initial),aucune anomalie significative<br />
n’a été relevée dans toutes les fractions<br />
analysées.<br />
D’une façon générale, les athlètes sous<br />
estroprogestatifs ont un profil hormonal<br />
stable à l’effort et aucun retentissement<br />
physique périphérique.Le taux d’estradiol<br />
est généralement bas,sauf dans 4 cas où il<br />
semble exister un “échappement”. Les<br />
4 <strong>sport</strong>ives étaient soumises au même<br />
estroprogestatif de composition triphasique.<br />
Deux des 8 <strong>sport</strong>ives sous contraceptif<br />
montrent également des taux de prolactine<br />
> à 20 ng/ml sans signe clinique d’accompagnement.<br />
Chez les <strong>sport</strong>ives sans contraception,<br />
5 ont un taux d’œstradiol bas en phase préovulatoire<br />
: le taux de LH est également<br />
insuffisant pour provoquer une ovulation<br />
compétente.Ces différences de niveau de<br />
sécrétion restent modestes et rejoignent<br />
les notions connues à l’effort. Elles n’ont<br />
pas de retentissement significatif sur l’avenir<br />
de fécondité ou sur la préservation de<br />
la densité osseuse.<br />
En période intensive<br />
49 <strong>sport</strong>ives se sont soumises aux prélèvements.<br />
Les taux de FSH et LH, témoins de l’équilibre<br />
hypothalamo-hypophysaire de la<br />
femme,ne subissent aucune perturbation<br />
lors de l’effort <strong>sport</strong>if intense.<br />
Lorsque des modifications apparaissent,<br />
elles surviennent après une longue exposition<br />
à l’effort et sont,dans la plupart des<br />
cas,associées à une perturbation de l’équilibre<br />
alimentaire et à un seuil d’émotivité<br />
supérieur à la normale.<br />
En revanche,une modification des taux de<br />
prolactine a été relevée.<br />
Sur les 32 athlètes soumises à ce dosage,<br />
8 ont un taux supérieur à 18 ng/ml.<br />
Les patientes sous estroprogestatifs ont des<br />
taux normaux,alors que ce type de traitement<br />
peut entraîner une augmentation de<br />
la prolactine.<br />
D’autres patientes voient également leur<br />
taux augmenter suite à une hypoglycémie,<br />
au stress,ou à la période d’ovulation.<br />
RÉFLEXIONS<br />
L’équilibre hormonal est nécessaire à la trophicité<br />
des organes cibles (seins, ovaires)<br />
et doit être recon<strong>du</strong>it à chaque cycle afin<br />
de préserver les temps essentiels de l’existence<br />
féminine:la puberté,la fécondité,la<br />
grossesse,l’allaitement et la ménopause.<br />
Les troubles <strong>du</strong> cycle, retard d’apparition<br />
des 1 res règles,insuffisance hormonale,sont<br />
autant d’effets de l’effort <strong>sport</strong>if, dont les<br />
conséquences doivent être identifiées et<br />
traitées.<br />
La prise d’une contraception chez les <strong>sport</strong>ives<br />
permet souvent un contrôle <strong>du</strong> cycle<br />
et <strong>du</strong> flux menstruel, de l’anémie secondaire<br />
et des phénomènes douloureux,tout<br />
en protégeant la densité osseuse;toutefois<br />
les composés triphasiques ne semblent pas<br />
adaptés au profil des <strong>sport</strong>ives.<br />
Mais il faut aussi garder à l’esprit qu’une<br />
alimentation déséquilibrée peut aussi<br />
contribuer à accentuer les désordres<br />
cycliques et hormonaux.<br />
La prolactine plasmatique constitue un<br />
excellent marqueur <strong>du</strong> <strong>sport</strong> au féminin,<br />
corrélée à plusieurs autres composantes<br />
comme le stress, l’hypoglycémie, l’effort<br />
physique intense et le profil prédictif des<br />
cycles menstruels.Elle renseigne donc l’état<br />
de forme de l’athlète,son profil psychologique<br />
(émotivité,réaction au stress) et son<br />
état nutritionnel.<br />
Cependant, la persistance d’une hyperprolactinémie,même<br />
minime,impose une<br />
imagerie par IRM hypophysaire et la<br />
recherche soigneuse de causes secondaires<br />
(médicamenteuses).<br />
Préserver l’intégrité de l’équilibre hormonal<br />
des <strong>sport</strong>ives passe donc par un suivi<br />
gynécologique adapté au haut niveau et suivant<br />
un protocole rigoureux (Tab.I),afin:<br />
● d’établir le profil des cycles menstruels<br />
préalable à l’exercice physique <strong>sport</strong>if;<br />
● d’adapter le contenu et le rythme des<br />
entraînements (et de la récupération) à l’influence<br />
de la physiologie menstruelle;<br />
● de corriger les effets négatifs et les<br />
troubles constatés (spanio-aménorrhée,<br />
hyperprolactinémie,hypertestostéronémie,<br />
mastodynies);<br />
● d’adapter les traitements estroprogestatifs;<br />
● d’uniformiser les bilans;<br />
● de préserver l’avenir de ces femmes;<br />
● et d’instaurer une authentique médecine<br />
de gynécologie <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
■<br />
Pour en savoir plus:<br />
Consultez l’intégralité de l’étude sur le site<br />
www.menarini.fr<br />
Bady J, Rousseau D, Saint-Marc M. Cycle menstruel<br />
et performances <strong>sport</strong>ives. Réponse hormonale<br />
à l’exercice physique intense. Etude préliminaire<br />
chez les femmes judokas de l’équipe de France.<br />
Mise au point<br />
Mise au point<br />
Tableau I: protocole gynécologique<br />
adapté au <strong>sport</strong> de haut niveau<br />
1/ Examen clinique<br />
2/ Dosages hormonaux de base (DHB)<br />
● FSH<br />
● Prolactine<br />
● Estradiol 17 bêta<br />
● Cortisol – 17 OH – 17 cestostéroîde<br />
● Testostérone<br />
● Delta 4 androstenedione<br />
● Dater le moment <strong>du</strong> cycle<br />
● Noter la prise ou non d’estroprogestatifs<br />
3/ Marqueurs hormonaux de l’effort intensif (DHE)<br />
● FSH – Estradiol<br />
● Prolactine<br />
● Cortisol<br />
● Testostérone<br />
● Progestérone (phase lutéale)<br />
● Catabolisme musculaire (hydroxyproline, CPK)<br />
● Dater le moment <strong>du</strong> cycle<br />
● Noter la prise ou non d’estroprogestatifs et les<br />
modifications relatives par rapport au précédent bilan<br />
4/ Surveillance médico-<strong>sport</strong>ive adaptée<br />
et correction des troubles identifiés<br />
MÉDECINS DU SPORT 33 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001