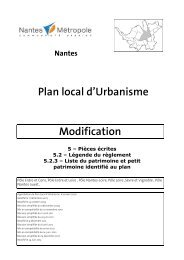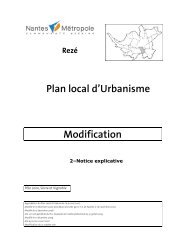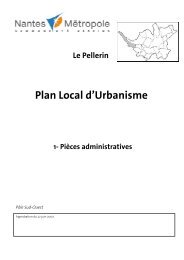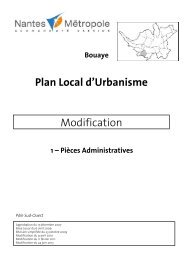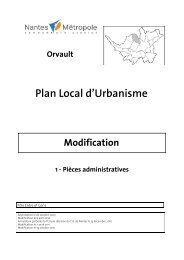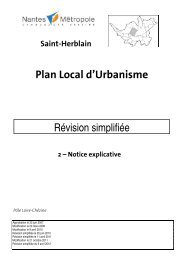2PDG rapport - Le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole
2PDG rapport - Le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole
2PDG rapport - Le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Couëron<br />
Plan Local d’Urbanisme<br />
2. Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Pôle Loire Chézine<br />
Approbation le 17 décembre 2007
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
2
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
INTRODUCTION _______________________________________________________________ 7<br />
<strong>Le</strong> Plan Local d’Urbanisme : un outil communal au service d’un projet communautaire _____ 7<br />
I- La révision générale <strong>de</strong>s PLU : un projet communautaire ___________________________ 9<br />
II- <strong>Le</strong> contexte <strong>de</strong> la révision du PLU <strong>de</strong> Couëron ___________________________________ 11<br />
III- <strong>Le</strong> PLU : un nouvel outil ___________________________________________________ 13<br />
1. <strong>Le</strong>s objectifs du PLU ______________________________________________________ 13<br />
2. <strong>Le</strong>s pièces constitutives du dossier du PLU et leur portée juridique __________________ 13<br />
Chapitre 1 – Présentation du territoire communal et <strong>de</strong> ses phénomènes constitutifs __________ 17<br />
I- Situation Générale ________________________________________________________ 19<br />
1. Position <strong>de</strong> l’agglomération nantaise dans l’espace géographique __________________ 19<br />
2. Emergence <strong>de</strong> nouvelles échelles <strong>de</strong> territoire et <strong>de</strong> projet : la métropole <strong>Nantes</strong>-Saint-<br />
Nazaire ________________________________________________________________ 20<br />
3. La commune dans l’agglomération __________________________________________ 21<br />
II- <strong>Le</strong> développement urbain : historique et organisation actuelle ______________________ 25<br />
1. Histoire <strong>de</strong> la commune et <strong>de</strong> son urbanisation ________________________________ 25<br />
2. L’organisation générale du territoire _________________________________________ 27<br />
III- <strong>Le</strong> diagnostic du territoire __________________________________________________ 32<br />
1. <strong>Le</strong>s évolutions socio-démographiques ________________________________________ 32<br />
2. L’habitat ______________________________________________________________ 43<br />
3. <strong>Le</strong>s activités économiques et l’emploi ________________________________________ 54<br />
4. <strong>Le</strong>s déplacements _______________________________________________________ 59<br />
5. <strong>Le</strong> fonctionnement urbain ________________________________________________ 64<br />
IV- Synthèse du diagnostic urbain ______________________________________________ 71<br />
Chapitre 2 – L’Etat Initial <strong>de</strong> l’Environnement ________________________________________ 73<br />
I- <strong>Le</strong> milieu physique ________________________________________________________ 75<br />
1. <strong>Le</strong> contexte géologique ___________________________________________________ 75<br />
2. le relief _______________________________________________________________ 77<br />
3. <strong>Le</strong> climat ______________________________________________________________ 77<br />
4. <strong>Le</strong> réseau hydrographique ________________________________________________ 78<br />
3
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
II- <strong>Le</strong> patrimoine naturel _____________________________________________________ 85<br />
1. <strong>Le</strong>s entités naturelles ____________________________________________________ 85<br />
2. <strong>Le</strong>s composantes paysagères naturelles ______________________________________ 87<br />
III- <strong>Le</strong> patrimoine végétal _____________________________________________________ 91<br />
<strong>Le</strong>s espaces naturels protégés _______________________________________________ 91<br />
IV- <strong>Le</strong>s paysages urbains _____________________________________________________ 105<br />
1. La morphologie <strong>de</strong>s quartiers ______________________________________________ 105<br />
2. <strong>Le</strong>s différentes typologies urbaines et ambiances paysagères ______________________ 114<br />
3. <strong>Le</strong>s entrées <strong>de</strong> ville ______________________________________________________ 115<br />
4. <strong>Le</strong> patrimoine bâti ______________________________________________________ 120<br />
5. <strong>Le</strong> patrimoine archéologique ______________________________________________ 124<br />
V- La gestion <strong>de</strong>s Ressources __________________________________________________ 125<br />
1. La gestion <strong>de</strong>s besoins en eau potable ________________________________________ 125<br />
2. La gestion <strong>de</strong>s eaux usées et pluviales _______________________________________ 126<br />
3. <strong>Le</strong> programme Neptune __________________________________________________ 128<br />
4. Ressources énergétiques _________________________________________________ 129<br />
5. Energies renouvelables ___________________________________________________ 132<br />
6. <strong>Le</strong>s déchets et leur valorisation _____________________________________________ 133<br />
VI- Environnement urbain ____________________________________________________ 139<br />
1. <strong>Le</strong>s nuisances urbaines ___________________________________________________ 139<br />
2. <strong>Le</strong>s nuisances sonores ____________________________________________________ 142<br />
3. <strong>Le</strong>s risques naturels _____________________________________________________ 143<br />
4. <strong>Le</strong>s risques technologiques ________________________________________________ 146<br />
VII- Synthèse <strong>de</strong>s enjeux environnementaux ______________________________________ 155<br />
La protection et la valorisation <strong>de</strong>s milieux naturels ______________________________ 155<br />
Chapitre 3 – L’explication <strong>de</strong>s choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et <strong>de</strong><br />
Développement Durable ________________________________________________________ 157<br />
I- le PADD ; élément fondateur du PLU <strong>de</strong> Couëron _________________________________ 159<br />
1. Une approche nouvelle du document d’urbanisme ______________________________ 155<br />
2. <strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> Couëron pour les 10 prochaines années ______________ 160<br />
4
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
II- <strong>Le</strong> PADD : un projet communal articulé à une ambition communautaire ______________ 163<br />
1. L’accueil <strong>de</strong>s populations et l’équilibre social <strong>de</strong> l’habitat _________________________ 163<br />
2. L’offre d’équipements et <strong>de</strong> services, y compris en matière <strong>de</strong> déplacements __________ 164<br />
3. Conforter l’attractivité économique métropolitaine et jouer le rôle <strong>de</strong> locomotive du<br />
Grand Ouest ____________________________________________________________ 165<br />
4. Valoriser un exceptionnel cadre <strong>de</strong> vie _______________________________________ 165<br />
III- <strong>Le</strong> PADD communal : une réponse à <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> développement durable __________ 167<br />
1. Valoriser le patrimoine naturel et l’activité agricole pour conforter la qualité <strong>de</strong> vie<br />
couëronnaise ____________________________________________________________ 167<br />
2. Affirmer le dynamisme couëronnais par un développement fédérateur ______________ 168<br />
3. Favoriser les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> déplacement alternatifs à la voiture _______________________ 169<br />
4. Développer les zones d’activités, pérenniser l’agriculture et les commerces <strong>de</strong> proximité _ 170<br />
IV- les documents supra-communaux s’imposant ou a prendre en compte dans le PADD ____ 173<br />
1. Compatibilité avec les documents <strong>de</strong> <strong>plan</strong>ification communautaire _________________ 173<br />
2. Compatibilité avec les documents nationaux et départementaux __________________ 175<br />
V- Compatibilité avec la loi et ses principes d’équilibre, <strong>de</strong> diversité et d’utilisation économe<br />
<strong>de</strong> l’espace _______________________________________________________________ 181<br />
VI- La politique foncière ______________________________________________________ 183<br />
1. Nouvelles interventions <strong>de</strong> la politique foncière_________________________________ 183<br />
2. Réserves foncières communautaires – Acquisition d’opportunités foncières au profit <strong>de</strong>s<br />
projets d’espaces publics, voirie et réseaux ______________________________________ 183<br />
3. Réserves foncières communautaires – Constitution d’espaces naturels à protéger et à<br />
valoriser ________________________________________________________________ 183<br />
4. Réserves foncières communautaires – Constitution <strong>de</strong> réserves foncières à vocation<br />
économique _____________________________________________________________ 183<br />
5. Politique foncière partenariale pour la mise en œuvre <strong>de</strong>s objectifs du programme <strong>local</strong><br />
<strong>de</strong> l’habitat ______________________________________________________________ 184<br />
6. <strong>Le</strong>s instruments du droit <strong>de</strong> préemption ______________________________________ 185<br />
Chapitre 4 – Justification du zonage et du règlement __________________________________ 189<br />
I- Bilan du POS actuel _______________________________________________________ 193<br />
1. <strong>Le</strong>s zones urbaines à vocation d’habitat ______________________________________ 193<br />
2. <strong>Le</strong> potentiel d’accueil et la <strong>local</strong>isation <strong>de</strong>s zones d’activités _______________________ 194<br />
3. <strong>Le</strong>s zones d’extension <strong>de</strong> l’urbanisation ______________________________________ 194<br />
4. Articulation entre zones agricoles et naturelles ________________________________ 194<br />
5
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
II- <strong>Le</strong>s principales évolutions du POS au PLU ______________________________________ 195<br />
1. Présentation <strong>de</strong> la nouvelle typologie <strong>de</strong>s zones et correspondance du POS au PLU ______ 195<br />
2. <strong>Le</strong>s grands choix du zonage et du règlement __________________________________ 205<br />
III- La structure du zonage et les principales dispositions du règlement zone par zone ______ 217<br />
1. <strong>Le</strong>s zones urbaines à dominante d’habitat ____________________________________ 217<br />
2. <strong>Le</strong>s zones urbaines à dominante d’activités et d’équipements _____________________ 223<br />
3. <strong>Le</strong>s zones à urbaniser ____________________________________________________ 226<br />
4. La zone agricole ________________________________________________________ 227<br />
5. <strong>Le</strong>s zones naturelles _____________________________________________________ 228<br />
IV- <strong>Le</strong>s servitu<strong>de</strong>s d’urbanisme particulières ______________________________________ 233<br />
1. <strong>Le</strong>s servitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> constructibilité limitée ______________________________________ 233<br />
2. <strong>Le</strong>s Emplacements Réservés _______________________________________________ 233<br />
3. <strong>Le</strong>s Espaces Boisés Classés ________________________________________________ 235<br />
4. <strong>Le</strong>s éléments du patrimoine bâti ou paysager à préserver _________________________ 235<br />
5. <strong>Le</strong>s cheminements à préserver _____________________________________________ 235<br />
6. <strong>Le</strong>s servitu<strong>de</strong>s d’utilité publique ____________________________________________ 235<br />
Chapitre 5 – L’impact du <strong>plan</strong> sur l’environnement et les mesures compensatoires ____________ 237<br />
I- Bilan <strong>de</strong> la consommation d’espace à venir _____________________________________ 239<br />
1. Consommation d’espace pour l’habitat _______________________________________ 239<br />
2. Consommation d’espace pour les activités économiques _________________________ 239<br />
II- L’impact du <strong>plan</strong> sur l’environnement et les mesures compensatoires ________________ 241<br />
1. La zone Natura 2000 elle-même ____________________________________________ 241<br />
2. <strong>Le</strong>s zones <strong>de</strong> contact avec Natura 2000 ______________________________________ 241<br />
6
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
INTRODUCTION<br />
LE PLU<br />
un outil communal<br />
au service d’un projet communautaire<br />
7
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
8
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
II- LA REVIISIION GENERALE DES PLANS LOCAUX<br />
D’’URBANIISME :: UN PROJET COMMUNAUTAIIRE<br />
Depuis sa création, le 31 décembre 2000, la Communauté Urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole exerce <strong>de</strong> plein<br />
droit la compétence en matière d’aménagement <strong>de</strong> l’espace, et par suite, celle tenant aux documents<br />
d’urbanisme.<br />
<strong>Le</strong> 21 juin 2002, le conseil communautaire a prescrit la révision générale <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s documents<br />
locaux d’urbanisme. Cette décision a pour objectif <strong>de</strong> doter chaque commune membre d’un Plan Local<br />
d’Urbanisme (P.L.U), se substituant aux Plans d’Occupations <strong>de</strong>s Sols (P.O.S.) et aux Plans<br />
d’Aménagement <strong>de</strong> Zones (P.A.Z).<br />
Ce nouveau cadre réglementaire, issu <strong>de</strong> la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13<br />
Décembre 2000, ajoute aux éléments constituant ce document d’urbanisme un élément central : le<br />
Projet d’Aménagement et <strong>de</strong> Développement Durable (PADD).<br />
<strong>Le</strong> PADD constitue le projet politique <strong>de</strong> développement à l’échelle <strong>de</strong> la commune, fon<strong>de</strong>ment du PLU. Il<br />
fixe les objectifs du développement <strong>de</strong> la ville pour les 10 années à venir en matière d’urbanisme mais<br />
aussi en matière d’habitat, d’environnement, d’économie, <strong>de</strong> déplacements… <strong>Le</strong> PADD s’inscrit dans une<br />
perspective <strong>de</strong> développement durable :<br />
- équilibre entre renouvellement urbain, urbanisation nouvelle et préservation <strong>de</strong>s espaces<br />
naturels ;<br />
- diversité <strong>de</strong>s fonctions urbaines et mixité sociale ;<br />
- protection <strong>de</strong> l’environnement par une utilisation économe <strong>de</strong> l’espace, la maîtrise <strong>de</strong>s<br />
déplacements, la préservation <strong>de</strong>s ressources environnementales et patrimoniales et la prévention<br />
<strong>de</strong>s risques.<br />
<strong>Le</strong> Plan Local d’Urbanisme, notamment le PADD, doit être compatible avec les documents élaborés à <strong>de</strong>s<br />
échelles territoriales plus larges, estuaire, métropole, agglomération : Directive Territoriale<br />
d’Aménagement (DTA) et Schéma <strong>de</strong> Cohérence Territoriale (SCOT), Plan <strong>de</strong> Déplacements Urbains<br />
(PDU), Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat (PLH), charte d’orientation commerciale …<br />
Au travers <strong>de</strong>s PLU, la Communauté Urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> organise le développement <strong>de</strong> son territoire en<br />
association étroite avec chacune <strong>de</strong> ses communes-membres. Dans ce montage, le PADD joue un rôle<br />
essentiel d’articulation entre les projets locaux et les stratégies d’agglomération développées au travers<br />
<strong>de</strong>s orientations communautaires dont les grands principes se déclinent <strong>de</strong> la manière suivante.<br />
Une métropole solidaire qui :<br />
Mène une politique <strong>de</strong> logement volontariste, concrétisée par :<br />
- un engagement sur la construction <strong>de</strong> 3.900 logements neufs par an, et une diversification<br />
répondant aux attentes <strong>de</strong> parcours rési<strong>de</strong>ntiel <strong>de</strong> la population ;<br />
- un souci <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsification (à l’intérieur du périphérique, dans les centres et le long <strong>de</strong>s axes<br />
structurants <strong>de</strong> transports collectifs), avec le développement d’opérations pilotes dans les<br />
communes, promouvant <strong>de</strong>s formes urbaines, <strong>de</strong>s architectures et <strong>de</strong>s techniques<br />
innovantes ;<br />
- un accès au logement facilité, notamment par une offre importante <strong>de</strong> logements locatifs<br />
sociaux (900 logements locatifs sociaux neufs par an), et par une réponse aux besoins<br />
spécifiques (jeunes et étudiants, personnes âgées, personnes handicapées, …) ;<br />
- une politique foncière active et volontaire.<br />
9
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Met en œuvre <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> renouvellement urbain :<br />
- en intervenant sur les secteurs en mutation ;<br />
- en participant à <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> restructuration urbaine au sein <strong>de</strong>s quartiers prioritaires <strong>de</strong> la<br />
Politique <strong>de</strong> la Ville ;<br />
- en favorisant le renforcement <strong>de</strong>s centre-bourgs et <strong>de</strong>s pôles <strong>de</strong> quartier.<br />
Soutient l’emploi et l’insertion par l’économique ;<br />
Appuie la structuration <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> santé.<br />
Une métropole dynamique qui :<br />
Conforte le tissu existant et facilite l’installation <strong>de</strong> nouvelles activités sur le territoire (secteurs<br />
tertiaires, industriel et commercial) ;<br />
Développe <strong>de</strong>s projets innovants (secteurs <strong>de</strong>s biotechnologies, <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> l’information<br />
et <strong>de</strong> la communication) et favorise le développement <strong>de</strong> l’enseignement supérieur et <strong>de</strong> la<br />
recherche ;<br />
Prend en compte et accueille les activités industrielles en lien avec le fonctionnement <strong>de</strong><br />
l’agglomération ;<br />
Développe les équipements utiles au rayonnement <strong>de</strong> l’agglomération ;<br />
Stimule l’offre commerciale dans les centres-villes ;<br />
Soutient les entreprise agricoles périurbaines ;<br />
Encourage la création d’emplois et d’activités.<br />
Une métropole mobile qui :<br />
Renforce le réseau <strong>de</strong>s transports publics urbains ;<br />
Développe l’étoile ferroviaire et les pôles multimodaux ;<br />
Privilégie une maîtrise <strong>de</strong> la circulation automobile ;<br />
Développe l’usage du vélo et les continuités cyclables ;<br />
Organise les conditions <strong>de</strong> stationnement ;<br />
Rationalise le transport <strong>de</strong>s marchandises en ville.<br />
Une métropole qui prépare le cadre <strong>de</strong> vie pour les générations futures en :<br />
Promouvant les économies d’énergie, les énergies renouvelables et les éco-quartiers ;<br />
Protégeant les espaces naturels et la biodiversité ;<br />
Restaurant et valorisant le réseau <strong>de</strong>s cours d’eau ;<br />
Préservant et améliorant la qualité <strong>de</strong> l’eau ;<br />
Prévenant les risques naturels et urbains ;<br />
Valorisant la diversité <strong>de</strong>s patrimoines et <strong>de</strong>s paysages ;<br />
Maîtrisant l’évolution <strong>de</strong>s espaces naturels et agricoles périurbains en mutation.<br />
A l’échelle <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s communes, c’est l’analyse <strong>de</strong>s enjeux issus du diagnostic, à la fois global et<br />
synthétique, qui a conduit à définir les orientations du Projet d’Aménagement et <strong>de</strong> Développement<br />
Durable.<br />
Chaque commune sera autonome avec son propre document d’urbanisme. Cependant, l’ambition <strong>de</strong><br />
cette révision générale se traduit par l’élaboration <strong>de</strong> nouveaux documents d’urbanisme communaux<br />
qui <strong>de</strong>vront être, dans la mesure du possible, solidaires et homogènes.<br />
10
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIII- LE CONTEXTE DE LA REVIISIION DU PLU DE<br />
COUERON<br />
Couëron est couverte par un Plan d’Occupation <strong>de</strong>s Sols (P.O.S.) révisé en 2000.<br />
L’élaboration <strong>de</strong> son Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) a été prescrite par délibération du Conseil<br />
communautaire en date du 21 juin 2002.<br />
Cette révision actuelle du PLU <strong>de</strong> Couëron s’inscrit dans un nouveau contexte :<br />
- intégrer les dispositions relatives à la loi SRU du 13 décembre 2000,<br />
- conférer à la commune un Plan d’Aménagement et <strong>de</strong> Développement Durable, clé <strong>de</strong> voûte <strong>de</strong><br />
l’aménagement et du développement du territoire à moyen terme,<br />
- harmoniser les documents d’urbanisme <strong>de</strong> toutes les communes <strong>de</strong> la communauté urbaine <strong>Nantes</strong><br />
Métropole.<br />
Une révision permet aussi à la commune d’adapter la formulation <strong>de</strong>s règles pour améliorer la qualité <strong>de</strong><br />
la vie urbaine, pour remo<strong>de</strong>ler les limites <strong>de</strong> certaines zones et pour reconsidérer le classement <strong>de</strong>s<br />
secteurs traversés par les nouvelles infrastructures routières.<br />
La révision globale <strong>de</strong>s 24 PLU <strong>de</strong> la Communauté urbaine se fait dans une double optique :<br />
- rendre cohérentes les règles d’urbanisme <strong>de</strong> tout le territoire concerné grâce à un tronc commun à<br />
tous les PLU qui retranscrira les objectifs communautaires dans les documents communaux,<br />
- conserver l’i<strong>de</strong>ntité propre à chaque commune ainsi que ses spécificités <strong>local</strong>es en maintenant un<br />
PLU par commune membre .<br />
Située à l’ouest <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>, Couëron bénéficie d’une position privilégiée entre Loire et Chézine. Bien que<br />
commune <strong>de</strong> secon<strong>de</strong> couronne <strong>de</strong> l’agglomération nantaise, Couëron n’en a pas le profil. En effet, dès<br />
le 17 ème siècle, Couëron est un avant-port <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>, ce qui lui confère une richesse qui se perçoit encore<br />
dans le paysage architectural communal. Jusqu’à la fin du 18 ème siècle, la Loire favorise le mouillage <strong>de</strong>s<br />
navires <strong>de</strong> 200 à 300 tonneaux au Port Launay. <strong>Le</strong>s bateaux venus <strong>de</strong>s Antilles, <strong>de</strong> Guinée ou d’Espagne y<br />
déchargent <strong>de</strong>s produits exotiques, du cuir <strong>de</strong> Russie et <strong>de</strong>s cordages.<br />
La ville <strong>de</strong> Couëron a également joué un rôle moteur dans le développement industriel <strong>de</strong> la Basse-Loire<br />
avec notamment l’im<strong>plan</strong>tation d’une verrerie en 1785 et <strong>de</strong> la société <strong>de</strong>s fon<strong>de</strong>ries et laminoirs créée<br />
en 1860 sur les bords <strong>de</strong> Loire.<br />
Dans le même temps, du fait <strong>de</strong> son cadre <strong>de</strong> vie, Couëron est un territoire attractif pour les nouveaux<br />
habitants <strong>de</strong> l’agglomération. <strong>Le</strong> marché du logement connaît donc <strong>de</strong> fortes tensions. Trois opérations<br />
majeures – la Métairie , Ouest centre-ville et rives <strong>de</strong> Loire – sont néanmoins en train <strong>de</strong> voir le jour et<br />
vont permettre <strong>de</strong> générer une nouvelle offre <strong>de</strong> logements maîtrisée par la commune dans le cadre <strong>de</strong><br />
Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.).<br />
<strong>Le</strong> P.L.U. <strong>de</strong> Couëron a donc pour ambition <strong>de</strong> poursuivre les politiques mises en œuvre dans le P.O.S<br />
récent <strong>de</strong> 2000 – et notamment la protection et la mise en valeur <strong>de</strong>s espaces naturels et ruraux, tout<br />
en répondant aux nouveaux besoins en matière <strong>de</strong> logements, d’activités et d’emplois liés aux<br />
évolutions récentes <strong>de</strong> la commune dans l’agglomération. Ainsi le PLU vise à garantir la diversité du<br />
territoire tout en confirmant l’attractivité <strong>de</strong> la commune dans l’agglomération nantaise.<br />
11
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
12
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIIIII.. LE PLAN LOCAL D’’URBANIISME :: UN NOUVEL<br />
OUTIIL<br />
1. <strong>Le</strong>s objectifs du PLU<br />
<strong>Le</strong> Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) remplace aujourd’hui le Plan d’Occupation <strong>de</strong>s Sols (P.O.S.). Il est<br />
désormais l’outil principal par lequel les communes organisent le développement <strong>de</strong> leur territoire.<br />
<strong>Le</strong> PLU, comme le POS est un document d’urbanisme <strong>local</strong>, réalisé <strong>de</strong>puis les lois <strong>de</strong> décentralisation à<br />
l’initiative <strong>de</strong> la commune, ou à celle d’un groupement <strong>de</strong> communes, comme c’est le cas pour <strong>Nantes</strong><br />
Métropole.<br />
<strong>Le</strong> PLU est un outil <strong>de</strong> <strong>plan</strong>ification mais également un document réglementaire <strong>de</strong> droit commun qui<br />
régit notamment les possibilités <strong>de</strong> constructions et d’usages <strong>de</strong>s sols.<br />
Plus ambitieux que le précé<strong>de</strong>nt P.O.S., ce nouveau document cadre englobe dans une même vision,<br />
l’habitat, les transports, l’environnement et le traitement <strong>de</strong>s espaces publics, mais aussi, la préservation<br />
<strong>de</strong>s paysages comme les secteurs à renouveler ou à protéger. Au total, tous les volets <strong>de</strong> l’urbanisme<br />
seront traités pour <strong>de</strong>ssiner un nouveau cadre <strong>de</strong> vie.<br />
L’objectif du renouvellement urbain posé par l’article L.121.1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme, marque un tournant<br />
voulu par la loi SRU dans les objectifs <strong>de</strong>s politiques d’urbanisme que l’on souhaite davantage orienter<br />
vers le développement durable et le renouvellement <strong>de</strong> la ville sur elle-même.<br />
La révision du PLU a été menée dans le respect <strong>de</strong> l’article L.121.1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme qui précise.<br />
<strong>Le</strong>s <strong>plan</strong>s locaux <strong>d'urbanisme</strong> déterminent les conditions permettant d'assurer :<br />
1. l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement<br />
<strong>de</strong> l'espace rural, d'une part, et la préservation <strong>de</strong>s espaces affectés aux activités agricoles et<br />
forestières et la protection <strong>de</strong>s espaces naturels et <strong>de</strong>s paysages, d'autre part, en respectant les<br />
objectifs du développement durable ;<br />
2. la diversité <strong>de</strong>s fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat<br />
rural, en prévoyant <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> réhabilitation suffisantes pour la<br />
satisfaction, sans discrimination, <strong>de</strong>s besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités<br />
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général<br />
ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier <strong>de</strong> l'équilibre entre emploi et<br />
habitat ainsi que <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> transport et <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s eaux ;<br />
3. une utilisation économe et équilibrée <strong>de</strong>s espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la<br />
maîtrise <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> déplacement et <strong>de</strong> la circulation automobile, la préservation <strong>de</strong> la qualité<br />
<strong>de</strong> l'air, <strong>de</strong> l'eau, du sol et du sous-sol, <strong>de</strong>s écosystèmes, <strong>de</strong>s espaces verts, <strong>de</strong>s milieux, sites et<br />
paysages naturels ou urbains, la réduction <strong>de</strong>s nuisances sonores, la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ensembles<br />
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention <strong>de</strong>s risques naturels prévisibles, <strong>de</strong>s<br />
risques technologiques, <strong>de</strong>s pollutions et <strong>de</strong>s nuisances <strong>de</strong> toute nature."<br />
2. <strong>Le</strong>s pièces constitutives du dossier du PLU et leur portée juridique<br />
<strong>Le</strong> nouvel article R. 123-1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme issu du décret du 9 juin 2004 stipule : « le <strong>plan</strong> <strong>local</strong><br />
d’urbanisme comprend un <strong>rapport</strong> <strong>de</strong> présentation, le projet d’aménagement et <strong>de</strong> développement<br />
durable <strong>de</strong> la commune et un règlement ainsi que <strong>de</strong>s documents graphiques. Il peut comporter en outre<br />
<strong>de</strong>s orientations d’aménagement relatives à <strong>de</strong>s quartiers ou à <strong>de</strong>s secteurs, assorties le cas échéant <strong>de</strong><br />
documents graphiques (…). Il est accompagné d’annexes. »<br />
13
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong> <strong>rapport</strong> <strong>de</strong> présentation<br />
<strong>Le</strong> <strong>rapport</strong> <strong>de</strong> présentation (article R. 123-2) se présente comme le document explicatif ayant pour<br />
vocation d’exprimer le plus clairement possible le <strong>rapport</strong> entre le territoire et son projet. Il doit<br />
constituer une source d’information complète et cohérente et revêtir une dimension pédagogique qui en<br />
fait une pièce accessible et compréhensible par tous.<br />
En termes <strong>de</strong> contenu, le <strong>rapport</strong> <strong>de</strong> présentation doit nécessairement exposer le diagnostic du territoire<br />
en recensant les principaux besoins présents et futurs et analyser l’état initial <strong>de</strong> l’environnement. En<br />
outre, le <strong>rapport</strong> explique les choix retenus pour établir le PADD, expose les motifs <strong>de</strong> la délimitation <strong>de</strong>s<br />
zones, <strong>de</strong>s règles qui y sont applicables et <strong>de</strong>s orientations d’aménagement.<br />
Il évalue les inci<strong>de</strong>nces <strong>de</strong>s orientations du <strong>plan</strong> sur l’environnement et expose la manière dont le <strong>plan</strong><br />
prend en compte le souci <strong>de</strong> sa préservation et <strong>de</strong> sa mise en valeur.<br />
Au <strong>plan</strong> juridique, le <strong>rapport</strong> n’a pas <strong>de</strong> caractère réglementaire, ni <strong>de</strong> valeur normative vis-à-vis <strong>de</strong>s<br />
particuliers.<br />
<br />
<strong>Le</strong> Projet d’Aménagement et <strong>de</strong> Développement Durable<br />
<strong>Le</strong> Projet d’Aménagement et <strong>de</strong> Développement Durable (PADD) est une pièce nouvelle créée par la loi<br />
SRU du 13 décembre 2000, mais dont le contenu et la portée ont été refondus par la loi Urbanisme et<br />
Habitat (UH) du 2 juillet 2003 (article R. 123-3).<br />
Ce document se présente comme l’élément dynamique et stratégique du PLU qui définit le véritable<br />
projet urbain. Il définit, dans le respect <strong>de</strong>s objectifs et <strong>de</strong>s principes énoncés dans les articles L.110 et<br />
L.121-1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour<br />
l’ensemble <strong>de</strong> la commune. Il doit donc respecter les principes d’équilibre, <strong>de</strong> diversité <strong>de</strong>s fonctions<br />
urbaines et <strong>de</strong> mixité sociale et l’environnement.<br />
Ce projet se veut un document simple, <strong>de</strong>stiné à l’ensemble <strong>de</strong>s citoyens, qui doit permettre un débat<br />
clair en conseil municipal et en conseil communautaire.<br />
Sa fonction va bien au-<strong>de</strong>là d’une simple fonction d’information à l’instar du <strong>rapport</strong> <strong>de</strong> présentation. Il<br />
est la clef <strong>de</strong> voûte du PLU et en fait intimement partie. En effet, le règlement est établi « en cohérence »<br />
avec le PADD <strong>de</strong> sorte qu’il ne doit contenir aucune prescription contraire au projet.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s orientations d’aménagement<br />
<strong>Le</strong>s orientations d’aménagement relatives à <strong>de</strong>s quartiers ou à <strong>de</strong>s secteurs (article R. 123-3-1) sont<br />
<strong>de</strong>venues avec le décret d’application du 9 juin 2004 <strong>de</strong> la loi UH, un document à part entière du PLU.<br />
Ces orientations d’aménagement relatives à <strong>de</strong>s quartiers ou à <strong>de</strong>s secteurs permettent aux collectivités<br />
<strong>de</strong> préciser, sur certains secteurs sensibles ou fortement évolutifs, <strong>de</strong>s principes plus ou moins détaillés<br />
(sous forme <strong>de</strong> schémas ou <strong>de</strong> textes) d’aménagement <strong>de</strong>s espaces que <strong>de</strong>vront respecter les<br />
constructions. Bien que facultatives, ces orientations peuvent prendre la forme <strong>de</strong> schémas<br />
d’aménagement pour mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager <strong>de</strong>s quartiers ou <strong>de</strong>s<br />
secteurs et préciser les principales caractéristiques <strong>de</strong>s voies et espaces publics.<br />
De façon plus générale, il leur est possible <strong>de</strong> prévoir, selon une liste exhaustive, les actions et opérations<br />
d’aménagement <strong>de</strong>stinées à mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées <strong>de</strong> villes et le<br />
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement<br />
au sein <strong>de</strong>s différents quartiers du territoire communal.<br />
Au <strong>plan</strong> juridique, les effets <strong>de</strong> droit sont à double sens. <strong>Le</strong>s orientations d’aménagement doivent, si elles<br />
existent, être en cohérence avec le PADD. En revanche, l’exécution <strong>de</strong> tous travaux, constructions,<br />
<strong>plan</strong>tations, affouillements ou exhaussements <strong>de</strong>s sols, la création <strong>de</strong> lotissements et l’ouverture<br />
d’installations classées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement existantes.<br />
14
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong> règlement<br />
<strong>Le</strong> règlement du PLU (articles R. 123-4 et R. 123-9) conserve ses <strong>de</strong>ux fonctions originelles :<br />
• fixer les règles d’affectation <strong>de</strong>s sols en délimitant quatre types <strong>de</strong> zones : les zones urbaines (U),<br />
à urbaniser (AU), agricoles (A) et enfin naturelles et forestières (N) ;<br />
• fixer les règles d’utilisation <strong>de</strong>s sols applicables à l’intérieur <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong> ces zones et<br />
déterminer leur constructibilité selon une présentation type, dans les conditions prévues à<br />
l’article R. 123-9 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme.<br />
Au <strong>plan</strong> juridique, le règlement est opposable à tous travaux ou opérations d’une personne publique ou<br />
privée.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s documents graphiques<br />
<strong>Le</strong>s documents graphiques (articles R. 123-11 et R. 123-12) ont pour objet <strong>de</strong> délimiter le champ<br />
d’application territorial <strong>de</strong>s diverses règles concernant l’occupation <strong>de</strong>s sols applicables sur le territoire<br />
communal.<br />
Ils permettent ainsi <strong>de</strong> visualiser non seulement les choix d’aménagement exposés dans le <strong>rapport</strong> <strong>de</strong><br />
présentation et mis en oeuvre dans le règlement mais également <strong>de</strong> délimiter les différentes zones<br />
créées et plusieurs rubriques en fonction <strong>de</strong> leur existence (secteurs, zones, périmètres et<br />
emplacements). <strong>Le</strong>ur aspect synthétique les rend lisibles et accessibles à tous <strong>de</strong> façon immédiate.<br />
<strong>Le</strong>ur portée juridique a évolué car ils <strong>de</strong>viennent, avec la loi SRU, opposables au même titre que le<br />
règlement.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s annexes<br />
<strong>Le</strong>s annexes (articles R. 123-13 et R. 123-14) regroupent <strong>de</strong>s règles concernant l’occupation du sol sur les<br />
territoires couverts par le PLU et qui relèvent pour la plupart d’autres législations.<br />
Elles ont un caractère informatif et permettent <strong>de</strong> prendre connaissance <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s contraintes<br />
administratives applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au <strong>rapport</strong> <strong>de</strong> présentation qu’aux<br />
dispositions réglementaires.<br />
La loi SRU précise leur contenu en le développant <strong>de</strong> sorte que désormais <strong>de</strong>ux types d’annexes doivent<br />
être prévus : <strong>de</strong>s annexes informatives et <strong>de</strong>s documents graphiques complémentaires où figurent un<br />
certain nombre <strong>de</strong> zones et périmètres.<br />
Elles indiquent entre autres la <strong>local</strong>isation <strong>de</strong>s ZAC, les zones <strong>de</strong> préemption, les périmètres <strong>de</strong>s secteurs<br />
situés au voisinage <strong>de</strong>s infrastructures <strong>de</strong> transports terrestres, dans lesquels <strong>de</strong>s prescriptions<br />
d’isolement acoustique ont été édictées. Elles comprennent en outre la liste <strong>de</strong>s servitu<strong>de</strong>s d’utilité<br />
publique, la liste <strong>de</strong>s lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues, les schémas <strong>de</strong>s<br />
réseaux d’eau et d’assainissement et <strong>de</strong>s systèmes d’élimination <strong>de</strong>s déchets, le <strong>plan</strong> d’exposition au<br />
bruit <strong>de</strong>s aérodromes, les dispositions d’un projet <strong>de</strong> <strong>plan</strong> <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s risques naturels prévisibles,<br />
les zones termitées …<br />
15
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
16
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
CHAPITRE I<br />
Présentation du territoire communal<br />
et <strong>de</strong> ses phénomènes constitutifs<br />
17
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
18
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
II- SIITUATIION GENERALE<br />
1. Position <strong>de</strong> l’agglomération nantaise dans l’espace géographique<br />
L'agglomération nantaise, attenante à l'estuaire <strong>de</strong> la Loire, se situe à une cinquantaine <strong>de</strong> kilomètres <strong>de</strong><br />
l'embouchure du fleuve. Elle appartient à l'espace atlantique à travers son histoire portuaire (principal<br />
port <strong>de</strong> Loire), ses paysages, ses productions et son architecture.<br />
Sa position géographique excentrée dans l'espace français et la conception historiquement centralisée<br />
<strong>de</strong> l'aménagement du territoire et rayonnante <strong>de</strong>puis Paris font qu'aujourd'hui <strong>Nantes</strong>, ville-centre <strong>de</strong><br />
l’agglomération, bénéficie d'une bonne <strong>de</strong>sserte vers Paris (2 heures en TGV) mais se trouve relativement<br />
à l'écart <strong>de</strong>s grands axes nationaux et européens. Sa position <strong>de</strong> proximité à la faça<strong>de</strong> atlantique, le<br />
développement possible <strong>de</strong> réseaux aériens européens forment autant d'ouvertures pour pallier ce<br />
handicap : il s'agit donc tout autant <strong>de</strong> créer et capter <strong>de</strong>s flux nouveaux que <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r ou renforcer<br />
sa position pour les villes d'un certain rang dans un espace européen aux dynamiques et aux<br />
concurrences vives entre territoires. C'est donc bien à l'échelle du bi-pôle <strong>Nantes</strong>-Saint-Nazaire que<br />
peuvent se concevoir l'un et l'autre.<br />
19
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
2. Emergence <strong>de</strong> nouvelles échelles <strong>de</strong> territoire et <strong>de</strong> projet : la métropole<br />
<strong>Nantes</strong>-Saint-Nazaire<br />
La réunion au sein d'un périmètre <strong>de</strong> SCOT (Schéma <strong>de</strong> Cohérence Territoriale) <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux agglomérations<br />
<strong>de</strong> Saint-Nazaire et <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> pesant respectivement 110 200 et 550 000 habitants, et <strong>de</strong> trois<br />
communautés <strong>de</strong> communes représentant au total 23 communes à caractère beaucoup plus rural et<br />
naturel et 43 300 habitants, forment un territoire <strong>de</strong> réflexion, <strong>de</strong> <strong>plan</strong>ification et <strong>de</strong> projet <strong>de</strong> plus <strong>de</strong><br />
760 0001 habitants. <strong>Le</strong>s 57 communes réunies au sein du périmètre du futur SCOT forment un territoire<br />
<strong>de</strong> 1660 km², soit un peu moins d'un quart du département <strong>de</strong> Loire Atlantique (6815 km²), mais<br />
rassemblent la gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong> la population (730 000 <strong>de</strong> 1 135 000 habitants, soit près <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
tiers), <strong>de</strong>s actifs (338 000 <strong>de</strong> 460 000, soit 73%) et <strong>de</strong>s emplois.<br />
L'assemblage <strong>de</strong> ces différentes intercommunalités a plusieurs motifs : prendre en compte les nouvelles<br />
échelles <strong>de</strong> territoire auxquelles se jouent les enjeux <strong>de</strong> développement durable pour une population <strong>de</strong><br />
plus en plus mobile (mobilités rési<strong>de</strong>ntielles, d'emploi, <strong>de</strong> loisirs, etc.), créer <strong>de</strong>s dynamiques <strong>de</strong> solidarité<br />
et <strong>de</strong> développement économique à l'échelle <strong>de</strong> l'estuaire, et au bout du compte affirmer un espace<br />
métropolitain, sous-tendu par <strong>de</strong>ux agglomérations (formant quasiment les <strong>de</strong>ux foyers d'une ellipse <strong>de</strong><br />
plus <strong>de</strong> 50 kilomètres d'amplitu<strong>de</strong>) aux profils différents et complémentaires (l'une plus industrielle et <strong>de</strong><br />
production, l'autre plus tertiaire et <strong>de</strong> direction) et par <strong>de</strong>ux grands sites d'envergure européenne encore<br />
peu reconnus : le littoral atlantique pourtant très fréquenté (le département se place au 6e rang<br />
national, La Baule et sa "plus gran<strong>de</strong> plage d'Europe" étant la principale <strong>de</strong>stination et image<br />
internationale <strong>de</strong> la métropole en gestation) et la Loire (dont la partie centrale entre le Maine et Sully sur<br />
Loire est promue patrimoine mondial à l'Unesco), espace naturel à l'enjeu écologique majeur dans la<br />
partie estuarienne entre <strong>Nantes</strong> et Saint-Nazaire. Un projet <strong>de</strong> Métropole était déjà présenté dans le<br />
SDAAM (Schéma Directeur d'Aménagement <strong>de</strong> l'Aire Métropolitaine) <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>-Saint-Nazaire <strong>de</strong> 1970.<br />
Carte 1 : réseaux et pôles urbains, SCOT, AURAN.<br />
1 Chiffres INSEE 1999<br />
20
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Carte 2 : espaces urbanisés dans l'estuaire.<br />
Comme ses institutions, la signification <strong>de</strong> la métropole est également profondément modifiée : il ne<br />
s'agit plus tant <strong>de</strong> rééquilibrer le territoire national que <strong>de</strong> promouvoir un territoire au niveau européen.<br />
S'affirme alors une stratégie <strong>local</strong>e et régionale <strong>de</strong> projet, dans un environnement plus libéral et plus<br />
concurrentiel, et non plus seulement <strong>de</strong> <strong>plan</strong>ification. L'aménagement du territoire <strong>de</strong>vient, dans ce<br />
contexte, une fonction <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong>s atouts et <strong>de</strong> "mise en scène" <strong>de</strong> l'attractivité.<br />
Elaboré par un Syndicat Mixte qui regroupe 57 communes, et 5 intercommunalités, le SCOT <strong>de</strong> la<br />
Métropole Atlantique <strong>Nantes</strong> Saint-Nazaire a pour objectif <strong>de</strong> répondre aux besoins <strong>de</strong> développement<br />
<strong>de</strong> la métropole en favorisant une organisation urbaine plus économe <strong>de</strong> l’espace et respectueuse <strong>de</strong><br />
l’environnement. La stratégie européenne <strong>de</strong> la métropole qu’exprime le SCOT permettra à<br />
l’agglomération nantaise et à sa sœur nazairienne <strong>de</strong> répondre aux besoins d’emploi et <strong>de</strong><br />
développement personnel et social <strong>de</strong> ses habitants. Pour cela, la métropole doit se doter <strong>de</strong>s fonctions<br />
nouvelles et renforcer les fonctions existantes nécessaires à cette ambition. <strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> SCOT a été<br />
arrêté le 3 juillet 2006.<br />
3. La commune dans l'agglomération<br />
Secon<strong>de</strong> commune <strong>de</strong> l’agglomération nantaise par sa superficie – 4 874 hectares-, Couëron dispose d’un<br />
patrimoine naturel remarquable avec une campagne verdoyante, un lac, <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s espaces<br />
agricoles préservés, et un marais, le Marais Audubon, qui couvre 2 000 hectares. Trait d’union <strong>de</strong> la<br />
métropole <strong>Nantes</strong> Saint-Nazaire, Couëron s’appuie désormais sur le fleuve pour asseoir son projet <strong>de</strong><br />
développement.<br />
Au niveau <strong>de</strong> la communauté urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole, Couëron est rattachée au nord-ouest <strong>de</strong><br />
l'agglomération, avec Indre et Saint-Herblain (pôle Loire-Chézine), Orvault, Sautron et La Chapelle sur<br />
Erdre (pôle Erdre et Cens). En 2004, la population est estimée à 18 750 <strong>de</strong> habitants.<br />
21
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Chiffres-clé <strong>de</strong> Couëron en 1999 (source : INSEE RGP 99)<br />
Couëron<br />
Communauté urbaine<br />
population 17 808 habitants 555 518 habitants<br />
superficie<br />
4 403 hectares<br />
(en cours <strong>de</strong> vérification)<br />
52 336 hectares<br />
<strong>de</strong>nsité 4 habitants / ha 10,5 habitants / ha<br />
emploi 4364 emplois 254 787 emplois<br />
Situation <strong>de</strong> Couëron dans <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
22
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Située à 15 km. à l’Ouest <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>, la commune <strong>de</strong> Couëron appartient historiquement à la continuité<br />
industrielle et traditionnellement populaire <strong>de</strong> l’agglomération, ancrée sur la Loire avec Indre, la partie<br />
Sud <strong>de</strong> Saint-Herblain et le Bas-Chantenay à <strong>Nantes</strong>.<br />
La commune est limitrophe :<br />
- d’Indre et <strong>de</strong> Saint Herblain à l’Est,<br />
- <strong>de</strong> Saint-Jean-<strong>de</strong>-Boiseau et du Pellerin au Sud, sur l’autre rive <strong>de</strong> la Loire,<br />
- <strong>de</strong> Sautron au Nord,<br />
- <strong>de</strong> Saint Etienne-<strong>de</strong>-Montluc à l’Ouest.<br />
Elle est ainsi au contact <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong> communes Coeur d’Estuaire à laquelle appartiennent<br />
Saint Etienne <strong>de</strong> Montluc, <strong>Le</strong> Temple et Cor<strong>de</strong>mais.<br />
<strong>Le</strong> port récemment aménagé au pied du centre-ville <strong>de</strong> Couëron<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
23
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
24
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIII – LE DÉVELOPPEMENT URBAIIN :: HIISTORIIQUE ET<br />
ORGANIISATIION ACTUELLE<br />
1. Histoire <strong>de</strong> la commune et <strong>de</strong> son urbanisation<br />
<br />
Rapi<strong>de</strong> panorama historique<br />
Source : "Histoire <strong>de</strong> Couëron et <strong>de</strong> la Loire armoricaine" <strong>de</strong> Raymond Briant, collection Monographies <strong>de</strong>s<br />
villes et villages <strong>de</strong> France édité par "<strong>Le</strong> livre d'Histoire-Lorisse".<br />
L'origine du nom Couëron provient d'une ancienne orthographe inscrite dans le cartulaire <strong>de</strong> Redon qui<br />
rattache le nom <strong>de</strong> Couëron à la première migration celte bien avant l'ère chrétienne. Il s'agit <strong>de</strong> la racine<br />
indo-européenne "Koria" qui a donné le mot latin "curia" désignant le centre administratif d'une ville. <strong>Le</strong><br />
territoire communal abriterait <strong>de</strong>s vestiges d’une société organisée aux époques gallo-romaine et<br />
mérovingienne.<br />
Différentes pério<strong>de</strong>s ont marqué Couëron :<br />
- <strong>Le</strong>s époques gallo-romaines et mérovingiennes<br />
Quelques vestiges témoignent <strong>de</strong> l'existence d'une société organisée à Couëron aux époques galloromaines<br />
et mérovingiennes : les établissements romains aux Salles et près <strong>de</strong> l'église saint-Symphorien,<br />
les sarcophages <strong>de</strong> la ville-aux-chefs, les briques sigillées provenant <strong>de</strong> l'ancienne chapelle Saint-Martin.<br />
- Au Moyen Âge<br />
Des fiefs se partagent le territoire comme celui <strong>de</strong> Bougon et <strong>de</strong> Vigneux qui doit sa prospérité à la<br />
proximité du fleuve.<br />
- Au XV e siècle<br />
Des transactions amènent Couëron dans le domaine ducal. En 1488, après la guerre entre la France et la<br />
Bretagne, le Duc François II reçoit à Couëron les ambassa<strong>de</strong>urs du roi Charles VIII et signe le 31 août, le<br />
traité qui met fin à l'indépendance bretonne. <strong>Le</strong> duc décè<strong>de</strong>ra 8 jours plus tard à Couëron.<br />
- Au XVII e siècle<br />
<strong>Le</strong> port Launay était considéré comme l'avant-port <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> : il permettait d'accueillir les navires en<br />
eaux profon<strong>de</strong>s. Couëron connaît alors une activité économique et industrielle importante.<br />
- Au XVIII e siècle<br />
Une verrerie s'installe en 1785 et en 1860, une usine <strong>de</strong> traitement du minerai <strong>de</strong> plomb<br />
voit le jour sur les bords <strong>de</strong> Loire.<br />
La commune est alors très active et compte une forte population ouvrière Ce développement industriel<br />
nécessite déjà le recours à une main d’œuvre importante. Après le premier conflit mondial, <strong>de</strong>s Arabes,<br />
<strong>de</strong>s Espagnols et <strong>de</strong>s Polonais viennent travailler à Couëron et Indre (établissement Carnaud et forges <strong>de</strong><br />
Basse-Indre).<br />
Afin <strong>de</strong> loger ces travailleurs, <strong>de</strong>s cités ouvrières sont construites. A l’Est du bourg, la cité Chabossière<br />
faites <strong>de</strong> maisons en parpaing <strong>de</strong> mâchefer est créée pour les immigrants espagnols. Au nord du bourg,<br />
les polonais sont logés dans les petites maisons ouvrières en bois <strong>de</strong> la cité Bessonneau dès 1921. La cité<br />
du Bossis, à l’Est du bourg à l’entrée <strong>de</strong>puis les bords <strong>de</strong> Loire est construite avec <strong>de</strong>s pierres extraites <strong>de</strong><br />
la carrière <strong>de</strong> la Garenne.<br />
Couëron est alors une petite cité ouvrière et cosmopolite accueillant notamment 847 polonais, 332<br />
espagnols, 136 italiens et 114 russes.<br />
25
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Mais déjà l’activité politique et syndicale <strong>de</strong>s travailleurs avait permis <strong>de</strong> faire émerger un projet<br />
solidaire. A la toute fin du XIX e siècle, la Fraternité, coopérative <strong>de</strong> consommation est créée par les<br />
militants politiques <strong>de</strong> gauche. Elle est <strong>de</strong>stinée aux familles ouvrières en proposant pain et produits <strong>de</strong><br />
première nécessité à moindre coût. Cette coopérative fraternelle qui pouvait intervenir aussi auprès <strong>de</strong>s<br />
chômeurs s’est inscrite longtemps dans la mémoire ouvrière couëronnaise.<br />
A la fin <strong>de</strong>s années 1920, Couëron compte <strong>de</strong>ux nouveaux équipements <strong>de</strong>stinés aux loisirs et au sport :<br />
une bibliothèque municipale quai Gambetta et un vélodrome installé rue Marcel <strong>de</strong> la Provoté après<br />
plusieurs pistes utilisées sur les quais ou à la Jarriais. Ce vélodrome a été construit selon les mêmes <strong>plan</strong>s<br />
que le Vel’d’Hiv à Paris.<br />
<br />
Patrimoine et protections<br />
<strong>Le</strong> château <strong>de</strong> Beaulieu : Fief <strong>de</strong> la Châtellerie <strong>de</strong> Beaulieu le plus important <strong>de</strong> la paroisse, ce château<br />
seigneurial remonte à une époque très ancienne. Il fait partie du domaine <strong>de</strong>s Ducs <strong>de</strong> Bretagne,<br />
duché auquel Couëron est rattaché au XV e siècle. Il en reste <strong>de</strong>s vestiges remarquables : un porche,<br />
un puits du XIV e siècle, <strong>de</strong>s grosses pierres <strong>de</strong> granit taillées pour l’entourage <strong>de</strong>s fenêtres, une porte<br />
en arrondi.<br />
En 1488, après la guerre entre la France et le duché <strong>de</strong> Bretagne, le duc François II reçoit à Couëron les<br />
ambassa<strong>de</strong>urs du roi Charles VIII et le 31 août signe le traité qui met fin à l’indépendance bretonne. Une<br />
plaque commémorative <strong>de</strong> cet instant a été posée à l’occasion du 500 ème anniversaire <strong>de</strong> la mort <strong>de</strong><br />
Charles VIII, décédé 9 jours après la signature du traité.<br />
<strong>Le</strong> château <strong>de</strong> Bougon du XVI e siècle a le fronton <strong>de</strong> l’orangerie aux armes <strong>de</strong> Bougon, ce qui<br />
témoigne <strong>de</strong> son architecture initiale.<br />
Au XVII e siècle, le village <strong>de</strong> Port Launay, à l’aval immédiat du bourg <strong>de</strong> Couëron peut accueillir <strong>de</strong>s<br />
navires en eaux profon<strong>de</strong>s. C’est le début d’une activité portuaire commerciale et industrielle<br />
importante qui a déterminé l’évolution <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers siècles <strong>de</strong> la cité.<br />
<strong>Le</strong>s quais <strong>de</strong> la Loire font l’objet d’une activité <strong>de</strong> plus en plus intense jusqu’à son apogée entre 1620<br />
et 1740. <strong>Nantes</strong> au début du XVIIIè siècle possè<strong>de</strong> 1332 vaisseaux et est le premier port d’Europe,<br />
notamment en raison du trafic d’esclaves. Port Launay, siège <strong>de</strong> la capitainerie <strong>de</strong> Couëron accueille<br />
un poste <strong>de</strong> douane chargé <strong>de</strong> percevoir les droits <strong>de</strong>s nombreux produits issus <strong>de</strong>s commerces<br />
maritimes. Il subsiste quelques témoins architecturaux <strong>de</strong> cette activité débordante d’un site très<br />
couru <strong>de</strong>s armateurs nantais. Une cale du XVII e siècle est encore en place un peu plus loin en aval <strong>de</strong><br />
l’étier à Pierre Tamis.<br />
Fin XVIII e, une verrerie et une usine <strong>de</strong> traitement du minerai <strong>de</strong> plomb s’installent. Installée en 1785,<br />
cette entreprise réalisait divers objets en verre dont les canevettes <strong>de</strong>stinées aux échanges lors du<br />
commerce d’esclaves. Il reste une porte <strong>de</strong> l’établissement initial place <strong>de</strong> la Verrerie.<br />
La tour à plomb <strong>de</strong> Couëron est d’ailleurs <strong>de</strong>venu un élément architectural <strong>de</strong>s bords <strong>de</strong> la Loire,<br />
visible <strong>de</strong>puis les communes alentours. Il fait l’objet d’un classement au titre <strong>de</strong> monument<br />
historique. Construite en 1878 par la société <strong>de</strong>s fon<strong>de</strong>ries et <strong>de</strong>s laminoirs, cette tour permettait la<br />
fabrication <strong>de</strong> plomb <strong>de</strong> chasse. C’est la seule encore <strong>de</strong>bout en France. <strong>Le</strong>s ingénieurs <strong>de</strong> la fon<strong>de</strong>rie<br />
<strong>de</strong> plomb disposeront ensuite d’un logis, appelé autrefois « château <strong>de</strong> Couëron » construit fin XIX e<br />
sur le quai Emile Paraf.<br />
La Gerbetière est l’ancienne rési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la famille Audubon, nom rendu célèbre par Jean-Jacques<br />
Audubon naturaliste qui y passa sa jeunesse. Il <strong>de</strong>vint connu suite à la diffusion <strong>de</strong> ses peintures<br />
d’oiseaux effectués lors <strong>de</strong> ses voyages en Amérique du Nord. Cette maison du XVII e siècle est la<br />
propriété <strong>de</strong> la famille Audubon à partir <strong>de</strong> la fin du XVIII e siècle, en même temps que la chapelle<br />
Notre-Dame-<strong>de</strong>-Recouvrance au Port Launay jusqu’au début du XIX e siècle. La Gerbetière fait l’objet<br />
d’une instruction en cours par la conservation régionale <strong>de</strong>s monuments historiques.<br />
Comme dans les communes voisines, les hauteurs rurales <strong>de</strong> Couëron, ventilées par les courants <strong>de</strong><br />
la Loire ont accueilli <strong>de</strong>s moulins à vent. Celui <strong>de</strong> la Galonnière, <strong>de</strong> 1740, semble être le plus ancien.<br />
Au milieu du XIX e siècle, une nouvelle activité s’im<strong>plan</strong>te à Couëron : une briqueterie.<br />
26
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
L’histoire récente du développement communal<br />
Du fait d’activités variées et incessantes <strong>de</strong>puis plusieurs siècles, la commune s’est développée<br />
progressivement, contrairement aux autres communes <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> couronne <strong>de</strong> l’agglomération<br />
nantaise dont le développement date essentiellement <strong>de</strong>s années 1960.<br />
A partir du XX ème siècle, la construction <strong>de</strong>s cités ouvrières marque cependant une conception nouvelle et<br />
plus intense du développement communal avec la constitution <strong>de</strong> petits quartiers. Ce développement<br />
n’est pas le fait <strong>de</strong> la municipalité mais <strong>de</strong>s patrons d’industrie qui organisent le logement <strong>de</strong> leurs<br />
employés et ouvriers pour attirer la main-d’œuvre et la fixer près <strong>de</strong>s usines. L’essentiel <strong>de</strong> la<br />
construction s’est effectué par <strong>de</strong> l’habitat pavillonnaire pour les familles et <strong>de</strong> petits immeubles<br />
collectifs pour les célibataires, selon un principe inspiré <strong>de</strong>s cités-jardins anglaises. Cette urbanisation a<br />
généré une forme urbaine bien particulière à proximité du bourg mais aussi à la Chabossière. <strong>Le</strong> centre<br />
urbain attractif est toujours resté autour du centre historique, même si aujourd’hui l’activité<br />
commerciale s’est légèrement déplacée.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la voie ferrée, <strong>de</strong> l’étier <strong>de</strong> Beaulieu et du pont <strong>de</strong> Retz, le quartier <strong>de</strong> la Chabossière a<br />
commencé à se structurer comme un <strong>de</strong>uxième bourg. Doté d’un nombre moins important<br />
d’équipements et <strong>de</strong> commerces, il présente un aspect rési<strong>de</strong>ntiel comme les extensions du centre-ville<br />
au-<strong>de</strong>là du boulevard <strong>de</strong> l’Europe. Après la secon<strong>de</strong> guerre mondiale, ce quartier a continué à se<br />
développer <strong>de</strong> façon plus intense à travers plusieurs opérations <strong>de</strong> lotissements.<br />
D’un point <strong>de</strong> vue industriel, les im<strong>plan</strong>tations se sont effectuées d’abord près <strong>de</strong> la Loire en lien avec le<br />
moyen <strong>de</strong> transport privilégié et les capacités d’échanges commerciaux offerts par le fleuve. Ces activités<br />
situées près <strong>de</strong>s quais, au pied <strong>de</strong> la falaise, sont intégrées dans l’urbanisation couëronnaise.<br />
<strong>Le</strong>s bords <strong>de</strong> Loire en amont du centre-ville accueillent <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s emprises industrielles : l’usine<br />
d’incinération <strong>de</strong>s ordures ménagères Arc-en-Ciel et l’usine <strong>de</strong> production d’acier pour l’emballage<br />
alimentaire dans la continuité du site industriel <strong>de</strong> Basse-Indre.<br />
Depuis les années 1980, le développement <strong>de</strong>s activités a changé <strong>de</strong> nature et <strong>de</strong> <strong>local</strong>isation dans la ville.<br />
Un parc à dominante tertiaire <strong>de</strong> PME-PMI s’est en effet déployé en accroche sur l’échangeur entre les RD<br />
101 et 201, dans ce qui s’appelle désormais « les Hauts <strong>de</strong> Couëron ».<br />
27
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
2. L’organisation générale du territoire<br />
A Couëron, territoire <strong>de</strong> transition entre la ville et la campagne <strong>de</strong> 4 873 hectares, les espaces naturels et<br />
agricoles occupent plus <strong>de</strong> 70 % du territoire communal.<br />
Organisation général du territoire couëronnais<br />
<br />
Un territoire marqué par les zones humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Loire<br />
Source : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Au Sud, une gran<strong>de</strong> partie du territoire est façonnée par le fleuve. <strong>Le</strong> marais Audubon ouvre vers les<br />
larges espaces naturels <strong>de</strong> l’estuaire. Très étendus, les prés-marais recouvrent 1 687 ha. Riverains du<br />
fleuve et marqués par une altitu<strong>de</strong> à peine plus élevée que le niveau <strong>de</strong> la mer, ils sont quadrillés par un<br />
réseau d’étiers, <strong>de</strong> fossés et <strong>de</strong> canaux assurant la gestion hydraulique <strong>de</strong> l’ensemble. Encore utilisés par<br />
une agriculture extensive, ils constituent un site extrêmement riche pour la faune et la flore.<br />
La présence <strong>de</strong> ces terres humi<strong>de</strong>s a cadré l’extension <strong>de</strong> l’urbanisation. <strong>Le</strong>s zones humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Beaulieu<br />
frangent la voie ferrée et le Nord du bourg et l’étier <strong>de</strong> Beaulieu sépare les <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s entités urbaines.<br />
A l’Est, au Sud <strong>de</strong> la Chabossière et <strong>de</strong> la voie ferrée, ce sont les zones humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Patissière,<br />
également reliée à la Loire, qui limitent le rapprochement <strong>de</strong> l’urbanisation vers le fleuve.<br />
<br />
Un plateau bocager<br />
Au Nord, la présence relativement discrète <strong>de</strong> la Chézine est surtout doublée du passage <strong>de</strong> la RN 165 et<br />
<strong>de</strong> l’arrivée sur les hauteurs du Sillon <strong>de</strong> Bretagne dont la ligne Nord-Ouest/Sud-Est tranche le massif<br />
armoricain. Depuis la vallée <strong>de</strong> la Loire jusqu’à ces points hauts, s’organise un plateau bocager et agricole.<br />
Il présente toujours une forte activité agricole au sein d’un ensemble bocager préservant <strong>de</strong>s traces du<br />
maillage <strong>de</strong> haies et <strong>de</strong> chemins.<br />
Il a cependant fait l’objet d’une im<strong>plan</strong>tation humaine ancienne autour d’exploitations agricoles et <strong>de</strong><br />
petits hameaux. <strong>Le</strong> développement <strong>de</strong>s cinquante <strong>de</strong>rnières années a contribué à un mitage très présent<br />
du paysage. De nombreux hameaux mais aussi <strong>de</strong> l’habitat isolé marquent l’organisation du territoire<br />
rural.<br />
Certains hameaux sont aujourd’hui absorbés par l’urbanisation comme celui <strong>de</strong> la Sinière au Nord <strong>de</strong> la<br />
Chabossière.<br />
28
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
D’autres sont en campagne et présentent une morphologie urbaine <strong>de</strong>nse et sans étalement majeur :<br />
l’Erdurière, la Bazillère, la Guinière, etc. <strong>Le</strong> hameau <strong>de</strong> la Montagne, accroché sur la route <strong>de</strong> Saint-<br />
Etienne-<strong>de</strong>-Montluc présente un habitat linéaire, venant poursuivre les zones d’activités.<br />
Enfin, le hameau <strong>de</strong> Brimberne qui s’est fortement développé <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>rnière révision du P.O.S. est<br />
aujourd’hui confronté à une urbanisation relativement <strong>de</strong>nse pour un secteur rural, sans que les diverses<br />
constructions aient été pensées dans une préoccupation d’aménagement d’ensemble. Ceci pose <strong>de</strong>s<br />
problèmes importants, en matière d’équipement comme l’assainissement par exemple.<br />
L’ensemble <strong>de</strong>s hameaux, maisons isolées et villages accueillaient en 1990 un peu plus <strong>de</strong> 15 % <strong>de</strong> la<br />
population couëronnaise.<br />
<br />
Deux grands quartiers d’habitat<br />
L’agglomération <strong>de</strong> Couëron est constituée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux pôles urbains <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importance :<br />
- le cœur <strong>de</strong> la ville est im<strong>plan</strong>té à partir du bourg originel. Il constitue un pôle vivant, doté <strong>de</strong><br />
nombreux équipements avec une partie <strong>de</strong>nse et ancienne sur les quais et autour <strong>de</strong> l’église. <strong>Le</strong>s<br />
extensions réalisées progressivement accueillent un habitat plutôt pavillonnaire et les grands<br />
équipements couëronnais : mairie, lycée professionnel, collège, bibliothèque, CCAS. <strong>Le</strong>s<br />
commerces se sont déplacés du centre ancien vers les nouveaux espaces urbains autour <strong>de</strong> la<br />
mairie. <strong>Le</strong>s aménagements récents visent à raccrocher le centre aux quais <strong>de</strong> Loire réaménagés<br />
et <strong>de</strong>venus un lieu <strong>de</strong> promena<strong>de</strong> privilégié. <strong>Le</strong> centre ville accueillait au recensement <strong>de</strong> 1990,<br />
plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> la population, soit 8 420 habitants ;<br />
- les quartiers Est, autour <strong>de</strong> La Chabossière se sont développés au cours du XX e siècle. D’aspect<br />
plutôt rési<strong>de</strong>ntiel, ils comptent cependant <strong>de</strong>s équipements <strong>de</strong> proximité : écoles, terrains <strong>de</strong><br />
sports, ainsi qu’un petit centre commercial. Cet ensemble comptait, en 1990, 5 314 habitants.<br />
Organisation urbaine du territoire couëronnais<br />
Source : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
29
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s zones d’activités<br />
Ville active <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s siècles, Couëron dispose <strong>de</strong> trois grands sites d’activités :<br />
- les bords <strong>de</strong> Loire en amont du centre-ville, dans la continuité <strong>de</strong> Basse-Indre, un pôle d’industrie<br />
lour<strong>de</strong> avec notamment le pôle <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s déchets <strong>de</strong> l’agglomération nantaise, Arc en<br />
Ciel ;<br />
- les quais <strong>de</strong> la Loire, au pied du centre-ville, soit les plus anciens sites occupés par l’industrie, qui<br />
connaissent aujourd’hui <strong>de</strong>s mutations et opérations <strong>de</strong> renouvellement urbain ;<br />
- sur le plateau, les nouvelles zones à vocation d’activités plus légères qui sont en plein<br />
développement : les hauts <strong>de</strong> Couëron, qui sont aujourd’hui un <strong>de</strong>s sites d’im<strong>plan</strong>tation<br />
privilégié en entrée ouest <strong>de</strong> l’agglomération.<br />
D’autres petites zones d’activités se sont développées ici et là, soit sur les bords <strong>de</strong> la Loire (le Paradis),<br />
soit le long <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> circulation (RD 101 en particulier) en secteur rural.<br />
<strong>Le</strong> Marais Audubon accueille quant à lui un chantier traditionnel <strong>de</strong> construction-réparation <strong>de</strong> chalutiers<br />
en bois, près <strong>de</strong> l’écluse du Dareau.<br />
30
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La Loire <strong>de</strong>vant Couëron<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
31
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIIIII- LE DIIAGNOSTIIC DU TERRIITOIIRE<br />
1. <strong>Le</strong>s évolutions socio-démographiques caractéristiques<br />
<br />
Une croissance démographique continue<br />
En 1999, la population était <strong>de</strong> 17 808 habitants. Une estimation faite à partir <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s matrices<br />
<strong>de</strong>s taxes d’habitation avance le chiffre <strong>de</strong> 18 750 habitants en 2004. Couëron connaît une croissance<br />
continue du nombre <strong>de</strong> ses habitants <strong>de</strong>puis le début du XX ème siècle. Cette évolution est plus ou moins<br />
soutenue selon les pério<strong>de</strong>s avec un pic récent durant les années 1980 : +1,83 % <strong>de</strong> croissance annuelle.<br />
Entre 1990 et 1999, le taux d’accroissement total a été <strong>de</strong> 9.1 %, et entre 1999 et 2004 <strong>de</strong> 5.3 %.<br />
Evolution démographique <strong>de</strong> Couëron <strong>de</strong>puis 1975<br />
20 000<br />
18 000<br />
16 000<br />
14 000<br />
12 000<br />
13 273<br />
14 113<br />
16 319<br />
17 808<br />
18 750<br />
10 000<br />
8 000<br />
6 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
0<br />
1975 1982 1990 1999 2004<br />
Source : INSEE RGP 99<br />
C’est ainsi que progressivement la cité s’est développée pour faire désormais partie <strong>de</strong>s plus importantes<br />
<strong>de</strong> l’agglomération.<br />
Depuis 1999, la commune a continué d’attirer <strong>de</strong> nouveaux rési<strong>de</strong>nts, malgré une légère accalmie dans<br />
les projets d’habitat réalisés ces cinq <strong>de</strong>rnières années. D’après les estimations, sa croissance<br />
démographique s’est poursuivie à un rythme supérieur à 1 % annuel, dans la continuité <strong>de</strong> ce qui s’est fait<br />
<strong>de</strong>puis 1990. Au 1er janvier 2004, la population couëronnaise s’élevait à environ 18 750 habitants, soit une<br />
progression moyenne <strong>de</strong> 200 habitants chaque année <strong>de</strong>puis 1999.<br />
Population Totale<br />
Population <strong>de</strong>s ménages<br />
Variation annuelle pop<br />
ménages<br />
1999/2004<br />
1999 2004 1999 2004<br />
17 808 18 750 17664 18 600<br />
+ 1,05 %<br />
Source : RGP INSEE, T.H. 1999-2004 ; Traitement SQUARE d’après estimation TH<br />
32
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s effets <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s naturels et migratoires positifs<br />
Couëron connaît un équilibre <strong>de</strong> ses composantes démographiques : les sol<strong>de</strong>s naturel et migratoire<br />
participent chacun à la progression. Selon les pério<strong>de</strong>s, le sol<strong>de</strong> migratoire est nettement plus marqué<br />
mais globalement, les <strong>de</strong>ux participent activement à la croissance démographique <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s dizaines<br />
d’années.<br />
Ainsi Couëron présente un profil <strong>de</strong> commune attractive où les arrivées sont plus nombreuses que les<br />
départs et une vitalité interne <strong>de</strong> sa population dont la jeunesse permet la croissance continue du sol<strong>de</strong><br />
naturel <strong>de</strong>puis 1975.<br />
Evolution <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s naturel et migratoire<br />
1975-1982 1982 -1990 1990-1999<br />
Taux <strong>de</strong> variation annuel 0,88% 1,83% 0,97%<br />
- dû au mouvement naturel 0,42% 0,48% 0,52%<br />
- dû au mouvement migratoire 0,46% 1,35% 0,46%<br />
Source : INSEE<br />
Evolution du nombre <strong>de</strong> naissances et <strong>de</strong> décès à Couëron<br />
1990-1999 1982-1990 1975-1982<br />
Naissances 1 854 1 556 1 238<br />
Décès 1 062 982 836<br />
Variation abs pop +1 489 +2 206 +840<br />
Source : INSEE<br />
33
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Une population jeune<br />
Bien que la population couëronnaise présente quelques signes <strong>de</strong> vieillissement, puisque son indice <strong>de</strong><br />
jeunesse baisse (part <strong>de</strong>s jeunes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 20 ans par <strong>rapport</strong> à la part <strong>de</strong>s plus 60 ans), elle conserve<br />
une population encore assez jeune. La progression <strong>de</strong>s personnes âgées <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 60 ans est notable,<br />
mais leur proportion au sein <strong>de</strong> la population totale est légèrement inférieure à celle <strong>de</strong> l’agglomération.<br />
La proportion <strong>de</strong>s différentes classes d’âge <strong>de</strong> la population couëronnaise et leur évolution<br />
1982 1990 1999<br />
Nord-Ouest<br />
1999<br />
Agglo 99<br />
0 - 19 ans 33,6% 31,1% 29,2% 27,0% 25,0%<br />
20 - 39 ans 28,5% 29,2% 26,3% 26,5% 31,6%<br />
40 - 59 ans 23,6% 24,0% 27,4% 29,1% 25,4%<br />
60 ans et plus 14,4% 15,8% 17,1% 17,4% 17,9%<br />
Indice <strong>de</strong> jeunesse 2,34 1,97 1,71 1,55 1,40<br />
Source : INSEE RGP 82-90-99<br />
La part <strong>de</strong>s jeunes adultes, si elle marque un recul, en particulier pour la part <strong>de</strong>s 20 - 39 ans, reste assez<br />
stable, notamment pour une collectivité éloignée <strong>de</strong>s sites universitaires.<br />
Cependant, leur proportion est moindre que dans l’ensemble <strong>de</strong> l’agglomération, traduisant la difficulté<br />
que rencontrent les jeunes ménages désormais pour s’installer dans la commune.<br />
La part <strong>de</strong>s ménages <strong>de</strong> 40 à 59 ans est en progression, en lien avec le vieillissement <strong>de</strong> cette population<br />
installée, mais elle reste dans <strong>de</strong>s proportions normales, sans être « gonflée » par <strong>de</strong>s arrivées <strong>de</strong><br />
rési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cette tranche d’âge et intégrée dans un phénomène <strong>de</strong> renouvellement permanent <strong>de</strong> la<br />
population.<br />
Ainsi, l’indice <strong>de</strong> jeunesse <strong>de</strong> Couëron, diminue <strong>de</strong> façon régulière et constante, mais reste nettement<br />
supérieur à celui <strong>de</strong> l’ensemble du secteur Nord-Ouest et encore plus <strong>de</strong> l’agglomération dans son<br />
ensemble.<br />
34
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Pyrami<strong>de</strong> <strong>de</strong>s âges <strong>de</strong> la population <strong>de</strong> Couëron en 1999<br />
Source : INSEE<br />
L’accroissement <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 75 ans, en lien avec un peuplement ancien <strong>de</strong> la commune,<br />
commence à apparaître <strong>de</strong> façon conséquente à Couëron.<br />
Evolution <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s plus <strong>de</strong> 75 ans<br />
COUËRON<br />
en 1999<br />
(RGP INSEE)<br />
en 2004 (estimation TH)<br />
Pop. Totale 17 821 18 750<br />
Pop + <strong>de</strong> 75 ans 891 1 125<br />
part <strong>de</strong>s + <strong>de</strong> 75 ans 5% 6%<br />
(source : INSEE RGP 99 * estimation Aures)<br />
Au recensement <strong>de</strong> 1999, les personnes âgées <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 75 ans représentaient 5 % <strong>de</strong> la population pour<br />
un peu moins <strong>de</strong> 900 personnes. En 2004, leur nombre s’est accru pour atteindre plus <strong>de</strong> 1 100<br />
personnes, soit 6 % <strong>de</strong>s Couëronnais. <strong>Le</strong>ur rythme <strong>de</strong> progression est bien inférieur à celui <strong>de</strong> la<br />
population, mais il n’en reste pas moins que la présence d’une population âgée nécessite une attention<br />
particulière dans l’offre <strong>de</strong> logements et <strong>de</strong> services.<br />
35
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong> maintien d’une population à caractère familial<br />
<strong>Le</strong> <strong>de</strong>sserrement <strong>de</strong>s familles est un phénomène structurel, au <strong>plan</strong> national, qui résulte du vieillissement<br />
<strong>de</strong> la population et du veuvage, <strong>de</strong>s décohabitations <strong>de</strong>s jeunes, <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong>s familles<br />
monoparentales et du nombre <strong>de</strong> célibataires. Ainsi, la taille moyenne <strong>de</strong>s ménages ne cesse <strong>de</strong><br />
diminuer, à Couëron, comme ailleurs.<br />
Mais le maintien d’un bon taux <strong>de</strong> natalité et l’arrivée <strong>de</strong> nouveaux ménages permet <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r une taille<br />
moyenne <strong>de</strong>s ménages élevée, supérieure à celle du secteur Nord-Ouest <strong>de</strong> l’agglomération<br />
Taille moyenne <strong>de</strong>s ménages<br />
1982 1990 1999 2004*<br />
Couëron 3,04 2,90 2,78 2,71<br />
Secteur N-O <strong>de</strong> l’agglomération 3,12 2,85 2,61 2,47<br />
Agglomération nantaise 2,70 2,50 2,29 NR<br />
Source : INSEE RGP 82-90-99 ; *estimation Square d’après TH ; NR : non renseigné<br />
Malgré tout, la diminution, même mo<strong>de</strong>ste, <strong>de</strong> la taille moyenne <strong>de</strong>s ménages implique <strong>de</strong>s besoins<br />
accrus en logements à nombre d’habitants équivalents. C’est ce que l’on appelle la satisfaction du point<br />
mort, ou l’accroissement <strong>de</strong> la production <strong>de</strong> logements <strong>de</strong>stinée aux seuls besoins <strong>de</strong> la population en<br />
place et non à l’accueil <strong>de</strong> nouveaux habitants.<br />
Comparaison <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s ménages en 1999<br />
Couëron<br />
N-O<br />
Agglomération<br />
Agglomération<br />
1 personne 19,4% 23,0% 36,1%<br />
2 personnes 29,8% 32,1% 29,3%<br />
3 personnes 18,3% 17,7% 14,1%<br />
4 personnes 21,2% 17,8% 13,2%<br />
5 personnes 9,0% 7,5% 5,6%<br />
6 personnes et plus 2,3% 1,9% 1,7%<br />
De fait, la part <strong>de</strong>s ménages composés d’une seule personne (19.4 %) progresse, mais très légèrement et<br />
reste inférieure à celle du secteur Nord-Ouest (23 %) et bien sûr à celle <strong>de</strong> l’agglomération (36.1 %). La<br />
progression du nombre <strong>de</strong> ménages <strong>de</strong> 2 personnes est plus marquée (29.8 %) et leur proportion dans la<br />
population dépasse celle <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> l’agglomération (29.3 %). On peut y voir le phénomène <strong>de</strong><br />
vieillissement <strong>de</strong>s ménages installés <strong>de</strong>puis longtemps et dont les enfants sont partis. On peut<br />
également y voir la présence <strong>de</strong> jeunes ménages qui n’ont pas encore d’enfants.<br />
36
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La part <strong>de</strong>s « gran<strong>de</strong>s » familles est particulièrement marquante à Couëron avec un tiers <strong>de</strong>s ménages<br />
composé d’au moins 4 personnes. C’est un taux bien supérieur à celui du secteur Nord-Ouest (27.2 %) et<br />
à celui <strong>de</strong> la moyenne communautaire (20.5 %).<br />
Evolution <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s ménages à Couëron<br />
30,00%<br />
25,00%<br />
20,00%<br />
15,00%<br />
10,00%<br />
1982<br />
1990<br />
1999<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes<br />
et plus<br />
<br />
Une mobilité accrue<br />
Source : INSEE RGP 82-90-99<br />
La part <strong>de</strong>s nouveaux ménages représente un taux relativement faible, au regard <strong>de</strong> celui <strong>de</strong><br />
l’agglomération, mais en augmentation.<br />
En effet, en 1990, 71.2 % <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> Couëron habitaient déjà la commune en 1982, alors que la<br />
moyenne communautaire s’établissait à 66.4 %. En 1999, le taux <strong>de</strong> mobilité rési<strong>de</strong>ntielle augmente, car<br />
seuls 68.6 % <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> Couëron habitaient déjà la commune en 1990. La moyenne pour les autres<br />
communes <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole est <strong>de</strong> 62.3 %.<br />
La ville opère une forte attraction auprès <strong>de</strong>s jeunes ménages. Plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s nouveaux rési<strong>de</strong>nts a<br />
entre 25 et 39 ans, soit les forces actives et familiales les plus vives.<br />
La mobilité rési<strong>de</strong>ntielle par classe d’âge Source : INSEE RGP 82-90-99<br />
1982-90 dont 25-39 ans 1990-99 dont 25-39 ans<br />
Nouveaux arrivants dans la commune 4692 1814 5590 2003<br />
Part dans la population totale 28,8% 49,6% 31,4% 53,8%<br />
dont issue du reste département 3736 1332 4043 1453<br />
dont d’une autre origine 956 482 1547 550<br />
Au total, plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> la population recensée en 1999 habitait donc un autre logement en 1990.<br />
37
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Au niveau <strong>de</strong>s catégories socioprofessionnelles, les nouveaux arrivants sont en gran<strong>de</strong> partie inactifs<br />
(autres que retraités) pour 44 %, tandis que les actifs sont pour la plupart issus <strong>de</strong>s classes moyennes, à<br />
savoir professions intermédiaires (15.2 %), employés (16 %) et ouvriers (13 %).<br />
CSP <strong>de</strong>s nouveaux habitants arrivés entre 1990 et 1999 à Couëron<br />
Agriculteurs 0.2 %<br />
Artisans et commerçants 3 %<br />
Cadres et professions intellectuelles 5 %<br />
Professions intermédiaires 15.2 %<br />
Employés 16 %<br />
Ouvriers 13 %<br />
Retraités 3.6 %<br />
Autres inactifs 44 %<br />
Total <strong>de</strong>s nouveaux arrivants entre 1990 et 1999<br />
5404 personnes<br />
Source :INSEE RGP 99<br />
A noter que l’attractivité <strong>de</strong> Couëron n’est pas particulièrement élevée auprès <strong>de</strong>s personnes venant<br />
nouvellement s’installer dans l’agglomération nantaise : près <strong>de</strong> 28 % <strong>de</strong>s nouveaux arrivants dans la<br />
commune venaient d’un département autre que la Loire-Atlantique, dans certaines communes du<br />
secteur Nord-Ouest, le taux est proche <strong>de</strong> 40 %. Il faut sans doute y voir l’effet <strong>de</strong> l’histoire et <strong>de</strong> la place<br />
particulière <strong>de</strong> la population ouvrière dans la vie <strong>de</strong> la cité et une méconnaissance du site et <strong>de</strong> ses<br />
évolutions auprès <strong>de</strong>s ménages mobiles. Ceci étant, comme pour Indre, les effets <strong>de</strong> mobilité peuvent<br />
évoluer avec une valorisation <strong>de</strong>s quais, <strong>de</strong>s centres anciens en accroche sur le fleuve et d’autres projets<br />
<strong>de</strong> développement.<br />
<br />
Des catégories socio-professionnelles représentatives <strong>de</strong> milieux populaires<br />
Couëron est une ville ouvrière. Son histoire et les différents peuplements (polonais, espagnols, …) ont<br />
contribué à ce phénomène. Malgré la diminution du poids <strong>de</strong> la classe ouvrière dans la société française,<br />
elle <strong>de</strong>meure encore bien présente avec plus du quart <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> ménages ayant ce statut<br />
socioprofessionnel à Couëron.<br />
La part <strong>de</strong>s employés est mo<strong>de</strong>ste parmi les chefs <strong>de</strong> ménages, mais concerne une population féminine<br />
importante.<br />
La part <strong>de</strong>s retraités est élevée : 27.6 %. Elle est supérieure à celles du secteur Nord-Ouest (26.9 %) et <strong>de</strong><br />
l’agglomération nantaise (24.9 %).<br />
38
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Evolution <strong>de</strong> la représentativité <strong>de</strong>s catégories socioprofessionnelle <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> ménages <strong>de</strong> Couëron<br />
35,00%<br />
30,00%<br />
25,00%<br />
20,00%<br />
15,00%<br />
1990<br />
1999<br />
10,00%<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
Agric<br />
Artisans,<br />
comm,<br />
chefs<br />
d'entr.<br />
Cadres,<br />
prof<br />
intellect.<br />
Prof interm Employés Ouvriers Retraités Sans<br />
activité prof<br />
Source : INSEE, RGP 99<br />
La part <strong>de</strong>s catégories sociales avec <strong>de</strong>s revenus un peu plus élevés progresse nettement. Il en est ainsi<br />
pour les catégories intermédiaires (+ 24 % entre 1990 et 1999), dans une moindre mesure pour les cadres<br />
(+ 11 %) . On peut y voir un phénomène d’attractivité <strong>de</strong> la commune pour ces ménages, notamment pour<br />
ce qui concerne la partie ancienne, en bord <strong>de</strong> Loire. S’ajoute à cela, la hausse du coût du logement et <strong>de</strong><br />
l’accession ainsi qu’un report <strong>de</strong> ces ménages vers la périphérie <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>.<br />
CSP du chef <strong>de</strong> ménage en 1999<br />
Couëron N-O Agglo Agglo<br />
Agriculteurs exploitants 0,5% 0,2% 0,2%<br />
Artisans, commerçants, chefs d'entr. 4,4% 4,3% 4,0%<br />
Cadres, professions intellect. sup. 5,9% 12,9% 12,4%<br />
Professions intermédiaires 17,6% 18,9% 17,5%<br />
Employés 9,9% 12,9% 13,1%<br />
Ouvriers 27,9% 18,2% 15,7%<br />
Retraités 27,6% 26,9% 24,9%<br />
Sans activité professionnelle 6,2% 5,7% 12,2%<br />
Source : INSEE RGP 82-90-99<br />
39
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Un taux d’activité en forte progression<br />
En 1999, le taux d’activité <strong>de</strong> Couëron est <strong>de</strong> 46 %, alors qu’il était <strong>de</strong> 41.6 % en 1982, soit une<br />
augmentation <strong>de</strong> 10.6 % sur la pério<strong>de</strong>.<br />
Comme dans la plupart <strong>de</strong>s autres communes du secteur Nord-Ouest, le taux d’activité s’est accru grâce<br />
à la poursuite <strong>de</strong> l’augmentation du taux d’activité <strong>de</strong>s femmes, malgré l’abaissement <strong>de</strong> l’âge du départ<br />
à la retraite.<br />
En effet, les <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong>s femmes étaient actives en 1990, elle sont plus <strong>de</strong>s trois-quarts en 1999. C’est<br />
une progression très soutenue. <strong>Le</strong> taux d’activité féminin <strong>de</strong> Couëron dépasse désormais celui <strong>de</strong><br />
l’agglomération comme celui du secteur Nord-ouest.<br />
On peut y voir les effets <strong>de</strong> la nécessité d’avoir <strong>de</strong>ux salaires pour l’acquisition d’un logement mais aussi,<br />
du développement massif <strong>de</strong>s emplois féminins, très développés dans la commune voisine <strong>de</strong> Saint-<br />
Herblain et dans une moindre mesure, parmi les entreprises <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron.<br />
1982 1990 1999<br />
N-O<br />
Agglo 99 Agglo 99<br />
Taux d'activité 41,6% 43,0% 46,0% 47,0% 46,2%<br />
dont femmes 20 - 59 ans 67,0% 67,6% 77,5% 76,8% 74,0%<br />
dont femmes 20 - 39 ans 67,4% 73,7% 78,2% 75,9% 70,5%<br />
dont femmes 40 - 59 ans 44,7% 60,3% 76,8% 77,6% 78,2%<br />
Source : INSEE RGP 82-90-99<br />
<strong>Le</strong>s Couëronnais sont <strong>de</strong> moins en moins nombreux à travailler dans leur commune <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce. Ainsi,<br />
en 1982, 35 % <strong>de</strong>s actifs occupés travaillaient à Couëron, tandis qu’en 1999 ils ne sont plus que 22.5 %. <strong>Le</strong><br />
report s’est effectué au profit <strong>de</strong> la ville-centre, <strong>Nantes</strong> représentant un pôle d’emplois fort attractif et<br />
dynamique, ainsi que vers Saint Herblain.<br />
Cela engendre <strong>de</strong>s migrations alternantes croissantes qu’il convient <strong>de</strong> prendre en compte dans la<br />
politique <strong>de</strong> déplacements ainsi qu’en termes <strong>de</strong> préservation du cadre <strong>de</strong> vie contre la pollution due au<br />
trafic automobile.<br />
40
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Où travaillaient les 7315 Couëronnais occupés en 1999 ?<br />
NANTES<br />
29 %<br />
Saint Herblain<br />
19 %<br />
COUERON<br />
22.5 % <strong>de</strong>s actifs occupés<br />
travaillent dans leur commune<br />
<strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce<br />
Indre<br />
6 %<br />
Extérieur du département<br />
2.3 %<br />
Orvault, Carquefou,<br />
Sautron<br />
7%<br />
Reste du<br />
département 44<br />
14.2 %<br />
Source : INSEE RGP 99<br />
41
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Synthèse <strong>de</strong>s caractéristiques socio démographiques <strong>de</strong> la population<br />
couëronnaise<br />
La croissance démographique <strong>de</strong> Couëron a connu un pic dans les années 1980 et se maintient à un rythme<br />
<strong>de</strong> 200 personnes <strong>de</strong> plus par an, en moyenne, <strong>de</strong>puis 1999. En 2004, la population est estimée à 18 750<br />
personnes, ce qui en fait une <strong>de</strong>s villes les plus peuplées <strong>de</strong> la communauté urbaine, avec <strong>Nantes</strong>, Orvault,<br />
Saint Herblain, Rezé, Saint Sébastien sur Loire et Vertou.<br />
Afin d’optimiser les équipements publics et <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s logements adaptés, tant aux besoins <strong>de</strong> la<br />
population qu’à <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong> limitation <strong>de</strong> l’étalement urbain dans un souci <strong>de</strong> développement durable,<br />
il convient <strong>de</strong> maîtriser la croissance démographique et d’anticiper les mutations sociologiques et<br />
générationnelles au sein <strong>de</strong> la population.<br />
La croissance est aussi bien due au sol<strong>de</strong> naturel qu’aux arrivées <strong>de</strong> nouveaux habitants. Cette dynamique<br />
est bien équilibrée.<br />
Cependant, malgré le bon taux <strong>de</strong> natalité <strong>de</strong> la commune, le vieillissement <strong>de</strong>s habitants se fait sentir, le<br />
nombre <strong>de</strong> personnes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 60 ans croît et fait chuter l’indice <strong>de</strong> jeunesse à 1.73. Ce chiffre reste<br />
supérieur à celui du secteur nord-ouest (1.55) et à celui <strong>de</strong> l’agglomération (1.4).<br />
Si la part <strong>de</strong>s plus <strong>de</strong> 75 ans augmente pour atteindre 6 % <strong>de</strong> la population en 2004, elle grandit cependant<br />
moins vite que la population dans son ensemble. Il faut néanmoins être vigilant aux besoins croissants <strong>de</strong><br />
ces personnes, en termes <strong>de</strong> logements accessibles, en termes <strong>de</strong> soins médicaux et en termes <strong>de</strong> mobilité.<br />
La taille <strong>de</strong>s ménages diminue, passant <strong>de</strong> 3.04 personnes en moyenne en 1982 à 2.78 en 1999. Phénomène<br />
structurel, le nombre <strong>de</strong> petits ménages augmente et requiert <strong>de</strong>s logements plus petits, parfois en location,<br />
et proches <strong>de</strong>s commodités. Notons que malgré cela, les familles <strong>de</strong> 4 personnes et plus reste gran<strong>de</strong>, soit un<br />
tiers <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s ménages, ce qui est bien supérieur au secteur nord-ouest et à la moyenne<br />
communautaire.<br />
Bien que le sol<strong>de</strong> migratoire soit positif, la mobilité rési<strong>de</strong>ntielle est faible au regard <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s autres<br />
communes <strong>de</strong> l’agglomération. Cependant, elle augmente. La commune attire beaucoup les jeunes<br />
ménages, et d’une manière générale une population issue <strong>de</strong>s classes populaires et moyennes, en cohérence<br />
avec le peuplement traditionnel <strong>de</strong> la commune.<br />
En effet, Couëron est une commune ouvrière, où les chefs <strong>de</strong> ménage appartenant à cette catégorie<br />
socioprofessionnelle représentent plus du quart <strong>de</strong> l’ensemble en 1999. La part <strong>de</strong>s retraités est également<br />
forte, 27.6% <strong>de</strong> la population, ce qui est supérieur aux chiffres du secteur Nord-Ouest et <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
Métropole. <strong>Le</strong>s catégories dîtes supérieures telles que les professions intermédiaires et les cadres voient leur<br />
part augmenter ces <strong>de</strong>rnières années. Cela est dû à la hausse <strong>de</strong>s prix du foncier. Il faudra être attentif à<br />
conserver une mixité sociale permettant l’accueil notamment <strong>de</strong>s jeunes ménages.<br />
<strong>Le</strong> taux d’activité était <strong>de</strong> 46 % en 1999, en hausse <strong>de</strong>puis le précé<strong>de</strong>nt recensement, grâce à l’augmentation<br />
du taux d’activité féminine. Ce phénomène induit <strong>de</strong>s besoins nouveaux en termes <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> d’enfants et en<br />
termes <strong>de</strong> mobilité.<br />
<strong>Le</strong>s Couëronnais travaillent <strong>de</strong> plus en plus à l’extérieur <strong>de</strong> leur commune <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce, impliquant un trafic<br />
automobile plus <strong>de</strong>nse, à défaut d’une <strong>de</strong>sserte en transports collectifs concurrentielle.<br />
42
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
2. L’habitat<br />
<br />
La reprise du parc <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces principales<br />
En 1999, Couëron comptait 6 347 rési<strong>de</strong>nces principales, soit 781 <strong>de</strong> plus qu’en 1990. En 2005, le parc est<br />
composé <strong>de</strong> 7 044 rési<strong>de</strong>nces principales, soit 697 <strong>de</strong> plus qu’en 1999.<br />
Evolution du nombre <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces principales à Couëron<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
4698<br />
5566<br />
6347<br />
7044<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1982 1990 1999 2005<br />
Source : INSEE RGP 99<br />
<strong>Le</strong> parc <strong>de</strong> logements voit le nombre <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces principales en progression plus soutenue <strong>de</strong>puis 1990,<br />
+14 %, par <strong>rapport</strong> à la pério<strong>de</strong> intercensitaire précé<strong>de</strong>nte (+10 %). L’estimation faite (à partir <strong>de</strong> l’analyse<br />
<strong>de</strong> la matrice <strong>de</strong>s taxes d’habitation) au 1er janvier 2004 en dénombre 6 865, en progression annuelle <strong>de</strong><br />
1,6 %.<br />
La quasi absence <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces secondaires et les rares logements vacants, 3,9 %, taux compris entre<br />
celui du secteur Nord-Ouest et celui <strong>de</strong> l’agglomération, traduisent une forte tension du marché <strong>de</strong><br />
l’habitat.<br />
Etat du parc <strong>de</strong> logements et comparaison avec le secteur et l’agglomération<br />
Couëron<br />
1990 Couëron<br />
1999<br />
Secteur<br />
Nord-ouest<br />
1999<br />
<strong>Nantes</strong><br />
Métropole<br />
1999<br />
Rési<strong>de</strong>nces principales 94,8 % 95,3 % 95,9 % 93,6 %<br />
Rési<strong>de</strong>nce secondaire+logement<br />
occasionnel*<br />
Logements vacants 3,7 %<br />
1,5 % 0,8 % 1 %<br />
3,9 %<br />
1,6 %<br />
3,0 % 4,9 %<br />
Source : INSEE RGP<br />
82-90-99 ; * RGP<br />
1990 et 1999<br />
seulement<br />
Total 100,0 % 100,0 % 100 % 100 %<br />
<br />
43
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Un parc en constante progression<br />
L’âge du parc <strong>de</strong> logements <strong>de</strong> Couëron est lié à l’histoire <strong>de</strong> son urbanisation, à l’ancienneté <strong>de</strong><br />
l’occupation humaine <strong>de</strong> la ville. La ville n’a jamais connu <strong>de</strong> développement brusque, massif,<br />
contrairement à Saint-Herblain ou Orvault. Ainsi, Couëron a préservé tout au long du XX ème siècle, une<br />
progression continue, parfois mo<strong>de</strong>ste, mais ne remettant pas en cause l’i<strong>de</strong>ntité communale.<br />
Il reste ainsi un taux non négligeable <strong>de</strong> logements très anciens, construits avant la première guerre<br />
mondiale. Ces logements situés soit dans la partie ancienne du bourg et <strong>de</strong> Port Launay, soit dans les<br />
villages, participent d’une part à l’i<strong>de</strong>ntité couëronnaise et d’autre part à son attractivité auprès <strong>de</strong>s<br />
ménages désireux <strong>de</strong> réinvestir dans l’ancien.<br />
La <strong>de</strong>uxième époque ancienne, entre les <strong>de</strong>ux guerres, compte encore <strong>de</strong> nombreux logements dans la<br />
commune, dans <strong>de</strong>s proportions encore supérieures à celle <strong>de</strong> l’agglomération pourtant marquée par le<br />
poids historique <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> (mais dont les bombar<strong>de</strong>ments ont détruit une forte proportion du bâti<br />
ancien). <strong>Le</strong>s cités ouvrières <strong>de</strong>s années 1920 y contribuent pour une bonne part.<br />
Près <strong>de</strong> la moitié du parc (47.2 %) est postérieure à 1975.<br />
Comparaison <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong>s constructions entre Couëron, le secteur nord-ouest et l’ensemble <strong>de</strong> l’agglomération<br />
30,00%<br />
25,00%<br />
20,00%<br />
15,00%<br />
10,00%<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
avant 1915 1915 - 1948 1949 - 1967 1968 - 1974 1975 - 1981 1982 - 1990 post 1990<br />
Source : INSEE RGP 99<br />
Des travaux ont donc lieu afin <strong>de</strong> mettre aux normes actuelles <strong>de</strong> confort les constructions anciennes. En<br />
1999, il restait encore 92 habitations sans baignoire ni douche. De nombreux logements avaient déjà fait<br />
l’objet <strong>de</strong> réhabilitations <strong>de</strong>puis 1990, car le nombre <strong>de</strong> logements sans douche ni baignoire a chuté <strong>de</strong><br />
67.4 % entre les <strong>de</strong>ux dates.<br />
44
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong>s rési<strong>de</strong>nces principales selon le confort<br />
Confort <strong>de</strong>s logements 1999 %<br />
Evolution <strong>de</strong> 1990 à<br />
1999<br />
Ensemble <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces principales 6 347 100,0 % 14,0 %<br />
Ni baignoire, ni douche 92 1,4 % -67,4 %<br />
Avec chauffage central* 5 782 91,1 % 14,3 %<br />
Sans chauffage central 565 8,9 % 11,0 %<br />
Garage-box-parking** 4 763 75,0 % ///<br />
Deux salles d'eau** 583 9,2 % ///<br />
<br />
Typologie <strong>de</strong> l’habitat<br />
Source : INSEE, RGP 99<br />
Jusqu’à une pério<strong>de</strong> récente, l’essentiel <strong>de</strong>s logements réalisés était en individuel. Ainsi, en 1999, sur les 6<br />
347 rési<strong>de</strong>nces principales, 88.1 % étaient <strong>de</strong>s maisons individuelles et 10.5 % <strong>de</strong>s appartements. En 1990,<br />
les proportions étaient i<strong>de</strong>ntiques.<br />
Depuis quelques années, <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> renouvellement urbain apparaissent dans le centre-ville.<br />
Ainsi, en 2004, sur les 96 logements mis en chantier, 60 étaient <strong>de</strong> l’habitat collectif.<br />
Individuel pur Individuel groupé collectif total<br />
24 12 60 96<br />
<br />
Taille <strong>de</strong>s logements<br />
Source : données DRE<br />
La part <strong>de</strong>s petits logements, 1 à 2 pièces, reste mo<strong>de</strong>ste, un peu plus <strong>de</strong> 10 %. En lien avec la présence<br />
d’un parc <strong>de</strong> logements individuels occupé par leur propriétaire, la taille <strong>de</strong>s logements est élevée. 3<br />
logements sur quatre ont au moins 4 pièces, un petit tiers 5 pièces et plus. Cela est caractéristique <strong>de</strong><br />
l’habitat individuel et d’une population <strong>de</strong> propriétaire mais aux revenus plutôt mo<strong>de</strong>stes.<br />
Entre 1990 et 1999, le nombre <strong>de</strong> grands logements a augmenté, passant <strong>de</strong> 30 % à presque 37 %. En<br />
revanche, la part <strong>de</strong>s petits logements <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 3 pièces a baissé.<br />
Cela va à l’encontre <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s ménages, qui pour sa part, diminue.<br />
45
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Evolution <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s logements couëronnais selon le nombre <strong>de</strong> pièces<br />
40,00%<br />
35,00%<br />
30,00%<br />
25,00%<br />
20,00%<br />
1990<br />
1999<br />
15,00%<br />
10,00%<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus<br />
Source : INSEE RGP 99<br />
Comparaison <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces principales <strong>de</strong> Couëron avec celles du secteur et <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
Métropole<br />
Couëron Secteur nord-ouest Agglomération<br />
1 pièce 1 % 2,2% 9,1%<br />
2 pièces 7,8 % 9,0% 15,3%<br />
3 pièces 19,0 % 18,4% 22,2%<br />
4 pièces 35,4 % 30,1% 25,1%<br />
5 pièces et plus 36,8 % 40,2% 28,3%<br />
Source : INSEE RGP 90-99<br />
Etant donné que la taille <strong>de</strong>s ménages se réduit <strong>de</strong> plus en plus, les opérations d’habitat à venir <strong>de</strong>vraient<br />
favoriser les petits logements, proches <strong>de</strong>s commerces, <strong>de</strong>s services et <strong>de</strong>s transports collectifs.<br />
46
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Comparaison <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s logements et <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s ménages <strong>de</strong> Couëron<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
5 et +<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Tailles <strong>de</strong>s R.P.<br />
Taille <strong>de</strong>s ménages<br />
“5 et +” représente tour à tour le nombre <strong>de</strong> pièces et le nombre <strong>de</strong> personnes<br />
Source : INSEE RGP 99<br />
<br />
Des statuts d’occupation dominés par la propriété<br />
Statut d'occupation<br />
1990 % 1999 %<br />
N-O<br />
Agglo<br />
99 Agglo 99<br />
Propriétaire 4 078 73,3% 4 818 75,9% 67,2% 51,9%<br />
Locataire, dont : 1 341 24,1% 1 432 22,6% 30,9% 45,9%<br />
-Locataire non-HLM +meublés 446 8,0% 501 7,9% 13,5% 27,7%<br />
-Locataire HLM 895 16,1% 931 14,7% 17,4% 18,2%<br />
Logés gratuitement 147 2,6% 97 1,5% 1,9% 2,2%<br />
Source : INSEE RGP 90-99<br />
<strong>Le</strong>s caractéristiques d'occupation <strong>de</strong>s logements <strong>de</strong> Couëron ne dépareillent pas au sein du secteur Nord-<br />
Ouest et périurbain, où domine l’accession en logement individuel.<br />
Seules quelques réalisations récentes viennent modifier légèrement la donne.<br />
47
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> parc est occupé aux <strong>de</strong>ux tiers par leur propriétaire. Ce constat n’est d’ailleurs pas sans poser <strong>de</strong>s<br />
problèmes <strong>de</strong> vieillissement par quartier ou lotissement faute <strong>de</strong> mobilité et <strong>de</strong> renouvellement<br />
démographique.<br />
La part du locatif privé est réduite (notamment T2 et T3) et ne s’est pas non plus accrue dans les<br />
constructions récentes. Il semble que Couëron n’ait d’une part pas été considérée comme un lieu<br />
d’investissement en la matière et qu’en plus, la faible mobilité <strong>de</strong> la population n’ait pas libéré <strong>de</strong><br />
logements qui auraient pu être mis en location ensuite.<br />
<strong>Le</strong> nombre <strong>de</strong> locatifs privés, 7,9% <strong>de</strong> l’ensemble du parc, est le plus faible du secteur Nord-Ouest. Pour<br />
comparaison, cette part est <strong>de</strong> 13,5 % à La Chapelle sur Erdre, <strong>de</strong> 18,3 % à Indre, <strong>de</strong> 14 % à Orvault, <strong>de</strong> 15,6 %<br />
à Saint Herblain.<br />
Construction neuve en 1999 selon le statut d'occupation*<br />
Couëron Secteur Nord Ouest Agglomération<br />
Propriétaires 90,5% 62,1% 41,2%<br />
Locataires non HLM 5,5% 18,7% 43,4%<br />
Locataires HLM 4,0% 19,1% 15,4%<br />
Rési<strong>de</strong>nces principales seulement ; Source : INSEE RGP 99<br />
La faiblesse globale <strong>de</strong> l’offre locative explique la difficulté à maintenir les jeunes ménages (20-29 ans)<br />
dans la commune.<br />
De 2000 à 2003, la répartition <strong>de</strong>s constructions neuves fait apparaître une plus gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong><br />
l’offre :<br />
- les propriétaires occupants en individuel sont toujours majoritaires mais dans une proportion<br />
moindre (53 %) ;<br />
- la part du collectif, y compris en accession, s’est fortement développée atteignant 36 % <strong>de</strong><br />
l’ensemble ;<br />
Un tiers <strong>de</strong>s logements collectifs construits est en accession. Ceci permet <strong>de</strong> diversifier les possibilités<br />
d’accueil en proposant du logement pour les jeunes ménages actifs mais aussi pour les ménages plus<br />
âgés souhaitant ne plus s’occuper d’un grand logement avec jardin.<br />
La part du locatif, tant privé que social, reste mo<strong>de</strong>ste avec 11 % <strong>de</strong>s logements produits.<br />
<strong>Le</strong> coût <strong>de</strong> l’accession constitue également un frein pour les ménages. La part <strong>de</strong>s usagers du prêt à taux<br />
zéro s’est ainsi réduite passant <strong>de</strong> 61 prêts en 1997 à 42 en 2002.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s locatifs sociaux<br />
En 2005, la commune accueille près <strong>de</strong> 16.27 % <strong>de</strong> locatifs sociaux. Cette part a régressé entre 1990 et<br />
1999 du fait d’un faible investissement public dans le locatif social : 4 % <strong>de</strong>s constructions neuves. Ainsi,<br />
la part du parc <strong>de</strong> logements locatifs sociaux au sens <strong>de</strong> la loi SRU en 2004 était <strong>de</strong> 16.55 %, soit 6 locatifs<br />
sociaux <strong>de</strong> plus qu’en 2005.<br />
En 2005, la commune compte 1146 locatifs sociaux. Pour atteindre les 20 % fixés par la loi, elle <strong>de</strong>vrait<br />
disposer <strong>de</strong> 1409 logements <strong>de</strong> ce type. Cela représente donc un déficit <strong>de</strong> 263 logements. Ce déficit<br />
<strong>de</strong>vrait s’atténuer grâce aux opérations d’urbanisme en cours (ZAC) qui imposent la réalisation <strong>de</strong> 20%<br />
minimum <strong>de</strong> logements locatifs sociaux.<br />
48
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Un marché <strong>de</strong> l'habitat <strong>de</strong> plus en plus onéreux.<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron, du fait <strong>de</strong> son caractère populaire et ouvrier, a longtemps été un <strong>de</strong>s sites<br />
d’accès au logement peu cher dans l’agglomération nantaise. Depuis quelques années, faute d’une offre<br />
importante en individuel neuf ou en foncier constructible à la vente, les transactions se portent<br />
essentiellement sur l’ancien.<br />
A la location les prix varient, mais sont tirés à la hausse compte tenu <strong>de</strong> la pression <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> face à<br />
la raréfaction <strong>de</strong>s biens. Selon les agences immobilières en 2006, il n’y a quasiment pas d’appartement à<br />
louer et les prix, s’ils restent mo<strong>de</strong>stes comparés à d’autres communes <strong>de</strong> l’agglomération, commencent<br />
à présenter <strong>de</strong>s signes évi<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> hausse.<br />
<br />
<strong>Le</strong> rythme <strong>de</strong> construction et la satisfaction <strong>de</strong>s besoins<br />
1982/90 1990/99<br />
1 - Logements construits 1 090 880<br />
- par an 136 98<br />
2 - Offre liée au renouvellement 187 93<br />
- par an 23 10<br />
3 - Consommation liée à la variation <strong>de</strong>s Rési<strong>de</strong>nces Secondaires 48 -36<br />
- par an 6 -4<br />
4 - Consommation liée à la variation <strong>de</strong>s Logements Vacants -102 42<br />
- par an -13 5<br />
5 - Consommation liée au <strong>de</strong>sserrement 229 229<br />
- par an 29 25<br />
6 - POINT MORT(1) 362 328<br />
- par an 45 36<br />
CN disponible pour accroissement <strong>de</strong> population = 1-6 728 552<br />
- par an 91 61<br />
Indice <strong>de</strong> construction (2) 8,95 5,73<br />
Agglo 8,29 8,09<br />
(1) Nombre théorique <strong>de</strong> logements permettant <strong>de</strong> conserver le même niveau <strong>de</strong> population<br />
(2) Valeur absolue <strong>de</strong> 2 + 3 + 4+ 5. Construction neuve annuelle moyenne <strong>rapport</strong>ée à la population moyenne <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> (pour mille<br />
habitants)<br />
Source : INSEE RGP 82-90-99<br />
L’indice <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> Couëron s’est réduit dans la décennie 1990, bien inférieur à la moyenne <strong>de</strong><br />
l’agglomération nantaise, alors qu’il présentait un taux bien supérieur dans la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte.<br />
Chaque année, 98 logements ont été construits, 38 <strong>de</strong> moins que dans la décennie précé<strong>de</strong>nte.<br />
10 logements ont disparu chaque année du parc <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces principales.<br />
L’évolution du nombre <strong>de</strong> logements vacants a été très mo<strong>de</strong>ste, en lien avec la pression du marché dans<br />
un contexte d’offre neuve réduite.<br />
La diminution du nombre <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces secondaires a permis d’alimenter à hauteur <strong>de</strong> 4 logements<br />
chaque année le parc <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces principales en plus <strong>de</strong> la construction neuve.<br />
Contrairement aux communes marquées par le vieillissement, les effets du <strong>de</strong>sserrement ont été<br />
mesurés compte tenu <strong>de</strong> la présence importante <strong>de</strong>s familles. La taille moyenne <strong>de</strong>s ménages a continué<br />
à se réduire mais à un rythme plus lent qu’ailleurs dans l’agglomération nantaise.<br />
49
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> point mort annuel, le nombre <strong>de</strong> logements pour satisfaire les différents besoins du parc et <strong>de</strong> la<br />
population en place correspond avec 36 logements à un gros tiers <strong>de</strong> la production annuelle. Par <strong>rapport</strong><br />
à la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte, la situation s’est améliorée avec <strong>de</strong>s effets moindres du <strong>de</strong>sserrement <strong>de</strong>s<br />
ménages (29 logements utilisés chaque année) et un renouvellement plus soutenu (23 logements libérés<br />
chaque année).<br />
Au final <strong>de</strong> 1990 à 1999, 61 logements par an, soit 62 % <strong>de</strong> la construction neuve, ont permis chaque<br />
année d’accueillir <strong>de</strong> nouveaux rési<strong>de</strong>nts. C’est un bon ratio.<br />
Cet effort <strong>de</strong> production (2,7 fois plus élevée que le point mort), a permis l’arrivée significative <strong>de</strong>s 35-54<br />
dans la commune entre 1990 et 1999, avec l’installation <strong>de</strong> ménages avec enfants (notamment <strong>de</strong>s 0/4<br />
ans) se traduisant par une augmentation <strong>de</strong>s effectifs scolaires par effet <strong>de</strong> report dans le temps (Voir<br />
infra).<br />
<strong>Le</strong>s logements mis en chantier <strong>de</strong>puis 1990 jusqu’à 2004 à Couëron<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
source : DRE Sita<strong>de</strong>l<br />
<br />
<strong>Le</strong>s hypothèses d’évolution<br />
Projection <strong>de</strong> l’évolution démographique à l’horizon 2015<br />
COUËRON en 1999 (RGP) en 2004 (estimation base TH) en 2010 en 2015<br />
Pop. Totale 17 821 18 750 19 900 20 920<br />
<strong>Le</strong>s hypothèses d’évolution retenues correspon<strong>de</strong>nt à une poursuite tendancielle du développement<br />
démographique <strong>de</strong>puis 1999 (+1% annuel). La commune s’est fixée comme objectif démographique<br />
plafond 25 000 habitants à l’horizon 2020, ce qui plai<strong>de</strong> en faveur d’une intensification du rythme <strong>de</strong><br />
construction.<br />
Ces objectifs prennent en compte les objectifs dévolus à Couëron dans le cadre <strong>de</strong> la sectorisation du<br />
Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat. L’hypothèse haute (180 logements par an) peut sembler délicate à tenir<br />
immédiatement compte tenu <strong>de</strong>s délais <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s trois Z.A.C. Une fois ces programmes lancés, ils<br />
<strong>de</strong>vraient cependant être atteints aisément.<br />
La diversité affichée <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> logements <strong>de</strong>vrait permettre <strong>de</strong> relancer l’attractivité <strong>de</strong> la ville<br />
auprès <strong>de</strong>s jeunes ménages, en location ou en primo accession.<br />
50
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Vieillissement et estimation <strong>de</strong>s + 75 ans par prolongation <strong>de</strong> tendances<br />
En 1999 (RGP) En 2004<br />
En 2010 En 2015<br />
(estimation TH)<br />
Part <strong>de</strong>s plus <strong>de</strong> 75 ans 5% 6% 7% 8%<br />
Hypothèse d'une augmentation d'1 point tous les 5 ans <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s + <strong>de</strong> 75 ans . Réf. évolution mesurée au niveau<br />
national par l'INSEE entre 1999 et 2004 (Insee Première n° 1001 janv.2005)<br />
Par projection <strong>de</strong> la pyrami<strong>de</strong> <strong>de</strong>s âges <strong>de</strong> 1999, et en référence à la tendance au vieillissement, la part<br />
<strong>de</strong>s plus <strong>de</strong> 75 ans atteindrait 8% à l’horizon 2015 (soit 1 670 personnes).<br />
A noter que plusieurs établissements d’accueil <strong>de</strong>s personnes âgées sont aujourd’hui saturés (avec listes<br />
d’attente) et ne pourraient satisfaire une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> plus forte. Cependant, plusieurs réalisations ou<br />
projets vont permettre d’accroître l’offre en la diversifiant (pas d’hébergement médicalisé mais du<br />
logement <strong>de</strong> plein-pied en centre ville).<br />
En effet, l’adaptation <strong>de</strong> l’offre au vieillissement <strong>de</strong> la population passe par un <strong>plan</strong> d’ensemble<br />
proposant une offre <strong>de</strong> logements adaptée aux personnes âgées, <strong>de</strong>puis le logement banalisé accessible<br />
dans les programmes collectifs jusqu’à la structure médicalisée. C’est tout le sens du projet<br />
intergénérationnel programmé dans le quartier Bessonneau.<br />
En parallèle, la commune <strong>de</strong>vra veiller à ce que les besoins en termes <strong>de</strong> services (soins, services à<br />
domicile, etc.) soient satisfaits. Avec le souci d’un accès aux soins pour tous, il s’agira <strong>de</strong> soutenir le<br />
développement d’une offre <strong>de</strong> proximité <strong>de</strong> qualité. (Ex. création d’une maison <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> médicale) et<br />
d’intégrer <strong>de</strong>s logements adaptés dans les futurs programmes (ZAC) en veillant à l’accessibilité aux<br />
services et à la <strong>de</strong>sserte en transports collectifs.<br />
<strong>Le</strong> développement <strong>de</strong> l’offre pourrait également passer par l’adaptation <strong>de</strong>s logements anciens pour le<br />
maintien à domicile. Une intervention <strong>de</strong> type groupé comme une Opération d’Amélioration <strong>de</strong> l’Habitat<br />
(OPAH) est à cet effet prévue, notamment dans le centre-ville ancien.<br />
Objectifs en matière <strong>de</strong> production <strong>de</strong> logements à l’horizon 2015<br />
Dans le cadre du PLH, les objectifs retenus par la commune sont <strong>de</strong> 170 à 180 logements neufs par an.<br />
Se conformant aux objectifs fixés par le PLH la commune souhaite par la construction neuve diversifier<br />
son parc <strong>de</strong> logement selon la répartition suivante :<br />
Collectif ➜ 26%<br />
Individuel groupé ➜ 20%<br />
Individuel diffus ➜ 54%<br />
La production <strong>de</strong> logement social <strong>de</strong>vrait atteindre une proportion <strong>de</strong> 20 % du total quelle que soit sa<br />
forme bâtie afin d’améliorer la mixité sociale <strong>de</strong> la commune. 400 logements sociaux sont ainsi projetés<br />
dans les trois ZAC, avec pour enjeux <strong>de</strong> permettre la réalisation <strong>de</strong> parcours rési<strong>de</strong>ntiels dans la<br />
commune et d’améliorer la diversité dans la composition sociale <strong>de</strong>s quartiers :<br />
- en favorisant la diversité <strong>de</strong>s formes d’habitat produites ;<br />
- en permettant l’accueil <strong>de</strong> jeunes ménages (locatif dont social, primo accession) ;<br />
- en proposant une offre adaptée aux personnes âgées en recherchant la mixité<br />
intergénérationnelle.<br />
51
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Impacts du développement <strong>de</strong> l’habitat sur les besoins en équipements<br />
(Source : AURES)<br />
Sur la base <strong>de</strong> 180 nouveaux logements par an, facilitant l’installation <strong>de</strong> jeunes ménages, les nouveaux<br />
besoins en mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> s’élèveraient à 20 places par an. Mais le vieillissement global <strong>de</strong> la population<br />
pourrait tempérer cette augmentation.<br />
Sur cette même base, on peut estimer à 70 le nombre <strong>de</strong> nouveaux élèves à scolariser en primaire chaque<br />
année. Cette approche prospective est cependant à rapprocher d’un effet <strong>de</strong> report à court terme <strong>de</strong> la<br />
baisse <strong>de</strong>s effectifs <strong>de</strong> maternelle vers l’élémentaire, à moins que ne se confirme dans le temps l’arrivée<br />
<strong>de</strong>s ménages plus âgés ayant <strong>de</strong>s enfants <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 6 ans ou en secon<strong>de</strong> accession avec adolescents<br />
voire plus d’enfant au domicile familial.<br />
L’évolution <strong>de</strong>s effectifs (pré-) scolaires est fortement dépendante <strong>de</strong> la structuration du parc <strong>de</strong><br />
logements qui sera développée.<br />
L’accueil <strong>de</strong> la Petite Enfance<br />
<strong>Le</strong> développement <strong>de</strong> l’offre est en lien avec le développement <strong>de</strong>s nouveaux programmes d’habitat . Au<br />
centre ville : création d’une crèche associative intégrée au programme <strong>de</strong> l’espace Intergénérationnel.<br />
Une réflexion est également en cours sur l’évolution et l’adaptation aux besoins <strong>de</strong> l’offre existante (une<br />
halte-gar<strong>de</strong>rie intégrée au centre socio-culturel Henri Normand). Il pourrait y avoir une offre <strong>de</strong> type<br />
multi-accueil.<br />
<strong>Le</strong>s équipements scolaires<br />
Évolution <strong>de</strong>s effectifs élémentaires<br />
<strong>de</strong>puis 1995 à Couëron<br />
1200<br />
1175<br />
1100<br />
1000<br />
900<br />
1012<br />
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04<br />
Annˇes scolaires<br />
A la Chabossière, l’absorption <strong>de</strong>s nouveaux effectifs par les écoles existantes (G.S. Métairie, Maternelle<br />
Jean Macé, écoles élémentaires Paul Bert et Aristi<strong>de</strong> Briand) semble envisageable en renouvellement <strong>de</strong>s<br />
générations vieillissantes.<br />
Dans le centre-ville, le futur groupe scolaire inscrit dans la ZAC Ouest centre-ville permettra au moins<br />
dans un premier temps d’absorber les sureffectifs <strong>de</strong>s écoles du centre bourg puis d’accueillir les<br />
nouveaux habitants.<br />
52
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Synthèse <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> l’habitat<br />
En 2005, Couëron comptait 7 044 rési<strong>de</strong>nces principales, soit une augmentation <strong>de</strong> 11 % <strong>de</strong>puis 1999. Depuis<br />
le début du XXème siècle, le rythme <strong>de</strong> construction est continu, sans véritable à-coup. Ainsi, la commune<br />
compte <strong>de</strong> nombreux logements anciens, datant d’avant 1945, et faisant l’objet <strong>de</strong> réhabilitations. En effet,<br />
ce marché attire beaucoup les jeunes ménages, en quête <strong>de</strong> logements <strong>de</strong> caractère à prix abordable. Ces<br />
logements anciens sont surtout situés dans le bourg historique et dans les villages. Parallèlement, presque la<br />
moitié du parc est postérieur à 1975, induisant <strong>de</strong>s normes <strong>de</strong> confort et d’hygiène correctes.<br />
En 1999, 88 % <strong>de</strong>s logements étaient encore <strong>de</strong>s maisons individuelles, et 76 % du parc était occupé par les<br />
propriétaires. <strong>Le</strong> manque <strong>de</strong> logements collectifs et / ou locatifs a <strong>de</strong>s répercussions néfastes sur l’accueil <strong>de</strong><br />
jeunes ménages, aux revenus mo<strong>de</strong>stes. De plus, les logements sont grands et seulement un logement sur 4<br />
comportait en 1999 moins <strong>de</strong> 4 pièces. Avec 16 % <strong>de</strong> logements sociaux, la commune ne répond pas encore<br />
aux objectifs <strong>de</strong> la loi SRU, mais impose 20 % <strong>de</strong> locatifs sociaux dans chaque nouvelle opération (400 sont<br />
prévus au sein <strong>de</strong>s 3 ZAC).<br />
La commune s’attache désormais à favoriser la construction et le renouvellement <strong>de</strong> logements en collectifs<br />
et en individuels groupés, ainsi qu’en locatifs sociaux et privés. Cependant, moins d’efforts sont fournis en<br />
direction <strong>de</strong>s petits logements, pourtant <strong>de</strong> plus en plus nécessaires face au <strong>de</strong>sserrement <strong>de</strong>s familles. De<br />
manière générale, la diversification <strong>de</strong>s formes urbaines, la mixité sociale et fonctionnelle et l’élargissement<br />
<strong>de</strong> la palette <strong>de</strong>s statuts d’occupation doivent s’intensifier, dans le respect <strong>de</strong>s objectifs assignés du<br />
Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat.<br />
<strong>Le</strong>s prix du marché <strong>de</strong> l’immobilier sont <strong>de</strong> plus en plus élevés, comme dans toute l’agglomération nantaise.<br />
La raréfaction <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces secondaires et <strong>de</strong>s logements vacants en atteste. Ils constituent un facteur<br />
bloquant pour l’installation <strong>de</strong>s personnes aux revenus mo<strong>de</strong>stes, <strong>de</strong>s jeunes et <strong>de</strong> manière générale <strong>de</strong>s<br />
classes populaires. La commune veillera à conserver sa part d’i<strong>de</strong>ntité ouvrière et à faciliter l’accès au<br />
logement pour tous, en proposant <strong>de</strong>s solutions <strong>de</strong> parcours rési<strong>de</strong>ntiels.<br />
53
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
3. <strong>Le</strong>s activités économiques et l’emploi<br />
<br />
<strong>Le</strong> contexte : une métropole dynamique<br />
<strong>Le</strong> développement économique <strong>de</strong> Couëron s’inscrit aujourd’hui dans le contexte <strong>de</strong> la « Métropole<br />
Atlantique » <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Saint-Nazaire. Avec ses 760 000 habitants, dont 550 000 dans l’agglomération<br />
nantaise, la métropole est au 36 ème rang européen, <strong>de</strong>vant <strong>de</strong>s villes comme Liverpool, Bologne ou Bilbao,<br />
proche d’Amsterdam ou <strong>de</strong> Stockholm.<br />
Dotée du premier port français sur l’Atlantique, d’un aéroport international <strong>de</strong> 2 millions <strong>de</strong> passagers et<br />
du TGV, la métropole connaît un développement économique important, qui contribue à son attractivité<br />
démographique exceptionnelle. L’agglomération <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> a connu la plus forte croissance <strong>de</strong>s villes<br />
françaises entre 1990 et 1999.<br />
La métropole compte en 1998 plus <strong>de</strong> 350 000 emplois, dont plus <strong>de</strong> 67% dans l’agglomération nantaise.<br />
L’industrie <strong>de</strong> Loire-Atlantique a créé plus <strong>de</strong> 5 000 emplois nets <strong>de</strong> 1994 à 2000, et le secteur tertiaire a<br />
généré la création <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 30 000 emplois, tout cela très largement au sein <strong>de</strong> la métropole. 7,5% <strong>de</strong>s<br />
créations d’emplois en France entre 1990 et 2000 ont eu lieu dans la métropole <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Saint-Nazaire<br />
(hausse <strong>de</strong> 5% <strong>de</strong>s effectifs salariés).<br />
La répartition <strong>de</strong>s emplois <strong>de</strong> la métropole est assez équilibrée : 19% sont encore industriels, 59% sont<br />
tertiaires, 14% relèvent du commerce et 7% du bâtiment et <strong>de</strong>s travaux publics. La proportion d’emplois<br />
commerciaux semble avoir augmenté <strong>de</strong>puis.<br />
<br />
Un pôle d’emplois qui se développe<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron est un vieux site d’activités. Depuis quelques années, ceux-ci ont évolué et leur<br />
<strong>local</strong>isation géographique a changé.<br />
<strong>Le</strong> nombre d’emplois a donc bondi <strong>de</strong>puis 1990, à un rythme bien supérieur à celui <strong>de</strong> l’agglomération ou<br />
du secteur Nord-Ouest, pourtant bien placé dans la métropole.<br />
Evolution du nombre d’emplois à Couëron<br />
1990 1999<br />
Evolution<br />
1990 - 1999<br />
Secteur nordouest<br />
Agglomération<br />
Emplois 3160 4364 + 38,1% + 18 % + 12 %<br />
Actifs 7 020 8 201 + 17 % + 8 % + 11 %<br />
Source : RGP 1990-1999<br />
Parallèlement, le nombre d’actifs n’a que faiblement augmenté. Dès lors, le ratio nombre d’emplois /<br />
nombre d’actifs s’est accru pour atteindre 0,53, ce qui est un taux assez élevé dans l’agglomération bien<br />
que très mo<strong>de</strong>ste par <strong>rapport</strong> à <strong>Nantes</strong> ou Saint-Herblain.<br />
54
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Des sites dispersés dans la commune<br />
<strong>Le</strong>s sites d’activités près <strong>de</strong> la Loire<br />
- <strong>Le</strong> site <strong>de</strong> production métallurgique d’Arcelor est situé à cheval sur les communes d’Indre et <strong>de</strong><br />
Couëron. Il fait partie <strong>de</strong> cette ancienne continuité industrielle ligérienne développée au XIXème<br />
siècle. La partie Ouest <strong>de</strong> cette zone est séparée <strong>de</strong> l’agglomération par l’étier <strong>de</strong> Beaulieu, qui<br />
crée une superficie inondable à extraire <strong>de</strong> la zone ;<br />
- la zone d’activités <strong>de</strong> la Navale est située en amont du centre ville, le long <strong>de</strong> la RD 17. Elle<br />
accueille quelques PME-PMI au sein d’un lotissement artisanal, en partie dans les locaux d’une<br />
ancienne cité ouvrière ;<br />
- la Z.A. du Paradis est une petite zone artisanale située en aval du centre ville, en faça<strong>de</strong> sur le<br />
fleuve. Elle accueille quelques entreprises diverses. Elle nécessiterait une action <strong>de</strong><br />
requalification ;<br />
- au pied du centre-ville, quai Emile Paraf, quelques entreprises industrielles subsistent à l’est du<br />
pied <strong>de</strong> la Tour à Plomb. A l’ouest <strong>de</strong> cette même Tour, les entreprises existant encore sont en<br />
cours <strong>de</strong> re<strong>local</strong>isation pour faire place à une opération <strong>de</strong> renouvellement urbain au profit <strong>de</strong><br />
l’habitat ;<br />
- au Sud <strong>de</strong> la Chabossière, le dépôt d’essence <strong>de</strong>s armées est toujours en activité.<br />
<strong>Le</strong> parc d’activités <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron<br />
L’ensemble du secteur se situe au croisement <strong>de</strong> la RD 101 et <strong>de</strong> la RD 201, barreau <strong>de</strong> liaison entre le<br />
périphérique et la RN 165. Elle a une vocation industrielle et <strong>de</strong> logistique du fait <strong>de</strong> son positionnement.<br />
Elle prolonge tout un chapelet <strong>de</strong> zones d’activités im<strong>plan</strong>tées <strong>de</strong> part et d’autre <strong>de</strong> la RD 201 jusqu’à<br />
Atlantis. Elle est éloignée <strong>de</strong>s zones urbaines <strong>de</strong> Couëron et non-accessible par les transports collectifs.<br />
Zone d’intérêt communautaire à vocation d’accueil d’entreprises industrielles, <strong>de</strong> logistique et <strong>de</strong><br />
transport, elle compte environ 2200 emplois. L’importance en termes d’emplois est fortement liée à la<br />
présence d’entreprises <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> l’artisanat, <strong>de</strong> l’industrie et <strong>de</strong> la construction.<br />
Ces espaces regroupent plus <strong>de</strong> 150 établissements différents avec la sur-représentation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
secteurs : les services aux entreprises (30 %) et le commerce <strong>de</strong> gros (17 %).<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la ZAC dite <strong>de</strong>s « Hauts <strong>de</strong> Couëron 3 », <strong>Nantes</strong> Métropole a pour ambition d’organiser<br />
l’extension <strong>de</strong> ce parc d’activités en améliorant le fonctionnement d’ensemble. Une première tranche <strong>de</strong><br />
35 ha est envisagée pour 2008.<br />
<br />
<strong>Le</strong> secteur <strong>de</strong> la Croix Gicquiau<br />
Situé au nord <strong>de</strong> la RD 101, l’extension prévue dans le cadre <strong>de</strong> la ZAC <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron 3 permettra<br />
l’accueil <strong>de</strong> PME-PMI en particulier liées à la logistique.<br />
<br />
<strong>Le</strong> secteur <strong>de</strong> la Martinière<br />
Ce secteur est programmé en <strong>de</strong>rnier dans le cadre <strong>de</strong> la ZAC <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron 3.<br />
<br />
<strong>Le</strong> secteur du Moulin du Bois David<br />
L’extension programmée au Sud <strong>de</strong> la zone actuelle sera reliée à la ZAC <strong>de</strong> la Lorie présente à Saint-<br />
Herblain. Il existe un espace boisé à intégrer dans le projet d’aménagement.<br />
<br />
le secteur du Pan Loup<br />
Il se trouve en-<strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la ZAC, mais sur le même site. Lotissement privé créé en 1989, il est situé au<br />
contact <strong>de</strong> la ZAC <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron, mais présente un aménagement urbain <strong>de</strong>s plus sommaire.<br />
De petits sites dispersés le long <strong>de</strong> la rue du sta<strong>de</strong>, <strong>de</strong> la RD 101 et <strong>de</strong> la RD 26<br />
Quelques petites zones d’activités, souvent dédiées à une seule entreprise, existent le long <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
axes <strong>de</strong> circulation.<br />
55
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s emplois tertiaires en développement<br />
<strong>Le</strong> développement <strong>de</strong>s activités se pratique donc essentiellement sur le site <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron. Hors<br />
celui-ci connaît le mouvement <strong>de</strong> tertiarisation qui a déjà touché la commune voisine <strong>de</strong> Saint Herblain.<br />
<strong>Le</strong>s 156 entreprises installées dans le secteur se répartissent en :<br />
• 37 établissements à vocation d’artisanat, industrie, construction, soit 24 % <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> la<br />
zone,<br />
• 42 commerces pour 27 % <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> la zone,<br />
• 77 entreprises <strong>de</strong> services représentant 49 % <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> la zone.<br />
<br />
Des migrations alternantes développées<br />
<strong>Le</strong> nombre d’emplois offerts sur le territoire communal n’entre plus en ligne <strong>de</strong> compte dans le fait <strong>de</strong><br />
travailler ou pas sur sa commune <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce. Ceci était vrai quand il n’y avait pas <strong>de</strong> moyens <strong>de</strong><br />
transport motorisés. Couëron abritait ainsi ses propres actifs et ceux <strong>de</strong>s forges <strong>de</strong> Basse Indre.<br />
Désormais l’emploi se conjugue à l’échelle <strong>de</strong> l’agglomération et au-<strong>de</strong>là.<br />
La distorsion entre la création d’emplois et les actifs sortant <strong>de</strong> la commune pour aller travailler n’a donc<br />
cessé <strong>de</strong> se réduire à un petit rythme et concerne encore 1 645 personnes.<br />
% d’actifs travaillant dans leur commune<br />
<strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce 1 982 1 990 1 999<br />
Couëron 32,0% 23,2% 20,1%<br />
Secteur N-O Agglo 26,7% 25,6% 22,7%<br />
Agglo 49,3% 44,0% 37,7%<br />
Source : INSEE RGP 99<br />
56
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> flux d’actifs le plus important est bien évi<strong>de</strong>mment avec <strong>Nantes</strong> (2126 actifs), bien que la commune en<br />
soit distante d’une quinzaine <strong>de</strong> km. Dans l’autre sens, la commune attire elle aussi <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong><br />
nantais : 700 personnes y viennent tous les jours <strong>de</strong>puis <strong>Nantes</strong>.<br />
Saint-Herblain, commune limitrophe et pôle d’emplois, constitue le <strong>de</strong>uxième site d’emplois <strong>de</strong>s actifs<br />
couëronnais (1478 personnes). <strong>Le</strong> mouvement inverse est beaucoup plus mo<strong>de</strong>ste.<br />
Il y a également beaucoup <strong>de</strong> migrations alternantes avec le reste du secteur Nord-Ouest, Sautron et<br />
Orvault sont proches, très accessibles <strong>de</strong>puis le périphérique.<br />
Enfin, la commune a beaucoup d’échanges avec l’extérieur <strong>de</strong> l’agglomération, tant au Nord qu’au Sud<br />
<strong>de</strong> la Loire, aidée en cela par la liaison assurée par le bac.<br />
<br />
Une activité agricole dynamique<br />
(source : diagnostic agricole, 2004, Chambre d’Agriculture pour la C.U.)<br />
La commune est fortement valorisée par l’agriculture notamment toute la partie du plateau bocager<br />
tandis que les prés marais constituent un site pour l’élevage extensif .<br />
La superficie communale étant vaste, les surfaces valorisées par l’activité agricole ne sont pas<br />
négligeables : 1815 ha sont mis en valeur par l’agriculture dont 1215 ha par les exploitations <strong>de</strong> la<br />
commune et 600 ha par 8 exploitations extérieures. La protection <strong>de</strong>s terres au POS a été assurée par le<br />
zonage NC pour 2070 ha, soit 46 % <strong>de</strong> la superficie communale, et plus ponctuellement par la zone ND<br />
sur 1330 ha. . <strong>Le</strong>s friches sont cependant présentes du fait d’une rétention foncière liée à un gel spéculatif<br />
dans l’attente d’un classement <strong>de</strong>s terres en zone urbanisable, en particulier sur les franges <strong>de</strong>s<br />
hameaux. C’est pourquoi la Surface Agricole Utilisée est très inférieure au potentiel offert. De plus<br />
certains types d’activités, notamment équestre, consomment fortement du foncier. Pourtant 8<br />
exploitants ont exprimé le souhait d’augmenter leur SAU.<br />
La forte <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong>s quotas laitiers (2 800 000 litres auxquels il faut ajouter les références laitières <strong>de</strong>s<br />
exploitations hors commune) allié au dynamisme <strong>de</strong>s exploitants communaux expliquent la bonne<br />
santé agricole avec la présence <strong>de</strong> 28 exploitations agricoles. L'activité agricole s’organise autour <strong>de</strong> 40<br />
chefs d'exploitation.<br />
L'agriculture fait travailler en 2004, 48 actifs permanents dont 8 salariés. 25 d’entre eux exercent à plein<br />
temps, 22 autres chefs d'exploitation à plein temps ont leur siège d’exploitation en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la<br />
commune.<br />
L'organisation <strong>de</strong>s exploitations est diverse :<br />
- 17 sont en exploitation individuelle ;<br />
- 5 en SCEA ;<br />
- 3 en GAEC ;<br />
- 2 en EARL.<br />
La moyenne d’âge <strong>de</strong>s chefs d’exploitation est jeune, 44 ans ; 1/3 <strong>de</strong>s chefs d’exploitation a entre 40 et 44<br />
ans, en lien avec un fort renouvellement qui s’est effectué au milieu <strong>de</strong>s années 80 ; au total, 57 % d’entre<br />
eux a moins <strong>de</strong> 45 ans. La question <strong>de</strong> la reprise et <strong>de</strong> la non transmission <strong>de</strong>s exploitations concerne<br />
donc seulement <strong>de</strong>ux sièges. Ces <strong>de</strong>ux exploitants ne disposent pas selon eux <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> production<br />
suffisants pour pérenniser une activité.<br />
Quatre exploitants sont également concernés par la transmission <strong>de</strong> leur exploitation, mais témoignent<br />
en 2004 d’une volonté <strong>de</strong> la transmettre.<br />
57
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong>s productions agricoles :<br />
Production laitière<br />
14 ateliers<br />
455 vaches laitières pour 2 760 000 litres <strong>de</strong> quotas laitiers<br />
Vian<strong>de</strong> bovine<br />
10 ateliers<br />
337 vaches allaitantes<br />
280 PMTVA<br />
Chevaux<br />
2 ateliers d’élevage<br />
1 atelier <strong>de</strong> pension avec 20 chevaux<br />
1 centre équestre<br />
Ovins<br />
1 atelier<br />
50 moutons<br />
Volaille<br />
Maraîchage<br />
Pépinière<br />
1 atelier pour 400 m2<br />
3 ateliers pour 21,5 ha<br />
1 atelier<br />
4 ha spécialisés en <strong>plan</strong>tes tropicales<br />
Un atelier= une unité <strong>de</strong> production, chaque exploitation pouvant en compter plusieurs.<br />
PMTVA = Prime au maintien du troupeau vaches allaitantes<br />
L'activité agricole est dominée par l'élevage bovin, notamment laitier et la vian<strong>de</strong>.<br />
La proximité d’un bassin <strong>de</strong> clientèle permet à l’agriculture couëronnaise <strong>de</strong> diversifier ses débouchés <strong>de</strong><br />
productions par la pratique <strong>de</strong> la vente directe.<br />
10 exploitations la pratiquent sur le siège ou dans <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s et moyennes surfaces. Parmi elles, 6 sont<br />
en vian<strong>de</strong> bovine, 2 en production <strong>de</strong> légumes, 1 en lait et fromage, 1 en lait et œufs.<br />
Concernant la mise aux normes <strong>de</strong>s bâtiments d’élevage, 6 exploitations soumises au régime <strong>de</strong>s<br />
installations classées l’avaient effectué ; 3 <strong>de</strong>vaient le faire.<br />
Parmi les exploitations soumises au règlement sanitaire départemental, 6 l’avaient faite et 9 <strong>de</strong>vaient s’y<br />
engager. La chambre d’agriculture note que les exploitations <strong>de</strong>vant faire leur mises aux normes<br />
n’étaient pas dans <strong>de</strong>s situations d’enclavement lourd vis-à-vis <strong>de</strong> l’habitat.<br />
Il est à noter cependant que 20 exploitations sont situées à moins <strong>de</strong> 100 mètres <strong>de</strong> l'habitation d'un<br />
tiers non agricole, dont 14 à moins <strong>de</strong> 50 mètres.<br />
Da manière qualitative pour la Chambre d'Agriculture, l'agriculture couëronnaise apparaît dynamique<br />
avec <strong>de</strong>s droits à produire suffisant, l’adaptation à l’environnement périurbain par la pratique <strong>de</strong> la vente<br />
directe ainsi que la fonctionnalité <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> production.<br />
58
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
4. <strong>Le</strong>s déplacements<br />
<br />
Organisation <strong>de</strong> la trame viaire départementale<br />
<strong>Le</strong> schéma routier départemental, approuvé par le Conseil général le 21 mars 2006, structure le réseau en<br />
trois niveaux :<br />
−<br />
−<br />
−<br />
<strong>Le</strong> réseau majeur qui complète le réseau national et assure le trafic <strong>de</strong> tansit : ce sont les routes<br />
principales classées en catégorie 1 ou 2 ;<br />
<strong>Le</strong> réseau <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte <strong>local</strong>e qui assure la <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> proximité, l’irrigation fine du territoire à<br />
partir du réseau majeur ;<br />
<strong>Le</strong> réseau périurbain départemental <strong>de</strong> l’agglomération qui assure la liaison entre les principaux<br />
pôles périurbains, le réseau majeur et les points d’échange intermodaux.<br />
<strong>Le</strong> long <strong>de</strong> ces voies et du réseau national, <strong>de</strong>s reculs par <strong>rapport</strong> à l’axe, hors zones urbanisées, sont<br />
préconisés selon les types <strong>de</strong> voiries :<br />
Liaisons structurantes<br />
Routes principales <strong>de</strong> catégorie 1<br />
Routes principales <strong>de</strong> catégorie 2<br />
Réseau périurbain<br />
Autres RD<br />
100 m (habitat) – 50m (activités)<br />
50 mètres<br />
35 mètres<br />
25 mètres<br />
25 mètres<br />
59
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Ce qui se traduit sur le territoire communal comme suit.<br />
<strong>Le</strong> long <strong>de</strong> la RN 444, hors agglomération, l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions doit respecter un recul, par<br />
<strong>rapport</strong> à l’axe <strong>de</strong> la voie, d’un minimum <strong>de</strong> :<br />
- 100 mètres pour les constructions et installations à <strong>de</strong>stination d’habitat ;<br />
- 50 mètres pour les constructions et installations à <strong>de</strong>stination d’activités ;<br />
- 30 mètres par <strong>rapport</strong> aux bretelles d’échangeurs.<br />
<strong>Le</strong> long <strong>de</strong> la RD 101, hors agglomération, l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions doit respecter un recul,<br />
par <strong>rapport</strong> à l’axe <strong>de</strong> la voie, d’un minimum <strong>de</strong> :<br />
- 50 mètres pour les constructions et installations à <strong>de</strong>stination d’habitat ou d’activités ;<br />
- 30 mètres par <strong>rapport</strong> aux bretelles d’échangeurs.<br />
Toutefois, ce recul peut être réduit à 20 mètres lorsqu’il s’agit d'installations nécessaires au<br />
service public d'exploitation et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la voie.<br />
<strong>Le</strong> long <strong>de</strong> la RD17, hors agglomération, l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions doit respecter un recul,<br />
par <strong>rapport</strong> à l’axe <strong>de</strong> la voie, d’au moins 35 mètres.<br />
Toutefois, ce recul peut être réduit à 20 mètres lorsqu’il s’agit d'installations nécessaires au<br />
service public d'exploitation et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la voie.<br />
<strong>Le</strong> long <strong>de</strong>s RD26, 81, 91, 107, 426, 517 et 617, hors agglomération, l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions<br />
doit respecter un recul, par <strong>rapport</strong> à l’axe <strong>de</strong> la voie, d’au moins 25 mètres.<br />
Toutefois, ce recul peut être réduit à 15 mètres lorsqu’il s’agit d'installations nécessaires au<br />
service public d'exploitation et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la voie.<br />
60
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Un maillage routier <strong>local</strong> à structurer<br />
La commune est <strong>de</strong>sservie par un maillage <strong>de</strong> voies <strong>de</strong> tous types et <strong>de</strong> qualité diverse qui quadrillent le<br />
territoire d’Est en Ouest :<br />
- La RN 165, inaccessible <strong>de</strong>puis le Nord (accès à l’échangeur <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron) ;<br />
- La RD 101, sur une ligne <strong>de</strong> crête du Sillon <strong>de</strong> Bretagne ;<br />
- La RD 17 qui traverse l’agglomération et structure le développement urbain <strong>de</strong> la Chabossière.<br />
Passée le centre urbain, elle prend une orientation Nord pour rejoindre la RD 101.<br />
- la RD 107 <strong>de</strong>ssert la commune dans sa partie sud <strong>de</strong>puis <strong>Nantes</strong> et remonte à travers Couëron<br />
vers les hauteurs du bocage et la route <strong>de</strong> Saint Etienne <strong>de</strong> Montluc.<br />
<strong>Le</strong> maillage du Nord au Sud repose sur :<br />
- La rue du sta<strong>de</strong> entre la Chabossière et les Hauts <strong>de</strong> Couëron. Bien que traversant une partie<br />
urbanisée, elle fait l’objet d’un important trafic journalier ;<br />
- La RD 26 relie le centre-ville et la gare au bourg <strong>de</strong> Sautron en passant sous la RN 165 ;<br />
- La RD 81 <strong>de</strong>ssert par l’ouest la zone rurale avant <strong>de</strong> rejoindre la RD 965 et <strong>de</strong> poursuivre vers<br />
Vigneux <strong>de</strong> Bretagne ;<br />
- La RD 91 traverse les quartiers ouest <strong>de</strong> Couëron et mène au bac ; la <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> la ZAC ouest<br />
centre-ville s’accrochera sur cette départementale ;<br />
- Enfin le bac, dont l’embarcadère est situé à l’extrémité ouest <strong>de</strong>s quais, assure <strong>de</strong>s traversées<br />
régulières vers <strong>Le</strong> Pellerin.<br />
Ce réseau est doublé d’un tissu <strong>de</strong> voies communales qui <strong>de</strong>sservent l’ensemble du bâti dispersé et<br />
créent <strong>de</strong>s passages privilégiés pour se rendre à Saint Herblain ou Sautron.<br />
<strong>Le</strong>s <strong>de</strong>ux zones agglomérées sont elles aussi dotées d’un réseau fin <strong>de</strong> voies, étroites dans la partie la plus<br />
ancienne, puis plus larges pour celles dont sont parties les extensions <strong>de</strong> l’urbanisation. Cependant face à<br />
l’évolution démographique et au renforcement <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong> la voiture, certaines <strong>de</strong> ces rues doivent<br />
faire l’objet d’un réaménagement voire d’une restructuration. C’est le cas du boulevard <strong>de</strong> l’Europe, axe<br />
tracé en diagonale en appui sur plusieurs tronçons <strong>de</strong> voies <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte pour créer une vraie liaison inter<br />
quartier.<br />
Il existe actuellement 4 franchissements <strong>de</strong> la voie ferrée dans le centre <strong>de</strong> Couëron relativement proches<br />
les uns <strong>de</strong>s autres mais peu valorisés. Il s’agit donc <strong>de</strong> valoriser en priorité ces franchissements avant d’en<br />
créer d’autres.<br />
<strong>Le</strong>s extensions pavillonnaires se sont accompagnées d’un réseau classique <strong>de</strong> voies avec impasses et<br />
parfois une sur largeur .<br />
<strong>Le</strong>s enjeux pour la voirie urbaine sont <strong>de</strong> restructurer la voirie principale et <strong>de</strong> multiplier les parcours<br />
possibles pour éviter <strong>de</strong> faire passer tous les véhicules par le centre-ville.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s transports collectifs<br />
Commune éloignée du centre <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>, la <strong>de</strong>sserte repose sur <strong>de</strong>s connexions <strong>de</strong> réseaux qui mettent le<br />
centre a moins d’une <strong>de</strong>mi-heure <strong>de</strong> Couëron via le bus-express. <strong>Le</strong>s <strong>de</strong>ux autres lignes <strong>de</strong> bus (91, 84) qui<br />
<strong>de</strong>sservent Couëron traversent en effet toutes les <strong>de</strong>ux le bourg <strong>de</strong> Saint Herblain avant <strong>de</strong> rejoindre la<br />
ligne 1 du tramway.<br />
La ligne 91 débute à l’appontement du bac ou à partir <strong>de</strong> Bougon puis traverse le centre ville et <strong>de</strong>ssert la<br />
Chabossière par la RD 17.<br />
La ligne 84 part <strong>de</strong> la Sinière et rejoint l’itinéraire <strong>de</strong> la ligne précé<strong>de</strong>nte dès la Chabossière.<br />
61
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Ces <strong>de</strong>ux lignes ne <strong>de</strong>sservent donc pas les principales zones d’activités <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong>puis le bourg,<br />
ni ne relie cette zone d’activités à celle voisine <strong>de</strong> la Lorie.<br />
Un nouvel itinéraire <strong>de</strong> bus permet <strong>de</strong> <strong>de</strong>sservir désormais la gare <strong>de</strong> Couëron. La ville désire également<br />
<strong>de</strong>sservir les bords <strong>de</strong> Loire.<br />
<strong>Le</strong> train <strong>de</strong>ssert le centre ville <strong>de</strong> Couëron avec une accentuation <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong>s trains dans le cadre<br />
<strong>de</strong> la mise en place du TER (16 allers-retours en 2005). <strong>Le</strong>s trains ne s’arrêtent pas en revanche à la<br />
Chabossière. La gare du centre-ville, d’ailleurs excentrée, est assez discrète dans le paysage urbain et son<br />
accès assez confi<strong>de</strong>ntiel. Ceci peut expliquer un usage encore modéré <strong>de</strong> ce moyen <strong>de</strong> transport.<br />
<br />
<strong>Le</strong> stationnement<br />
La capacité <strong>de</strong> stationnement en centre-ville est réduite du fait <strong>de</strong> la configuration <strong>de</strong> la voirie. <strong>Le</strong> centre<br />
est percé <strong>de</strong> venelles qui en font son charme et sont peu accessibles aux voitures. Peu éloignée, la place<br />
De Gaulle a été aménagée en préservant un vaste espace <strong>de</strong> stationnement aérien. Pour autant le<br />
stationnement <strong>de</strong>s résidants est parfois délicat.<br />
Il serait judicieux d’améliorer l’offre et d’organiser le stationnement (rési<strong>de</strong>ntiel, <strong>de</strong> courte durée) dans le<br />
bourg (micro-poches, réglementation).<br />
La plupart <strong>de</strong>s équipements publics possè<strong>de</strong>nt également leur stationnement, parfois à usage privé<br />
comme celui du lycée Audubon. Une mutualisation <strong>de</strong> ces stationnements est souhaitée.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s liaisons douces<br />
Couëron a organisé dans la plupart <strong>de</strong> ses quartiers récents <strong>de</strong>s liaisons douces permettant <strong>de</strong> relier les<br />
quartiers les uns aux autres, ainsi que vers les principaux équipements. <strong>Le</strong>s projets <strong>de</strong> ZAC intègrent eux<br />
aussi cette préoccupation.<br />
En revanche, certaines liaisons font défaut compte tenu <strong>de</strong> la physionomie <strong>de</strong> l’agglomération en 2 <strong>de</strong>ux<br />
pôles. Il manque ainsi une vraie liaison entre la Chabossière et le centre avec ses commerces et<br />
établissements scolaires (axe Libération/Martyrs <strong>de</strong> la Résistance – Langevin/Blancho et Jaurès/pont<br />
SNCF).<br />
La commune est concernée par l’itinéraire « Loire à vélo » qui passe par les quais en évitant les zones<br />
d’activités en amont <strong>de</strong> l’agglomération. Dans le marais Audubon, les opportunités <strong>de</strong> promena<strong>de</strong><br />
cyclistes sont nombreuses en empruntant les chemins ruraux et voies communales. <strong>Le</strong>s marais sont<br />
d’ailleurs maillés d’un ensemble <strong>de</strong> chemins notamment dans la partie proche <strong>de</strong> l’agglomération, et très<br />
accessibles <strong>de</strong>puis cette <strong>de</strong>rnière.<br />
Certains chemins <strong>de</strong> promena<strong>de</strong> pé<strong>de</strong>stre ne sont cependant pas ouverts aux vélos en bord <strong>de</strong> Loire.<br />
L’aménagement <strong>de</strong> la coulée verte du Drillet a été réalisé récemment. La promena<strong>de</strong> est désormais<br />
ouverte au public en frange <strong>de</strong> Couëron et <strong>de</strong> Saint Herblain.<br />
<strong>Le</strong> GR 3 passe au Nord du territoire communal en provenance <strong>de</strong> Sautron. Il prend appui sur le coteau du<br />
Sillon et quitte rapi<strong>de</strong>ment la commune vers Saint Etienne <strong>de</strong> Montluc. Il serait opportun <strong>de</strong> préserver<br />
une emprise pour relier cet itinéraire aux autres cheminements couëronnais dans le cadre <strong>de</strong><br />
l’aménagement foncier.<br />
62
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s déplacements <strong>de</strong>s actifs<br />
La très gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s actifs travaille en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la commune.<br />
La <strong>de</strong>sserte en transport en commun est faiblement efficace y compris pour atteindre les zones<br />
d’activités <strong>de</strong> la commune, l’usage <strong>de</strong> la voiture personnelle est donc nécessaire à la plupart <strong>de</strong>s actifs.<br />
C’est pourquoi près <strong>de</strong> 8 actifs sur 10 utilisent leur véhicule personnel.<br />
La proximité <strong>de</strong> lieux <strong>de</strong> travail permet à une proportion <strong>de</strong> 5 % <strong>de</strong> la population <strong>de</strong> prendre leur 2-roues.<br />
Enfin, les transports en commun, compte tenu d’une <strong>de</strong>sserte moyennement efficace et <strong>de</strong> la politique<br />
ferroviaire récente, sont très peu utilisés.<br />
Mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> déplacement <strong>de</strong>s actifs en 1 999 Couëron N-O Agglo Agglo<br />
Pas <strong>de</strong> déplacement à effectuer 4,0% 3,2% 3,2%<br />
Déplacement à pied 2,0% 3,0% 5,2%<br />
Déplacement en 2 roues 5,1% 3,8% 4,1%<br />
Déplacement en voiture 79,3% 76,1% 68,9%<br />
Déplacement en transport en commun 4,7% 7,2% 10,2%<br />
Plusieurs moyens <strong>de</strong> transport 4,9% 6,6% 8,4%<br />
Source : INSEE RGP 99<br />
<strong>Le</strong> TER à Couëron<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
63
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
5. <strong>Le</strong> fonctionnement urbain<br />
<br />
<strong>Le</strong> taux d’équipement <strong>de</strong> la commune et le fonctionnement urbain<br />
<br />
ÉQUIPEMENTS<br />
Existence ou<br />
nombre<br />
Distance à la<br />
commune<br />
fréquentée<br />
Communes équipées<br />
<strong>de</strong> taille équivalente<br />
du département<br />
en %<br />
Nombre % Région France<br />
Services généraux<br />
Garage 9ou+ - 208 94.1 100.0 99.8<br />
Artisans du bâtiment<br />
Maçon 3-4 - 168 76.0 95.2 97.5<br />
Électricien 3-4 - 176 79.6 100.0 99.8<br />
Alimentation<br />
Alimentation générale, épicerie 2 - 122 55.2 90.5 96.3<br />
Boulangerie, pâtisserie 9ou+ - 191 86.4 100.0 100.0<br />
Boucherie, charcuterie 9ou+ - 145 65.6 100.0 99.5<br />
Services généraux<br />
Bureau <strong>de</strong> poste 1 - 162 73.3 100.0 99.8<br />
Librairie, papeterie 3-4 - 85 38.5 85.7 98.8<br />
Droguerie, quincaillerie 1 - 68 30.8 85.7 90.3<br />
Autres services à la population<br />
Salon <strong>de</strong> coiffure 5-8 - 185 83.7 100.0 100.0<br />
Café, débit <strong>de</strong> boissons 9ou+ - 219 99.1 100.0 100.0<br />
Bureau <strong>de</strong> tabac 2 - 218 98.6 100.0 100.0<br />
Restaurant 5-8 - 178 80.5 100.0 99.8<br />
Enseignement public du premier <strong>de</strong>gré<br />
École maternelle ou classe enfantine OUI - 191 86.4 100.0 100.0<br />
Enseignement du second <strong>de</strong>gré premier cycle public ou privé<br />
Collège public OUI - 44 19.9 100.0 98.8<br />
Fonctions médicales et paramédicales (libérales)<br />
Dentiste 9ou+ - 143 64.7 100.0 100.0<br />
Infirmier ou infirmière - 142 64.3 95.2 99.8<br />
Mé<strong>de</strong>cin généraliste 9ou+ - 168 76.0 100.0 100.0<br />
Pharmacie 5-8 - 157 71.0 100.0 100.0<br />
Source : INSEE - Inventaire Communal <strong>de</strong> 1998<br />
Organisé en appui sur les <strong>de</strong>ux quartiers principaux, le centre-ville et les quartiers est, l’offre <strong>de</strong> services<br />
et <strong>de</strong> commerces se divise entre les <strong>de</strong>ux entités :<br />
<strong>Le</strong> centre-ville (environ 8 000 habitants) a une fonction <strong>de</strong> centralité autour <strong>de</strong>s équipements<br />
administratifs, culturels et sportifs, et d’enseignement du second <strong>de</strong>gré (collège Paul Langevin et Lycée<br />
professionnel JJ. Audubon).<br />
<strong>Le</strong>s quartiers est autour <strong>de</strong> la Chabossière (environ 6 000 habitants) disposent d’une polarité secondaire<br />
autour d’équipements <strong>de</strong> proximité : écoles, commerces, centre socio-culturel, poste...<br />
Un service <strong>de</strong> ramassage scolaire <strong>de</strong>sservant les villages est assuré quotidiennement.<br />
64
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
les équipements à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s enfants et <strong>de</strong>s jeunes<br />
L’accueil <strong>de</strong> la petite Enfance<br />
L’offre actuelle :<br />
Type d'offre Nb <strong>de</strong> structures Nb <strong>de</strong> places<br />
Multi-accueil (acc.<br />
Perm.) 1 8<br />
Crèche familiale 1<br />
40<br />
As. Mat. Indép.<br />
219<br />
120 à l'ouest 98<br />
à Chabossiè La<br />
53 + 150 = 200<br />
Halte (acc. occ.) dt re<br />
M.Acc. 2 27<br />
Remarque :<br />
Scolarisation possible à<br />
partir <strong>de</strong> 2 ans<br />
Actuellement l’offre en mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> correspond à 8 places en Multi-Accueil (au centre ville), 40 places<br />
en crèche familiale et environ 300 places chez <strong>de</strong>s Assistantes Maternelles agréées.<br />
L’ensemble représente un total <strong>de</strong> 348 places pour <strong>de</strong>s besoins estimés à 448 places (Réf. CAF déc. 2003).<br />
Par ailleurs, la commune favorise la scolarisation à partir <strong>de</strong> 2 ans, en développant un service périscolaire<br />
adapté.<br />
Des <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s restent à ce jour insatisfaites.<br />
<strong>Le</strong>s équipements scolaires<br />
La commune dispose <strong>de</strong> 4 écoles maternelles publiques, 5 écoles élémentaires publiques et 1 groupe<br />
scolaire privé. Ils sont répartis par quartier :<br />
Dans le centre ville :<br />
- 3 écoles maternelles : “Rose Orain“, “Charlotte Divet“, « Léon Blum“ ;<br />
- 3 écoles élémentaires : “Louise Michel“, “Marcel Gouzil“ et “Anne Frank“ ;<br />
- 1 groupe scolaire privé (Primaire-Collège) “Sainte Philomène“ et « Saint-Symphorien ».<br />
La commune dispose également d’un collège public “Paul Langevin“ et d’un lycée professionnel “J.J.<br />
Audubon“.<br />
Dans les quartiers est (Chabossière) :<br />
- 1 groupe scolaire public “La Métairie“ ;<br />
- 1 école maternelle “Jean Macé“ ;<br />
- 2 écoles élémentaires (Paul Bert et Aristi<strong>de</strong> Briand) ;<br />
65
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Évolution <strong>de</strong>s effectifs dans les écoles primaires publiques<br />
Évolution <strong>de</strong>s effectifs scolaires maternelles<br />
<strong>de</strong>puis 1995 à Couëron<br />
75<br />
70 0<br />
65 0<br />
60 0<br />
55 0<br />
0<br />
61<br />
5<br />
1995/<br />
96<br />
1996/<br />
97<br />
1997/<br />
98<br />
1998/ 1999/<br />
99 Années 00<br />
scolaires<br />
2000/<br />
01<br />
71<br />
6<br />
2001/<br />
02<br />
2002/<br />
03<br />
70<br />
5<br />
2003/<br />
04<br />
Évolution <strong>de</strong>s effectifs élémentaires<br />
<strong>de</strong>puis 1995 à Couëron<br />
120<br />
110 0<br />
100<br />
0<br />
090<br />
0<br />
1995/<br />
96<br />
1996/<br />
97<br />
101<br />
2<br />
1997/<br />
98<br />
1998/ 1999/<br />
99 Années 00<br />
scolaires<br />
2000/<br />
01<br />
2001/<br />
02<br />
2002/<br />
03<br />
117<br />
5<br />
2003/<br />
04<br />
La tendance globale est à une augmentation régulière et douce <strong>de</strong>s effectifs (+ 5 élèves à la rentrée 2005)<br />
mais cette observation ne doit pas masquer la tendance à la baisse <strong>de</strong>s effectifs <strong>de</strong> maternelle alors que<br />
ceux <strong>de</strong> primaire augmentent sensiblement.<br />
En parallèle au phénomène <strong>de</strong> vieillissement <strong>de</strong>s ménages, on observe que, <strong>de</strong>puis 1999 à Couëron<br />
comme sur la plupart <strong>de</strong>s communes <strong>de</strong> la 1 ère couronne, les jeunes ménages primo-accédants sont<br />
moins nombreux parmi les nouveaux arrivants, ceux-ci sont plus généralement <strong>de</strong>s familles avec enfants<br />
<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 6 ans . Ainsi à la rentrée 2005/2006, 2 fermetures <strong>de</strong> classes sont prévues en maternelle et 2<br />
ouvertures sont programmées en élémentaire (sur 2 écoles, l’une <strong>de</strong>vant recourir à l’installation d’une<br />
classe mobile). <strong>Le</strong>s équipements existants ne disposent pas <strong>de</strong> potentialités permettant leur extension.<br />
D’ores et déjà <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> capacités d’accueil se posent en élémentaire.<br />
Au collège, les effectifs varient peu : écart à la moyenne <strong>de</strong> + à - 20 élèves <strong>de</strong>puis 1998 (cette moyenne<br />
étant <strong>de</strong> 725 élèves).<br />
Déclinaison par secteur<br />
La création d’un nouvel équipement scolaire est prévue dans le cadre <strong>de</strong> la ZAC Ouest Centre Ville avec<br />
une ouverture envisagée pour la rentrée 2008/2009.<br />
Cet équipement <strong>de</strong> 10 classes (4 en maternelle et 6 en primaire) -comprenant également locaux pour<br />
l’accueil périscolaire et service <strong>de</strong> restauration scolaire ainsi que <strong>de</strong>s locaux partagés avec <strong>de</strong>s<br />
associations <strong>de</strong> quartier-, permettra, dans un premier temps et avant même l’installation <strong>de</strong>s nouvelles<br />
familles d’absorber les sureffectifs <strong>de</strong>s écoles élémentaires du centre ville. Son extension sera possible à<br />
long terme (pouvant répondre aux besoins générés par le développement <strong>de</strong> l’habitat au Nord <strong>de</strong> la voie<br />
ferrée)<br />
66
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Évolution <strong>de</strong>s effectifs scolaires à la<br />
Chabossière <strong>de</strong>puis 1998<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
Maternelle Métairie<br />
Maternelle Jean macé<br />
Ens. maternelle Chabossière<br />
Élémentaire Métairie<br />
Élémetaire Paul Bert<br />
Élémentaire A. Briand<br />
Ens. Élémentaire Chabossière<br />
100<br />
0<br />
1998/1999<br />
2000/2001<br />
2002/2003<br />
2004/2005<br />
1999/2000<br />
2001/2002<br />
2003/2004<br />
<strong>Le</strong>s quartiers est sont davantage marqués par le vieillissement <strong>de</strong> la population, ce qui se traduit par une<br />
baisse <strong>de</strong>s effectifs en maternelles dans les 2 écoles.<br />
L’offre en direction <strong>de</strong>s personnes âgées<br />
La commune dispose :<br />
- D’une maison <strong>de</strong> retraite privée (La Grange) d’une capacité d’accueil <strong>de</strong> 86 résidants (55<br />
personnes en attente) ; Une extension pourrait être envisagée sous la forme d’une dizaine <strong>de</strong><br />
logements autonomes <strong>de</strong> plain-pied reliés aux services ;<br />
- À St Éloi, une opération récente <strong>de</strong> 15 logements <strong>de</strong> plain-pied en a réservé une partie à<br />
l’emménagement <strong>de</strong> personnes âgées ;<br />
- La création d’un équipement intergénérationel quartier Bessonneau est programmée : 18<br />
logements réservés aux personnes âgées avec multi-services.<br />
À long terme, la commune envisage la création d’une secon<strong>de</strong> maison <strong>de</strong> retraite à la Chabossière (le<br />
long <strong>de</strong> la rue du sta<strong>de</strong>).<br />
<br />
<strong>Le</strong>s équipements <strong>de</strong> sports et <strong>de</strong> loisirs<br />
Compte tenu <strong>de</strong> l’ancienneté du peuplement et <strong>de</strong> sa politique <strong>de</strong> loisirs, ainsi que le poids <strong>de</strong>s scolaires<br />
dans le fonctionnement communal, Couëron est doté <strong>de</strong> nombreux équipements couverts ou <strong>de</strong> pleinair<br />
à vocation <strong>de</strong> sports et <strong>de</strong> loisirs. <strong>Le</strong>ur <strong>local</strong>isation répond à la fois à la satisfaction <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ux principaux quartiers mais aussi à l’existence <strong>de</strong> structures ou sites préexistants et valorisés dans le<br />
cadre <strong>de</strong> ces vocations.<br />
Complexe René Gaudin, rue Marcel <strong>de</strong> la Provoté :<br />
- 2 courts <strong>de</strong> tennis couverts ;<br />
- 1 court <strong>de</strong> tennis extérieur ;<br />
- 1 terrain <strong>de</strong> football stabilisé ;<br />
- 1 salle spécifique : gymnastique, tennis <strong>de</strong> table, tir à l'arc, danse, musculation.<br />
67
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Complexe sportif Jules boullery, bd Blancho<br />
- 1 gymnase ;<br />
- 1 plateau d'évolution.<br />
Complexe Paul Langevin, Bd Paul Langevin<br />
- 1 gymnase ;<br />
- 1 salle type COSECA;<br />
- 1 plateau d'évolution ;<br />
- 1 piscine (Baptiste <strong>Le</strong>fèvre).<br />
Complexe Léo Lagrange, Rue <strong>de</strong> la Noë Allais<br />
- 2 terrains <strong>de</strong> football engazonnés ;<br />
- 1 terrain <strong>de</strong> football stabilisé ;<br />
- 1 salle multisports couverte ;<br />
- 1 plateau d’évolution.<br />
Gymnase Pierre Moisan, Rue Rouget <strong>de</strong> Lisle<br />
Sta<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ardillets, Rue <strong>de</strong> la Frémondière<br />
- Un terrain engazonné<br />
Sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Frémondière, rue <strong>de</strong> la Frémondière<br />
- Un terrain engazonné ;<br />
- Un terrain stabilisé ;<br />
- Piscine Baptiste <strong>Le</strong>fèvre, BD Paul Langevin ;<br />
- <strong>Le</strong> vélodrome, Rue Marcel <strong>de</strong> la Provoté ;<br />
- La piste bicross, près du "pont <strong>de</strong> Retz".<br />
<br />
<strong>Le</strong>s équipements culturels, sociaux et associatifs<br />
- Bibliothèque Victor Jara, quai Gambetta ;<br />
- Théâtre Boris Vian, rue Jean Rostand (capacité 240 places) ;<br />
- 2 centres socioculturels:<br />
Pierre <strong>Le</strong>gendre, Bd Blancho,<br />
Henri Normand, Place <strong>de</strong>s Cités,<br />
- Salle polyvalente <strong>de</strong> l'Estuaire, rue <strong>de</strong> la Frémondière.<br />
Centre <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong> l'Erdurière<br />
- 3 bâtiments dont 1 <strong>de</strong> restauration ;<br />
- 1 centre maternel ;<br />
- 1 centre primaire.<br />
68
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Ecole <strong>de</strong> Musique, Centre Henri Normand<br />
Centre Médico-Social au Centre P. <strong>Le</strong>gendre<br />
Maison <strong>de</strong> retraite ;<br />
Maison <strong>de</strong> la petite enfance ;<br />
Mini - terrain d’accueil GDV + Aire <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> la ferraille, Lieu dit « <strong>Le</strong>s Mares Jaunes » ;<br />
Maison associative, Quai Gambetta ;<br />
Salle <strong>de</strong> la Fraternité, Place <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’Homme ;<br />
Salle La boule d’or, Place Charles Gi<strong>de</strong> ;<br />
Salle Mille Club, rue <strong>de</strong> la Corbadière.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s projets (à l’étu<strong>de</strong>, initié ou en cours <strong>de</strong> réalisation)<br />
Pour satisfaire les besoins <strong>de</strong> la population, la municipalité a plusieurs projets en cours <strong>de</strong> réalisation ou<br />
prévus à court terme ; les orientations générales <strong>de</strong> ces projets sont <strong>de</strong> :<br />
- Répondre aux besoins <strong>de</strong>s différents âges <strong>de</strong> la vie ;<br />
- Favoriser les solidarités entre les générations ;<br />
- Redynamiser le centre ville<br />
Dans le cadre d‘un Plan Pluriannuel d’Actions (P.P.A. 2003-2010), la commune a inscrit à son programme :<br />
<br />
- La création d’un Espace culturel et associatif sur le site <strong>de</strong> la Tour à Plomb participant à la<br />
redynamisation du centre ville (début <strong>de</strong>s travaux prévus en 2006) ;<br />
- La création d’une Médiathèque sur les bords <strong>de</strong> la Loire ;<br />
- La création <strong>de</strong> 2 espaces multi-fonctionnels :<br />
o<br />
l’un intégré à la création d’un groupe scolaire - ZAC Ouest centre ville,<br />
o l’autre prévu dans le cadre <strong>de</strong> la ZAC Métairie ;<br />
- La réalisation d’une crèche collective dans le cadre du Programme “Espace Intergénérationnel“<br />
(quartier Bessonneau) ;<br />
- La création d’un parc <strong>de</strong> roller-skate (étu<strong>de</strong> en cours) ;<br />
- Une réflexion en cours concernant la création d’un nouveau complexe sportif sur le site <strong>de</strong>s<br />
Daudières (remblaiement en cours <strong>de</strong> l’ancienne carrière) ;<br />
- La création <strong>de</strong> jardins familiaux (à étudier).<br />
Point sur les situations d’habitat en caravanes ou mixte à Couëron<br />
La commune dispose d’une aire d’accueil pour les voyageurs <strong>de</strong> passage (6 places) située au lieu-dit <strong>Le</strong>s<br />
Mares Jaunes.<br />
La création d’une secon<strong>de</strong> aire d’accueil (6 places) est à l’étu<strong>de</strong> conformément aux préconisations du<br />
Schéma Départemental..<br />
Concernant les situations <strong>de</strong> fixation ou d’hivernage, la commune <strong>de</strong> Couëron compte, <strong>de</strong>puis<br />
longtemps déjà, parmi ses habitants <strong>de</strong>s familles dites du voyage qui se sont installées en faisant<br />
l’acquisition <strong>de</strong> terrains bâtis ou non.<br />
69
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Deux cas <strong>de</strong> figures se présentent :<br />
- L’installation dans le respect du cadre légal (droits <strong>de</strong>s sols) : acquisition <strong>de</strong> terrain bâti, travaux<br />
avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation ;<br />
- L’installation <strong>de</strong> caravanes sur terrain agricole avec construction sans autorisation le cas échéant.<br />
La commune gère ces situations au cas par cas, engageant <strong>de</strong>s procédures dès lors que les occupants ne<br />
se conforment pas au droit (quelques situations tolérées cependant du fait <strong>de</strong> l’ancienneté notamment).<br />
Elle souhaite maîtriser les installations nouvelles par une politique dissuasive (procédure quasisystématique).<br />
Quelques équipements symboliques <strong>de</strong> Couëron<br />
La Mairie (photo <strong>Nantes</strong> Métropole)<br />
La bibliothèque (photo <strong>Nantes</strong> Métropole)<br />
La salle <strong>de</strong> la Fraternité place <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong><br />
l’homme (photo <strong>Nantes</strong> Métropole)<br />
La maison <strong>de</strong> la laïcité quai Gambetta (photo<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole)<br />
70
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIV- SYNTHESE DU DIIAGNOSTIIC URBAIIN<br />
Après une analyse thématique, il ressort quelques gran<strong>de</strong>s caractéristiques constituant autant d’atouts<br />
et <strong>de</strong> contraintes qui encadrent l’élaboration d’un projet <strong>de</strong> territoire cohérent. Ce point est présenté sou<br />
la forme d’un tableau synthétique. Il sera complété par la présentation <strong>de</strong>s enjeux environnementaux à<br />
la fin du chapitre II portant sur l’état initial <strong>de</strong> l’environnement.<br />
Thèmes Atouts Contraintes<br />
Espaces urbanisés<br />
Un cadre <strong>de</strong> vie préservé malgré un mitage<br />
important <strong>de</strong> l’espace rural<br />
Une structuration nécessaire du réseau <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte<br />
urbaine<br />
Socio-démographie<br />
Des sol<strong>de</strong>s naturel et migratoire positifs <strong>de</strong>puis <strong>de</strong><br />
nombreuses années<br />
Apparition <strong>de</strong>s effets du vieillissement dans cette<br />
commune où les 2/3 <strong>de</strong>s gens sont propriétaires et<br />
donc peu mobiles<br />
Une tradition <strong>de</strong> commune ouvrière qui s’atténue<br />
Habitat<br />
16,55 % <strong>de</strong> logements sociaux dans le parc<br />
couëronnais<br />
De récentes opérations d’habitat mixte, reprise du<br />
rythme <strong>de</strong> la construction<br />
Une mixité sociale et une diversité <strong>de</strong>s formes<br />
urbaines amorcée<br />
Un potentiel <strong>de</strong> renouvellement urbain important<br />
dans le centre-ville notamment<br />
…mais il ne répond pas à l’ampleur <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
…mais une tension sur le marché <strong>de</strong> l’immobilier<br />
<strong>de</strong>meure<br />
Difficulté récente d’installation <strong>de</strong>s jeunes<br />
ménages <strong>de</strong> par l’insuffisance <strong>de</strong> l’offre locative et<br />
le coût <strong>de</strong> l’immobilier<br />
Activité économique et<br />
emplois<br />
Un pôle d’emplois en croissance avec l’extension<br />
du parc d’activités <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron<br />
Un secteur industriel encore bien présent<br />
Une activité agricole forte<br />
Un bon niveau commercial <strong>de</strong> proximité<br />
Un potentiel <strong>de</strong> tourisme <strong>de</strong> proximité<br />
….mais <strong>de</strong>s zones d’activités à requalifier<br />
…. mais un espace mité par l’habitat et <strong>de</strong>s activités<br />
para-agricoles (pâturage <strong>de</strong> chevaux notamment)<br />
Déplacements<br />
Un bon réseau routier à l’échelle communale mais<br />
aussi communautaire<br />
Une offre en transports collectifs insuffisante eu<br />
égard au poids <strong>de</strong> population<br />
Un maillage <strong>de</strong> liaisons douces <strong>de</strong>nse (Loire à Vélo)<br />
Des flux <strong>de</strong> migrations domicile/travail importants<br />
Des entrées <strong>de</strong> ville mal i<strong>de</strong>ntifiées<br />
Un manque <strong>de</strong> relations entre le centre-ville et la<br />
Chabossière<br />
Fonctionnement urbain<br />
Une mixité <strong>de</strong>s fonctions dans le centre-ville et à la<br />
Chabossière<br />
Un bon niveau d'équipements collectifs<br />
Une bipolarité entre le centre-ville et la Chabossière<br />
71
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
72
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Chapitre II-<br />
L’Etat Initial <strong>de</strong> l’Environnement<br />
73
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
74
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
I - <strong>Le</strong> milieu physique<br />
1. <strong>Le</strong> contexte géologique<br />
L’analyse <strong>de</strong> la carte géologique au 1/50000 (voir page suivante) montre que la commune <strong>de</strong> Couëron est<br />
située dans le domaine <strong>de</strong> la Loire et du Massif armoricain.<br />
La commune se trouve en effet au niveau du Sillon <strong>de</strong> Bretagne, acci<strong>de</strong>nt géologique et topographique<br />
majeur formé lors du plissement hercynien, et qui s’étend sur 350 km <strong>de</strong>puis la pointe du Raz jusqu’au<br />
Nord <strong>de</strong> Montaigu. Sur la commune <strong>de</strong> Couëron, il délimite les bassins versants <strong>de</strong> la Chézine au Nord et<br />
<strong>de</strong> la Loire au Sud.<br />
<strong>Le</strong> socle au Nord <strong>de</strong> la commune est ainsi constitué d’une large ban<strong>de</strong> granitique orientée Nord-Ouest -<br />
Sud-Est. Sur toute la longueur du Sillon <strong>de</strong> Bretagne, ce granite a subi une forte cataclase (broyage <strong>de</strong>s<br />
minéraux et création d’une schistosité). Il en résulte une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> myolinites et d’ultra-myolinites<br />
(granite écrasé) parallèle et délimitée par <strong>de</strong>ux failles témoins <strong>de</strong>s mouvements tectoniques.<br />
Des roches métamorphiques <strong>de</strong> type gneiss et micaschistes, sur lesquelles se sont installées les zones<br />
urbanisées <strong>de</strong> Couëron longent la partie sud <strong>de</strong> cette ban<strong>de</strong> granitique.<br />
Des formations d’origine éoliennes, pliocènes ou fluviatiles résiduelles (sables et limons éoliens,<br />
épaisseur maximum <strong>de</strong> l’ordre du mètre) recouvrent par placage le socle au Sud du sillon <strong>de</strong> Bretagne.<br />
Enfin, le secteur <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Loire est occupée par <strong>de</strong>s alluvions fluvio-marines (vases et sables) et<br />
par <strong>de</strong>s terrains remblayés.<br />
75
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
76
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
2. <strong>Le</strong> relief<br />
Riverains <strong>de</strong> la Loire et marqués par une altitu<strong>de</strong> à peine plus élevée que le niveau <strong>de</strong> la mer, les prémarais<br />
représentent plus d’un tiers du territoire communal.<br />
Deux vallées encadrent le territoire au sud et au nord :<br />
<br />
<br />
La vallée <strong>de</strong> la Loire qui marque le territoire <strong>de</strong> son empreinte avec tout un ensemble naturel <strong>de</strong><br />
terres reliées au fleuve : les marais Audubon à l’Ouest, l’étier <strong>de</strong> Beaulieu qui passe au Nord du<br />
bourg et crée une <strong>de</strong>uxième zone humi<strong>de</strong>, la vallée <strong>de</strong> la Patissière, au Nord <strong>de</strong> l’étier <strong>de</strong> la<br />
Bouma ;<br />
La vallée <strong>de</strong> la Chézine marque la limite Nord avec Sautron sur un linéaire <strong>de</strong> 6 km. Cette vallée<br />
est beaucoup plus discrète car elle est doublée par une gran<strong>de</strong> infrastructure régionale, la RN<br />
165. La partie Nord <strong>de</strong> la commune, <strong>de</strong> plus en plus élevée, rejoint ainsi le Sillon <strong>de</strong> Bretagne.<br />
3. <strong>Le</strong> climat<br />
<strong>Le</strong>s données climatiques proviennent <strong>de</strong> la station Météo France <strong>de</strong> Bouguenais. Ces données sont<br />
établies sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence : <strong>de</strong> janvier 1971 à décembre 2000 pour la pluviométrie et les<br />
températures.<br />
<strong>Le</strong> climat <strong>de</strong> la zone d’étu<strong>de</strong> est <strong>de</strong> type océanique tempéré avec une répartition régulière et saisonnière<br />
<strong>de</strong>s précipitations. <strong>Le</strong>s hivers et les étés sont en moyenne peu marqués ce qui traduit la proximité <strong>de</strong> la<br />
faça<strong>de</strong> maritime.<br />
Pluviométrie :<br />
On recense une pluviométrie annuelle <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 750 mm avec une variation saisonnière entre les mois<br />
les moins humi<strong>de</strong>s, juin et août avec 40mm et le mois le plus humi<strong>de</strong>, décembre avec 90 mm.<br />
Température :<br />
La température annuelle moyenne est <strong>de</strong> 12,3°C<br />
<strong>Le</strong>s hivers sont assez doux avec une moyenne <strong>de</strong> 5,5°C pour le mois <strong>de</strong> janvier et les étés n’engendrent<br />
pas <strong>de</strong> fortes chaleurs avec une moyenne <strong>de</strong> 19,5°C pour le mois d’août.<br />
77
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Hauteur moyenne <strong>de</strong>s précipitations (mm)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Janvier<br />
Février<br />
Mars<br />
Avril<br />
Mai<br />
Juin<br />
Juillet<br />
Août<br />
Septembre<br />
Octobre<br />
Novembre<br />
Décembre<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Température moyenne (°C)<br />
Diagramme ombrothermique (source Météo France)<br />
Précipitation<br />
Température minimale<br />
Température maximale<br />
Température moyenne<br />
Vents :<br />
<strong>Le</strong>s vents dominants sont <strong>de</strong> secteur Ouest à Sud-Ouest.<br />
Rose <strong>de</strong>s vents <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
4. <strong>Le</strong> réseau hydrographique<br />
<br />
Description <strong>de</strong>s cours d’eau<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron est située dans la vallée alluviale <strong>de</strong> la Loire dans sa partie Sud, et dans la vallée<br />
<strong>de</strong> la Chézine dans sa partie Nord. Ces <strong>de</strong>ux cours d’eau marquent les limites communales.<br />
La plaine alluviale <strong>de</strong> la Loire, réceptacle <strong>de</strong> nombreux ruisseaux qui s’écoulent <strong>de</strong>puis les coteaux au<br />
nord (ruisseau du Drillet en limite Est), est drainée par un réseau <strong>de</strong>nse <strong>de</strong> fossés et d’étiers en lien direct<br />
avec la Loire. On citera notamment :<br />
<br />
<br />
l’étier <strong>de</strong> Beaulieu et l’étier <strong>de</strong> la Bouma qui drainent les alentours <strong>de</strong>s secteurs urbains Est, et<br />
qui s’écoulent en direction <strong>de</strong> la Patissière après avoir reçu les eaux du ruisseau du Drillet ;<br />
l’étier <strong>de</strong> la Musse et l’étier du Dareau qui drainent le marais d’Audubon à l’Ouest.<br />
78
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La Loire<br />
La Loire en Loire-Atlantique représente l'exutoire <strong>de</strong> ce fleuve dont le bassin versant couvre environ le 1/5<br />
du territoire national. Elle connaît, dans sa partie aval, un régime hydraulique particulier, une dynamique<br />
estuarienne sous l'influence <strong>de</strong> la remontée du front salin et une dynamique sédimentaire complexe,<br />
avec la présence d’un bouchon vaseux.<br />
- Jusqu'à Ancenis, le courant est irrégulier, souvent très rapi<strong>de</strong>, avec une profon<strong>de</strong>ur variant <strong>de</strong> 0,50<br />
à 5 mètres ;<br />
- Jusqu'à l'amont <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>, le profil est sensiblement le même mais le niveau varie sous l'effet<br />
conjoint <strong>de</strong> la marée et du débit du fleuve ;<br />
- Lorsque les débits d'étiages sont très faibles, le bouchon vaseux peut remonter très en amont,<br />
jusqu'à Oudon.<br />
<strong>Le</strong> territoire communal est situé dans le bassin versant <strong>de</strong> la Loire qui marque la limite communale sud.<br />
Couëron jouit d’une faça<strong>de</strong> sur la Loire <strong>de</strong> 9 km <strong>de</strong> linéaire, bordée <strong>de</strong> vastes prairies humi<strong>de</strong>s à l’ouest du<br />
centre-ville. Nombre d’étiers subsistent encore et vont faire l’objet <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> restauration.<br />
<strong>Le</strong> réseau hydraulique <strong>de</strong> la commune est intimement lié à l’influence <strong>de</strong> la Basse Loire. <strong>Le</strong> Marais<br />
Audubon est une zone où à certaines pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’année d’importants mouvements <strong>de</strong> masses d’eau se<br />
mêlent. Elle constitue le principal récepteur <strong>de</strong>s différents cours d’eau <strong>de</strong> la commune et, subit par<br />
ailleurs l’effet <strong>de</strong>s marées. En pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> crue hivernale, lorsqu’au débit <strong>de</strong>s cours d’eau s’ajoute le<br />
volume d’eau apporté par les marées, ce sont <strong>de</strong>s volumes importants qui doivent pouvoir librement<br />
s’évacuer vers la Loire.<br />
Cette présence <strong>de</strong> l’eau sur ce secteur contribue directement à sa valeur floristique et faunistique. La<br />
vallée offre <strong>de</strong> belles étendues <strong>de</strong> pré-marais inondables du type <strong>de</strong> ceux recherchés par les oiseaux<br />
d’eau. Ces inondations sont particulièrement accentuées à l’occasion <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s marées (coefficient > à<br />
100).<br />
La Chézine (affluent <strong>de</strong> la Loire)<br />
La Chézine est une rivière <strong>de</strong> 21 Km qui prend sa source sur la commune <strong>de</strong> Saint-Étienne-<strong>de</strong>-Montluc.<br />
Elle traverse ensuite les communes <strong>de</strong> Sautron, <strong>de</strong> Couëron, <strong>de</strong> Saint-Herblain, puis <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> où elle se<br />
jette dans la Loire au niveau du quai <strong>de</strong> la Fosse à hauteur <strong>de</strong> la rue Mathurin Brissonneau. La Chézine est<br />
recouverte au niveau <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> jusqu'à sa confluence avec la Loire, du côté <strong>de</strong> la rive droite <strong>de</strong> cette<br />
<strong>de</strong>rnière.<br />
79
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Hydrogéologie et alimentation<br />
Dans les roches dures et sans perméabilité d’ensemble rencontrées dans le socle du secteur, l’eau circule<br />
à la faveur <strong>de</strong>s fissures. <strong>Le</strong>s ressources sont donc inégalement réparties et limitées.<br />
<strong>Le</strong>s formations d’altération superficielles peuvent contenir <strong>local</strong>ement <strong>de</strong>s nappes d’eau au contact <strong>de</strong>s<br />
niveaux imperméables sous-jacents (roche saine, argiles d’altération). Ces nappes isolées présentent <strong>de</strong>s<br />
capacités <strong>de</strong> production limitées. Elles peuvent être exploitées à partir <strong>de</strong> puits peu profonds permettant<br />
<strong>de</strong> satisfaire les besoins domestiques <strong>de</strong>s habitations et l'arrosage <strong>de</strong>s jardins.<br />
<strong>Le</strong>s alluvions <strong>de</strong> la Loire contiennent par contre d’importantes ressources en eau. Néanmoins, il n’existe<br />
pas <strong>de</strong> captages <strong>de</strong>stinés à l’alimentation en eau potable ou périmètres <strong>de</strong> protection sur le territoire<br />
communal <strong>de</strong> Couëron en raison <strong>de</strong> la vulnérabilité du secteur (situation en aval <strong>de</strong> l’agglomération<br />
nantaise, présence d’industries lour<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> sites pollués). <strong>Le</strong>s prises d’eau en Loire qui permettent<br />
d’alimenter la métropole en eau potable sont situées à <strong>Nantes</strong> (La Roche), à Mauves, et à Basse-Goulaine.<br />
<strong>Le</strong>s forages recensés sur la commune <strong>de</strong> Couëron sont utilisés à titre privé. Seul un forage est utilisé par<br />
la commune pour <strong>de</strong>s besoins collectifs (terrain <strong>de</strong> football, espaces verts).<br />
<br />
La qualité <strong>de</strong>s eaux<br />
Qualité physico-chimique<br />
<strong>Le</strong>s matières organiques contenues dans les rejets urbains, agricoles et industriels se dégra<strong>de</strong>nt par<br />
oxydation en consommant l’oxygène dissous <strong>de</strong> l’eau. <strong>Le</strong>s matières azotées, les nitrates et le phosphore<br />
favorisent le développement <strong>de</strong>s <strong>plan</strong>tes, <strong>de</strong>s algues et du phyto<strong>plan</strong>cton <strong>de</strong> nos rivières. Contrairement<br />
aux nitrates, le phosphore se fixe dans les sols et ne s’accumule donc pas dans les eaux souterraines.<br />
Depuis 1997, la qualité s’améliore pour les matières organiques et oxydables. Pour les nitrates, les<br />
qualités très bonne et bonne diminuent, tandis que la qualité moyenne augmente. <strong>Le</strong>s matières<br />
phosphorées sont stables<br />
Qualité hydrobiologique<br />
La qualité hydrobiologique <strong>de</strong>s cours d’eau intègre la qualité chimique <strong>de</strong>s eaux et la qualité physique<br />
<strong>de</strong>s milieux aquatiques. Depuis 1997, la qualité hydrobiologique se dégra<strong>de</strong> dans le département <strong>de</strong> la<br />
Loire Atlantique.<br />
La Loire<br />
• La qualité MOOX (Matières Organiques et Oxydables) est mauvaise à l’amont <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> puis très<br />
mauvaise à l’aval ;<br />
• La qualité matières azotées passable jusqu’à la confluence <strong>de</strong> la Divatte puis passable à bonne en<br />
amont <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>, la qualité passable dans la ville <strong>de</strong>vient passable à mauvaise puis très mauvaise à<br />
l’embouchure ;<br />
• La qualité <strong>de</strong>s matières phosphorées se dégra<strong>de</strong> progressivement à partir <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>. Elle est passable à<br />
l’amont et très mauvaise à l’embouchure ;<br />
• La qualité est mauvaise pour les effets <strong>de</strong>s proliférations végétales sur l’ensemble <strong>de</strong> son cours.<br />
80
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La Chézine<br />
La Chézine est soumise à <strong>de</strong> nombreux rejets d’eaux usées dans l’agglomération nantaise :<br />
- La qualité MOOX (Matières Organiques et Oxydables) au niveau <strong>de</strong> Sautron et <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> est <strong>de</strong> ce<br />
fait mauvaise ;<br />
- La qualité nitrates est passable au niveau <strong>de</strong> Sautron et <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> ;<br />
- La qualité matières phosphorées est bonne au niveau <strong>de</strong> Sautron puis passable à <strong>Nantes</strong> ;<br />
- Parmi la population piscicole, on trouve l’Anguille, migrateur classé dans le livre rouge national.<br />
<br />
Programme <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong> la ressource en eau<br />
SDAGE ET SAGE<br />
<strong>Le</strong> SDAGE Loire Bretagne<br />
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration <strong>de</strong> Schémas Directeurs d'Aménagement et <strong>de</strong><br />
Gestion <strong>de</strong>s Eaux par bassin ou groupement <strong>de</strong> bassins pour concilier les besoins <strong>de</strong> l'aménagement du<br />
territoire et la gestion équilibrée <strong>de</strong> la ressource en eau.<br />
Dans le bassin Loire Bretagne, le comité du bassin a décidé la mise à l'étu<strong>de</strong> d'un seul SDAGE pour<br />
l'ensemble du bassin, qui a été adopté le 4 juillet 1996 et approuvé par le Préfet, coordinateur du Bassin le<br />
1er décembre 1996.<br />
<strong>Le</strong> bassin couvre l'ensemble <strong>de</strong>s bassins versants <strong>de</strong> la Loire et <strong>de</strong> ses affluents, les bassins côtiers bretons<br />
et la Vilaine, les côtiers vendéens, pour une superficie <strong>de</strong> 155 000 km². <strong>Le</strong> SDAGE a pour objet <strong>de</strong> fixer <strong>de</strong>s<br />
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée <strong>de</strong> la ressource en eau et <strong>de</strong>s milieux aquatiques. Il<br />
énonce <strong>de</strong>s recommandations générales et particulières et arrête les objectifs <strong>de</strong> quantité et <strong>de</strong> qualité<br />
<strong>de</strong>s eaux. Il délimite en outre le périmètre <strong>de</strong>s sous-bassins correspondant à une unité hydrologique, où<br />
peut-être mis en œuvre un Schéma d'Aménagement et <strong>de</strong> Gestion <strong>de</strong>s Eaux. (S.A.G.E).<br />
<strong>Le</strong> SDAGE et les SAGE possè<strong>de</strong>nt une portée juridique forte qui s'impose à <strong>de</strong> nombreux documents<br />
administratifs, notamment au SCOT et aux PLU, qui doivent être compatibles avec leurs objectifs.<br />
<strong>Le</strong>s sept objectifs fondamentaux du SDAGE Loire Bretagne sont les suivants :<br />
- gagner la bataille <strong>de</strong> l'alimentation en eau potable ;<br />
- poursuivre l'amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface ;<br />
- retrouver <strong>de</strong>s rivières vivantes et mieux les gérer ;<br />
- sauvegar<strong>de</strong>r et mettre en valeur les zones humi<strong>de</strong>s ;<br />
- préserver et restaurer les écosystèmes littoraux ;<br />
- réussir la concertation notamment avec les agriculteurs ;<br />
- savoir mieux vivre avec les crues.<br />
Dans le département <strong>de</strong> la Loire Atlantique, les objectifs <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> la Loire ont été précisés par le<br />
SDAGE au niveau <strong>de</strong>s points nodaux <strong>de</strong> Mauves (Lre2) et <strong>de</strong> Cor<strong>de</strong>mais (Lre1).<br />
<strong>Le</strong> SAGE <strong>de</strong> l’estuaire <strong>de</strong> la Loire<br />
<strong>Le</strong> S.A.G.E <strong>de</strong> l’estuaire <strong>de</strong> la Loire est en cours d'élaboration. Il concerne la Loire Atlantique, le Maine et<br />
Loire et le Morbihan, puisqu'il comprend l'estuaire, d'Anetz à l'Océan, avec les affluents sauf la Sèvre<br />
Nantaise. <strong>Le</strong> périmètre du SAGE a été arrêté le 2 septembre 1998, pour une superficie <strong>de</strong> 3 923 km². La<br />
Commission Locale <strong>de</strong> l'eau (CLE) a été constituée.<br />
Notons que la totalité du territoire communal <strong>de</strong> Couëron est inscrit dans le périmètre du S.A.G.E. <strong>de</strong><br />
l’estuaire <strong>de</strong> la Loire.<br />
81
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La compétence <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole en matière <strong>de</strong> gestion durable <strong>de</strong> la ressource en eau<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole exerce les compétences transférées <strong>de</strong> la production et <strong>de</strong> la distribution <strong>de</strong> l’eau<br />
potable, <strong>de</strong> l’assainissement (collecte et traitement <strong>de</strong>s eaux usées), ainsi que la compétence<br />
environnement et prévention <strong>de</strong>s risques liés.<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole est donc désormais l’unique interlocutrice <strong>de</strong> l’Agence <strong>de</strong> l’Eau pour le contrat<br />
d’agglomération, même si les communes conservent un rôle important en termes <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong> police,<br />
<strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong>s autorisations d’urbanisme, d’entretien <strong>de</strong>s espaces restaurés, etc.<br />
<strong>Le</strong> programme Neptune<br />
La pression <strong>de</strong> l’urbanisation rend nécessaire un fort accompagnement <strong>de</strong> la collectivité en matière <strong>de</strong><br />
protection et <strong>de</strong> mise en valeur <strong>de</strong> ses espaces naturels et notamment ceux liés aux cours d’eau. C’est la<br />
vocation du programme NEPTUNE, mené par le District puis par <strong>Nantes</strong> Métropole en partenariat avec<br />
l’Agence <strong>de</strong> l’Eau Loire Bretagne <strong>de</strong>puis les années 1990. Ce programme constitue la mise en œuvre<br />
opérationnelle <strong>de</strong>s objectifs généraux du SDAGE à l’échelle <strong>de</strong> l’agglomération nantaise.<br />
<strong>Le</strong> premier contrat d’agglomération a été essentiellement axé sur la mise en place <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
infrastructures nécessaires à l’assainissement <strong>de</strong> l’agglomération, ainsi que la suppression <strong>de</strong> petites<br />
stations et leur rattachement au réseau général d’assainissement.<br />
Neptune 2 (1999-2003) visait à restaurer la qualité <strong>de</strong>s milieux, à travers <strong>de</strong>s actions par bassin versant,<br />
via notamment une augmentation du taux <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s eaux usées par extension <strong>de</strong>s réseaux et<br />
fiabilisation <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> transfert.<br />
Neptune 3 (2004-2007) s’inscrit dans la continuité <strong>de</strong> ces contrats, en y ajoutant un volet eau potable,<br />
comportant ainsi <strong>de</strong>s actions sur l’ensemble du cycle <strong>de</strong> l’eau.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs généraux <strong>de</strong> Neptune 3 sont <strong>de</strong> :<br />
- sécuriser la ressource en eau potable : l’approvisionnement en eau potable <strong>de</strong> l’agglomération<br />
dépend actuellement <strong>de</strong> la Loire en totalité. L’objectif est <strong>de</strong> trouver une solution substitutive, en<br />
cas <strong>de</strong> pollution grave du fleuve que l’usine <strong>de</strong> la Roche ne pourrait pas traiter ;<br />
- limiter les rejets sur l’Erdre aval ;<br />
- protéger et valoriser les coulées vertes <strong>de</strong> l’agglomération que sont les milieux aquatiques ;<br />
- adapter les dispositifs d’assainissement aux contraintes <strong>de</strong> l’urbanisation (et à ses perspectives<br />
d’évolution, tant à <strong>Nantes</strong> que pour l’ensemble <strong>de</strong> l’agglomération) et à la réglementation. La<br />
station d’épuration du Pellerin a été mise à niveau en 2004.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> ses objectifs définis dans le Programme Neptune 2, Couëron a bénéficié d’une action<br />
visant à mettre en valeur le ruisseau du Drillet et le rendre accessible par un sentier pé<strong>de</strong>stre. Une<br />
réflexion a été engagée sur son bassin versant pour définir les actions à mener pour maîtriser les<br />
écoulements et ainsi, <strong>plan</strong>ifier les inci<strong>de</strong>nces éventuelles sur les aménagements le long <strong>de</strong>s cours d’eau.<br />
Une étu<strong>de</strong> préalable à la restauration <strong>de</strong>s étiers nord <strong>de</strong> La Loire est en cours sur les territoires <strong>de</strong><br />
Couëron, Indre et Saint-Herblain : curetage <strong>de</strong>s étiers, aménagement <strong>de</strong> frayères, aménagement <strong>de</strong><br />
chemins piétons.<br />
Par ailleurs, à l’instar <strong>de</strong>s communes membres, le programme Neptune 3 (2004-2007) s’applique au<br />
territoire sur le volet <strong>de</strong> l’assainissement : actions pour l’amélioration du fonctionnement du réseau<br />
séparatif, système <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s installations d’assainissement autonome à travers la mise en place du<br />
SPANC.<br />
82
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La Chézine à Couëron<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
83
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
84
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIII- LE PATRIIMOIINE NATUREL<br />
1. <strong>Le</strong>s entités naturelles<br />
<strong>Le</strong> patrimoine naturel <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Couëron est constitué <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux entités majeures :<br />
- La vallée <strong>de</strong> la Loire,<br />
- <strong>Le</strong> plateau agricole bocager.<br />
<br />
La vallée <strong>de</strong> la Loire et ses prairies humi<strong>de</strong>s<br />
La partie naturelle <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Loire est constituée du cours du fleuve, du marais Audubon, <strong>de</strong>s<br />
zones humi<strong>de</strong>s et du lac <strong>de</strong> Beaulieu.<br />
<strong>Le</strong> cours du fleuve a été canalisé pour permettre la navigation, avec la constitution d’un chenal et<br />
l’abaissement du lit. Au droit <strong>de</strong> Couëron, l’influence <strong>de</strong>s marées se fait fortement sentir, accompagnée<br />
<strong>de</strong> la remontée du gradient <strong>de</strong> salinité et du phénomène <strong>de</strong> bouchon vaseux. Malgré ces dégradations, le<br />
fleuve reste un couloir migratoire pour <strong>de</strong> nombreuses espèces d’oiseaux et <strong>de</strong> poissons notamment,<br />
alors qu’une végétation typique se développe encore <strong>local</strong>ement sur les berges.<br />
Riverains <strong>de</strong> la Loire et marqués par une altitu<strong>de</strong> à peine plus élevée que le niveau <strong>de</strong> la mer, le marais<br />
Audubon représente plus d’un tiers du territoire communal. Il est quadrillé <strong>de</strong> canaux, étiers, et fossés qui<br />
permettent <strong>de</strong> gérer la circulation <strong>de</strong>s eaux. Il est encore très utilisé pour la pâture. Ces prairies, par un<br />
entretien extensif et <strong>de</strong>s caractéristiques naturelles (inondations régulières, humidité du sol)<br />
connaissent le développement d’une flore rare et diversifiée, permettant l’accueil <strong>de</strong> nombreux oiseaux,<br />
insectes ou batraciens. Elles jouent également un rôle important dans le fonctionnement <strong>de</strong><br />
l’hydrosystème <strong>de</strong> la Loire, en tant que zones d’expansion <strong>de</strong>s crues. Elles permettent par ailleurs <strong>de</strong><br />
meilleurs échanges entre le fleuve et la nappe (infiltrations) et jouent le rôle d’épuration naturelle <strong>de</strong>s<br />
eaux.<br />
La confluence entre les étiers et la Loire est le siège <strong>de</strong> milieux naturels similaires, où les roselières se<br />
développent à proximités <strong>de</strong>s vasières régulièrement recouvertes. Cette alternance <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s inondées<br />
et exondées, par les marées ou inondations saisonnières, conduit au développement d’une flore<br />
caractéristique remarquable.<br />
<br />
<strong>Le</strong> plateau agricole bocager<br />
Une gran<strong>de</strong> partie du territoire communal <strong>de</strong> Couëron est encore occupée par les activités agricoles. Plus<br />
précisément, on rencontre principalement sur la commune <strong>de</strong>s terres <strong>de</strong>stinées aux cultures céréalières<br />
et fourragères, parcourues par un bocage <strong>local</strong>ement <strong>de</strong>nse ou lâche.<br />
Ce plateau est sillonné par plusieurs petits cours d’eau qui forment <strong>de</strong>s vallons, jouant le rôle <strong>de</strong> coulées<br />
vertes. La vallée <strong>de</strong> la Chézine, au Nord <strong>de</strong> la commune longe et traverse la RN 165. Ensuite, son vallon<br />
traverse <strong>de</strong>s zones boisées et bocagères <strong>de</strong> qualité paysagère et écologique. <strong>Le</strong> vallon du Drillet à l’est<br />
présente un caractère plus enfriché.<br />
85
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
86
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
2. <strong>Le</strong>s composantes paysagères naturelles<br />
<strong>Le</strong> territoire <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Couëron est limité au Nord, au Sud, au Sud-Ouest et à l'Est par les espaces<br />
naturels <strong>de</strong> la Chézine, <strong>de</strong> la Loire, du Marais Audubon et du Drillet. L'agglomération, située en bord <strong>de</strong><br />
Loire, s'étire le long <strong>de</strong> la RD17, son extension est aujourd'hui limitée par la voie ferrée qui cadre le<br />
quartier <strong>de</strong> la Chabossière au nord et le centre-ville au sud.<br />
<br />
<strong>Le</strong> paysage <strong>de</strong> Loire, un paysage déterminé par ses rives<br />
La Loire possè<strong>de</strong> son paysage propre (lumière, rythme <strong>de</strong>s marées, <strong>de</strong>s bateaux, et <strong>de</strong>s différents usages<br />
associés au fleuve), mais celui-ci revêt <strong>de</strong>s caractères différents suivant l'occupation du sol (alternance <strong>de</strong><br />
zones d'habitat, d'usines et d'espaces naturels).<br />
En effet, la Loire a généré l'im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong> zones industrielles sur ses rives, soit au sein d'un paysage<br />
<strong>plan</strong> <strong>de</strong> marais, soit en limite <strong>de</strong> zones d'habitat, orientées sur la Loire. Ainsi, le caractère rigi<strong>de</strong> et minéral<br />
<strong>de</strong> l'urbanisation et <strong>de</strong>s zones industrielles alterne avec un caractère plus souple mais assez fermé et<br />
mouvant <strong>de</strong> roselières et <strong>de</strong> saulaies.<br />
La Loire <strong>de</strong>vant Couëron<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
87
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Paysage <strong>plan</strong> du Marais Audubon<br />
<strong>Le</strong> marais Audubon est caractérisé par un paysage homogène assez ouvert, <strong>plan</strong>, constitué notamment<br />
<strong>de</strong> prairies inondées, irriguées, découpées et orientées par les étiers bordés ou non <strong>de</strong> frênes émondés et<br />
<strong>de</strong> saules.<br />
Vue sur un étier dans le marais Audubon<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
<br />
Paysage <strong>de</strong> zone humi<strong>de</strong><br />
Il s'agit <strong>de</strong>s vallées <strong>de</strong> la Chézine et du Drillet, paysages fermés par les peupliers, une ripisylve <strong>de</strong>nse ou<br />
<strong>de</strong>s espaces naturels boisés au caractère enfriché.<br />
<strong>Le</strong>s abords du lac <strong>de</strong> Beaulieu offre un paysage plus ouvert <strong>de</strong> prairies humi<strong>de</strong>s, ponctuées d'une<br />
structure bocagère arborée <strong>de</strong> frênes émondés.<br />
<strong>Le</strong>s marais <strong>de</strong> Beaulieu<br />
Lac <strong>de</strong> Beaulieu et bocage attenant<br />
<br />
88
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Paysage agricole <strong>de</strong> bocage<br />
Il s’agit d’un paysage <strong>de</strong> bocage plus ou moins serré, avec une tendance à une fermeture en fond <strong>de</strong><br />
vallons humi<strong>de</strong>s (ou ponctuellement sous forme <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>s sur les hauteurs).<br />
<strong>Le</strong> paysage s'ouvre sur les hauteurs, offrant quelques perceptions plus lointaines.<br />
Des petits cours d'eau modèlent et ponctuent le territoire, nuançant le paysage agricole fermé <strong>de</strong> bocage.<br />
Ils apparaissent sous formes d'un paysage fermé par les peupliers et les boisements ou bien d'un paysage<br />
plus ouvert au relief doux, accompagné ou non <strong>de</strong> saules ou <strong>de</strong> frênes émondés.<br />
<strong>Le</strong> paysage agricole est mité par l'habitat, n'offrant que <strong>de</strong> rares espaces préservés <strong>de</strong> l'urbanisation<br />
(présence quasi générale d'une co-visibilité <strong>de</strong> l'espace agricole ou naturel avec <strong>de</strong> l'habitat).<br />
Vache dans le Marais Audubon<br />
Photo : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Un tracteur dans le Marais Audubon<br />
Photo : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Reliquat <strong>de</strong> haies <strong>de</strong> chêne têtard sur le plateau agricole<br />
Photo : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Un exemple <strong>de</strong> boisement dans la zone agricole<br />
Photo : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
89
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
90
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIIIII- LE PATRIIMOIINE VEGETAL<br />
<strong>Le</strong> patrimoine végétal <strong>de</strong> la commune est lié à son patrimoine naturel et agricole.<br />
<strong>Le</strong>s boisements alluviaux et le réseau bocager contiennent <strong>de</strong> nombreux arbres remarquables.<br />
Ainsi les secteurs <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Chézine, <strong>de</strong> la Loire, Marais Audubon et du Drillet, étier <strong>de</strong> Beaulieu,<br />
vallée <strong>de</strong> la Patissière sont riches en haies <strong>de</strong> saules ou <strong>de</strong> frênes souvent émondés.<br />
<strong>Le</strong> plateau agricole présente un paysage <strong>de</strong> bocage plus ou moins serré et souvent arboré (chêne,<br />
châtaigner).<br />
La vallée <strong>de</strong> la Chézine sera à valoriser dans le cadre <strong>de</strong> la forêt urbaine.<br />
Enfin, le territoire communal comporte quelques massifs boisés qui, outre une qualité végétale<br />
significative, présentent une capacité à limiter l’impact paysager <strong>de</strong>s constructions, à structurer le<br />
paysage dans les espaces ouverts, à créer <strong>de</strong>s liens avec les autres unités environnementales et<br />
i<strong>de</strong>ntitaire du territoire. Un recensement pour mise à jour reste à effectuer.<br />
1. <strong>Le</strong>s espaces naturels protégés<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron étant dotée <strong>de</strong> milieux naturels exceptionnels, le nombre <strong>de</strong> dispositions visant<br />
à leur protection est varié.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s ZNIEFF<br />
L’inventaire <strong>de</strong>s Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif<br />
<strong>de</strong> réaliser une couverture <strong>de</strong>s zones les plus intéressantes au <strong>plan</strong> écologique, essentiellement dans la<br />
perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et <strong>de</strong> fournir aux différents<br />
déci<strong>de</strong>urs un outil d’ai<strong>de</strong> à la prise en compte <strong>de</strong> l’environnement dans l’aménagement du territoire.<br />
Ces ZNIEFF représentent le résultat d’un inventaire scientifique. <strong>Le</strong>ur valeur en jurispru<strong>de</strong>nce est attestée.<br />
Il faut distinguer <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> classement :<br />
• <strong>Le</strong>s ZNIEFF <strong>de</strong> type I désignent « <strong>de</strong>s secteurs d’une superficie en général limitée caractérisée par<br />
la présence d’espèces, d’association d’espèces ou <strong>de</strong> milieux rares, remarquables, ou<br />
caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national ». Ces secteurs, inventoriés<br />
par <strong>de</strong>s naturalistes et <strong>de</strong>s scientifiques, peuvent révéler la présence d’espèces protégées par la<br />
loi, mais le plus souvent, soit la présence d’espèces rares - ou en raréfaction - et <strong>local</strong>isées, soit<br />
<strong>de</strong>s espèces en limite d’aire <strong>de</strong> répartition, mais toujours d’intérêt écologique ;<br />
• <strong>Le</strong>s ZNIEFF <strong>de</strong> type II désignent les « grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui<br />
offrent <strong>de</strong>s potentialités biologiques importantes ». Ces zones plus vastes sont le siège <strong>de</strong><br />
milieux souvent relictuels, singuliers et/ou <strong>local</strong>isés, mais généralement sans espèce strictement<br />
protégée.<br />
L’inventaire ZNIEFF a été réalisé en Loire-Atlantique durant les années 1980. Il a été actualisé par <strong>de</strong>s<br />
ZNIEFF dites <strong>de</strong> "<strong>de</strong>uxième génération".<br />
A Couëron, <strong>de</strong>ux ZNIEFF <strong>de</strong> type II <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième génération et quatre ZNIEFF <strong>de</strong> type I <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième<br />
génération ont été répertoriés.<br />
91
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
ZNIEFF type II <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième génération N°10010000 : « Vallée <strong>de</strong> la Loire à l’aval <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> ».<br />
Il s’agit d’une zone d'un intérêt écologique élevé constituée <strong>de</strong> milieux très diversifiés en fonction du<br />
<strong>de</strong>gré d'humidité et du caractère plus ou moins halophile <strong>de</strong> certaines zones. Elle se compose<br />
d’importantes surfaces <strong>de</strong> prairies naturelles inondables sillonnées <strong>de</strong> canaux et d'étiers, <strong>de</strong> vasières et<br />
<strong>de</strong> roselières à forte productivité primaire... Cette zone présente une valeur exceptionnelle sur le <strong>plan</strong><br />
botanique, abritant <strong>de</strong> nombreux groupements végétaux hygrophiles à mésophiles, avec <strong>de</strong><br />
remarquables variations <strong>de</strong> l'amont vers l'aval en fonction du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> salinité. De nombreuses <strong>plan</strong>tes<br />
rares ou menacées sont présentes, dont certaines protégées au niveau national ou régional. Ce site est<br />
également <strong>de</strong> valeur internationale pour l'avifaune migratrice, hivernante et nicheuse, abritant plusieurs<br />
oiseaux rares ou menacés, dont certaines espèces sont concernées par la directive européenne relative à<br />
la conservation <strong>de</strong>s oiseaux sauvages. Sur le <strong>plan</strong> ichtyologique, les vasières encore existantes<br />
constituent <strong>de</strong>s zones essentielles pour la croissance <strong>de</strong> diverses espèces <strong>de</strong> poissons marins. La présence<br />
<strong>de</strong> plusieurs espèces <strong>de</strong> mammifères, <strong>de</strong> reptiles, <strong>de</strong> batraciens et d'insectes rares dans notre région vient<br />
aussi confirmer l'intérêt faunistique remarquable <strong>de</strong> cette zone.<br />
> Cette ZNIEFF couvre le lit mineur <strong>de</strong> la Loire, les marais Audubon à l’Ouest, et les étiers à l’Est.<br />
ZNIEFF type II <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième génération N°11450000 BOCAGE DES LANDES DE HAUT<br />
Il s’agit d’une petite zone bocagère bien préservée, traversée par le ruisseau <strong>de</strong> la Chézine. On note la<br />
présence d'une espèce végétale protégée sur le <strong>plan</strong> national (Luronium natans) dans les mares et le<br />
ruisseau. <strong>Le</strong> peuplement d'odonates est intéressant avec en particulier <strong>de</strong>ux espèces rares ou menacées<br />
dont une protégée sur le <strong>plan</strong> national.<br />
> Cette ZNIEFF occupe l’extrémité Nord-ouest <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Couëron.<br />
ZNIEFF type I <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième génération N° 10010009 : « Prairies <strong>de</strong> Saint-Jean-<strong>de</strong>-Boiseau à Bouguenais »<br />
Cette zone naturelle est essentiellement composées <strong>de</strong> prairies humi<strong>de</strong>s inondables aux gran<strong>de</strong>s marées,<br />
d’anciens bras colmatés également inondables aux gran<strong>de</strong>s marées, et <strong>de</strong> roselières.<br />
L’intérêt floristique repose sur <strong>de</strong>s groupements végétaux hygrophiles et méso-hygrophiles variés, en<br />
fonction du <strong>de</strong>gré d’humidité et du mo<strong>de</strong> d’exploitation, avec roselières à dominance <strong>de</strong> roseau,<br />
baldingère et gran<strong>de</strong> glycérie selon les points, quelques boisements <strong>de</strong> saules, <strong>de</strong>s prairies pâturées et <strong>de</strong><br />
fauche. A noter la présence <strong>de</strong> diverses <strong>plan</strong>tes rares dont plusieurs protégées, comme l’angélique <strong>de</strong>s<br />
estuaires et le scirpe triquètre en bordure <strong>de</strong> Loire, la gratiole officinale et le trèfle <strong>de</strong> Micheli sur les<br />
prairies.<br />
L’intérêt ornithologique repose sur une avifaune nicheuse caractéristique <strong>de</strong>s prairies <strong>de</strong> fauche et <strong>de</strong>s<br />
roselières, avec certaines espèces rares et menacées (râle <strong>de</strong>s genêts, pie-grièche écorcheur, rousserole<br />
turdoï<strong>de</strong>, locustelle luscinoï<strong>de</strong>). Zones <strong>de</strong> gagnage essentielle pour les anatidés et les limicoles<br />
migrateurs hivernants, les roselières constituent aussi une halte migratoire indispensable pour les<br />
fauvettes paludicoles.<br />
> Cette ZNIEFF ne concerne qu’une petite frange au sud du territoire communal.<br />
ZNIEFF type I <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième génération N°10010006 : « Zone <strong>de</strong> Cor<strong>de</strong>mais à Couëron »<br />
<strong>Le</strong>s types <strong>de</strong> milieux rencontrés sur cette ZNIEFF sont <strong>de</strong>s prairies humi<strong>de</strong>s inondables lors <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
marées, quelques roselières, <strong>de</strong> petites vasières en bordure <strong>de</strong> rive, <strong>de</strong>s milieux aquatiques et d’anciens<br />
bras colmatés inondables à marée haute.<br />
Il s’agit donc aussi d’un ensemble très varié <strong>de</strong> zones humi<strong>de</strong>s, régulièrement inondables au niveau <strong>de</strong>s<br />
anciens bras où se trouvent <strong>de</strong>s roselières et autres formations <strong>de</strong> grands hélophytes, avec ailleurs une<br />
gamme étendue <strong>de</strong> divers types hygrophiles, méso-hygrophiles et mésophiles, montrant en divers points<br />
<strong>de</strong> remarquables zonations.<br />
92
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
On y rencontre divers groupements végétaux et espèces subhalophiles en limite amont, ainsi que <strong>de</strong><br />
nombreuses <strong>plan</strong>tes rares ou protégées comme l’angélique <strong>de</strong>s estuaires ou la gratiole officinale. On<br />
note enfin l’abondance en certains points <strong>de</strong> la fritillaire, au voisinage <strong>de</strong> sa limite occi<strong>de</strong>ntale.<br />
Pour l’avifaune, ce site est également une importante remise pour les anatidés et les limicoles,<br />
notamment lors <strong>de</strong>s inondations printanières (halte migratoire au cours <strong>de</strong> la migration prénuptiale) au<br />
niveau <strong>de</strong> la réserve <strong>de</strong> chasse <strong>de</strong>s Baracons. <strong>Le</strong>s prairies <strong>de</strong> fauche et les roselières abritent aussi une<br />
avifaune intéressante et caractéristique dont certaines espèces sont rares, voire menacées (râle <strong>de</strong>s<br />
genets, marouette ponctuée, rousserole turdoï<strong>de</strong>, pie-grièche écorcheur…).<br />
> Cette ZNIEFF concerne le marais Audubon.<br />
ZNIEFF type I <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième génération N°10010014 MARAIS ET LAC DE BEAULIEU<br />
Il s’agit d’une zone marécageuse constituée <strong>de</strong> prairies inondables, <strong>de</strong> roselières variées et <strong>de</strong> cariçaies et<br />
d'un lac artificiel, abritant une flore intéressante et une riche diversité d'Odonates. Cette ZNIEFF subit<br />
une pression et <strong>de</strong>s dégradations importantes liées à la pression <strong>de</strong>s activités humaines.<br />
> Cette ZNIEFF concerne le lac et l’étier <strong>de</strong> Beaulieu et les marais attenants à l’Ouest.<br />
ZNIEFF type I <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième génération N°10010007 ARRIERE DES MARAIS DE LA CAUDELAIS A L'ETANG<br />
BERNARD<br />
Il s’agit d’un ensemble bien diversifié <strong>de</strong> prairies inondables argileuses à tourbeuses, hygrophiles à<br />
mésohygrophiles sillonnées <strong>de</strong> douves, abritant une flore riche comprenant <strong>de</strong> nombreuses <strong>plan</strong>tes<br />
intéressantes dont plusieurs protégées sur le <strong>plan</strong> national ou régional.<br />
Cette ZNIEFF constitue une intéressante zone <strong>de</strong> gagnage pour l'avifaune migratrice et hivernante<br />
(anatidés et limicoles en particulier) et zone <strong>de</strong> reproduction pour diverses espèces d'oiseaux rares dans<br />
notre région (rallidés, Cigogne blanche..).<br />
Cette ZNIEFF concerne principalement la commune <strong>de</strong> Saint-Etienne-<strong>de</strong>-Montluc ; seule une<br />
petite zone à l’Ouest <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Coüeron est concernée.<br />
93
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s ZICO<br />
La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite "directive Oiseaux" vise à assurer une protection <strong>de</strong> toutes les<br />
espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen.<br />
Elle impose aux États membres l'interdiction <strong>de</strong> les tuer ou <strong>de</strong> les capturer intentionnellement, <strong>de</strong><br />
détruire ou d'endommager leurs nids, <strong>de</strong> ramasser leurs œufs dans la nature, <strong>de</strong> les perturber<br />
intentionnellement ou <strong>de</strong> les détenir (exception faite <strong>de</strong>s espèces dont la chasse est autorisée).<br />
Chaque pays <strong>de</strong> l'Union Européenne a charge d'inventorier sur son territoire les Zones Importantes pour<br />
la Conservation <strong>de</strong>s Oiseaux et d'y assurer la surveillance et le suivi <strong>de</strong>s espèces. <strong>Le</strong>s ZICO sont <strong>de</strong>s sites<br />
reconnus d’importance internationale , qui ont été sélectionnés à partir <strong>de</strong> critères scientifiques et dont<br />
l’inventaire offre une liste <strong>de</strong>s zones prioritaires pour la désignation <strong>de</strong>s ZPS dans chaque Etat Membre<br />
<strong>de</strong> l’Union Européenne. La valeur scientifique <strong>de</strong> cet inventaire a été reconnue par la Cour <strong>de</strong> Justice <strong>de</strong>s<br />
Communautés Européennes et la Commission Européenne. Il s’agit donc <strong>de</strong> la première étape du<br />
processus pouvant conduire à la désignation <strong>de</strong> ZPS (Zones <strong>de</strong> Protection Spéciale), sites effectivement<br />
proposés pour intégrer le réseau Natura 2000. Précisons également que l’annexe I <strong>de</strong> la directive Oiseaux<br />
énumère les espèces les plus menacées <strong>de</strong> la Communauté.<br />
En France, l'inventaire <strong>de</strong>s ZICO a été conduit en 1990/1991 par la Ligue pour la Protection <strong>de</strong>s Oiseaux et<br />
le service du Patrimoine Naturel du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du ministère<br />
<strong>de</strong> l'Environnement.<br />
L'annexe I <strong>de</strong> la directive Oiseaux énumère les espèces les plus menacées <strong>de</strong> la Communauté ; elles<br />
doivent donc faire l'objet <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer<br />
leur survie et leur reproduction. À cet effet, chaque État classe les ZICO les plus appropriées en nombre et<br />
en superficie à la conservation <strong>de</strong> ces espèces en Zones <strong>de</strong> Protection Spéciales (ZPS) afin que puissent y<br />
être mises en œuvre <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection et/ou <strong>de</strong> restauration.<br />
Une ZICO est répertoriée sur la commune <strong>de</strong> Couëron ; il s’agit <strong>de</strong> la zone « Estuaire <strong>de</strong> la Loire » (co<strong>de</strong><br />
régional PL 03).<br />
L’ensemble est constitué d’une vaste zone estuarienne comprenant le fleuve et son embouchure avec ses<br />
vasières et ses prés-salés, mais aussi ses marais, ses roselières et ses prairies humi<strong>de</strong>s attenantes. Cette<br />
zone humi<strong>de</strong> figure comme site d’importance internationale pour l’hivernage <strong>de</strong>s oiseaux d’eau, tel que<br />
les anatidés et les limicoles (sarcelle d’hiver, canard souchet, avocette, etc …). Cet estuaire joue aussi un<br />
rôle majeur en tant que halte migratoire pour les fauvettes paludicoles en particulier, et abrite une<br />
avifaune nicheuse d’un grand intérêt (tadorne <strong>de</strong> Belon, sarcelle d’hiver et d’été, busard <strong>de</strong>s roseaux, râle<br />
<strong>de</strong>s genêts, barge à queue noire, gravelot à collier interrompu, gorgebleue, rousserolle turdoï<strong>de</strong>, etc…).<br />
> A Couëron, cette ZICO concerne le lit <strong>de</strong> la Loire et ses abords, le marais Audubon, l’étier <strong>de</strong> Beaulieu,<br />
et les étiers à l’Est.<br />
<strong>Le</strong> réseau NATURA 2000<br />
« L'Union européenne a adopté <strong>de</strong>ux directives, l'une en 1979, l'autre en 1992 pour donner aux Etats<br />
membres un cadre commun d'intervention en faveur <strong>de</strong> la préservation <strong>de</strong>s milieux naturels.<br />
La directive du 2 avril 1979 dite directive "Oiseaux" prévoit la protection <strong>de</strong>s habitats nécessaires à la<br />
reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle <strong>de</strong><br />
l'Europe. Dans chaque pays <strong>de</strong> l'Union européenne seront classés en Zone <strong>de</strong> Protection Spéciale (ZPS) les<br />
sites les plus adaptés à la conservation <strong>de</strong>s habitats <strong>de</strong> ces espèces en tenant compte <strong>de</strong> leur nombre et<br />
<strong>de</strong> leur superficie. Pour déterminer ces sites, un inventaire a été réalisé, dénommé ZICO, zones<br />
d’importance pour la conservation <strong>de</strong>s oiseaux.<br />
La directive du 21 mai 1992 dite directive "Habitats" promeut la conservation <strong>de</strong> 253 types d’habitats<br />
naturels, <strong>de</strong> 200 espèces d’animaux et <strong>de</strong> 434 espèces végétales figurant aux annexes <strong>de</strong> la directive<br />
Habitats. De plus, plusieurs autres sites pressentis ont été transmis à la Commission. Ils sont appelés<br />
actuellement pSIC (propositions <strong>de</strong> sites d'intérêt communautaire). Après désignation formelle par la<br />
Commission Européenne et la France, ils <strong>de</strong>viendront <strong>de</strong>s Zones Spéciales <strong>de</strong> Conservation (ZSC).<br />
94
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La directive s'applique sur le territoire européen <strong>de</strong>s vingt-cinq Etats membres. Elle concerne :<br />
- les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger <strong>de</strong> disparition dans<br />
leur aire <strong>de</strong> répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire <strong>de</strong> répartition réduite par suite<br />
<strong>de</strong> leur régression ou en raison <strong>de</strong> leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils<br />
constituent <strong>de</strong>s exemples remarquables <strong>de</strong> caractéristiques propres à l'une ou plusieurs <strong>de</strong>s<br />
six régions biogéographiques (alpine, atlantique, continentale, macaronésienne,<br />
méditerranéenne et boréale) ; les types d'habitats concernés sont mentionnés à l'annexe I ;<br />
- les habitats abritant <strong>de</strong>s espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger,<br />
vulnérables, rares ou endémiques ; les espèces concernées sont mentionnées à l'annexe II ;<br />
- les éléments <strong>de</strong> paysage qui, <strong>de</strong> par leur structure linéaire et continue ou leur rôle <strong>de</strong> relais,<br />
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique<br />
d'espèces sauvages.<br />
Par ailleurs, la directive liste dans son annexe IV, les espèces dont les Etats doivent assurer la protection.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs sont la protection <strong>de</strong> la biodiversité dans l'Union européenne, le maintien ou le<br />
rétablissement dans un état <strong>de</strong> conservation favorable <strong>de</strong>s habitats naturels et <strong>de</strong>s espèces <strong>de</strong> faune et<br />
<strong>de</strong> flore sauvages d'intérêt communautaire, la conservation <strong>de</strong>s habitats naturels (listés à l'annexe I <strong>de</strong> la<br />
directive) et <strong>de</strong>s habitats d'espèces (listés à l'annexe II <strong>de</strong> la directive) par la désignation <strong>de</strong> zones<br />
spéciales <strong>de</strong> conservation (ZSC) qui peuvent faire l'objet <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> protection<br />
particulières, la mise en place du réseau Natura 2000 constitué <strong>de</strong>s zones spéciales <strong>de</strong> conservation (ZSC)<br />
et <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> protection spéciale (ZPS).<br />
<strong>Le</strong> réseau Natura 2000, en cours <strong>de</strong> constitution, doit également permettre <strong>de</strong> réaliser les objectifs fixés<br />
par la convention sur la diversité biologique, adoptée lors du "Sommet <strong>de</strong> la Terre" <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro en<br />
1992 et ratifiée par la France en 1996. Natura 2000 a pour objectif <strong>de</strong> maintenir la diversité biologique<br />
<strong>de</strong>s milieux en tenant compte <strong>de</strong>s exigences économiques, sociales, culturelles et régionales qui s'y<br />
attachent. Voilà pourquoi le réseau va donner lieu à l'élaboration <strong>de</strong> contrats. »<br />
A Couëron, la vallée alluviale <strong>de</strong> la Loire est concernée par <strong>de</strong>ux zonages du réseau Natura 2000.<br />
ZPS n° FR 5210103 et SIC n°FR5200621 <strong>de</strong> l’Estuaire <strong>de</strong> la Loire.<br />
La vallée alluviale <strong>de</strong> la Loire au Pellerin est incluse dans une vaste zone concernant l’estuaire <strong>de</strong> la Loire.<br />
Il s’agit d’une zone humi<strong>de</strong> estuarienne constituée par l'embouchure du fleuve et ses marais attenants.<br />
<strong>Le</strong> site présente un ensemble <strong>de</strong> milieux très diversifiés en fonction du gradient d'humidité et du<br />
caractère plus ou moins halophile <strong>de</strong> certaines zones. L’estuaire est soumis dans toute la zone au régime<br />
<strong>de</strong>s marées, et se compose <strong>de</strong> petites zones dunaires et îlots rocheux à l'aval, zones humi<strong>de</strong>s d'une<br />
extrême diversité avec vasières, roselières, prairies inondables <strong>local</strong>ement tourbeuses...<br />
L’ensemble est exceptionnel sur le <strong>plan</strong> floristique, avec <strong>de</strong>s groupements végétaux particulièrement<br />
diversifiés : scirpaies maritimes et roselières pionnières colonisant les anciennes vasières et les anciens<br />
bras, diverses formations <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s herbes avec remarquable association riveraine à angélique <strong>de</strong>s<br />
estuaires, vastes étendues <strong>de</strong> prairies hygrophiles à mésophiles, avec riches associations subhalophiles.<br />
Il s'agit aussi d'un site exceptionnel pour la faune, d'intérêt international par les espèces qui s'y<br />
reproduisent, notamment pour l'avifaune avec le Râle <strong>de</strong>s genêts, la Marouette ponctuée, la Guifette<br />
noire, le Busard <strong>de</strong>s roseaux la Cigogne blanche, l'Avocette et l'Echasse... Avec <strong>de</strong>s effectifs <strong>de</strong> canards<br />
supérieurs à 20 000 individus, c'est aussi un site <strong>de</strong> migration et d'hivernage <strong>de</strong> toute première<br />
importance. Notons aussi la présence <strong>de</strong> population <strong>de</strong> loutres, et d’un insecte remarquable : la Rosalie<br />
<strong>de</strong>s Alpes.<br />
95
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Site classé<br />
Cet outil réglementaire concerne la protection du patrimoine naturel et culturel.<br />
Un site classé est un site <strong>de</strong> caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont<br />
la préservation ou la conservation présentent un intérêt général.<br />
Toute modification <strong>de</strong> l'état <strong>de</strong>s lieux est soumise à l'autorisation spéciale du ministre chargé <strong>de</strong><br />
l'environnement, après avis <strong>de</strong> la commission départementale <strong>de</strong>s sites et, si le ministre le juge utile, <strong>de</strong><br />
la commission supérieure <strong>de</strong>s sites. Pour les travaux <strong>de</strong> moindre importance, énumérés par le décret du<br />
15/12/1998, l'autorisation est du ressort du préfet <strong>de</strong> département.<br />
> Sur la commune <strong>de</strong> Couëron, on recense un site classé au titre <strong>de</strong> la loi du 2 mai 1930, il concerne<br />
l’estuaire <strong>de</strong> la Loire (décret du 25 avril 2002, site n°44SC53).<br />
<br />
Arrêté Préfectoral <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong> Biotope (APB)<br />
Cet arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation <strong>de</strong>s biotopes nécessaires à la survie<br />
d'espèces protégées. La réglementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent.<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron est concernée par l’APB N°44006 « STATIONS D'ANGELIQUE DES<br />
ESTUAIRES ». Cette zone est située en bordure <strong>de</strong> la Loire au sud du centre-ville.<br />
Intérêt biologique : une espèce floristique exceptionnelle, l’Angélique <strong>de</strong>s Estuaires<br />
Caractéristiques et répartition<br />
L'angélique <strong>de</strong>s estuaires ne se rencontre que dans les grands estuaires du<br />
littoral Atlantique français, soumis à la marée. L’estuaire <strong>de</strong> la Loire est un<br />
<strong>de</strong>s rares territoires à possé<strong>de</strong>r cette espèce.<br />
L'angélique <strong>de</strong>s estuaires est une <strong>plan</strong>te <strong>de</strong> berge envasée, détrempée ou<br />
inondée, strictement <strong>local</strong>isée à la zone <strong>de</strong> balancement <strong>de</strong>s marées.<br />
L'angélique <strong>de</strong>s estuaires est capable <strong>de</strong> s'installer sur différents substrats :<br />
vases, remblais et enrochements récents envasés, digues, appontements,<br />
souches d'arbres ou arbres vivants, sables vaseux. Mais les plus belles<br />
populations d'angélique <strong>de</strong>s estuaires se trouvent surtout sur les berges<br />
envasées, le plus souvent peu pentues, et sous couvert <strong>de</strong> forêt riveraine.<br />
96
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
L'angélique <strong>de</strong>s estuaires se maintient en Loire-Atlantique dans une zone d'environ 50 km le long <strong>de</strong><br />
l'estuaire.<br />
Cependant, une migration <strong>de</strong> l'espèce a été constatée <strong>de</strong>puis les années 1970 en liaison avec <strong>de</strong>s<br />
modifications dans le fonctionnement écologique <strong>de</strong> l'estuaire sur le <strong>plan</strong> <strong>de</strong> la salinité et <strong>de</strong> la<br />
sédimentation.<br />
Menaces sur l’espèce et protection à mettre en œuvre<br />
Elle est menacée aujourd’hui par :<br />
- L'augmentation <strong>de</strong> la salinité <strong>de</strong>s eaux,<br />
- L'érosion <strong>de</strong> berges,<br />
- L'artificialisation <strong>de</strong>s berges,<br />
- L'enfrichement <strong>de</strong>s berges.<br />
Aujourd'hui, l'angélique <strong>de</strong>s estuaires est présente en tant qu'espèce prioritaire sur la liste rouge <strong>de</strong> la<br />
flore menacée <strong>de</strong> France. Cela représente une très forte responsabilité pour la France et, en particulier,<br />
pour l'estuaire <strong>de</strong> la Loire, qui rassemble le tiers <strong>de</strong> la population mondiale d'Angelica Heterocarpa.<br />
97
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Ainsi, <strong>de</strong>s efforts doivent être faits pour éviter tout ce qui pourrait nuire à l'épanouissement <strong>de</strong> la <strong>plan</strong>te,<br />
comme par exemple :<br />
- les dépôts sauvages <strong>de</strong> remblais ou déchets sur les berges,<br />
- l'emploi d'herbici<strong>de</strong>s sur les berges,<br />
- l'érosion <strong>de</strong>s berges sous l'effet du batillage dû aux bateaux ou au pâturage en bordure <strong>de</strong><br />
berge,<br />
- l'entretien trop précoce <strong>de</strong>s berges par fauche.<br />
<strong>Le</strong>s conditions <strong>de</strong> préservation<br />
<strong>Le</strong> maintien et la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> cette espèce passent avant tout par le<br />
respect <strong>de</strong>s conditions optimales <strong>de</strong> son développement :<br />
- Faible <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> salinité <strong>de</strong>s eaux,<br />
- Berges comprises entre le niveau moyen <strong>de</strong>s marées et celui<br />
<strong>de</strong>s pleines mers <strong>de</strong> vives eaux,<br />
- Substrats constitués <strong>de</strong> vases colmatées,<br />
- Berges en pente douce et replats immergés à marée haute,<br />
émergés à marée basse ;<br />
- Berges peu ou pas érodées,<br />
- Présence d'une couverture arborée.<br />
Mesures <strong>de</strong> protection<br />
L'angélique <strong>de</strong>s estuaires est protégée au niveau européen par la Directive Habitats (annexe II). Elle est<br />
par ailleurs inscrite dans :<br />
- <strong>Le</strong> livre rouge <strong>de</strong> la flore menacée <strong>de</strong> France,<br />
- La liste <strong>de</strong>s espèces protégées en France <strong>de</strong>puis 1982,<br />
- <strong>Le</strong>s Conventions <strong>de</strong> Berne et <strong>de</strong> Washington,<br />
- <strong>Le</strong> livre rouge <strong>de</strong> l'Union internationale pour la conservation <strong>de</strong> la nature.<br />
La zone délimitée par l’arrêté <strong>de</strong> biotope abrite une <strong>de</strong>s plus belles populations <strong>de</strong> l’Estuaire <strong>de</strong> la Loire.<br />
Effets <strong>de</strong> la protection :<br />
1) Il est interdit <strong>de</strong> jeter, d'épandre, <strong>de</strong> laisser écouler, d'abandonner tous produits inertes ou chimiques,<br />
tous matériaux, résidus, déchets ou quelque substance que ce soit, qui soit susceptible <strong>de</strong> dégra<strong>de</strong>r le<br />
biotope et les spécimens d'Angélique <strong>de</strong>s estuaires.<br />
2) Il est interdit d'introduire <strong>de</strong>s espèces végétales non spontanées ou allochtones, d'arracher ou <strong>de</strong><br />
couper <strong>de</strong>s arbres et arbustes sauf pour <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> sécurité publique ou dans le cadre d'une gestion<br />
raisonnée <strong>de</strong>s ligneux dans un souci exclusif <strong>de</strong> préservation du biotope et <strong>de</strong>s populations, d'effectuer<br />
<strong>de</strong>s brûlages et broyages <strong>de</strong> végétaux.<br />
3) Toute construction, installation ou ouvrage nouveaux sont interdits. Il est également interdit<br />
d'effectuer <strong>de</strong>s creusements, remblais ou apports <strong>de</strong> matériaux à l'exception :<br />
- <strong>de</strong>s travaux nécessaires à l'entretien, à la restauration ou à l'aménagement du site,<br />
- <strong>de</strong> ceux nécessaires au maintien <strong>de</strong> la stabilité <strong>de</strong>s berges ou pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> sécurité publique.<br />
98
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
L’engagement <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
<strong>Le</strong> développement durable est aujourd'hui au cœur du développement <strong>de</strong> l'espace communautaire. La<br />
préservation d’une espèce en milieu urbain conduit la communauté urbaine à développer sa capacité<br />
d’imaginer <strong>de</strong>s façons nouvelles <strong>de</strong> concevoir l’urbanisme et l’aménagement.<br />
En avril 2004, <strong>Nantes</strong> Métropole a présenté au Comité National <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong> la Nature un projet <strong>de</strong><br />
<strong>plan</strong> <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong> l'espèce innovant, intégrant la compatibilité <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> l'espèce avec les<br />
exigences d'une ville toujours en mouvement.<br />
L’intérêt biologique <strong>de</strong> ces berges rési<strong>de</strong> dans la présence <strong>de</strong> l’Angélique <strong>de</strong>s estuaires (Angelica<br />
heterocarpa). Il s’agit d’une <strong>plan</strong>te rare, endémique ouest-atlantique, protégée au niveau national, qui<br />
figure également en annexe 2 <strong>de</strong> la directive Habitats et considérée comme vulnérable par le « Livre<br />
rouge <strong>de</strong> la Flore menacée <strong>de</strong> France » (Tome 1 – espèces prioritaires). L’estuaire <strong>de</strong> la Loire constitue un<br />
noyau majeur <strong>de</strong> sa population. L’essentiel <strong>de</strong>s stations <strong>de</strong> l’estuaire se concentre dans l’agglomération<br />
nantaise, hors du site Natura 2000, et sont soumises à <strong>de</strong> fortes menaces, du fait <strong>de</strong> l’anthropisation <strong>de</strong>s<br />
milieux qu’elles recouvrent. Par ailleurs, l’espèce est en régression aussi bien en aval qu’en amont <strong>de</strong><br />
l’agglomération, notamment du fait <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong> la salinité vers l’amont <strong>de</strong> l’estuaire.<br />
99
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
100
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong>s Espaces Naturels Sensibles<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron est concernée par une zone <strong>de</strong> préemption au titre <strong>de</strong>s Espaces Naturels<br />
Sensibles, à l’intérieur <strong>de</strong> laquelle le Département a un droit <strong>de</strong> préemption ainsi que la commune par<br />
substitution. Cette zone a été délimitée par délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 1993 et<br />
par délibération du Conseil Général <strong>de</strong> Loire-Atlantique du 7 octobre 1994.<br />
Cette zone <strong>de</strong> préemption, située sur le secteur du marais Audubon, doit être reportée, au titre <strong>de</strong> l’article<br />
R123-13 alinéa 3, sur un ou plusieurs documents graphiques.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs <strong>de</strong> cette action sont <strong>de</strong> préserver la qualité <strong>de</strong>s sites, <strong>de</strong>s paysages et <strong>de</strong>s milieux naturels et<br />
<strong>de</strong> mettre en oeuvre une politique <strong>de</strong> protection, <strong>de</strong> gestion et d’ouverture au public <strong>de</strong>s espaces naturels<br />
sensibles. <strong>Le</strong>s principes et les modalités <strong>de</strong> cette politique sont définis dans les articles L 142 et R 142 et<br />
suivants du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme.<br />
Carte <strong>de</strong>s Espaces Naturels Sensibles à Couëron<br />
<br />
I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s corridors <strong>de</strong> déplacement et leur fonctionnalité écologique<br />
Notions préalables<br />
De nos jours, le territoire est morcelé par <strong>de</strong>s infrastructures linéaires <strong>de</strong> transport (TGV, autoroutes,<br />
roca<strong>de</strong>s, canaux), <strong>de</strong> lignes à haute tension, <strong>de</strong>s zones urbaines... Ces infrastructures et ces zones<br />
induisent une fragmentation <strong>de</strong>s systèmes écologiques et sont reconnues comme l’une <strong>de</strong>s premières<br />
causes <strong>de</strong> raréfaction ou <strong>de</strong> disparition d’espèces et <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> biodiversité. En effet, le processus <strong>de</strong><br />
fragmentation va transformer un habitat vaste d’une espèce (par exemple une forêt pour un cervidé) en<br />
plusieurs îlots ou taches <strong>de</strong> plus en plus petites.<br />
Ce processus explique alors que l’aire totale <strong>de</strong> l’habitat d’origine diminue. En parallèle, l’isolation <strong>de</strong>s<br />
fragments d’habitats augmente. Par habitat il faut entendre le lieu où vit l’espèce et son environnement<br />
immédiat biotique et abiotique.<br />
Divers travaux ont montré que le maintien <strong>de</strong> la biodiversité dépend non seulement <strong>de</strong> la préservation<br />
<strong>de</strong>s habitats mais aussi <strong>de</strong>s espaces interstitiels qui permettent les échanges biologiques entre ces<br />
habitats (Burel & Baudry, 1999).<br />
101
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
L’une <strong>de</strong>s premières recommandations qui a émané <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fragmentation <strong>de</strong>s habitats pour<br />
améliorer la conservation <strong>de</strong> la faune sauvage a été le fait que <strong>de</strong>s fragments liés par <strong>de</strong>s corridors d’un<br />
habitat convenable ont une valeur <strong>de</strong> conservation plus gran<strong>de</strong> que <strong>de</strong>s fragments isolés <strong>de</strong> taille<br />
similaire (Diamond 1975 ; Wilson & Willis 1975).<br />
<strong>Le</strong>s corridors, garants <strong>de</strong> la biodiversité ?<br />
<strong>Le</strong>s corridors ont été définis comme étant <strong>de</strong>s « éléments<br />
linéaires du paysage dont la physionomie diffère <strong>de</strong><br />
l’environnement adjacent (voir schéma ci-contre). <strong>Le</strong>s<br />
corridors peuvent être naturels (rivières, crêtes, passages<br />
d’animaux) ou crées par l’homme (routes, lignes à haute<br />
tension..). Ils sont pour la plupart organisés en réseaux et<br />
leur linéarité leur confère un rôle particulier dans la<br />
circulation <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> matières ou d’organismes » (Burel,<br />
2000).<br />
b<br />
a : Corridor<br />
c<br />
a<br />
b : Taches d’habitat favorable pour une ou plusieurs<br />
espèce(s) considérée(s)<br />
b<br />
c : matrice (élément dominant du paysage par exemple<br />
dans un paysage agraire la matrice est l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
parcelles <strong>de</strong>stinées à la production agricole –Burel &<br />
Baudry, 1999)<br />
Différents types <strong>de</strong> corridors ont été distingués en fonction <strong>de</strong> leur origine (1986):<br />
• Corridors d’habitats naturels : qui suivent en général la topographie ou <strong>de</strong>s contours<br />
environnementaux, et qui sont le résultat <strong>de</strong> processus environnementaux ;<br />
• Corridors d’habitats régénérés : lorsqu’il y a à nouveau croissance d’une végétation initialement<br />
perturbée (exemple : <strong>de</strong>s haies) ;<br />
• Des corridors d’habitats <strong>plan</strong>tés : ce sont <strong>de</strong>s corridors qui ont été établis par l’être humain et<br />
sont composés généralement d’espèces <strong>de</strong> <strong>plan</strong>tes non indigènes ou bien d’espèces exotiques ;<br />
• Corridors d’habitats perturbés: comme les voiries, les couloirs laissés par l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong> lignes<br />
à haute tension.<br />
<strong>Le</strong>s corridors possè<strong>de</strong>nt plusieurs fonctions : habitat (si l’espèce se reproduit), conduit (pour le<br />
déplacement), barrière (exemple une haie pour <strong>de</strong>s vaches), filtre ( si le déplacement dans le corridor est<br />
amoindri), source (si le corridor est un habitat qui « fournit » <strong>de</strong>s individus) ou l’inverse, un puits.<br />
<strong>Le</strong> rôle <strong>de</strong>s corridors dépend <strong>de</strong> leur structure, <strong>de</strong> leur place dans le paysage, <strong>de</strong>s caractéristiques<br />
biologiques <strong>de</strong> l’espèce considérée, <strong>de</strong> leur place dans le réseau d’éléments linéaires. Ces réseaux se<br />
caractérisent par ailleurs par leur linéaire, leur nombre, la qualité <strong>de</strong> leur connexions et <strong>de</strong> leur éléments<br />
(Burel, 2000)<br />
I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s corridors à l’échelle du territoire communal<br />
<strong>Le</strong>s corridors ont très tôt été perçus par les aménageurs comme étant un moyen pour pallier les effets<br />
négatifs <strong>de</strong> la fragmentation sur un territoire. Il ne faut pas oublier que pour déterminer un corridor dans<br />
un but <strong>de</strong> maintien <strong>de</strong> la biodiversité il faut se poser <strong>de</strong>s questions préalables :<br />
• Quelles sont les espèces présentes ?<br />
• Quelles en sont les habitats favorables ?<br />
• En fonction <strong>de</strong>s espèces considérées et <strong>de</strong> leur habitat favorable, quelles en sont les barrières (par<br />
exemple, pour un chevreuil une autoroute est une barrière infranchissable, les zones urbanisées<br />
sont également <strong>de</strong>s barrières pour beaucoup d’espèces) ?<br />
• Quelles sont les zones <strong>de</strong> plus forte accessibilité pour les espèces et donc quels sont les corridors ?<br />
102
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> principal corridor écologique fonctionnel sur la commune <strong>de</strong> Couëron est constitué par la Loire. Même<br />
si ses rives et son cours ont été partiellement aménagés pour la navigation ou l’industrie, elle reste un<br />
important couloir migratoire pour les espèces aquatiques (poissons, batraciens, certains insectes) et pour<br />
les oiseaux. Son rôle <strong>de</strong> corridor peut <strong>de</strong> plus être étendu par la présence <strong>de</strong> milieux naturels associés,<br />
comme <strong>de</strong>s roselières, vasières, boisements alluviaux, prairies inondables...).<br />
<strong>Le</strong>s étiers <strong>de</strong> Beaulieu et Nord constituent <strong>de</strong>s corridors écologiques en liaison avec la Loire. Il est donc<br />
important <strong>de</strong> conserver ou <strong>de</strong> reconstituer les passages au niveau <strong>de</strong> la zone urbaine. <strong>Le</strong>ur protection et<br />
leur mise en valeur sont donc nécessaires, afin que l’effet <strong>de</strong> fragmentation engagé avec les routes et<br />
l’urbanisation proche soit enrayé.<br />
2.<strong>Le</strong>s continuités piétonnes et <strong>de</strong>ux roues<br />
Couëron a organisé dans la plupart <strong>de</strong> ses quartiers récents <strong>de</strong>s liaisons douces permettant <strong>de</strong> relier les<br />
quartiers les uns aux autres, ainsi que les principaux équipements. <strong>Le</strong>s ZAC Ouest centre-ville, Métairie et<br />
Rives <strong>de</strong> Loire intègrent eux aussi cette préoccupation.<br />
En revanche, certaines liaisons font défaut compte tenu <strong>de</strong> la physionomie <strong>de</strong> la commune en <strong>de</strong>ux pôles<br />
urbanisés. Il manque ainsi une vraie liaison entre la Chabossière et le centre-ville avec ses commerces et<br />
établissements scolaires (axe Libération/Martyrs <strong>de</strong> la Résistance – Langevin/Blancho et Jaurès/pont<br />
SNCF).<br />
Certains chemins <strong>de</strong> promena<strong>de</strong> pé<strong>de</strong>stre ne sont cependant pas ouverts aux vélos en bord <strong>de</strong> Loire.<br />
L’aménagement <strong>de</strong> la coulée verte du Drillet a été réalisé récemment ;la promena<strong>de</strong> est désormais<br />
ouverte au public en frange <strong>de</strong> Couëron et <strong>de</strong> Saint Herblain.<br />
<strong>Le</strong> GR 3 passe au Nord du territoire communal en provenance <strong>de</strong> Sautron. Il prend appui sur le coteau du<br />
Sillon et quitte rapi<strong>de</strong>ment la commune vers Saint-Etienne-<strong>de</strong>-Montluc. Il serait opportun <strong>de</strong> préserver<br />
une emprise pour relier cet itinéraire aux autres cheminements couëronnais.<br />
Sentiers pé<strong>de</strong>stres à Couëron<br />
Source : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron est traversée par plusieurs sentiers <strong>de</strong> randonnée inscrits au Plan<br />
Départemental <strong>de</strong>s Itinéraires <strong>de</strong> Promena<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Randonnée dont l’objectif est <strong>de</strong> préserver et <strong>de</strong><br />
promouvoir ces itinéraires.<br />
103
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Sentiers <strong>de</strong> randonnée inscrits au Plan Départemental <strong>de</strong>s Itinéraires <strong>de</strong> Promena<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Randonnée<br />
Dans le marais Audubon, les opportunités <strong>de</strong> promena<strong>de</strong>s cyclistes sont nombreuses en empruntant les<br />
chemins ruraux et voies communales. <strong>Le</strong>s marais sont d’ailleurs maillés d’un ensemble <strong>de</strong> chemins<br />
notamment dans la partie proche <strong>de</strong> l’urbanisation, et très accessible <strong>de</strong>puis cette <strong>de</strong>rnière.<br />
La « Loire à vélo »<br />
La Loire à vélo est un projet <strong>de</strong> création <strong>de</strong> 600 kilomètres d’itinéraire cyclable le long <strong>de</strong> la Loire <strong>de</strong><br />
Nevers à l’embouchure du fleuve, qui s’inscrit dans le réseau européen <strong>de</strong>s « vélo routes ».<br />
Dans l’agglomération nantaise,l’itinéraire démarre au pont <strong>de</strong> Mauves, longe la rive nord <strong>de</strong> la Loire<br />
jusqu’à Couëron, traverse le fleuve pour se diriger vers la côte atlantique le long du canal <strong>de</strong> la Martinière.<br />
Un itinéraire complémentaire partant du centre <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> pour longer la Loire sur la rive sud jusqu’au<br />
bac du Pellerin est également prévu.<br />
En ce qui concerne l’itinéraire <strong>de</strong> la Loire à Vélo à Couëron, le parcours emprunte la piste cyclable<br />
existante jusqu’au centre-ville puis <strong>de</strong>s aménagements en site propre seront réalisés pour rejoindre le<br />
bac .<br />
104
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIV- LES PAYSAGES URBAIINS<br />
1. La morphologie <strong>de</strong>s quartiers<br />
La commune est caractérisée par un habitat multipolaire : le centre ancien <strong>de</strong> Couëron entre la voie<br />
ferrée et la Loire, les quartiers Est autour <strong>de</strong> la Chabossière, adossés à la vallée du Drillet, <strong>de</strong> nombreux<br />
villages parfois très étendus et <strong>de</strong>nsément peuplés comme celui <strong>de</strong> Brimberne ou rattrapé par<br />
l’urbanisation contemporaine comme la Sinière.<br />
Localisation <strong>de</strong>s différents quartiers <strong>de</strong> Couëron<br />
<br />
<strong>Le</strong> bourg ancien et ses extensions<br />
<strong>Le</strong> noyau urbain d’origine et ses extensions<br />
Source : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
La structure ancienne du bourg <strong>de</strong> Couëron, héritée d’une dynamique morphologique centrée autour <strong>de</strong><br />
la place <strong>de</strong> l’Eglise, et <strong>de</strong> quartiers plus spécifiques (im<strong>plan</strong>tations bourgeoises à l’est, sur la<br />
Loire, quartier populaire à l’ouest <strong>de</strong> la rue <strong>de</strong> la Marne) développe aujourd’hui ses « faça<strong>de</strong>s » sur la Loire,<br />
notamment grâce à leur revalorisation pour l’aménagement <strong>de</strong>s quais en promena<strong>de</strong>.<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
105
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Vue aérienne du bourg dans les années 1950<br />
<strong>Le</strong> bourg actuel se structure autour <strong>de</strong> la place <strong>de</strong> l’église Saint-Symphorien. L’étroitesse <strong>de</strong>s voies, la<br />
topographie du site, les constructions <strong>de</strong> typologie variée, les rares perspectives sur la Loire sont autant<br />
d’atouts pour le bourg et pour son i<strong>de</strong>ntité. Ce sont les ensembles <strong>de</strong>s rues constituées <strong>de</strong> maisons<br />
mo<strong>de</strong>stes à l’ouest <strong>de</strong> la rue <strong>de</strong> la Marne, formant <strong>de</strong>s rues étroites, qui constituent le tissu urbain le plus<br />
particulier du bourg <strong>de</strong> Couëron.<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
<strong>Le</strong> bâti est pour l’essentiel im<strong>plan</strong>té à la limite <strong>de</strong>s emprises publiques et <strong>de</strong>s voies et d’une limite à<br />
l’autre <strong>de</strong> la parcelle. La hauteur <strong>de</strong>s constructions est assez variée <strong>de</strong> R+combles à R+3. <strong>Le</strong>s<br />
remaniements <strong>de</strong> bâti ayant été nombreux, il est difficile <strong>de</strong> reconnaître une unité architecturale.<br />
Toutefois, différents styles cohabitent maisons mo<strong>de</strong>stes, maisons bourgeoises, immeubles <strong>de</strong> <strong>rapport</strong>….<br />
La structure spatiale du bourg parvient encore à assurer la cohérence <strong>de</strong> l’ensemble.<br />
<strong>Le</strong>s bâtiments sur le quai sont soit <strong>de</strong>s maisons bourgeoises, parmi lesquelles le « château <strong>de</strong> Couëron »,<br />
soit <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s « arrières » <strong>de</strong> bâtiment <strong>de</strong> la place <strong>de</strong> l’église qui se donnent aujourd’hui à voir sur le<br />
quai, soit <strong>de</strong>s bâtiments plus anciens remaniés surtout à la fin du XIX ème siècle dans un esprit <strong>de</strong><br />
villégiature.<br />
106
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> centre-ville actuel et ses extensions<br />
<strong>Le</strong> centre-ville actuel s’est déplacé au nord du noyau ancien entre la place Anatole France et le boulevard<br />
<strong>de</strong> l’Europe.<br />
<strong>Le</strong> centre-ville et ses extensions récentes constituent un pôle <strong>de</strong> vie accueillant divers équipements <strong>de</strong><br />
proximité ou d’échelle communale (Hôtel <strong>de</strong> Ville, CCAS, bibliothèque, théâtre Boris Vian, écoles, collège,<br />
lycée professionnel…). <strong>Le</strong> centre-ville s’ouvre désormais sur les rives <strong>de</strong> la Loire réaménagées et <strong>de</strong>venues<br />
un lieu <strong>de</strong> promena<strong>de</strong>.<br />
<br />
La Chabossière et ses extensions<br />
<strong>Le</strong> pôle <strong>de</strong> proximité <strong>de</strong> la Chabossière<br />
L’urbanisation à l’Est du centre-ville s’est développée à partir <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> communication (voie ferrée et<br />
RD 17), puis sous forme <strong>de</strong> cités ouvrières avec la Chabossière. Ce quartier est désormais englobé dans un<br />
tissu pavillonnaire récent..<br />
<strong>Le</strong> pôle <strong>de</strong> proximité <strong>de</strong> la Chabossière est dynamique tant du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s services que <strong>de</strong>s<br />
commerces.<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Ce pôle s’est constitué vers la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle. Il a emprunté son nom à<br />
un lieu-dit (village) qui sur la carte <strong>de</strong> Cassini (XVIIIème siècle), se situe à l’extrémité <strong>de</strong> l’actuel territoire<br />
<strong>de</strong> la Chabossière. C’est l’essor industriel d’Indre (Arsenal d’Indret, forges <strong>de</strong> Basse-Indre), <strong>de</strong>mandant<br />
une main d’œuvre importante, qui explique le développement d’un centre urbain sur la voie <strong>de</strong><br />
communication haute entre Couëron et <strong>Nantes</strong>. Une chaussée (aujourd’hui la D617) permettait <strong>de</strong>puis la<br />
Garotais-l’Islette (hameau ancien du site) <strong>de</strong> rejoindre les usines plus au sud à travers les marais plus ou<br />
moins recouverts d’eau. Cette route n’existait pas en 1815.<br />
Des bâtiments isolés tels que les écoles Jules Ferry et Aristi<strong>de</strong> Briand sont intéressants, quelques maisons<br />
<strong>de</strong> bourg en alignement témoignent également <strong>de</strong> l’architecture <strong>de</strong> cette époque ; les ensembles<br />
composés par l’habitat ouvrier sont emblématiques <strong>de</strong> la Chabossière et constituent <strong>de</strong>puis la gran<strong>de</strong><br />
cité <strong>de</strong> la Chabossière construite dans les années vingt aux rues <strong>de</strong> Carpental et Jolliot-Curie, datant<br />
d’après guerre, <strong>de</strong>s éléments très forts <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité couëronnaise.<br />
107
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s cités ouvrières<br />
Couëron possè<strong>de</strong> un patrimoine d’habitat ouvrier exceptionnel qu’il s’agit <strong>de</strong> conserver pour son<br />
architecture, son organisation spatiale mais aussi la qualité paysagère du traitement <strong>de</strong>s haies,<br />
<strong>plan</strong>tations, pelouses… Quelques images <strong>de</strong> ces cités sont montrés ci-après.<br />
La cité Bessonneau<br />
Cette cité construite dans les années 1920 selon le procédé Bessonneau a aujourd’hui presque<br />
entièrement disparu. Un projet <strong>de</strong> cité intergénérationnelle est en cours d ‘étu<strong>de</strong> sur ce site. Il est<br />
envisagé <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r une <strong>de</strong>s maisons encore existantes et <strong>de</strong> la déplacer sur un autre site .<br />
La cité <strong>de</strong> la Jarriais<br />
Elévation d’origine d’une maison<br />
Plan d’alignement <strong>de</strong> la cité <strong>de</strong> la Jarrais (en rouge<br />
les extensions d’habitation réalisées <strong>de</strong>puis le<br />
rachat <strong>de</strong>s maisons par <strong>de</strong>s propriétaires privés)<br />
108
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La cité du Bossis<br />
La cité du Berligout<br />
D’autres cités existent encore comme la Chabossière et la Bertaudière.<br />
• <strong>Le</strong>s faubourgs fin XIX ème<br />
<strong>Le</strong>s « faubourgs » fin XIX ème siècle constituent, quant à eux, <strong>de</strong>s extensions urbaines en alignement le<br />
long <strong>de</strong>s grands axes est-ouest et nord-sud du bourg. Ce sont quasiment les <strong>de</strong>rnières manifestations<br />
urbaines formant alignement sur rue et dont la déclinaison d’une même typologie, présentant <strong>de</strong>s<br />
variations légères, confère à ces rues une i<strong>de</strong>ntité remarquable. Ces extensions urbaines témoignent <strong>de</strong><br />
la vitalité très forte <strong>de</strong> Couëron à cette époque.<br />
109
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Illustrations <strong>de</strong>s faubourgs<br />
• <strong>Le</strong> Port Launay<br />
L’éloignement actuel du fleuve a privé le village <strong>de</strong> ce qui lui avait valu son nom et sa fonction d’avantport<br />
<strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> dès le XVIème siècle. Sa forme urbaine actuelle, son paysage, le logis <strong>de</strong> la Gerbetières et<br />
les belles <strong>de</strong>meures d’armateurs nantais qui subsistent en font un lieu emblématique <strong>de</strong> la commune.<br />
Il s’agit d’un port ayant perdu aujourd’hui sa fonction possédant encore, dans son architecture <strong>de</strong><br />
maisons d’armateurs et <strong>de</strong> pêcheurs l’importance <strong>de</strong> son passé.<br />
L’ancienne cale Pierre Tamis<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
Des maisons d’armateur sur l’ancien quai qui bordait la Loire<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
110
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
« <strong>Le</strong> fleuve couvrait toute l’étendue comprise entre le Port-Launay et <strong>Le</strong> Pellerin, les terrains d’alluvions<br />
qui occupent aujourd’hui la moitié <strong>de</strong> cet espace n’existaient pas. On voyait tout récemment encore les<br />
anciens quais dominer ces prairies, c’est leur maçonnerie qui soutenait la route longeant la rangée <strong>de</strong><br />
maisons et dont l’élargissement a fait disparaître ce vieux témoignage portuaire ; mais on voit encore à<br />
Pierre Tamis les cales <strong>de</strong> l’extrémité ouest. C’est en ces lieux aujourd’hui comblés que se trouvaient les<br />
plus profonds mouillages ». Raymond Briant<br />
Pour les pèlerins bretons <strong>de</strong> Saint-Jacques <strong>de</strong> Compostelle, le passage au Pellerin se faisait par le<br />
franchissement <strong>de</strong> la Loire au Port-Launay, sur le Chemin du Paradis. Il s’agit donc d’un lieu stratégique<br />
<strong>de</strong> longue date et qui a perdu son <strong>rapport</strong> direct au fleuve par les alluvions similaires aux atterrissements<br />
<strong>de</strong> Saint-Jean-<strong>de</strong>-Boiseau, rétrécissant le cours du fleuve et reléguant la faça<strong>de</strong> continue sur Loire à<br />
l’image <strong>de</strong> front urbain unilatéral.<br />
L’activité commerciale, maritime et industrielle (Port-Launay possédait 2 moulins en 1830) a totalement<br />
disparu et les coteaux du village se sont couverts <strong>de</strong> pavillons qui prennent assez peu en compte la<br />
topographie naturelle remarquable du site en « promontoire ».<br />
<strong>Le</strong> manoir <strong>de</strong> la Gerbetière<br />
La Gerbetière est une maison <strong>de</strong> maître, petite gentilhommière au style classique, achetée par Jean<br />
Audubon au Marquis François Blanchard en 1781. Dans ses années d’enfance et d’adolescence, Jean-<br />
Jacques Audubon, célèbre naturaliste, y séjourne à l’écart <strong>de</strong>s grands bouleversements <strong>de</strong> la Révolution.<br />
• <strong>Le</strong>s hameaux, bor<strong>de</strong>ries, écarts et villages<br />
<strong>Le</strong>s bor<strong>de</strong>ries et groupements <strong>de</strong> maisons rurales formant écarts sont nombreux à Couëron. Il s’agit<br />
historiquement d’habitats isolés (fermes, manoirs, maisons nobles) répartis sur les coteaux et le plateau<br />
nord principalement, évitant ainsi les crues <strong>de</strong>s ruisseaux et <strong>de</strong> la Loire mais aussi les vents <strong>de</strong> plateau.<br />
Quelques groupements d’importance peuvent être appelés hameaux : la Bazillère, l’Erdurière, la Roche-<br />
Guillet, la Galonnière, Brimberne…<br />
<strong>Le</strong>s écarts, constitués pour la plupart <strong>de</strong> métairies familiales ou constituées autour d’une cour <strong>de</strong> ferme,<br />
présentent une variété d’im<strong>plan</strong>tation selon qu’ils se développent :<br />
- <strong>Le</strong> long d’une voie <strong>de</strong> communication en habitat linéaire <strong>de</strong> part et d’autre <strong>de</strong> la voie ou bien<br />
d’un seul côté : les exemples à Couëron concernent principalement les im<strong>plan</strong>tations en bordure<br />
<strong>de</strong> marais tels que l’ensemble La Rotte-La Bourdinière-<strong>Le</strong> Bois, Bouillon…<br />
- Autour d’un espace central ou/et d’un élément significatif, souvent un puits ou un four mais<br />
aussi un petit bâtiment : les écarts à Couëron n’ont pas <strong>de</strong> structure réellement compacte, basé<br />
sur l’alignement <strong>de</strong>s bâtiments. Il s’agit <strong>de</strong> bor<strong>de</strong>ries familiales où les bâtiments semblent suivre<br />
une logique d’im<strong>plan</strong>tation en <strong>rapport</strong> direct avec la topographie <strong>de</strong>s coteaux mais également<br />
<strong>de</strong> l’exposition <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong> principale.<br />
111
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Certains <strong>de</strong> ces écarts et hameaux forment aujourd’hui <strong>de</strong>s « poches » anciennes dans <strong>de</strong>s extensions<br />
pavillonnaires, notamment à la Sinière, la Bazillère, l’Erdurière, Brimberne, La Guinière…<br />
Localisation <strong>de</strong>s différents villages<br />
Source : <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
112
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Photographies <strong>de</strong>s villages et hameaux<br />
L’habitat présent au nord <strong>de</strong> la voie ferrée <strong>Nantes</strong> - Saint-Nazaire s’est récemment diffusé à partir <strong>de</strong><br />
hameaux anciens. <strong>Le</strong>ur développement pose question par <strong>rapport</strong> aux besoins générés en matières <strong>de</strong><br />
réseaux (assainissement en particulier) et services (transports collectifs). La pérennité <strong>de</strong>s espaces<br />
agricoles et naturels est ainsi menacée dans ces secteurs.<br />
• L’habitat isolé<br />
De nombreuses maisons isolées, petites fermes et bor<strong>de</strong>ries, se sont im<strong>plan</strong>tées sur les coteaux <strong>de</strong><br />
Couëron le long <strong>de</strong>s rues <strong>de</strong> la Lionnière, <strong>de</strong> la Noë Saint-Jean, <strong>de</strong> l’Océan, du Tertre Buchelier, à la fin du<br />
XIX ème siècle et au début du XX ème siècle. La particularité <strong>de</strong> son im<strong>plan</strong>tation présentant une faça<strong>de</strong> sur la<br />
Loire (sud) est intéressante, et il est regrettable que les ensembles pavillonnaires récents n’aient tenu<br />
compte en aucun cas d’une façon <strong>de</strong> faire qui relevait d’un certain bon sens et qui aurait permis <strong>de</strong><br />
conforter l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> la partie nord-ouest du bourg <strong>de</strong> Couëron.<br />
113
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s extensions pavillonnaires<br />
Depuis les années 1960-1970, comme dans toutes les communes <strong>de</strong> l’agglomération nantaise, <strong>de</strong>s<br />
extensions pavillonnaires se sont réalisées sous forme <strong>de</strong> lotissement le plus souvent, dans le centre-ville,<br />
au nord <strong>de</strong> la Chabossière, au nord <strong>de</strong> Port Launay. Globalement, ces quartiers d’habitat pavillonnaire ont<br />
une organisation viaire et un parcellaire indépendants. Ils forment un tissu urbain plus lâche que les<br />
noyaux plus anciens <strong>de</strong> l’urbanisation. <strong>Le</strong>s rues se terminent souvent par <strong>de</strong>s impasses. <strong>Le</strong> parcellaire est<br />
plus large afin d’éviter la mitoyenneté du bâti. Ce <strong>de</strong>rnier se retrouve également en retrait par <strong>rapport</strong> à<br />
la rue.<br />
2. <strong>Le</strong>s différentes typologies urbaines et ambiances paysagères<br />
Différentes typologies urbaines et ambiances paysagères ont été i<strong>de</strong>ntifiées sur la commune <strong>de</strong><br />
Couëron :<br />
114<br />
• Noyau ancien<br />
<strong>Le</strong> noyau ancien est caractérisé par un centre ancien <strong>de</strong>nse à caractère minéral généré par un front bâti<br />
continu, généralement à l’alignement R+1 avec une présence éventuelle <strong>de</strong> commerces en rez-<strong>de</strong>chaussée.<br />
• Premières extensions<br />
<strong>Le</strong>s premières extensions correspondant à un tissu relativement homogène, linéaire. Elles sont<br />
constituées pour les premières extensions <strong>de</strong> maisons <strong>de</strong> ville, majoritairement à l’alignement avec <strong>de</strong><br />
petits jardins sur l’avant. Un caractère minéral et structuré est dominant. Elles sont également<br />
constituées <strong>de</strong> pavillons plus récents orientés sur la voie.<br />
• Tissu pavillonnaire classique<br />
Il s’agit d’extensions par opérations successives <strong>de</strong> pavillons im<strong>plan</strong>tés généralement en milieu <strong>de</strong><br />
parcelle. <strong>Le</strong>s parcelles sont peu arborées et la présence végétale est peu significative. <strong>Le</strong>s lotissements<br />
très récents ne sont pas encore végétalisés.<br />
• Cité ouvrière<br />
La cité ouvrière correspond à un ensemble homogène et très structuré (organisation généralement<br />
orthonormée) <strong>de</strong> maisons mitoyennes avec un léger recul par <strong>rapport</strong> à la voie. Il s’agit notamment <strong>de</strong> la<br />
Cité du Bossis.<br />
• Ensemble d’habitat collectif<br />
Plus ou moins récents à partir <strong>de</strong> R+2, les immeubles les plus hauts se trouvant à Bel Air. <strong>Le</strong>s ensemble<br />
ont un caractère assez minéral et vertical et caractérisé par un faible accompagnement végétal. Seuls les<br />
collectifs situés en bordure d’espace naturel au niveau du pont <strong>de</strong> Retz sont situés dans un espace vert<br />
(grands cèdres signaux).<br />
• Secteur mixte à dominante d’équipement<br />
Il s’agit d’un tissu assez lâche et hétérogène tant du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’im<strong>plan</strong>tation sur la parcelle que <strong>de</strong><br />
la volumétrie. Cette hétérogénéité se retrouve également au niveau du parcellaire souvent clos, plus<br />
grand que pour l’habitat.<br />
• Paysage diffus <strong>de</strong> zones industrielles et artisanales<br />
<strong>Le</strong>s paysages <strong>de</strong> zones industrielles sont caractérisés par <strong>de</strong>s espaces clos et <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
envergure dominant un espace majoritairement naturel et <strong>plan</strong>, en rive <strong>de</strong> Loire.<br />
• Secteur d’activités (commerces, services)<br />
<strong>Le</strong>s secteurs d’activités sont caractérisés par un caractère dispersif dû à une im<strong>plan</strong>tation en recul et<br />
rarement à l’alignement <strong>de</strong> bâtiment <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> volumétrie.
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
3. les entrées <strong>de</strong> ville<br />
115
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Entrée <strong>de</strong> ville sur Couëron <strong>de</strong>puis la RD 107<br />
L’entrée sur Couëron <strong>de</strong>puis la RD 107 est fortement marquée par l’association du paysage naturel et <strong>de</strong>s<br />
repères tels que la cheminée <strong>de</strong> l’usine du centre <strong>de</strong> tri et <strong>de</strong> valorisation <strong>de</strong>s déchets (Arc-en-ciel) et par<br />
en <strong>de</strong>uxième <strong>plan</strong>, par la tour à plomb.<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> ville sur la porte <strong>de</strong> ville<br />
La principale entrée est la porte <strong>de</strong> ville qui se situe au giratoire par les rives <strong>de</strong> Loire. Cette porte en<br />
marquée par un rond point et au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce rond point d’un côté par les infrastructures industrielles et <strong>de</strong><br />
l’autre côté par un étier se jetant dans la Loire.<br />
116
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis le bac <strong>de</strong> Loire<br />
Cette entrée <strong>de</strong> ville est très séquencée. L’arrivée se fait sur un quai d’embarquement dissocié <strong>de</strong> la partie<br />
agglomérée du bourg par <strong>de</strong>s séquences aux ambiances très différenciées : un espace naturel <strong>de</strong> zone<br />
humi<strong>de</strong> suivi du hameau aux habitations bourgeoises <strong>de</strong> Port Launay pour se poursuivre par une<br />
séquence naturelle avant <strong>de</strong> retrouver la partie urbanisée du centre-bourg. L’entrée <strong>de</strong> ville la plus<br />
typique du village <strong>de</strong> Loire à Couëron se fait par le bac <strong>de</strong> Loire. Même si la fréquence <strong>de</strong>s bacs peut<br />
provoquer certaines attentes, l’accès par la Loire permet <strong>de</strong> donner la mesure du rythme <strong>de</strong> la vie ligérien<br />
encore traditionnel.<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis la RD 17 en venant <strong>de</strong> Saint-Etienne-<strong>de</strong>-Montluc<br />
L’entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong> <strong>de</strong>puis la RD 17 venant <strong>de</strong> Saint-Etienne-<strong>de</strong>-Montluc est une entrée rurale caractérisée<br />
par une faible largeur <strong>de</strong> voie, une sinuosité associée à <strong>de</strong>s haies <strong>plan</strong>tées sur talus participant à réduire<br />
la visibilité et nécessitant un fort ralentissement pour cette entrée d’aspect encore très rurale. De plus<br />
cette entrée sur la commune se fait au droit d’intersections <strong>de</strong> voies et <strong>de</strong> chemins ruraux sur laquelle se<br />
sont greffées quelques habitations.<br />
117
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis la RD 101 en venant <strong>de</strong> Saint-Etienne-<strong>de</strong>-Montluc<br />
Cette entrée <strong>de</strong> ville à la hauteur <strong>de</strong> la Quiételais se fait sur une voie rectiligne favorisant la vitesse. Celleci<br />
se situe à l’intersection <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux voies à la hauteur <strong>de</strong> la Quiételais sur laquelle vient se greffer un<br />
hameau constitué <strong>de</strong> bâti ancien. Toutefois la RD 101 évite le bourg <strong>de</strong> Couëron et la Chabossière pour<br />
venir se connecter à la 4 voies <strong>de</strong> l’entrée ouest <strong>de</strong> l’agglomération.<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis la RD 81 en provenance <strong>de</strong> Sautron<br />
La limite communale nord <strong>de</strong> Couëron se situe à proximité même <strong>de</strong> l’ancienne RN 165 proche du bourg<br />
<strong>de</strong> Sautron. <strong>Le</strong> marquage <strong>de</strong>s limites communales se fait au croisement en passage inférieur <strong>de</strong> la RN 165.<br />
C’est une entrée <strong>de</strong> ville au caractère rural marquée par sa végétation abondante avec cependant une<br />
largeur <strong>de</strong> voie conséquente.<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis la RD 26 <strong>de</strong>puis le bourg <strong>de</strong> Sautron<br />
Cette entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis la RD 26 <strong>de</strong>puis le bourg <strong>de</strong> Sautron est marquée par le passage inférieur sous<br />
la RN 165 au droit d’un ruisseau dont la coulée naturelle est complètement dissimulée par l’infrastructure<br />
routière et ses ouvrages d’art.<br />
118
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis l’entrée ouest <strong>de</strong> l’agglomération<br />
L’entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis l’entrée ouest <strong>de</strong> l’agglomération n’est pas marquée compte tenu du caractère<br />
autoroutier et industriel <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>sserte. Aucune limite communale n’est perceptible.<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>puis la RD 17 <strong>de</strong>puis Saint-Herblain<br />
L’entrée <strong>de</strong> ville est banalisée par le traitement fonctionnel routier qui est confondu avec la bretelle<br />
d’entrée ouest <strong>de</strong> l’agglomération.<br />
<br />
Entrée <strong>de</strong> bourg <strong>de</strong> la Chabossière<br />
L’entrée <strong>de</strong> bourg <strong>de</strong> la Chabossière s’effectue dans une ambiance rurale d’espace naturel à la<br />
topographie assez marquée.<br />
L’application <strong>de</strong> la loi Barnier (article L 111-1-4 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme)<br />
L’article L 111-1-4 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme dit que « en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s espaces urbanisés <strong>de</strong>s communes, les<br />
constructions ou installations sont interdites dans une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> cent mètres <strong>de</strong> part et d’autre <strong>de</strong> l’axe <strong>de</strong>s<br />
autoroutes, <strong>de</strong>s routes express et <strong>de</strong>s déviations au sens du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la voirie routière et <strong>de</strong> soixante-quinze<br />
mètres <strong>de</strong> part et d’autre <strong>de</strong> l’axe <strong>de</strong>s autres routes classées à gran<strong>de</strong> circulation ».<br />
Toutefois, il peut être fait application <strong>de</strong> ce même article qui précise que les dispositions énoncées ci<strong>de</strong>ssus<br />
« ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le <strong>plan</strong> <strong>local</strong><br />
d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard<br />
notamment <strong>de</strong>s nuisances, <strong>de</strong> la sécurité, <strong>de</strong> la qualité architecturale, ainsi que <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’urbanisme<br />
et <strong>de</strong>s paysages ».<br />
119
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
4. <strong>Le</strong> patrimoine bâti<br />
<strong>Le</strong> patrimoine bâti est constitué <strong>de</strong> différentes catégories qui classent les édifices, monuments… au<br />
regard <strong>de</strong> leur volume, <strong>de</strong> leur fonction, <strong>de</strong> leur histoire ou <strong>de</strong> leur rôle <strong>de</strong> témoins <strong>de</strong> l’histoire <strong>local</strong>e.<br />
Ainsi Couëron est dotée d’une richesse patrimoniale importante diffuse sur son territoire.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s bâtiments remarquables<br />
<strong>Le</strong> patrimoine bâti classé à l’inventaire <strong>de</strong>s Monuments Historiques<br />
La Tour à plomb a été classée au titre <strong>de</strong>s Monuments Historiques par arrêté du 11 février 1993. La Tour à<br />
Plomb <strong>de</strong> Couëron est d’ailleurs <strong>de</strong>venu un élément architectural <strong>de</strong>s bords <strong>de</strong> la Loire, visible <strong>de</strong>puis les<br />
communes alentours.<br />
Construite entre 1875 et 1878, cette tour servit à la fabrication <strong>de</strong>s plombs <strong>de</strong> chasse. Elle fut reprise par la<br />
Société Tréfimétaux, avant d’être rachetée par la commune. Elle s’élève à environ 60 mètres <strong>de</strong> hauteur<br />
et son diamètre est <strong>de</strong> 11,3 mètres. La matière en fusion était précipitée du sommet et se refroidissait<br />
dans sa chute, elle était récupérée au sol. <strong>Le</strong> matériel protégé comprend le monte-charge, <strong>de</strong>s cuves <strong>de</strong><br />
réception, un four, <strong>de</strong>ux cuves <strong>de</strong> fusion et différents outils. C’est la seule qui reste en France.<br />
La tour à plomb<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
La tour à plomb<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
120
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> patrimoine industriel<br />
« Vers 1860, le quart <strong>de</strong> la population couëronnaise est ouvrier, avec la verrerie, la fon<strong>de</strong>rie <strong>de</strong> plomb, la<br />
biscuiterie, la pêche, la batellerie, les industries agricoles et la briqueterie, qui existe alors <strong>de</strong>puis une<br />
dizaine d’années . » (Source : Flohic)<br />
<strong>Le</strong> patrimoine industriel (bâtiments industriels mais également habitations <strong>de</strong>s ouvriers, <strong>de</strong>s ingénieurs<br />
et directeurs liés aux industries) est exceptionnel à Couëron. En témoigne le seul « édifice » <strong>de</strong> la<br />
commune figurant sur la liste <strong>de</strong>s Monuments Historiques : la tour à plomb.<br />
<strong>Le</strong>s cités ouvrières (cf chap. sur la morphologie <strong>de</strong>s quartiers) sont également <strong>de</strong>s ensembles très<br />
intéressants qui témoignent <strong>de</strong> l’histoire ouvrière et sociale <strong>de</strong> la commune.<br />
L’ensemble <strong>de</strong> la briqueterie est également intéressant.<br />
121
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong>s châteaux et maisons nobles<br />
Un grand nombre <strong>de</strong> châteaux et <strong>de</strong> maisons nobles se sont im<strong>plan</strong>tées sur le territoire <strong>de</strong> la commune<br />
<strong>de</strong> Couëron. Il s’agit pour beaucoup <strong>de</strong> monuments possédant une base médiévale :<br />
• Château <strong>de</strong> la Basse Salle ;<br />
• Château <strong>de</strong> Beaulieu, XIV-XV ème siècle ;<br />
• Château <strong>de</strong> l’Epine, en partie détruit ;<br />
• Château du Bossis ;<br />
• Château du Plessis ;<br />
• Château <strong>de</strong> Bougon du XVI ème siècle;<br />
• Maison <strong>de</strong> la Noé Saint-Jean ;<br />
• Château <strong>de</strong>s Daudières ; <strong>Le</strong>s Daudières<br />
122
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
• Château <strong>de</strong> l’Erdurière ;<br />
• Château <strong>de</strong> la Vinaudière ;<br />
• Château du Champ Guillet ;<br />
• Château <strong>de</strong> la Carterie ;<br />
• Château du Grand Bois <strong>de</strong>s Loups ;<br />
• Château <strong>de</strong> Lan<strong>de</strong>mont ;<br />
• Château <strong>de</strong> la Loire ;<br />
• Maison <strong>de</strong> Saint-Yves et <strong>de</strong> la Picar<strong>de</strong>rie ;<br />
• Château <strong>de</strong> la Gerbetière XVII-XVIII ème siècle. Cette maison du XVII ème siècle est la propriété <strong>de</strong> la<br />
famille Audubon à partir <strong>de</strong> la fin du XVIII ème siècle, en même temps que la chapelle Notre-Dame<strong>de</strong><br />
Recouvrance au Port Launay jusqu’au début du XIX ème siècle. La Gerbetière fait l’objet d’une<br />
instruction en cours par la conservation régionale <strong>de</strong>s Monuments Historiques ;<br />
• La Bouraudière ;<br />
• Château <strong>de</strong> la Botardière XIX ème siècle.<br />
La Bouraudière<br />
<strong>Le</strong> château du Plessis<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
<strong>Le</strong> château <strong>de</strong> l’Epine<br />
Photo <strong>Nantes</strong> Métropole<br />
La qualité <strong>de</strong> leurs abords – cours, parcs, jardins, clôtures, allées – est à conserver, à entretenir et à<br />
restaurer. Ces châteaux possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s arbres remarquableset leurs parcs étoffent le paysage <strong>de</strong> leur<br />
présence, constituent un élément i<strong>de</strong>ntitaire.<br />
La répartition géographique <strong>de</strong> ces édifices et leurs jardins et parcs sur le territoire <strong>de</strong> Couëron est un<br />
atout pour le développement <strong>de</strong> la commune. Il s’agit ainsi aujourd’hui <strong>de</strong> préserver les espaces paysagés<br />
et <strong>de</strong> servir leurs qualités <strong>de</strong> composition urbaine, architecturale et spatiale dans tout projet <strong>de</strong><br />
développement durable, notamment par la conservation à leurs abords d’espaces non construits.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s autres bâtiments d’intérêt<br />
<strong>Le</strong>s moulins<br />
De nombreux moulins ont existé sur le territoire <strong>de</strong> Couëron. Une analyse comparée <strong>de</strong> la carte <strong>de</strong><br />
Cassini (XVIII ème ) avec le cadastre napoléonien (1815) permet d’évaluer leur nombre à une dizaine au début<br />
du XIX ème siècle et d’estimer que <strong>de</strong> nombreux moulins ont été construits sur les hauteurs du plateau, au<br />
nord du territoire, au XIX ème siècle. D’autres moulins semblent avoir disparu tels que ceux du Port-Launay<br />
et <strong>de</strong> la Salle, sur l’actuelle D17, celui du Quilly…<br />
123
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Sept moulins ont été repérés :<br />
• Moulin <strong>de</strong> Beaulieu (bâtiment en ruine) ;<br />
• Moulin <strong>de</strong> Tertumbe ;<br />
• Moulin <strong>de</strong> la Roche Guillet ;<br />
• Moulin du Tertre Buchelier ;<br />
• Moulin <strong>de</strong> la Marsillère ;<br />
• Moulin rue Henri Gautier ;<br />
• Moulin <strong>de</strong> la Galonnière <strong>de</strong> 1740 semble être le plus ancien.<br />
Moulin <strong>de</strong> la Galonnière<br />
Ces moulins en gran<strong>de</strong> partie ont conservé leur couverture et servent <strong>de</strong> marqueurs visuels importants<br />
dans le paysage vallonné du nord <strong>de</strong> la commune.<br />
5. <strong>Le</strong> patrimoine archéologique<br />
Un site archéologique est pressenti à la Chabossière au lieu-dit « <strong>Le</strong>s Salles ».<br />
124
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
V- LA GESTIION DES RESSOURCES<br />
1. La gestion <strong>de</strong>s besoins en eau potable<br />
<br />
Origine <strong>de</strong> l’eau distribuée<br />
(Données issues du <strong>rapport</strong> annuel <strong>de</strong> la Direction <strong>de</strong> l’Eau, <strong>Nantes</strong> Métropole, 2004)<br />
La production et la distribution <strong>de</strong> l’eau sont <strong>de</strong> compétence communautaire <strong>de</strong>puis 2004 sur le territoire<br />
<strong>de</strong>s 24 communes formant la Communauté Urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>.<br />
La production d’eau potable, compétence <strong>de</strong> la Direction <strong>de</strong> l’Eau, est assurée par :<br />
L’usine <strong>de</strong> la Roche, propriété <strong>de</strong> la Direction <strong>de</strong> l’Eau <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole ;<br />
L’usine <strong>de</strong> Basse Goulaine, propriété du Syndicat Mixte du Sud Est ;<br />
Par l’achat d’eau aux syndicats limitrophes (notamment : Syndicat Mixte du Sud Est et SIAEP Sud<br />
Estuaire).<br />
L’eau distribuée sur le réseau public <strong>de</strong> la communauté urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> provient majoritairement du<br />
pompage en Loire à Mauves sur Loire. Ce captage ne fait pas l’objet <strong>de</strong> périmètre <strong>de</strong> protection. L’eau<br />
brute doit subir un traitement complet (ozonation filtration, désinfection…) à l’usine <strong>de</strong> la Roche pour<br />
être rendue potable, avant sa distribution sur le réseau public. <strong>Le</strong>s analyses réalisées révèlent <strong>de</strong>s valeurs<br />
conformes aux normes <strong>de</strong> qualités nécessaires <strong>de</strong> « l’eau potable ».<strong>Le</strong>s eaux superficielles subissent <strong>de</strong>s<br />
variations saisonnières importantes <strong>de</strong>s teneurs en nitrate et atrazine, certaines d’entre elles (retenues<br />
d’eau et Loire) présentent une eutrophisation estivale.<br />
La prise d’eau à proximité <strong>de</strong> l’usine <strong>de</strong> production d’eau potable <strong>de</strong> la Roche (peu utilisée du fait <strong>de</strong> la<br />
remontée du bouchon vaseux notamment) est toujours fonctionnelle.<br />
L’usine <strong>de</strong> Basse-Goulaine est alimentée par <strong>de</strong>s forages captant les eaux souterraines contenues dans<br />
les alluvions <strong>de</strong> la Loire.<br />
L’eau distribuée à Couëron provient <strong>de</strong> l’usine <strong>de</strong> La Roche.<br />
125
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Qualité <strong>de</strong> l’eau distribuée<br />
La qualité <strong>de</strong> l’eau est suivie par <strong>de</strong>s contrôles <strong>de</strong> la DDASS (près <strong>de</strong> 990 prélèvements pour 10 à 350<br />
paramètres) et <strong>de</strong>s mesures d’autocontrôle <strong>de</strong>s opérateurs.<br />
<strong>Le</strong>s analyses réglementaires témoignent d’une bonne qualité microbiologique et physico-chimique. De<br />
même, les teneurs en pestici<strong>de</strong>s et en nitrates sont conformes à la réglementation en vigueur.<br />
<strong>Le</strong>s eaux superficielles subissent néanmoins <strong>de</strong>s variations saisonnières importantes <strong>de</strong>s teneurs en<br />
nitrate et atrazine, certaines d’entre elles (retenues d’eau et Loire) présentent une eutrophisation<br />
estivale.<br />
Dureté <strong>de</strong> l’eau :<br />
La dureté <strong>de</strong> l’eau est liée à la présence<br />
<strong>de</strong> calcium et <strong>de</strong> magnésium dans l’eau.<br />
Pour tenir compte à la fois <strong>de</strong> l’intérêt<br />
d’une eau dure (eau calcaire) pour la<br />
santé et <strong>de</strong>s inconvénients liés à<br />
l’entartrage, il est admis qu’une dureté<br />
<strong>de</strong> l’eau comprise entre 10*°F et 20°F est<br />
idéale.<br />
Analyse bactériologique :<br />
<strong>Le</strong>s résultats <strong>de</strong>s analyses bactériologiques font état d’une qualité d’eau distribuée satisfaisante en<br />
permanence en 2001 comme en 2000 et en 1999.<br />
Pestici<strong>de</strong>s :<br />
La teneur en pestici<strong>de</strong> (insectici<strong>de</strong>s, désherbants) dans l’eau distribuée est très faible et toujours<br />
inférieure aux limites admissibles (
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
En tant qu’autorité organisatrice, <strong>Nantes</strong> Métropole peut donc gérer ce service elle-même ou bien le<br />
déléguer (par DSP ou à un prestataire privé). De plus, <strong>de</strong> part son statut <strong>de</strong> maître d’ouvrage, voire <strong>de</strong><br />
maître d’œuvre, <strong>Nantes</strong> Métropole supervise la construction et la maintenance <strong>de</strong>s infrastructures et <strong>de</strong>s<br />
équipements. Enfin, en tant qu’opérateur public, elle exerce un contrôle sur les territoires et ouvrages qui<br />
sont exploités en régie.<br />
<br />
<strong>Le</strong> réseau d’assainissement<br />
La zone agglomérée <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Coüeron (centre ville, Chabossière, Port Launay, La Bazillière,<br />
Hauts <strong>de</strong> Couëron) est <strong>de</strong>sservie par le réseau d’assainissement séparatif du nord Loire <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
Métropole. <strong>Le</strong>s secteurs non <strong>de</strong>sservis par le réseau d’assainissement sont gérés en assainissement<br />
autonome.<br />
<strong>Le</strong> réseau d’assainissement géré par <strong>Nantes</strong> Métropole comprend près <strong>de</strong> 2 000km (réseaux primaire et<br />
secondaire) et 120 km <strong>de</strong> réseaux <strong>de</strong> transfert.<br />
Ce réseau est majoritairement <strong>de</strong> type séparatif, excepté en ce qui concerne le centre ville <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> où<br />
le réseau est unitaire (un seul réseau pour les eaux usées et les eaux pluviales).<br />
<strong>Le</strong> réseau séparatif est sensible aux eaux parasitaires. Ainsi, <strong>de</strong>s augmentations <strong>de</strong>s volumes d’apports <strong>de</strong><br />
200 à 400% ont été constatées sur <strong>de</strong>s secteurs en bordure <strong>de</strong> l’Erdre, équipés en réseaux séparatifs. De<br />
même, en pério<strong>de</strong> hivernale, <strong>de</strong>s augmentations <strong>de</strong>s volumes d’apports aux stations <strong>de</strong> Tougas et <strong>de</strong> la<br />
Petite Californie ont été enregistrées, respectivement <strong>de</strong> 90% et 47% par <strong>rapport</strong> au régime estival.<br />
<strong>Le</strong> taux <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment au réseau d’assainissement collectif est estimé à 88% sur l’agglomération. Pour<br />
les secteurs non raccordés (zones d’assainissement autonome), un Service Public d’Assainissement Non<br />
Collectif (SPANC) a été mis en place à compter du 1er janvier 2005.<br />
<br />
La gestion <strong>de</strong>s eaux pluviales<br />
<strong>Le</strong>s eaux pluviales sont collectées au niveau <strong>de</strong>s surfaces imperméabilisées par un réseau indépendant<br />
du réseau d’assainissement. Ce réseau totalise un linéaire <strong>de</strong> 55 km à Couëron. <strong>Le</strong>s eaux collectées<br />
rejoignent ensuite le réseau hydrographique.<br />
<br />
La station d’épuration<br />
Une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s eaux usées <strong>de</strong> l’agglomération converge vers <strong>de</strong>ux stations majeures :<br />
- La station <strong>de</strong> Tougas reçoit les eaux usées <strong>de</strong> toutes les communes situées au nord <strong>de</strong> la Loire (dont<br />
Couëron), exceptée la commune <strong>de</strong> Mauves sur Loire (équipée <strong>de</strong> sa propre station). Inaugurée en 1998<br />
sur la commune <strong>de</strong> Saint Herblain, la station d’épuration <strong>de</strong> Tougas a une capacité <strong>de</strong> pointe <strong>de</strong> 600 000<br />
équivalents habitants et traite en moyenne 400 000 équivalents habitants. <strong>Le</strong>s rejets sont déversés en<br />
Loire après traitement. Notons qu’elle a été conçue pour accueillir <strong>de</strong>s extensions l’amenant à une<br />
capacité <strong>de</strong> 750 000 équivalents habitants (3,5m³/s). <strong>Le</strong>s ren<strong>de</strong>ments épuratoires <strong>de</strong> cette station sont <strong>de</strong><br />
95% pour les matières organiques, 92% pour l’azote réduit, 53% pour le phosphore total, 60% pour les<br />
matières inhibitrices et 70% pour les métaux et métalloï<strong>de</strong>s.<br />
- La station <strong>de</strong> la Petite Californie reçoit quant à elle les eaux usées <strong>de</strong> plusieurs communes du sud <strong>de</strong> la<br />
Loire (Saint Sébastien sur Loire, Rezé, Vertou, <strong>Le</strong>s Sorinières, Bouguenais). La capacité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> la<br />
station <strong>de</strong> la Petite Californie, située sur la commune <strong>de</strong> Rezé, doit passer <strong>de</strong> 122 000 à 180 000<br />
équivalents habitants. En effet, elle arrive actuellement en limites <strong>de</strong> capacité.<br />
<strong>Le</strong> procédé <strong>de</strong> traitement est comparable à celui utilisé à la station <strong>de</strong> Tougas.<br />
<strong>Le</strong>s ren<strong>de</strong>ments épuratoires <strong>de</strong> cette station sont jugés satisfaisants, ils atteignent 96% pour les matières<br />
organiques, 95% pour l’azote réduit, 66% pour le phosphore, 60% pour les matières inhibitrices 70% pour<br />
les métaux et métalloï<strong>de</strong>s.<br />
<strong>Le</strong>s boues issues <strong>de</strong>s stations d’épuration sont valorisées en agriculture après analyses en laboratoire<br />
(même filière que pour les boues <strong>de</strong> Tougas), ou encore incinérées.<br />
127
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La filière agricole pour la valorisation <strong>de</strong>s boues <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Metropole s’étend sur 75 communes du<br />
département, mobilisant 150 exploitations agricoles pour un <strong>plan</strong> d’épandage <strong>de</strong> 8400 ha. Ce sont ainsi<br />
50 000 tonnes <strong>de</strong> boues qui sont épandues chaque année. Ces boues ont un taux <strong>de</strong> matière sèche <strong>de</strong><br />
30%, d’où une charge d’épandage d’environ 1,8 tonnes <strong>de</strong> matières sèches par hectare.<br />
3. <strong>Le</strong> programme Neptune<br />
La politique globale <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole en termes <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong>s cours d’eau et <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
milieux aquatiques (basée sur la maîtrise <strong>de</strong> l’assainissement) est définie par le programme Neptune. Ce<br />
programme a pour principaux objectifs :<br />
• d’adapter le réseau d’assainissement à l’évolution <strong>de</strong> l’agglomération nantaise,<br />
• d’améliorer les capacités et les performances <strong>de</strong>s traitements <strong>de</strong>s stations d’épuration,<br />
• d’affirmer la politique <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s cours d’eau et la restauration <strong>de</strong>s usages traditionnels liés à<br />
l’eau.<br />
Deux programmes ont déjà été menés (Neptune I entre 1994 et 1998 ; Neptune II entre 1999 et 2003),<br />
alors que le contrat Neptune III a été engagé sur la pério<strong>de</strong> 2004 – 2008. Ces programmes sont financés<br />
par l’Agence <strong>de</strong> l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Général <strong>de</strong> Loire Atlantique, la Région Pays <strong>de</strong> la Loire et<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole.<br />
En termes d’assainissement, le programme Neptune I a permis <strong>de</strong> :<br />
• mettre en place <strong>de</strong>s collecteurs intercommunaux permettant la suppression <strong>de</strong> stations<br />
communales déversant dans <strong>de</strong>s cours d’eau sensibles (Bouguenais, les Sorinières, Couëron, La<br />
Chapelle sur Erdre),<br />
• équiper en métrologie permettant <strong>de</strong> diagnostiquer le fonctionnement du réseau (50 points <strong>de</strong><br />
contrôle) et mettre en place un système d’autosurveillance <strong>de</strong>s ouvrages d’épuration,<br />
• installer 130km <strong>de</strong> réseau et en réhabiliter 73km,<br />
• mettre en service 6 stations d’épuration : Tougas, Petite Californie, Ile Chaland, Saint Aignan <strong>de</strong><br />
Grand-Lieu, Saint Jean <strong>de</strong> Boiseau et Trellières (hors <strong>Nantes</strong> Métropole).<br />
L’ensemble <strong>de</strong> ces actions a permis <strong>de</strong> porter le taux <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s eaux usées <strong>de</strong> 63% à 74% et<br />
d’atteindre <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments épuratoires <strong>de</strong> 80% pour les matières organiques oxydables (MOOX) et <strong>de</strong><br />
50% pour le phosphore.<br />
<strong>Le</strong> programme Neptune II a quant à lui porté notamment sur :<br />
• la réalisation <strong>de</strong> 177km <strong>de</strong> réseaux d’assainissement raccordant 15 000 équivalents habitants<br />
environ,<br />
• la réhabilitation <strong>de</strong> 46km <strong>de</strong> réseaux,<br />
• la fiabilisation <strong>de</strong>s chaînes <strong>de</strong> transfert entre <strong>Nantes</strong>-Thouaré-Sainte Luce sur Loire et Sucé-<br />
Carquefou-<strong>Nantes</strong>,<br />
• la réalisation d’étu<strong>de</strong>s pour les zonages d’assainissement et sur la valorisation agricole <strong>de</strong>s<br />
boues.<br />
Il s’agissait donc principalement <strong>de</strong> poursuivre et réaffirmer les objectifs du premier contrat. Toutefois, la<br />
réorganisation <strong>de</strong>s services en janvier 2001 a induit un retard dans le programme, ne permettant pas<br />
d’atteindre la totalité <strong>de</strong>s objectifs fixés.<br />
Enfin, quatre objectifs majeurs ont été définis pour le contrat Neptune III :<br />
• Sécuriser l’alimentation en eau potable, notamment en mettant en place une prise d’eau <strong>de</strong><br />
secours sur l’Erdre aval reliée à l’usine <strong>de</strong> la Roche, et pour cela ;<br />
128
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
• Limiter les rejets polluants en Erdre aval en :<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Améliorant les réseaux <strong>de</strong> transfert séparatifs et unitaires,<br />
Réduisant les rejets du réseau unitaire,<br />
Fiabilisant le réseau <strong>de</strong> transfert séparatif,<br />
Optimisant le réseau séparatif secondaire,<br />
• Protéger et valoriser les coulées vertes <strong>de</strong> l’agglomération que constituent les milieux<br />
aquatiques et les zones humi<strong>de</strong>s associées,<br />
• En termes d’assainissement, les actions prioritaires consisteront donc à limiter les déversements<br />
du réseau unitaire sur l’Erdre. <strong>Le</strong>s collecteurs <strong>de</strong> la Chézine et la liaison Couëron Saint Herblain<br />
seront également sécurisés.<br />
Enfin, le programme prévoit <strong>de</strong>s actions visant à pérenniser le traitement <strong>de</strong>s boues <strong>de</strong> stations<br />
d’épuration, et à étendre les réseaux et le contrôle <strong>de</strong> 10 000 à 13 000 installations individuelles via le<br />
SPANC.<br />
4. Ressources énergétiques<br />
<br />
Ressources énergétiques <strong>local</strong>es<br />
La thématique ressources énergétiques concerne l’échelle <strong>de</strong> territoire du département <strong>de</strong> Loire-<br />
Atlantique. <strong>Le</strong>s principaux sites d’alimentation énergétiques sont :<br />
• le terminal méthanier <strong>de</strong> Montoir ;<br />
• le terminal pétrolier et la raffinerie <strong>de</strong> Donges ;<br />
• la centrale thermique <strong>de</strong> Cor<strong>de</strong>mais ;<br />
• le terminal charbonnier <strong>de</strong> Montoir.<br />
A ces quatre sites principaux, il faut ajouter <strong>de</strong>s productions énergétiques très <strong>local</strong>isées que<br />
représentent, les filières <strong>de</strong> valorisation <strong>de</strong>s déchets urbains (réseau <strong>de</strong> chaleur, vapeur ou électricité) ou<br />
l’énergie géothermique produite grâce à la chaleur <strong>de</strong> la terre et permettant <strong>de</strong> chauffer <strong>de</strong> plus en plus<br />
<strong>de</strong> maisons individuelles.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s statistiques <strong>de</strong> la consommation énergétique globale et par secteurs<br />
d’activité<br />
<strong>Le</strong>s statistiques énergétiques régionales mettent en évi<strong>de</strong>nce une augmentation <strong>de</strong> la consommation<br />
énergétique régionale (en milliers <strong>de</strong> TEP – voir figure suivante) atteignant en l’an 2000 95000 milliers<br />
<strong>de</strong> TEP.<br />
129
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Bilan 1998 par vecteurs énergétiques (en milliers <strong>de</strong> TEP)<br />
En terme <strong>de</strong> consommation, l’électricité et les produits pétroliers sont les sources énergétiques les plus<br />
consommées alors que les énergies produites en plus gran<strong>de</strong> quantité dans la région sont les produits<br />
pétroliers et le gaz naturel.<br />
La consommation énergétique finale correspond à 9595 ktep toutes énergies confondues (charbon,<br />
produits pétroliers, gaz, électricité, bois).<br />
Charbon<br />
Produits<br />
pétroliers<br />
Gaz Electricité Bois<br />
Ensemble<br />
<strong>de</strong>s<br />
énergies<br />
recensées<br />
Industrie (1) 31 286 391 1 231 45 1 996<br />
Rési<strong>de</strong>ntiel et Tertiaire 0 901 801 2 504 425 4 631<br />
Agriculture nr 222 46 77 nr 345<br />
Transport nr 2 562 nr 60 nr 2 622<br />
Ensemble 31 3 971 1 238 3 872 470 9 595<br />
1) Industrie y compris sidérurgie BTP production distribution d'eau et industries agro-alimentaires<br />
Source : Observatoire <strong>de</strong> l'énergie. Mai 2000.<br />
Consommation énergétique finale : 9 595 ktep<br />
Unité : ktep<br />
130
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Dans le secteur industriel, l’électricité est l’énergie la plus consommée représentant 61,5% <strong>de</strong> la<br />
consommation totale.<br />
Part relative <strong>de</strong>s énergies dans l'industrie en 1998<br />
En pays <strong>de</strong> la Loire, la quantité d’énergie électrique est consommée majoritairement et a proportion<br />
quasi égale par le secteur rési<strong>de</strong>ntiel (1/3) et l’industrie (1/3). <strong>Le</strong> <strong>de</strong>rnier tiers étant majoritairement<br />
consommée par le secteur tertiaire.<br />
Répartition <strong>de</strong> la consommation d'électricité par secteurs économiques en 1998<br />
<strong>Le</strong> gaz naturel est utilisé majoritairement (42,8%) par le secteur domestique et agricole suivi a proportion<br />
quasi égale par les secteurs <strong>de</strong> la petit industrie (20,6%), du tertiaire (19,6) et <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> industrie<br />
(16,8%).<br />
Répartition <strong>de</strong> la consommation <strong>de</strong> gaz naturel par secteurs économiques en 1998<br />
<strong>Le</strong>s produits pétroliers sont employés majoritairement dans le secteur <strong>de</strong>s transports à hauteur <strong>de</strong> 62,9%,<br />
suivi loin <strong>de</strong>rrière par le secteur tertiaire correspondant à 23,1%.<br />
Répartition <strong>de</strong>s consommations <strong>de</strong> produits pétroliers par secteurs économiques en 1998<br />
131
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
5. Energies renouvelables<br />
<br />
Actions d’économie d’énergie, ou <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s énergies renouvelables<br />
Des potentialités tant dans le domaine <strong>de</strong> l’éolien que solaire existent dans le département <strong>de</strong> la Loire-<br />
Atlantique.<br />
Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données et contraintes pour l’im<strong>plan</strong>tation d’aérogénérateurs sur le territoire <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
Métropole a été réalisée en vue <strong>de</strong> constituer un outil d’ai<strong>de</strong> à la décision. Cette étu<strong>de</strong> intitulée « Etu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s données et constraintes pour l’im<strong>plan</strong>tation d’aérogénérateurs sur le territoire <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
Métropole » a été réalisée dans le cadre <strong>de</strong> l’Agenda 21 <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> métropole en partenariat avec l’ADEME<br />
– Contrat ATEnEE en mars 2005.<br />
L’objectif principal est <strong>de</strong> poser le cadre relatif au développement possible <strong>de</strong> la filière éolienne sur le<br />
territoire <strong>de</strong> la communauté en apportant <strong>de</strong>s informations sur :<br />
- la <strong>local</strong>isation précise <strong>de</strong>s sites susceptibles d’accueillir un projet éolien ;<br />
- la visualisation du développement <strong>de</strong> l’éolien sur le territoire ;<br />
- la mesure <strong>de</strong>s enjeux par <strong>rapport</strong> aux secteurs et aux populations concernées.<br />
Un parc éolien est l’aboutissement d’une démarche <strong>de</strong> développement qui vise la sélection du meilleur<br />
site d’im<strong>plan</strong>tation. Pour cela, ont été pris en compte les <strong>de</strong>ux impératifs suivants :<br />
- s’assurer d’un potentiel éolien suffisant ;<br />
- vérifier que le site d’im<strong>plan</strong>tation ne représente pas <strong>de</strong> contrainte d’im<strong>plan</strong>tation, autre que celle<br />
liée au vent.<br />
L’exploitation et la rentabilité d’un site éolien sont fortement liées au contexte économique.<br />
Actuellement en France, un site éolien est considéré comme exploitable et donc rentable s’il présente<br />
une vitesse moyenne annuelle <strong>de</strong> 6,3m/s à 60 mètres <strong>de</strong> hauteur. Rappelons que pour qu’un projet<br />
éolien soit en conformité avec un document d’urbanisme communal, il faut que le POS/PLU en vigueur<br />
autorise l’im<strong>plan</strong>tation d’éolienne ou les installations d’intérêt général.<br />
L’im<strong>plan</strong>tation d’une éolienne est assujettie aux textes réglementaires qui régissent les bruits <strong>de</strong><br />
voisinage :<br />
- le décret n°95-408 du 18 avril 1995 ;<br />
- la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits <strong>de</strong> voisinage ;<br />
- la norme NFS 31-010 sur les conditions <strong>de</strong> mesurage.<br />
La réglementation <strong>de</strong>s bruits <strong>de</strong> voisinage et donc <strong>de</strong>s parcs éoliens, s’appuie sur la notion d’émergence.<br />
« l’émergence est définie par la différence entre le niveau <strong>de</strong> bruit ambiant, comportant le bruit<br />
particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble <strong>de</strong>s bruits habituels, extérieurs ou<br />
intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale <strong>de</strong>s locaux et au fonctionnement<br />
normal <strong>de</strong>s équipements ».<br />
<strong>Le</strong> décret du 18 avril 1995 fixe <strong>de</strong>s émergences à respecter au droit <strong>de</strong>s riverains. Dans le cas d’installation<br />
susceptible <strong>de</strong> fonctionner en continu, les critères d’émergence, pour un niveau sonore global incluant le<br />
bruit particulier supérieur à 30 dB(A), sont les suivants :<br />
- pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 7h à 22h : + 5 dB(A) ;<br />
- -pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 22h à 7h : + 3 dB(A).<br />
L’étu<strong>de</strong> s’appuie sur une caractérisation du niveau sonore existant au droit <strong>de</strong>s tiers, avant l’im<strong>plan</strong>tation<br />
<strong>de</strong>s éoliennes, puis sur une estimation du même niveau sonore après installation <strong>de</strong>s éoliennes.<br />
132
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron comporte différentes potentialités d’im<strong>plan</strong>tation éolienne plus ou moins<br />
favorable puisque pour certains secteurs font partie <strong>de</strong>s secteurs d’im<strong>plan</strong>tation hors contraintes<br />
absolues les plus favorables, d’autres appartiennent aux secteurs d’im<strong>plan</strong>tation hors contraintes<br />
absolues favorables et d’autres encore font partie <strong>de</strong>s secteurs d’im<strong>plan</strong>tation hors contrainte absolues<br />
moyennement favorables.<br />
6. <strong>Le</strong>s déchets et leur valorisation<br />
(source <strong>Nantes</strong> Métropole – Rapport annuel déchets 2004)<br />
La gestion <strong>de</strong>s déchets communaux fait partie du dispositif communautaire <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s déchets.<br />
<br />
<strong>Le</strong> territoire concerné<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole assure le service d’élimination <strong>de</strong>s déchets ménagers et assimilés <strong>de</strong>s 24 communes<br />
membres pour 554 478 habitants (INSEE 1999).<br />
<br />
La compétence<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole exerce la fonction d’autorité organisatrice sur la globalité <strong>de</strong> la compétence en<br />
matière d’élimination <strong>de</strong>s déchets ménagers et assimilés à savoir la collecte, le tri, le traitement et la<br />
valorisation. Avec l’assistance, au sein <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole, <strong>de</strong> la Direction Déchets et <strong>de</strong>s<br />
pôles <strong>de</strong> proximité, l’autorité organisatrice:<br />
• organise et définit les missions du service public (réponse aux attentes et besoins <strong>de</strong>s usagers,<br />
accès au service, prospective, schéma directeur, évaluation <strong>de</strong>s politiques),<br />
• met en oeuvre les moyens spécifiques et définit la politique tarifaire et <strong>de</strong> financement du<br />
service public,<br />
• détermine les conditions d’exercice du service public (niveau <strong>de</strong> service, qualité <strong>de</strong> la prestation,<br />
choix <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion),<br />
• assure la gestion et la maîtrise d’ouvrage <strong>de</strong> son patrimoine,<br />
• contrôle l’exécution <strong>de</strong>s missions par les opérateurs (publics ou privés).<br />
Dans ce cadre, la Direction Déchets assure la gestion :<br />
• <strong>de</strong> la collecte <strong>de</strong>s déchets ménagers et assimilés,<br />
• <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> service public relatifs au traitement <strong>de</strong>s déchets,<br />
• du réseau <strong>de</strong>s 12 déchèteries et 4 écopoints,<br />
• <strong>de</strong>s marchés transversaux concernant l’élimination <strong>de</strong>s déchets banals produits par la<br />
Communauté urbaine,<br />
• <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong>s anciennes décharges <strong>de</strong> Tougas et <strong>de</strong> la Prairie <strong>de</strong> Mauves.<br />
Elle assure également la fonction d’opérateur <strong>de</strong> collecte sur le territoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>.<br />
<strong>Le</strong>s pôles <strong>de</strong> proximité sont associés à la définition <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s déchets <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
Métropole. Ils ont en charge le suivi, le contrôle <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> collecte et assurent les relations avec les<br />
habitants sur leur territoire.<br />
133
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
L’organisation <strong>de</strong>s collectes<br />
<strong>Le</strong>s ordures ménagères résiduelles sont collectées en bacs roulants (2 fois par semaine à Couëron).<br />
La collecte sélective est réalisée en porte-à-porte (en bacs et en sacs 2 fois par semaine à Couëron). <strong>Le</strong><br />
verre est collecté en points d’apports volontaires (35 sur la commune <strong>de</strong> Couëron). La commune est<br />
également équipée <strong>de</strong> 8 points d’apport volontaire pour les papiers-journaux-magazines.<br />
<strong>Le</strong>s déchets verts sont collectés en apport volontaire dans les déchèteries et écopoints <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
Métropole. <strong>Le</strong>s déchets verts en quantité trop importante pour être accueillis en déchetterie peuvent être<br />
déposés à l’unité <strong>de</strong> compostage d’Arc-en-Ciel. Ces déchets verts peuvent également être compostés<br />
chez les particuliers au moyen <strong>de</strong> composteurs individuels.<br />
<strong>Le</strong>s déchets dangereux <strong>de</strong>s ménages sont collectés sur l’espace public <strong>de</strong> chaque commune <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong><br />
Métropole grâce à un véhicule spécialisé (4 fois par an Couëron).<br />
<strong>Le</strong>s encombrants sont collectés en porte-à-porte (6 fois par an Couëron) excepté sur les communes <strong>de</strong><br />
Bouguenais, La Montagne, La Chapelle-sur-Erdre, <strong>Le</strong> Pellerin, <strong>Le</strong>s Sorinières, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-<br />
Jean-<strong>de</strong>-Boiseau.<br />
<strong>Le</strong>s déchèteries permettent aux habitants <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole <strong>de</strong> déposer leurs déchets ménagers non<br />
collectés en porte-à-porte : déblais et gravats (sauf dans les écopoints), papiers, cartons, journaux, livres,<br />
plastiques ménagers, verre, bois, ferraille, encombrants ménagers divers, huiles moteurs, batteries,<br />
déchets verts issus <strong>de</strong>s ménages, D.E.E.E.<br />
<strong>Le</strong>s 4 écopoints sur le territoire <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> offrent les mêmes services que les déchèteries, seuls les<br />
gravats ne sont pas admis. Ils ne disposent pas <strong>de</strong> quais <strong>de</strong> déchargement.<br />
Ces établissements n’acceptent pas les déchets <strong>de</strong>s professionnels.<br />
Organisation <strong>de</strong> la collecte sélective (hors verre)<br />
134
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s équipements<br />
Pour exercer sa compétence, <strong>Nantes</strong> Métropole dispose <strong>de</strong>s équipements suivants :<br />
• un réseau <strong>de</strong> 12 déchèteries (La-Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Saint Herblain, Saint-Jean-<strong>de</strong>-<br />
Boiseau, La Montagne, Rezé, Saint-Sébastien-Sur-Loire, Vertou, St Aignan-<strong>de</strong>-Grand-Lieu, Orvault,<br />
<strong>Nantes</strong>, Mauves-sur-Loire) et <strong>de</strong> 4 écopoints (mini-déchèteries) qui permettent aux habitants <strong>de</strong><br />
l‘agglomération <strong>de</strong> déposer leurs déchets ménagers autres que les ordures ménagères<br />
résiduelles : déchets encombrants, gravats (sauf dans les écopoints), déchets verts, ferraille,<br />
verre, carton ;<br />
• une unité <strong>de</strong> valorisation énergétique d’ordures ménagères Valoréna, mise en service en octobre<br />
1987, qui alimente un réseau <strong>de</strong> chauffage urbain, située à <strong>Nantes</strong> sur le site <strong>de</strong> la Prairie <strong>de</strong><br />
Mauves ;<br />
• un dispositif multifilières Arc-en-Ciel, mis en service en mars 1994, qui se compose :<br />
• à Couëron, d’un centre <strong>de</strong> traitement et <strong>de</strong> valorisation <strong>de</strong>s déchets avec une unité <strong>de</strong><br />
valorisation énergétique, un centre <strong>de</strong> tri et <strong>de</strong> conditionnement <strong>de</strong>s déchets ménagers<br />
recyclables, un centre <strong>de</strong> tri <strong>de</strong>s déchets industriels banals,<br />
• une unité <strong>de</strong> compostage <strong>de</strong> déchets verts à Saint-Herblain.<br />
135
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
<strong>Le</strong>s tonnages et leurs évolutions<br />
N.B. : D.E.E.E. Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques<br />
* Contrairement aux années précé<strong>de</strong>ntes, le tonnage <strong>de</strong>s encombrants collectés en porte-à-porte n’est<br />
plus comptabilisé avec les ordures ménagères résiduelles mais avec le tout venant. <strong>Le</strong>ur tonnage est <strong>de</strong><br />
2 113 tonnes.<br />
La légère baisse constatée en 2003 n’est pas observée cette année : le tonnage total collecté est en<br />
augmentation <strong>de</strong> 2,8 % par <strong>rapport</strong> à l’année précé<strong>de</strong>nte, en raison notamment d’une augmentation<br />
significative du tonnage <strong>de</strong> gravats. Une progression <strong>de</strong>s tonnages <strong>de</strong>stinés à la valorisation matière est<br />
également constatée : déchets verts, emballages et papiers recyclables, verre.<br />
Evolution <strong>de</strong>s tonnages par type <strong>de</strong> déchets<br />
Evolution <strong>de</strong>s tonnages par habitant (kg/hab/an)<br />
<strong>Le</strong> tonnage collecté est globalement en augmentation.<br />
136
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong>s ordures ménagères résiduelles :<br />
• on constate, comme en 2003, une baisse du tonnage d’ordures ménagères résiduelles ;<br />
• compte-tenu <strong>de</strong> l’augmentation régulière <strong>de</strong> la population sur le territoire <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole,<br />
la production d’ordures ménagères résiduelles par habitant et par an connaît une baisse plus<br />
significative encore, <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 1,3 %.<br />
La tendance observée <strong>de</strong>puis 2001 semble donc être une tendance <strong>de</strong> fond. Elle peut s’expliquer par une<br />
évolution <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> consommation, mais aussi par un transfert vers les différents mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> collectes<br />
sélectives mis en place sur le territoire.<br />
• le tonnage d’emballages et papiers recyclables augmente <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 1 000 tonnes (+ 6 % par<br />
<strong>rapport</strong> à 2003). Il faut y voir l’effet <strong>de</strong> la montée en puissance <strong>de</strong> la collecte sélective,<br />
notamment, suite au passage <strong>de</strong> l’apport volontaire au porte-à-porte sur plusieurs communes en<br />
2003 et 2004 ;<br />
• parallèlement, le tonnage <strong>de</strong> verre progresse également <strong>de</strong> 1 000 tonnes environ (+ 7 %). De<br />
manière générale, il est souvent constaté que ces <strong>de</strong>ux collectes évoluent <strong>de</strong> manière similaire ;<br />
• Une nouvelle hausse <strong>de</strong> la production <strong>de</strong> déchets verts par habitant est constatée (+4 %), après la<br />
stagnation observée les années précé<strong>de</strong>ntes. A noter qu’en 2003, les conditions climatiques<br />
étaient particulièrement sèches ;<br />
• le tonnage <strong>de</strong> ferraille par habitant connaît à nouveau une baisse importante (- 14 %), non<br />
compensée par l’augmentation du tonnage <strong>de</strong> DEEE collecté en déchèterie. Ce constat est à<br />
mettre en lien avec la hausse <strong>de</strong>s cours mondiaux <strong>de</strong> l’acier, qui accroît le phénomène <strong>de</strong><br />
récupération sur les déchèteries.<br />
Autres déchets :<br />
• La production du tout venant par habitant augmente <strong>de</strong> 7 %, ce qui confirme la progression <strong>de</strong> la<br />
collecte en déchèterie. En 2004, cette augmentation est plus sensible que sur les exercices<br />
précé<strong>de</strong>nts ;<br />
• <strong>Le</strong> tonnage <strong>de</strong> gravats par habitant augmente quant à lui fortement (+14 %). A noter : un<br />
changement <strong>de</strong> mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> collecte dans certaines déchèteries, qui permet une augmentation <strong>de</strong><br />
la capacité d’accueil.<br />
<br />
La <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s déchets<br />
137
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
• 55 % <strong>de</strong>s déchets collectés sont <strong>de</strong>s déchets résiduels faisant l’objet d’une valorisation<br />
énergétique (récupération <strong>de</strong> l’énergie dégagée par l’incinération pour produire <strong>de</strong> l’électricité,<br />
<strong>de</strong> la chaleur alimentant un réseau <strong>de</strong> chauffage urbain ou <strong>de</strong> la vapeur utilisée dans<br />
l’industrie) ;<br />
• 25 % <strong>de</strong>s tonnages collectés sont <strong>de</strong>s matériaux recyclables. Il s’agit du verre, <strong>de</strong>s emballages, <strong>de</strong>s<br />
papiers, <strong>de</strong> la ferraille et <strong>de</strong>s déchets verts, qui font l’objet d’une valorisation matière : ils sont<br />
réutilisés pour fabriquer <strong>de</strong> nouveaux produits ;<br />
• 11 % sont <strong>de</strong>s gravats réutilisés sans transformation en remblaiement ;<br />
• 9 % sont constitués <strong>de</strong> tout venant et d’encombrants, qui sont principalement <strong>de</strong>stinés à<br />
l’enfouissement.<br />
138
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
VII- ENVIIRONNEMENT URBAIIN<br />
1. <strong>Le</strong>s nuisances urbaines<br />
<br />
La pollution atmosphérique<br />
<strong>Le</strong>s engagements nationaux et les Plans <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong> l’Atmosphère<br />
La ratification du protocole <strong>de</strong> Kyoto par une gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong> pays dans le mon<strong>de</strong> traduit l’intérêt<br />
pour la lutte contre l’effet <strong>de</strong> serre et la réduction <strong>de</strong> la couche d’ozone.<br />
La Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle <strong>de</strong> l'énergie du 30 décembre 1996, reprise dans le co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l'environnement, fixe pour objectif l'amélioration et la préservation <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l'air. A cette fin, <strong>de</strong>s<br />
outils <strong>de</strong> <strong>plan</strong>ification sont mis en place parmi lesquels figure le <strong>plan</strong> <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l'atmosphère<br />
(PPA).<br />
Ce dispositif est prévu pour les agglomérations <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 250 000 habitants et pour les zones où les<br />
valeurs limites <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> l'air sont dépassées ou risquent <strong>de</strong> l'être (cas <strong>de</strong> la zone industrielle <strong>de</strong> la<br />
Basse-Loire). C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'élaborer un <strong>plan</strong> <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l'atmosphère<br />
couvrant la zone <strong>Nantes</strong>/Saint-Nazaire.<br />
<strong>Le</strong> projet, initié en juin 2002, a pu être adopté par arrêté préfectoral le 30 août 2005.<br />
<strong>Le</strong> périmètre du PPA <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>-Saint-Nazaire comprend 57 communes et se confond avec le territoire du<br />
projet <strong>de</strong> schéma <strong>de</strong> cohérence territoriale.<br />
• Situation <strong>de</strong> la zone vis-à-vis <strong>de</strong>s valeurs limites applicables en 2002 : sur la pério<strong>de</strong> 1998-2001,<br />
les valeurs limites fixées par décret ont été dépassées pour le dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> soufre à Donges, les<br />
oxy<strong>de</strong>s d'azote à <strong>Nantes</strong> (sur les sites urbains et <strong>de</strong> trafic) et Donges et les poussières PM10 dans<br />
la zone portuaire <strong>de</strong> Montoir-<strong>de</strong>-Bretagne.<br />
Pour tous les autres polluants, aucune valeur limite n'a été dépassée à <strong>Nantes</strong>, dans les sites urbains ou<br />
<strong>de</strong> trafic : dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> soufre (SO2), dioxy<strong>de</strong> d'azote (NO2), Plomb, Poussières PM10, Monoxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone<br />
(CO), Benzène (C6H6), Ozone (O3).<br />
• Situation <strong>de</strong>s futures valeurs limites (2003 et au-<strong>de</strong>là) : les valeurs limites actuelles seront<br />
progressivement renforcées d'ici 2005 et 2010 en application <strong>de</strong>s directives européennes du 22<br />
avril 1999 et du 16 novembre 2000, transposées par le décret n°2002-213 du 15 février 2002.<br />
Si l'on compare les mesures effectuées <strong>de</strong>puis 1998 aux futures valeurs limites, la situation serait la<br />
suivante : à <strong>Nantes</strong>, les valeurs limites risqueraient d'être dépassées pour le dioxy<strong>de</strong> d'azote et les oxy<strong>de</strong>s<br />
d'azote dans les sites urbains ou <strong>de</strong> trafic, si les conditions <strong>de</strong> trafic et d'émission n'évoluent pas.<br />
<strong>Le</strong> <strong>plan</strong> régional pour la qualité <strong>de</strong> l’air<br />
La Loi sur l'air met en place également <strong>de</strong>s <strong>plan</strong>s régionaux, qui sont à l'initiative <strong>de</strong>s collectivités <strong>local</strong>es<br />
et <strong>de</strong> l'Etat et viennent affiner les mesures et les objectifs <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s émissions par région, selon<br />
ses caractéristiques spécifiques.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong>s travaux préparatoires à l’élaboration du PRQA (<strong>plan</strong> régional pour la qualité <strong>de</strong> l’air), le<br />
Centre Interprofessionnel Technique d’Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Pollution Atmosphérique (CITEPA) a réalisé en<br />
décembre 2001 un inventaire actualisé 1999 <strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong> polluants atmosphériques, ainsi qu’une<br />
étu<strong>de</strong> prospective <strong>de</strong>s émissions pour l’ensemble <strong>de</strong>s gaz étudiés à l’horizon 2005, tenant compte <strong>de</strong>s<br />
évolutions réglementaires et techniques.<br />
139
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong>s sources <strong>de</strong> pollutions sont classées en trois catégories :<br />
• les gran<strong>de</strong>s sources ponctuelles, c'est-à-dire les établissements industriels soumis à la taxe<br />
parafiscale sur la pollution atmosphérique complétés par quelques autres émetteurs,<br />
• les gran<strong>de</strong>s sources linéaires, soit les autoroutes et les routes nationales,<br />
• les sources surfaciques diffuses, constituées par le reste <strong>de</strong>s sources ponctuelles et linéaires,<br />
chaque type étant considéré globalement.<br />
<strong>Le</strong>s résultats obtenus permettent d’estimer la répartition <strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong> polluants atmosphériques par<br />
territoire et par polluant. Vingt-six substances sont étudiées dans l’inventaire, ainsi que le « Potentiel <strong>de</strong><br />
réchauffement global » (PRG) qui agrège, conformément au protocole <strong>de</strong> Kyoto en une seule valeur<br />
l’effet cumulé <strong>de</strong> toutes les substances contribuant à l’accroissement <strong>de</strong> l’effet <strong>de</strong> serre en « équivalent<br />
CO2 ».<br />
La qualité <strong>de</strong> l’air dans la région pays <strong>de</strong> la Loire<br />
En 2005, les agglomérations <strong>de</strong>s Pays <strong>de</strong> la Loire ont bénéficié d’une bonne qualité <strong>de</strong> l’air plus <strong>de</strong> 8 jours<br />
sur 10. Une qualité <strong>de</strong> l’air moyenne à médiocre a été constatée pendant 1 jour 1/2 sur 10. Une mauvaise<br />
qualité <strong>de</strong> l’air a été observée plus rarement, moins d’1/2 jour sur 10, soit 3 jours <strong>de</strong> l’année.<br />
En 2005, les niveaux <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> l’air <strong>de</strong> la région ont respecté la majorité <strong>de</strong>s seuils réglementaires. Sur<br />
les 30 seuils applicables, seuls 9 ont été dépassés sur quelques sites <strong>de</strong> la région <strong>de</strong>s Pays <strong>de</strong> la Loire.<br />
Ainsi, une valeur limite établie pour le dioxy<strong>de</strong> d’azote a été franchie à <strong>Nantes</strong> sur <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> circulation<br />
exposés. <strong>Le</strong>s seuils <strong>de</strong> recommandation et d’information ont été ponctuellement dépassés pour le<br />
dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> soufre, l’ozone et le dioxy<strong>de</strong> d’azote, sans toutefois atteindre les seuils d’alerte. Des<br />
dépassements <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> qualité ont été enregistrés pour quelques polluants (ozone, benzène et<br />
dioxy<strong>de</strong> d’azote).<br />
Situation <strong>de</strong>s mesures permanentes et indicatives par <strong>rapport</strong> aux seuils réglementaires <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong><br />
l’air dans les Pays <strong>de</strong> la Loire en 2005<br />
<strong>Le</strong>s sites <strong>de</strong> mesures dans l’agglomération nantaise<br />
La qualité <strong>de</strong> l’air dans l’agglomération nantaise est effectuée à partir <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> mesure <strong>local</strong>isés selon<br />
<strong>de</strong>s objectifs précis <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l'air, définis au <strong>plan</strong> national. Différents sites sont<br />
i<strong>de</strong>ntifiés :<br />
• Sites urbains : <strong>Le</strong>s sites urbains sont <strong>local</strong>isés dans une zone <strong>de</strong>nsément peuplée en milieu<br />
urbain, <strong>de</strong> façon à ne pas être soumis à une source déterminée <strong>de</strong> pollution et à caractériser la<br />
pollution moyenne <strong>de</strong> cette zone ;<br />
140
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
• Sites périurbains : <strong>Le</strong>s sites périurbains sont <strong>local</strong>isés dans une zone peuplée en milieu<br />
périurbain, <strong>de</strong> façon à ne pas être soumis à une source déterminée <strong>de</strong> pollution et à caractériser<br />
la pollution moyenne <strong>de</strong> cette zone ;<br />
• Sites <strong>de</strong> trafic : <strong>Le</strong>s sites <strong>de</strong> trafic sont <strong>local</strong>isés près d'axes <strong>de</strong> circulation importants, souvent<br />
fréquentés par les piétons ; ils caractérisent la pollution maximale liée au trafic automobile ;<br />
• Sites industriels : <strong>Le</strong>s sites industriels sont <strong>local</strong>isés <strong>de</strong> façon à être soumis aux rejets<br />
atmosphériques <strong>de</strong>s établissements industriels ; ils caractérisent la pollution maximale due à<br />
ces sources fixes.<br />
En 2005, la surveillance <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’air a été assurée par le réseau permanent <strong>de</strong>s mesures<br />
indicatives :<br />
• Début 2005, le réseau permanent comportait 10 sites : 5 urbains, 2 périurbains, 2 sites <strong>de</strong> trafic et<br />
1 site météorologique Météo France. La nouvelle stratégie <strong>de</strong> surveillance (programme Argos) a<br />
amené l’arrêt <strong>de</strong> trois sites permanents (Chauvinière, Eaux et Strasbourg) en cours d’année ;<br />
• Dans le cadre du programme <strong>de</strong> surveillance cyclique, un analyseur <strong>de</strong> poussières PM 2,5<br />
(poussières <strong>de</strong> diamètre inférieur à 2,5µm) a été utilisée en 2005 sur un site urbain à <strong>Nantes</strong> ;<br />
• Deux sites <strong>de</strong> mesure indicative ont été mis en œuvre en 2005 dans le cadre <strong>de</strong> campagnes <strong>de</strong><br />
mesure : il s’agissait d’un site <strong>de</strong> trafic rue Crébillon à <strong>Nantes</strong> et d’un site industriel près <strong>de</strong><br />
l’usine <strong>de</strong> production d’engrais SOFERTI à Indre.<br />
L’indice Atmo dans l’agglomération nantaise<br />
Localisation <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> mesures<br />
L’indice Atmo mesuré <strong>de</strong>puis 1996 dans l’agglomération nantaise est un indice global qui prend en<br />
compte plusieurs polluants : le dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> soufre, le dioxy<strong>de</strong> d’azote et l’ozone (ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers<br />
polluants étant majoritairement émis par les véhicules à moteurs).<br />
Indice Atmo pour la ville <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> sur l’année 2005<br />
L’échelle <strong>de</strong> 1 à 10 allant <strong>de</strong> très bon à très mauvais en passant par bon, moyen, médiocre, mauvais<br />
L’indice <strong>de</strong> qualité globale Atmo est sensible aux conditions <strong>de</strong> dispersion <strong>de</strong>s polluants (vents<br />
dominants, conditions atmosphériques et géographiques). De ce point <strong>de</strong> vue (vent dominants d’ouest,<br />
relief faible), l’agglomération nantaise connaît une situation plutôt favorable.<br />
141
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
A <strong>Nantes</strong>, en juillet, <strong>de</strong>s pics <strong>de</strong> pollution par l'ozone ont amené Air Pays <strong>de</strong> la Loire à déclencher la<br />
procédure d'information du public pendant trois journées, les 17, 18 et 26. Des épiso<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pollution<br />
comparables ont été signalés sur la majeure partie <strong>de</strong> la France. En effet, la situation caniculaire <strong>de</strong> juillet<br />
a favorisé la formation d'ozone, à partir <strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong> polluants précurseurs.<br />
A <strong>Nantes</strong>, en août, les niveaux d'ozone sont re<strong>de</strong>scendus et les Pays <strong>de</strong> la Loire ont connu<br />
majoritairement une bonne qualité <strong>de</strong> l'air.<br />
Différents polluants dans l’agglomération nantaise<br />
Dépassement d’une valeur limite sous l’influence <strong>de</strong>s rejets automobiles - Dioxy<strong>de</strong> d’azote : pollution<br />
élevée dans <strong>de</strong>s rues exposées<br />
En 2005, la valeur limite annuelle <strong>de</strong> 50µg/m3 applicable au dioxy<strong>de</strong> d’azote a été dépassée cette année<br />
rue Crébillon. Cette rue encaissé et empruntée chaque jour par 11000 véhicules présente une<br />
configuration favorable à l’accumulation <strong>de</strong> la pollution. Cette situation n’est pas spécifique à <strong>Nantes</strong>.<br />
Sur les autres axes <strong>de</strong> circulation surveillés dans l’agglomération nantaise, les valeurs limites ont été<br />
respectées. En agglomération, la dégradation <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’air est principalement observée à<br />
proximité <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> circulation, notamment ceux les plus encaissés et/ou présentant un trafic<br />
important.<br />
Poussières PM10 ont approché les valeurs limites.<br />
Pour les poussières PM10, les abords <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux axes <strong>de</strong> circulation nantais (rue Crébillon et boulevard<br />
Victor-Hugo) ont approché la valeur limite <strong>de</strong> 50 µg/m 3 .<br />
Pics <strong>de</strong> dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> soufre et d’ozone : 19 jours d’information du public.<br />
En 2005, Air Pays <strong>de</strong> la Loire a déclenché la procédure d’information du public, en raison <strong>de</strong> pics d’ozone :<br />
• 2 jours <strong>de</strong> déclenchement pour l’ozone le 23 juin en Loire-Atlantique et le 15 juillet pour l’ensemble <strong>de</strong> la<br />
région.<br />
2. <strong>Le</strong>s nuisances sonores<br />
<br />
Classement <strong>de</strong>s infrastructures bruyantes<br />
Sur la commune <strong>de</strong> Couëron le classement <strong>de</strong>s infrastructures <strong>de</strong> transports est défini par l’arrêté<br />
préfectoral du 19 mai 1999 (voir tableau ci-<strong>de</strong>ssous).<br />
Ce classement montre que la commune <strong>de</strong> Couëron est concernée par plusieurs infrastructures<br />
bruyantes.<br />
142
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong>s bâtiments à construire, dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement<br />
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et n° 95-21.<br />
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé par l’arrêté du 30 mai<br />
1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé l’arrêté du 9<br />
janvier 1995.<br />
Nom <strong>de</strong><br />
l’Infrastructure<br />
Nom du<br />
tronçon<br />
Début du<br />
tronçon<br />
Fin du<br />
tronçon<br />
Catégorie <strong>de</strong><br />
l’Infrastructure<br />
Largeur <strong>de</strong>s<br />
secteurs<br />
affectés par le<br />
bruit (1)<br />
Type <strong>de</strong> tissu<br />
(rue en “ U ”<br />
ou tissu<br />
ouvert)<br />
RD 101 D 101.01.01 D 201 D 26 3 100 Tissu ouvert<br />
RD 107 D 107.01.01 D 17 D 75 3 100 Tissu ouvert<br />
RD 17 D 17.02.01 D 617 D 75 3 100 Tissu ouvert<br />
RD 201 D 201.01.01 N 165 D 101 2 250 Tissu ouvert<br />
RD 201 D 201.02.01 D 101 D 75 2 250 Tissu ouvert<br />
RN 165 N 165.01.01 A 821 D 201 1 300 Tissu ouvert<br />
RN 165 N 165.02.01 D 201<br />
LC Nord <strong>Le</strong><br />
Temple <strong>de</strong><br />
Bretagne<br />
1 300 Tissu ouvert<br />
Ligne 515 N°3201 430+420 469+758 2 250<br />
(1) La largeur <strong>de</strong>s secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssus,<br />
comptée <strong>de</strong> part et d’autre <strong>de</strong> l’infrastructure à partir du bord extérieur <strong>de</strong> la chaussée la plus proche.<br />
3. <strong>Le</strong>s risques naturels<br />
Dans le cadre du projet <strong>local</strong> <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s risques et pollutions <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole, le préalable à<br />
toute action est <strong>de</strong> connaître la réalité <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong>s nuisances auxquels peut être confrontée<br />
l’agglomération. L’objectif étant d’adapter tant les mesures <strong>de</strong> prévention que les réponses<br />
opérationnelles en cas <strong>de</strong> crise avec l’ensemble <strong>de</strong>s acteurs concernés, à travers une culture commune.<br />
<strong>Le</strong>s utilisations concrètes du diagnostic <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong>s nuisances, et <strong>de</strong> la carte <strong>de</strong>s aléas sont <strong>de</strong><br />
plusieurs ordres :<br />
En matière <strong>de</strong> prévention, la prise en compte <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong>s nuisances dans la <strong>plan</strong>ification urbaine<br />
permet <strong>de</strong> réduire les vulnérabilités en évitant notamment d’exposer <strong>de</strong>s populations aux risques (par<br />
exemple, limitation <strong>de</strong>s constructions en zones inondables, zones tampons entre une entreprise à<br />
risques et <strong>de</strong>s habitations…). Elle permet également <strong>de</strong> définir, le cas échéant, <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection<br />
et <strong>de</strong> para<strong>de</strong> : schéma d’alerte <strong>de</strong>s crues <strong>de</strong> certains ruisseaux, par exemple, construction d’ouvrages…<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la révision <strong>de</strong>s PLU ou <strong>de</strong> l’instruction <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> construire, elle apporte une ai<strong>de</strong> à la<br />
décision pour répondre aux obligations données par les articles L.121.1, R123.11.b et R111.2 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’Urbanisme.<br />
143
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Elle est également à la base <strong>de</strong> l’information préventive <strong>de</strong> la population. A titre d’exemple, les<br />
Documents Communaux Synthétiques (DCS) transmis par l’Etat aux communes, et dont les données ont<br />
été intégrées au diagnostic, sont réalisés dans cet objectif.<br />
En matière <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> crise, la carte <strong>de</strong>s aléas permet l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s secteurs vulnérables et<br />
participe à la définition <strong>de</strong>s scénarios <strong>de</strong> crise, dans le cadre <strong>de</strong> la réalisation tant <strong>de</strong>s <strong>plan</strong>s communaux<br />
<strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> que du <strong>plan</strong> d’intervention et <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> la logistique communautaire.<br />
A Couëron, la structure morphologique est responsable <strong>de</strong> l'existence d’un type <strong>de</strong> risques naturels : les<br />
inondations.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s inondations<br />
D’après les Plus Hautes Eaux Connues relevées en 1910, la commune <strong>de</strong> Couëron est concernée par le<br />
risque d’inondation sur plus d’un tiers <strong>de</strong> son territoire. <strong>Le</strong>s limites communales englobent une large<br />
partie <strong>de</strong> la Loire et <strong>de</strong> son lit majeur. De ce fait, les espaces exposés aux inondations correspon<strong>de</strong>nt<br />
logiquement au champ d’expansion <strong>de</strong>s crues du fleuve. Ils se situent à proximité du cours d’eau.<br />
La zone d’épanchement <strong>de</strong>s eaux superficielles est composée <strong>de</strong> prairies humi<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> marais et est<br />
parcourue par <strong>de</strong> nombreux canaux d’irrigation dans la « Vallée <strong>de</strong> la Musse ». De part la situation<br />
géographique <strong>de</strong> Couëron, ces inondations se produisent lorsque se conjuguent mers <strong>de</strong> vives eaux<br />
exceptionnelles (conséquence <strong>de</strong>s surcôtes marines) et <strong>de</strong> fortes pluies. <strong>Le</strong>s limites <strong>de</strong>s Plus Hautes Eaux<br />
Connues, issues <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> la crue <strong>de</strong> 1910, englobent un autre espace à l’est <strong>de</strong> Couëron. Cet espace<br />
correspond au Lac <strong>de</strong> Beaulieu et l’étier qui lui est associé.<br />
L’aléa et le risque<br />
Sur les 1670 hectares <strong>de</strong> périmètre inondable, 1640 sont composés <strong>de</strong> prairies, bois, et zones humi<strong>de</strong>s, le<br />
tout sur <strong>de</strong>s basses terres. Si l’aléa est fort, c’est parce qu’il est associé à la <strong>local</strong>isation géographique en<br />
bordure du cours d’eau et à une configuration du terrain propice à la propagation <strong>de</strong>s eaux.<br />
<strong>Le</strong> risque quant à lui concerne les secteurs d’urbanisation au niveau <strong>de</strong> « l’Arche du Dareau », et <strong>de</strong> « La<br />
Rote », ainsi que les habitations sur la marge ouest du bourg au niveau <strong>de</strong> « La Rograie » (construites sur<br />
<strong>de</strong>s terres basses entre les isolignes 5 et 10 mètres).<br />
<br />
<strong>Le</strong> risque inondation<br />
<strong>Le</strong> risque inondation représente le risque naturel le plus courant en France. Ce risque peut être accentué<br />
par l’imperméabilisation <strong>de</strong>s sols, l’accélération <strong>de</strong>s vitesses d’écoulement <strong>de</strong>s eaux par l’artificialisation<br />
et le resserrement <strong>de</strong>s berges, ou certaines pratiques culturales et forestières.<br />
Aujourd’hui, les préoccupations <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques sont plus fortes que jamais et les moyens <strong>de</strong> lutte<br />
et <strong>de</strong> prévention sont très développés. <strong>Le</strong>s principaux cours d’eau ont fait l’objet d’étu<strong>de</strong>s hydrauliques<br />
(relatives à la circulation et la distribution <strong>de</strong> l’eau) et hydrologiques (hydrologie : étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la qualité et<br />
propriétés <strong>de</strong>s eaux), qui doivent se traduire par une procédure <strong>de</strong> Plan <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques<br />
Naturels prévisibles (PPR) mené par l’Etat.<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron est concernée par le risque d’inondation principalement lié à la Loire, même s’il<br />
reste très faible (nécessité <strong>de</strong> la conjugaison d’une crue <strong>de</strong> la Loire et d’une forte marée). <strong>Le</strong> débor<strong>de</strong>ment<br />
<strong>de</strong> la Loire et l’inondation potentielle <strong>de</strong> plaine constitue la cause essentielle du risque <strong>de</strong> montée <strong>de</strong>s<br />
eaux.<br />
La Loire connaît trois types <strong>de</strong> crues :<br />
• les crues océaniques : consécutives à <strong>de</strong>s pluies durables et généralisées sur une gran<strong>de</strong> partie<br />
du bassin <strong>de</strong> la Loire, principalement situées sur la partie amont ;<br />
• les crues cévenoles : consécutives à <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s orageux violents cantonnés à la partie sud du<br />
bassin <strong>de</strong> la Loire sous influence méditerranéenne. Ces crues, ponctuelles et <strong>local</strong>isées,<br />
n’affectent que rarement le cours moyen <strong>de</strong> la Loire car les volumes mis en jeu sont en général<br />
relativement faibles compte tenu <strong>de</strong> la surface du bassin aval (très inférieurs à ceux <strong>de</strong>s crues<br />
océaniques) ;<br />
144
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
• les crues mixtes : événement correspondant à la conjonction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux phénomènes déjà<br />
mentionnés. Ce type <strong>de</strong> crues occasionne souvent <strong>de</strong>s submersions très importantes.<br />
A ces phénomènes <strong>de</strong> crues s'ajoutent les effets <strong>de</strong> marée qui selon la conjonction <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s peuvent<br />
renforcer ou atténuer l'importance <strong>de</strong>s crues.<br />
L’évolution historique du niveau <strong>de</strong>s crues <strong>de</strong> Loire et leur probabilité<br />
Depuis le début du XX ème siècle, le lit <strong>de</strong> la Loire a été considérablement modifié. Outre les<br />
aménagements propres à la navigation estuarienne et le creusement d’un chenal à la cote – 5,50 m cote<br />
marine (CM), les aménagements <strong>de</strong>s bras <strong>de</strong> la Loire dans la traversée <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> combinées avec le<br />
recalibrage <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux bras <strong>de</strong> la Ma<strong>de</strong>leine au nord et <strong>de</strong> Pirmil au sud ont considérablement modifié les<br />
conditions d’écoulement du fleuve en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> crue. Ainsi, pour <strong>de</strong>s crues relativement i<strong>de</strong>ntiques en<br />
débit à <strong>Nantes</strong>, en 1910 et en 1982, les niveaux atteints par cette <strong>de</strong>rnière ont été inférieurs <strong>de</strong> 1,90 m à<br />
<strong>Nantes</strong>.<br />
En revanche, les phénomènes météorologiques connus dans l’estuaire peuvent engendrer une<br />
aggravation <strong>de</strong>s conditions d’écoulement du fleuve.<br />
<strong>Le</strong> risque <strong>de</strong> formation d’embâcles et d’encombres qui peuvent être provoqués par l’amoncellement <strong>de</strong><br />
végétaux emportés par le courant sur les ponts, nombreux à <strong>Nantes</strong>, doit être surveillé, dans la mesure<br />
où il pourrait provoquer <strong>de</strong>s rehaussements <strong>local</strong>ement très importants du niveau atteint par la crue.<br />
Il existe une relation entre le débit maximum d’une crue et la probabilité qu’elle se réalise : en amont <strong>de</strong><br />
l’agglomération nantaise, ces probabilités sont les suivantes :<br />
La réglementation <strong>de</strong>s surfaces submersibles a été instaurée afin <strong>de</strong> réduire les inondations dans les<br />
vallées inondables. Il s’agit <strong>de</strong> limiter les occupations du sol existantes et futures pour qu’elles ne fassent<br />
pas obstacle à l’écoulement <strong>de</strong>s crues, ni ne diminuent la taille <strong>de</strong>s champs d’expansion.<br />
<strong>Le</strong> Plan <strong>de</strong>s surfaces submersibles <strong>de</strong> la Loire (P.S.S.), approuvé par décret du 6 novembre 1958, a vocation<br />
<strong>de</strong> servitu<strong>de</strong> d’utilité publique, s’imposant au document d’urbanisme et aux tiers pour les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d’autorisation d’occupation <strong>de</strong>s sols.<br />
L'atlas <strong>de</strong>s zones inondables <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Loire pour la section du fleuve comprise entre les<br />
communes <strong>de</strong> Saint-Sébastien-sur-Loire et le Pellerin en rive gauche et celles <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> et Saint-Etienne<br />
– <strong>de</strong>- Montluc en rive droite a été transmis pour information à <strong>Nantes</strong> Métropole par <strong>Le</strong> Préfet le 19<br />
janvier 2007.<br />
Cet atlas a pour objectif <strong>de</strong> porter à connaissance <strong>de</strong>s collectivités <strong>local</strong>es et du public <strong>de</strong>s éléments<br />
d'information sur le risque d'inondation historique sous forme <strong>de</strong> textes et <strong>de</strong> cartes.<br />
Cet atlas se traduira prochainement sous forme réglementaire par la mise en oeuvre d'un <strong>plan</strong> <strong>de</strong><br />
prévention <strong>de</strong>s risques naturels prévisibles qui se substituera au <strong>plan</strong> <strong>de</strong>s surfaces submersibles (PSS)<br />
régi par les décrets n°58-1083 et 58-1084 du 6 novembre 1958.<br />
Dans l'attente <strong>de</strong> ce document <strong>de</strong> prévention, le P.S.S. est annexé au PLU.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s mouvements <strong>de</strong> terrain<br />
La commune n’est pas soumise au risque <strong>de</strong> mouvement <strong>de</strong> terrain.<br />
145
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
4. <strong>Le</strong>s risques technologiques<br />
La gran<strong>de</strong> concentration <strong>de</strong> zones industrielles dans l’estuaire <strong>de</strong> la Loire engendre cependant une<br />
circulation <strong>de</strong> matière dangereuses sur les différents axes d’acheminement : route, rail, <strong>de</strong>sserte Port<br />
Autonome <strong>Nantes</strong> – Saint-Nazaire. En outre, <strong>de</strong>ux oléoducs traversent le département au départ <strong>de</strong> la<br />
raffinerie <strong>de</strong> Donges (Oléoduc Donges-Metz et oléoduc Donges-Vern-sur-Seiche). La préfecture recense<br />
comme les plus exposées au risque lié au transport <strong>de</strong> matières dangereuses 33 communes du<br />
Département. Ces communes sont considérées comme les plus exposées car, étant traversées par un<br />
axe <strong>de</strong> communication important, elles présentent une <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> population supérieure à 200ha/km².<br />
Mais l’ensemble <strong>de</strong>s communes du département est concerné par le risque <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> matières<br />
dangereuses, ne serait ce que du fait <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité du réseau routier ou <strong>de</strong> la possibilité <strong>de</strong> propagation<br />
d’un nuage toxique.<br />
Deux sites particuliers sont notamment concernés par ce type <strong>de</strong> risque :<br />
• <strong>Le</strong> tunnel ferroviaire <strong>de</strong> la ligne <strong>Nantes</strong> – <strong>Le</strong> Croisic à <strong>Nantes</strong>, présente un risque particulier<br />
inhérent à ce type d’ouvrage où circule <strong>de</strong>s trains transportant <strong>de</strong>s matières dangereuses,<br />
inflammables ou explosives et <strong>de</strong>s trains <strong>de</strong> voyageurs ;<br />
• <strong>Le</strong> site <strong>de</strong> la Raffinerie <strong>de</strong> Donges à proximité immédiate duquel passe également la ligne SNCF<br />
<strong>Nantes</strong>- <strong>Le</strong> Croisic.<br />
Il est statistiquement établi en France que le transport <strong>de</strong> matières dangereuses par voie routière<br />
représente au moins 10% du trafic <strong>de</strong> poids lourds global. <strong>Le</strong> transit interdépartemental, interrégional et<br />
même international <strong>de</strong> matières dangereuses est une réalité qui concerne l’ensemble <strong>de</strong>s grands axes<br />
routiers.<br />
Toutefois il serait nécessaire <strong>de</strong> recenser plus précisément les trajets <strong>de</strong> ces transporteurs dans<br />
l’agglomération. Certains produits <strong>de</strong> matières inflammables ou explosives comme les carburants sont<br />
véhiculés au cœur même <strong>de</strong> la ville pour alimenter les stations services. 3 stations services sont<br />
im<strong>plan</strong>tées sur la commune <strong>de</strong> Couëron.<br />
<br />
<strong>Le</strong>s entreprises présentant un risque pour l’environnement<br />
A partir <strong>de</strong> 1995, la Cellule Opérationnelle <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques a pris l’initiative <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s<br />
cartes <strong>de</strong> <strong>local</strong>isation <strong>de</strong>s établissements dont l’im<strong>plan</strong>tation, l’importance ou les quantités et/ou la<br />
nature <strong>de</strong>s produits stockés, justifient à l’échelle <strong>de</strong> l’agglomération, une attention particulière. Ce<br />
recensement porte sur 99 établissements repartis suivant <strong>de</strong>ux niveaux <strong>de</strong> risques :<br />
- aucun « établissement à risques » pour l’environnement humain (dangers principaux) n’est<br />
répertorié par la COPR sur la commune <strong>de</strong> Couëron ;<br />
- <strong>Le</strong>s « Etablissements à risques secondaires » pour l’environnement naturel (danger secondaire).<br />
Soit 61 entreprises sur l’agglomération dont 2 pour la commune <strong>de</strong> Couëron ;<br />
o<br />
o<br />
ESSENCE AUX ARMEES (stockage et distribution <strong>de</strong> carburants),<br />
NGK BERYLCO (métallurgie).<br />
Toutefois cette cartographie est associée à une grille d’appréciation n’ayant aucun caractère<br />
réglementaire ou administratif, mais informatif en tant que recueil <strong>de</strong>s informations recensées lors <strong>de</strong> la<br />
visite <strong>de</strong>s établissements. Cette grille gradue le risque à partir <strong>de</strong> :<br />
- une échelle à 6 <strong>de</strong>grés (nuisances, dégradation écosystème, menace écosystème, effets<br />
sanitaires, blessures – intoxication – risque incendie, mort – risque explosion ;<br />
- Une capacité <strong>de</strong> stockage : 50 000 L ;<br />
- <strong>Le</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> diffusion : poussières, liqui<strong>de</strong>, gazeux ;<br />
- La proximité du vecteur <strong>de</strong> diffusion : confiné, eaux usées, eaux pluviales, étang, rivières ;<br />
- <strong>Le</strong> niveau <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong>s axes routier : <strong>local</strong>e, moyenne, très fréquentée ;<br />
146
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
- La proximité d’autres sites à risques : aucune, < 100m, mitoyenne ;<br />
- La <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> population : rase campagne, habitations diffuses, lotissements, immeubles ;<br />
- La qualité <strong>de</strong>s installations : stockage ordonné et rétentions étanches, rétentions insuffisantes,<br />
installations vétustes ;<br />
- <strong>Le</strong>s risques d’incendie : sans, pollution <strong>de</strong>s eaux d’extinction, dégagement dangereux ;<br />
Chacune <strong>de</strong>s rubriques étant affectée d’un coefficient.<br />
<strong>Le</strong>s installations classées soumises à autorisation font l’objet <strong>de</strong> conditions d’im<strong>plan</strong>tation (étu<strong>de</strong>s<br />
d’impact, <strong>de</strong> dangers, enquête publique, consultation <strong>de</strong>s services intéressés) <strong>de</strong> contrôles en<br />
exploitation (DRIRE, DSV, COPR). Ils s’agit généralement d’établissements industriels, mais également<br />
d’entreprises agricoles, et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> déchets.<br />
La DRIRE a i<strong>de</strong>ntifié 6 Installations classées soumises à autorisation à Couëron :<br />
o<br />
ARC EN CIEL (UIOM) (Elimination <strong>de</strong>s déchets industriels, Métaux et (stockage, activité<br />
<strong>de</strong> récupération), installation <strong>de</strong> combustion, ordures ménagères (stockage et<br />
traitement) ;<br />
o CLERAMBAULT P (Métaux, stockage, activité <strong>de</strong> récupération) ;<br />
o MANO (Métaux, stockage, activité <strong>de</strong> récupération) ;<br />
o MASUY (Elimination <strong>de</strong>s déchets industriels d’I.C.) ;<br />
o<br />
o<br />
NGK BERYLCO France (Travail mécanique <strong>de</strong>s métaux et alliages, traitement <strong>de</strong>s métaux<br />
et matières plastiques) ;<br />
SANI OUEST (Elimination <strong>de</strong>s déchets industriels., ordures ménagères, stockage et<br />
traitement).<br />
La COPR a i<strong>de</strong>ntifié 4 Installations classées soumises à déclaration à Couëron :<br />
<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
ARC EN CIEL (UIOM) (broyage, concassage, criblage… <strong>de</strong>s substances végétales, et<br />
broyages, concassage, criblage … <strong>de</strong> pierres et autres minéraux) ;<br />
MASUY (Liqui<strong>de</strong>s inflammables (remplissage ou distribution, Ateliers <strong>de</strong> réparation,<br />
entretien <strong>de</strong> véhicules à moteur, dont carrosserie et tôlerie) ;<br />
NGK BERYLCO France (Installations <strong>de</strong> refroidissement par dispersion d’eau dans un flux<br />
d’air) ;<br />
SANI OUEST (Liqui<strong>de</strong>s inflammables (remplissage et distribution).<br />
Sites et sols pollués<br />
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts <strong>de</strong> déchets, d’infiltration <strong>de</strong> substances polluantes,<br />
ou d’installations industrielles, présente une pollution susceptible <strong>de</strong> provoquer une nuisance ou un<br />
risque durable pour les personnes ou l’environnement.<br />
La pollution présente un caractère concentré, à savoir <strong>de</strong>s teneurs souvent élevées et sur une surface<br />
réduite (quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie <strong>de</strong>s pollutions diffuses, comme<br />
celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées <strong>de</strong> la pollution automobile près <strong>de</strong>s grands<br />
axes routiers.<br />
Il existe <strong>de</strong>ux bases <strong>de</strong> données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels :<br />
BASOL<br />
La base <strong>de</strong> données BASOL dresse l’inventaire <strong>de</strong>s sites pollués par les activités industrielles appelant une<br />
action <strong>de</strong>s pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL a été renouvelée durant l’année 2000 et<br />
recense plus <strong>de</strong> 3000 sites au niveau national. Un tel inventaire doit permettre d’appréhen<strong>de</strong>r les actions<br />
menées par l’administration et les responsables <strong>de</strong> ces sites pour prévenir les risques et les nuisances.<br />
147
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Il existe <strong>de</strong>ux sites inscrits dans la base BASOL sur la commune <strong>de</strong> Couëron.<br />
La ville au Chef<br />
Ce dépôt <strong>de</strong> déchets non autorisé à l'origine <strong>de</strong> la pollution était exploité par la ste Sanitra Fourrier<br />
jusqu'en 1995 sans que <strong>de</strong>s précautions pour éviter les risques d'écoulement acci<strong>de</strong>ntel n'aient été mises<br />
en oeuvre (absence <strong>de</strong> rétention associées aux stockages et aux postes <strong>de</strong> chargement: dépôt direct <strong>de</strong>s<br />
cuves sur le sol naturel).<br />
Au droit <strong>de</strong>s zones affectées aux cuves <strong>de</strong> stockage le sol naturel a été infiltré par endroit par <strong>de</strong>s déchets<br />
principalement <strong>de</strong>s mélanges eaux et hydrocarbures provenant <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> collecte et <strong>de</strong> transport<br />
<strong>de</strong>s déchets industriels et <strong>de</strong> l'assainissement urbain <strong>de</strong> la société Sanitra Fourrier (site <strong>de</strong> 1,5 ha au total).<br />
<strong>Le</strong>s installations (cuves, dépôts divers) ainsi que les terres polluées en surface ont été retirés du terrain<br />
(1996/1997) re<strong>de</strong>venu zone naturelle et propriété <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Couëron.<br />
Description qualitative à la date du 20/09/2005 :<br />
<strong>Le</strong>s <strong>rapport</strong>s <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> pollution réalisés en 1996 et 1997 par un cabinet spécialisé indiquent que le<br />
sol naturel a été pollué principalement par <strong>de</strong>s hydrocarbures (HCT) au droit <strong>de</strong>s stockages effectués sur<br />
le site. On y relève également <strong>de</strong>s traces <strong>de</strong> métaux, principalement Pb, Cd et Cr.<br />
<strong>Le</strong>s eaux <strong>de</strong> la nappe circulant dans le réseau <strong>de</strong> fracture du rocher à faible profon<strong>de</strong>ur ont été touchées<br />
par cette pollution.<br />
Après enlèvement <strong>de</strong> 50 tonnes <strong>de</strong> terres souillées en surface, un suivi <strong>de</strong> la nappe a été prescrit pour une<br />
périodicité d'au moins 5 ans au responsable <strong>de</strong> la pollution (jusqu'en 2002).<br />
<strong>Le</strong>s <strong>de</strong>rnières analyses <strong>de</strong>s eaux (février 2002) montrant l'absence <strong>de</strong> pollution résiduelle <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> la<br />
nappe sur le site, cette surveillance a donc été arrêtée.<br />
Il n'y a pas <strong>de</strong> captage d'eau souterraine sur le site à <strong>de</strong>s fins d'utilisation agricole, humaine ou animale.<br />
<strong>Le</strong>s terres polluées ayant été enlevées et l'absence <strong>de</strong> pollution résiduelle <strong>de</strong>s eaux souterraines étant<br />
vérifiée, ce site ne nécessite pas d'investigations complémentaires en particulier <strong>de</strong> poursuite du suivi <strong>de</strong>s<br />
eaux souterraines ni <strong>de</strong> mise en place <strong>de</strong> restriction d'usage.<br />
Tréfimétaux<br />
<strong>Le</strong> site a été le siège, <strong>de</strong> la fin du 19ème siècle jusqu'à la secon<strong>de</strong> guerre mondiale, d'activités liées à la<br />
métallurgie du plomb. Il est <strong>de</strong>venu par la suite un site spécialisé dans la métallurgie du cuivre et du zinc<br />
et a notamment été exploité en tant que tel par la société Tréfimétaux pendant la pério<strong>de</strong> allant <strong>de</strong> 1964<br />
à 1988.<br />
La société Tréfimétaux a déclaré la cessation <strong>de</strong> ses activités en 1995, la plupart <strong>de</strong>s bâtiments et<br />
parcelles qu'elle détenait ayant été cédés en 1988 à <strong>de</strong>s entreprises du travail <strong>de</strong>s métaux.<br />
Description qualitative à la date du 26/07/2005 :<br />
L’inspection <strong>de</strong>s installations classées a dès 1995 <strong>de</strong>mandé à Tréfimétaux <strong>de</strong> mettre en sécurité les<br />
terrains dont elle restait propriétaire, d’évaluer la qualité <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers, et <strong>de</strong> mettre en place<br />
une surveillance <strong>de</strong>s eaux souterraines du site.<br />
<strong>Le</strong>s données analytiques recueillies, tout en révélant la présence <strong>de</strong> taux élevés en certains métaux<br />
(plomb, arsenic,…) dans les sols, n’ont pas mis en évi<strong>de</strong>nce l’induction <strong>de</strong> risques significatifs, dans le<br />
contexte existant <strong>de</strong> non réutilisation <strong>de</strong>s terrains concernés et compte tenu <strong>de</strong> la vocation industrielle<br />
générale <strong>de</strong> la zone.<br />
148
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> projet, en 2003, d’une opération immobilière par la ville <strong>de</strong> Couëron incluant notamment la friche<br />
Tréfimétaux a conduit l’inspection <strong>de</strong>s installations classées à proposer au préfet <strong>de</strong> prescrire à<br />
l’industriel :<br />
- une caractérisation analytique <strong>de</strong>s terrains propriété actuelle ou ancienne <strong>de</strong> la société ;<br />
- une évaluation <strong>de</strong>s zones extérieures au site industriel susceptibles d’avoir été affectées par les<br />
activités.<br />
L’arrêté correspondant a été signé le 6 octobre 2003. <strong>Le</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>mandées, transmises par Tréfimétaux<br />
au préfet le 5 juillet 2004, montrent que :<br />
- dans l’emprise <strong>de</strong> l’ancien site, la zone fortement polluée s’étend, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la parcelle propriété<br />
<strong>de</strong> l’industriel, sur <strong>de</strong>ux parcelles adjacentes habitées par <strong>de</strong>s tiers ;<br />
- la zone périphérique extérieure, occupée par un habitat pavillonnaire, présente <strong>de</strong>s teneurs en<br />
plomb et en arsenic susceptibles <strong>de</strong> se révéler non compatibles avec l’usage actuel <strong>de</strong>s lieux<br />
(présence <strong>de</strong> jardins potagers).<br />
L’examen <strong>de</strong> ces éléments a conduit l’inspection <strong>de</strong>s installations classées à proposer dès le 8 juillet 2004<br />
au préfet la mise en œuvre d’un <strong>plan</strong> d’actions comportant :<br />
la prescription à Tréfimétaux <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> :<br />
- réaliser une évaluation détaillée <strong>de</strong>s risques (EDR) sur l’ensemble <strong>de</strong>s secteurs concernés<br />
(site proprement dit et zone périphérique) ;<br />
- proposer les actions structurantes visant à prévenir <strong>de</strong> manière pérenne l’exposition aux<br />
polluants présents <strong>de</strong>s personnes résidant sur l’ancien site industriel (dépollution <strong>de</strong>s<br />
terrains, confinement <strong>de</strong>s emplacements pollués ou acquisition <strong>de</strong>s parcelles concernées).<br />
Ces dispositions ont été fixées par arrêté préfectoral du 16 juillet 2004. Cet arrêté prescrit également<br />
l’institution <strong>de</strong> servitu<strong>de</strong>s d’utilité publique visant à garantir la pérennité <strong>de</strong>s restrictions d’usage<br />
nécessaires au maintien <strong>de</strong> la sécurité du site, au regard <strong>de</strong>s types d’utilisation <strong>de</strong>s sols qui auront été<br />
jugés acceptables.<br />
<strong>Le</strong>s actions structurantes <strong>de</strong> mise en sécurité du site qui doivent être proposées par Tréfimétaux seront<br />
explicitées et rendues exécutoires par la voie d’un nouvel arrêté.<br />
la prise <strong>de</strong> mesures d’application immédiate visant, dans l’attente <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s actions<br />
précé<strong>de</strong>ntes, à prévenir les éventuels désordres sanitaires dont pourraient être l’objet les<br />
personnes exposées en l’absence <strong>de</strong> précautions (émission <strong>de</strong> consignes concernant la culture <strong>de</strong><br />
végétaux pour la consommation, prévention <strong>de</strong> l’accès <strong>de</strong>s jeunes enfants aux zones non<br />
protégées …).<br />
Plusieurs campagnes <strong>de</strong> prélèvements et d'analyses <strong>de</strong> sols, <strong>de</strong> végétaux et d'eau <strong>de</strong> puits ont été<br />
réalisées en 2004 et 2005. <strong>Le</strong>s résultats ont conduit à mettre en évi<strong>de</strong>nce l'impact marqué <strong>de</strong>s anciennes<br />
activités "plomb" sur l'environnement. Après examen du dossier par l'inspection <strong>de</strong>s installations<br />
classées, le préfet a prescrit, par arrêté préfectoral du 23 juin 2005, la mise en oeuvre <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong><br />
protection nécessaires avant le 31 octobre 2005.<br />
BASIAS<br />
La base <strong>de</strong> données BASIAS (basias.brgm.fr) recense les sites industriels et <strong>de</strong> service en activité ou non,<br />
susceptibles d’être affectés par une pollution <strong>de</strong>s sols. La finalité est <strong>de</strong> conserver la mémoire <strong>de</strong> ces sites<br />
pour fournir <strong>de</strong>s informations utiles à la <strong>plan</strong>ification urbaine et à la protection <strong>de</strong> l'environnement.<br />
Cette base <strong>de</strong> données a aussi pour objectif d'ai<strong>de</strong>r, dans les limites <strong>de</strong>s informations récoltées forcément<br />
non exhaustives, les notaires et les détenteurs <strong>de</strong>s sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions<br />
foncières.<br />
Il existe 36 sites inscrits dans la base BASIAS sur la commune <strong>de</strong> Couëron.<br />
Ils concernent essentiellement les zones industrielles et urbaines à l’Est <strong>de</strong> la commune.<br />
149
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Localisation <strong>de</strong>s sites BASIAS et BASOL sur la commune <strong>de</strong> Couëron<br />
150
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Liste <strong>de</strong>s sites BASIAS sur la commune <strong>de</strong> Couëron<br />
I<strong>de</strong>ntifiant Adresse (ancien format) Raison sociale <strong>de</strong> l'entreprise connue<br />
Etat<br />
d'occupation<br />
du site<br />
Activité(s)<br />
PAL4403613<br />
la jaunaie route <strong>de</strong> St Etienne<br />
LEBLANC Pierre,Dépôt chiffons, papiers,<br />
peaux, ferrailles, plumes<br />
Activité<br />
terminée<br />
Récupération <strong>de</strong> matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... ),<br />
PAL4403617<br />
Quai Emile Paraf - 44220<br />
Couëron<br />
SAMENA,Traitement, revêtement <strong>de</strong>s<br />
métaux<br />
En activité<br />
Traitement et revêtement <strong>de</strong>s métaux (traitement <strong>de</strong> surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,<br />
application <strong>de</strong> vernis et peintures),<br />
PAL4403618 <strong>Le</strong>s Ardillets NIEDBALEC Pierre,station service<br />
PAL4403619 Chef <strong>de</strong> l'eau COMMUNE DE COUERON, Dépôt d'OM<br />
Activité<br />
terminée<br />
Activité<br />
terminée<br />
Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),<br />
Enlèvement et traitement <strong>de</strong>s ordures ménagères (décharge d'O.M.<br />
PAL4403609<br />
4, rue <strong>de</strong>s Ardillets<br />
MAHIEU Jean-Marie,Distribution<br />
d'essence<br />
En activité<br />
Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),<br />
PAL4403604<br />
Quai Emile Paraf<br />
METAYER-NOEL Ste, Travaux et<br />
traitement <strong>de</strong>s métaux / avant<br />
TREFIMETAUX Ste<br />
Activité<br />
terminée<br />
Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales,Raffinage, distillation et rectification<br />
du pétrole et/ou stockage d'huile minérales,Bijouterie et monnaies métalliques,Traitement et revêtement <strong>de</strong>s<br />
métaux (traitement <strong>de</strong> surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application <strong>de</strong> vernis et<br />
peintures),Traitement et revêtement <strong>de</strong>s métaux (traitement <strong>de</strong> surface, sablage et métallisation, traitement<br />
électrolytique, application <strong>de</strong> vernis et peintures),Traitement et revêtement <strong>de</strong>s métaux (traitement <strong>de</strong> surface,<br />
sablage et métallisation, traitement électrolytique, application <strong>de</strong> vernis et peintures),<br />
PAL4403611<br />
<strong>Le</strong> port Launay<br />
BREHERET ATELIERS ET<br />
CHANTIERS,Constructions navales<br />
En activité<br />
Construction navale,<br />
PAL4403608<br />
ZI<br />
CIE FRANCAISE D'ENTREPRISES<br />
METALLIQUES,Serrurerie, charpente,<br />
peinture<br />
En activité<br />
Travaux <strong>de</strong> finition (plâtrier<br />
PAL4403635<br />
rte <strong>de</strong> sautron<br />
APPLICATION <strong>de</strong>s GAZ,Dépôt<br />
Hydrocarbures<br />
Activité<br />
terminée<br />
Dépôt <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>s inflammables (D.L.I.),<br />
PAL4403670<br />
Usine <strong>de</strong> Basse Indre<br />
CARNAUD JJ ET FORGES Sté,Dépôt<br />
d'aci<strong>de</strong> sulfurique concentré<br />
En activité Stockage <strong>de</strong> produits chimiques (minéraux, organiques, ...),<br />
151
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
PAL4403650<br />
la potence<br />
TRANSPORTS CLEMENT & FILS,Dépôt<br />
<strong>de</strong> carburants, garage<br />
En activité<br />
Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),<br />
PAL4403720<br />
Cité Navale 44220 COUERON<br />
ARC-EN-CIEL Ste,stat transit Broyage<br />
OM, Stock et récup déchet Incinération<br />
OM install combust, dépôt d'ordures<br />
ménagères<br />
En activité<br />
Enlèvement et traitement <strong>de</strong>s ordures ménagères (décharge d'O.M.<br />
PAL4403735 48 Bd <strong>de</strong> la Libération SANZ et Fils Ets,Station service En activité Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),<br />
PAL4403601 rue Henri Gautier JAGUET Yvon,Garage, station essence En activité<br />
Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),Dépôt <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>s inflammables<br />
(D.L.I.),Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),<br />
PAL4403664 La Barrière Noire SEMEN Ste,Garage En activité Entretien et réparation <strong>de</strong> véhicules automobiles (ou autres),<br />
PAL4403624<br />
L'arche <strong>de</strong> Beaulieu<br />
ROCHE Georges,Carosserie, tôlerie,<br />
peinture<br />
En activité<br />
Carrosserie, peinture,Carrosserie, peinture,<br />
PAL4403681<br />
la chabossiere rue du<br />
Sta<strong>de</strong>/bd <strong>de</strong> la Libération<br />
SOURON J/L,Distribution <strong>de</strong> carburants<br />
Activité<br />
terminée<br />
Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),<br />
PAL4403694<br />
Usine <strong>de</strong> Basse Indre<br />
SOLLAC BASSE INDRE SA,Dépôt<br />
d'hydrocarbures<br />
En activité Dépôt <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>s inflammables (D.L.I.),Stockage <strong>de</strong> produits chimiques (minéraux, organiques, ...),<br />
PAL4403745<br />
<strong>Le</strong> Fonteny<br />
MASUY, Station <strong>de</strong> transit<br />
(récupérateur d'huiles usagées et<br />
graisses industrielles)<br />
En activité<br />
Régénération et/ou stockage d'huiles usagées,<br />
PAL4403605 Bd Paul Langevin CONSOEUR MARTIN,Station service En activité<br />
Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),Commerce <strong>de</strong> gros, détail,<br />
<strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),<br />
PAL4403626<br />
Usine <strong>de</strong> Basse Indre<br />
CARNAUD JJ ET FORGES Sté,Dépôt<br />
d'ammoniaque liqui<strong>de</strong><br />
En activité<br />
Production et distribution <strong>de</strong> combustibles gazeux, pour autres gaz industriels cf. DG24.1a,<br />
PAL4403740<br />
La Chabossière<br />
ESSENCE AUX ARMEES,Dépôt<br />
d'hydrocarbures<br />
En activité<br />
Dépôt <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>s inflammables (D.L.I.),<br />
PAL4403663<br />
Quai Emile Paraf - 44220<br />
Couëron<br />
BERYLCO FRANCE NGK Ste,Traitement<br />
et travail <strong>de</strong>s métaux<br />
En activité<br />
Traitement et revêtement <strong>de</strong>s métaux (traitement <strong>de</strong> surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,<br />
application <strong>de</strong> vernis et peintures),Traitement et revêtement <strong>de</strong>s métaux (traitement <strong>de</strong> surface, sablage et<br />
métallisation, traitement électrolytique, application <strong>de</strong> vernis et peintures),<br />
PAL4403686 Usine <strong>de</strong> Basse Indre CARNAUD JJ ET FORGES<br />
Sté,Traitements thermiques par <strong>de</strong>s<br />
En activité<br />
Traitement et revêtement <strong>de</strong>s métaux (traitement <strong>de</strong> surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,<br />
152
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
bains <strong>de</strong> sels fondus<br />
application <strong>de</strong> vernis et peintures),<br />
PAL4403746<br />
<strong>Le</strong> Panloup - 44220 Couëron<br />
S.A.I.P. Ste,Traitement, revêtement <strong>de</strong>s<br />
métaux<br />
En activité<br />
Traitement et revêtement <strong>de</strong>s métaux (traitement <strong>de</strong> surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,<br />
application <strong>de</strong> vernis et peintures),<br />
PAL4403612<br />
les dosdieres<br />
CARRIERES CHASSE -MORLAIX<br />
SA,Install. broyage<br />
Activité<br />
terminée<br />
Extraction <strong>de</strong> pierres (voir aussi DI26.7),<br />
PAL4403710<br />
<strong>Le</strong> Fonteny<br />
BOSCHER-GRAVURE Sté,Atelier <strong>de</strong><br />
sérigraphie<br />
En activité<br />
Imprimerie (y compris reliure, photogravure,...),<br />
PAL4403747<br />
Rue <strong>de</strong>s Vignerons- 44220<br />
Couëron<br />
SERMCI Ste,Fab. Constructions<br />
Métalliques<br />
En activité<br />
Fabrication d'élements en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, treillage...),<br />
PAL4403737<br />
Quai Langlois - 44610 Indre<br />
NORD CHROME Sté,Traitement<br />
revêtement mtx (unité <strong>de</strong> chromage)<br />
En activité<br />
Traitement et revêtement <strong>de</strong>s métaux (traitement <strong>de</strong> surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,<br />
application <strong>de</strong> vernis et peintures),<br />
PAL4403603<br />
38 bd <strong>de</strong>s martyrs <strong>de</strong> la<br />
résistance<br />
GARCIA,Station service<br />
En activité<br />
Commerce <strong>de</strong> gros, détail, <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),Commerce <strong>de</strong> gros, détail,<br />
<strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> carburants, (station service <strong>de</strong> toute capacité),<br />
PAL4403723<br />
La Potence, rte <strong>de</strong> St Etienne<br />
Montluc<br />
MANO,Récup/ carcasses auto En activité Récupération <strong>de</strong> matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... ),<br />
PAL4403738 La Moye CLERAMBAULT M.P.,Démolition auto<br />
Activité<br />
terminée<br />
Récupération <strong>de</strong> matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... ),<br />
PAL4403748<br />
lan<strong>de</strong> bourne<br />
TRANSPORTS RAPIDES<br />
"JOYAU",Stockage marchandises, dépôt<br />
<strong>de</strong> carburants et gaz combustible<br />
En activité<br />
Dépôt <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>s inflammables (D.L.I.),<br />
PAL4403606<br />
ds enceinte <strong>de</strong> la Ste<br />
Tréfimetaux<br />
HARDY,Travaux <strong>de</strong> concassage<br />
Activité<br />
terminée<br />
Travail <strong>de</strong> la pierre (taille, concassage, criblage, polissage),Travail <strong>de</strong> la pierre (taille, concassage, criblage, polissage),<br />
153
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
154
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
VIIII – SYNTHESE DES ENJEUX ENVIIRONNEMENTAUX<br />
A l’échelle <strong>de</strong> Couëron, les principaux enjeux en matière d’environnement sont résumés et déclinés ciaprès<br />
à partir <strong>de</strong>s thèmes suivants :<br />
1. La protection et la valorisation <strong>de</strong>s milieux naturels<br />
- Maintenir une activité agricole gestionnaire <strong>de</strong>s différents milieux : dans les marais (importance<br />
<strong>de</strong> faire perdurer les activités <strong>de</strong> fauche et <strong>de</strong> pâturage) ainsi que dans les espaces bocagers du<br />
plateau, en définissant <strong>de</strong>s zones agricoles durables permettant aux exploitants un<br />
investissement pérenne ;<br />
- Remettre en valeur les secteurs en friche en leur donnant un nouvel usage : agricole en<br />
s’appuyant sur l’aménagement foncier qui s’engagera dans les zones agricoles durables, et<br />
forestier dans le cadre <strong>de</strong> la forêt urbaine ;<br />
- Protéger les zones d’intérêt écologique et les prairies humi<strong>de</strong>s formant notamment le réseau<br />
Natura 2000 ;<br />
- Développer <strong>de</strong>s corridors écologiques nord-sud en s’appuyant sur les vallons affluents <strong>de</strong> la Loire<br />
et sur le projet <strong>de</strong> Forêt urbaine ;<br />
- Développer les continuités piétonnes malgré les coupures <strong>de</strong>s infrastructures ;<br />
- Maîtriser l’extension <strong>de</strong>s hameaux.<br />
<br />
La protection du patrimoine bâti<br />
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable, le patrimoine industriel et<br />
portuaire et le petit patrimoine ;<br />
- Qualifier les entrées <strong>de</strong> ville en veillant à leur intégration paysagère pour préserver l’i<strong>de</strong>ntité<br />
rurale <strong>de</strong> la commune.<br />
<br />
La lutte contre les nuisances, l’amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux<br />
- Adapter les capacités d’assainissement aux projets en cours : amélioration et extension du<br />
réseau d’assainissement, lutte contre les déversements directs, contrôle <strong>de</strong>s installations<br />
d’assainissement autonome via le SPANC ;<br />
- Gérer les eaux <strong>de</strong> ruissellement à la source : solutions d’aménagement spécifiques pour chaque<br />
projet d’urbanisation ;<br />
- Lutter contre les pollutions diffuses et les incivilités (contrôle et mise à niveau <strong>de</strong>s installations<br />
d’assainissement autonome, lutte contre les dépôts sauvages <strong>de</strong> déchets et les remblaiements) ;<br />
- Limiter les surfaces imperméables dans les futures opérations <strong>de</strong> construction ;<br />
- Prendre en compte les contraintes acoustiques le long <strong>de</strong>s voies bruyantes en imposant <strong>de</strong>s<br />
reculs pour les constructions à usage d’habitation notamment.<br />
155
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
156
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Chapitre III<br />
L’explication <strong>de</strong>s choix retenus pour établir<br />
le projet d’aménagement<br />
et <strong>de</strong> développement durable<br />
157
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
158
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
II - LE PADD,, ELEMENT FONDATEUR DU PLU DE<br />
COUËRON<br />
1. Une approche nouvelle du document d’urbanisme<br />
La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, souvent appelée « loi<br />
SRU » a profondément renouvelé l’approche <strong>de</strong>s documents d’urbanisme. En remplaçant l’ancien Plan<br />
d’Occupation <strong>de</strong>s Sols (POS) par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), elle introduit <strong>de</strong>ux innovations<br />
fondamentales :<br />
- le document d’urbanisme n’est plus seulement constitué par un ensemble <strong>de</strong> zonages et <strong>de</strong><br />
règles définissant l’affectation <strong>de</strong>s sols et les contraintes <strong>de</strong> constructibilité, il repose aussi<br />
sur l’énoncé d’objectifs <strong>de</strong> développement, que les dispositions doivent mettre en œuvre ;<br />
- ces objectifs doivent correspondre aux ambitions du développement durable : l’urbanisme<br />
doit tenir compte <strong>de</strong> préoccupations économiques, sociales et environnementales, et les<br />
rendre complémentaires les unes <strong>de</strong>s autres.<br />
En effet, le PLU doit « [déterminer] les conditions permettant d’assurer (Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme, article<br />
L 121-1) :<br />
1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement <strong>de</strong><br />
l’espace rural, d’une part, et la préservation <strong>de</strong>s espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la<br />
protection <strong>de</strong>s espaces naturels et <strong>de</strong>s paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du<br />
développement durable ;<br />
2° La diversité <strong>de</strong>s fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en<br />
prévoyant <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans<br />
discrimination, <strong>de</strong>s besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment<br />
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en<br />
tenant compte en particulier <strong>de</strong> l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> transport et<br />
<strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s eaux ;<br />
3° Une utilisation économe et équilibrée <strong>de</strong>s espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise<br />
<strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> déplacement et <strong>de</strong> la circulation automobile, la préservation <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’air, <strong>de</strong> l’eau,<br />
du sol et du sous-sol, <strong>de</strong>s écosystèmes, <strong>de</strong>s espaces verts, <strong>de</strong>s milieux, sites et paysages naturels ou<br />
urbains, la réduction <strong>de</strong>s nuisances sonores, la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ensembles urbains remarquables et du<br />
patrimoine bâti, la prévention <strong>de</strong>s risques naturels prévisibles, <strong>de</strong>s risques technologiques, <strong>de</strong>s pollutions<br />
et <strong>de</strong>s nuisances <strong>de</strong> toute nature. »<br />
Ces innovations majeures sont traduites grâce à l’élaboration d’un document qui n’existait pas dans les<br />
P.O.S. : le Projet d’Aménagement et <strong>de</strong> Développement Durable ou PADD.<br />
Véritable « cœur » du PLU, si l’on suit l’esprit <strong>de</strong> la loi SRU, le PADD s’appuie sur les enjeux qui résultent<br />
du diagnostic et définit les orientations <strong>de</strong> développement que le PLU met en œuvre pour les dix<br />
prochaines années environ.<br />
<strong>Le</strong> Projet d’Aménagement et <strong>de</strong> Développement Durable « définit les orientations générales<br />
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble <strong>de</strong> la commune ». Il peut s’accompagner<br />
d’ »orientations d’aménagement relatives à <strong>de</strong>s quartiers ou à <strong>de</strong>s secteurs à mettre en valeur,<br />
réhabiliter, restructurer ou aménager ». (Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme, article L 123-1).<br />
<strong>Le</strong> règlement et les pièces graphiques du PLU doivent être définis « en cohérence avec le projet<br />
d’aménagement et <strong>de</strong> développement durable » (Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme, article L 123-1).<br />
159
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Ce chapitre contient les justifications du PADD au regard <strong>de</strong>s textes en vigueur (Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme,<br />
parties législatives et règlementaires) et précise la compatibilité entre le PADD <strong>de</strong> La Chapelle-sur-Erdre<br />
et les documents supra-communaux. Il précise en outre en quoi le PADD répond aux enjeux qui ont été<br />
i<strong>de</strong>ntifiés à l’issue du diagnostic.<br />
Pour plus <strong>de</strong> clarté <strong>de</strong> l’ensemble, le contenu du PADD dans ses axes fédérateurs et ses objectifs<br />
thématiques est repris dans ce <strong>rapport</strong>, afin que le lecteur puisse comprendre la justification et la<br />
compatibilité <strong>de</strong> celui-ci directement.<br />
2. <strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> Couëron pour les 10 prochaines années<br />
<strong>Le</strong> PADD permet <strong>de</strong> fixer <strong>de</strong>s objectifs et <strong>de</strong>s cadres à l’évolution urbaine, à l’échelle <strong>de</strong> la commune<br />
comme à celle <strong>de</strong> secteurs ou <strong>de</strong> quartiers, dans tous les domaines aujourd’hui sensibles <strong>de</strong><br />
l’urbanisation nouvelle et du renouvellement urbain : assurer une répartition équilibrée <strong>de</strong> l’habitat et<br />
<strong>de</strong>s activités économiques, répondre aux besoins <strong>de</strong> logement en assurant la diversité sociale <strong>de</strong> la ville<br />
et <strong>de</strong> ses quartiers, apporter une meilleure organisation <strong>de</strong>s déplacements, protéger et mettre en valeur<br />
les ressources naturelles et environnementales et le patrimoine, etc.<br />
<strong>Le</strong> PADD <strong>de</strong>vient ainsi l’expression du projet politique <strong>de</strong> la collectivité <strong>local</strong>e. <strong>Le</strong>s principes d’un<br />
développement durable sont affirmés et développés dans le Projet d’Aménagement et <strong>de</strong><br />
Développement Durable du PLU.<br />
<strong>Le</strong> PADD <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Couëron contribue également au respect et à la mise en œuvre <strong>de</strong>s<br />
orientations d’aménagement et <strong>de</strong> développement durable dont se dote la communauté urbaine. Parmi<br />
elles figure la volonté <strong>de</strong> lutter contre « l’étalement urbain » pour favoriser le développement d’une<br />
agglomération plus équilibrée et plus économe <strong>de</strong>s ressources environnementales. Pour Couëron, cela<br />
veut dire que ses fonctions <strong>de</strong> centralité doivent être renforcées (équipements, commerces…) ainsi que sa<br />
capacité d’accueil <strong>de</strong>s habitants et <strong>de</strong>s activités économiques. En même temps, les déplacements les plus<br />
flui<strong>de</strong>s et les moins polluants doivent être encouragés (transports collectifs, circulations douces…), et les<br />
qualités du patrimoine et <strong>de</strong>s paysages couëronnais mises en valeur, <strong>de</strong> manière à ce que la commune et<br />
son agglomération conservent et développent plus encore la qualité <strong>de</strong> vie qui fon<strong>de</strong> leur attractivité.<br />
<strong>Le</strong>s enjeux du PLU sont importants pour Couëron. Elle doit en effet répondre à <strong>de</strong> nouveaux besoins <strong>de</strong><br />
développement et d’accueil <strong>de</strong> population. Positionnée en interface <strong>de</strong> plusieurs entités que sont la ville<br />
agglomérée, la Loire et ses zones humi<strong>de</strong>s, Couëron jouit d’une position stratégique. Avec la proximité <strong>de</strong><br />
<strong>Nantes</strong>, Couëron souhaite renforcer ses liens avec la ville-centre tout en confortant ses spécificités qui<br />
font son i<strong>de</strong>ntité.<br />
Couëron entend participer pleinement au <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> l’agglomération et s’affirmer en tant que polarité<br />
dynamique, en accueillant <strong>de</strong> nouveaux habitants et <strong>de</strong> nouvelles activités, tout en conservant son<br />
i<strong>de</strong>ntité.<br />
160
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La Communauté Urbaine a prescrit la révision <strong>de</strong>s 24 PLU communaux. Pour ce faire, le territoire<br />
communautaire a été découpé en 5 secteurs : <strong>Nantes</strong>, les secteurs Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est, et<br />
enfin le secteur Nord-Ouest auquel appartient Couëron en compagnie d’Indre, <strong>de</strong> Saint-Herblain (pôle<br />
Loire-Chézine), et <strong>de</strong> Sautron, d’Orvault et <strong>de</strong> La Chapelle-sur-Erdre (pôle Erdre et Cens).<br />
La commune a donc été étudiée également à l’échelle <strong>de</strong> ce secteur. <strong>Le</strong> PADD <strong>de</strong> Couëron se réinscrit<br />
donc, d’une part dans les objectifs communautaires <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole à 10 ans, définis sans son<br />
projet <strong>de</strong> territoire, et d’autre part se décline au sein <strong>de</strong>s enjeux reconnus à l’échelle du secteur Nord-<br />
Ouest.<br />
161
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
162
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIII- LE PADD :: UN PROJET COMMUNAL ARTIICULE A<br />
UNE AMBIITIION COMMUNAUTAIIRE<br />
<strong>Le</strong> PADD <strong>de</strong> Couëron s’organise autour <strong>de</strong> 3 axes fédérateurs :<br />
<br />
Promouvoir une urbanisation diversifiée pour favoriser le développement durable du territoire<br />
couëronnais ;<br />
Ouvrir la ville sur l’agglomération ;<br />
<br />
Valoriser le patrimoine naturel pour conforter la qualité <strong>de</strong> vie.<br />
Ces trois axes intègrent les points essentiels du projet <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole, eux-mêmes structurés<br />
autour <strong>de</strong> quatre thèmes.<br />
1. L’accueil <strong>de</strong>s populations et l’équilibre social <strong>de</strong> l'habitat<br />
La Communauté Urbaine <strong>Nantes</strong> Métropole a adopté un Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat en 2005. Celui-ci<br />
prévoit la construction annuelle <strong>de</strong> 3 900 logements neufs dont 900 locatifs sociaux.<br />
Ses orientations stratégiques retenues abor<strong>de</strong>nt trois aspects essentiels :<br />
- L’accompagnement du développement <strong>de</strong> l’agglomération à l’horizon 2010. <strong>Le</strong>s objectifs <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong> logement définis par secteur géographique se traduisent ensuite par commune ;<br />
- <strong>Le</strong> traitement <strong>de</strong>s besoins en logements prioritaires. <strong>Le</strong> PLH a défini <strong>de</strong>s objectifs qualitatifs dans<br />
la production <strong>de</strong> logements <strong>de</strong> manière à répondre aux besoins insatisfaits notamment<br />
l’accession <strong>de</strong>s ménages jeunes, celle <strong>de</strong>s familles à revenus intermédiaires et les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
locatifs publics ou privés ;<br />
- <strong>Le</strong> traitement <strong>de</strong>s besoins spécifiques en logement afin <strong>de</strong> répondre aux besoins <strong>de</strong>s jeunes en<br />
insertion professionnelle et <strong>de</strong>s étudiants ainsi que ceux <strong>de</strong>s ménages les plus démunis.<br />
A l’échelle du secteur Nord-Ouest, les objectifs du PLH se déclinent comme suit :<br />
<br />
Accueillir <strong>de</strong> nouveaux habitants avec une production moyenne <strong>de</strong> 740 logements neufs par an<br />
dont au moins 20 % <strong>de</strong> logements locatifs sociaux (exclusivement PLUS et PLA I) ;<br />
Poursuivre <strong>de</strong> la diversification du parc <strong>de</strong> logements ;<br />
Favoriser le renouvellement urbain et la <strong>de</strong>nsification <strong>de</strong> proximité <strong>de</strong>s pôles <strong>de</strong> services ;<br />
<br />
Maîtriser les extensions urbaines pour une offre d’habitat <strong>de</strong> qualité et accessible au plus grand<br />
nombre ;<br />
Maintenir la forme et le caractère actuel <strong>de</strong>s villages ;<br />
<br />
Equilibrer le développement urbain avec la préservation <strong>de</strong>s espaces naturels.<br />
La commune doit répondre au triple objectif du programme Local <strong>de</strong> l’Habitat (proposer à tous <strong>de</strong>s<br />
logements plus nombreux, plus variés et plus accessibles). Au travers <strong>de</strong> l'axe fédérateur « Promouvoir<br />
une urbanisation diversifiée pour favoriser le développement durable du territoire couëronnais », la<br />
commune prend à son compte les données essentielles pour le développement équilibré <strong>de</strong> l'habitat.<br />
La mise en oeuvre <strong>de</strong>s trois ZAC d’habitat (Ouest centre-ville, Métairie et Rives <strong>de</strong> Loire) programmées<br />
pour 1700 logements s’inscrit dans le PLH métropolitain en prenant en considération la diversification<br />
<strong>de</strong>mandée <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> logements. La commune appuie son projet communal en inscrivant pour objectif<br />
la réalisation <strong>de</strong> 170 à 180 logements neufs par an dont 20 % <strong>de</strong> locatifs sociaux et une diversité <strong>de</strong><br />
logements pour les jeunes ménages. Elle souhaite respecter la notion <strong>de</strong> parcours rési<strong>de</strong>ntiel en offrant<br />
<strong>de</strong>s logements pour tout âge et pour <strong>de</strong>s revenus mo<strong>de</strong>stes en favorisant la diversité <strong>de</strong>s formes<br />
d’habitat produites, en permettant l’accueil <strong>de</strong> jeunes ménages (locatif dont social, primo accession), et<br />
enfin en proposant une offre adaptée aux personnes âgées en recherchant la mixité<br />
intergénérationnelle.<br />
163
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
L’offre communale se traduira donc <strong>de</strong> la façon suivante :<br />
Collectif ➜ 26%<br />
Individuel groupé ➜ 20%<br />
Individuel diffus ➜ 54%<br />
La production <strong>de</strong> logement social <strong>de</strong>vrait atteindre une proportion <strong>de</strong> 20 % du total quelle que soit sa<br />
forme bâtie afin d’améliorer la mixité sociale et urbaine <strong>de</strong> la commune. 400 logements sociaux sont<br />
ainsi projetés dans les trois ZAC.<br />
Par ailleurs, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s trois ZAC d’habitat, dont la durée prévue oscille entre 10 et 15 années, Couëron a<br />
i<strong>de</strong>ntifié les futures zones d’urbanisations dans le projet <strong>de</strong> PLU qui permettront <strong>de</strong> diversifier l’offre tout<br />
en préservant la campagne d’un développement <strong>de</strong>s constructions individuelles.<br />
<strong>Le</strong> PADD <strong>de</strong> Couëron s’inscrit donc dans les grands objectifs communautaires.<br />
2. L’offre d’équipements et <strong>de</strong> services, y compris en matière <strong>de</strong><br />
déplacements<br />
A l’échelle du secteur Nord-Ouest <strong>de</strong> l’agglomération, ces objectifs communautaires se déclinent <strong>de</strong><br />
façon ciblée :<br />
<br />
Favoriser la diversité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssertes en transports collectifs (trams, bus, TER, tram-train, navettes<br />
fluviales) entre communes périphériques <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> ;<br />
Améliorer le réseau <strong>de</strong>s voies communales ;<br />
Maîtriser et adapter l’offre <strong>de</strong> stationnement pour une utilisation réduite <strong>de</strong> la voiture ;<br />
<br />
Développer le réseau <strong>de</strong>s pistes cyclables et <strong>de</strong>s liaisons piétonnières entre les quartiers et les<br />
centres.<br />
Par ailleurs, la métropole souhaite favoriser une ville solidaire et diversifiée (rejoignant ainsi les objectifs<br />
du PLH), avec le souci <strong>de</strong> l’équilibre entre les espaces urbains, ruraux et naturels et une bonne<br />
accessibilité <strong>de</strong>s équipements et <strong>de</strong>s transports.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs communaux inscrits dans le PADD s’inscrivent dans le programme <strong>de</strong> la métropole. Ils<br />
prennent en compte divers aspects qui favorisent les usages alternatifs à la voiture. Ce sont par<br />
exemple :<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> création d’une aire <strong>de</strong> stationnement relais en lien avec le projet culturel <strong>de</strong> la<br />
Gerbetière <strong>de</strong> manière à favoriser les liaisons douces vers le marais Audubon ;<br />
<strong>Le</strong> développement d’un réseau <strong>de</strong> liaisons douces entre les quartiers, les équipements, le centreville<br />
et les rives <strong>de</strong> Loire et d’un réseau <strong>de</strong> pistes cyclables entre les quartiers est et le centre-ville ;<br />
<strong>Le</strong>s projets pour favoriser l’usage du train en améliorant la <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> la gare <strong>de</strong> manière à<br />
renforcer les déplacements domicile-travail utilisant ce mo<strong>de</strong> ; Sur ce point particulier, Couëron<br />
située en fin <strong>de</strong> ligne <strong>de</strong> bus espère une augmentation <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong>s transports collectifs<br />
et la création d’un arrêt ferroviaire à La Chabossière ;<br />
<strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> navette fluviale vers <strong>Nantes</strong>.<br />
Ces options et attentes se réinscrivent aussi dans l’axe « Ouvrir la ville sur l’agglomération » et<br />
l’orientation thématique « Favoriser les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> déplacements alternatifs à la voiture », retenus par la<br />
collectivité.<br />
164
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
3. Conforter l’attractivité économique métropolitaine et jouer le rôle <strong>de</strong><br />
locomotive du Grand-Ouest<br />
En appui sur un vivier d’activités et <strong>de</strong> compétences, doté <strong>de</strong> 275 000 emplois, cet objectif<br />
communautaire se propose <strong>de</strong> :<br />
<br />
Conforter une économie innovante, diversifiée et solidaire, avec la création <strong>de</strong> nouveaux parcs<br />
tertiaires, l’extension <strong>de</strong> sites industriels et la requalification <strong>de</strong> sites anciens ;<br />
Développer <strong>de</strong>s projets performants en tertiaire, technologiques, culture et loisirs ;<br />
<br />
<br />
Rééquilibrer l’offre commerciale au bénéfice du centre-ville <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> et <strong>de</strong>s centres-bourgs,<br />
ainsi que du commerce <strong>de</strong> proximité ;<br />
Assurer la pérennité <strong>de</strong>s espaces agricoles en permettant les investissements sur le long terme,<br />
en préservant la diversité <strong>de</strong> productions, en encourageant la vente directe.<br />
A l’échelle du secteur Nord-Ouest, ces quatre objectifs se déclinent en autant d’enjeux. <strong>Le</strong> caractère rural<br />
étant cependant plus affirmé puisque la pérennité <strong>de</strong> l’agriculture et <strong>de</strong>s sièges d’exploitations concerne<br />
plus <strong>de</strong> la moitié du territoire.<br />
<strong>Le</strong>s axes du PADD communal s'inscrivent dans cet objectif qui est essentiel pour Couëron compte tenu <strong>de</strong><br />
son histoire industrielle, <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong> diversifier les activités économiques notamment vers<br />
l’artisanat et le tertiaire, et <strong>de</strong> redynamiser le commerce urbain.<br />
Ouvrir la ville sur l’agglomération s’appuie sur la volonté <strong>de</strong> poursuivre l’aménagement <strong>de</strong>s parcs<br />
d’activités <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron mais également <strong>de</strong> conforter le dynamisme <strong>de</strong> l’agriculture<br />
couëronnaise.<br />
Dans l’axe « Valoriser le patrimoine naturel pour conforter la qualité <strong>de</strong> vie », la commune inscrit par<br />
ailleurs la volonté <strong>de</strong> développer une activité liée aux sports et loisirs sur le site <strong>de</strong> l’ancienne carrière <strong>de</strong>s<br />
Daudières et <strong>de</strong> développer une capacité d’hébergement touristique sur le site du lac <strong>de</strong> Beaulieu. Ces<br />
<strong>de</strong>ux espaces participeront <strong>de</strong>s éléments valorisant du cadre <strong>de</strong> vie, mais seront également <strong>de</strong>s sites très<br />
attractifs pour les populations extérieures. <strong>Le</strong>ur développement est donc susceptible <strong>de</strong> favoriser une<br />
fréquentation accrue et ouverte aux communes voisines.<br />
De par la richesse <strong>de</strong> son patrimoine tant bâti - et en particulier industriel (Tour à plomb, cités ouvrières,<br />
ancienne verrerie…) - que naturel, la commune <strong>de</strong> Couëron a incontestablement un rôle à jouer en<br />
matière <strong>de</strong> développement touristique.<br />
4. Valoriser un exceptionnel cadre <strong>de</strong> vie<br />
L’agglomération bénéficie d’un environnement marqué par l’eau et les vallées. Celles-ci pénètrent<br />
jusqu’au cœur <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> et ont fait, <strong>de</strong>puis la définition <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong>s coulées vertes, l’objet <strong>de</strong><br />
nombreux projets. Aujourd’hui cette orientation s’est développée vers d’autres aspects et d’autres<br />
ambitions à l’échelle <strong>de</strong>s enjeux actuels <strong>de</strong> notre société et <strong>de</strong> l’avenir <strong>de</strong> la métropole nantaise. Il s’agit<br />
<strong>de</strong> :<br />
- Préserver et améliorer la qualité <strong>de</strong> l’eau avec le programme Neptune et assurer une meilleure<br />
gestion <strong>de</strong> l’eau dans les opérations d’urbanisme ;<br />
- Valoriser la diversité <strong>de</strong>s patrimoines et <strong>de</strong>s paysages : éléments représentatifs du patrimoine<br />
<strong>local</strong>, nouvelles coulées vertes, réseau <strong>de</strong> promena<strong>de</strong> et espaces naturels, agriculture périurbaine<br />
et biodiversité, création <strong>de</strong> forêts urbaines ;<br />
- Prévenir les risques : lutte contre la pollution et les nuisances, protection <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’air, <strong>de</strong><br />
l’eau, du sol et du sous-sol ;<br />
- Réduire la consommation énergétique et promouvoir les éco-quartiers : promotion <strong>de</strong>s<br />
constructions HQE et <strong>de</strong> l’efficacité énergétique, développement <strong>de</strong>s énergies renouvelables,<br />
valorisation <strong>de</strong>s déchets ménagers, optimisation <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> chaleur.<br />
165
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Dans le secteur Nord-Ouest, la production et la mise en valeur <strong>de</strong>s vallées concernent la Loire, l’Erdre, le<br />
Cens, le Gesvres et la Chézine, ainsi que l’ensemble <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s recensées.<br />
Directement concernée par cet objectif communautaire, la ville <strong>de</strong> Couëron, dotée d’un vaste territoire<br />
d’une richesse naturelle exceptionnelle, inscrit cette politique au sein l’axe fédérateur « Valoriser le<br />
patrimoine naturel pour conforter la qualité <strong>de</strong> vie ».<br />
<strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> PADD prend en compte la protection <strong>de</strong>s espaces naturels comme élément majeur <strong>de</strong> son<br />
i<strong>de</strong>ntité et <strong>de</strong> la construction d’une ville durable. Il s’appuie notamment sur :<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Le</strong> patrimoine naturel et paysager exceptionnel donné par le fleuve, le marais Audubon, les zones<br />
humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Beaulieu,<br />
<strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> forêt urbaine en lien avec les communes <strong>de</strong> Saint-Herblain et Sautron,<br />
L’aménagement <strong>de</strong>s coulées vertes comme celle du Drillet, dont le sentier réservé aux piétons a<br />
été ouvert récemment.<br />
166
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIIIII- LE PADD COMMUNAL :: UNE REPONSE A DES<br />
OBJECTIIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE<br />
La commune est très marquée par son i<strong>de</strong>ntité ligérienne, son histoire ouvrière ainsi que par<br />
l’organisation urbaine fondée autour <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux grands quartiers. La capacité <strong>de</strong> développement <strong>de</strong><br />
Couëron s’inscrit dans ce contexte et l’organisation du PADD autour <strong>de</strong> quatre orientations thématiques<br />
reflète bien l’ensemble <strong>de</strong>s problématiques couëronnaises.<br />
1. Valoriser le patrimoine naturel et l’activité agricole pour conforter la<br />
qualité <strong>de</strong> vie couëronnaise<br />
<br />
Concilier protection et mise en valeur du marais Audubon<br />
En lien avec le fleuve, la commune dispose d’un territoire dont 40 % est en espace naturel. En tout<br />
premier lieu, le marais Audubon, avec un tiers <strong>de</strong> la superficie totale <strong>de</strong> la commune, constitue un espace<br />
préservé d’un développement mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>structeur avec une activité agricole extensive et une richesse<br />
environnementale exceptionnelle.<br />
La présence d’un tel site génère en lui-même un objectif <strong>de</strong> préservation associé au souhait <strong>de</strong> pouvoir le<br />
faire découvrir aux populations :<br />
<br />
<strong>Le</strong> maintien <strong>de</strong> l’agriculture extensive constitue un bon moyen d’entretien <strong>de</strong>s prés et prairies ;<br />
<br />
<br />
<strong>Le</strong> système hydraulique nécessaire à la régulation <strong>de</strong> l’eau dans les marais, favorisé par la<br />
collectivité respecte un fonctionnement séculaire <strong>de</strong>s marais ;<br />
Enfin la découverte <strong>de</strong>s marais au travers <strong>de</strong> liaisons douces avec la création d’une aire <strong>de</strong><br />
stationnement à la Gerbetière, <strong>de</strong>meure <strong>de</strong> la famille Audubon, répond aux attentes <strong>de</strong><br />
préservation d’un tel site dans un contexte <strong>de</strong> proximité d’une gran<strong>de</strong> métropole <strong>de</strong> plus <strong>de</strong><br />
600 000 habitants.<br />
Protéger les autres espaces naturels remarquables<br />
Couëron dispose <strong>de</strong> nombreux sites naturels en lien avec la Loire comme le site <strong>de</strong> Beaulieu dont le <strong>plan</strong><br />
d’eau a fait l’objet d’un aménagement à vocation <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong>puis longtemps. Il se prolonge par <strong>de</strong>s<br />
zones humi<strong>de</strong>s en lien avec l’étier <strong>de</strong> la Bouma qui se jette en Loire à l’Est du centre-ville. C’est à<br />
proximité <strong>de</strong> ce débouché que le projet <strong>de</strong> PLU a d’ailleurs supprimé une ancienne zone d’urbanisation<br />
future à vocation industrielle pour protéger la zone inondable et éviter tout remblaiement.<br />
La vallée <strong>de</strong> la Patissière, sur laquelle débouche le vallon du Drillet, et qui se poursuit sur la commune <strong>de</strong><br />
Saint-Herblain, présente le même caractère <strong>de</strong> zones humi<strong>de</strong>s liées au fleuve. Elle <strong>de</strong>meure donc<br />
légitimement inconstructible et préservée. Seul le vallon, trait d’union entre les <strong>de</strong>ux communes, fait<br />
l’objet d’une ouverture au public.<br />
Tout au Nord la vallée <strong>de</strong> la Chézine, bien que discrète sur la commune, présente elle aussi un<br />
environnement <strong>de</strong> valeur mais fragile. C’est pourquoi l’objectif <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> ces espaces est<br />
nécessaire au maintien d’une qualité environnementale tout en favorisant un cadre <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
qualité.<br />
<br />
Protéger et valoriser les paysages d’une commune <strong>de</strong>s rives <strong>de</strong> Loire<br />
La présence du fleuve a engendré diverses formes d’urbanisation en lien avec <strong>de</strong>s activités industrielles,<br />
artisanales, commerciales ou d’habitat qui se sont succédées. De cette riche histoire <strong>de</strong>meurent <strong>de</strong>s<br />
traces architecturales intéressantes : la faça<strong>de</strong> <strong>de</strong>s quais <strong>de</strong> Loire qui présente une succession <strong>de</strong> maisons<br />
typiques, les maisons <strong>de</strong>s entrepreneurs ou <strong>de</strong> pêcheurs, les traces industrielles avec notamment la tour<br />
à plomb qui domine les quais et constitue pour les riverains et les navigateurs un repère i<strong>de</strong>ntitaire bien<br />
connu.<br />
167
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
L’aménagement <strong>de</strong>s quais <strong>de</strong> Loire a par ailleurs permis <strong>de</strong> redécouvrir le fleuve et offre désormais au<br />
promeneur un itinéraire aménagé, agréable et fréquenté.<br />
En retrait <strong>de</strong> la Loire, la campagne a toujours connu une activité agricole soutenue. Si les moulins se font<br />
rares, les constructions rurales, anciens corps <strong>de</strong> fermes ou maisons bourgeoises <strong>de</strong>meurent et restituent<br />
la mémoire <strong>de</strong>s lieux. <strong>Le</strong>ur préservation en limitant par exemple le développement <strong>de</strong> l’urbanisation en<br />
campagne constitue une réponse appropriée à leur intérêt i<strong>de</strong>ntitaire, voire architectural ou historique<br />
dans certains cas.<br />
<br />
Développer la vocation <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong> certains espaces naturels<br />
Outre les espaces naturels protégés, Couëron dispose déjà <strong>de</strong> sites <strong>de</strong> loisirs <strong>local</strong>isés hors <strong>de</strong>s zones<br />
urbanisées : le centre <strong>de</strong> l’Erdurière et le lac <strong>de</strong> Beaulieu au Nord <strong>de</strong> la voie ferrée et du centre-ville.<br />
Aménagés, ces <strong>de</strong>ux sites vont faire l’objet d’une amélioration <strong>de</strong> leur attractivité avec le renforcement<br />
ou l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong> nouvelles activités.<br />
Par ailleurs, en lien avec le développement démographique, la ville réfléchit aux évolutions à apporter<br />
aux secteurs <strong>de</strong>s sports et loisirs. La reconversion <strong>de</strong> la carrière <strong>de</strong>s Daudières, entre les RD 81 et 26, au<br />
Nord <strong>de</strong> la voie ferrée permettra à terme <strong>de</strong> développer un nouveau site accessible <strong>de</strong>puis le centre-ville,<br />
en lien avec l’accroissement <strong>de</strong>s besoins.<br />
L’aménagement <strong>de</strong> la forêt urbaine est inscrit dans le PLU en lien avec la politique communautaire et les<br />
communes <strong>de</strong> Sautron et <strong>de</strong> Saint-Herblain. Il correspond à l’évolution <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong>s<br />
populations urbaines et à la création d’une offre nouvelle.<br />
Enfin, fidèle à sa tradition ouvrière, la ville prévoit dans la zone urbaine l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong> nouveaux<br />
jardins familiaux. Ceux-ci permettront d’avoir <strong>de</strong>s espaces extérieurs <strong>de</strong> convivialité tout en offrant aux<br />
habitants <strong>de</strong> logements collectifs ou <strong>de</strong> maisons <strong>de</strong> ville sans jardin, un espace extérieur.<br />
<strong>Le</strong> PADD répond ainsi aux besoins <strong>de</strong>s couëronnais mais aussi <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> l’agglomération dans leur<br />
recherche <strong>de</strong> sites <strong>de</strong> loisirs et d’espaces extérieurs à proximité <strong>de</strong> la ville.<br />
<br />
Garantir une agriculture pérenne<br />
En préservant les contours <strong>de</strong> l’urbanisation, en organisant le développement <strong>de</strong>s zones d’activités en<br />
lien avec les professionnels <strong>de</strong> l’agriculture, et en limitant la capacité <strong>de</strong> construction dans les villages, le<br />
projet <strong>de</strong> PADD permet <strong>de</strong> préserver un fort potentiel pour l’agriculture. Celle-ci est dynamique, forte <strong>de</strong><br />
la présence <strong>de</strong> 28 exploitations agricoles, pérennes pour l’essentiel. <strong>Le</strong> PADD prend donc en compte la<br />
diversité <strong>de</strong>s usages mais également la nécessité du maintien d’une agriculture périurbaine dans un<br />
contexte <strong>de</strong> fortes pressions sur les terres.<br />
2. Affirmer le dynamisme couëronnais par un développement fédérateur<br />
<br />
Développer l’habitat pour favoriser les parcours rési<strong>de</strong>ntiels<br />
En lien avec l’application du PLH et en continuité d’une production diversifiée et accessible <strong>de</strong>s<br />
logements <strong>de</strong>puis toujours, la ville <strong>de</strong> Couëron poursuit sa politique <strong>de</strong> développement urbain tout en<br />
préservant cadre <strong>de</strong> vie et proximité <strong>de</strong>s équipements.<br />
L’agglomération est le site principal d’accueil <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> logements :<br />
Une extension à l’Ouest du centre ville via la ZAC Centre Ouest prévue sur 70 ha environ. Elle viendra<br />
compléter le pôle urbain en associant diversité <strong>de</strong>s logements, équipements publics et notamment<br />
scolaires, et voirie en accroche sur la RD 17. Ce projet achève l’urbanisation Ouest avant l’entrée dans les<br />
marais. <strong>Le</strong> nouveau quartier, proche du centre et <strong>de</strong> ses équipements, renforcera encore le poids<br />
démographique <strong>de</strong> ce secteur tout en perpétuant un accueil ouvert à tous grâce à la diversité <strong>de</strong>s<br />
logements produits (25 % <strong>de</strong> locatifs sociaux, accession sociale, …) et aux équipements créés pour<br />
l’occasion (gendarmerie, école, équipement <strong>de</strong> quartier multi-usages). La proximité <strong>de</strong>s marais et la<br />
présence d’une coulée verte au sein du périmètre <strong>de</strong> ZAC constitueront un atout majeur en terme <strong>de</strong><br />
qualité <strong>de</strong> vie.<br />
168
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La ZAC Rive <strong>de</strong> Loire procè<strong>de</strong> d’une opération <strong>de</strong> renouvellement urbain visant à reconvertir une emprise<br />
industrielle en site d’habitat privilégié en lien avec le fleuve. Couëron s’appuie sur son i<strong>de</strong>ntité ligérienne<br />
et industrielle pour créer une nouvelle offre <strong>de</strong> logements (dont 20 % <strong>de</strong> logements sociaux). Comme<br />
dans les autres projets et par le passé, l’habitat s’accompagne <strong>de</strong> l’im<strong>plan</strong>tation d’équipements mais<br />
aussi <strong>de</strong> commerces <strong>de</strong> manière à renforcer l’attractivité du centre ville. Ainsi les <strong>de</strong>ux ZAC doivent elle<br />
participer au renforcement <strong>de</strong> l’activité commerciale <strong>de</strong> proximité.<br />
<strong>Le</strong>s opérations ponctuelles <strong>de</strong> renouvellement urbain, qui sont déjà en cours compte tenu <strong>de</strong> la<br />
spéculation foncière qui a atteint Couëron, viendront également compléter une offre diversifiée <strong>de</strong><br />
logements notamment en petits collectifs.<br />
La ZAC <strong>de</strong> la Métairie est située en bordure Ouest du quartier <strong>de</strong> La Chabossière ; ses 400 logements<br />
organisés en individuels, logements groupés ou petits collectifs viendront achever l’urbanisation du<br />
secteur sur sa frange Ouest. La proximité <strong>de</strong>s équipements <strong>de</strong> quartier, le renforcement <strong>de</strong>s liaisons<br />
douces vers le centre ville (dont collège et le lycée) faciliteront la vie <strong>de</strong>s futurs résidants. Par ailleurs, le<br />
lac <strong>de</strong> Beaulieu tout proche constitue un élément qualitatif majeur pour le cadre <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> ce futur<br />
quartier.<br />
<strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> réalisation d’une <strong>de</strong>uxième aire d’accueil <strong>de</strong>s gens du voyage complète la diversité <strong>de</strong> l’offre<br />
et répond aux besoins recensés dans le cadre du schéma départemental <strong>de</strong>s gens du voyage.<br />
<br />
Redynamiser le centre-ville en développant les équipements structurants<br />
Couëron est une ville <strong>de</strong> dimension conséquente (18 000 habitants) avec une forte proportion <strong>de</strong> jeunes<br />
et un vieillissement à l’œuvre. Dès lors, elle doit satisfaire <strong>de</strong> nombreux besoins en services et<br />
équipements, et ce d’autant plus que le milieu associatif est dynamique.<br />
<strong>Le</strong>s grands projets urbains et d’habitat comptent tous la présence d’équipements qui viennent compléter<br />
l’offre existante (école, équipement <strong>de</strong> quartier,…). Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cette offre future, la ville veut répondre<br />
aux besoins exprimés à tous les âges <strong>de</strong> la vie. La reconversion du quartier Bessonneau par la démolition<br />
d’une partie <strong>de</strong>s maisons ouvrières en bois et la transformation du site vers l’accueil <strong>de</strong>s populations au<br />
sein d’un équipement intergénérationnel répond à cette politique et à ces besoins.<br />
La reconversion du site <strong>de</strong> la tour à plomb en espace culturel et associatif, l’im<strong>plan</strong>tation d’une<br />
médiathèque sur le même site sont autant <strong>de</strong> réponses aux attentes <strong>de</strong> la population et aux évolutions<br />
démographiques et sociétales.<br />
3. Favoriser les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> déplacement alternatifs à la voiture<br />
<br />
Organiser la voirie structurante<br />
La construction progressive permanente, par <strong>de</strong>s opérations diffuses, <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Couëron ne s’est pas<br />
toujours accompagnée d’une réflexion sur les déplacements automobiles. L’extension <strong>de</strong> la ville et <strong>de</strong> ce<br />
mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> transport implique une intervention majeure <strong>de</strong> la collectivité pour mieux structurer ses<br />
gran<strong>de</strong>s voies principales et les distinguer du maillage <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte <strong>local</strong>e parfois peu distinct<br />
visuellement aujourd’hui. C’est pourquoi la réalisation du boulevard <strong>de</strong> l’Europe, véritable voie nouvelle,<br />
en appui sur <strong>de</strong>s tronçons <strong>de</strong> rues <strong>de</strong> lotissement constitue un atout essentiel pour l’amélioration du<br />
fonctionnement urbain du centre ville.<br />
L’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s zones d’emplois au Nord du territoire communal, et l’absence <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte par les<br />
transports collectifs entre les quartiers d’habitat et ces sites créent un afflux <strong>de</strong> déplacements<br />
individuels. Cette évolution milite pour l’amélioration <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> trafic et d’accès notamment sur<br />
la RD 26 et 101 (aménagement d’un giratoire), l’aménagement <strong>de</strong> certaines voies comme celle <strong>de</strong> la<br />
Sinière, <strong>de</strong> la route <strong>de</strong> Brimberne vers Sautron ou <strong>de</strong> la rue du sta<strong>de</strong>.<br />
169
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Tirer parti <strong>de</strong>s projets d’extension pour améliorer les transports collectifs<br />
De même, pour favoriser l’usage du train d’une population <strong>de</strong> plus en plus encline à aller travailler sur<br />
Saint-Herblain, <strong>Nantes</strong> et les autres pôles d’emplois métropolitains, les accès à la gare seront améliorés.<br />
Un parking <strong>de</strong> rabattement renforcera son attractivité. La collectivité souhaite d’ailleurs le renforcement<br />
<strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>nces du TER et la création d’un arrêt au quartier <strong>de</strong> La Chabossière. La complémentarité entre<br />
politique d’aménagement économique et <strong>de</strong> transports publics en serait ainsi renforcée. La liaison rapi<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> transport en commun entre Couëron et la ligne 1 <strong>de</strong> tramway a notamment permis d’améliorer<br />
sensiblement la qualité <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> Couëron.<br />
Par ailleurs, le projet d’une navette fluviale, même s’il n’est pas encore en phase <strong>de</strong> définition précise,<br />
mérite compte tenu <strong>de</strong> la pression <strong>de</strong> la circulation automobile dans l’agglomération nantaise d’être<br />
anticipé et préparé par les diverses communes qui seront <strong>de</strong>sservies. A cet effet, la ville réserve un espace<br />
quai Emile Paraf avec un aménagement spécifique qui permettra d’accueillir un embarcadère.<br />
<br />
Développer le réseau <strong>de</strong>s circulations douces<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron compte déjà <strong>de</strong> nombreuses liaisons piétonnes. <strong>Le</strong> PADD reprend donc<br />
légitimement cette préoccupation dans ses projets. Cette option a d’autant plus <strong>de</strong> sens que les <strong>de</strong>ux<br />
gran<strong>de</strong>s entités urbaines sont assez circonscrites et que les distances entre habitat, équipements, et<br />
pôles centraux sont relativement faibles. De plus, l’aménagement <strong>de</strong>s rives <strong>de</strong> Loire constitue un appel<br />
pressant à la promena<strong>de</strong>. <strong>Le</strong>s liaisons douces rabattant vers cet itinéraire sont donc à privilégier. Ceci<br />
participe à la qualité <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> la commune.<br />
<strong>Le</strong>s projets urbains (ZAC) ou <strong>de</strong> création d’équipements comme le site <strong>de</strong>s Daudières, s’accompagnent <strong>de</strong><br />
cette politique : permettre l’accessibilité aux piétons et aux cycles, quelque que soit leur mobilité ;<br />
améliorer les liens entre différents quartiers d’habitat et équipements ou espaces naturels : c’est le cas<br />
par exemple avec l’aménagement du vallon du Drillet<br />
De plus la commune s’inscrit dans l’itinéraire Loire à vélo qui vise à créer une continuité douce tout au<br />
long du fleuve, <strong>de</strong> la source à l’estuaire. Cet itinéraire vient d’Indre par la RD 107 en passant au Nord <strong>de</strong><br />
l’ensemble industriel continu entre Indre et Couëron. Il rejoint les quais <strong>de</strong> Loire puis les marais Audubon<br />
via Port Launay.<br />
4. Développer les zones d’activités, pérenniser l’agriculture et les<br />
commerces <strong>de</strong> proximité<br />
<br />
Développer le parc d’activités <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron<br />
Terre industrielle traditionnelle comme ses voisines <strong>de</strong> bord <strong>de</strong> Loire, la commune connaît <strong>de</strong>puis une<br />
vingtaine d’années un redéploiement <strong>de</strong> ses sites d’activités <strong>de</strong>s bords <strong>de</strong> Loire vers le carrefour routier<br />
entre RD 101 et 201. <strong>Le</strong> projet <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron 3 est un projet d’intérêt communautaire dans le cadre<br />
du renforcement du pôle d’activité Ouest, notamment en direction <strong>de</strong>s services.<br />
<strong>Le</strong> PADD reprend naturellement cette orientation en s’appuyant sur les étu<strong>de</strong>s préalables qui ont été<br />
réalisées pour <strong>Nantes</strong> Métropole et qui permet <strong>de</strong> préciser les contours exacts du périmètre <strong>de</strong><br />
l’extension projetée selon les sensibilités environnementales et les activités déjà en place (notamment<br />
agricoles).<br />
<br />
Améliorer l’organisation et la qualité paysagère du Paradis<br />
Par ailleurs, le PLU conserve l’ensemble <strong>de</strong>s anciens sites à vocation industrielle ou artisanale situés à<br />
proximité <strong>de</strong> la Loire. La plus à l’Ouest, la zone du Paradis, au contact <strong>de</strong>s marais Audubon, à Port Launay<br />
va connaître une amélioration sensible <strong>de</strong> son environnement afin <strong>de</strong> lui permettre un renouvellement<br />
<strong>de</strong>s im<strong>plan</strong>tations mais sans extension du site contraint par un environnement sensible et <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
qualité.<br />
170
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<br />
Conforter les commerces et services du centre-ville<br />
En lien avec la volonté <strong>de</strong> favoriser l’attractivité commerciale du centre ville <strong>de</strong> Couëron, la collectivité<br />
s’appuie sur un développement et une diversification <strong>de</strong>s petites surfaces commerciales en site urbain.<br />
Cette orientation est en corrélation avec le développement <strong>de</strong> l’habitat à proximité (les <strong>de</strong>ux ZAC) qui<br />
renforcera la fréquentation du centre, mais aussi avec une réorganisation <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong><br />
stationnement dans le centre urbain.<br />
En lien avec sa politique d’équipements et <strong>de</strong> services, la municipalité reste par ailleurs attentive au<br />
maintien d’une qualité <strong>de</strong> services et <strong>de</strong> leur accès par les habitants <strong>de</strong> manière à permettre à chacun <strong>de</strong><br />
vivre sur place dans les meilleures conditions.<br />
<br />
Favoriser l’essor du tourisme<br />
La métropole nantaise est <strong>de</strong> plus en plus attractive, elle subit une fréquentation accrue, ce qui amène à<br />
réfléchir à l’amélioration <strong>de</strong>s loisirs <strong>de</strong> fin <strong>de</strong> semaine, <strong>de</strong>s accès au plus grand nombre tout en veillant à<br />
la protection <strong>de</strong>s sites naturels.<br />
Du fait <strong>de</strong> sa qualité paysagère, <strong>de</strong> la présence <strong>de</strong>s marais, du site aménagé <strong>de</strong> Beaulieu, la ville <strong>de</strong><br />
Couëron intègre le tourisme dans ses préoccupations. Ce <strong>de</strong>rnier peut améliorer l’activité commerciale et<br />
avoir <strong>de</strong>s répercussions économiques intéressantes. Pour le favoriser, le projet prévoit dans la continuité<br />
<strong>de</strong> l’aménagement <strong>de</strong>s quais, l’amélioration <strong>de</strong>s liaisons douces vers les marais, la réhabilitation <strong>de</strong> la<br />
Gerbetière. <strong>Le</strong> site <strong>de</strong> Beaulieu dispose par ailleurs d’une orientation touristique plus marquée avec le<br />
développement d’une offre hôtelière et <strong>de</strong> restauration en lien avec une fréquentation déjà forte et<br />
ouverte aux personnes extérieures à Couëron.<br />
<br />
Garantir le maintien <strong>de</strong> l’agriculture, véritable activité économique<br />
Commune agricole, dotée <strong>de</strong> quotas laitiers conséquents et d’exploitations bien organisées, Couëron<br />
préserve l’activité agricole dans son PLU.<br />
<strong>Le</strong>s terres réservées à l’agriculture sont ainsi extraites d’une course à la pression foncière et à la<br />
spéculation que les exploitants vivaient <strong>de</strong> façon involontaire. L’arrêt <strong>de</strong> la possibilité <strong>de</strong> construire dans<br />
les villages et dans la zone agricole va limiter le mitage <strong>de</strong> l’espace et faciliter les conditions<br />
d’exploitations pour les agriculteurs tout en préservant la qualité paysagère du plateau.<br />
De même la valorisation par un élevage extensif <strong>de</strong>s marais contribue au double objectif <strong>de</strong> préservation<br />
d’une agriculture périurbaine et d’un site naturel.<br />
171
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
172
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIV.. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX<br />
S’’IIMPOSANT OU A PRENDRE EN COMPTE DANS<br />
LE PADD<br />
« <strong>Le</strong> <strong>plan</strong> <strong>local</strong> <strong>d'urbanisme</strong> doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma <strong>de</strong> cohérence<br />
territoriale, du schéma <strong>de</strong> secteur, du schéma <strong>de</strong> mise en valeur <strong>de</strong> la mer et <strong>de</strong> la charte du parc naturel<br />
régional, ainsi que du <strong>plan</strong> <strong>de</strong> déplacements urbains et du programme <strong>local</strong> <strong>de</strong> l'habitat. » (Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’urbanisme, article L-123.1).<br />
Dans l’agglomération nantaise, ces conditions <strong>de</strong> compatibilité portent sur les dispositions prises par la<br />
communauté urbaine dans le cadre <strong>de</strong> ses documents <strong>de</strong> <strong>plan</strong>ification.<br />
1. Compatibilité avec les documents <strong>de</strong> <strong>plan</strong>ification communautaire<br />
<br />
<strong>Le</strong> Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat (Communauté Urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>)<br />
Approuvé le 18 juin 2004 par le conseil communautaire, il fixe pour objectifs d’offrir <strong>de</strong>s logements en<br />
plus grand nombre, plus variés dans leurs différentes caractéristiques, en particulier en termes <strong>de</strong> prix, et<br />
plus accessibles à l’ensemble <strong>de</strong>s ménages résidant dans l’agglomération ou qui souhaitent y rési<strong>de</strong>r. Il<br />
entend également mieux répondre aux différents besoins spécifiques encore insuffisamment satisfaits<br />
aujourd’hui (étudiants, personnes âgées, handicapés, gens du voyage). <strong>Le</strong> PADD reprend ces objectifs.<br />
<strong>Le</strong> PLH a fixé quatre principaux axes d’actions :<br />
- La relance <strong>de</strong> la production d’habitat,<br />
- La diversification <strong>de</strong> l’offre,<br />
- <strong>Le</strong>s réponses aux besoins en logements particuliers, en direction notamment <strong>de</strong>s<br />
étudiants, jeunes et personnes âgées,<br />
- L’accueil <strong>de</strong>s populations spécifiques (personnes défavorisées et gens du voyage).<br />
Pour ce faire, le PLH fixe l'objectif d’une production <strong>de</strong> 3 900 logements neufs par an dont 740 par an<br />
dans le secteur nord-ouest. <strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron participe à la réalisation <strong>de</strong> cet objectif avec une<br />
production moyenne <strong>de</strong> 170 à 180 logements par an. <strong>Le</strong> lancement <strong>de</strong> l’opération <strong>de</strong> la ZAC Ouest centreville,<br />
<strong>de</strong> la ZAC <strong>de</strong> la Métairie, <strong>de</strong> la ZAC <strong>de</strong>s Rives <strong>de</strong> Loire et le renouvellement urbain contribueront à<br />
atteindre cet objectif et permettront d’offrir <strong>de</strong>s logements plus variés en types, en tailles et en formes<br />
architecturales.<br />
<strong>Le</strong> PLH énonce également <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> programmation <strong>de</strong> logements sociaux : il s’agit <strong>de</strong><br />
programmer un minimum <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong> logements locatifs sociaux dans chaque opération d’ensemble.<br />
<br />
<strong>Le</strong> Plan <strong>de</strong> Déplacements Urbains (Communauté Urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>)<br />
<strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> Plan <strong>de</strong> Déplacements Urbains a été approuvé par le Conseil du District du 27 octobre 2000.<br />
<strong>Le</strong> P.D.U. s’affirme comme une démarche à la fois ambitieuse et réaliste pour gérer les différentes<br />
composantes <strong>de</strong> la mobilité urbaine <strong>de</strong> ces dix prochaines années. Il vise à tendre vers un équilibre entre<br />
la place <strong>de</strong> l’automobile et celle <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transports alternatifs en donnant la priorité aux mo<strong>de</strong>s<br />
doux (<strong>de</strong>ux roues, marche à pied) et aux transports collectifs.<br />
S’appuyant sur le bilan positif <strong>de</strong>s actions développées dans le cadre du P.D.U. <strong>de</strong> 1991, les choix<br />
stratégiques du District pour le P.D.U. <strong>de</strong> 2000-2010 s’inscrivent dans une logique <strong>de</strong> maintien et <strong>de</strong><br />
confortement <strong>de</strong>s acquis <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte. En prenant en compte une hypothèse d’évolution <strong>de</strong>s<br />
déplacements <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 30% d’ici 2010, les élus du district ont décidé <strong>de</strong> retenir une hypothèse <strong>de</strong><br />
poursuite du fléchissement <strong>de</strong> la mobilité en voitures particulières au profit du transport public et <strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>s doux (marche à pied et vélo), au travers d’une approche combinant multi modalité et<br />
complémentarité.<br />
173
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Cinq grands objectifs sont fixés par le P.D.U. pour la pério<strong>de</strong> 2000-2010 :<br />
1. Poursuivre le développement <strong>de</strong> la mobilité pour tous,<br />
2. Maintenir et développer l’accessibilité à l’ensemble <strong>de</strong>s centralités,<br />
3. Tendre vers un équilibre entre la voiture (50%) et les autres mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> déplacement (transport<br />
public 18%, autres mo<strong>de</strong>s 32%),<br />
4. Développer une démarche <strong>de</strong> management global <strong>de</strong> la mobilité,<br />
5. Associer l’ensemble <strong>de</strong>s acteurs.<br />
<strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> P.D.U. 2000-2010 comporte 42 actions regroupées selon huit thèmes pour concourir aux<br />
objectifs définitifs.<br />
Certains projets sont déjà engagés et font partie du quotidien <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> Couëron :<br />
- La gratuité du bac <strong>de</strong>puis septembre 2005,<br />
- La poursuite du maillage <strong>de</strong> liaisons douces (voies cyclables et piétonnes dans et entre quartiers)<br />
dans toutes les communes (cf les Schémas Directeurs <strong>de</strong>s liaisons cyclables et <strong>de</strong>s continuités<br />
piétonnes au fil <strong>de</strong> l’eau),<br />
- A plus long terme, la possible création d’une halte ferroviaire à la Chabossière.<br />
<br />
La Charte d’orientation commerciale<br />
La Charte d’orientation commerciale, approuvée en 2003 par le conseil communautaire, privilégie le<br />
renforcement <strong>de</strong> la centralité d’agglomération et <strong>de</strong>s pôles <strong>de</strong> quartier et <strong>de</strong> proximité. Ces orientations<br />
sont reprises par l’axe «affirmer le dynamisme couëronnais par un développement fédérateur » du<br />
PADD et ses thématiques, en particulier «redynamiser le centre-ville en développant les équipements<br />
structurants » et « conforter les commerces et services du centre-ville ».<br />
L’ Agenda 21<br />
Depuis les années 1990, l’agglomération nantaise agit dans le sens du développement durable. Cohésion<br />
sociale, diversité économique, protection <strong>de</strong> l'environnement et gouvernance sont prises en compte dans<br />
les projets communautaires. En témoignent les politiques en matière d'eau et d'assainissement (ex.<br />
projet Neptune), <strong>de</strong> déplacements, <strong>de</strong> déchets, d’environnement, d'économie plurielle (ex. soutien à<br />
l’économie sociale et solidaire), les projets d’éco quartiers sur l’Ile <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>, le Grand Projet <strong>de</strong> Ville<br />
Malakoff Pré-Gauchet, … En décidant, en avril 2004, l'élaboration <strong>de</strong> l'Agenda 21 <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole, le<br />
conseil communautaire a choisi <strong>de</strong> se doter d'un "outil repère", co-produit avec les partenaires locaux. Un<br />
"fil rouge" jalonné d’"actions témoins", l’Agenda 21 décline le développement durable dans les politiques<br />
publiques et dans les pratiques quotidiennes <strong>de</strong> la Collectivité.<br />
<strong>Le</strong> diagnostic réalisé au printemps 2005 a révélé un certain nombre <strong>de</strong> constats, sur la manière dont le<br />
développement durable est présent sur le territoire. <strong>Le</strong>s élus, les agents <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole et les<br />
partenaires locaux y ont i<strong>de</strong>ntifié <strong>de</strong>s domaines à conforter (ex. la protection <strong>de</strong> l’environnement et du<br />
cadre <strong>de</strong> vie, l’égalité <strong>de</strong>vant l’emploi, …), et à renforcer (la diversité sociale et culturelle et la mise au<br />
débat <strong>de</strong>s politiques publiques), <strong>de</strong> nouveaux champs à explorer, (les services rési<strong>de</strong>ntiels, la conciliation<br />
<strong>de</strong>s temps, le commerce éthique et équitable….).<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole souhaite répondre à <strong>de</strong>ux défis mondiaux :<br />
• La lutte contre les déséquilibres environnementaux <strong>plan</strong>étaires ;<br />
• La cohésion sociale et les solidarités économiques et interculturelles.<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole, à son échelle, contribuera à relever ces <strong>de</strong>ux défis. Elle souhaite aujourd’hui, à travers<br />
son Agenda 21, agir dans 3 directions principales :<br />
• La lutte contre l’effet <strong>de</strong> serre ;<br />
• <strong>Le</strong>s solidarités et évolutions <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie ;<br />
• La diversification économique.<br />
174
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
La prise en compte <strong>de</strong> ces enjeux se concrétisera notamment par l’animation du territoire, la<br />
mobilisation <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole et la poursuite du débat public. La démarche a abouti à<br />
l’élaboration d’un projet d’actions en faveur du développement durable.<br />
2. Compatibilité avec les documents nationaux et départementaux<br />
<br />
La D.T.A <strong>de</strong> l’estuaire <strong>de</strong> la Loire<br />
<strong>Le</strong>s Directives Territoriales d’Aménagement ont été prévues par la loi du 4 février 1995. La loi<br />
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 a confirmé<br />
ces dispositions.<br />
La D.T.A. est à la fois un outil <strong>de</strong> <strong>plan</strong>ification <strong>de</strong> long terme <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s priorités et actions <strong>de</strong> l’Etat et un<br />
document ayant valeur juridique avec lequel doivent être compatibles les documents d’urbanisme<br />
locaux. Son élaboration est <strong>de</strong> la compétence <strong>de</strong> l’Etat et se fait en collaboration avec les collectivités<br />
<strong>local</strong>es.<br />
La D.T.A. fixe les principaux objectifs <strong>de</strong> l’Etat en matière <strong>de</strong> <strong>local</strong>isation <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s infrastructures <strong>de</strong><br />
transport et <strong>de</strong>s grands équipements, ainsi qu’en matière <strong>de</strong> préservation <strong>de</strong>s espaces naturels, <strong>de</strong>s sites<br />
et <strong>de</strong>s paysages. Elle précise les modalités d’application <strong>de</strong>s lois d’aménagement et d’urbanisme,<br />
adaptées aux particularités géographiques <strong>local</strong>es.<br />
La DTA Estuaire <strong>de</strong> La Loire, opposable <strong>de</strong>puis juillet 2006, couvre les trois arrondissements <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>,<br />
Saint-Nazaire et Ancenis ainsi que les cantons <strong>de</strong> Blain, Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique et<br />
Champtoceaux et Saint-Florent-le-Vieil dans le Maine et Loire.<br />
L’enjeu central est la conciliation <strong>de</strong>s fonctions portuaires, industrielles et logistiques, avec la protection<br />
<strong>de</strong> milieux d’intérêt écologique majeur. Plus précisément, les principaux enjeux sont les suivants :<br />
- Renforcer l’attractivité urbaine et patrimoniale <strong>de</strong> la métropole <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>/Saint-<br />
Nazaire ;<br />
- Poursuivre la mise en place <strong>de</strong> conditions favorables au développement économique<br />
et industrialo-portuaire ;<br />
- Protéger et valoriser les espaces naturels, sites et paysages dans une logique <strong>de</strong><br />
développement durable ;<br />
- Préciser les modalités <strong>local</strong>es d’application <strong>de</strong> la loi Littoral.<br />
La DTA a été approuvée par décret le 17 juillet 2006.<br />
<br />
<strong>Le</strong> SCOT <strong>de</strong> la Métropole <strong>Nantes</strong> Saint-Nazaire<br />
Approuvé le 26 mars 2007 par le Comité Syndical qui regroupe 57 communes et 5 intercommunalités, le<br />
SCOT <strong>de</strong> la Métropole Atlantique <strong>Nantes</strong> - Saint-Nazaire a pour objectif <strong>de</strong> répondre aux besoins <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong> la métropole en favorisant une organisation urbaine plus économe <strong>de</strong> l’espace et<br />
respectueuse <strong>de</strong> l’environnement. La stratégie européenne <strong>de</strong> la métropole qu’exprime le SCOT<br />
permettra à l’agglomération nantaise et à sa sœur nazairienne <strong>de</strong> répondre aux besoins d’emploi et <strong>de</strong><br />
développement personnel et social <strong>de</strong> ses habitants. Pour cela, la métropole doit se doter <strong>de</strong> fonctions<br />
nouvelles et renforcer les fonctions existantes nécessaires à cette ambition.<br />
En application <strong>de</strong>s articles L 122-1 et R 122-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme, le PLU <strong>de</strong> Couëron doit être<br />
compatible avec le Document d’Orientations Générales du Scot <strong>de</strong> la métropole <strong>Nantes</strong>-Saint-Nazaire et<br />
avec les documents graphiques qui lui sont assortis.<br />
La compatibilité du PLU <strong>de</strong> Couëron doit s’apprécier au regard <strong>de</strong>s dix chapitres du Document<br />
d’Orientations Générales.<br />
175
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong>s orientations générales <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> l’espace et <strong>de</strong> la restructuration <strong>de</strong>s espaces urbanisés<br />
<strong>Le</strong> Scot rappelle que toutes les communes doivent assurer les conditions <strong>de</strong> leur développement<br />
démographique et économique et prévoir les espaces urbanisables nécessaires dans un souci :<br />
- <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong>s centralités existantes,<br />
- d’économie d’espace,<br />
- <strong>de</strong> lutte contre le mitage <strong>de</strong> l’espace métropolitain,<br />
- <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s espaces agricoles et naturels constituant la trame verte <strong>de</strong> la métropole,<br />
- <strong>de</strong> prise en compte <strong>de</strong> la problématique <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sserte notamment en transports collectifs,<br />
- <strong>de</strong> prise en compte du patrimoine et du paysage,<br />
- <strong>de</strong> prise en compte <strong>de</strong>s risques naturels, notamment le risque d’inondation, et <strong>de</strong>s risques<br />
technologiques.<br />
Ces grands principes sont déclinés précisément dans les chapitres 2 à 9 du Document d’Orientations<br />
Générales du Scot avec lesquels le PLU <strong>de</strong> Couëron doit être compatible.<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron, comme toute commune du territoire concerné par le Scot, participe, à son<br />
échelle, au développement démographique et économique <strong>de</strong> la métropole <strong>Nantes</strong>-Saint-Nazaire. Ce<br />
développement doit s’effectuer en limitant le mitage du territoire et en inscrivant les éventuels<br />
développements urbains en continuité <strong>de</strong>s centralités principales. <strong>Le</strong> territoire <strong>de</strong> Couëron est organisé<br />
en <strong>de</strong>ux quartiers mixtes (le centre-ville et la Chabossière) et un pôle d’activité (<strong>Le</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron).<br />
<strong>Le</strong>s espaces <strong>de</strong> développement prévus dans le PLU se situent soit dans <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> renouvellement<br />
urbain (ZAC Rives <strong>de</strong> Loire), soit dans la continuité <strong>de</strong> ces espaces urbains existants (ZAC Ouest centreville,<br />
ZAC Métairie).<br />
<strong>Le</strong>s grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles ou<br />
forestiers<br />
<strong>Le</strong> Scot indique sa volonté <strong>de</strong> réduire d’au moins 10% la consommation moyenne annuelle d’espaces<br />
naturels et/ou agricoles par l’urbanisation. Il précise que cet objectif <strong>de</strong> production doit être affiché par<br />
les schémas <strong>de</strong> secteur et détaillé dans les PLU.<br />
En l’absence <strong>de</strong> schéma <strong>de</strong> secteur sur le territoire <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole, le PLU <strong>de</strong> Couëron doit être<br />
compatible avec les grands principes d’économie <strong>de</strong> l’espace et assurer un développement urbain<br />
cohérent défini avec le Scot :<br />
- privilégier le renouvellement urbain et la <strong>de</strong>nsification <strong>de</strong>s opérations d’habitat, favoriser<br />
l’évolution <strong>de</strong>s zones d’activités existantes,<br />
- inscrire les extensions urbaines à <strong>de</strong>stination d’habitat en continuité <strong>de</strong>s centres, étant précisé<br />
que les documents d’urbanisme peuvent subordonner l’ouverture <strong>de</strong>s extensions urbaines à<br />
l’utilisation préalable <strong>de</strong> terrains situés en zone urbanisée et <strong>de</strong>sservis par les équipements,<br />
- définir les extensions urbaines à <strong>de</strong>stination d’activités dans un souci d’économie d’espace et<br />
d’insertion paysagère,<br />
- stopper le mitage <strong>de</strong> l’espace métropolitain en limitant fortement les extensions d’urbanisation<br />
<strong>de</strong>s écarts, hameaux et villages.<br />
<strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron prévoit un volume <strong>de</strong> zone AU <strong>de</strong> 17 hectares à vocation d’habitat, <strong>de</strong> 10 ha à vocation<br />
d’activités, soit 27 hectares au total (en comparaison aux 226,5 hectares classés en zone NA au POS<br />
antérieur). Cette réduction importante <strong>de</strong>s surfaces vouées à l’urbanisation est liée à la réalisation<br />
prochaine d’opérations <strong>de</strong> développement urbain, représentant 90 hectares classés en zone UP (ZAC<br />
Ouest centre-ville, ZAC Métairie, ZAC Rives <strong>de</strong> Loire).<br />
L’objectif <strong>de</strong> renforcement du centre-ville, <strong>de</strong> la Chabossière ainsi que du pôle d’activité, et ce tout en<br />
limitant les extensions urbaines au dépend <strong>de</strong>s territoires agricoles et naturels, est cohérent avec les<br />
orientations du Scot.<br />
176
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> PLU i<strong>de</strong>ntifie les zones UC correspondant aux emprises <strong>de</strong>s écarts et hameaux. Ils occupent une<br />
superficie <strong>de</strong> 41 hectares. Ces villages sont contenus dans leur périmètre existant afin <strong>de</strong> limiter une<br />
urbanisation dispersée non connectée à l’offre <strong>de</strong> services et d’équipements publics du centre-ville <strong>de</strong><br />
Couëron et <strong>de</strong> la Chabossière.<br />
79 hectares sont classés en zone NH correspondant à <strong>de</strong>s espaces déjà bâtis isolés au sein d’une zone<br />
agricole ou naturelle. Il s’agit <strong>de</strong> secteurs <strong>de</strong> taille et <strong>de</strong> capacité d’accueil limitées où l’évolution <strong>de</strong>s<br />
habitations est autorisée mais <strong>de</strong> manière très restreinte.<br />
<strong>Le</strong>s espaces agricoles pérennes font l’objet d’un classement en zone A assurant une protection durable<br />
<strong>de</strong>s espaces agricoles ou potentiellement agricoles pour 1604 hectares.<br />
Enfin, les espaces naturels représentent une part majeure du territoire communal. A ce titre, 1929<br />
hectares sont classés en zone NN dont 1249 hectares en zone NNs afin <strong>de</strong> protéger les espaces naturels à<br />
fort intérêt écologique, en particulier le site Natura 2000. La zone NL <strong>de</strong>stinée à accueillir <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong><br />
loisirs dans le respect <strong>de</strong>s caractéristiques naturelles du territoire représente 133 hectares.<br />
<strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron est compatible avec les orientations du Scot en matière d’économie d’espace et <strong>de</strong><br />
protection <strong>de</strong> l’espace agricole.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs relatifs à l’équilibre social <strong>de</strong> l’habitat et à la construction <strong>de</strong> logements sociaux<br />
Répondre aux besoins <strong>de</strong>s habitants et s’adapter aux évolutions démographiques<br />
<strong>Le</strong> Scot fixe comme objectif que la construction <strong>de</strong> nouveaux logements doit répondre d’une part aux<br />
besoins <strong>de</strong>s ménages d’aujourd’hui et d’autre part à l’accueil <strong>de</strong>s nouvelles populations. Sur la base <strong>de</strong>s<br />
projections <strong>de</strong> population retenue à l’horizon 2020, ce sont 5620 logements minimum qui <strong>de</strong>vront être<br />
construits en moyenne chaque année dont 3 900 pour <strong>Nantes</strong> Métropole.<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron, qui comptait 17 808 habitants en 1999, a connu ces <strong>de</strong>rnières années un<br />
accroissement régulier <strong>de</strong> sa population, correspondant à une augmentation d’environ 200 habitants<br />
chaque année <strong>de</strong>puis 1999. Selon les objectifs du Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat et pour garantir la<br />
croissance <strong>de</strong> la population malgré le <strong>de</strong>sserrement rési<strong>de</strong>ntiel <strong>de</strong>s ménages, le rythme <strong>de</strong> construction<br />
doit s’accentuer afin d’atteindre environ 180 logements neufs par an grâce aux trois programmes <strong>de</strong> ZAC<br />
à vocation d’habitat. De même, la délimitation <strong>de</strong> zones NX permet d’esquisser les espaces potentiels <strong>de</strong><br />
développement urbain à moyen et long terme sur la commune.<br />
Diversifier l’offre nouvelle d’habitat<br />
<strong>Le</strong>s objectifs <strong>de</strong> production <strong>de</strong> logement social du Scot sont <strong>de</strong> 1 200 logements locatifs sociaux (hors PLS)<br />
répartis sur l’ensemble <strong>de</strong>s intercommunalités. Pour <strong>Nantes</strong> Métropole, cela représente 900 logements<br />
par an.<br />
<strong>Le</strong> Scot prévoit que la part <strong>de</strong> logements locatifs sociaux doit représenter au moins 20% <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong><br />
la construction neuve pour Couëron. La commune s’inscrit dans le PLH <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole et a pour<br />
objectifs <strong>de</strong> créer environ 36 logements locatifs sociaux neufs en moyenne par an soit 20% <strong>de</strong> l’objectif<br />
total <strong>de</strong> production <strong>de</strong> logements. 400 logements sociaux sont ainsi projetés dans les trois ZAC, afin<br />
d’augmenter le parc locatif social tout en assurant une diversité <strong>de</strong>s logements apte à permettre une<br />
diversité socio-démographique <strong>de</strong> la population communale. <strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron s’inscrit donc dans la<br />
continuité <strong>de</strong>s orientations du Scot en matière <strong>de</strong> développement du logement social.<br />
Favoriser <strong>de</strong>s formes urbaines moins consommatrices d’espace et encourager la mixité sociale<br />
<strong>Le</strong> Scot affirme que la programmation <strong>de</strong>s extensions urbaines doit s’effectuer en prenant en<br />
considération le potentiel <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsification du centre-ville ainsi que le potentiel résiduel <strong>de</strong> construction<br />
dans les villages et hameaux, et ce en favorisant la mixité <strong>de</strong>s typologies <strong>de</strong> logements et une mixité <strong>de</strong>s<br />
statuts d’occupation. Par ailleurs, le développement <strong>de</strong> l’habitat doit être privilégié dans les secteurs<br />
présentant <strong>de</strong> bonnes possibilités <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte par les transports collectifs ainsi qu’une proximité <strong>de</strong>s<br />
équipements, <strong>de</strong>s services et <strong>de</strong>s commerces.<br />
177
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Couëron souhaite favoriser la <strong>de</strong>nsité dans le cadre du renouvellement urbain au sein <strong>de</strong>s quartiers<br />
préexistants et dans les nouvelles opérations. Ces opérations permettront <strong>de</strong> diversifier la typologie <strong>de</strong>s<br />
logements communaux, actuellement dominée par le logement individuel (88,1% du parc en 1999). La<br />
commune souhaite ainsi accroître la part <strong>de</strong> l’habitat collectif sur le territoire.<br />
<strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron est donc compatible avec les objectifs du Scot en matière d’équilibre social <strong>de</strong><br />
l’habitat et <strong>de</strong> limite <strong>de</strong> l’étalement urbain.<br />
Organiser la mobilité : les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et les réseaux <strong>de</strong> transport<br />
Relier urbanisme et déplacements : les conditions permettant <strong>de</strong> favoriser le développement <strong>de</strong><br />
l’urbanisation prioritaire dans les secteurs <strong>de</strong>sservis par les transports collectifs<br />
<strong>Le</strong> Scot préconise <strong>de</strong> :<br />
- mettre en place un système <strong>de</strong> déplacements durable en structurant le territoire par les mo<strong>de</strong>s<br />
ferroviaires,<br />
- développer la ville <strong>de</strong>s courtes distances en favorisant les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> déplacements doux<br />
complémentaires <strong>de</strong>s transports publics,<br />
- encourager à utiliser l’automobile autrement notamment en zone urbaine <strong>de</strong>nse,<br />
- favoriser la construction <strong>de</strong> logements, <strong>de</strong> services, d’activités tertiaires et d’équipements en<br />
priorité à proximité <strong>de</strong>s stations et <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> transports collectifs,<br />
- traiter les gares et les principaux points d’échange <strong>de</strong> transports collectifs en pôles <strong>de</strong> centralité.<br />
Malgré son éloignement du centre <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong>, Couëron bénéficie d’une bonne <strong>de</strong>sserte en transport<br />
collectif grâce à la nouvelle ligne express <strong>de</strong> bus liant la mairie <strong>de</strong> Couëron à la ligne 1 <strong>de</strong> tramway au<br />
niveau <strong>de</strong> l’arrêt gare maritime à <strong>Nantes</strong>, via la Chabossière.<br />
De même, la commune <strong>de</strong> Couëron est <strong>de</strong>sservie par un maillage <strong>de</strong> voies <strong>de</strong>nses, permettant une<br />
accessibilité aux communes environnantes et aux principales infrastructures <strong>de</strong> transport (RN 165,<br />
périphérique nantais).<br />
<strong>Le</strong> PLU décline les principaux objectifs du Scot en matière <strong>de</strong> déplacements et <strong>de</strong> mobilité en privilégiant<br />
les transports collectifs, en définissant un réseau <strong>de</strong> voirie hiérarchisé pour une circulation automobile<br />
apaisée et en favorisant les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> déplacement doux.<br />
A ce titre, l’organisation <strong>de</strong> la voirie structurante est notamment permise par le projet d’aménagement<br />
d’une partie du boulevard <strong>de</strong> l’Europe afin d’améliorer le fonctionnement urbain du centre-ville. <strong>Le</strong><br />
souhait <strong>de</strong> renforcer le rôle <strong>de</strong>s transports collectifs se traduit essentiellement par la valorisation <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>sserte ferroviaire, en améliorant la <strong>de</strong>nsité et la qualité <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong>s TER, en valorisant le<br />
parking relais <strong>de</strong> la gare <strong>de</strong> Couëron et en créant à plus long terme une gare afin <strong>de</strong> <strong>de</strong>sservir la<br />
Chabossière.<br />
<strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron est donc compatible avec les objectifs du Scot en matière <strong>de</strong> déplacements.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs relatifs à la <strong>local</strong>isation préférentielle <strong>de</strong>s activités économiques<br />
<strong>Le</strong> Scot indique sa volonté <strong>de</strong> développer, optimiser et qualifier le foncier à <strong>de</strong>stination économique. Il<br />
s’agit <strong>de</strong> développer l’emploi, <strong>de</strong> garantir la cohérence <strong>de</strong>s pôles <strong>de</strong> développement économique, <strong>de</strong><br />
respecter les règles paysagères et d’aménagement qualitatif dans tout projet <strong>de</strong> parc d’activités et<br />
d’assurer une gestion économe <strong>de</strong> l’espace. En matière <strong>de</strong> développement commercial, il est précisé<br />
qu’aucune nouvelle zone <strong>de</strong> périphérie ne sera créée afin <strong>de</strong> conforter la vocation commerciale <strong>de</strong>s<br />
centres-villes. Enfin, le Scot affirme la nécessité <strong>de</strong> développer le tourisme rural et <strong>de</strong> découverte.<br />
Sa proximité avec <strong>Nantes</strong> et son réseau d’infrastructures routières font <strong>de</strong> Couëron un pôle économique<br />
important (4 364 emplois en 1999) même s’il reste mo<strong>de</strong>ste au regard <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> et <strong>de</strong> Saint-Herblain. Il<br />
reste marqué par l’emploi industriel, représentant 24,1% <strong>de</strong> l’emploi communal, malgré l’affirmation <strong>de</strong><br />
l’emploi tertiaire.<br />
178
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> PLU a pour objectif <strong>de</strong> requalifier et développer les pôles d’activités communaux, via la ZAC d’activité<br />
d’intérêt communautaire <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron et la requalification du site <strong>de</strong> Paradis afin <strong>de</strong> renouveler<br />
l’activité et d’améliorer l’organisation et la qualité paysagère <strong>de</strong> ce site.<br />
De même, le PLU s’intéresse aux autres typologies d’activités. Il affirme le renforcement <strong>de</strong>s commerces<br />
et <strong>de</strong>s services du centre-ville, la pérennisation <strong>de</strong> l’activité agricole en préservant durablement l’intégrité<br />
<strong>de</strong>s exploitations présentes sur le territoire, et enfin l’essor du tourisme, en affirmant la vocation <strong>de</strong><br />
loisirs <strong>de</strong> Beaulieu.<br />
<strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron, par ses objectifs économiques, participe donc à la logique du Scot.<br />
<strong>Le</strong>s espaces et les sites naturels ou urbains à protéger<br />
Dotée d’un environnement naturel et urbain emblématique et à fort intérêt, le PLU <strong>de</strong> Couëron affirme la<br />
préservation et la valorisation <strong>de</strong> ces espaces remarquables, aussi bien pour protéger la biodiversité que<br />
pour offrir un cadre <strong>de</strong> vie agréable aux couëronnais.<br />
Ces objectifs sont affirmés par la protection <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s ligériennes tel les marais Audubon et par<br />
la valorisation du patrimoine industriel et rural couëronnais.<br />
<strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron décline les orientations du Scot en matière <strong>de</strong> protection et <strong>de</strong> préservation <strong>de</strong>s<br />
espaces naturels et <strong>de</strong>s vallées, <strong>de</strong>s paysages urbains, du patrimoine bâti et participe ainsi à la volonté du<br />
Scot d’offrir à chacun un cadre <strong>de</strong> vie agréable.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs relatifs à la protection <strong>de</strong>s paysages et à la mise en valeur <strong>de</strong>s entrées <strong>de</strong> ville<br />
<strong>Le</strong> Scot donne <strong>de</strong>s orientations pour :<br />
- protéger et valoriser les grands paysages et les sites emblématiques,<br />
- i<strong>de</strong>ntifier et protéger les paysages quotidiens,<br />
- valoriser les paysages <strong>de</strong>s entrées <strong>de</strong> ville et <strong>de</strong>s grands axes routiers.<br />
<strong>Le</strong> PLU <strong>de</strong> Couëron est compatible avec le Scot en ce sens qu’il souhaite :<br />
- préserver la qualité <strong>de</strong>s espaces naturels et renforcer la qualité <strong>de</strong>s paysages urbains et <strong>de</strong>s<br />
espaces publics,<br />
- favoriser la découverte <strong>de</strong>s paysages en renforçant les possibilités <strong>de</strong> circulations douces dans<br />
l’ensemble <strong>de</strong> la commune et en lien avec les communes limitrophes, en s’appuyant notamment<br />
sur le réseau <strong>de</strong> la Loire à vélo.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs relatifs à la prévention <strong>de</strong>s risques<br />
La commune <strong>de</strong> Couëron est concernée par le Plan <strong>de</strong>s Surfaces Submersibles <strong>de</strong> la Loire.<br />
En matière <strong>de</strong> risques technologiques, la DRIRE a recensé 6 installations classées soumises à autorisation<br />
sur la commune <strong>de</strong> Couëron . La Cellule Opérationnelle <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques a par ailleurs recensé 2<br />
établissements présentant <strong>de</strong>s dangers secondaires et aucun "établissement à risques" pour<br />
l’environnement humain (dangers principaux) sur le territoire.<br />
Couëron est en outre concernée par la dépollution <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> l’ancien site industriel Tréfimétaux.<br />
Ces contraintes sont prises en compte par le zonage du PLU.<br />
<br />
<strong>Le</strong> schéma départemental d'accueil <strong>de</strong>s gens du voyage, un arrêté préfectoral <strong>de</strong><br />
2002<br />
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 rend obligatoire en vue <strong>de</strong> la détermination <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> la<br />
<strong>local</strong>isation <strong>de</strong>s équipements nécessaires à l’accueil <strong>de</strong>s gens du voyage, la réalisation <strong>de</strong> schémas<br />
départementaux prenant en compte l’ensemble <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> la population noma<strong>de</strong>.<br />
179
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> PADD contribue par ses objectifs à la mise en œuvre du Plan départemental pour le logement <strong>de</strong>s<br />
personnes défavorisées <strong>de</strong> 2002 en cours <strong>de</strong> révision, et du Schéma départemental d’accueil <strong>de</strong>s gens du<br />
voyage, révisé en 2002 élaboré par le Syndicat Mixte pour l'hébergement <strong>de</strong>s gens du voyage.<br />
<br />
<strong>Le</strong> Schéma directeur d’aménagement et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s eaux (SDAGE)<br />
<strong>Le</strong> PADD s’inscrit également dans la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement et <strong>de</strong> Gestion<br />
<strong>de</strong>s Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, approuvé en 1996 et en cours <strong>de</strong> révision. Ce <strong>de</strong>rnier définit<br />
pour 15 ans, les objectifs <strong>de</strong> quantité et <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s eaux, les orientations <strong>de</strong> gestion et les<br />
aménagements nécessaires pour les atteindre. Concrètement, ce document <strong>de</strong> référence cadre<br />
l’intervention <strong>de</strong>s collectivités notamment dans le domaine <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s eaux et l’assainissement. <strong>Le</strong><br />
SDAGE Loire-Bretagne prévoit dans ses objectifs, le maintien <strong>de</strong> la qualité dans un certain nombre <strong>de</strong><br />
points nodaux dont fait partie Couëron. Il vise également à la préservation <strong>de</strong>s eaux souterraines, à la<br />
limitation <strong>de</strong>s risques d’inondation, à une bonne gestion <strong>de</strong>s eaux pluviales .... Il est relayé à un l’échelon<br />
<strong>local</strong> par le S.A.G.E. Estuaire <strong>de</strong> la Loire, actuellement en cours d’élaboration. <strong>Le</strong>s SAGE déjà approuvés<br />
exigent qu’un recensement et la protection <strong>de</strong>s sites tels que les cours d’eau et les zones humi<strong>de</strong>s soient<br />
assurés dans le cadre <strong>de</strong>s PLU. En outre, le SAGE fait <strong>de</strong> l’agriculture le levier principal pour assurer la<br />
protection <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> bord <strong>de</strong> Loire. <strong>Le</strong> PADD respecte ces principes <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s secteurs<br />
déjà inventoriés et souhaite conforter la présence <strong>de</strong> l’agriculture dans cette zone naturelle qui fait partie<br />
<strong>de</strong>s zones agricoles durables du territoire. Par ailleurs, le programme Neptune III <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong>s<br />
cours d’eau, conduit par la Communauté Urbaine, a précisément pour but d’atteindre les objectifs <strong>de</strong><br />
qualité qui ont été validés dans les programmes cités.<br />
En complément <strong>de</strong>s documents s’imposant, <strong>de</strong>s prescriptions nationales ou communautaires intéressent<br />
le territoire <strong>de</strong> Couëron. Il s’agit <strong>de</strong>s servitu<strong>de</strong>s d’utilité publique (télécommunications...).<br />
180
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
V- COMPATIIBIILIITE AVEC LA LOII ET SES PRIINCIIPES<br />
D’’EQUIILIIBRE,, DE DIIVERSIITE ET D’’UTIILIISATIION<br />
ECONOME DE L’’ESPACE ((ARTIICLE L 121-1 DU<br />
CODE DE L’’URBANIISME))<br />
<strong>Le</strong>s trois axes du PADD <strong>de</strong> Couëron répon<strong>de</strong>nt également aux objectifs fixés par la loi en matière <strong>de</strong><br />
développement durable (art. L110 et L 121.1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme), à savoir le respect <strong>de</strong>s principes<br />
d’équilibre, <strong>de</strong> diversité <strong>de</strong>s fonctions urbaines et <strong>de</strong> mixité sociale et le respect <strong>de</strong> l’environnement.<br />
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement <strong>de</strong><br />
l'espace rural, d'une part, et la préservation <strong>de</strong>s espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la<br />
protection <strong>de</strong>s espaces naturels et <strong>de</strong>s paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement<br />
durable.<br />
<strong>Le</strong> PADD <strong>de</strong> Couëron met en place, à l’échelle <strong>de</strong> la commune, une politique équilibrée entre<br />
renouvellement urbain, dans les centres et les tissus urbains existants et le développement <strong>de</strong><br />
l’urbanisation en extension.<br />
La consommation d'espace "naturel" est limitée par <strong>rapport</strong> à ce qui était déjà prévu dans le POS.<br />
L'ampleur <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong>s espaces naturels est maintenue, dans la mesure où les rives <strong>de</strong> Loire sont<br />
protégées, tout en permettant leur gestion par l’agriculture et que <strong>de</strong>s zones agricoles durables sont<br />
définies, garantissant une pérennité réelle aux exploitations agricoles. <strong>Le</strong> classement au titre <strong>de</strong>s ZNIEFF ,<br />
ZICO et Natura 2000 est repris dans le <strong>plan</strong> <strong>de</strong> zonage en tant que zones NNs (à l’exception <strong>de</strong>s terrains<br />
déjà urbanisés).<br />
2º La diversité <strong>de</strong>s fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en<br />
prévoyant <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans<br />
discrimination, <strong>de</strong>s besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment<br />
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en<br />
tenant compte en particulier <strong>de</strong> l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> transport et <strong>de</strong><br />
la gestion <strong>de</strong>s eaux.<br />
La diversité <strong>de</strong>s fonctions urbaines et la mixité sociale <strong>de</strong> l'habitat sont au cœur <strong>de</strong>s objectifs du PADD.<br />
Par les choix réalisés et leur application future dans les opérations d’aménagement, Couëron a pour<br />
ambition <strong>de</strong> renforcer la place <strong>de</strong>s logements locatifs <strong>de</strong> type groupé ou collectif. Pour ce faire, la<br />
commune souhaite avoir une maîtrise publique sur les opérations futures les plus importantes et<br />
encadrer leur développement par les orientations d’aménagement qui fixent pour chaque opération la<br />
réalisation d’un minimum <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong> logements sociaux. Par ailleurs, le PADD prévoit la réalisation<br />
d’équipements <strong>de</strong> proximité au sein <strong>de</strong>s quartiers d’habitat futur.<br />
3º Une utilisation économe et équilibrée <strong>de</strong>s espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise <strong>de</strong>s<br />
besoins <strong>de</strong> déplacement et <strong>de</strong> la circulation automobile, la préservation <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l'air, <strong>de</strong> l'eau, du sol<br />
et du sous-sol, <strong>de</strong>s écosystèmes, <strong>de</strong>s espaces verts, <strong>de</strong>s milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la<br />
réduction <strong>de</strong>s nuisances sonores, la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,<br />
la prévention <strong>de</strong>s risques naturels prévisibles, <strong>de</strong>s risques technologiques, <strong>de</strong>s pollutions et <strong>de</strong>s nuisances <strong>de</strong><br />
toute nature. » (Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme, article L-121.1)<br />
Chacun <strong>de</strong>s points énoncés en 3° se retrouve dans le PADD <strong>de</strong> Couëron. La plupart <strong>de</strong> ces préoccupations,<br />
qui constituent le socle d'une gestion durable <strong>de</strong> la ville, sont aujourd'hui prises en charge par la<br />
Communauté Urbaine, dans la mesure où c'est à l'échelle <strong>de</strong>s 24 communes que la réponse est la plus<br />
pertinente et la plus efficace : transports et déplacements avec le PDU et le schéma <strong>de</strong> transports<br />
collectifs pour 2010; politique <strong>de</strong> l'eau à travers le programme Neptune III ; les compétences<br />
d'assainissement; la prévention <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong>s nuisances ou leur réduction qui sont pour la plupart<br />
<strong>de</strong>s politiques partenariales avec les services <strong>de</strong> l'Etat (PPRI, PEB, rôle <strong>de</strong> la DRIRE dans la prévention <strong>de</strong>s<br />
sols pollués et <strong>de</strong>s risques industriels, etc.).<br />
<strong>Le</strong> PADD <strong>de</strong> Couëron met en place une protection renforcée, dans le cadre <strong>de</strong> la loi Paysage, du<br />
patrimoine bâti et du petit patrimoine remarquable ou intéressant.<br />
181
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
182
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
VII- LA POLIITIIQUE FONCIIERE<br />
Par délibération du 18 juin 2004, <strong>Nantes</strong> Métropole a mis en place une nouvelle politique foncière. Elle<br />
doit permettre <strong>de</strong> soutenir les gran<strong>de</strong>s orientations d’aménagement décidées notamment dans le<br />
Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat et traduites dans le Projet d’Aménagement et <strong>de</strong> Développement Durable.<br />
Cet objectif a nécessité <strong>de</strong> :<br />
- redéfinir les conditions d’interventions foncières propres <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole ;<br />
- réorienter le Programme d’Action Foncière pour les communes <strong>de</strong> façon à soutenir activement<br />
leurs interventions au titre <strong>de</strong> la mise en œuvre du Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat.<br />
1. Nouvelles interventions <strong>de</strong> la politique foncière<br />
<strong>Le</strong>s bilans effectués sur certains secteurs <strong>de</strong> compétence communautaire, notamment Développement<br />
Economique et Habitat, font apparaître la nécessité non seulement <strong>de</strong> poursuivre la maîtrise foncière<br />
précé<strong>de</strong>mment assurée par les communes, mais également d’amplifier la constitution <strong>de</strong> réserves<br />
foncières pour faire face à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> très importante notamment en matière <strong>de</strong> logement social.<br />
Il paraît donc nécessaire <strong>de</strong> développer une politique foncière plus conséquente, sur plusieurs secteurs<br />
d’interventions.<br />
2. Réserves foncières communautaires - Acquisition d'opportunités<br />
foncières au profit <strong>de</strong>s projets d'espaces publics, voirie et réseaux<br />
La plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s acquisitions nécessaires aux grands projets d’espaces publics, <strong>de</strong> réseaux<br />
(Transport Public notamment) et voirie font l’objet <strong>de</strong> procédures foncières opérationnelles.<br />
Il arrive cependant que <strong>de</strong>s opportunités se présentent (sous forme <strong>de</strong> Déclaration d’Intention d’Aliéner),<br />
pour lesquelles les projets ne sont pas encore lancés et qui nécessitent une prise en charge sous forme <strong>de</strong><br />
réserve foncière à court ou moyen terme, en attendant la réalisation <strong>de</strong>s opérations ; il convient donc <strong>de</strong><br />
conserver sur ces thématiques une capacité d’intervention foncière.<br />
3. Réserves foncières communautaires - Constitution d'espaces naturels à<br />
protéger et à valoriser<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la politique communautaire en faveur <strong>de</strong> la protection et la valorisation <strong>de</strong>s espaces<br />
naturels, les enjeux <strong>de</strong> maîtrise foncière sont estimés, dans les 10 ans à venir, à environ 50 ha/an, en vue<br />
principalement <strong>de</strong> la création <strong>de</strong> massifs <strong>de</strong> forêt péri-urbaine, mais aussi en vue <strong>de</strong> la maîtrise <strong>de</strong><br />
certains espaces naturels à protéger (Iles <strong>de</strong> Loire, …).<br />
Cette politique sera bien évi<strong>de</strong>mment à développer en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, la<br />
SAFER et le Conseil Général (subventions au titre <strong>de</strong> la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels<br />
Sensibles – T.D.E.N.S.).<br />
4. Réserves foncières communautaires - Constitution <strong>de</strong> réserves foncières<br />
à vocation économique<br />
<strong>Nantes</strong> Métropole a décidé, par délibération du Conseil du 11 octobre 2002, la prise en charge d’un certain<br />
nombre <strong>de</strong> sites d’activités économiques et le transfert à <strong>Nantes</strong> Métropole <strong>de</strong>s réserves foncières <strong>de</strong>s<br />
communes à finalité économique.<br />
Il existe ainsi un stock limité <strong>de</strong> surfaces disponibles à court, moyen et long terme, dont la surface<br />
cumulée est malgré tout faible au regard du constat d’une consommation annuelle supérieure à 50 ha.<br />
183
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Il importe donc que <strong>Nantes</strong> Métropole développe une politique foncière volontariste en vue <strong>de</strong> la création<br />
ou <strong>de</strong> l’extension <strong>de</strong> nouveaux sites, permettant <strong>de</strong> répondre à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s entreprises ; l’objectif<br />
quantitatif représente la mobilisation d’environ 25 ha/an, ces acquisitions <strong>de</strong>vant être réalisées sur <strong>de</strong>s<br />
secteurs définis dans les Plans Locaux d’Urbanisme en cours <strong>de</strong> révision et voués à l’aménagement <strong>de</strong><br />
zones d’activités.<br />
5. Politique foncière partenariale pour la mise en œuvre <strong>de</strong>s objectifs du<br />
Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat<br />
<strong>Le</strong>s objectifs du PLH impliquent <strong>de</strong> renforcer les moyens communautaires pour augmenter<br />
significativement le volume et le rythme <strong>de</strong> la production <strong>de</strong> logements et favoriser la mixité sociale et<br />
urbaine .<br />
En effet, les tendances actuelles du marché foncier constituent un frein à la production d'habitat, en<br />
particulier le logement social, notamment du fait <strong>de</strong> la très forte hausse <strong>de</strong>s coûts.<br />
Pour agir sur ce phénomène, le Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat (PLH) a proposé <strong>de</strong> développer une<br />
politique foncière volontariste établie sur <strong>de</strong>ux outils complémentaires : le Programme Action Foncière<br />
pour les Communes (PAF) et les réserves foncières communautaires, tenant compte aussi bien <strong>de</strong>s<br />
compétences <strong>de</strong>s Communes que <strong>de</strong> celles <strong>de</strong> la communauté urbaine.<br />
<strong>Le</strong> dispositif <strong>de</strong> portage foncier est le suivant :<br />
Nouveau Programme Action Foncière (P.A.F. - Habitat) pour les communes - Réserves foncières à moyen et<br />
long terme pour l’habitat<br />
Il est proposé <strong>de</strong> spécialiser le PAF en vue <strong>de</strong> faciliter le montage à terme <strong>de</strong>s opérations nouvelles<br />
d'habitat permettant <strong>de</strong> mettre en œuvre <strong>de</strong> façon volontariste les objectifs du PLH, dans le cadre<br />
d’initiatives communales menées en partenariat avec <strong>Nantes</strong> Métropole (actions 5 et 6 du PLH).<br />
L’objectif quantitatif représente la mobilisation d’environ 25 ha/an, ces acquisitions <strong>de</strong>vant être réalisées<br />
sur <strong>de</strong>s secteurs définis dans les PLU en cours <strong>de</strong> révision et voués à l’aménagement <strong>de</strong> zones d’habitat.<br />
Cette nouvelle politique <strong>de</strong> portage foncier pour le compte <strong>de</strong>s communes bénéficiera d’un engagement<br />
renforcé <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole dans les conditions suivantes :<br />
<br />
- le nouveau dispositif PAF-Habitat ne prendra en compte que les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s portant sur <strong>de</strong>s<br />
opérations d'habitat,<br />
- la durée maximum <strong>de</strong> portage sera étendue <strong>de</strong> 6 ans à 10 ans.<br />
Réserves foncières communautaires - Maîtrise d'opportunités foncières pour<br />
l'habitat social en milieu urbanisé<br />
Comme préconisé dans le Programme Local <strong>de</strong> l’Habitat, il importe <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong><br />
mobiliser <strong>de</strong>s opportunités foncières, dans certains milieux déjà urbanisés et i<strong>de</strong>ntifiés dans les PLU en<br />
cours <strong>de</strong> révision, afin d’y im<strong>plan</strong>ter <strong>de</strong> l’habitat social.<br />
Il est proposé que, après accord <strong>de</strong>s Communes concernées, <strong>Nantes</strong> Métropole porte les initiatives<br />
d’intervention en la matière (portage <strong>de</strong> la réserve foncière, relations avec les opérateurs pour le<br />
montage et le financement <strong>de</strong>s opérations).<br />
L'intervention communautaire se fera sur les dossiers présentant les caractéristiques<br />
suivantes :<br />
- acquisitions d'opportunité en milieu urbain, notamment sur <strong>de</strong>s secteurs i<strong>de</strong>ntifiés dans les PLU,<br />
- pour <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> petite taille (moins <strong>de</strong> 80 logements), majoritairement <strong>de</strong>stinées pour <strong>de</strong>s<br />
logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLA-I),<br />
- portage foncier relativement court : 2 à 4 ans maximum (durée du portage opérationnel).<br />
184
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
L'objectif d’intervention en la matière représente une capacité <strong>de</strong> création <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 25.000 m²<br />
SHON/an, soit l'équivalent d'une production <strong>de</strong> 350 logements/an.<br />
L'ensemble <strong>de</strong>s dotations à affecter à cette nouvelle politique foncière représente un volume financier<br />
global <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 11 M euros/an dont 2,5 M euros affectés au PAF Communes et 8,5 M euros affectés<br />
aux réserves foncières communautaires (tous secteurs inclus) ; cette mise <strong>de</strong> fond sera logiquement<br />
partiellement reconstituée dans le temps par les cessions correspondantes, et peut bénéficier d’un<br />
soutien <strong>de</strong> l’Etat au titre du Contrat Etat-Région en cours.<br />
Cette politique pourrait à moyen terme s'inscrire dans la perspective <strong>de</strong> développement d'un outil dédié<br />
tel qu'un établissement public foncier <strong>local</strong> à développer à une échelle appropriée intégrant au moins le<br />
SCOT métropolitain et l'aire urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> et répondant notamment aux enjeux <strong>de</strong> régulation<br />
foncière sur les territoires voisins <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole ; une telle démarche a vocation à se développer<br />
<strong>de</strong> façon partenariale avec la Région et le Département.<br />
6. <strong>Le</strong>s instruments du droit <strong>de</strong> préemption<br />
<strong>Le</strong> droit <strong>de</strong> préemption est un instrument d’intervention publique ayant un double but : maîtriser le<br />
foncier et lutter contre la pression foncière dans le respect <strong>de</strong>s enjeux d’aménagement.<br />
<strong>Le</strong> droit <strong>de</strong> préemption urbain constitue l’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux faces <strong>de</strong> l’intervention foncière urbaine <strong>de</strong>s<br />
collectivités publiques, la secon<strong>de</strong> étant le droit <strong>de</strong> préemption dans les zones d’aménagement différé. La<br />
frontière entre ces <strong>de</strong>ux instruments est stabilisée <strong>de</strong>puis 1991, le droit <strong>de</strong> préemption urbain étant<br />
<strong>de</strong>venu l’outil privilégié d’intervention <strong>de</strong>s communes.<br />
<br />
<strong>Le</strong> droit <strong>de</strong> préemption urbain<br />
En vertu <strong>de</strong>s articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et s. du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme, « <strong>Le</strong>s communes dotées d'un<br />
<strong>plan</strong> d'occupation <strong>de</strong>s sols rendu public ou d'un <strong>plan</strong> <strong>local</strong> <strong>d'urbanisme</strong> approuvé peuvent, par délibération,<br />
instituer un droit <strong>de</strong> préemption urbain sur tout ou partie <strong>de</strong>s zones urbaines et <strong>de</strong>s zones d'urbanisation<br />
future délimitées par ce <strong>plan</strong> ainsi que sur tout ou partie <strong>de</strong> leur territoire couvert par un <strong>plan</strong> <strong>de</strong><br />
sauvegar<strong>de</strong> et <strong>de</strong> mise en valeur rendu public ou approuvé en application <strong>de</strong> l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas<br />
été créé <strong>de</strong> zone d'aménagement différé ou <strong>de</strong> périmètre provisoire <strong>de</strong> zone d'aménagement différé sur ces<br />
territoires… »<br />
La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 a fait du droit <strong>de</strong> préemption un outil permettant d’une<br />
part <strong>de</strong> limiter l’urbanisation <strong>de</strong>s zones soumises à un risque technologique et d’autre part <strong>de</strong> faciliter la<br />
création <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> rétentions temporaires <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> crue ou <strong>de</strong> ruissellement. Ce même texte a<br />
complété l’article L.211-1 par un second alinéa ouvrant un droit <strong>de</strong> préemption aux communes disposant<br />
d’une carte communale.<br />
Dans le cadre du P.O.S., la municipalité avait institué le droit <strong>de</strong> préemption urbain sur ses zones urbaines<br />
« U » et ses zones à urbaniser « NA ».<br />
Depuis 2001, la communauté urbaine <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> est titulaire <strong>de</strong> ce droit <strong>de</strong> préemption. Un droit <strong>de</strong><br />
préemption urbain existe sur le territoire urbanisé ou à urbaniser <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> La Chapelle-sur-Erdre. Il<br />
est confirmé et étendu sur les nouvelles zones U et AU dans le cadre du PLU révisé.<br />
<br />
La Zone d’Aménagement Différé (Z.A.D.)<br />
<strong>Le</strong> droit <strong>de</strong> préemption dans les Z.A.D. a été entièrement renouvelé en 1985. Celui-ci ne pouvait plus<br />
s’exercer que dans les communes non dotées d’un <strong>plan</strong> d’occupation <strong>de</strong>s sols approuvé. Suite à une<br />
remise en cause, l’utilisation <strong>de</strong> cet instrument a été revue. Depuis 1991, l’Etat peut désormais créer <strong>de</strong>s<br />
zones d’aménagement différé sur l’ensemble du territoire sans distinction entre les communes. Ces<br />
zones ouvrent un droit <strong>de</strong> préemption qui conserve un aspect « pré-opérationnel » qui prévaut sur le<br />
droit <strong>de</strong> préemption urbain.<br />
En application <strong>de</strong>s articles L. 212-1 et s, et R.212-1 et suivants, du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme, il est précisé « Des<br />
zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant <strong>de</strong> l'Etat dans le<br />
département, sur proposition ou après avis <strong>de</strong> la commune ou <strong>de</strong> l'établissement public <strong>de</strong> coopération<br />
185
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa <strong>de</strong> l'article L. 211-2. <strong>Le</strong>s zones urbaines ou<br />
d'urbanisation future délimitées par un <strong>plan</strong> d'occupation <strong>de</strong>s sols rendu public ou un <strong>plan</strong> <strong>local</strong><br />
<strong>d'urbanisme</strong> approuvé et comprises dans un périmètre provisoire <strong>de</strong> zone d'aménagement différé ou dans<br />
une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit <strong>de</strong> préemption urbain institué sur ces<br />
territoires. En cas d'avis défavorable <strong>de</strong> la commune ou <strong>de</strong> l'établissement public compétent, la zone<br />
d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat. »<br />
Dans les ZAD, un droit <strong>de</strong> préemption peut être exercé pendant une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> quatorze ans à compter<br />
<strong>de</strong> la publication <strong>de</strong> l'acte qui a créé la zone, sous réserve <strong>de</strong> ce qui est dit à l'article L. 212-2-1. Ce droit est<br />
ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société<br />
d'économie mixte répondant aux conditions définies au <strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong> l'article L. 300-4 et<br />
bénéficiant d'une convention publique d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit<br />
<strong>de</strong> préemption.<br />
La révision générale <strong>de</strong>s PLU <strong>de</strong> l’agglomération et l’élaboration du SCOT métropolitain <strong>Nantes</strong>- Saint<br />
Nazaire ont pour ambition notamment :<br />
- d’assurer un développement urbain maîtrisé du territoire,<br />
- en respectant les principes du développement durable définis par l’Agenda 21,<br />
- tout en prévoyant <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> renouvellement urbain suffisantes pour<br />
satisfaire les besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques,<br />
d’équipements publics et d’espaces naturels et <strong>de</strong> loisirs.<br />
Pour répondre à ces objectifs, <strong>Nantes</strong> Métropole exerce <strong>de</strong> plein droit la compétence « constitution <strong>de</strong><br />
réserves foncières d’intérêt communautaire », après avis <strong>de</strong>s conseils municipaux. Par délibération du 21<br />
juin 2002, le Conseil Communautaire a décidé <strong>de</strong> reconnaître d’intérêt communautaire les réserves<br />
foncières constituées en vue <strong>de</strong> la réalisation d’une action ou opération d’aménagement, définies à<br />
l’article L300.1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme et s’inscrivant dans les compétences exercées par <strong>Nantes</strong><br />
Métropole. <strong>Le</strong>s Conseils Municipaux <strong>de</strong>s 24 communes <strong>de</strong> l’agglomération ont confirmé cette définition<br />
<strong>de</strong> la compétence communautaire.<br />
<strong>Le</strong>s bilans effectués sur certains secteurs <strong>de</strong> compétence communautaire, notamment développement<br />
économique et habitat font apparaître la nécessité d’amplifier la constitution <strong>de</strong> réserves foncières pour<br />
faire face à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> très importante. Par délibération du 18 juin 2004, le Conseil Communautaire a<br />
donc approuvé les grands axes <strong>de</strong> la politique foncière <strong>de</strong> l’agglomération portant principalement sur :<br />
- la création <strong>de</strong> réserves foncières pour l’habitat, à moyen et long terme, à travers le « nouveau<br />
programme d’action foncière habitat », pour la mise en œuvre <strong>de</strong>s objectifs du Programme <strong>local</strong> <strong>de</strong><br />
l’habitat. L’objectif quantitatif représente la mobilisation annuelle d’environ 25 ha, « afin d’augmenter<br />
significativement le volume et le rythme <strong>de</strong> production <strong>de</strong> logements et favoriser la mixité sociale et<br />
urbaine ».<br />
- la constitution <strong>de</strong> réserves foncières à vocation économique, en création ou par l’extension <strong>de</strong> nouveaux<br />
sites, permettant <strong>de</strong> répondre à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s entreprises. L’objectif est également fixé à environ 25 ha<br />
par an,<br />
- la constitution d’espaces naturels à protéger et à valoriser, en vue principalement <strong>de</strong> maîtriser<br />
l’étalement urbain, <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s massifs <strong>de</strong> forêt périurbaine et aussi <strong>de</strong> maîtriser certains espaces<br />
naturels à protéger (Iles <strong>de</strong> Loire…). L’objectif fixé est <strong>de</strong> 50 hectares par an.<br />
<strong>Le</strong>s ZAD peuvent être créées sur l’ensemble du territoire, quel que soit le zonage du PLU. La création d’une<br />
telle zone doit être motivée soit par la constitution <strong>de</strong> réserves foncières, soit pour lutter contre la<br />
spéculation foncière ou encore afin <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s actions ou opérations d’aménagement.<br />
Au sein <strong>de</strong>s PLU <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole, <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> zones peuvent constituer <strong>de</strong>s réserves foncières à<br />
long terme, il s’agit :<br />
- <strong>de</strong>s zones d’urbanisation future (2AU sur environ 1 130 hectares sur le territoire<br />
communautaire), <strong>de</strong>stinées à recevoir <strong>de</strong> l’habitat et/ou <strong>de</strong>s activités économiques mais<br />
inconstructibles en l’état, dans la mesure où les réseaux existants à leur périphérie immédiate<br />
sont inexistants ou insuffisants pour <strong>de</strong>sservir <strong>de</strong>s constructions. <strong>Le</strong>ur urbanisation suppose la<br />
mise en œuvre d’une procédure <strong>de</strong> modification.<br />
186
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
<strong>Le</strong> Droit <strong>de</strong> Préemption Urbain y est en vigueur mais la mise en place d’une ZAD présente différents<br />
avantages. Elle permet <strong>de</strong> se référer aux motivations générales <strong>de</strong> la ZAD , et notamment (selon la<br />
jurispru<strong>de</strong>nce actuelle), <strong>de</strong> préempter pour s’opposer à la spéculation foncière alors que sous le régime<br />
du DPU, chaque préemption doit être motivée spécifiquement et faire référence à une étu<strong>de</strong><br />
d’aménagement validée.<br />
- <strong>de</strong>s zones agricoles non pérennes (zones NX sur environ 910 hectares <strong>de</strong> l’agglomération) :<br />
espaces actuellement agricoles dans lesquels la pérennité <strong>de</strong> l’activité n’est pas assurée au-<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> la prochaine révision du PLU et ce pour différentes raisons (urbanisation proche,<br />
morcellement, projet d’infrastructures etc.). …). La préemption n’y est aujourd’hui possible que<br />
par la biais <strong>de</strong>s SAFER.<br />
Ces espaces constituent logiquement <strong>de</strong>s réserves foncières à long terme pour les futures extensions<br />
urbaines ou pour l’application <strong>de</strong> politiques d’interface avec les espaces naturels ou pour un maintien<br />
d’une agriculture pérenne. Il importe qu’à ce titre, elles soient maîtrisées par la collectivité.<br />
Afin <strong>de</strong> constituer <strong>de</strong>s réserves foncières pour <strong>de</strong> futures opérations d’intérêt général, tant dans le<br />
domaine économique que dans le domaine <strong>de</strong> l’habitat, l’instauration <strong>de</strong> ZAD sur les zones 2AU est à<br />
l’étu<strong>de</strong>.<br />
187
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
188
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Chapitre IV-<br />
Justification du zonage et du règlement<br />
189
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
190
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
191
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
192
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
II- BIILAN DU POS ACTUEL<br />
<strong>Le</strong> Plan d’Occupation <strong>de</strong>s Sols <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Couëron a été approuvé par délibération du Conseil<br />
municipal du 11 décembre 2000. Depuis, le POS a évolué au travers <strong>de</strong> diverses procédures :<br />
- une mise à jour du PLU le 24 février 2003 ;<br />
- une révision simplifiée approuvée le 16 décembre 2005 pour permettre l’aménagement du parc<br />
d’activités <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron 3 ;<br />
- une mise en compatibilité suite à l’arrêté <strong>de</strong> Déclaration d’utilité publique permettant la<br />
réalisation <strong>de</strong> la ZAC ouest centre-ville le 7 décembre 2005 ;<br />
- une mise en compatibilité suite à l’arrêté <strong>de</strong> Déclaration d’utilité publique permettant la<br />
réalisation <strong>de</strong> la ZAC <strong>de</strong> la Métairie le 7 décembre 2005.<br />
1. <strong>Le</strong>s zones urbaines à vocation d’habitat<br />
<strong>Le</strong> POS découpe les zones d’habitat en trois types : UA pour le centre-ville, UB pour les extensions du<br />
bourg ancien, UC pour les villages.<br />
<strong>Le</strong> découpage <strong>de</strong>s zones urbaines correspond aux différents tissus urbains. La zone UA du POS<br />
correspond au centre-ville <strong>de</strong> Couëron. <strong>Le</strong>s dispositions <strong>de</strong> cette zone ont pour vocation <strong>de</strong> maintenir le<br />
rôle multifonctionnel du centre et <strong>de</strong> conserver ses caractéristiques urbaines. Cette zone n’a pas <strong>de</strong><br />
surface minimale. <strong>Le</strong>s règles d’im<strong>plan</strong>tation visent à favoriser la préservation <strong>de</strong>s fronts bâti, par un<br />
alignement le long <strong>de</strong>s voies et emprises publiques et une im<strong>plan</strong>tation en continuité <strong>de</strong>s constructions<br />
existantes. La hauteur <strong>de</strong>s constructions ne peut excé<strong>de</strong>r 12 mètres à l’égout et 15 mètres au faîtage.<br />
Enfin, seule la règle d’im<strong>plan</strong>tation par <strong>rapport</strong> aux limites séparatives latérales distingue les<br />
constructions en ban<strong>de</strong> constructible principale et secondaire : en ban<strong>de</strong> constructible secondaire, les<br />
constructions doivent être im<strong>plan</strong>tées en retrait <strong>de</strong> toutes les limites séparatives pour ne pas générer <strong>de</strong>s<br />
vues directes.<br />
Ces dispositions <strong>de</strong> la zone UA ont donné <strong>de</strong>s résultats satisfaisants. Seules les hauteurs mériteraient<br />
d’être modulées en fonction <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong> la construction en ban<strong>de</strong> constructible principale ou<br />
secondaire, <strong>de</strong> façon à construire moins haut dans les fonds <strong>de</strong> parcelle, afin <strong>de</strong> limiter les vues sur le<br />
voisinage.<br />
La zone UB , à dominante d’habitat, regroupe les quartiers périphériques du centre-ville et <strong>de</strong> la<br />
Chabossière correspondant aux extensions urbaines récentes et ayant une fonction <strong>de</strong> mixité : habitat<br />
individuel et collectif, équipements publics, activités économiques compatibles avec la vie <strong>de</strong> quartier.<br />
Cette zone comprend 4 secteurs : le secteur UBa qui regroupe les quartiers ayant une vocation <strong>de</strong> mixité,<br />
le secteur UBb qui concerne essentiellement les quartiers d’habitat pavillonnaire, le secteur Ube qui<br />
rassemble les équipements scolaires, socio-culturels et <strong>de</strong> loisirs, et le secteur UBc qui correspond au<br />
secteur <strong>de</strong> Bel Air.<br />
La surface minimale pour construire en cas <strong>de</strong> division est <strong>de</strong> 250 m² en secteur UBa et 300 m² en secteur<br />
UBb. D’autre part, le COS est différencié selon les secteurs. Dans le secteur UBa, le COS est fixé à 0.6. En<br />
secteur UBb, le COS est égal à 0.50. Dans les secteurs UBe et UBc, le COS n’est pas réglementé.<br />
La zone UC correspond au quartier du Port Launay et au hameau <strong>de</strong> la Bazillière. <strong>Le</strong>s règles<br />
d’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions y sont quasiment i<strong>de</strong>ntiques à celles du secteur UBb. La hauteur au<br />
faîtage est limitée à 10 mètres, la surface minimale est <strong>de</strong> 500 m², l’ emprise au sol est limitée à 40% <strong>de</strong><br />
la superficie du terrain d’assiette du projet et il n’y a pas <strong>de</strong> COS.<br />
<strong>Le</strong>s règles <strong>de</strong>s zones UB et UC ont permis d’encadrer la construction en second ri<strong>de</strong>au. Toutefois,<br />
reposant essentiellement sur le COS et une surface minimale <strong>de</strong> terrain, leur application mathématique<br />
ne permet pas une gestion plus souple <strong>de</strong>s tissus urbains. La constructibilité <strong>de</strong> certaines parcelles est<br />
bloquée du fait <strong>de</strong> leur configuration. Ainsi, ces règles freinent parfois le renouvellement urbain qui<br />
pourrait pourtant se faire tout en préservant le voisinage.<br />
193
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
2. <strong>Le</strong> potentiel d’accueil et la <strong>local</strong>isation <strong>de</strong>s zones d’activités<br />
<strong>Le</strong>s zones d’activités sont <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux types : la zone UE <strong>de</strong>stinée à accueillir <strong>de</strong>s activités économiques et la<br />
zone UG qui accueille les activités industrielles lour<strong>de</strong>s peu compatibles avec un environnement<br />
rési<strong>de</strong>ntiel.<br />
La zone UE est composée du secteur UE1, qui correspond à la zone d’activités <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron.<br />
La zone UG est principalement affectée aux activités autrefois liées à la proximité <strong>de</strong> la Loire et plus<br />
particulièrement aux activités <strong>de</strong> la filière métallurgique ou <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s déchets.<br />
<strong>Le</strong>s dispositions règlementaires <strong>de</strong> ces zones ont donné <strong>de</strong>s résultats satisfaisants.<br />
3. <strong>Le</strong>s zones d’extension <strong>de</strong> l’urbanisation<br />
<strong>Le</strong>s zones d’urbanisation futures sont <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux types : NA strictes non constructibles dans l’état et NA<br />
constructibles ouvertes à l’urbanisation.<br />
<strong>Le</strong> POS comptait 5 zones classées en secteur NAa, zones d’urbanisations futures <strong>de</strong>stinées à l’habitat<br />
fermées à l’urbanisation. Etaient concernées les zones <strong>de</strong> la Sinière, du Bois Laurent, <strong>de</strong> la rue <strong>de</strong><br />
Bretagne, <strong>de</strong> la Métairie et <strong>de</strong> Ouest centre-ville. Ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières ont été ouvertes à l’urbanisation<br />
dans le cadre <strong>de</strong> DUP emportant mise en compatibilité du PLU prononcée le 7 décembre 2006.<br />
La zone NAae <strong>de</strong>stinée à accueillir <strong>de</strong>s activités économiques et fermée à l’urbanisation est situé au nord<br />
<strong>de</strong> la Croix Giciquau.<br />
<strong>Le</strong>s zones NA ouvertes à l’urbanisation sont <strong>de</strong> cinq types,celles affectées à l’habitat (NAb), celles<br />
affectées aux activités économiques (NAe et NAg), celles affectées aux activités <strong>de</strong> loisir (NAL) et celles<br />
affectées aux activités touristiques (NAt).<br />
4. Articulation entre zones agricoles et naturelles<br />
<strong>Le</strong>s zones agricoles et naturelles couvrent près <strong>de</strong> 76 % du territoire.<br />
La zone NC correspond aux espaces protégés en raison <strong>de</strong> la richesse <strong>de</strong> leur sol au regard <strong>de</strong> l’activité<br />
agricole.<br />
L’habitat isolé, disséminé dans le territoire, ne fait l’objet d’aucun zonage spécifique (hormis les<br />
hameaux classés en zone NB), ce qui est désormais incompatible avec le classement en zone agricole.<br />
La zone ND comprend quatre secteurs : NDa, NDc, NDca et NDL. <strong>Le</strong> secteur NDa correspond aux secteurs<br />
naturels sensibles et à protéger ; le secteur NDc couvre les zones naturelles <strong>de</strong>stinées à accueillir <strong>de</strong>s<br />
activités sportives, culturelles et <strong>de</strong> loisirs; le secteur NDca est <strong>de</strong>stiné à l’aménagement d’une aire<br />
d’accueil pour les gens du voyage ; enfin,le secteur NDL couvre le secteur <strong>de</strong> Beaulieu.<br />
<strong>Le</strong>s zones NC couvrent ainsi 39,8 % du territoire communal et les zones ND 36,1 %.<br />
194
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
IIII- LES PRIINCIIPALES EVOLUTIIONS DU POS AU PLU<br />
1. Présentation <strong>de</strong> la nouvelle typologie <strong>de</strong>s zones et correspondance du<br />
POS au PLU<br />
Si les PLU sont élaborés à l’échelle <strong>de</strong> chaque commune, une harmonisation <strong>de</strong>s zonages et <strong>de</strong>s<br />
règlements est mise en œuvre, par <strong>Nantes</strong> Métropole, à l’occasion <strong>de</strong> la révision <strong>de</strong>s 24 PLU.<br />
Ce point vise à présenter la typologie <strong>de</strong>s nouvelles zones et leur correspondance avec le POS <strong>de</strong> Couëron.<br />
195
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Proposition d’une nouvelle typologie <strong>de</strong> zones en<br />
adéquation avec les lois SRU et UH<br />
Correspondance avec les zonages actuels du POS<br />
2000 <strong>de</strong> Couëron<br />
Evolution <strong>de</strong>s surfaces<br />
POS<br />
PLU<br />
LES ZONES URBAINES<br />
UA<br />
Zone UA : zone urbaine <strong>de</strong>nse <strong>de</strong> centre-ville ou dce<br />
centre <strong>de</strong> quartier. A Couëron, <strong>de</strong>ux zones UA (une<br />
pour le centre-ville et une pour la Chabossière) sont<br />
inscrites dans le PLU.<br />
La zone UA du centre-ville est composée d’un secteur<br />
Secteur UAp : secteur patrimonial correspondant au<br />
bourg ancien et regroupant les activités urbaines.<br />
Actuelle zone UA du centre-ville et ancienne zone UBb<br />
pour la Chabossière , l’objectif étant le renforcement<br />
du centre-ville et du centre ancien <strong>de</strong> la Chabossière.<br />
<strong>Le</strong> secteur UAp est créé afin <strong>de</strong> prendre en compte les<br />
spécificités urbaines et architecturales du bourg<br />
ancien et d’adapter la réglementation <strong>de</strong> la zone UAp<br />
au caractère <strong>de</strong>nse et ancien du tissu urbain.<br />
UA – 25 ha<br />
UA – 32,5 ha<br />
Dont<br />
UAp – 7,5 ha<br />
196
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Zone UB : Zone mixte à dominante d’habitat<br />
correspondant à <strong>de</strong> l’habitat et à <strong>de</strong>s activités<br />
urbaines.<br />
Actuelles zones UB et NAb découpées en UBa et UBb<br />
<strong>de</strong> la façon suivante :<br />
- maintien du secteur UBa pour favoriser la mixité<br />
<strong>de</strong>s formes urbaines autour du centre-ville<br />
UB : 402 ha<br />
UB – 454,5 ha<br />
dont<br />
UBa – 37,5 ha<br />
Secteur UBa : zone mixte permettant l’accueil<br />
d’opérations d’habitat intermédiaire ou collectif à<br />
proximité <strong>de</strong>s centres et équipements publics.<br />
- intégration <strong>de</strong>s zones UBe<br />
- intégration <strong>de</strong>s zones NAb construites<br />
UBb – 388 ha<br />
UBp- 29 ha<br />
UB<br />
Secteur UBb : zones d’extensions pavillonnaires<br />
Secteur UBp : secteurs où le tissu urbain est déjà<br />
fortement constitué et qui représente un caractère<br />
patrimonial<br />
Actuelle zone UBb<br />
<strong>Le</strong>s secteurs UBp étaient classés dans le POS en Ubb<br />
ou UC (Port Launay).<br />
197
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
UP<br />
Zone UP : zone <strong>de</strong> projet à vocation d’habitat et<br />
d’activités urbaines<br />
Correspond aux ZAC Ouest centre-ville (UPo),<br />
Métairie (UPm) et Rives <strong>de</strong> Loire (UPl)<br />
La zone UPo est divisée en quatre secteurs UPo1<br />
(secteurd’habitat à dominante collectif), UPo2<br />
(secteur d’habitat à dominante <strong>de</strong> maisons groupées),<br />
UPo3 (équipements publics dans un cadre paysager)<br />
et Upo4 (îlot d’habitat existant).<br />
La zone UPm est divisée en trois secteurs : UPm1<br />
(habitat à dominante collectif), UPm2 (habitat<br />
groupé et individuel) et UPm3 (dominante d’habitat<br />
individuel et espaces paysagers).<br />
Périmètre <strong>de</strong><br />
ZAC :<br />
UP – 99 ha<br />
dont<br />
UPo – 67 ha<br />
UPl – 7,5 ha<br />
UPm- 24,5 ha<br />
La zone UPlh est divisée en 3 secteurs : UPlh1 (secteur<br />
d’habitat collectif pouvant recevoir <strong>de</strong>s commerces et<br />
<strong>de</strong>s services), UPlh2 (secteur d’habitat intermédiaire)<br />
et UPlh3 (secteur d’habitat groupé ou individuel).<br />
198
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
LES ZONES URBAINES<br />
UC<br />
Zone UC : Zone <strong>de</strong>s hameaux et écarts situés dans les<br />
espaces ruraux.<br />
Secteur UCb : secteur correspondant au hameau <strong>de</strong><br />
Brimberne<br />
<strong>Le</strong>s zones UC reprennent le zonage <strong>de</strong>s zones UC et<br />
NB du POS<br />
<strong>Le</strong> secteur UCb correspond à une ancienne zone NB,<br />
dont la <strong>de</strong>nsification n’est plus souhaitée.<br />
UC – 41 ha<br />
NB – 33 ha<br />
UC – 45 ha<br />
Dont<br />
UCb – 13,5 ha<br />
Secteur UCv : secteur correspondant au terrain<br />
d’accueil <strong>de</strong>s gens du voyage<br />
<strong>Le</strong> secteur UCv était classé en NDc dans le POS<br />
UCv – 0,8 ha<br />
UE<br />
Zone UE : Zone d’accueil <strong>de</strong>s activités économiques <strong>de</strong><br />
toute nature, à l’exception <strong>de</strong> certaines installations<br />
classées nuisantes pour leur environnement<br />
rési<strong>de</strong>ntiel.<br />
Zones correspondantes :<br />
- UE<br />
- NAe etNAae<br />
UE – 84 ha<br />
UE – 185 ha<br />
dont<br />
UEa – 80 ha<br />
UG<br />
Zone UG : Zone d'accueil <strong>de</strong>s activités économiques <strong>de</strong><br />
toute nature, à l'exception <strong>de</strong>s bureaux et commerces<br />
non liés aux activités autorisées.<br />
Actuelle zone UG et NAg<br />
UG – 41 ha<br />
UG – 89 ha<br />
dont<br />
Secteur UGc : secteur d’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s carrières en<br />
activité.<br />
Carrière <strong>de</strong>s Daudières<br />
UGc – 16 ha<br />
UM<br />
Zone UM : Zone <strong>de</strong>stinée à accueillir les grands<br />
équipements publics ou d’intérêt collectif dont les<br />
emprises foncières sont vastes.<br />
Actuelle zone NAL du vélodrome<br />
Actuelle zone NDC et NC (Maison d’accueil<br />
spécialisée)<br />
/ UM – 1 1 ha<br />
199
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
LES ZONES A URBANISER<br />
Zone 1AU : Zone à urbaniser dont le règlement et<br />
les orientations d’aménagement définissent les<br />
modalités <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong> leurs équipements<br />
internes.<br />
La zone 1 AU correspon<strong>de</strong>nt à une ancienne zone NAb.<br />
NAb – 17 ha<br />
NAe et NAg<br />
1 AUb – 1,2ha<br />
1AUe – 10,5 ha<br />
1AU<br />
Secteur 1AUb : zone d’habitat à dominante<br />
pavillonnaire<br />
<strong>Le</strong>s zones 1 AUe correspon<strong>de</strong>nt à la Lan<strong>de</strong> Bourne et à<br />
la Barrière Noire classées NAe dans le POS.<br />
84 ha<br />
Secteur 1AUe : dédié aux activités économiques <strong>de</strong><br />
toute nature, à l’exception <strong>de</strong> certaines<br />
installations classées nuisantes pour leur<br />
environnement rési<strong>de</strong>ntiel.<br />
2AU<br />
Zone 2AU : zone à urbaniser, pour laquelle une<br />
procédure <strong>de</strong> modification ou <strong>de</strong> révision du PLU<br />
sera nécessaire pour permettre son ouverture à<br />
l’urbanisation. Elle est inconstructible dans cette<br />
attente.<br />
<strong>Le</strong> POS distinguait zones NA fermées pour l’habitat et<br />
zones NA fermées pour les activités économiques<br />
futures, les activités <strong>de</strong> loisirs futures . Désormais une<br />
seule zone 2AU est délimitée sur ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong><br />
zones ; c’est le PADD qui affiche leur vocation.<br />
NA stricte<br />
NAa – 145 ha<br />
2 AU – 17 ha<br />
200
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
LA ZONE AGRICOLE<br />
Zone A : zone <strong>de</strong> protection durable <strong>de</strong>s activités<br />
agricoles.<br />
NC<br />
NC – 1903<br />
ha<br />
A - 1746 ha<br />
Seules y sont autorisées les constructions et<br />
installations nécessaires à l'exploitation agricole et<br />
aux services publics ou d'intérêt collectif.<br />
<strong>Le</strong>s modifications suivantes sont apportées à<br />
l’actuelle zone NC :<br />
A<br />
- <strong>de</strong>s réductions dues aux extensions urbaines<br />
citées ci-<strong>de</strong>ssus ;<br />
- <strong>de</strong>s réductions liées à la création du<br />
pastillage NH pour les habitations non liées<br />
à un logement <strong>de</strong> fonction d’agriculteurs.<br />
La zone A est aussi modifiée au nord <strong>de</strong> la commune<br />
du fait du projet <strong>de</strong> forêt urbaine.<br />
201
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
LES ZONES NATURELLES<br />
Ces zones doivent en principe être inconstructibles, à la seule exception <strong>de</strong> secteurs <strong>de</strong> taille et <strong>de</strong> capacité d'accueil limitées.<br />
Zone NN : zone <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s espaces naturels<br />
pour leur qualité biologique ou paysagère ou la<br />
préservation du cadre <strong>de</strong> vie tel qu’en ceinture verte<br />
autour du bourg.<br />
La zone NN correspond à la partie la « moins »<br />
sensible <strong>de</strong> la zone NDa.<br />
NDa– 1749<br />
ha<br />
NN – 1630 ha<br />
Dont<br />
NNs –1378 ha<br />
NN<br />
Secteur NNs : Milieux sensibles d’intérêt<br />
écologique, tout aménagement et construction y<br />
est interdit à l’exception <strong>de</strong> ceux liés à la<br />
fréquentation du public et <strong>de</strong> ceux strictement<br />
nécessaires au pâturage et à la gestion <strong>de</strong>s prairies<br />
humi<strong>de</strong>s (constructions légères limitées à 20 m² <strong>de</strong><br />
SHOB pour 20 hectares exploités).<br />
La zone NNs reprend la zone NDa du marais<br />
Audubon, <strong>de</strong> l’étier <strong>de</strong> Beaulieu et <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s<br />
associées, <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Pâtissière et <strong>de</strong> la Chézine.<br />
L’île <strong>de</strong> la Liberté est aussi classée en NNs.<br />
NNf – 101 ha<br />
Secteur NNf : secteur voué au boisement au sein du<br />
périmètre <strong>de</strong> Forêt urbaine.<br />
Un secteur NNf est créé au sein du périmètre <strong>de</strong> forêt<br />
urbaine sur <strong>de</strong>s terrains classés NC et NDa au POS.<br />
NE<br />
Zone NE : one correspondant aux espaces en eau <strong>de</strong><br />
la Loire.<br />
Il s’agit d’un nouveau secteur créé en remplacement<br />
<strong>de</strong>s zones NDa et NDc sur la Loire<br />
/ NE – 236 ha<br />
202
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
LES ZONES NATURELLES<br />
Ces zones doivent en principe être inconstructibles, à la seule exception <strong>de</strong> secteurs <strong>de</strong> taille et <strong>de</strong> capacité d'accueil limitées.<br />
NH<br />
Zone NH : zone correspondant à <strong>de</strong>s espaces déjà<br />
bâtis isolés au sein d’une zone naturelle ou agricole.<br />
Il s’agit <strong>de</strong> secteurs <strong>de</strong> taille et <strong>de</strong> capacité d'accueil<br />
limitées où une constructibilité est autorisée<br />
(extension <strong>de</strong> l’existant, annexe, changement <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stination …).<br />
Constructions à usage d’habitation et d’activités<br />
isolées dans l’espace naturel et rural auparavant<br />
classées en N. <strong>Le</strong> chantier naval Fouchard délimité en<br />
NDa <strong>de</strong>vient du NH pour autoriser extension limitée<br />
en raison <strong>de</strong> l’environnement naturel strict (réseau<br />
Natura 2000, site inscrit).<br />
/ NH – 87. ha<br />
Dont<br />
NHp – 2,8 ha<br />
Secteur NHp : vise les édifices ayant une valeur<br />
patrimoniale et dont on autorise le changement <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stination et une extension limitée à 50 m² <strong>de</strong><br />
SHOB.<br />
NL<br />
Zone NL : zone correspondant à <strong>de</strong>s espaces<br />
naturels aménagés en vue d’activités <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong><br />
plein air, <strong>de</strong> sports ainsi d’hébergement hôtelier<br />
(uniquement dans le secteur <strong>de</strong> Beaulieu pour cette<br />
<strong>de</strong>rnière vocation).<br />
Secteur NLf : correspond aux espaces dédiés aux<br />
loisirs au sein <strong>de</strong> la Forêt urbaine ;<br />
La zone NL reprend les zones NDc et NAt, hormis le lac<br />
<strong>de</strong> Beaulieu (NN) et l’île <strong>de</strong> la Liberté(NNs).<br />
Elle intègre une zone NC au sein <strong>de</strong> la forêt urbaine.<br />
NDc, NDca,<br />
NAt, NAl et<br />
NDl – 244 ha<br />
NL – 133 ha<br />
dont<br />
NLj – 3,5 ha<br />
Secteur NLj : correspondant aux espaces dédiés aux<br />
jardins familiaux.<br />
NX<br />
Zone NX : zone correspondant à <strong>de</strong>s espaces<br />
agricoles dont la pérennité n’est pas garantie.<br />
<strong>Le</strong>s installations agricoles peuvent faire l’objet<br />
d’aménagements et d’extensions. En revanche, les<br />
nouvelles im<strong>plan</strong>tations agricoles sont interdites.<br />
La zone NX s’étend sur d’anciennes zones NC. / NX – 59 ha<br />
203
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
204
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
2. <strong>Le</strong>s grands choix du zonage et du règlement<br />
Ce point a pour objectif <strong>de</strong> souligner les changements les plus importants entre le POS et le PLU.<br />
<br />
De nouvelles règles en zones urbaines pour favoriser le renouvellement urbain et<br />
la diversité <strong>de</strong> l’habitat<br />
Un nouveau découpage <strong>de</strong>s zones urbaines : UA, UAp, UBa, UBb et UBp<br />
<strong>Le</strong> PLU poursuit globalement les choix du POS <strong>de</strong> 2000, en y intégrant toutefois les objectifs clairement<br />
affichés <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité, <strong>de</strong> mixité sociale et <strong>de</strong> renouvellement urbain.<br />
Ainsi, les limites <strong>de</strong> la zone UA du POS sont maintenues pour le centre-ville. <strong>Le</strong> changement principal du<br />
PLU est la création d’une nouvelle zone UA qui correspond au centre <strong>de</strong> quartier <strong>de</strong> la Chabossière.<br />
Dans ces <strong>de</strong>ux zones UA, les tissus urbains y sont caractérisés par un front urbain continu et<br />
l’alignement par <strong>rapport</strong> à la voie. L’objectif du PLU est <strong>de</strong> pérenniser ces formes urbaines en permettant<br />
quelques évolutions à la marge.<br />
Ainsi, une partie <strong>de</strong> la zone UA du centre-ville <strong>de</strong>vient un secteur UAp – protégée au titre <strong>de</strong> l’article L123-<br />
1-7 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme dans lequel les règles d’im<strong>plan</strong>tations favorisent le maintien du tissu ancien<br />
et où les caractéristiques architecturales <strong>de</strong>s bâtiments doivent être conservées, voire restituées.<br />
<strong>Le</strong> secteur UBa, auparavant limité aux zones d’habitat mixte et d’activités urbaines directement accolées<br />
au centre-ville et au centre <strong>de</strong> la Chabossière, est agrandi pour englober l’ancien secteur Ube<br />
(équipements). <strong>Le</strong> secteur UBa du PLU vise ainsi à assurer une transition entre les centres anciens et la<br />
périphérie pavillonnaire, en permettant une <strong>de</strong>nsification, dans le temps, <strong>de</strong>s tissus urbains existants.<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce secteur est bien d’y favoriser un certain renouvellement urbain en y autorisant <strong>de</strong> petites<br />
opérations d’habitat groupé et/ou collectif. Ainsi, la hauteur à l’égout y est <strong>de</strong> 9 mètres (et 14 m en<br />
hauteur plafond).<strong>Le</strong>s règles d’im<strong>plan</strong>tation y sont mixtes. Une attention particulière est accordée aux<br />
règles d’im<strong>plan</strong>tation en limites séparatives pour éviter <strong>de</strong>s cohabitations difficiles entre <strong>de</strong>s habitations<br />
plutôt basses et <strong>de</strong> nouveaux projets plus hauts.<br />
205
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Quant au secteur UBb, <strong>de</strong> type pavillonnaire, outre son extension liée à l’englobement <strong>de</strong>s zones NAb<br />
construites et <strong>de</strong> la création d’un secteur UBp, il évolue peu.<br />
Un secteur UBp est créé qui correspond au quartier du Port Launay et aux cités <strong>de</strong> la Jarriais, du Bossis, du<br />
Berligout, <strong>de</strong> la Chabossière et <strong>de</strong> la Bertaudière. Il correspond à un secteur protégé au titre <strong>de</strong> l’article<br />
L123-1-7 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme dans lequel les règles d’im<strong>plan</strong>tations favorisent le maintien du tissu<br />
ancien (Port Launay), voire l’exige dans les anciennes cités ouvrières, une petite souplesse étant accordée<br />
pour les extensions qui doivent néanmoins être contiguës aux bâtiments existants à la date<br />
d’approbation du PLU. Dans ces secteurs, les caractéristiques architecturales <strong>de</strong>s bâtiments doivent être<br />
conservées, voire restituées.<br />
La suppression <strong>de</strong>s surfaces minimales et du COS<br />
La Loi SRU a modifié le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme en n’autorisant pas les PLU à réglementer la superficie<br />
minimale <strong>de</strong>s terrains dans les secteurs raccordés à l’assainissement collectif (la Loi Urbanisme et<br />
Habitat <strong>de</strong> 2003 a intégré quelques exceptions mais elles sont peu applicables à Couëron).<br />
Ces changements du Co<strong>de</strong> visent d’une part à renforcer les <strong>de</strong>nsités urbaines afin d’économiser les<br />
espaces naturels et agricoles, d’autre part à restreindre certains phénomènes <strong>de</strong> ségrégation sociale<br />
observés dans <strong>de</strong>s communes souhaitant n’attirer que <strong>de</strong>s classes aisées sur leur territoire. C’est pour ces<br />
raisons que le PLU <strong>de</strong> Couëron ne comporte plus <strong>de</strong> surfaces minimales.<br />
La zone UA <strong>de</strong> Couëron ne comportait déjà pas <strong>de</strong> surface minimale. En revanche la zone UB, en son<br />
article 5 , imposait une surface minimale <strong>de</strong> 250 m² en UBa et 300 m² en UBb, en cas <strong>de</strong> division<br />
parcellaire. La zone UC imposait une surface minimale <strong>de</strong> 500 m² en UC, en cas <strong>de</strong> division parcellaire.<br />
Par ailleurs, <strong>Nantes</strong> Métropole a opté dans les 24 communes pour la suppression <strong>de</strong>s coefficients<br />
d’occupation du sol (COS), qui, à Couëron, étaient limités, pour les constructions à usage d’habitation à<br />
0,60 en UBa et 0,50 en UBb.<br />
206
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
La gestion <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité par le biais du COS permet <strong>de</strong> maîtriser la <strong>de</strong>nsité à la parcelle mais s’avère<br />
souvent inadaptée à l’introduction d’objectifs relatifs à la forme urbaine. <strong>Le</strong> COS peut avoir certains<br />
effets pervers tels que <strong>de</strong>s ruptures dans le gabarit <strong>de</strong> fronts bâtis que l’on souhaiterait plus homogène<br />
ou l’utilisation maximum <strong>de</strong> la constructibilité d’un terrain, sans prise en compte <strong>de</strong> sa configuration ou<br />
<strong>de</strong> son environnement.<br />
La suppression du COS doit ainsi permettre <strong>de</strong> passer d’une approche quantitative (la <strong>de</strong>nsité) à une<br />
approche qualitative (la forme urbaine).<br />
La suppression du COS est compensée par un ensemble <strong>de</strong> règles <strong>de</strong> composition urbaine adaptées à la<br />
morphologie existante ou recherchée, qui comprend notamment les règles d’im<strong>plan</strong>tations, <strong>de</strong> hauteur<br />
et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s espaces libres et <strong>plan</strong>tations.<br />
L’avantage d’une gestion <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité par le croisement <strong>de</strong> règles qualitatives apparaît préférable au<br />
maintien d’une expression en valeur absolue souvent irréaliste et susceptible <strong>de</strong> bloquer la valorisation<br />
<strong>de</strong> petites parcelles tout en favorisant la création <strong>de</strong> vastes emprises génératrices <strong>de</strong> programmes<br />
inadaptés au tissu existant.<br />
Des principes <strong>de</strong> constructibilité revus notamment en ban<strong>de</strong> constructible secondaire<br />
L’objectif <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole et <strong>de</strong> la commune est <strong>de</strong> favoriser le renouvellement urbain <strong>de</strong>s tissus<br />
existants, pour éviter <strong>de</strong> consommer <strong>de</strong> nouveaux espaces naturels. Toutefois, ce renouvellement urbain<br />
doit respecter un certain nombre <strong>de</strong> règles et <strong>de</strong> principes.<br />
Il est avant tout prioritaire dans les centres ou à proximité immédiate <strong>de</strong>s équipements publics, services<br />
et commerces, en zone UA et UBa. <strong>Le</strong> renouvellement urbain doit s’engager sans remettre en cause<br />
l’évolution du centre historique et en veillant au respect <strong>de</strong> la forme urbaine traditionnelle et <strong>de</strong>s<br />
éléments patrimoniaux. Il pourra s’effectuer également en secteur UBb, à condition <strong>de</strong> respecter le tissu<br />
existant. Enfin dans les villages, les possibilités <strong>de</strong> constructions neuves se restreignent aux « <strong>de</strong>nts<br />
creuses » et aux espaces libres en faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> voie.<br />
<strong>Le</strong> règlement généralise et affine le principe <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> constructibilités aux règles<br />
différenciées : la ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> constructibilité principale va favoriser la <strong>de</strong>nsification en faça<strong>de</strong> sur rue alors<br />
que la ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> constructibilité secondaire offrira <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> construction plus faibles pour<br />
préserver l’environnement proche et limiter les possibles vues sur les parcelles voisines.<br />
Dans les zones UA et UB, la ban<strong>de</strong> constructible principale (BCP) reste fixée à 20 mètres comme dans le<br />
POS.<br />
Au-<strong>de</strong>là, dans la ban<strong>de</strong> constructible secondaire (BCS), les règles ont été affinées. <strong>Le</strong> principe suivi est <strong>de</strong><br />
permettre la constructibilité en second ri<strong>de</strong>au, tout en garantissant une certaine « intimité » <strong>de</strong>s fonds<br />
<strong>de</strong> parcelles. Ainsi, les règles en BCS sont systématiquement plus restrictives qu’en BCP : la hauteur y est<br />
inférieure (12 m en UA, 9 m en UBa, 6 m en UBb et UBp, 3,20 m en UC) et les retraits par <strong>rapport</strong> aux<br />
limites séparatives importants (au moins D = moitié <strong>de</strong> la hauteur à l’égout). Enfin, l’emprise au sol est<br />
limitée en secteur UBa (75 %), UBb (50 %) et UC (40%).<br />
Ces règles restreignent donc les possibilités <strong>de</strong> construction en second ri<strong>de</strong>au tout en donnant plus <strong>de</strong><br />
souplesse que la règle précé<strong>de</strong>nte : en effet, il sera désormais possible <strong>de</strong> construire en limite séparative<br />
mais à une hauteur absolue (au faîtage) <strong>de</strong> 3,20 mètres, ce qui évite également les vues plongeantes sur<br />
le voisinage.<br />
207
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Dans le secteur UCb, ce principe <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s constructibles est introduit avec <strong>de</strong>s emprises au sol limitée à<br />
40% dans la BCP et à 20% dans la BCS pour éviter <strong>de</strong>s divisions parcellaires trop conséquentes et donc un<br />
développement <strong>de</strong> l’habitat sans <strong>rapport</strong> avec la capacité <strong>de</strong>s équipements publics (en particulier <strong>de</strong><br />
l’assainissement).<br />
Des zones UC maintenues dans leurs limites actuelles pour éviter les extensions <strong>de</strong><br />
hameaux<br />
La zone UC du POS est maintenue (la Bazillière) et les anciennes zones NB <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong>s zones UC.<br />
Par ailleurs, le POS <strong>de</strong> 2000 avait été l’occasion d’étudier au plus près la forme <strong>de</strong>s villages et hameaux et<br />
dont les règles traduisaient la volonté <strong>de</strong> préserver leur i<strong>de</strong>ntité. Ces <strong>de</strong>rnières ont été reprises et<br />
ajustées dans le PLU. Seul le hameau <strong>de</strong> Brimberne, constitué <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s parcelles et dont la surface<br />
minimale constructible était <strong>de</strong> 750 mètres carrés, dispose désormais <strong>de</strong> règles plus strictes (cf<br />
explication donnée ci-<strong>de</strong>ssus).<br />
Des normes <strong>de</strong> stationnement réadaptées pour correspondre aux besoins<br />
<strong>Le</strong> POS actuel exige 1 à 2 places par logement.<br />
<strong>Le</strong>s règles relatives au stationnement (art.12) ont été revues à l’échelle <strong>de</strong> l’agglomération pour mieux<br />
correspondre aux besoins. En effet, avec la multi-motorisation <strong>de</strong>s ménages (cf - diagnostic), le taux<br />
d’équipement augmente, d’où un accroissement du nombre <strong>de</strong> véhicules sur emprise publique, avec <strong>de</strong>s<br />
conséquences néfastes en termes <strong>de</strong> sécurité routière, <strong>de</strong> saturation <strong>de</strong> l’offre, voire <strong>de</strong> fréquentation<br />
<strong>de</strong>s commerces <strong>de</strong> centre-bourg.<br />
Dans le même temps, le PLU doit être en cohérence avec le Plan <strong>de</strong> Déplacements Urbains dont l’axe fort<br />
est le développement <strong>de</strong>s transports collectifs au détriment <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s véhicules personnels,<br />
notamment pour réaliser <strong>de</strong>s économies d ‘énergie et réduire la pollution.<br />
Aussi, comme dans la plupart <strong>de</strong>s autres communes <strong>de</strong> l’agglomération, le PLU <strong>de</strong> Couëron propose <strong>de</strong><br />
réadapter les normes aux besoins.<br />
La réglementation s’effectuera désormais au regard <strong>de</strong> la surface <strong>de</strong>s logements, soit un nombre <strong>de</strong><br />
places / m² <strong>de</strong> SHON.<br />
Pour les logements individuels, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 85 m² <strong>de</strong> SHON dans toutes les zones urbaines, il sera exigé<br />
une secon<strong>de</strong> place <strong>de</strong> stationnement, et ainsi <strong>de</strong> suite pour les tranches <strong>de</strong> surface suivantes (120 m² en<br />
UA …).<br />
Pour les logements collectifs, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 60 m² <strong>de</strong> SHON dans toutes les zones urbaines, il sera exigé une<br />
secon<strong>de</strong> place <strong>de</strong> stationnement, et ainsi <strong>de</strong> suite pour les tranches <strong>de</strong> surface suivantes (120 m² en<br />
UA …).<br />
208
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
En outre, afin d’harmoniser les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calcul pour les opérations d’ensemble, la norme en matière<br />
<strong>de</strong> stationnement <strong>de</strong>s visiteurs est revue : 1 place / 300 m² <strong>de</strong> SHON créée sera exigée à partir d’une<br />
opération <strong>de</strong> 300 m² <strong>de</strong> SHON totale (et non plus <strong>de</strong> 1 pour 150 m² <strong>de</strong> SHON créée au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> 200 m² total<br />
dans le POS).<br />
En matière <strong>de</strong> commerces, l’objectif est <strong>de</strong> ne pas contraindre les im<strong>plan</strong>tations <strong>de</strong> commerces dans les<br />
centre-bourgs ou centre-villes. Ainsi, il sera exigé 1,5 place <strong>de</strong> stationnement par tranche <strong>de</strong> 50 m2 <strong>de</strong><br />
SHON comprise entre 301 et 1.000 m2 <strong>de</strong> SHON et 2 places <strong>de</strong> stationnement par tranche <strong>de</strong> 50 m2 <strong>de</strong><br />
SHON au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 1.000 m2 <strong>de</strong> SHON.<br />
Des orientations d’aménagement pour cadrer <strong>de</strong>s secteurs potentiels <strong>de</strong> mutation<br />
urbaine<br />
<strong>Le</strong> secteur <strong>de</strong> la Frémondière<br />
Im<strong>plan</strong>té à un kilomètre du centre-ville <strong>de</strong> Couëron, le secteur <strong>de</strong> la Frémondière se situe entre la rue <strong>de</strong><br />
la Frémondière et le boulevard <strong>de</strong>s Martyrs <strong>de</strong> la Résistance. Il est voisin du sta<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ardillets et <strong>de</strong> la<br />
cité <strong>de</strong> la Jarriais.<br />
<strong>Le</strong>s enjeux sont <strong>de</strong> favoriser les liaisons douces entre le boulevard <strong>de</strong> la Résistance et la rue <strong>de</strong> la<br />
Frémondière, <strong>de</strong> désenclaver le coeur d’îlot en créant une rue traversant les arrières du front bâti sur le<br />
boulevard <strong>de</strong>s Martyrs <strong>de</strong> la Résistance, d’organiser la nouvelle trame urbaine à partir <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> la cité<br />
<strong>de</strong> la Jarriais, préserver le patrimoine socio-sportif que représente le sta<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ardillets, <strong>de</strong> requalifier et<br />
d’étendre le réseau d’assainissement.<br />
<strong>Le</strong> nombre indicatif <strong>de</strong> logements est <strong>de</strong> 80, dont au moins 20% <strong>de</strong> logements locatifs sociaux.<br />
<strong>Le</strong> secteur <strong>de</strong> Lavigne<br />
Im<strong>plan</strong>té à l’ouest du bourg ancien <strong>de</strong> Couëron, le secteur <strong>de</strong> Lavigne fait face au vélodrome, à l’angle <strong>de</strong><br />
la rue Marcel <strong>de</strong> la Provoté et du boulevard François Blancho.<br />
<strong>Le</strong>s enjeux sont <strong>de</strong> développer un programme d’habitat diversifié qui renforcera cette entrée dans le<br />
bourg <strong>de</strong> Couëron et <strong>de</strong> préserver les arbres remarquables existant sur ce site, <strong>de</strong> requalifier et d’étendre<br />
le réseau d’assainissement.<br />
<strong>Le</strong> nombre indicatif <strong>de</strong> logements est <strong>de</strong> 70, dont au moins 20% <strong>de</strong> logements locatifs sociaux.<br />
<strong>Le</strong> secteur <strong>de</strong> la rue du Docteur Janvier<br />
Im<strong>plan</strong>té à 500 mètres à peine du centre-ville <strong>de</strong> Couëron, le secteur <strong>de</strong> la rue du Docteur Janvier se situe<br />
à l’arrière du quai Emile Paraf. La topographie est chahutée.<br />
<strong>Le</strong>s enjeux sont <strong>de</strong> favoriser la mutation urbaine <strong>de</strong> ce site <strong>de</strong> centre-ville, <strong>de</strong> désenclaver l’habitat <strong>de</strong>nse<br />
existant le long <strong>de</strong> la rue du Docteur Janvier et <strong>de</strong> préserver le patrimoine arboré et architectural, <strong>de</strong><br />
requalifier et d’étendre le réseau d’assainissement.<br />
<strong>Le</strong> nombre indicatif <strong>de</strong> logements est <strong>de</strong> 70, dont au moins 20% <strong>de</strong> logements locatifs sociaux.<br />
<br />
Une programmation <strong>de</strong> l’urbanisation future répondant aux objectifs du<br />
Programme <strong>local</strong> <strong>de</strong> l’habitat<br />
Traduisant les objectifs du PADD en matière d’habitat, le zonage et le règlement du PLU visent à offrir<br />
<strong>de</strong>s logements diversifiés en nombre suffisant, permettant <strong>de</strong> répondre aux besoins.<br />
<strong>Le</strong>s choix d’urbanisation future à vocation d’habitat<br />
En matière d’habitat, le PLU poursuit les choix effectués dans le POS <strong>de</strong> 2000 en les ajustant aux besoins<br />
présents.<br />
209
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
<strong>Le</strong>s ZAC <strong>de</strong> la Métairie, Ouest centre-ville et Rives <strong>de</strong> Loire sont intégrées au PLU en zone UP (projet) : les<br />
réseaux sont en effet programmés pour accueillir la population prévue. Chacune <strong>de</strong> ces ZAC est dotée<br />
d’une orientation d’aménagement qui reprend l’essentiel <strong>de</strong> l’armature urbaine et paysagère <strong>de</strong> ces<br />
futurs quartiers.<br />
<strong>Le</strong> nombre total indicatif <strong>de</strong> logements est d’environ 1 750 logements.<br />
Ces trois opérations satisfont en gran<strong>de</strong> partie les objectifs <strong>de</strong> production du PLH, à savoir la construction<br />
<strong>de</strong> 180 logements neufs en moyenne par an pendant 10 ans. Ainsi, une zone NA du POS a été confirmée<br />
dans sa vocation et ouverte à l’urbanisation du fait <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> réseaux aux capacités suffisantes<br />
en périphérie immédiate <strong>de</strong> ce site. Elle est classée en zone 1AUb – <strong>de</strong> type pavillonnaire.<br />
Cette zone d’urbanisation future ouverte fait l’objet d’une orientation d’aménagement qui fixe les<br />
principes d’urbanisation à respecter par tout opérateur. <strong>Le</strong>s principes d’accès et <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte, les espaces<br />
verts à respecter, les espaces publics à créer, les continuités piétonnes à réaliser, ainsi qu’un programme<br />
minimal <strong>de</strong> logements (exprimé en SHON minimale) dont les logements locatifs sociaux y sont imposés.<br />
Cette orientation d’aménagement est opposable au tiers.<br />
Orientation d’aménagement du secteur du Doceul<br />
Im<strong>plan</strong>té à un kilomètre du centre-ville <strong>de</strong> Couëron, à proximité <strong>de</strong> la gare, le secteur du Doceul est situé<br />
à l’intérieur d’un îlot urbain déjà constitué <strong>de</strong> maisons individuelles avec jardin, entre la rue Alexandre<br />
Olivier et la rue <strong>de</strong> la Pierre.<br />
<strong>Le</strong>s objectifs sont <strong>de</strong> favoriser le renouvellement urbain dans une enclave résiduelle à proximité <strong>de</strong> la<br />
gare, <strong>de</strong> <strong>de</strong>sservir le coeur d’îlot, d’utiliser la pente du terrain pour développer <strong>de</strong> l’habitat en terrasse et<br />
<strong>de</strong> préserver quelques beaux arbres fruitiers.<br />
D’une superficie d’environ 1,3 hectares, le nombre indicatif <strong>de</strong> logements est <strong>de</strong> 23 logements.<br />
Outre cette zone 1 AU, <strong>de</strong>ux secteurs sont classés en zones 2 AU, fermées à l’urbanisation, du fait <strong>de</strong> leur<br />
caractère naturel actuel d’une part, et <strong>de</strong> l’insuffisance <strong>de</strong>s réseaux situés en périphérie immédiate à<br />
absorber l’urbanisation nouvelle d’autre part.<br />
La zone située au nord <strong>de</strong> la Sinière et délimitée en zone NAa au POS est reconduite en zone 2AU<br />
(environ 5,7 ha).<br />
La zone située à l’ouest du Bois Laurent et délimitée en zone NAa au POS est également reconduite en<br />
zone 2AU (environ 8,1 ha).<br />
Des objectifs <strong>de</strong> mixité sociale traduits dans les règles proposées<br />
<strong>Le</strong>s choix réglementaires du PLU traduisent la volonté <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> développer la mixité <strong>de</strong>s<br />
populations. Plusieurs outils permettent d’atteindre cet objectif.<br />
<strong>Le</strong>s orientations d’aménagement <strong>de</strong> la zone 1AU et <strong>de</strong>s zones U fixent un pourcentage minimal <strong>de</strong><br />
logements locatifs sociaux à atteindre dans chaque opération. Ce pourcentage est fixé à 20 % dans<br />
toutes les orientations, sauf pour la ZAC ouest centre-ville où ce pourcentage est fixé à 25%.<br />
Globalement, les orientations d’aménagement imposent l’équivalent d’un minimum <strong>de</strong> 446 logements<br />
locatifs sociaux à réaliser.<br />
Enfin, les choix <strong>de</strong> la commune en matière d’accueil <strong>de</strong>s gens du voyage sont repris dans le PLU. <strong>Le</strong><br />
secteur réservé à l’aire d’accueil <strong>de</strong>s gens du voyage perdure dans le PLU sous une nouvelle<br />
dénomination UCv au lieu-dit les Mares Jaunes.<br />
<br />
Un découpage simplifié <strong>de</strong>s zones d’activités et <strong>de</strong>s choix permettant <strong>de</strong><br />
conforter le développement économique<br />
<strong>Le</strong> POS <strong>de</strong> 2000 et la révision simplifiée du PLU <strong>de</strong> décembre 2005 comportait 3 types <strong>de</strong> zones d’activités<br />
économiques.<br />
210
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Une répartition en <strong>de</strong>ux zones principales : UE et UG<br />
<strong>Le</strong>s zones UE et UG se distinguent par le type d’entreprises accueillies et certaines règles <strong>de</strong> hauteur et<br />
d’im<strong>plan</strong>tation.<br />
La zone UE est <strong>de</strong>stinée à recevoir <strong>de</strong>s activités variées <strong>de</strong> type commerces, services, bureaux, activités<br />
artisanales, à l’exception <strong>de</strong> certaines installations classées pour la protection <strong>de</strong> l’environnement qui<br />
présenteraient <strong>de</strong>s nuisances pour l’environnement habité situé à proximité. La hauteur autorisée y est<br />
<strong>de</strong> 15 mètres. Cette zone regroupe les principales zones d’activités : <strong>Le</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron (déjà classés<br />
UE au POS) et le Paradis (classé NAg).Une petite zone UE existe également à proximité <strong>de</strong> la gare qui<br />
accueille notamment le centre technique municipal.<br />
<strong>Le</strong> secteur UEa situé au sud <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron n’autorise pas l’im<strong>plan</strong>tation d’activités commerciales,<br />
conformément à la Charte d’orientation commerciale <strong>de</strong> l’agglomération nantaise qui privilégie le<br />
développement commercial dans les centralités.<br />
Par ailleurs, le POS avait délimité <strong>de</strong> petites zones d’activités dans l’espace rural. Elles ont été reprises en<br />
UE.<br />
La zone UG est <strong>de</strong>stinée à recevoir <strong>de</strong>s activités économiques <strong>de</strong> toute nature, à l’exception <strong>de</strong>s bureaux<br />
et commerces non liées aux activités autorisées. Cette zone UG reprend les anciennes zones UG et NAg<br />
(hormis <strong>Le</strong> Paradis) <strong>de</strong>s bords <strong>de</strong> Loire<br />
Cette zone doit permettre l’accueil d’entreprises industrielles dites « lour<strong>de</strong>s » dans <strong>de</strong>s domaines<br />
spécialisés. <strong>Le</strong>s règles y sont souples (hauteur non limitée notamment) pour pouvoir im<strong>plan</strong>ter <strong>de</strong>s<br />
bâtiments <strong>de</strong> taille importante correspondant aux activités présentes. <strong>Le</strong>s emprises existantes d’Arcelor,<br />
d’Arc-en-Ciel, <strong>de</strong> Berylco, du dépôt <strong>de</strong>s essences <strong>de</strong>s armées, etc.ont été reprises.<br />
Une ancienne zone NAg située entre Arc-en-Ciel et l’étier <strong>de</strong> la Bouma a été reclassée en zone naturelle<br />
protégée (NN) car située en zone inondable et concernée dans sa frange sud par une Zone d’Importance<br />
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO).<br />
Un secteur UGc est créé pour le site <strong>de</strong> la carrière <strong>de</strong>s Daudières en cours <strong>de</strong> remblaiement.<br />
<strong>Le</strong>s zones d’urbanisation future à vocation économique<br />
Il s’agit <strong>de</strong>s zones 1AUe <strong>de</strong> la Lan<strong>de</strong> Bourne et <strong>de</strong> la Barrière Noire.<br />
Exceptionnellement, elles ne sont pas dotées d’orientations d’aménagement. En effet, leur<br />
aménagement est lié au <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> la zone 2AU <strong>de</strong> la Rousselière située en continuité territoriale à Saint-<br />
Herblain, notamment en ce qui concerne les <strong>de</strong>ssertes en réseau et voirie. Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité va<br />
donc être lancée qui déterminera <strong>de</strong>s orientations d’aménagement qui seront transcrites dans le PLU le<br />
moment venu.<br />
Un zonage spécifique pour les grands équipements <strong>de</strong> la commune<br />
La zone NAL du POS <strong>de</strong> 2000 correspondant au Vélodrome, ainsi que la Maison d’Accueil Spécialisée sont<br />
transformées en zone UM. Cette zone définie à l’échelle <strong>de</strong> l’agglomération permet d’i<strong>de</strong>ntifier les<br />
ensembles d’équipements structurants à vocation supra-communale et d’y garantir <strong>de</strong>s règles<br />
compatibles avec les occupations qui y sont autorisées.<br />
<br />
Un découpage affiné <strong>de</strong>s zones naturelles pour mieux protéger les différents<br />
milieux<br />
Cinq grands types <strong>de</strong> zones ont été délimités à l’échelle <strong>de</strong> l’agglomération :<br />
- <strong>Le</strong>s zones NN correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s espaces naturels à protéger pour leur qualité biologique ou<br />
paysagère ou la préservation du cadre <strong>de</strong> vie ; elles contiennent un secteur NNs dans lequel les<br />
qualités biologiques sont telles que les règles y sont encore plus strictes ; un secteur NNf voué au<br />
boisement dans le cadre <strong>de</strong> la Foret urbaine ; un secteur NNj, voué aux activités <strong>de</strong> jardinage ;<br />
211
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
- <strong>Le</strong>s zones NL correspon<strong>de</strong>nt, elles, à <strong>de</strong>s espaces naturels aménagés en vue d’activités <strong>de</strong> découverte<br />
ou <strong>de</strong> loisirs ;<br />
- La zone NE s’attache à protéger la Loire ;<br />
- <strong>Le</strong>s zones NH correspon<strong>de</strong>nt aux constructions isolées dans l’espace rural ;<br />
- <strong>Le</strong>s zones NX sont <strong>de</strong>s zones naturelles dans lesquelles l’usage agricole n’est pas garanti au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong><br />
ce PLU.<br />
<strong>Le</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières zones sont présentées dans le point suivant (2.5).<br />
<strong>Le</strong> classement <strong>de</strong>s prairies <strong>de</strong> la Loire et <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s en secteur NNs<br />
<strong>Le</strong> Marais Audubon, les zones humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Beaulieu et la vallée <strong>de</strong> la Pâtissière sont classées dans le<br />
secteur NNs <strong>de</strong> la zone NN.<br />
Ce secteur regroupe les milieux naturels sensibles d’intérêt écologique dans lesquels sont admis les<br />
aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion <strong>de</strong> la fréquentation du<br />
public, tels que les cheminements piétons, les sanitaires, et à l’exclusion <strong>de</strong>s places <strong>de</strong> stationnement.<br />
Il comprend le périmètre Natura 2000.<br />
<strong>Le</strong>s secteurs <strong>de</strong> qualité paysagère classés en zone NN<br />
Plusieurs secteurs sont classés en zone NN pour leur qualité écologique et paysagère. La zone NN est<br />
inconstructible. Y sont seulement autorisés les constructions, ouvrages et travaux directement<br />
nécessaires au pâturage <strong>de</strong>s animaux dans la limite <strong>de</strong> 15 m² <strong>de</strong> SHOB, ainsi que les aménagements liés à<br />
la gestion <strong>de</strong> la fréquentation du public.<br />
Il s’agit notamment <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Chézine (hors périmètre forêt urbaine), du nord du lac <strong>de</strong> Beaulieu,<br />
du Nord <strong>de</strong> l’Erdurière.<br />
<strong>Le</strong>s zones NL pour les espaces voués aux activités <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong> plein air, <strong>de</strong> sports et<br />
d’hébergement hôtelier<br />
En zone NL, sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt<br />
collectif ainsi que les constructions directement nécessaires à l’accueil du public et à l’animation du site<br />
tels que kiosque, restaurants et sanitaires sont autorisés, <strong>de</strong> même que les terrains <strong>de</strong> camping et <strong>de</strong><br />
caravanage et les cimetières paysagers.<br />
Ainsi, la plupart <strong>de</strong>s sites NDc du POS <strong>de</strong> 2000 ont été repris : lac <strong>de</strong> Beaulieu, centre <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong><br />
l’Erdurière, ancienne carrière <strong>de</strong>s Daudières.<br />
L’ancienne zone NAt <strong>de</strong> Beaulieu est classée partiellement en zone NL dans le PLU. Y sont<br />
exceptionnellement autorisées les constructions et installations à vocation d’hébergement hôtelier, à la<br />
condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sites, milieux naturels et paysages.<br />
Enfin, <strong>de</strong>ux secteurs NLj ont été créés au Pont <strong>de</strong> Retz et à la Bazillière dans la perspective <strong>de</strong> la création<br />
<strong>de</strong> jardins familiaux.<br />
La traduction réglementaire du projet <strong>de</strong> forêt urbaine<br />
La forêt urbaine i<strong>de</strong>ntifiée dans le PADD par un périmètre est traduite par différents zonages pour<br />
respecter les usages actuels du territoire tout en ancrant le site dans une dynamique <strong>de</strong> projet. Ainsi,<br />
plusieurs zonages sont délimités au sein du périmètre :<br />
- Un secteur NNf est délimité au milieu du périmètre sur <strong>de</strong>s terres agricoles en déshérence ;<br />
- Un secteur NLf s’étend au sud du hameau <strong>de</strong> Brimberne ;<br />
212
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
- Une zone A située entre la Chézine et la RN 444. L’usage agricole actuel prime sur le<br />
boisement.<br />
La création d’une zone NE pour la Loire<br />
<strong>Le</strong> classement NE <strong>de</strong> la Loire la préservera <strong>de</strong>s risques d’atteinte aux milieux en réglementant<br />
strictement les occupations du sol potentielles. Ce classement réalisé pour les espaces en eau et<br />
navigables <strong>de</strong> l’agglomération (Erdre, Sèvre et Loire) permet, à condition qu’ils ne portent pas atteinte<br />
aux milieux naturels, les ouvrages et installations nécessaires à l’entretien <strong>de</strong>s cours d’eau, à la<br />
navigation, aux activités portuaires. Tous ces ouvrages et constructions doivent être raccordés aux<br />
réseaux nécessaires à leur fonctionnement et leur insertion paysagère doit être particulièrement<br />
soignée, dans le respect du site et du paysage.<br />
<br />
La détermination d’une zone agricole durable et d’une zone naturelle dans<br />
laquelle l’usage agricole n’est pas garanti à long terme<br />
La zone d’agriculture durable (A)<br />
L’objectif <strong>de</strong> la zone A est d’assurer les conditions <strong>de</strong> pérennité <strong>de</strong>s activités agricoles. <strong>Le</strong> nouveau zonage<br />
A est ainsi exclusivement orienté vers l’activité agricole (construction <strong>de</strong> bâtiments d’activités agricoles<br />
et logement <strong>de</strong> fonction).<br />
La zone A diminue très peu du POS au PLU passant <strong>de</strong> 1750 ha à 1604 ha. Cette diminution s’explique par<br />
le pastillage <strong>de</strong>s constructions existantes isolées au sein <strong>de</strong> la zone NH et la création d’une zone NX.<br />
En complément du zonage A durable, le PLU vise également la protection <strong>de</strong>s sièges d’exploitations.<br />
Ainsi, le règlement rappelle, dans chaque zone, l’application <strong>de</strong> la règle dite <strong>de</strong> « réciprocité » entre<br />
habitations et activités agricoles. <strong>Le</strong> PLU développe aussi l’information et la sensibilisation <strong>de</strong>s habitants<br />
en joignant un périmètre d’information en annexe, i<strong>de</strong>ntifiant tous les sièges d’exploitation en activité<br />
en 2004 ainsi que les périmètres <strong>de</strong> recul qu’ils imposent.<br />
<strong>Le</strong>s bâtiments agricoles sont en effet soumis au respect <strong>de</strong> plusieurs législations et règlementations au<strong>de</strong>là<br />
du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme : le Co<strong>de</strong> Rural, le règlement sanitaire départemental, le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’environnement avec les installations classées pour la protection <strong>de</strong> l’environnement (ICPE). Ces textes<br />
exigent <strong>de</strong>s reculs entre les habitations et les bâtiments d’élevage et certaines installations telles que<br />
fosses ou silos. Ces reculs sont dits « réciproques », c’est-à-dire qu’ils s’appliquent dans un sens comme<br />
dans l’autre. Ainsi, les habitations nouvelles par construction neuve ou changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination<br />
doivent respecter les distances réglementaires <strong>de</strong> 50 m, 100 m voire plus.<br />
<strong>Le</strong> pastillage <strong>de</strong>s habitations isolées en zone naturelle et agricole (NH)<br />
Avant la loi SRU, les constructions isolées en zone NC (habitat ou activités) pouvaient bénéficier<br />
d’extensions limitées. Ce principe est supprimé dans les PLU. Désormais, pour bénéficier <strong>de</strong> ce type<br />
d’extensions, les constructions doivent être classées en zone NH.<br />
La zone A est donc « pastillée » <strong>de</strong> petites zones NH, « secteurs <strong>de</strong> taille et <strong>de</strong> capacité limitée » définis<br />
par l’article R.123-8 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme. Ces secteurs, limités en taille, correspon<strong>de</strong>nt aux habitations<br />
ou activités isolées existantes à la date d’approbation du PLU. En zone NH sont autorisées <strong>de</strong>s extensions<br />
ou constructions nouvelles, limitées à 50 m² <strong>de</strong> surface hors œuvre brute pour les constructions liées à<br />
l’habitat , 150 m² <strong>de</strong> S.H.O.B. pour les constructions liées à une activité.<br />
Ces secteurs doivent permettre aux occupants <strong>de</strong>s constructions <strong>de</strong> réaliser une extension, une annexe<br />
ou <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> rénovation sans toutefois augmenter le mitage <strong>de</strong> l’espace rural par la création <strong>de</strong><br />
nouveaux logements. En zone NH, le changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination est interdit, contrairement au secteur<br />
NHp où il est autorisé pour favoriser la réhabilitation <strong>de</strong> bâtiments au caractère patrimonial affirmé.<br />
213
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Une zone naturelle pour les espaces agricoles dont la pérennité n’est pas garantie (NX)<br />
La zone NX s’étend sur 59 ha. Cette zone correspond à <strong>de</strong>s espaces agricoles dont la pérennité n’est pas<br />
garantie. Elle doit permettre d’engager une réflexion sur les usages qui y seront autorisés à très long<br />
terme. <strong>Le</strong>s exploitations existantes peuvent continuer d’exploiter, mais l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong> nouveaux<br />
bâtiments n’est pas admise. <strong>Le</strong> règlement veille donc à ne pas en autoriser <strong>de</strong> nouveaux afin <strong>de</strong> préserver<br />
ces secteurs <strong>de</strong> toute im<strong>plan</strong>tation susceptible <strong>de</strong> remettre en cause le futur projet.<br />
Au-<strong>de</strong>là du PLU, et dans le même temps que la réflexion sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> ces sites est engagée, le<br />
programme pour la préservation <strong>de</strong> l’agriculture périurbaine <strong>de</strong>vra être mobilisé pour trouver <strong>de</strong>s<br />
solutions compensant les atteintes portées aux agriculteurs en place.<br />
214
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
La zone NX couvre trois sites :<br />
- Un secteur situé au nord <strong>de</strong> la Sinière. Il est en voie <strong>de</strong> déprise agricole ;<br />
- Un secteur situé au nord <strong>de</strong> la voie ferrée, à proximité <strong>de</strong> la gare du centre-ville <strong>de</strong> Couëron, et au<br />
sud <strong>de</strong> l’ancienne carrière <strong>de</strong>s Daudières, en cours <strong>de</strong> remblaiment, et qui pourrait <strong>de</strong>venir dans le<br />
futur un espace <strong>de</strong> loisirs accueillant <strong>de</strong>s équipements publics ;<br />
- Un secteur situé au nord <strong>de</strong> la Croix Gicquiau.<br />
<br />
La poursuite <strong>de</strong> la protection du patrimoine bâti et végétal<br />
<strong>Le</strong> PADD affiche fortement la volonté <strong>de</strong> protéger et <strong>de</strong> mettre en valeur le patrimoine communal.<br />
<strong>Le</strong> POS <strong>de</strong> 2000 n’ avait pas cette ambition. Toutefois, par le biais <strong>de</strong> l’instruction <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong><br />
construire, la Mairie consulte assez régulièrement l’architecte du CAUE, en particulier lorsque les travaux<br />
portent sur <strong>de</strong>s bâtiments qui lui semble intéressant d’un point <strong>de</strong> vue architectural.<br />
<strong>Le</strong> PLU, dans son règlement et son zonage, i<strong>de</strong>ntifie clairement les bâtiments ayant un intérêt<br />
patrimonial.<br />
Suite à la réalisation du diagnostic du patrimoine communal, par le Conseil en Architecture, Urbanisme<br />
et Environnement, à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole, un travail important dans ce sens a été réalisé en<br />
i<strong>de</strong>ntifiant les fermes et dépendances à préserver, en instaurant <strong>de</strong>s règles précises pour conserver leur<br />
i<strong>de</strong>ntité ainsi que celle <strong>de</strong>s châteaux, manoirs et <strong>de</strong> leur parc<br />
A partir <strong>de</strong> cet inventaire, le PLU s’appuie sur l’application <strong>de</strong> la Loi Paysage (art. L123-1-7 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’urbanisme) pour protéger les éléments emblématiques <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité communale. En effet, cet article<br />
prévoit que le PLU peut « i<strong>de</strong>ntifier et <strong>local</strong>iser les éléments <strong>de</strong> paysage et délimiter les quartiers, îlots,<br />
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier<br />
pour <strong>de</strong>s motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions <strong>de</strong><br />
nature à assurer leur protection. »<br />
La création <strong>de</strong> secteurs patrimoniaux<br />
Au regard <strong>de</strong> l’inventaire du patrimoine réalisé et <strong>de</strong> sa <strong>local</strong>isation, il a été décidé la création d’un<br />
secteur UAp et <strong>de</strong>s secteurs UBp. Ces secteurs présentent un caractère ancien, traditionnel et historique,<br />
et une forme urbaine jugée typique <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> la commune.<br />
La zone UAp correspond au bourg ancien. <strong>Le</strong> tissu urbain y est caractérisé par l’alignement par <strong>rapport</strong> à<br />
la voie et une im<strong>plan</strong>tation continue <strong>de</strong>s constructions. La hauteur <strong>de</strong>s constructions est variable d’une<br />
rue à l’autre .<br />
Dans ce secteur, les constructions sont soumises à un régime <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> démolir particulier, à savoir :<br />
- l'avis <strong>de</strong> l'architecte <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> France est obligatoire (article R.430-9) ;<br />
- la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> démolir doit comporter, outre les pièces normalement exigées, la date<br />
approximative <strong>de</strong> construction du bâtiment et <strong>de</strong>s documents photographiques faisant apparaître<br />
les conditions <strong>de</strong> son insertion dans les lieux environnants ;<br />
- le refus du permis <strong>de</strong> démolir peut être fondé non pas uniquement sur un motif social, comme dans<br />
le cas <strong>de</strong>s permis requis au titre du a) <strong>de</strong> l'article L.430-1, mais sur <strong>de</strong>s motifs liés à la protection et à<br />
la mise en valeur <strong>de</strong>s quartiers, sites et monuments.<br />
De plus, pour ce secteur, l’élaboration d’un règlement adapté au tissu urbain et à la morphologie du tissu<br />
urbain permet <strong>de</strong> pérenniser les formes urbaines.<br />
Par ailleurs, l’article 11 du règlement <strong>de</strong> la zone UAp comporte <strong>de</strong>s dispositions particulières concernant la<br />
réhabilitation <strong>de</strong>s constructions existantes et les constructions nouvelles :<br />
- les matériaux et aspects <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s, notamment, la surface <strong>de</strong>s percements, le maintien <strong>de</strong>s<br />
soubassements, <strong>de</strong>s encadrements d’ouverture existants, <strong>de</strong>s éléments ornementaux d’origine….<br />
- le ravalement et le respect <strong>de</strong>s matériaux prévus initialement pour être apparents ;<br />
215
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
- les couronnements et toitures : les éléments <strong>de</strong> décors <strong>de</strong> toiture doivent être si possible conservés<br />
et restaurés…<br />
- les clôtures doivent être conçues en harmonie avec les constructions avoisinantes présentant un<br />
intérêt et les éléments <strong>de</strong> ferronnerie existants doivent être conservés et restaurés.<br />
<strong>Le</strong>s secteurs UBp couvrent le quartier du Port Launay et d’anciennes cités ouvrières : la Jarriais, la Bossis,<br />
le Berligout, la Chabossière et la Bertaudière.<br />
<strong>Le</strong>s secteurs UBp sont soumis à la même réglementation concernant les permis <strong>de</strong> démolir que le secteur<br />
UAp.<br />
De plus, pour ce secteur, l’élaboration d’un règlement adapté à la morphologie du tissu urbain permet <strong>de</strong><br />
pérenniser les formes urbaines.<br />
Par ailleurs, l’article 11 du règlement <strong>de</strong>s zones UAp et UBp comporte <strong>de</strong>s dispositions particulières<br />
concernant la réhabilitation <strong>de</strong>s constructions existantes et les constructions nouvelles :<br />
- les matériaux et aspects <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s, notamment, la surface <strong>de</strong>s percements, le maintien <strong>de</strong>s<br />
soubassements, <strong>de</strong>s encadrements d’ouverture existants, <strong>de</strong>s éléments ornementaux d’origine….<br />
- le ravalement et le respect <strong>de</strong>s matériaux prévus initialement pour être apparents ;<br />
- les couronnements et toitures : les éléments <strong>de</strong> décors <strong>de</strong> toiture doivent être si possible conservés<br />
et restaurés…<br />
- les clôtures doivent être conçues en harmonie avec les constructions avoisinantes présentant un<br />
intérêt et les éléments <strong>de</strong> ferronnerie existants doivent être conservés et restaurés.<br />
Enfin, un secteur NHp est créé autour <strong>de</strong>s constructions isolées présentant un caractère architectural<br />
remarquable. Dans ce secteur, le changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination est permis et la SHOB autorisée est <strong>de</strong> 50<br />
m². Cette règle doit permettre les rénovations <strong>de</strong> bâtiments en offrant un autre usage possible que<br />
l’habitat. Ces secteurs correspon<strong>de</strong>nt, à Couëron, aux châteaux, <strong>de</strong>meures ou fermes remarquables, dont<br />
les caractéristiques ont été décrites dans l’état initial <strong>de</strong> l’environnement.<br />
L’i<strong>de</strong>ntification et la protection <strong>de</strong>s bâtiments remarquables et du petit patrimoine<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s secteurs UAp, UCp et NHp qui regroupent l’essentiel <strong>de</strong>s bâtiments d’intérêt, dans lesquels<br />
toutes les constructions sont soumises à permis <strong>de</strong> démolir, le règlement instaure une protection <strong>de</strong>s<br />
éléments bâtis et paysagers représentatifs <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> Couëron. Grâce à l’inventaire réalisé, un<br />
certain nombre <strong>de</strong> constructions et <strong>de</strong> monuments ou édifices ont été repérés. Ils sont i<strong>de</strong>ntifiés sur le<br />
<strong>plan</strong> <strong>de</strong> zonage par un symbole. <strong>Le</strong>ur liste (avec <strong>local</strong>isation précise) est annexée au règlement.<br />
Toute construction i<strong>de</strong>ntifiée au <strong>plan</strong> <strong>de</strong> zonage, au titre <strong>de</strong> l’article L 123-1-7, est soumise au régime du<br />
permis <strong>de</strong> démolir, en application <strong>de</strong> l’article L. 430-1,d. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces<br />
éléments doivent être conçus dans le respect <strong>de</strong>s caractéristiques du patrimoine à préserver,<br />
conformément à l’article 11 <strong>de</strong> chaque zone.<br />
La protection <strong>de</strong>s éléments végétaux remarquables (ensembles boisés et haies)<br />
Outre la protection <strong>de</strong>s boisements au titre <strong>de</strong> l’article L.130-1, en Espaces boisés classés, le PLU introduit<br />
une protection du patrimoine paysager, au titre <strong>de</strong> l’article L.123-1-7°, principalement dans les Zones<br />
d’Aménagement Concerté.<br />
Tous les travaux ayant pour effet <strong>de</strong> modifier ou détruire un élément <strong>de</strong> paysage i<strong>de</strong>ntifié <strong>de</strong>vront faire<br />
l’objet d’une autorisation préalable au titre <strong>de</strong>s installations et travaux divers, en application <strong>de</strong> l’article<br />
L.442-2 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme. Une modification partielle d’un élément paysager peut être admise dès<br />
lors que l’unité <strong>de</strong> l’espace n’est pas compromise.<br />
216
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
217
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
IIIIII- LA STRUCTURE DU ZONAGE ET LES PRIINCIIPALES<br />
DIISPOSIITIIONS DU REGLEMENT ZONE PAR ZONE<br />
1. <strong>Le</strong>s zones urbaines à dominante d’habitat<br />
Zone UA<br />
Secteurs et règlement<br />
La zone UA couvre le centre-ville et le centre <strong>de</strong> la Chabossière ; elle a pour<br />
vocation d’accueillir <strong>de</strong>s habitants, <strong>de</strong>s activités centrales (commerces, services,<br />
équipements…).<br />
La zone UA comprend un secteur UAp qui correspond au bourg ancien.<br />
UA<br />
Art 5 - pas <strong>de</strong> surface minimale<br />
Art 6 - Construction en limite d’emprise publique ou <strong>de</strong> voie.<br />
Art 7 - Dans la ban<strong>de</strong> constructible principale (BCP): im<strong>plan</strong>tation sur une ou<br />
<strong>de</strong>ux limites séparatives latérales. Si retrait : au moins égal à la moitié <strong>de</strong> la<br />
hauteur H1 <strong>de</strong> la construction, avec un minimum <strong>de</strong> 3 mètres.<br />
<strong>Le</strong> retrait vis à vis <strong>de</strong> la limite <strong>de</strong> fond <strong>de</strong> terrain doit être supérieur à la moitié<br />
<strong>de</strong> la hauteur <strong>de</strong> la construction avec un minimum <strong>de</strong> 3 mètres.<br />
Dans la ban<strong>de</strong> constructible secondaire (BCS): im<strong>plan</strong>tation en retrait d’au<br />
moins la moitié <strong>de</strong> la hauteur H1 <strong>de</strong> la construction avec un minimum <strong>de</strong> 3<br />
mètres (possibilité d’im<strong>plan</strong>tation en limite avec hauteur plafond (H2)<br />
inférieure à 3,20m)<br />
218
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
UA<br />
Art 9- Emprise au sol non réglementée<br />
Art 10 – Dans la BCP : Hauteur <strong>de</strong> 12 m + 5 m <strong>de</strong> hauteur plafond + gabarit à<br />
45°<br />
Dans la BCS : Hauteur plafond <strong>de</strong> 12 m avec un retrait <strong>de</strong>s limites séparative <strong>de</strong><br />
H/2<br />
Art 12 – Normes <strong>de</strong> stationnement pour les habitations : 1 pl/60 m²/SHON<br />
pour les logements collectifs 1pl/85m²SHON pour les individuels avec au moins<br />
1 place par logement ; pour les commerces : au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 300 m² SHON 1,5pl / 50<br />
m² SHON puis au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 1000 m² <strong>de</strong> SHON, 2pl / 50m² SHON ; pour les<br />
bureaux : 1pl / 50 m² SHON ; pour les hôtels : 1pl / 150 m² SHON ; pour les<br />
autres activités : 1pl / 100 m² SHON<br />
Art.14 – Pas <strong>de</strong> COS<br />
Zone UB<br />
La zone UB reprend la zone UB en révisant ses limites, elle est généralement<br />
étendue aux abords du centre-ville et du centre <strong>de</strong> la Chabossière, secteurs <strong>de</strong><br />
transitions urbaines.<br />
Zonage et vocation<br />
Secteurs et règlement<br />
La zone couvre l’ensemble <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> transition entre les centres anciens et<br />
les extensions pavillonnaires, les extensions pavillonnaires ainsi que les<br />
opérations d’habitat plus <strong>de</strong>nses.<br />
La zone UB comprend trois secteurs :<br />
UBa : secteur <strong>de</strong> transition, en périphérie du centre, permettant le<br />
renouvellement urbain.<br />
UBb : secteur à dominante pavillonnaire.<br />
UBp : secteur à dominante pavillonnaire, d’intérêt patrimonial.<br />
219
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
UB<br />
Art 5 - pas <strong>de</strong> surface minimale<br />
Art 6-<br />
Secteur UBa<br />
Construction entre 0 et 5 mètres par <strong>rapport</strong> à l’emprise publique ou à la voie.<br />
Secteur UBb<br />
Construction à 5 mètres fixes par <strong>rapport</strong> à l’emprise publique ou à la voie.<br />
Secteur UBp<br />
<strong>Le</strong>s constructions nouvelles doivent respecter le même recul que le bâtiment<br />
existant.<br />
<strong>Le</strong>s extensions se font en respectant l’im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong> la construction existante.<br />
Art 7 –<br />
Secteur UBa<br />
BCP : im<strong>plan</strong>tation obligatoire sur au moins l’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux limites séparatives<br />
ou en retrait <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> la hauteur H1 <strong>de</strong> la construction avec un minimum<br />
<strong>de</strong> 3 mètres<br />
BCS : im<strong>plan</strong>tation en limites séparatives (H2 inférieure à 3,20m) ou en retrait <strong>de</strong><br />
la moitié <strong>de</strong> la hauteur h1 <strong>de</strong> la construction avec un minimum <strong>de</strong> 3 mètres<br />
Secteur UBb et UBpL<br />
BCP : im<strong>plan</strong>tation sur l’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux limites séparatives ou en retrait <strong>de</strong> la<br />
moitié <strong>de</strong> la hauteur H1 <strong>de</strong> la construction avec un minimum <strong>de</strong> 3 mètres<br />
BCS : im<strong>plan</strong>tation en limites séparatives (H2 inférieure à 3,20m) ou en retrait <strong>de</strong><br />
la moitié <strong>de</strong> la hauteur H1 <strong>de</strong> la construction avec un minimum <strong>de</strong> 3 mètres<br />
Secteur UBp (hors UBpL)<br />
im<strong>plan</strong>tation selon les mêmes axes <strong>de</strong> composition que ceux <strong>de</strong>s constructions<br />
d’origine, à la date d’approbation du PLU.<br />
Art 9- Emprise au sol limitée à 75 % en UBa et UBpL et à 50% en UBb et UBp (hors<br />
UBpL)<br />
Art 10 –<br />
Secteur UBa<br />
BCP : hauteur H1 <strong>de</strong> 9 m + 5 m <strong>de</strong> hauteur plafond + gabarit à 45°<br />
BCS : hauteur H2 <strong>de</strong> 9 m <strong>de</strong> hauteur plafond + gabarit à 45°<br />
Secteur UBb<br />
BCP : hauteur H1 <strong>de</strong> 6 mètres + 5 mètres <strong>de</strong> hauteur plafond + gabarit <strong>de</strong> 45<br />
BCS : hauteur H2 <strong>de</strong> 6 mètres <strong>de</strong> hauteur plafond + gabarit <strong>de</strong> 45 °<br />
Secteur UBp<br />
<strong>Le</strong>s hauteurs maximales <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s (H1) et plafond (H2) ne peuvent dépasser<br />
<strong>de</strong> plus d’1,50 mètres les hauteurs H1 et H2 <strong>de</strong>s constructions existantes à la<br />
date d’approbation du PLU.<br />
Art 12 - Normes <strong>de</strong> stationnement pour les habitations : 1 pl/60 m²/SHON pour<br />
les logements collectifs 1pl/85m²SHON pour les individuels avec au moins 1<br />
place par logement ; pour les commerces : au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 300 m² SHON 1,5pl / 50 m²<br />
SHON puis au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 1000 m² <strong>de</strong> SHON, 2pl / 50m² SHON ; pour les bureaux :<br />
1pl / 50 m² SHON ; pour les hôtels : 1pl / 150 m² SHON ; pour les autres activités :<br />
1pl / 100 m² SHON<br />
Art.14 – COS non réglementé<br />
220
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Zone UPo<br />
Zonage et vocation<br />
UPo<br />
Zone UPm<br />
Zonage et vocation<br />
UPm<br />
Zone Uplh et Uple<br />
Zonage et vocation<br />
UPlh et UPle<br />
NPl<br />
La zone UPo couvre le projet urbain <strong>de</strong> la ZAC Ouest centre-ville, <strong>de</strong>stinée à<br />
recevoir <strong>de</strong>s logements et <strong>de</strong>s équipements participant directement au<br />
développement et au renouvellement urbain, dans le respect <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong><br />
mixité urbaine et sociale.<br />
Zone <strong>de</strong> projet comportant quatre secteurs adaptés à la mixité <strong>de</strong>s formes<br />
d’habitat :<br />
UPo1 : habitat groupé et petits collectifs<br />
UPo2 : habitat individuel<br />
UPo3 : équipements publics<br />
UPo4 : habitat existant<br />
I<strong>de</strong>m PLU en vigueur<br />
La zone UPm couvre le projet urbain <strong>de</strong> la ZAC <strong>de</strong> la Métairie, <strong>de</strong>stinée à recevoir<br />
<strong>de</strong>s logements et <strong>de</strong>s équipements participant directement au développement et<br />
au renouvellement urbain, dans le respect <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> mixité urbaine et<br />
sociale. .<br />
Zone <strong>de</strong> projet comportant trois secteurs adaptés à la mixité <strong>de</strong>s formes<br />
d’habitat :<br />
UPm1 : habitat à dominante collectif<br />
UPm2 : habitat groupé ou individuel<br />
UPm3 : habitat individuel et espaces paysagers<br />
I<strong>de</strong>m POS en vigueur<br />
<strong>Le</strong>s zones UPlh et UP<strong>Le</strong> couvrent le projet urbain <strong>de</strong> la ZAC <strong>de</strong>s Rives <strong>de</strong> Loire,<br />
<strong>de</strong>stinée à recevoir <strong>de</strong>s logements et <strong>de</strong>s équipements participant directement au<br />
développement et au renouvellement urbain, dans le respect <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong><br />
mixité urbaine et sociale. .<br />
Zone <strong>de</strong> projet comportant trois secteurs adaptés à la mixité <strong>de</strong>s formes<br />
d’habitat :<br />
UPlh1 : habitat collectif<br />
UPlh2 : habitat intermédiaire<br />
UPlh3 : habitat individuel<br />
UP<strong>Le</strong> : équipements publics<br />
I<strong>de</strong>m volet mise en compatibilité du PLU<br />
Ce secteur correspond à l’ancienne zone NDc du POS pour le parking lié à la ZAC<br />
Rives <strong>de</strong> Loire et pour une partie du quai Emile Paraf.<br />
221
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Zone UC<br />
La zone UC correspond aux hameaux dispersés dans l’espace rural.<br />
Zonage et vocation<br />
Secteurs et règlement<br />
La zone UC a un caractère d’habitat individuel . Elle est constituée par les<br />
hameaux dispersés dans le milieu rural.<br />
La zone UC comprend <strong>de</strong>ux secteurs :<br />
- UCb correspondant au hameau <strong>de</strong> Brimberne,<br />
- UCv correspondant au terrain d’accueil <strong>de</strong>s gens du voyage.<br />
Art 5 - pas <strong>de</strong> surface minimale<br />
Art 6 - Construction en recul fixe <strong>de</strong> 5 m par <strong>rapport</strong> à l’emprise publique ou à la<br />
voie .<br />
En UCv, construction en recul minimal <strong>de</strong> 5 m par <strong>rapport</strong> à l’emprise publique<br />
ou à la voie.<br />
Art 7 –BCP : im<strong>plan</strong>tation obligatoire sur au moins l’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux limites<br />
séparatives ou en retrait <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> la hauteur H1 <strong>de</strong> la construction avec un<br />
minimum <strong>de</strong> 3 mètres<br />
BCP : im<strong>plan</strong>tation sur l’une <strong>de</strong>s limites séparatives ou en retrait <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
limites (3 m)<br />
BCS : im<strong>plan</strong>tation sur l’une <strong>de</strong>s limites séparatives ou en retrait <strong>de</strong> la hauteur<br />
<strong>de</strong> h1 <strong>de</strong> la construction avec un minimum <strong>de</strong> 6 mètres<br />
Art 9- Emprise au sol limitée à 40%<br />
En UCb, emprise au sol limitée à 40% dans la BCP et à 20% dans la BCS.<br />
Art 10 -<br />
BCP : hauteur H1 <strong>de</strong> 6 mètres + 5 mètres <strong>de</strong> hauteur plafond + gabarit <strong>de</strong> 45°<br />
BCS : hauteur H2 <strong>de</strong> 6 mètres<br />
222
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Art 12 - Normes <strong>de</strong> stationnement pour les habitations : 1pl/85m²SHON avec au<br />
moins 1 place par logement; pour les commerces : au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 300 m² SHON 1,5pl<br />
/ 50 m² SHON puis au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 1000 m² <strong>de</strong> SHON, 2pl / 50m² SHON ; pour les<br />
bureaux : 1pl / 50 m² SHON ; pour les hôtels : 1pl / 150 m² SHON ; pour les autres<br />
activités : 1pl / 100 m² SHON<br />
Art 14 - COS non réglementé<br />
223
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
2. <strong>Le</strong>s zones urbaines à dominante d’activités et d’équipements<br />
Zone UE<br />
Secteurs et règlement<br />
Cette zone est <strong>de</strong>stinée à recevoir <strong>de</strong>s activités économiques <strong>de</strong> toute nature<br />
(commerces, industrie, entrepôts, artisanat, services, bureaux, équipements<br />
publics), à l’exception <strong>de</strong> certaines installations classées incompatibles avec le<br />
secteur rési<strong>de</strong>ntiel proche. Elle recouvre les zones d’activités <strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong><br />
Couëron et du Paradis, et les petites zones disséminées.<br />
La zone comprend un secteur UEa correspondant à la partie ouest et sud<br />
<strong>de</strong>s Hauts <strong>de</strong> Couëron dans laquelle les commerces ne sont pas autorisés.<br />
Art 5 - pas <strong>de</strong> surface minimale<br />
Art 6 - Construction à 5 mètres minimum <strong>de</strong> la voie sauf en UEa<br />
Art 7 - Im<strong>plan</strong>tation en retrait <strong>de</strong>s limites séparatives latérales au moins<br />
égal à 5 mètres<br />
Art 9 - L’emprise au sol n’est pas limitée<br />
UE<br />
Art 10 – Hauteur H2 limitée à 15 mètres<br />
Art 12 - Normes <strong>de</strong> stationnement pour les habitations : 1pl/85m²SHON ;<br />
pour les commerces : au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 300 m² SHON 1,5pl / 50 m² SHON puis au<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> 1000 m² <strong>de</strong> SHON, 2pl / 50m² SHON ; pour les bureaux : 1pl / 50 m²<br />
SHON ; pour les hôtels : 1pl / 150 m² SHON ; pour les autres activités : 1pl /<br />
100 m² SHON.<br />
Art 14 - COS non réglementé.<br />
224
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Zone UG<br />
La zone UG concerne les zones d’activités <strong>de</strong>s bords <strong>de</strong> la Loire et la carrière<br />
<strong>de</strong>s Daudières (UGc).<br />
Zonage et vocation<br />
Cette zone est <strong>de</strong>stinée à recevoir <strong>de</strong>s activités économiques ainsi que <strong>de</strong>s<br />
constructions et installations classées nécessaires aux services publics ou<br />
d’intérêt collectif, à l’exception <strong>de</strong>s bureaux et commerces non liées aux<br />
activités autorisées.<br />
Art 5 - pas <strong>de</strong> surface minimale<br />
Art 6 - Construction à 5 m minimum <strong>de</strong> la voie<br />
Art 7 - Im<strong>plan</strong>tation en retrait <strong>de</strong>s limites séparatives latérales au moins<br />
égal à 5 mètres<br />
UG<br />
Art 9 - L’emprise au sol n’est pas limitée<br />
Art 10 - Hauteur non réglementée<br />
Art 12 - Normes <strong>de</strong> stationnement pour les habitations : 1pl/85m²SHON ;<br />
pour les commerces : au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 300 m² SHON 1,5pl / 50 m² SHON puis au<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> 1000 m² <strong>de</strong> SHON, 2pl / 50m² SHON ; pour les bureaux : 1pl / 50 m²<br />
SHON ; pour les hôtels : 1pl / 150 m² SHON ; pour les autres activités : 1pl /<br />
100 m² SHON.<br />
Art 14 - COS non réglementé.<br />
225
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Zone UM<br />
Zonage et vocation<br />
La zone UM concerne le vélodrome et la Maison d’Accueil Spécialisé (M.A.S.).<br />
Cette zone est <strong>de</strong>stinée à recevoir un ensemble d’équipements publics ou<br />
d’intérêt collectif.<br />
Art 5 - pas <strong>de</strong> surface minimale<br />
Art 6 - Construction à 5 m minimum <strong>de</strong> la voie<br />
Art 7 - Im<strong>plan</strong>tation en retrait d’au moins la moitié <strong>de</strong> la hauteur H1 <strong>de</strong> la<br />
construction avec un minimum <strong>de</strong> 4 m par <strong>rapport</strong> aux limites séparatives<br />
UM<br />
Art 9 - L’emprise au sol est limitée à 70%<br />
Art 10 - Hauteur plafond <strong>de</strong> 19 mètres<br />
Art 12 - Normes <strong>de</strong> stationnement fonction <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s équipements, <strong>de</strong><br />
leur taux et rythme <strong>de</strong> fréquentation, <strong>de</strong> leur <strong>local</strong>isation, <strong>de</strong> leur<br />
regroupement et <strong>de</strong> leur taux <strong>de</strong> foisonnement.<br />
Art 14 - COS non réglementé.<br />
226
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
3. <strong>Le</strong>s zones à urbaniser<br />
Zone 1AU<br />
Zonage et vocation<br />
La zone 1AU correspond aux futures extensions urbaines, elle est ouverte à<br />
l’urbanisation et couvre les secteurs d’urbanisation prévus à court - moyen<br />
terme.<br />
La zone 1AU habitat concerne le secteur du Doceul.<br />
<strong>Le</strong>s zones 1AUe, <strong>de</strong>stinée aux activités économiques sont au nombre <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux : la Barrière Noire et la Lan<strong>de</strong> Bourne.<br />
1AUb et 1AUe<br />
Règlement = i<strong>de</strong>m UBb pour 1AUb et i<strong>de</strong>m UE pour 1AUe sauf :<br />
Art 2 - Opération d’aménagement d’ensemble sur toute la zone ou au fur<br />
et à mesure <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s réseaux + compatibilité avec les<br />
orientations d'aménagement<br />
Zone 2AU<br />
La zone 2AU correspond aux futures extensions urbaines <strong>de</strong> l'habitat, mais<br />
contrairement à la zone 1AU elle est fermée à l’urbanisation. En effet, elle a<br />
un caractère naturel et la capacité <strong>de</strong>s réseaux n’y est pas suffisante. Elle<br />
est inconstructible : son ouverture à l’urbanisation suppose préalablement<br />
la mise en oeuvre d’une procédure <strong>de</strong> modification ou <strong>de</strong> révision du PLU<br />
2AU<br />
Art 1 - Seules les extensions <strong>de</strong>s constructions existantes sont autorisées<br />
et limitées à 50 m² <strong>de</strong> SHON.<br />
Art 7 - <strong>Le</strong> retrait / limites séparatives est <strong>de</strong> 6 m et au moins égal à la<br />
hauteur <strong>de</strong> la construction<br />
227
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
4. La zone agricole<br />
Zone A<br />
La zone A s’étend sur les terres agricoles <strong>de</strong> la commune, excepté celles<br />
classées en zone N pour leur préservation.<br />
Zonage et vocation<br />
La zone caractérise les espaces agricoles où sont autorisés les<br />
bâtiments agricoles et les installations nécessaires aux services publics<br />
ou d’intérêt collectif.<br />
A<br />
Art 5 - pas <strong>de</strong> surface minimale.<br />
Art 6 – Im<strong>plan</strong>tation en recul minimal <strong>de</strong> 5 mètres<br />
Art 7 - Im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions soit en limites séparatives soit<br />
en retrait d’au moins 3 m et au moins égal à la hauteur h1 <strong>de</strong> la<br />
construction.<br />
Art 9 - Emprise au sol non réglementée.<br />
Art 10 - Hauteur <strong>de</strong>s habitations limitée à 6 m + 5 m<br />
Art 14 - COS non réglementé.<br />
228
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
5. <strong>Le</strong>s zones naturelles<br />
Zone NX<br />
La zone NX couvre les secteurs dont la pérennité agricole n’est pas<br />
garantie au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce PLU.<br />
Zonage et vocation<br />
NX<br />
La zone NX couvre un secteur situé au nord <strong>de</strong> la Croix Gicquiau, un<br />
secteur situé au nord <strong>de</strong> la Sinière et un secteur situé au nord <strong>de</strong> la<br />
gare.<br />
Art 5 - non réglementé<br />
Art 6 - Construction à 5 m minimum <strong>de</strong> la voie.<br />
Art 7 - Im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions soit en limites séparatives, soit<br />
en retrait d’au moins 3 m et au moins égal à la hauteur <strong>de</strong> la<br />
construction.<br />
Art 9 - Emprise au sol non réglementée.<br />
Art 10 - Hauteur <strong>de</strong> 6m+5m<br />
Art 14 - COS non réglementé.<br />
229
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Zone NH<br />
Zonage et vocation<br />
Secteurs et règlement<br />
NH<br />
La zone NH correspond aux constructions <strong>de</strong> tiers isolées en milieu rural.<br />
La zone caractérise ces sites construits où l’évolution <strong>de</strong>s habitations est<br />
autorisée, mais <strong>de</strong> manière très restreinte.<br />
La zone comprend un secteur NHp dans lequel le changement <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s constructions est autorisé. La SHOB <strong>de</strong>s constructions ou<br />
extension est limitée à 50 m².<br />
Art 5 - non réglementé<br />
Art 6 - Construction à 5m minimum <strong>de</strong> la voie.<br />
Art 7 - Im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions soit en limite (hauteur plafond <strong>de</strong><br />
3,20 m), soit en retrait d’au moins 3 m et au moins égal à la hauteur <strong>de</strong> la<br />
construction.<br />
Art 9 - Emprise au sol non réglementée.<br />
Art 10 - Hauteur <strong>de</strong> 3,20 m + 3 m (si extension <strong>de</strong> l’existant, même<br />
hauteur)<br />
Art 14 - COS non réglementé.<br />
230
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Zone NN<br />
Zonage et vocation<br />
La zone NN s’étend sur les espaces naturels, particulièrement les rives <strong>de</strong><br />
Loire et ses zones humi<strong>de</strong>s, ainsi que <strong>de</strong> la Chézine<br />
Cette zone protège les espaces naturels d’intérêt paysager ou écologique.<br />
Secteurs et règlement<br />
NN<br />
Zonage et vocation<br />
La zone comprend <strong>de</strong>ux secteurs : NNs et NNf.<br />
<strong>Le</strong> secteur NNs correspond zones humi<strong>de</strong>s protéges au titre <strong>de</strong> Natura<br />
2000 et/ou classées en ZNIEFF. Seuls sont autorisés les aménagements,<br />
ouvrages, installations directement nécessaires à la gestion <strong>de</strong> la<br />
fréquentation du public à l’exclusion <strong>de</strong>s aires <strong>de</strong> stationnement.<br />
<strong>Le</strong> secteur NNf est <strong>de</strong>stiné au site <strong>de</strong> la forêt urbaine.<br />
Art 5 - non réglementé<br />
Art 6 – Recul <strong>de</strong> 0 ou 5m minimum par <strong>rapport</strong> à l’emprise publique ou à<br />
la voie<br />
Art 7 - Im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions soit en limites séparatives, soit en<br />
retrait d’au moins 3 m.<br />
Art 9 - Emprise au sol non réglementée.<br />
Art 10 - Hauteur <strong>de</strong> 3,20m + 3m (si extension, même hauteur que<br />
l’existant)<br />
Art 14 - COS non réglementé.<br />
Sont admis, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
sites, milieux naturels et paysages, les ouvrages et installations<br />
directement nécessaires à l’entretien <strong>de</strong>s <strong>plan</strong>s d’eau, à la navigation, aux<br />
habitations, activités portuaires ainsi que les ouvrages et équipements<br />
d’intérêt collectif et/ou public.<br />
231
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
NE<br />
Art 5- non réglementé<br />
Art 6- et 7 - pas <strong>de</strong> condition d’im<strong>plan</strong>tation<br />
Art 9 – non réglementé.<br />
Art 10 – Hauteur non limitée<br />
Art 12 - Nombre <strong>de</strong> places à déterminer selon la nature et la <strong>de</strong>stination<br />
du projet, ses taux et rythme <strong>de</strong> fréquentation, sa situation par <strong>rapport</strong><br />
aux transports en commun.<br />
Art 14 – non réglementé.<br />
Zone NL<br />
La zone NL correspond principalement aux abords du lac <strong>de</strong> Beaulieu, au<br />
secteur <strong>de</strong> Beaulieu et à l’Erdurière.<br />
La zone caractérise les espaces naturels <strong>de</strong>stinés à être aménagés pour<br />
<strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> découverte et <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong> plein air. Elle couvre aussi les<br />
cimetières paysagers.<br />
Zonage et vocation<br />
La zone NL comprend :<br />
- un secteur NLf <strong>de</strong>stiné à <strong>de</strong>s activités sportives et <strong>de</strong> loisirs <strong>de</strong><br />
plein air dans le site <strong>de</strong> la forêt urbaine.<br />
- Un secteur NLj correspondant aux jardins familiaux à créer.<br />
NL<br />
Art 5 - non réglementé<br />
Art 6 – Im<strong>plan</strong>tation en limite ou en recul <strong>de</strong> 5 mètres minimum par<br />
<strong>rapport</strong> à l’emprise publique ou à la voie (sauf en NLj, non limité)<br />
232
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
NL<br />
Art 7 - Im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong>s constructions soit en limites séparatives, soit en<br />
retrait d’au moins 6 m (sauf NLj, non limité)<br />
Art 9 - L’emprise au sol doit être inférieure à 30 % <strong>de</strong> la superficie du<br />
terrain d’assiette du projet.<br />
Art 10 – Hauteur plafond limité à 9 mètres<br />
233
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
IIV– LES SERVIITUDES D’’URBANIISME PARTIICULIIERES<br />
1. <strong>Le</strong>s servitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> constructibilité limitée (L123-2-a)<br />
En application <strong>de</strong>s articles L 123-2-a) et R 123-12-1° du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'Urbanisme, le P.L.U. peut instituer en zones<br />
urbaines une servitu<strong>de</strong> consistant à limiter les droits à construire, dans un périmètre délimité et pour une<br />
durée au plus <strong>de</strong> cinq ans, dans l'attente <strong>de</strong> l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement<br />
global.<br />
Deux périmètres ont été délimités :<br />
- boulevard Paul Langevin : ce secteur est classé en UBa. Il est occupé par un supermarché et ses<br />
équipements (parking, station <strong>de</strong> lavage automobile, station-essence), une friche agricole et <strong>de</strong>s terrains <strong>de</strong><br />
sports utilisés par les équipements scolaires voisins. <strong>Le</strong>s enjeux d’aménagement sont forts : renforcer<br />
l’attractivité commerciale <strong>de</strong> la rue Alexandre Olivier, diversifier le parc <strong>de</strong> logements en centre-ville, mettre<br />
en place <strong>de</strong>s continuités piétonnes entre le boulevard Paul Langevin et la rue Jean Jaurès.<br />
- cité ouvrière du Bossis : ce secteur est classé en UBp. Il correspond à l’ancienne cité ouvrière du Bossis<br />
construite dans les années 1920 pour loger les ouvriers <strong>de</strong> Tréfimétaux. <strong>Le</strong>s logements appartiennent<br />
aujourd’hui à la SAMO, bailleur social. L’enjeu est <strong>de</strong> permettre l’adaptation <strong>de</strong> l’habitat aux normes <strong>de</strong><br />
confort actuelles et aux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie contemporains tout en préservant la structure urbaine <strong>de</strong> cette cité<br />
ainsi que ses caractéristiques architecturales et paysagères.<br />
Dans les périmètres considérés, les constructions ou installations supérieures à 20 m² <strong>de</strong> SHOB sont<br />
interdites. Toutefois, l'adaptation, le changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination, la réfection et l'extension <strong>de</strong>s<br />
constructions existantes sont autorisés.<br />
L'effet <strong>de</strong> la servitu<strong>de</strong> a une durée <strong>de</strong> cinq ans à compter <strong>de</strong> la date d'approbation du P.L.U. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce<br />
délai, la servitu<strong>de</strong> est levée automatiquement. Ce sont alors les dispositions <strong>de</strong> la zone dans laquelle se situe<br />
le périmètre qui <strong>de</strong>viennent pleinement applicables.<br />
<strong>Le</strong>s effets <strong>de</strong> la servitu<strong>de</strong> peuvent également être levés à l'initiative <strong>de</strong> la collectivité, avant le délai <strong>de</strong> cinq<br />
ans, par une procédure <strong>de</strong> modification du P.L.U.<br />
Un droit <strong>de</strong> délaissement au profit <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par<br />
cette servitu<strong>de</strong>, en application <strong>de</strong> l'article L 123-17 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'Urbanisme.<br />
2 <strong>Le</strong>s emplacements réservés (L123-1-8)<br />
En application <strong>de</strong>s articles L 123-1-8° et R 123-11 d) du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'Urbanisme, <strong>de</strong>s emplacements réservés pour<br />
voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U.<br />
L'inscription d'un emplacement réservé rend inconstructible, sauf à titre précaire, le terrain ou portion <strong>de</strong><br />
terrain concerné pour toute autre utilisation que celle prévue.<br />
Un droit <strong>de</strong> délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par cette servitu<strong>de</strong>, en application<br />
<strong>de</strong> l'article L 123-17 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'Urbanisme.<br />
Pour le calcul <strong>de</strong>s droits à construire, les emplacements réservés sont déduits <strong>de</strong> la superficie du terrain<br />
conformément à l’article R.123-10 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme.<br />
<strong>Le</strong> PLU a permis <strong>de</strong> mettre à jour les réserves antérieures : reconduction, abandon <strong>de</strong>s réserves <strong>de</strong>venues<br />
inutiles, suppression <strong>de</strong>s réserves réalisées dans le cadre du POS précé<strong>de</strong>nt.<br />
Plusieurs emplacements réservés ont été supprimés du fait <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s projets ou, au contraire, <strong>de</strong><br />
leur abandon. D’autres ont été reconduits. Une nouvelle numérotation a été mise en place incluant anciens<br />
et nouveaux emplacements.<br />
234
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
<br />
Emplacement réservé pour voies nouvelles, accès, élargissement et aires <strong>de</strong><br />
stationnement<br />
Accès à créer<br />
L’aménagement <strong>de</strong>s zones AU passe par la réalisation d’accès et l’aménagement <strong>de</strong> voiries. Ainsi, 2<br />
emplacements réservés (ER n° 11 et 12) visent à assurer l’accès à la zone 2AU du Bois Laurent.<br />
Ces ER sont au bénéfice <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole.<br />
Aménagement et/ou élargissement <strong>de</strong> voirie<br />
L’ER n° 1 a pour objet l’aménagement <strong>de</strong> voirie pour le compte <strong>de</strong> l’Etat..<br />
L’ER n° 5 a pour objet l’aménagement <strong>de</strong> voirie pour le compte du Conseil Général.<br />
<strong>Le</strong>s ER n°3, 4, 5, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24 et 26 ont pour objectif d’élargir (ER n°17, 20, 22), d’améliorer(ER n°3, 17)<br />
ou <strong>de</strong> créer (ER n°4, 13, 14, 19, 24, 26) <strong>de</strong>s voies afin d’améliorer la <strong>de</strong>sserte <strong>local</strong>e. Ces ER sont au bénéfice <strong>de</strong><br />
<strong>Nantes</strong> Métropole.<br />
Aménagement d’aires <strong>de</strong> stationnement<br />
Ils concernent les ER n° 7 et 8 et sont au bénéfice <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole pour la gare TER.<br />
L’ER n° 16 est <strong>de</strong>stiné à la création d’une aire <strong>de</strong> stationnement pour la Gerbetière et est au bénéfice <strong>de</strong> la<br />
commune.<br />
<br />
Emplacements réservés pour cheminements piétons et liaisons cyclables<br />
Liaisons piétonnes urbaines<br />
L’ER n°6 vise à développer une continuité piétonne entre les équipements et les quartiers d’habitat . Situé en<br />
zone urbaine, il est au bénéfice <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole.<br />
Liaisons cyclables<br />
L’ER n°27 vise la réalisation d’une piste cyclable dans le cadre du projet intercommunal « Loire à Vélo ».<br />
<br />
Emplacement réservé pour équipements collectifs<br />
Espaces verts à créer ou à préserver<br />
<strong>Le</strong>s ER n° 9, 18 et 23 visent à préserver ou créer <strong>de</strong>s espaces naturels, verts ou festifs et <strong>de</strong> rencontres. Ils sont<br />
au bénéfice <strong>de</strong> la commune.<br />
Jardins familiaux à créer<br />
Ils concernent les ER n° 10 et 25 et sont au bénéfice <strong>de</strong> la commune.<br />
Bassins <strong>de</strong> rétention <strong>de</strong>s eaux pluviales<br />
Ils concernent les ER n° 2 (Etat) et 21 (<strong>Nantes</strong> Métropole).<br />
Poste <strong>de</strong> relèvement eaux usées<br />
Il concerne l’ ER n° 15 et est au bénéfice <strong>de</strong> <strong>Nantes</strong> Métropole.<br />
235
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
3. <strong>Le</strong>s espaces boisés classés (EBC)<br />
Conformément à l’article L130-1, <strong>de</strong>s espaces boisés classés sont délimités dans le PLU.<br />
Ils couvrent une surface 7,5 ha, soit 2,5 ha <strong>de</strong> plus que dans le POS <strong>de</strong> 2000.<br />
4. <strong>Le</strong>s éléments du patrimoine bâti ou paysager à préserver<br />
Il s’agit ici <strong>de</strong> protéger les éléments du patrimoine bâti ou paysager les plus intéressants sur la commune tel<br />
que le permet l’article L.123-1-7°) du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Urbanisme. Toute atteinte à ces éléments est soumise à<br />
permis <strong>de</strong> démolir. voir la partie 2.6 du présent chapitre pour davantage <strong>de</strong> détails.<br />
En matière <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s éléments végétaux, l’aménagement foncier en cours <strong>de</strong>vant i<strong>de</strong>ntifier les<br />
éléments les plus intéressants, seuls ont été repris les espaces protégés dans les différentes ZAC.<br />
5. <strong>Le</strong>s cheminements à préserver<br />
Un recensement exhaustif <strong>de</strong>s cheminements parcourant le territoire communal a été réalisé. Il figure dans<br />
les annexes au titre <strong>de</strong>s périmètres d’information.<br />
6. les servitu<strong>de</strong>s d’utilité publique<br />
Conformément à l’article L 126-1<br />
affectant l’utilisation du sol.<br />
du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme, le PLU comporte en annexe les servitu<strong>de</strong>s<br />
236
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
237
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
Chapitre V-<br />
L’impact du <strong>plan</strong> sur l’environnement et<br />
les mesures compensatoires<br />
237
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
238
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
II- BIILAN DE LA CONSOMMATIION D’’ESPACE A<br />
VENIIR<br />
Si l’objectif premier <strong>de</strong> la ville est <strong>de</strong> privilégier l’urbanisation <strong>de</strong>s trois ZAC en cours (Ouest centreville,<br />
Métairie et Rives <strong>de</strong> Loire) et d’organiser le renouvellement urbain dans les espaces bâtis, le PLU<br />
prévoit, pour satisfaire les besoins dans un horizon <strong>de</strong> 10 ans, l’ouverture <strong>de</strong> différentes zones à<br />
vocation d’habitat et d’activités économiques.<br />
1. Consommation d’espace pour l’habitat<br />
L’urbanisation pour l’habitat a été réservée sous la forme d’une part <strong>de</strong> zones 1 AU – zones ouvertes à<br />
l’urbanisation, d’autre part <strong>de</strong> zones 2 AU.<br />
La zone 1 AU réservée à l’habitat représente une surface globale <strong>de</strong> 1,35 ha.<br />
<strong>Le</strong>s zones 2 AU pour l’habitat offrent environ 15 ha. Cela représente 0,3 % du territoire communal.<br />
Pour comparaison, les espaces déjà urbanisés, à vocation d’habitat, représentent environ 640 ha<br />
soit 13 % <strong>de</strong> la commune. A terme, les espaces urbanisés pour l’habitat et les équipements<br />
représenteront donc environ ha, soit 13,5 % <strong>de</strong> la surface totale.<br />
2. Consommation d’espace pour les activités économiques<br />
<strong>Le</strong>s zones 1AUe représentent environ 11 ha contre 85 ha dans le POS <strong>de</strong> 2000.<br />
Cette offre est complétée par la zone 2AU <strong>de</strong> la rue <strong>de</strong> Bretagne, fermée à l’urbanisation mais voué<br />
aux activités économiques (environ 2 ha).<br />
Pour comparaison, les zones urbaines à vocation d’activités s’éten<strong>de</strong>nt aujourd’hui sur environ 262 ha.<br />
239
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
240
COUERON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
IIII- L’’IIMPACT DU PLAN SUR L’’ENVIIRONNEMENT ET<br />
LES MESURES COMPENSATOIIRES<br />
Pour faciliter une vue d’ensemble <strong>de</strong> l’impact du projet dans ses différentes dimensions, ce point est<br />
présenté sous la forme d’un tableau qui met en regard les objectifs du PADD, les impacts prévisibles<br />
sur l’environnement et les dispositions du PLU qui visent à compenser ces impacts. En complément <strong>de</strong><br />
ce tableau, la commune <strong>de</strong> Couëron étant concernée par le site Natura 2000, il convient <strong>de</strong> préciser<br />
comment le projet <strong>de</strong> PLU intègre le respect <strong>de</strong> ce site Natura 2000.<br />
1. La zone Natura 2000 elle-même<br />
La zone Natura 2000 <strong>de</strong> Couëron est composée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux sites : le site d’importance communautaire<br />
« Estuaire <strong>de</strong> La Loire » au titre <strong>de</strong> la directive « Habitats » et la zone <strong>de</strong> protection spéciale « Estuaire<br />
<strong>de</strong> La Loire » au titre <strong>de</strong> la Directive « Oiseaux ».<br />
La zone Natura 2000 est couverte par <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> zones :<br />
- La partie en eau du fleuve est classée en NE, zone qui n’autorise que « les ouvrages et<br />
installations directement nécessaires à l’entretien <strong>de</strong>s <strong>plan</strong>s d’eau, à la navigation et aux<br />
activités portuaires… » sous réserve qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sites, <strong>de</strong>s<br />
milieux naturels et <strong>de</strong>s paysages (article 2 du règlement) ;<br />
En particulier, les remblais sont interdits (article 3 du règlement), et les équipements réalisés<br />
doivent être raccordés aux réseaux qui leur sont nécessaires (article 4 du règlement) ;<br />
- <strong>Le</strong> Marais Audubon qui s’étend <strong>de</strong>puis la limite ouest <strong>de</strong> la commune jusqu’à Pierre Tamis à<br />
l’ouest du bourg, les prairies <strong>de</strong> Loire au sud-ouest du bourg, une partie <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Beaulieu, une partie <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Pâtissière sont classées en zone NNs, correspondant à<br />
une zone <strong>de</strong> protection stricte où seuls les cheminements pour les piétons sont autorisés, <strong>de</strong><br />
même que les sanitaires. <strong>Le</strong>s stationnements y sont interdits. <strong>Le</strong>s prairies sont parcourues <strong>de</strong><br />
continuités piétonnes existantes. <strong>Le</strong> circuit Loire à vélo empruntera une partie <strong>de</strong> ces<br />
itinéraires entre le centre-ville et le bac : cette continuité fera l’objet d’un traitement<br />
spécifique intégrant la protection <strong>de</strong>s milieux traversés et la sensibilisation <strong>de</strong>s usagers <strong>de</strong> ce<br />
circuit au site naturel ;<br />
- <strong>Le</strong> site concerné par l’arrêté <strong>de</strong> biotope au sud du quai Emile Paraf a été lui aussi classé en<br />
zone NNs, zone <strong>de</strong> protection stricte.<br />
Ainsi le territoire couvert par Natura 2000 a été zoné <strong>de</strong> façon à ce qu’aucun projet ne soit susceptible<br />
d’avoir un effet notable sur celui-ci.<br />
2. <strong>Le</strong>s zones <strong>de</strong> contact avec Natura 2000<br />
Pour ce qui concerne les zonages en contact direct avec le territoire <strong>de</strong> Natura 2000, il convient <strong>de</strong> les<br />
prendre en compte territoire par territoire.<br />
En partant <strong>de</strong> l’Est, à partir <strong>de</strong>s limites communales <strong>de</strong> Saint-Herblain et d’Indre, le territoire est<br />
couvert par les zones suivantes :<br />
- <strong>Le</strong> quartier <strong>de</strong> la Chabossière est classé en zones UB comme dans le POS <strong>de</strong> 2000. Un secteur<br />
UBp a été créé correspondant aux cités ouvrières <strong>de</strong> la Bertaudière, du Berligout et <strong>de</strong> la<br />
Chabossière. Pour préserver la trame urbaine d’origine, les règles d’urbanisme interdisent les<br />
constructions nouvelles, à l’exception <strong>de</strong> la démolition-reconstruction sur les mêmes<br />
emprises et globalement selon les mêmes volumes, et limitent les extensions à 50% <strong>de</strong> la<br />
SHON existante à la date d’approbation du PLU. Ces règles restrictives vont dans le sens d’un<br />
moindre impact <strong>de</strong> l’urbanisation sur le milieu environnant par <strong>rapport</strong> aux règles existantes<br />
dans le POS <strong>de</strong> 2000 ;<br />
241
COUËRON<br />
Rapport <strong>de</strong> Présentation<br />
- <strong>Le</strong>s abords immédiats du lac <strong>de</strong> Beaulieu sont classés en zone naturelle <strong>de</strong> loisirs (NL) comme<br />
dans le POS <strong>de</strong> 2000. Ce site aménagé <strong>de</strong> façon légère pour la promena<strong>de</strong> n’a pas fait l’objet<br />
d’extension ; aucun autre projet n’est envisagé à ce jour sur ce site ;<br />
- <strong>Le</strong> centre-ville <strong>de</strong> Couëron n’a pas fait l’objet <strong>de</strong> modification règlementaire par <strong>rapport</strong> au<br />
document d’urbanisme en vigueur. <strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> Rives <strong>de</strong> Loire a fait l’objet d’une étu<strong>de</strong><br />
d’impact spécifique dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en<br />
compatibilité du PLU en cours d’instruction ;<br />
- <strong>Le</strong> vélodrome, classé en zone UM qui autorise les grands équipements d’échelle<br />
supracommunale, était déjà classé en zone d’équipement dans le POS. Il vient <strong>de</strong> faire l’objet<br />
d’une réhabilitation complète. Aucun autre projet n’est envisagé à ce jour sur ce site ;<br />
- <strong>Le</strong> site du Paradis était déjà classé en zone d’urbanisation à vocation économique (NAg) pour<br />
<strong>de</strong>s industries lour<strong>de</strong>s. Il est désormais classé en UE selon la même délimitation que dans le<br />
POS <strong>de</strong> 2000. Ce zonage est donc plus favorable par <strong>rapport</strong> à l’environnement puisque les<br />
installations classées y sont autorisées à condition que toute disposition soit mise en œuvre<br />
pour les rendre compatible avec le milieu environnant. Toutes les modifications d’usage du<br />
site ou <strong>de</strong>s bâtiments doivent donc aller dans le sens d’une amélioration <strong>de</strong>s impacts<br />
éventuels sur l’environnement.<br />
<strong>Le</strong>s contacts directs entre l’urbanisation et le site Natura 2000 se font au niveau <strong>de</strong> la Chabossière à<br />
l’est, <strong>de</strong>s quais dans le centre-ville, du secteur du Paradis à l’ouest. Toutefois, le PLU n’apporte pas <strong>de</strong><br />
modifications majeures <strong>de</strong> la situation réglementaire par <strong>rapport</strong> au POS. Une zone située à l’ouest <strong>de</strong><br />
l’étier <strong>de</strong> Beaulieu et en contact direct avec la Loire, anciennement classée en NAg, a même été<br />
reclassée en zone NN, du fait <strong>de</strong> son caractère inondable.<br />
<strong>Le</strong>s projets qui pourraient éventuellement voir le jour sur ces territoires <strong>de</strong>vront démontrer,<br />
préalablement à leur mise en œuvre, leur absence d’effet notable sur le site Natura 2000.<br />
En tout état <strong>de</strong> cause, le projet <strong>de</strong> PLU proposé améliore sensiblement la situation qui découle du<br />
document d’urbanisme actuel et n’autorise pas la mise en œuvre <strong>de</strong> projets qui auraient un effet<br />
notable sur le site Natura 2000.<br />
242
COUËRON<br />
Inci<strong>de</strong>nces prévisibles sur ...<br />
Rapport <strong>de</strong> présentation<br />
Objectifs <strong>de</strong> la commune et effets<br />
attendus<br />
paysage - consom. espace<br />
biodiversité - milieu naturel<br />
qualité <strong>de</strong> l'eau - traitement<br />
sols - sous sols -pollutions<br />
nuisances sonores<br />
Promouvoir une urbanisation diversifiée pour favoriser le développement durable du territoire coueronnais<br />
qualité <strong>de</strong> l'air - pollution<br />
cadre <strong>de</strong> vie - déplac.- sécur.<br />
gest. ressources - énergies<br />
déchets<br />
risques naturels<br />
risques industriels<br />
Impacts positifs<br />
Bilan <strong>de</strong>s impacts<br />
Impacts négatifs<br />
Dispositions du PLU et mesures<br />
compensatoires à mettre en œuvre<br />
Prévoir <strong>de</strong> nouvelles zones d'urbanisation<br />
futures à long terme<br />
Mettre en valeur les ZAC d'habitat Ouest centreville,<br />
Rives <strong>de</strong> Loire, Métairie<br />
Créer une secon<strong>de</strong> aire d'accueil pour les gens<br />
du voyage<br />
Réponse aux besoins quantitatifs <strong>de</strong><br />
logements<br />
-L'im<strong>plan</strong>tation <strong>de</strong> nouvelles zones<br />
d'habitat tend à réduire la surface et le<br />
taux <strong>de</strong>s espaces naturels, espaces <strong>de</strong><br />
respiration urbaine <strong>de</strong> la commune.<br />
-Certaines zones choisies pour les<br />
extensions d'habitat correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s<br />
secteurs agricoles bocagers présentant un<br />
intérêt écologique et paysager<br />
-L'urbanisation tend à accentuer les<br />
surfaces imperméables <strong>de</strong> la commune et<br />
à augmenter les volumes d'eaux pluviales<br />
à évacuer vers les cours d'eau, ainsi que les<br />
volumes d'eaux usées et les volumes <strong>de</strong><br />
déchets à traiter.<br />
-Proximité d'insfrastructures bruyantes<br />
-Nombreux sites et sols pollués répertoriés<br />
sur la commune<br />
<strong>Le</strong>s règles <strong>de</strong>s zones urbaines centrales favorisent <strong>de</strong>s<br />
programmes d'habitat permettant une <strong>de</strong>nsification<br />
sous <strong>de</strong>s formes mitoyennes, ainsi que le respect <strong>de</strong>s<br />
formes architecturales <strong>local</strong>es. <strong>Le</strong>s zones 1 AU font<br />
l'objet d'orientations d'aménagement qui encadrent<br />
les aménagements futurs par plusieurs principes : un<br />
respect <strong>de</strong>s éléments naturels remarquables (arbres,<br />
haies, mares...), <strong>de</strong>s éléments bâtis <strong>de</strong> qualité, la<br />
création <strong>de</strong> cheminements piétons et <strong>de</strong>ux roues au<br />
sein <strong>de</strong>s zones et pour les relier aux quartiers<br />
environnants, l'i<strong>de</strong>ntification d'espaces publics<br />
structurants. Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong>s zones 1 AU, le PLU protège les<br />
éléments bâtis et végétaux remarquables en déclinant<br />
la loi paysage (article L. 123-1-7).<br />
Maintenir les villages dans leur périmètre<br />
existant et contenir l'évolution du bâti dispersé<br />
Préserver le pâtromoine bâti, i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong><br />
l'histoire communale (Chabossière, …)<br />
Ouvrir la ville sur l'agglomération<br />
Limitation <strong>de</strong> l'étalement urbain<br />
Economie <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> fonctionnement<br />
d'investissements en équipements et<br />
services publics<br />
Protection et mise en valeur du patrimoine<br />
communal et du cadre <strong>de</strong> vie<br />
<strong>Le</strong> zonage ainsi que les règles <strong>de</strong> la zone UC qui<br />
correspond aux hameaux encadre le développement<br />
<strong>de</strong> l'urbanisation.<br />
Un secteur spécifique a été créé pour le hameau <strong>de</strong><br />
Brimberne <strong>de</strong> façon à limiter la constructibilité et<br />
réduire les divisions parcellaires.<br />
<strong>Le</strong>s élements les plus signfictaifs en termes<br />
d'architecture, <strong>d'urbanisme</strong> ou <strong>de</strong> paysage ont été<br />
étoilés au titre <strong>de</strong> l'article L 123-1,7° du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l'Urbanisme. Des secteurs "patrimoine" ont été créés<br />
au titre <strong>de</strong> ce même article pour préserver le quartier<br />
du Port Launay et les cités ouvrières, typiques <strong>de</strong><br />
l'urbanisation <strong>de</strong> Couëron au milieu du 20e siècle.<br />
Poursuivre l'aménagement <strong>de</strong>s parcs d'activité<br />
communautaire<br />
Dynamisme économique <strong>de</strong> la commune,<br />
accueil <strong>de</strong> nouvelles activités<br />
Impact visuel éventuel par <strong>rapport</strong> aux<br />
axes routiers, habitat.<br />
L'article 13 du règlement du PLU impose <strong>de</strong>s<br />
aménagements paysagers et <strong>de</strong>s <strong>plan</strong>tations sur une<br />
partie <strong>de</strong>s espaces libres <strong>de</strong> construction.<br />
Perte <strong>de</strong> surface végétale et perméable sur<br />
la commune.<br />
L'aménagement <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong>vra respecter la Loi sur<br />
l'Eau imposant aux aménageurs <strong>de</strong> ne pas augmenter<br />
les rejets d'eaux pluviales. Cela signifie la mise en<br />
place <strong>de</strong> solutions internes aux zones aménagées<br />
(bassin d'orage, structures réservoirs à couches <strong>de</strong><br />
fondation poreuses...).<br />
Risques industriels et nuisances liées aux<br />
activités<br />
Augmentation <strong>de</strong>s surfaces<br />
imperméabilisées et <strong>de</strong>s quantités<br />
potentielles <strong>de</strong> rejets pollués<br />
S'assurer <strong>de</strong> la bonne prise en charge <strong>de</strong>s déchets et<br />
effluents par les activités. Eventuellement, assurer le<br />
raccor<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s sites aux réseaux <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s<br />
eaux et <strong>de</strong>s déchets et prévoir les capacités <strong>de</strong><br />
traitement adaptées.<br />
Prévoir <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> respiration/sécurité suffisant à<br />
l'interface avec les zones d'habitat<br />
Gestion <strong>de</strong>s sites et sols pollués<br />
Créer <strong>de</strong>s bassins <strong>de</strong> rétention <strong>de</strong>s eaux pluviales<br />
équipés <strong>de</strong> systèmes <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s eaux adaptés<br />
Assurer le raccor<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s sites aux réseaux <strong>de</strong><br />
traitement <strong>de</strong>s eaux et <strong>de</strong>s déchets. Prévoir les<br />
capacités <strong>de</strong> traitement adaptées<br />
Consommation d'espaces agricoles.<br />
Préserver le réseau bocager et le patrimoine végétal.<br />
Préserver les corridors écologiques entre la Loire et la<br />
Chézine<br />
Conforter le dynamisme <strong>de</strong> l'agriculture<br />
Couêronnaise<br />
Permet <strong>de</strong> préserver les espaces naturels<br />
notamment les vallons et espaces<br />
sensibles (limitation <strong>de</strong><br />
l'imperméabilisation, <strong>de</strong>s rejets polluants...)<br />
Permet <strong>de</strong> maintenir <strong>de</strong>s espaces agricoles<br />
non urbanisés et entretenus, ce qui est<br />
favorable d'un point <strong>de</strong> vue<br />
environnemental et paysager, mais aussi<br />
permet <strong>de</strong> maintenir une certaine i<strong>de</strong>ntité<br />
rurale à la commune<br />
<strong>Le</strong> zonage A permet <strong>de</strong> garantir la pérennité <strong>de</strong>s<br />
espaces agricoles pour ce PLU et le suivant. <strong>Le</strong>s<br />
conditions d'exploitation seront améliorées par le<br />
biais d'un aménagement foncier. <strong>Le</strong> mitage est stoppé<br />
du fait <strong>de</strong> la définition très restrictive <strong>de</strong>s zones NH<br />
pour n'autoriser que les constructions très mesurées<br />
(extensions, annexes).<br />
Améliorer la <strong>de</strong>sserte vers la gare par <strong>de</strong>s<br />
déplacements alternatifs<br />
Améliorer les déplacements et la <strong>de</strong>sserte vers<br />
<strong>Nantes</strong> (train-tram, nouvelles voiries)<br />
Valoriser le patrimoine naturel pour conforter la qualité <strong>de</strong> vie<br />
Sécurisation <strong>de</strong>s liaisons piétonnes et<br />
cyclistes<br />
Développement <strong>de</strong> solutions alternatives<br />
<strong>de</strong> déplacement automobile ==> réduction<br />
<strong>de</strong> la pollution atmosphérique et <strong>de</strong>s<br />
nuisances sonores<br />
Si le cheminement se situe dans <strong>de</strong>s<br />
espaces naturels sensibles attention à<br />
l'impact sur la flore (piétinement) et la<br />
faune (dérangement)<br />
<strong>Le</strong> PLU prévoit <strong>de</strong>s emplacements réservés pour <strong>de</strong>s<br />
continuités piétonnes et/ou cyclables.<br />
<strong>Le</strong>s cheminements piétons dans les espaces naturels<br />
sensibles seront strictement encadrés : panneaux<br />
d'information, sensibilisation aux espèces.<br />
Limiter les aménagements en zones inondables.<br />
Tenir compte <strong>de</strong> la quiétu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sites, vitale pour<br />
certaines espèces ==> aménagements spécifiques<br />
limitant le dérangement <strong>de</strong>s espèces (par exemple<br />
cabane d'observation <strong>de</strong>s oiseaux...)<br />
Préserver et mettre en valeur le marais<br />
d'Audubon<br />
Aménager <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> loisirs (Daudière) et<br />
conforter les zones <strong>de</strong> loisirs existantes<br />
(Erdurière, Beaulieu)<br />
Mise en valeur du patrimoine naturel<br />
Protection <strong>de</strong> ces milieux sensibles, <strong>de</strong>s<br />
espèces inféodées à ces milieux<br />
Risque d'impact d'une ouverture au public<br />
accrue du fait <strong>de</strong> la fragilité <strong>de</strong> ces milieux<br />
Un zonage adapté assure la protection <strong>de</strong> ces espaces<br />
naturels. La zone NNs protège les secteurs très<br />
sensibles, (notamment la Vallée <strong>de</strong> la Loire) : seuls les<br />
aménagements légers pour l'accueil du public y sont<br />
autorisés. <strong>Le</strong>s prairies <strong>de</strong> Loire font par ailleurs l'objet<br />
d'un programme <strong>de</strong> remise en valeur <strong>de</strong>s étiers qui<br />
participent à leur bon entretien, à travers le<br />
programme Neptune.<br />
Développer la forêt urbaine en lien avec les<br />
communes <strong>de</strong> Saint-Herblain et <strong>de</strong> Sautron<br />
Amélioration du cadre <strong>de</strong> vie<br />
Gestion <strong>de</strong>s espaces en friche<br />
Favorable aux équilibres<br />
environnementaux et à la biodiversité<br />
Mise en place d'un effet "tampon" avec les<br />
zones urbanisées, plutôt d'ordre paysager<br />
<strong>Le</strong>s zones <strong>de</strong> boisements prioritaires sont exprimées<br />
par un zonage adapté NNf. La forêt urbaine fera l'objet<br />
d'aménagements légers ; les liaisons douces seront<br />
créées facilitant ainsi la découverte et la promena<strong>de</strong>.<br />
Ces liaisons seront encadrées par <strong>de</strong>s panneaux <strong>de</strong><br />
sensibilisation. <strong>Le</strong> projet repose sur la <strong>plan</strong>tation<br />
d'arbres d'essences <strong>local</strong>es, adaptés à leur<br />
environnement. Enfin, un volet pédagogique pourra<br />
être développé autour <strong>de</strong> la forêt (après la pousse <strong>de</strong>s<br />
arbres) pour sensibiliser les habitants <strong>de</strong><br />
l'agglomération à la spécificité <strong>de</strong> ces milieux.<br />
243


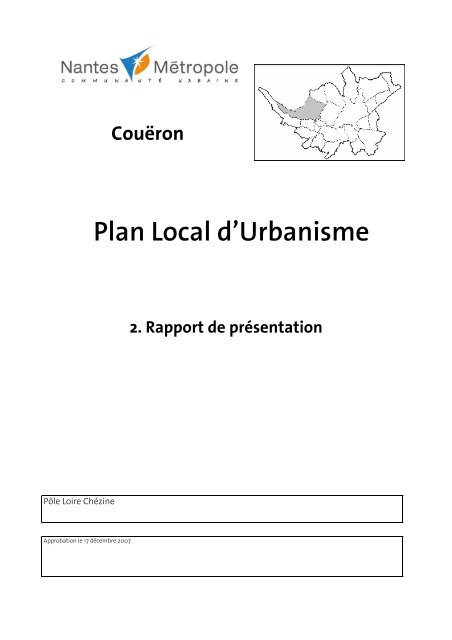
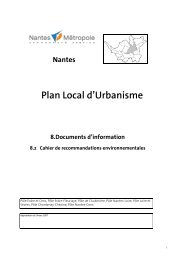
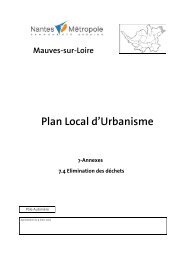
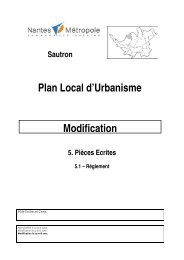

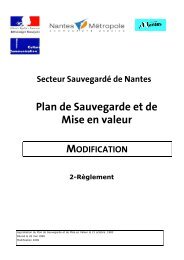
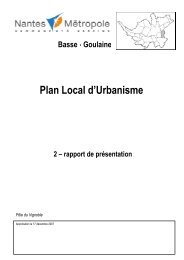
![Projet d'aménagement et de Développement Durable [taille: 10.65 Mo]](https://img.yumpu.com/46441172/1/190x134/projet-damacnagement-et-de-dacveloppement-durable-taille-1065-mo.jpg?quality=85)