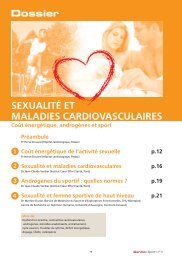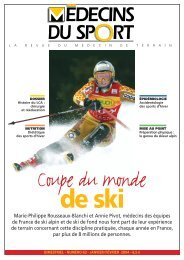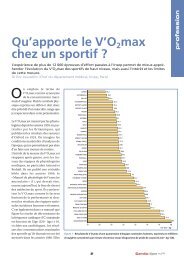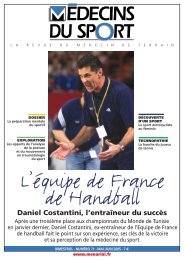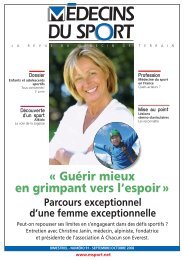Médecins du sport 61 - msport.net
Médecins du sport 61 - msport.net
Médecins du sport 61 - msport.net
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L A R E V U E D U M É D E C I N D E T E R R A I N<br />
DOSSIER<br />
Le surentraînement :<br />
comment faire<br />
le diagnostic ?<br />
MISE AU POINT<br />
Récupération<br />
après infection<br />
virale<br />
Championnats <strong>du</strong> Monde<br />
d’athlétisme<br />
Paris - 23-31 août<br />
La préparation de ce rendez-vous <strong>sport</strong>if exceptionnel<br />
a con<strong>du</strong>it à la mise en place d’un dispositif médical<br />
de grande envergure pour offrir à tous<br />
le meilleur <strong>du</strong> <strong>sport</strong> dans des conditions optimales.<br />
BIMESTRIEL - NUMÉRO <strong>61</strong> - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003 - 6,5 E
DPPI<br />
Première médaille<br />
pour la France : l’argent,<br />
avec la deuxième place<br />
d’Eunice Barber<br />
à l’heptathlon.<br />
9 es Championnats <strong>du</strong> Monde<br />
d’athlétisme<br />
Paris 23-31 août<br />
Du 23 au 31 août, à l'occasion des 9 es championnats <strong>du</strong> Monde, les “Dieux<br />
<strong>du</strong> Stade” ont écrit une nouvelle page de l’histoire de l’athlétisme. Dans leur<br />
quête de l’or mondial, ils se sont lancés à l’assaut des records de chacune<br />
des disciplines : 20 km marche, 50 km marche, heptathlon, décathlon, 100 m,<br />
200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m steeple, 5 000 m, 10 000 m, 4 x 400 m,<br />
100 m haies, 400 m haies, triple saut, saut à la perche, saut en hauteur, saut<br />
en longueur, lancer de poids, lancer <strong>du</strong> marteau, lancer <strong>du</strong> disque, lancer<br />
<strong>du</strong> javelot…<br />
Les 2 000 athlètes sélectionnés ont offert aux 500 000 spectateurs <strong>du</strong> Stade<br />
de France des moments forts et inoubliables.<br />
A cette occasion, la gestion de la sécurité médicale et l'organisation <strong>sport</strong>ive<br />
nourrissaient un objectif commun : le gage de l'efficacité d'une intervention<br />
rapide auprès de toutes les populations concernées (athlètes, accrédités,<br />
spectateurs). Le Groupement d'intérêt public (GIP) et les diverses équipes<br />
médicales mobilisées se sont donc coordonnés pour offrir aux passionnés le<br />
meilleur <strong>du</strong> <strong>sport</strong> dans des conditions optimales.<br />
■<br />
Evénement: championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
Evénement: championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
MÉDECINS DU SPORT 5 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Evénement: championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
Evénement: championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
Sécurité médicale et organisation<br />
<strong>sport</strong>ive : un objectif commun<br />
Les urgences en milieu <strong>sport</strong>if peuvent<br />
être définies par la survenue<br />
d’un événement soudain et subit engageant,<br />
à court terme, le pronostic vital<br />
ou fonctionnel. Le caractère subit ne<br />
préjuge en rien <strong>du</strong> lieu de survenue qui<br />
peut effectivement être le milieu <strong>sport</strong>if,<br />
favorisant par sa particularité certains<br />
types d’accidents. Mais il ne doit nullement<br />
être un facteur de compromission<br />
<strong>du</strong> pronostic des patients.<br />
Une analyse stratégique des risques accidentels<br />
en milieu <strong>sport</strong>if, variables en<br />
fonction de nombreux paramètres, doit<br />
con<strong>du</strong>ire ensuite à la proposition d’une<br />
tactique globale de prise en charge médicale.Un<br />
dispositif médical adapté doit,<br />
lors de la survenue d’événements accidentels,<br />
indivi<strong>du</strong>els ou collectifs, permettre<br />
la mise en œuvre de moyens humains<br />
et matériels appropriés à la taille<br />
et au type d’événement.En effet,une prévention,même<br />
optimale,ne ré<strong>du</strong>ira jamais<br />
complètement le risque.<br />
La sécurité médicale est un versant important<br />
de la sécurité d’une compétition<br />
<strong>sport</strong>ive.Elle concerne les <strong>sport</strong>ifs,mais<br />
aussi toutes les autres personnes présentes<br />
sur le site de la manifestation,des<br />
accrédités aux spectateurs. La quiétude<br />
<strong>du</strong> quotidien est le piège dans lequel l’organisateur<br />
ne doit pas tomber, le coût<br />
financier doit être intégré aux prévisions<br />
budgétaires,car l’organisateur est le responsable<br />
(d’après la loi <strong>du</strong> 16 juillet 1984<br />
modifiée par le décret <strong>du</strong> 11 juin 1996).<br />
DEUX NIVEAUX<br />
DE PRESTATION<br />
Un dispositif médical dédié doit pouvoir<br />
prendre en charge les urgences indivi<strong>du</strong>elles<br />
et collectives limitées.S’agissant des urgences<br />
collectives,le relais sera pris par les dispositifs<br />
de soin des services publics avec l’intégration,dans<br />
le cadre d’un plan de secours,<br />
<strong>du</strong> service médical de l’organisation.<br />
Le staff médical d’une manifestation <strong>sport</strong>ive<br />
doit comporter 2 niveaux de prestation.<br />
Une équipe médicale et paramédicale<br />
* Directeur délégué médical.<br />
** Adjoint au directeur délégué médical<br />
et médecin fédéral (FFA).<br />
Leslie Johnes<br />
(à droite), lors de<br />
sa qualification pour<br />
la finale <strong>du</strong> 400 m.<br />
DPPI<br />
de professionnels de la médecine <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong> doit gérer les urgences chez les<br />
athlètes, mais s’y ajoute systématiquement<br />
une seconde équipe, proportionnelle<br />
à la taille de l’événement, qui<br />
prendra en charge les urgences concernant<br />
les spectateurs,les différents staffs,<br />
mais aussi les <strong>sport</strong>ifs pour des urgences<br />
autres que celles de médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
Ces équipes seront constituées d’urgentistes<br />
professionnels entourés de secouristes.<br />
Le concept idéal est l’interconnexion<br />
et la complémentarité des<br />
2 types d’équipes médicales afin d’optimiser<br />
les soins.<br />
La sécurité médicale doit être pleinement<br />
intégrée à l’organisation d’un événement<br />
<strong>sport</strong>if.Une analyse prospective des risques<br />
suivie de l’installation de secours médicaux<br />
spécifiques est l’une des clés <strong>du</strong> succès.<br />
LE DISPOSITIF MÉDICAL<br />
Lors des championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
de Paris Saint-Denis,l’objectif d’excellence<br />
recherché par les athlètes existait<br />
aussi pour le comité d’organisation.<br />
La préparation de ce rendez-vous exceptionnel<br />
a donc con<strong>du</strong>it, entre autres, à la<br />
mise en place d’un dispositif médical adapté<br />
à l’envergure <strong>du</strong> 3 e rendez-vous <strong>sport</strong>if mondial<br />
après les Jeux Olympiques d’été et la<br />
coupe <strong>du</strong> Monde de Football.<br />
Le dispositif médical est intégré au Comité<br />
Quelques chiffres<br />
● 210 pays participants<br />
● 2 000 athlètes<br />
● 20 000 accrédités<br />
● 500 000 spectateurs<br />
● 24 épreuves masculines<br />
● 22 épreuves féminines<br />
● 204 médailles<br />
● 2 salles de régulation (l’une au<br />
Stade de France <strong>du</strong>rant<br />
les compétitions, l’autre au<br />
Village des athlètes)<br />
d’organisation,il permet de dispenser des<br />
soins optimaux de par les compétences<br />
des équipes médicales de professionnels,<br />
leur répartition et leur coordination.<br />
L’organigramme opérationnel<br />
L’analyse préalable et précise des risques<br />
engendrés par cette compétition, dans<br />
un contexte politique international délicat,<br />
a permis de proposer un organigramme<br />
opérationnel.<br />
La sécurité médicale idéale doit stratégiquement<br />
être un des versants de la sécurité<br />
générale.La direction médicale sur cet<br />
événement fut donc confiée à 2 médecins :<br />
- un directeur médical issu de la médecine<br />
d’urgence et de la médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong> :le<br />
Dr Nordine Benameur,praticien au centre<br />
hospitalier régional et universitaire de Lille ;<br />
- assisté d’un adjoint, médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> :<br />
MÉDECINS DU SPORT 6 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
d’une manifestation<br />
le Dr Béchir Boudjemaa,actuellement président<br />
de la commission médicale de la FFA.<br />
Leur tâche fut tout d’abord d’analyser préalablement<br />
les besoins médicaux,avant de<br />
mettre en place un dispositif pragmatique<br />
intégré dans la carte sanitaire régionale et<br />
d’en assumer la coordination tactique.<br />
Plusieurs équipes de soignants issus<br />
de la Fédération Française d’Athlétisme<br />
(médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, kinésithérapeutes,podologues,ostéopathes...),ont<br />
également œuvré pour la prise en charge<br />
des athlètes, sur les différents sites de<br />
la manifestation.<br />
En outre,des équipes médicales d’urgence<br />
et de réanimation (médecins<br />
urgentistes, infirmiers spécialisés, standardistes<br />
spécialisés, personnels administratifs)<br />
furent en charge des urgences<br />
médicales chez les spectateurs et accrédités<br />
dans l’enceinte <strong>du</strong> Stade de<br />
France.<br />
Citons enfin les 120 secouristes présents<br />
lors de cet événement, qui sont<br />
souvent les premiers intervenants,de par<br />
leur positionnement également stratégique<br />
sur tous les sites de l’événement.<br />
L’effectif total <strong>du</strong> staff médical de ces<br />
9 es championnats <strong>du</strong> Monde comptait<br />
plus de 200 personnes.<br />
Sécuriser l’événement<br />
Pour le Groupement d’intérêt public (GIP) en<br />
charge de son organisation, assurer la sécurité<br />
des 9 es championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme, c’est<br />
faire face aux risques. Risques exogènes (attentats,<br />
manifestations, délinquance, etc.), risques<br />
endogènes (internes à l’organisation), chacun a<br />
été identifié, analysé et soupesé en vue de<br />
déterminer le meilleur type d’organisation possible<br />
propre à le ré<strong>du</strong>ire.<br />
L’interface Etat/GIP<br />
L’originalité <strong>du</strong> régime juridique français étant d’être<br />
à la fois précis et souple, le choix a été fait d’une<br />
parfaite adéquation entre le GIP et les services<br />
de l’Etat. Si chacun intervient dans sa sphère de<br />
compétence (l’Etat se chargeant plus particulièrement<br />
des risques exogènes, le GIP se concentrant<br />
sur les risques endogènes), le système trouve<br />
son efficacité dans l’interface Etat/GIP.<br />
Un réseau de partenaires efficaces<br />
L’interconnexion des équipes soignantes<br />
est une des clés de la réussite d’une telle<br />
entreprise.Une véritable complémentarité<br />
est nécessaire, à la fois entre les équipes<br />
précédemment décrites, mais aussi pour<br />
les acteurs de soins des services publics.<br />
En effet, la collaboration avec les SAMU<br />
de Paris,de Bobigny,et les sapeurs pompiers<br />
est souvent quotidienne,tant pour<br />
le relais des acteurs médicaux lors de<br />
la prise en charge de patients indivi<strong>du</strong>els,<br />
qu’en cas d’événement exceptionnel<br />
avec victimes en nombre.<br />
De la même façon,un tel dispositif n’est<br />
pas viable sans un réseau de partenaires<br />
médicaux d’aval :<br />
- partenaires hospitaliers privés et publics<br />
pour la suite des soins prodigués,<br />
- mais aussi prestataires médicaux de l’urgence<br />
omnipraticienne pour les sites hôteliers<br />
et pour les actes médicaux spécifiques,<br />
tels la radiologie, la biologie,<br />
l’ophtalmologie, la gynécologie, la chirurgie<br />
dentaire...<br />
Des salles de régulations étaient chargées<br />
de coordonner les demandes de<br />
soins médicaux, et permettaient une réponse<br />
appropriée aux besoins médicaux<br />
en temps réel.<br />
Dr Nordine Benameur*<br />
Dr Béchir Boudjemaa**<br />
Les différentes infirmeries <strong>du</strong> stade<br />
de France ont également été activées<br />
afin de recevoir les staffs médicaux<br />
et prendre en charge les patients.<br />
Un centre médical opérationnel était<br />
disponible au village des athlètes et chaque<br />
terrain d’entraînement était également doté<br />
d’une structure médicale adaptée.<br />
Les membres <strong>du</strong> service médical ont pu<br />
travailler selon des procé<strong>du</strong>res préétablies,<br />
en étroite collaboration avec les staffs médicaux<br />
des délégations étrangères et dans<br />
le respect des cahiers des charges de l’IAAF<br />
et de la législation française.<br />
Dans sa phase opérationnelle,le service<br />
médical a fait preuve de son efficacité en<br />
s’intégrant parfaitement dans l’offre de<br />
soins de la région Ile de France et a pu<br />
rendre les services atten<strong>du</strong>s par tous, et<br />
fut,sans nul doute,l’un des gages de succès<br />
de cet événement.<br />
■<br />
Pour en savoir plus<br />
Le site des championnats <strong>du</strong> Monde<br />
http://www.paris2003saintdenis.org/fr<br />
Le site de la FFA<br />
www.athle.org/<br />
Benoît Martin*<br />
En ce qui concerne les risques exogènes, le GIP intervient<br />
pour prévenir et rendre aisée l’intervention des<br />
services de l’Etat. C’est le cas en matière de sécurité<br />
générale (attentats, manifestations, délinquance...),<br />
mais aussi en matière de secours médicaux.<br />
L’intégration des équipes <strong>du</strong> GIP dans les dispositifs<br />
de l’Etat et la clarté de la répartition des compétences<br />
sont, selon nous, les clefs de l’efficacité<br />
des interventions. L’arborescence des structures médicales<br />
<strong>du</strong> Dr Benameur en est un exemple. La<br />
position avancée <strong>du</strong> GIP, tant au village des athlètes<br />
qu’au Stade de France ou lors des courses de fond<br />
était tenue par les professionnels <strong>du</strong> Comité d’organisation.<br />
Leur expérience, leur spécialisation, leur<br />
vécu permettait d’envisager avec confiance une<br />
entreprise ren<strong>du</strong>e très délicate par le contexte<br />
international actuel.<br />
■<br />
* Directeur délégué à la sécurité.<br />
Evénement: championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
Evénement: championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
MÉDECINS DU SPORT 7 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Evénement: championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
J.C Gaillet<br />
Avec l’évolution des connaissances et des technologies,<br />
le podologue <strong>du</strong> <strong>sport</strong> est amené à jouer un rôle<br />
important au sein de l’équipe médicale chargée <strong>du</strong> suivi<br />
des <strong>sport</strong>ifs.<br />
Un rôle préventif<br />
En amont des compétitions lors <strong>du</strong> suivi longitudinal,<br />
le podologue établit un bilan stato-dynamique afin d’évaluer<br />
les facteurs de risque, et propose le port d’orthèses<br />
plantaires thermoformées moulées, adaptées au geste<br />
<strong>sport</strong>if si nécessaire. Un contrôle systématique des chaussures<br />
utilisées est effectué (pointure, modèle, usure...).<br />
Nous disposons aujourd’hui de techniques de mesures<br />
et d’investigations, tels que les capteurs embarqués, permettant<br />
une connaissance précise des appuis au cours<br />
<strong>du</strong> geste <strong>sport</strong>if en ambulatoire (temps d’appuis, déroulé<br />
<strong>du</strong> pas, pression maximale, pression moyenne...).<br />
Ceci permet notamment, en collaboration avec les en-<br />
* Podologue fédéral national (FFA), Reims.<br />
Le podologue met un pied<br />
dans le stade<br />
Trois questions à Muriel Hurtis<br />
Quelles méthodes utilises-tu sur le plan de<br />
la récupération ?<br />
Classiquement le sommeil,l’alimentation et l’hydratation,mais<br />
aussi les soins de kinésithérapie en particulier les massages,<br />
ainsi que les bains glacés et les douches alternées chaud-froid.<br />
Depuis 2 saisons,je suis suivie sur le plan diététique.Cela m’a permis<br />
de perdre <strong>du</strong> poids et de prendre conscience de la nécessité<br />
d’adapter mon alimentation en fonction de mon organisme,<br />
de la quantité d’entraînement et de la récupération.<br />
Peux-tu nous parler <strong>du</strong> rôle<br />
<strong>du</strong> kinésithérapeute ?<br />
Il est important pour la récupération mais aussi pour les<br />
soins en cas de problèmes ;je le vois de façon régulière afin<br />
de contrôler et prévenir les éventuels soucis qui pourraient<br />
arriver et soigner les problèmes chroniques. Il donne aussi<br />
des informations au coach qui en tient compte pour les plans<br />
d’entraînement.<br />
Justement, as-tu eu des soucis physiques à<br />
gérer cette année ?<br />
Au niveau de mon genou, j’ai un problème chronique qui se<br />
tra<strong>du</strong>it de temps en temps par une gêne douloureuse et qui<br />
perturbe certaines séances d’entraînement. Je diminue alors<br />
l’intensité de l’entraînement,fait davantage de soins et c’est reparti<br />
!<br />
DPPI<br />
Jean-Claude Gaillet*<br />
traîneurs, d’optimiser l’appui plantaire (ex : l’appui <strong>du</strong><br />
pied d’appel d’un sauteur).<br />
Un rôle curatif<br />
Le podologue assure aussi le suivi et les soins de la peau<br />
et des phanères, des pieds. Ces pathologies sont fréquentes<br />
et on imagine aisément l’impact douloureux généré<br />
par un ongle incarné ou une hyperkératose chez un<br />
<strong>sport</strong>if de haut niveau.<br />
Lors des championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme, un “camp<br />
de base” a été installé au village des athlètes avec le<br />
même plateau technique qu’un cabi<strong>net</strong> de podologie de<br />
ville.<br />
Par ailleurs, une présence sur le stade d’échauffement<br />
a permis d’effectuer des gestes préventifs (ampoules...)<br />
avant les compétitions.<br />
Une équipe a également été sollicitée pour les courses<br />
hors stade (marathon et marche) nécessitant après<br />
l’épreuve une prise en charge adaptée.<br />
■<br />
Dr Béchir Boudjemaa**<br />
Qualification de<br />
la championne<br />
d'Europe, Muriel<br />
Hurtis, pour les quarts<br />
de finale de l'épreuve<br />
<strong>du</strong> 200 m.<br />
Palmarès :<br />
24 ans<br />
● Championne d’Europe <strong>du</strong><br />
200 m et 4x100 m (2002)<br />
● Championne d’Europe en<br />
salle <strong>du</strong> 100 et 200 m<br />
(2002)<br />
● Championne<br />
de France <strong>du</strong> 200 m (2002)<br />
● Vainqueur de<br />
la Coupe d’Europe<br />
sur 100 m, 200 m<br />
et 4x100 m (2002)<br />
● 2 e de la Coupe<br />
<strong>du</strong> Monde sur 200 m (2002)<br />
MÉDECINS DU SPORT 8 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Equipe de France<br />
Organisation de la couverture médicale<br />
* Kinésithérapeute fédéral national (FFA), Paris.<br />
La Française Manuela<br />
Montebrun accède<br />
à la finale <strong>du</strong> marteau<br />
dames.<br />
DPPI<br />
Agenda <strong>sport</strong>if<br />
grammation <strong>du</strong> suivi indivi<strong>du</strong>el fut établie.<br />
Après 2-3 jours de rassemblements dits<br />
en opération “bulle”, 1 médecin et 3 kinésithérapeutes<br />
ont accompagné les premiers<br />
athlètes à la cité universitaire (Paris),<br />
siège de toutes les délégations mondiales.<br />
Sur place, la salle de soins (6 tables électriques,une<br />
logistique de fonctionnement<br />
équivalant à plus de 400 kg de matériel<br />
médical) était prête à accueillir la continuité<br />
de l’événement.<br />
Un véritable centre de réé<strong>du</strong>cation était ouvert<br />
12 h par jour,et parfois plus en fonction<br />
de l’horaire des compétitions.<br />
L’entrée en lice des épreuves fut marquée<br />
d’émotions croissantes et l’une des<br />
grandes difficultés consistait à gérer la<br />
scission progressive entre les athlètes “dé-<br />
Stage terminal et canicule<br />
Le staff médical chargé <strong>du</strong> suivi de<br />
l’équipe de France lors des championnats<br />
<strong>du</strong> Monde était représenté par 3 médecins<br />
et 5 kinésithérapeutes<br />
Le regroupement de l’équipe de France<br />
s’est d’abord déroulé par vagues au centre<br />
national <strong>du</strong> rugby à Marcoussis.L’ensemble<br />
de la délégation était réuni le 18 août.<br />
Cependant, dès le 4 août, une présence<br />
médicale et paramédicale était organisée<br />
et les “premiers réglages”ont pu débuter,<br />
profitant des installations mises en place<br />
pour l’événement.<br />
Dès leur arrivée, chaque <strong>sport</strong>if a bénéficié<br />
d’une consultation et d’une 1 re séance<br />
de soins au terme desquelles une probutants”<br />
et ceux dont les qualifications<br />
étaient programmées plus tardivement.<br />
L’athlétisme est un ensemble de disciplines<br />
indivi<strong>du</strong>elles et la force <strong>du</strong> directeur technique<br />
national est d’essayer de maintenir<br />
une solidarité dans l’équipe en jouant le<br />
rôle d’un véritable chef d’orchestre.<br />
Les épreuves combinées, la marche et le<br />
marathon nécessitant une couverture spécifique<br />
et éprouvante, monopolisant au<br />
moins 1 médecin et 2 à 3 kinésithérapeutes,l’alternance<br />
des permanences <strong>du</strong><br />
centre de soins,des lieux d’entraînement<br />
et <strong>du</strong> stade d’échauffement fut plus complexe<br />
à organiser et la synthèse de la journée<br />
ainsi que la préparation de la journée<br />
suivante s’effectuaient obligatoirement<br />
à une heure très tardive.<br />
■<br />
Du 4 au 23 août 2003, le centre national de rugby de Marcoussis accueillait les athlètes<br />
français en stage préparatoire terminal. Les <strong>sport</strong>ifs ont ainsi pu bénéficier des<br />
installations optimales mises en place sur ce site (échographe, salles de soins, bassins<br />
froid et chaud, balnéothérapie, renforcement ou réé<strong>du</strong>cation isocinétique…) pour la<br />
récupération, l’entraînement et la préparation.<br />
Seule “ombre” au tableau : la canicule !<br />
De telles températures retardant la récupération, le respect des consignes d’hydratation,<br />
le décalage de certaines plages d’entraînement en fin de journée et la pratique des<br />
étirements à l’ombre ont permis aux <strong>sport</strong>ifs d’aborder les épreuves en pleine forme.<br />
Le Dr Deymié rappelle que « dans des conditions normales de température, un <strong>sport</strong>if<br />
perd en moyenne 1,5 l d’eau pour un entraînement de 1h30, il est donc important de<br />
compenser ces pertes pendant et après les séances par l'absorption de 1,5 l d’eau<br />
équivalant aux pertes, plus une hydratation de base quotidienne, ce qui porte à 3 l la<br />
moyenne de consommation journalière <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if. Aussi, dans les conditions<br />
caniculaires connues début août et malgré un air sec limitant les pertes sudorales,<br />
les <strong>sport</strong>ifs s’exposaient, lors de chaque entraînement, à des pertes pouvant atteindre<br />
les 3 litres. »<br />
Colloque de la commission médicale de la FFA<br />
Rencontres inter-fédérations<br />
20-21 sept 2003, Maison <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, Paris<br />
Dans le cadre des rencontres médicales inter-fédérations initiées lors des Etats généraux <strong>du</strong> <strong>sport</strong>,<br />
la FFA et sa commission médicale organisent un colloque les 20 et 21 septembre prochains.<br />
La Fédération française de taekwondo, la Fédération française de voile, la Fédération française<br />
d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme, la Fédération française d'aviron et l'Insep s'associent à ces<br />
premières rencontres et viendront enrichir les réflexions et pratiques spécifiques à chaque discipline, afin de favoriser les<br />
échanges et les connaissances entre les professionnels de santé et de faire converger les expertises “<strong>sport</strong> et santé".<br />
Ce congrès sera consacré à la fois à des sujets traitant des aspects diagnostiques<br />
et thérapeutiques des pathologies liées à la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, mais aussi à des<br />
sujets traitant de la place de l'activité physique dans la prévention et la prise en<br />
charge de certaines maladies.<br />
DPPI<br />
Philippe Peytral*<br />
Renseignements / Inscriptions :<br />
Clinicpro<strong>sport</strong><br />
Tél : 01 40 65 04 18<br />
Mail : clinicpro<strong>sport</strong>@wanadoo.fr<br />
Evénement: championnats <strong>du</strong> Monde d’athlétisme<br />
MÉDECINS DU SPORT 9 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
DOSSIER ><br />
Le surentraînement<br />
COORDONATEUR : PR FRANÇOIS CARRÉ*<br />
DR ANNE FAVRE-JUVIN**<br />
PR GEORGES CAZORLA***,<br />
DR LAMIA BOUSSAIDI***, DR CYRIL PETIBOIS****<br />
Résultant souvent d’un<br />
déséquilibre entre charges de<br />
travail et périodes de<br />
récupération, le surentraînement<br />
intéresse tous les <strong>sport</strong>ifs et tous<br />
les médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
Mais, entre fatigue passagère,<br />
pathologies infectieuses et<br />
surentraînement, de quels outils<br />
dispose le médecin pour poser<br />
son diagnostic ?<br />
Sommaire<br />
Intro<strong>du</strong>ction Page 12<br />
Physiopathologie<br />
et aspects biologiques<br />
Mots clés<br />
Surentraînement<br />
Fatigue<br />
Examen clinique<br />
Bilan biologique<br />
Approche clinique<br />
Fatigue ou surentraînement ?<br />
Page 12<br />
● A - Quand savoir si une fatigue après l’effort<br />
est normale ?<br />
● B - La prévention, un rôle majeur<br />
Les signes cliniques <strong>du</strong><br />
surentraînement Page 13<br />
● A - Les symptômes subjectifs<br />
● B - Les symptômes objectifs<br />
Con<strong>du</strong>ite à tenir devant une<br />
suspicion de surentraînement<br />
Page 14<br />
● A - Caractériser la fatigue<br />
● B - Préciser la fatigue<br />
● C - L’enquête alimentaire<br />
● D - L’examen physique<br />
● E - Les tests d’effort<br />
Conclusion Page 15<br />
Entraînement et surentraînement<br />
Page 15<br />
● A - Trois conditions à respecter<br />
● B - Trois types de dysfonctionnements<br />
● C - Etiologie <strong>du</strong> surentraînement<br />
Hypothèses physiopathologiques<br />
<strong>du</strong> surentraînement<br />
Page 21<br />
● A - Hypothèses structurale et métabolique<br />
● B - Hypothèse immunitaire<br />
● C - Hypothèse hormonale<br />
● D - Manifestations psycho-comportementales<br />
Conclusion Page 25<br />
Pour la pratique<br />
on retiendra... Page 26<br />
Questionnaire<br />
de surentraînement Page 27<br />
Bibliographie Page 29<br />
* SERVICE D’EXPLORATIONS<br />
FONCTIONNELLES UNITÉ DE<br />
BIOLOGIE ET MÉDECINE DU<br />
SPORT. HÔPITAL DE PONT-<br />
CHAILLOU, UNIVERSITÉ DE<br />
RENNES.<br />
** UNITÉ FONCTIONNELLE<br />
DE BIOLOGIE ET MÉDECINE<br />
DU SPORT,<br />
SERVICE D’EXPLORATION<br />
FONCTIONNELLE<br />
CARDIO-RESPIRATOIRE,<br />
CHU DE GRENOBLE.<br />
*** LABORATOIRE<br />
EVALUATION SPORT SANTÉ.<br />
FACULTÉ DES SCIENCES DU<br />
SPORT ET DE L’ÉDUCATION<br />
PHYSIQUE,<br />
UNIVERSITÉ VICTOR<br />
SEGALEN, BORDEAUX 2.<br />
**** INSERM U443,<br />
GROUPE DE CHIMIE<br />
BIO-ORGANIQUE,<br />
UNIVERSITÉ VICTOR<br />
SEGALEN, BORDEAUX 2.<br />
MÉDECINS DU SPORT 11 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Le surentraînement<br />
< DOSSIER ><br />
Intro<strong>du</strong>ction<br />
Pr François Carré<br />
L’entraînement <strong>sport</strong>if doit être un harmonieux<br />
mélange de périodes de travail et de<br />
récupération, terme qui n’est pas synonyme<br />
d’inactivité.<br />
La charge de travail constitue pour l’organisme<br />
une “agression” qui va rompre son équilibre.<br />
Lors de la phase de récupération qui suit,<br />
l’organisme va se régénérer et doit retrouver<br />
un niveau d’équilibre plus élevé qu’avant<br />
“l’agression”. Ainsi, grâce à un entraînement<br />
régulier et équilibré utilisant des charges<br />
progressivement croissantes et des périodes<br />
de récupération en rapport, le but premier<br />
de l’entraînement, progresser, doit être atteint.<br />
Le surentraînement est le résultat d’un<br />
entraînement mal con<strong>du</strong>it avec un déséquilibre<br />
entre les charges de travail et les périodes<br />
de récupération. Il peut toucher les <strong>sport</strong>ifs de tout<br />
niveau et intéresse donc tous les médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
L’approche clinique <strong>du</strong> surentraînement a été<br />
abordée par le Dr Anne Favre-Juvin, responsable<br />
<strong>du</strong> groupe de réflexion sur le surentraînement<br />
mis en place par la Société Française de<br />
Médecine <strong>du</strong> Sport. Son existence témoigne<br />
de l’importance actuelle <strong>du</strong> problème. De ce<br />
paragraphe ressort, encore une fois, la place<br />
majeure occupée par un interrogatoire dirigé en<br />
médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
L’approche biologique et la physiopathologie<br />
<strong>du</strong> surentraînement ont été traitées par le<br />
Pr Georges Cazorla qui mène, avec ses<br />
collaborateurs, des travaux de recherche dans ce<br />
domaine. L’aspect multifactoriel et complexe de<br />
la physiopathologie <strong>du</strong> syndrome <strong>du</strong><br />
surentraînement est indispensable à connaître<br />
pour comprendre les “pistes” qui ont con<strong>du</strong>it à<br />
proposer tel ou tel bilan biologique. Nous verrons<br />
qu’il est encore impossible de proposer un bilan<br />
biologique standard à la recherche <strong>du</strong><br />
surentraînement.<br />
Le dernier paragraphe de ce dossier a pour but<br />
de résumer les éléments indispensables à<br />
connaître par le médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> pour éviter de<br />
“passer à côté” d’un syndrome de<br />
surentraînement dont le traitement curatif est<br />
simple, puisque basé sur le repos, mais souvent<br />
mal accepté par le <strong>sport</strong>if.<br />
Approche cliniqueDr Anne<br />
Favre-Juvin<br />
Pour le médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, le diagnostic<br />
clinique de surentraînement<br />
devient très fréquent,<br />
compte tenu des performances de plus<br />
en plus élevées dans chaque discipline<br />
<strong>sport</strong>ive ; mais ce diagnostic reste toujours<br />
aussi difficile.<br />
Ce syndrome, qui ne se voyait autrefois<br />
que dans les disciplines à grosses charges<br />
d’entraînement, comme les <strong>sport</strong>s d’en<strong>du</strong>rance,<br />
se rencontre maintenant dans<br />
tous les types de disciplines ; disciplines très<br />
différentes sur le plan des contraintes physiques,<br />
énergétiques, psychologiques...<br />
Fatigue ou surentraînement ?<br />
En pratique de médecine générale, la<br />
fatigue est une plainte fréquente. Elle est<br />
avant tout subjective ; c’est une sensation<br />
souvent mal explicitée et ressentie<br />
de façon variable dans des conditions<br />
d’effort ou de repos. Chez le <strong>sport</strong>if, cette<br />
plainte est peu fréquente, mais peut être<br />
majorée (prétexte à l’arrêt) ou au<br />
contraire cachée (<strong>sport</strong> professionnel).<br />
C’est pour cette raison qu’il est important<br />
d’avoir une approche clinique de repos<br />
et d’effort objective.<br />
En médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, la définition<br />
“physiologique” de la fatigue paraît la<br />
plus adaptée ; il s’agit de l’impossibilité<br />
pour un muscle, ou un groupe de<br />
muscles, de maintenir sa puissance de<br />
contraction initiale. Elle est d’abord<br />
locale, et entraîne des contre-performances,<br />
mais elle s’accompagne très<br />
vite de fatigue générale.<br />
MÉDECINS DU SPORT 12 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
DOSSIER ><br />
Le surentraînement<br />
■A - Quand savoir si<br />
une fatigue après<br />
l’effort est normale ?<br />
Une fatigue normale après l’effort est <strong>du</strong>e<br />
aux facteurs limitants habituels et définie<br />
par une période de récupération :<br />
- < 24 heures, si l’effort est habituel ;<br />
- < 48 heures, si l’effort est inhabituel (très<br />
intense ou très long).<br />
Une fatigue pathologique est une rupture<br />
d’équilibre entre les réactions d’adaptation<br />
déclenchées par la répétition des efforts et<br />
les processus de récupération ; elle est définie<br />
par un temps de récupération plus long<br />
que ceux définis précédemment.<br />
Cette fatigue peut être passagère, aiguë<br />
(c’est “l’overeaching”). Si la récupération est<br />
incomplète, la fatigue augmente chaque<br />
jour et la capacité de travail diminue de<br />
façon parallèle. Si le sujet est mis au repos<br />
rapidement, le retour à la normale pourra<br />
se faire en 15 jours.<br />
Si ce signal d’alarme n’est pas respecté,<br />
le <strong>sport</strong>if risque la fatigue chronique<br />
(“overtraining”), correspondant à l’état<br />
de surentraînement. Dans ce cas, le<br />
retour à la normale est beaucoup plus<br />
long. Il se fera en 2 à 3 mois, voire plus,<br />
6 à 12 mois dans certains cas.<br />
■B - La prévention,<br />
un rôle majeur<br />
La prévention joue donc un rôle majeur et<br />
consiste à rechercher les signes d’alarme <strong>du</strong><br />
surentraînement qui doivent être codifiés.<br />
Dans ce but, un questionnaire (appelé plutôt<br />
questionnaire de “forme” que de “surentraînement”,<br />
pour éviter une connotation<br />
péjorative) a été récemment validé par un<br />
groupe de travail de la Société Française de<br />
Médecine <strong>du</strong> Sport.<br />
Ce questionnaire comprend 2 parties (cf.<br />
p 27-28) :<br />
1 - 54 questions à réponses binaires,<br />
explorant les symptômes physiques et<br />
psychologiques ;<br />
2 - des questions d’ordre général et des<br />
échelles analogiques permettant d’établir<br />
une note de performance, de forme,<br />
de fatigue, de récupération, d’anxiété,<br />
de force et d’en<strong>du</strong>rance.<br />
Dans les premières études réalisées sur<br />
ce questionnaire, nous avons pu montrer<br />
qu’à partir de 20 items cochés (et audelà),<br />
un syndrome de surentraînement<br />
devait être suspecté. Cette approche a<br />
permis de préciser les signes cliniques les<br />
plus représentatifs <strong>du</strong> syndrome de surentraînement<br />
chez des <strong>sport</strong>ifs français.<br />
Les signes cliniques <strong>du</strong> surentraînement<br />
Classiquement, et de façon souvent schématique,<br />
2 syndromes de surentraînement,<br />
sympathique et parasympathique,<br />
ont été décrits (Tab. I).<br />
Le surentraînement sympathique semble<br />
le plus fréquent et toucherait en majorité<br />
les <strong>sport</strong>ifs jeunes et de disciplines<br />
explosives.<br />
Le surentraînement parasympathique<br />
concernerait plutôt les <strong>sport</strong>ifs plus âgés<br />
et les spécialistes d’en<strong>du</strong>rance. Il se pourrait<br />
que les signes de type sympathique<br />
constituent la première phase <strong>du</strong> surentraînement<br />
qui évoluerait ensuite vers la<br />
forme parasympathique.<br />
Tableau I : les 2 syndromes <strong>du</strong> surentraînement.<br />
Syndrome “sympathique”<br />
Troubles <strong>du</strong> sommeil<br />
Instabilité émotionnelle<br />
Baisse de l’appétit<br />
Tachycardie de repos<br />
Augmentation de la PA de repos<br />
Augmentation <strong>du</strong> métabolisme de base<br />
avec diminution de la masse maigre<br />
Dans l’étude décrite précédemment, des<br />
symptômes subjectifs et objectifs ont pu<br />
être distingués.<br />
■A - Les symptômes<br />
subjectifs<br />
Les symptômes subjectifs <strong>du</strong> surentraînement<br />
sont retrouvés par l’interrogatoire<br />
dirigé.<br />
• Contre-performance et fatigue<br />
Les plaintes les plus fréquentes chez ces<br />
<strong>sport</strong>ifs sont tout d’abord la fatigue qui<br />
accompagne la contre-performance.<br />
Celle-ci est complète : physique, psychologique,<br />
sensorielle, voire sexuelle.<br />
Syndrome “parasympathique”<br />
Hyperfatigabilité<br />
Troubles digestifs<br />
Anémie d’installation progressive<br />
Majoration de la bradycardie de repos<br />
Baisse de la PA de repos<br />
Baisse rapide de la fréquence<br />
cardiaque à l’arrêt de l’exercice<br />
Des troubles <strong>du</strong> sommeil soit à type de<br />
difficultés d’endormissement ou de réveils<br />
nocturnes, soit à type d’hypersomnie sont<br />
toujours retrouvés.<br />
• Les autres symptômes<br />
Il s’agit, par ordre de fréquence : d’une<br />
baisse de l’appétit, de symptômes musculaires<br />
à type de crampes, de tétanie<br />
voire de myalgies, de “malaises” et, de<br />
façon moins fréquente, de migraines et<br />
de troubles digestifs.<br />
Les blessures sont fréquentes, soit à type<br />
de pathologies bénignes répétées, soit à<br />
type de douleurs chroniques. Un contexte<br />
infectieux est souvent retrouvé dans les<br />
6 mois précédant l’état de fatigue. Une<br />
aménorrhée est rapportée par la majorité<br />
des athlètes féminines concernées.<br />
Enfin, un changement socio-familial a<br />
souvent été précurseur. Il peut entraîner<br />
une fragilisation supplémentaire sans<br />
que l’on puisse préciser sa place exacte<br />
dans le syndrome : cause ou conséquence<br />
?<br />
■B - Les symptômes<br />
objectifs<br />
L’examen physique peut retrouver des<br />
signes objectifs variés.<br />
MÉDECINS DU SPORT 13 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Le surentraînement<br />
< DOSSIER ><br />
• Une variation de poids<br />
Elle peut être positive ou négative, et<br />
varier de 2 à 5 kg. Il existe une relation<br />
entre la variation <strong>du</strong> pourcentage de<br />
masse grasse et le score au questionnaire<br />
de forme. Plus le sujet présente des<br />
signes subjectifs de fatigue, plus la variation<br />
de masse grasse, dans un sens ou<br />
dans l’autre, est importante.<br />
• Des erreurs nutritionnelles<br />
Si le niveau d’hydratation est satisfaisant,<br />
on note 1 fois sur 3 des rations caloriques<br />
<strong>net</strong>tement insuffisantes, en particulier en<br />
ce qui concerne les féculents et les protéines.<br />
• Les paramètres cardio-respiratoires<br />
Au repos, la fréquence cardiaque peut<br />
être abaissée très <strong>net</strong>tement ou franchement<br />
augmentée, ce qui rend difficile<br />
le diagnostic différentiel entre<br />
dysentraînement, désentraînement et<br />
surentraînement.<br />
La pression artérielle est souvent “pincée”,<br />
avec diminution de la pression systolique et<br />
élévation de la pression diastolique.<br />
Les électrocardiogrammes de repos et/ou<br />
d’effort sont rarement modifiés.<br />
Sur le plan respiratoire au repos, on<br />
retrouve, dans la moitié des cas, un<br />
contexte allergique et/ou asthmatique.<br />
Il peut s’agir d’une symptomatologie avec<br />
des explorations fonctionnelles respiratoires<br />
normales ou, à l’inverse, de l’absence de<br />
symptomatologie, mais avec un bronchospasme<br />
sur les explorations fonctionnelles<br />
respiratoires de base.<br />
• Les anomalies observées à l’effort<br />
Cette étude n’a pas retrouvé les perturbations<br />
classiques de la fréquence cardiaque.<br />
Ainsi, les fréquences cardiaques sous-maximales<br />
classiquement augmentées ont été<br />
trouvées soit beaucoup plus hautes, soit<br />
beaucoup plus basses et les classiques baisses<br />
de la fréquence cardiaque maximale et de<br />
VO 2 max n’ont pas été observées. En<br />
revanche, comme dans la littérature, les lactatémies<br />
sous-maximales étaient plus élevées<br />
et la lactatémie maximale abaissée.<br />
Les critères de récupération sont, en<br />
général, beaucoup moins bons.<br />
Il n’existe donc pas de signe clinique<br />
pathognomonique unique, aussi bien<br />
subjectif qu’objectif, de surentraînement,<br />
mais un faisceau de symptômes qui va<br />
permettre de faire le diagnostic.<br />
Con<strong>du</strong>ite à tenir devant<br />
une suspicion de surentraînement<br />
Devant un <strong>sport</strong>if qui se plaint d’une sensation<br />
de fatigue, l’interrogatoire caractérisera,<br />
précisera, objectivera celle-ci et éliminera<br />
toute autre pathologie débutante. Il sera<br />
complété par une enquête alimentaire et un<br />
examen physique de repos et d’effort.<br />
■A - Caractériser<br />
la fatigue<br />
- Ancien<strong>net</strong>é ?<br />
- Périodicité dans la journée, le mois, l’année ?<br />
- Fatigue uniquement physique, ou également<br />
intellectuelle, sensorielle, sexuelle ?<br />
- Amélioration par le repos ?<br />
- Fatigue uniquement locale et donc plutôt<br />
musculaire et/ou générale ?<br />
- Fatigue isolée ou accompagnée d’autres<br />
symptômes ?<br />
■B - Préciser la fatigue<br />
• Activité <strong>sport</strong>ive et professionnelle<br />
- Objectifs en compétition.<br />
- Modifications d’entraînement récentes<br />
ou dans les 6 mois précédents (stage en<br />
altitude ?).<br />
- Disponibilité pour cet entraînement.<br />
- Activité professionnelle (suractivité ou<br />
désintérêt ?).<br />
- Changement socio-familial récent.<br />
• Les signes subjectifs physiques<br />
- Insomnie et son type.<br />
- Troubles <strong>du</strong> comportement alimentaire<br />
(anorexie ou boulimie).<br />
- Céphalées.<br />
- Nausées ou autres troubles digestifs.<br />
• Antécédents récents<br />
- Nombre et type de blessures.<br />
- Episodes infectieux récents.<br />
- Augmentation de la sensibilité et de la<br />
sévérité des allergies.<br />
- Troubles menstruels (aménorrhée ou oligoménorrhée).<br />
- Prise médicamenteuse (laxatifs, anti-émétiques,<br />
diurétiques, anti-hypertenseurs centraux,<br />
anti-arythmiques, anti-histaminiques,<br />
anti-diabétiques oraux, anti-viraux, vaccins,<br />
métaux, anti-dépresseurs, anxiolytiques...).<br />
- Utilisation d’électrostimulation, d’une<br />
kinésithérapie intensive...<br />
- Etat des vaccinations.<br />
- Liste des voyages récents à l’étranger<br />
(décalage horaire).<br />
• Les signes subjectifs<br />
psychologiques<br />
- Dépression ou apathie.<br />
- Changement de personnalité.<br />
- Baisse de l’estime de soi.<br />
- Augmentation de l’instabilité émotionnelle.<br />
- Difficultés de concentration.<br />
- Diminution de la capacité d’intégration<br />
de nombreuses informations (<strong>sport</strong>s acrobatiques...).<br />
- Augmentation de la sensibilité au stress.<br />
- Appréhension de la compétition...<br />
■C - L’enquête<br />
alimentaire<br />
Elle recherchera une insuffisance dans<br />
l’hydratation, les rations de protéines, de<br />
féculents, de fer, en particulier d’origine<br />
animale, et précisera le type d’alimentation<br />
pendant l’effort.<br />
■D - L’examen physique<br />
L’examen physique sera orienté et devra :<br />
● rechercher une diminution ou une augmentation<br />
franche <strong>du</strong> poids ou de la<br />
masse grasse et chez l’enfant, un arrêt<br />
de croissance staturale ou un arrêt de la<br />
maturation pubertaire ;<br />
● inspecter la peau, les phanères, les<br />
conjonctives et les aires ganglionnaires<br />
(tout <strong>sport</strong>if même de haut niveau peut<br />
débuter une hémopathie ou un cancer) ;<br />
● rechercher, sur le plan cardio-pulmonaire,<br />
une augmentation ou une diminution<br />
franche de la fréquence cardiaque de repos,<br />
MÉDECINS DU SPORT 14 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
DOSSIER ><br />
Le surentraînement<br />
Le diagnostic de surentraînement n’est<br />
pas facile pour le médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>.<br />
Il ne doit pas être sous-estimé, ni surestimé.<br />
Les troubles <strong>du</strong> comportement, souvent<br />
banalisés, sont des signes précurseurs<br />
importants (bien expliqués sur le plan<br />
physiopathologique lors d’une fatigue<br />
musculaire). C’est l’association de sympune<br />
anomalie de la tension artérielle mesurée<br />
en position couchée et debout, une<br />
anomalie de l’électrocardiogramme, surtout<br />
si l’on a des examens antérieurs.<br />
■E - Les tests d’ effort<br />
Ils permettront de rechercher une augmentation<br />
<strong>du</strong> métabolisme de base.<br />
A l’effort sous-maximal, une modification<br />
de la fréquence cardiaque, une élévation<br />
éventuelle des paramètres ventilatoires<br />
(fréquence respiratoire et volume courant)<br />
et une augmentation des lactatémies sousmaximales.<br />
Enfin, une diminution <strong>du</strong><br />
temps d’en<strong>du</strong>rance au “seuil”.<br />
A l’exercice maximal, une diminution de<br />
Conclusion<br />
tômes subjectifs physiques et psychologiques,<br />
et de signes objectifs à l’examen<br />
physique au repos et à l’effort qui permettra<br />
de poser le diagnostic et d’envisager<br />
la con<strong>du</strong>ite à tenir.<br />
Le bilan biologique de repos apportera<br />
une aide complémentaire au diagnostic.<br />
Ce diagnostic sera d’autant plus facilité si<br />
VO 2 max, de la lactatémie et de la fréquence<br />
cardiaque. Plus que les tests de laboratoire,<br />
les tests de terrain peuvent être, dans chaque<br />
activité <strong>sport</strong>ive, d’un grand intérêt pour<br />
objectiver la contre-performance, la baisse<br />
de la force musculaire, la baisse de rendement<br />
ou la baisse d’en<strong>du</strong>rance, voire l’augmentation<br />
<strong>du</strong> temps de récupération.<br />
le <strong>sport</strong>if est suivi régulièrement et si le<br />
médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> est en possession de son<br />
état antérieur et a su établir une relation<br />
de confiance avec lui et son entraîneur.<br />
Ceci permettra de mettre le <strong>sport</strong>if au repos<br />
complet ou relatif pour une <strong>du</strong>rée plus ou<br />
moins longue selon l’intensité et le nombre<br />
de symptômes trouvés.<br />
■<br />
Physiopathologie<br />
et aspects biologiques<br />
Quel <strong>sport</strong>if ou quel entraîneur n’a<br />
pas un jour pensé qu’augmenter<br />
toujours et encore la charge d’entraînement<br />
(volume ou/et intensité) devrait<br />
permettre d’améliorer la performance ?<br />
La mésaventure dont fut victime au cours<br />
des années 1960 -1970 le marathonien<br />
Ron Hill résulte de cette croyance. Alors<br />
qu’en s’entraînant entre 160 et 180 km par<br />
semaine, son niveau de performance le<br />
situait très <strong>net</strong>tement devant les meilleurs<br />
mondiaux, afin d’augmenter (pensait-il !)<br />
un peu plus la différence avec ses concurrents,<br />
il passa à un kilométrage hebdomadaire<br />
supérieur à 200 km. Conséquence :<br />
il fut largement battu par un illustre<br />
inconnu, Ian Thompson, qui ne parcourait<br />
pas plus de 110 km par semaine!<br />
Pr Georges Cazorla,<br />
Dr Lamia Boussaidi,<br />
Dr Cyril Petibois, Pr François Carré<br />
Cette conception inflationni
DOSSIER ><br />
Le surentraînement<br />
cause. D’autres facteurs, comme la<br />
monotonie des contenus d’entraînement,<br />
les erreurs nutritionnelles et les stress de<br />
la vie courante, interviennent (Fig. 1).<br />
■B - Trois types de<br />
dysfonctionnements<br />
Les définitions des différents états de<br />
fatigue et <strong>du</strong> surentraînement, et leur<br />
filiation probable mais non formellement<br />
prouvée, ont été fournies dans le chapitre<br />
précédent de ce dossier.<br />
Dans le cas <strong>du</strong> surentraînement, la<br />
fatigue s’accumule, ne peut être résorbée<br />
et in<strong>du</strong>it des dysfonctionnements qui<br />
se manifestent sous 3 formes :<br />
1 - défaut d’adaptation irréversible avec<br />
perte d’efficacité des programmes<br />
moteurs et des gestes techniques ;<br />
2 - fragilisation de l’organisme <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if<br />
qui nécessite une plus longue période de<br />
récupération par rapport à la normale ;<br />
3 - et incapacité de l’organisme à résorber<br />
la fatigue accumulée alors que l’athlète<br />
est mis au repos.<br />
■C - Etiologie <strong>du</strong><br />
surentraînement<br />
Issue <strong>du</strong> dépassement fonctionnel des différents<br />
systèmes de l’organisme (musculaires,<br />
neurologiques, métaboliques,<br />
hormonaux, immunitaires et organiques),<br />
l’étiologie <strong>du</strong> surentraînement est complexe<br />
et obligatoirement systémique. Même<br />
si certains auteurs ont proposé de différencier<br />
2 types cliniques, sympathique et<br />
parasympathique, <strong>du</strong> surentraînement,<br />
celui-ci se manifeste par un ensemble de<br />
symptômes variables selon les disciplines<br />
pratiquées et selon les <strong>sport</strong>ifs considérés.<br />
L’ubiquité de ses manifestations explique<br />
la rareté des éléments diagnostiques cliniques<br />
stables actuellement disponibles.<br />
Les seuls marqueurs universels <strong>du</strong> surentraînement<br />
sont les modifications <strong>du</strong><br />
comportement habituel associées à une<br />
diminution <strong>du</strong>rable de la performance,<br />
malgré le maintien ou l’augmentation des<br />
charges d’entraînement. La démarche<br />
actuelle, qui consiste à interpréter les variations<br />
<strong>du</strong> niveau de performance et physiologiques<br />
de façon conjointe à celles <strong>du</strong><br />
comportement, semble constituer une<br />
bonne alternative diagnostique et ouvre des<br />
perspectives nouvelles à la recherche.<br />
Il est possible que ces manifestations soient<br />
interdépendantes, mais on s’interroge encore<br />
sur les facteurs déclenchants en cause. Sontils<br />
liés à des altérations périphériques structurales<br />
et/ou métaboliques au niveau <strong>du</strong><br />
muscle, à l’origine des modifications des<br />
concentrations des neurotransmetteurs <strong>du</strong><br />
système nerveux central et plus particulièrement<br />
de ceux de l’axe hypothalamo-pituitaire,<br />
déclenchant à leur tour des<br />
perturbations hormonales en cascade ? Ou<br />
bien ont-ils leur origine uniquement au<br />
niveau central, expliquant notamment les<br />
modifications psycho-comportementales ?<br />
Hypothèses physiopathologiques<br />
<strong>du</strong> surentraînement<br />
Le suivi biologique <strong>du</strong> surentraînement<br />
doit être guidé par sa physiopathologie.<br />
Nous allons donc essayer de préciser le<br />
pour et le contre de chaque hypothèse<br />
physiopathologique et <strong>du</strong> bilan biologique<br />
qui peut en découler.<br />
■A - Hypothèses structurale<br />
et métabolique<br />
• Les radicaux libres<br />
Lors de l’exercice intense, des altérations<br />
de la structure cellulaire <strong>du</strong> muscle peuvent<br />
apparaître tant pour des causes<br />
mécaniques (rupture d’éléments de l’architecture<br />
de la cellule), que métaboliques<br />
(agressions chimiques de ces<br />
mêmes éléments).<br />
Au plan métabolique, la pro<strong>du</strong>ction de radicaux<br />
libres est constante au sein des processus<br />
biochimiques aérobies. Lors de<br />
l’exercice, la consommation d’oxygène au<br />
sein de la chaîne de tran<strong>sport</strong> des électrons<br />
peut augmenter jusqu’à 40 fois sa valeur<br />
basale et il a été estimé que 1 à 3 % de l’oxy-<br />
gène consommé est incorrectement ré<strong>du</strong>it,<br />
augmentant d’autant la pro<strong>du</strong>ction de radicaux<br />
libres. Ces radicaux libres possèdent<br />
au moins un électron dissocié, ce qui les rend<br />
particulièrement réactifs, essayant d’extraire<br />
un électron à une autre molécule.<br />
Cet événement déclenche une série de<br />
réactions biochimiques qui peuvent altérer,<br />
à terme, le bon fonctionnement cellulaire.<br />
Au départ de ces réactions, les radicaux<br />
superoxydes (O 2 - • ) sont le plus fréquemment<br />
pro<strong>du</strong>its et peuvent in<strong>du</strong>ire, entre<br />
autres, une peroxydation des phospholipides<br />
membranaires de la cellule musculaire<br />
(Fig. 2). Cette “agression” a pour<br />
effet majeur d’augmenter la perméabilité<br />
de la membrane de la cellule musculaire,<br />
ce qui favorise la libération de certaines<br />
molécules dans la circulation sanguine,<br />
telles la CPK (créatine-phosphokinase), la<br />
myoglobine, la troponine I, la LDH (lacticodéhydrogénase).<br />
Les actions des radicaux libres peuvent aussi<br />
provoquer une altération des protéines<br />
contractiles susceptible de limiter fortement<br />
les capacités contractiles et métaboliques<br />
des cellules musculaires. La combinaison de<br />
ces 2 types d’altérations, chimique et mécanique,<br />
peut, à terme, altérer les performances<br />
de la structure musculaire.<br />
MÉDECINS DU SPORT 21 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Le surentraînement<br />
< DOSSIER ><br />
➎<br />
➍<br />
Stress mécanique<br />
(rupture) et/ou<br />
oxydatif<br />
Troponine i, CPK, LDH,<br />
MDA, myoglobine,<br />
3-méthylhistidine<br />
LOO .<br />
LO .<br />
H 2 O 2<br />
Troponine<br />
➌<br />
➋<br />
O 2<br />
-.<br />
Figure 2 : récapitulatif des altérations des structures cellulaires musculaires et diffusion des protéines<br />
métaboliques et/ou contractiles. ➊ : processus d’oxydo-ré<strong>du</strong>ction mitochondriaux. 1 à 3 % de l’oxygène<br />
consommé peuvent entraîner la formation de radicaux libres : ➋ : O 2<br />
-• (superoxydes), LOO• (lipoperoxyles), LO •<br />
(alkoxyles), H 2 O 2 (peroxyde d’hydrogène). ➌ : Ceux-ci peuvent altérer les structures contractiles et extraire<br />
notamment des protéines i et ➍ : membranaires rendant perméable la membrane cellulaire ➎ : à la troponine i,<br />
à la CPK (créatine phosphokinase), à la LDH (lacticodéhydrogénase), au MDA (malondialdhéhyde), à la myoglobine,<br />
et à la 3-méthylhistidine dont les dosages plasmatiques peuvent renseigner sur l’état de détresse de la fonction<br />
musculaire après un exercice intense de longue <strong>du</strong>rée (D’après Petibois et Coll. 2001).<br />
Le surentraînement pourrait apparaître<br />
à partir de ces phénomènes si des entraînements<br />
intenses étaient répétés sans<br />
permettre la restructuration <strong>du</strong> système<br />
musculaire. Ainsi, il a été proposé mais<br />
non encore démontré qu’une balance<br />
négative entre les actions des radicaux<br />
libres et les capacités anti-oxydantes des<br />
cellules musculaires à l’exercice puisse<br />
être un des mécanismes fondateurs <strong>du</strong><br />
processus de surentraînement.<br />
Il reste néanmoins vrai que, dans les<br />
48 heures suivant un exercice particulièrement<br />
intense et prolongé, l’étude<br />
conjointe des cinétiques des concentrations<br />
en vitamine E, MDA, CPK, myoglobine<br />
et troponine I peut donner un<br />
profil <strong>du</strong> stress structural des cellules<br />
musculaires et peut être utilisé comme<br />
un outil de diagnostic <strong>du</strong> surmenage<br />
musculaire, souvent à l’origine de traumatismes<br />
incapacitants (myalgies, déchirures,<br />
ruptures, œdèmes...).<br />
• Modifications d’utilisation des<br />
substrats énergétiques<br />
- Les glucides<br />
Lors de l’exercice d’en<strong>du</strong>rance, une hypoglycémie<br />
transitoire peut témoigner de la<br />
fatigue métabolique. Après plusieurs jours<br />
LDH<br />
GLYC. → Pyruvate ⇔ lactate<br />
ADP + Pi<br />
O 2 ↑ : exercice intense<br />
aérobie<br />
O 2<br />
CPK<br />
PCr ⇔ C + Pi<br />
ATP<br />
Tropomyosine<br />
Phospholipides<br />
membranaires<br />
1 à 3 % d’O 2<br />
Myoglobine<br />
➊<br />
Mitochondrie<br />
d’entraînement particulièrement longs et<br />
intenses et en l’absence d’une ingestion<br />
appropriée de glucides, une déplétion<br />
chronique <strong>du</strong> glycogène peut apparaître.<br />
Dans ce cas, la réplétion <strong>du</strong> glycogène est<br />
alors plus lente et retardée, ce qui entraîne<br />
une fatigue musculaire s’accumulant d’un<br />
entraînement à l’autre.<br />
Ces altérations <strong>du</strong> stockage <strong>du</strong> glycogène<br />
peuvent avoir plusieurs retentissements<br />
métaboliques.<br />
La lactatémie d’exercice baisse aussi bien<br />
pour une même intensité infra-maximale<br />
d’exercice chez des athlètes surentraînés,<br />
que pour une intensité maximale. La lactatémie<br />
est aussi étroitement liée à la<br />
concentration plasmatique de catécholamines.<br />
Le <strong>sport</strong>if surentraîné peut présenter<br />
une désensibilisation de son organisme<br />
aux catécholamines, probablement in<strong>du</strong>ite<br />
par une diminution de la densité des<br />
récepteurs ß adrénergiques ; cette perturbation<br />
de l’activité sympathique pourrait<br />
affecter la pro<strong>du</strong>ction musculaire d’acide<br />
lactique.<br />
Cette moindre lactatémie pourrait être <strong>du</strong>e<br />
à une utilisation minorée de la glycolyse<br />
pour la fourniture énergétique globale à<br />
l’exercice. Celle-ci serait alors plus largement<br />
alimentée par les substrats<br />
lipidiques dans le cas d’exercices inframaximaux.<br />
Par ailleurs, de faibles niveaux de glycogène<br />
peuvent con<strong>du</strong>ire à une oxydation<br />
accrue des acides aminés ramifiés qui,<br />
eux-mêmes, peuvent être à l’origine d’un<br />
processus menant à l’installation d’une<br />
fatigue centrale et/ou à une perturbation<br />
de l’action des neurotransmetteurs<br />
susceptibles d’expliquer le dysfonctionnement<br />
de l’axe hypothalamo-hypophysaire<br />
observé chez les sujets surentraînés.<br />
Enfin, la déplétion répétée en glycogène<br />
accompagnée d’un apport insuffisant en<br />
glucides pourrait aussi entraîner une sollicitation<br />
plus importante <strong>du</strong> métabolisme<br />
des purines nucléotides dont certains<br />
métabolites jouent un rôle dans la survenue<br />
de sensation de fatigue.<br />
Cependant, chez des athlètes surentraînés,<br />
même lorsque la déplétion <strong>du</strong><br />
glycogène s’avère significativement supérieure,<br />
la réplétion de ses stocks entre les<br />
entraînements apparaît généralement<br />
optimale. Le surentraînement ne serait<br />
donc pas directement lié à la déplétion<br />
chronique des stocks de glycogène,<br />
mais ceux-ci pourraient en être un facteur<br />
aggravant. L’hypoglycémie transitoire<br />
à l’exercice d’en<strong>du</strong>rance n’apparaît<br />
que légèrement plus importante chez<br />
l’athlète surentraîné ce qui ne permet pas<br />
de l’utiliser comme un outil de diagnostic<br />
discriminant.<br />
- Les acides aminés ramifiés (AAR)<br />
Lors de l’exercice de longue <strong>du</strong>rée, lorsque<br />
les stocks en glycogène sont en déplétion,<br />
les acides gras libres (AG) sanguins sont utilisés<br />
par le muscle comme substrats énergétiques<br />
de même que, à un moindre<br />
degré, les AAR (leucine, isoleucine, valine)<br />
dont l’oxydation contribue à un apport<br />
complémentaire en énergie.<br />
Les AG non hydrosolubles, et un autre<br />
acide aminé le tryptophane (Trp), ont un<br />
tran<strong>sport</strong>eur commun, l’albumine (Fig. 3).<br />
En conséquence de cette compétition, une<br />
consommation musculaire accrue en AG<br />
entraînera une libération importante de<br />
Trp libre dans la circulation sanguine.<br />
Comme les AAR et le Trp utilisent le même<br />
tran<strong>sport</strong>eur pour franchir la barrière cérébrale<br />
et que la concentration en Trp augmente<br />
tandis que celle des AAR diminue<br />
(<strong>du</strong> fait de leur utilisation musculaire), le Trp<br />
MÉDECINS DU SPORT 22 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
DOSSIER ><br />
Le surentraînement<br />
➊<br />
Acides aminés ramifiés (AAR) Acides gras (AG) Tryptophane (Trp)<br />
➋<br />
Energie = CO 2 + H 2 O<br />
↓ Glycogène ⇒↑ AG + ↑ AAR<br />
↑ AG +<br />
↑ AAR<br />
Relations physiologiques normales<br />
↑AG<br />
AAR<br />
↑ fTrp<br />
Figure 3 : compétition entre les acides aminés ramifiés (AAR) et le tryptophane (Trp) pour leur entrée dans<br />
le cerveau (fTrp : tryptophane libre). Plus les AAR sont utilisés par le muscle, plus de tryptophane entre dans<br />
le cerveau et plus de sérotonine (5-HT) est formée.<br />
➊ : une déplétion accrue <strong>du</strong> glycogène augmente la captation musculaire d’AAR et en acides gras (AG) par<br />
l’intermédiaire de l’albumine qui les tran<strong>sport</strong>e. ➋ : en conséquence une fraction <strong>du</strong> Trp est libérée par<br />
l’albumine dans le sang. ➌ : la baisse de la concentration sanguine en AAR (utilisés par le travail musculaire)<br />
et l’augmentation Trp libre favoriseront le passage de ce dernier à travers la barrière cérébrale. Dans le<br />
cerveau, le Trp favorisera une synthèse accrue de 5-hydroxytriptamine (5-HT = sérotonine), ce qui pourrait être<br />
à l’origine d’une fatigue centrale inhibant certains des principaux signaux d’alarme de l’organisme.<br />
est favorisé pour entrer dans le cerveau.<br />
Il est alors converti en un neurotransmetteur,<br />
la sérotonine (5-hydroxytryptamine)<br />
qui a plusieurs rôles au niveau des<br />
aires corticales spécifiques. Elle intervient<br />
dans l’in<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> sommeil, la ré<strong>du</strong>ction<br />
de l’excitabilité des motoneurones<br />
(notamment lors de l’exercice) et l’inhibition<br />
de facteurs de libération des hormones<br />
sécrétées dans l’hypothalamus,<br />
ce qui peut perturber les régulations<br />
endocriniennes de l’organisme. Une<br />
baisse <strong>du</strong> rapport des concentrations sanguines<br />
Trp/AAR a donc été proposée<br />
comme outil de diagnostic <strong>du</strong> surentraînement<br />
chez les <strong>sport</strong>ifs d’en<strong>du</strong>rance.<br />
Cependant, les résultats expérimentaux<br />
acquis à ce jour ne permettent pas de<br />
conclure sur d’éventuelles relations de<br />
cause à effet entre les déplétions chroniques<br />
des stocks de glycogène à l’exercice<br />
et l’in<strong>du</strong>ction d’une fatigue centrale<br />
liée à la baisse <strong>du</strong> rapport Trp/AAR.<br />
- La glutamine<br />
La glutamine (Gln) est l’acide aminé le<br />
plus abondant et le plus versatile de l’organisme<br />
humain. Elle est métabolisée<br />
par certaines cellules <strong>du</strong> système immunitaire,<br />
dont les lymphocytes et les macrophages.<br />
Le muscle est un des principaux lieux de<br />
+ Albumine (compétition) ⇒ ↑ f Trp<br />
➌<br />
↓ AAR<br />
↑ fTrp<br />
➩<br />
Tran<strong>sport</strong>eur commun<br />
(compétition) = + fTrp<br />
↓ AAR ⇒ ↓ Protéines<br />
↑ Trp ⇒ 5-HT<br />
Relations dans le surentraînement<br />
synthèse de la Gln qui est alors libérée<br />
dans le plasma. Ceci suggère qu’une<br />
baisse de la concentration plasmatique<br />
en Gln pourrait être responsable, <strong>du</strong><br />
moins partiellement, d’insuffisances<br />
fonctionnelles <strong>du</strong> système immunitaire.<br />
Ainsi, la concentration plasmatique en<br />
Gln pourrait représenter le lien métabolique<br />
entre le muscle squelettique et le<br />
système immunitaire. Au niveau des<br />
concentrations plasmatiques, les exercices<br />
intenses et/ou de longue <strong>du</strong>rée<br />
provoquent 2 types de réponse : les<br />
concentrations en Gln s’élèvent au cours<br />
de l’exercice, mais baissent significativement<br />
lors de la récupération. Leur retour<br />
aux conditions basales nécessite plusieurs<br />
heures. Si la récupération entre les<br />
séances d’entraînement est insuffisante,<br />
la libération de Gln depuis le tissu musculaire<br />
devient de plus en plus limitée à<br />
mesure que ce type de récupération se<br />
répète, ne permettant plus au système<br />
immunitaire de remplir correctement ses<br />
fonctions. La persistance de ce schéma<br />
pourrait donc contribuer à l’installation<br />
<strong>du</strong> surentraînement, les infections affaiblissant<br />
encore les capacités immunitaires<br />
de l’organisme alors qu’un stress métabolique<br />
est déjà présent dans l’entraînement<br />
intense.<br />
Tableau II : principaux paramètres sanguins<br />
et immunitaires à établir.<br />
● Numération formule sanguine<br />
● Numération des lymphocytes B et T<br />
● Activité des cellules NK<br />
● Tryptophane libre (Trp)<br />
● Acides aminés ramifiés (AAR)<br />
● Trp/AAR<br />
● Glutamine<br />
● Immunoglobulines A et G<br />
Ce schéma n’est toutefois pas systématique.<br />
Ainsi, une forte déplétion des<br />
réserves, notamment musculaires, de la<br />
Gln est souvent, mais pas toujours, observée<br />
chez les athlètes surentraînés. Le suivi<br />
des concentrations en Gln apparaît<br />
donc comme un des outils potentiels<br />
de diagnostic <strong>du</strong> surentraînement.<br />
Cependant, à cause de l’insuffisance de<br />
son pouvoir discriminant, il devrait être<br />
couplé à l’analyse d’autres paramètres<br />
sanguins et immunitaires (Tab. II).<br />
• Hypothèse de la leptine<br />
La leptine est une hormone spécifiquement<br />
libérée par les adipocytes. Elle<br />
reflète les contenus de l’organisme en<br />
lipides. Outre ses fonctions métaboliques<br />
(c’est-à-dire un signal putatif de la satiété),<br />
elle semble affecter les mécanismes de<br />
feed-back de l’axe hypothalamo-pituitairegonadal.<br />
Chez l’homme, la sécrétion de leptine est<br />
régulée de manière complexe. Il a été<br />
démontré que l’insuline stimule la sécrétion<br />
de leptine, alors que les catécholamines<br />
et la teneur sanguine en AG libres<br />
l’inhibent.<br />
Si l’exercice exhaustif ne semble pas avoir<br />
d’effet sur la concentration de leptine circulante,<br />
plusieurs études ont montré<br />
qu’un exercice d’en<strong>du</strong>rance baissait la<br />
concentration de leptine après<br />
48 heures, ceci étant associé à une<br />
baisse préliminaire de l’insuline.<br />
Globalement, il apparaît que les niveaux<br />
de leptine baissent chez les athlètes très<br />
entraînés en en<strong>du</strong>rance. Ces changements<br />
de concentration sont parallèles<br />
à la baisse des contenus lipidiques. Des<br />
travaux sont actuellement en cours pour<br />
préciser si la leptine, au même titre que<br />
d’autres hormones, pourrait servir de<br />
MÉDECINS DU SPORT 23 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Le surentraînement<br />
< DOSSIER ><br />
“transmetteur” entre une surcharge de<br />
travail musculaire et le cerveau. Ceci permettrait,<br />
en retour, de limiter ou d’inhiber<br />
le turnover métabolique des tissus<br />
concernés.<br />
Cependant, il n’a pas été mis en évidence<br />
d’altération <strong>du</strong> métabolisme de la leptine<br />
chez des patients présentant un syndrome<br />
de fatigue chronique, proche sur<br />
le plan métabolique <strong>du</strong> syndrome de surentraînement.<br />
De plus, la leptine ne<br />
semble pas sensible à l’augmentation <strong>du</strong><br />
volume d’entraînement. Elle ne peut<br />
donc pas encore être considérée comme<br />
un marqueur biochimique <strong>du</strong> surentraînement.<br />
En conclusion, à l’heure actuelle, les<br />
modifications <strong>du</strong> métabolisme de la leptine<br />
au cours de l’entraînement, de son<br />
intensité et de son volume, ne semblent<br />
pas suffisamment comprises pour en faire<br />
un critère de diagnostic fiable dans le<br />
cadre <strong>du</strong> surentraînement.<br />
Figure 4 : axe hypothalamo-hypophysaire <strong>du</strong><br />
surentraînement. Cette figure ne tente pas de<br />
dresser le portrait de la complexité des régulations<br />
hormonales, mais plutôt celui des effets que la<br />
dérégulation in<strong>du</strong>ite par le surentraînement peut<br />
avoir sur plusieurs systèmes de l’organisme. Dans ce<br />
sens, et sur bien des aspects, le système hormonal<br />
constitue la relation entre l’étiologie centrale et<br />
périphérique <strong>du</strong> surentraînement<br />
(D’après Fry et Coll., 1991).<br />
↓ A.A.<br />
Dysfonction<br />
hypothalamopituitaire<br />
LH<br />
FSH<br />
GH<br />
ACTH<br />
TSH<br />
Thyroxine<br />
Triiodothyronine<br />
Calcitonine<br />
Hormone parathyroïdienne<br />
■B - Hypothèse<br />
immunitaire<br />
L’immunosuppression semble récurrente<br />
chez les athlètes d’en<strong>du</strong>rance souffrant<br />
de surentraînement. Nous avons déjà vu<br />
l’interaction proposée entre le métabolisme<br />
de la glutamine et le système immunitaire.<br />
Il est aussi possible que le<br />
métabolisme des acides gras (AG) interagisse<br />
avec le système immunitaire. En<br />
effet, les ganglions lymphatiques sont associés<br />
au métabolisme <strong>du</strong> tissu adipeux.<br />
Lors de l’exercice, notamment lorsque les<br />
stocks de glycogène ne sont pas assez<br />
rapidement reconstitués, la concentration<br />
plasmatique en AG libérés par les<br />
adipocytes augmente. Ainsi, les cellules<br />
contenues à l’intérieur des ganglions lymphatiques<br />
peuvent être exposées à de<br />
hautes concentrations en AG polyinsaturés<br />
qui pourraient ainsi inhiber la prolifération<br />
des lymphocytes. Cependant,<br />
cette hypothèse attend toujours une vérification<br />
expérimentale sur des athlètes<br />
en état de surentraînement, notamment<br />
via l’étude <strong>du</strong> turnover et de la différenciation<br />
des AG synthétisés en réponse à<br />
l’exercice intense.<br />
Par ailleurs, des exercices intenses réalisés<br />
quotidiennement semblent avoir des<br />
effets cumulatifs et diversifiés sur les paramètres<br />
immunitaires, incluant les leucocytes<br />
circulants, les concentrations<br />
plasmatiques en cytokines, l’activité des<br />
cellules tueuses, la sécrétion d’immunoglobuline<br />
A et l’activité phagocytaire des<br />
macrophages et des neutrophiles. L’entraînement<br />
intense sans récupération suffisante<br />
pro<strong>du</strong>it des traumatismes<br />
musculaires, squelettiques et articulaires.<br />
Ceci peut favoriser une inflammation systémique<br />
pouvant devenir incapacitante.<br />
Plusieurs marqueurs immunitaires d’états<br />
de fatigue <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if ont été proposés,<br />
comme par exemple le rapport de<br />
2 sous-classes de lymphocytes T circulants<br />
(CD4/CD8) qui baisse systématiquement<br />
à l’exercice mais encore plus en<br />
cas de surentraînement. Cependant, la<br />
complexité <strong>du</strong> fonctionnement <strong>du</strong> système<br />
immunitaire et la versatilité de ses<br />
réactions au cours et entre les séances<br />
d’entraînement intenses en limitent<br />
encore fortement l’approche diagnostique.<br />
Un profil <strong>du</strong> statut immunitaire de<br />
l’athlète, incluant les concentrations plasmatiques<br />
en immunoglobulines A et G, la<br />
numération formule sanguine et des lymphocytes<br />
B et T et l’activité des cellules NK,<br />
Stress physiques<br />
et psychologiques<br />
excessifs et répétés<br />
↓ Synthèse d’androgènes<br />
↓ Synthèse de progestérone<br />
Cortisol<br />
Aldostérone<br />
Adrénaline<br />
Noradrénaline<br />
Métabolisme énergétique<br />
Croissance et différentiation cellulaire<br />
Minéralisation osseuse<br />
Ejection systolique<br />
Variations de la FC<br />
Faiblesse musculaire<br />
Tolérance au chaud et au froid<br />
Menstruation<br />
Léthargie, fatigue, nervosité<br />
Frémissements<br />
Baisse intellectuelle<br />
Ostéoporose<br />
Causes possibles<br />
<strong>du</strong> surentraînement<br />
Détérioration<br />
de la fonction<br />
de repro<strong>du</strong>ction<br />
Aménorrhée<br />
Anovulation<br />
↓ Pro<strong>du</strong>ction de sperme<br />
↓ Pulsions sexuelles<br />
Régulation des substrats<br />
Cétogénèse<br />
Glycémie<br />
Métabolisme de AGL<br />
Contrôle cardiovasculaire<br />
Variation de la PA<br />
Variation de la FC<br />
Système immunitaire<br />
Allergie<br />
Pathologies auto-immunes<br />
Infection virale/bactérienne<br />
Equilibre hydrique et sel<br />
Sensation de soif<br />
Déshydratation<br />
Equilibre anabolisme/<br />
catabolisme<br />
Perte de masse maigre<br />
Atrophie musculaire<br />
Elévation sérique de l’urée<br />
et de l’acide urique<br />
MÉDECINS DU SPORT 24 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
DOSSIER ><br />
Le surentraînement<br />
pourrait être suivi au cours des différentes<br />
phases d’entraînement de la saison. Plus<br />
que la détection d’un paramètre immunitaire<br />
réagissant spécifiquement à<br />
l’installation de la fatigue chronique<br />
<strong>du</strong> surentraînement, ce sera surtout<br />
l’apparition d’une réponse non spécifique<br />
qui tra<strong>du</strong>ira un déséquilibre fonctionnel<br />
profond.<br />
■C - Hypothèse<br />
hormonale<br />
Une moindre synthèse des neurotransmetteurs<br />
<strong>du</strong> système nerveux central<br />
(SNC) pourrait être à l’origine <strong>du</strong> dysfonctionnement<br />
hypothalamique rapporté<br />
chez le <strong>sport</strong>if surentraîné. Ces<br />
perturbations <strong>du</strong> SNC pourraient aussi<br />
être à l’origine de troubles psycho-comportementaux<br />
très souvent observés<br />
chez les sujets surentraînés.<br />
L’hypothalamus est un centre de coordination<br />
entre le système hormonal, le<br />
système nerveux autonome et l’environnement.<br />
Des stress environnementaux<br />
fréquents peuvent perturber le fonctionnement<br />
hyphotalamo-hypophysaire et<br />
entraîner des dérèglements en cascade<br />
de l’ensemble <strong>du</strong> système hormonal<br />
(Fig. 4). Il semble que seul le fonctionnement<br />
hypothalamique soit altéré dans le<br />
surentraînement. Les perturbations sécrétoires<br />
de l’hypophyse ne seraient donc<br />
que la conséquence <strong>du</strong> dysfonctionnement<br />
hypothalamique.<br />
Lors <strong>du</strong> surentraînement, la concentration<br />
en hormone lutéinisante (LH)<br />
chute pour les <strong>sport</strong>s d’en<strong>du</strong>rance, alors<br />
qu’elle reste stable pour des <strong>sport</strong>s de<br />
vitesse ou de puissance. Cependant, ce<br />
marqueur n’est pas vraiment utilisable<br />
pour le diagnostic précoce <strong>du</strong> surentraînement,<br />
étant donnée l’extrême lenteur<br />
de la réaction négative de l’axe<br />
hypothalamo-pituitaire aux surcharges<br />
d’entraînement.<br />
Au niveau de la symptomatologie, si les<br />
modifications des taux hormonaux en<br />
LH et en folliculo-stimuline (FSH) in<strong>du</strong>ites<br />
par le surentraînement sont amples, les<br />
synthèses de la testostérone et de la progestérone<br />
seront modifiées, provoquant<br />
chez la femme une anovulation, des oligoménorrhées,<br />
voire des aménorrhées,<br />
et chez l’homme une décroissance de la<br />
pro<strong>du</strong>ction de sperme accompagnée<br />
d’une baisse de la libido caractéristique<br />
chez le <strong>sport</strong>if surentraîné.<br />
En outre, en interaction avec une<br />
moindre pro<strong>du</strong>ction de l’hormone de<br />
croissance (GH), une moindre synthèse<br />
de testostérone et de progestérone<br />
déséquilibre la balance anabolisme/<br />
catabolisme en faveur de ce dernier,<br />
entraînant une perte de la masse musculaire,<br />
une augmentation de l’urée et<br />
de l’acide urique sérique tra<strong>du</strong>isant un<br />
turnover protéique déficitaire. Un déficit<br />
en GH perturbe aussi la régulation<br />
d’utilisation des substrats, plus particulièrement<br />
de la cétogenèse, de la<br />
glycémie et des AG libres.<br />
L’adrénocorticotrophine (ACTH) régule la<br />
sécrétion de cortisol et la pro<strong>du</strong>ction des<br />
catécholamines. En cas de surentraînement,<br />
les réponses de l’ACTH aux exercices<br />
intenses et le contrôle de la<br />
sécrétion de cortisol sont altérés. De fines<br />
fluctuations avec augmentation de la cortisolémie<br />
de repos, peu ou pas significatives<br />
sur le plan purement statistique,<br />
peuvent être des marqueurs tout à fait<br />
discriminants d’un état de surentraînement.<br />
L’étude <strong>du</strong> rapport des concentrations<br />
en testostérone libre et en cortisol<br />
(fT/C) a été proposée comme un indice<br />
<strong>du</strong> statut anabolique/catabolique de l’athlète.<br />
Une chute de ce rapport de plus de<br />
30 % pourrait indiquer un état de surentraînement<br />
dans les <strong>sport</strong>s de résistance<br />
ou de vitesse.<br />
Il est important de noter que les<br />
entraînements très poussés in<strong>du</strong>isent<br />
des perturbations hormonales<br />
proches de celles observées lors <strong>du</strong><br />
surentraînement. Des contrôles hormonaux<br />
isolés ne sont donc pas suffisamment<br />
pertinents pour diagnostiquer<br />
le surentraînement, car ils peuvent tout<br />
simplement tra<strong>du</strong>ire des effets transitoires<br />
<strong>du</strong>s à une charge d’entraînement<br />
exhaustive et non un dysfonctionnement<br />
déjà installé. En conséquence,<br />
l’étude <strong>du</strong> profil hormonal, standardisé<br />
et régulier, ne doit être à considérer que<br />
comme un complément d’information<br />
sur l’évolution de la situation physiologique<br />
d’un athlète s’entraînant intensément.<br />
Notons par ailleurs, qu’il est actuellement<br />
de plus en plus évident que des interactions<br />
très complexes entre le dysfonctionnement<br />
hypothalamo-hypophysaire, le<br />
système hormonal et le système immunitaire<br />
jouent un rôle essentiel dans l’explication<br />
des immunomo<strong>du</strong>lations, voire de<br />
l’immunosuppression, ouvrant la voie aux<br />
nombreuses maladies infectieuses observées<br />
chez le <strong>sport</strong>if surentraîné.<br />
■D - Manifestations<br />
psychocomportementales<br />
Les mécanismes responsables <strong>du</strong> surentraînement<br />
associent souvent des facteurs<br />
émotionnels et physiologiques.<br />
Probablement liées aux perturbations<br />
<strong>du</strong> système nerveux central, mais peutêtre<br />
aussi à certains dysfonctionnements<br />
périphériques, voire même à des événements<br />
extérieurs (pression accrue au<br />
travail, problèmes familiaux, domestiques<br />
ou matériels), les manifestations<br />
psycho-comportementales <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if surentraîné<br />
peuvent revêtir plusieurs<br />
aspects variables selon les indivi<strong>du</strong>s.<br />
Comme cela est décrit dans le paragraphe<br />
précédent de ce dossier, ces<br />
manifestations sont évaluées par des<br />
questionnaires adaptés.<br />
Conclusion<br />
Au terme de cette analyse physiopathologique<br />
<strong>du</strong> surentraînement, il<br />
apparaît difficile de proposer aujourd’hui<br />
aux <strong>sport</strong>ifs un bilan biologique de base<br />
permettant de prévenir en temps suffisant<br />
et à tous les coups la survenue d’un<br />
surentraînement. Des études complémentaires<br />
sont nécessaires pour affiner<br />
le contenu de ce suivi biologique. ■<br />
MÉDECINS DU SPORT 25 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Le surentraînement<br />
< DOSSIER ><br />
Pour la pratique<br />
on retiendra...<br />
Pr François Carré<br />
■A - Le déséquilibre<br />
charges / récupération<br />
Le surentraînement peut toucher les<br />
<strong>sport</strong>ifs de tous les niveaux de performance.<br />
Il est, le plus souvent, le résultat<br />
d’un déséquilibre entre les charges d’entraînement<br />
et les périodes de récupération<br />
qui sont les 2 éléments clés de<br />
la préparation physique pour progresser<br />
et réaliser une performance <strong>sport</strong>ive.<br />
■B - Une physiopathologie<br />
multifactorielle<br />
et complexe<br />
La physiopathologie <strong>du</strong> surentraînement<br />
est multifactorielle et complexe. Plusieurs<br />
hypothèses probablement intriquées les<br />
unes avec les autres sont proposées. Une<br />
hypothèse “musculaire” qui regroupe des<br />
altérations structurales et fonctionnelles <strong>du</strong><br />
muscle avec une altération de l’équilibre<br />
d’utilisation des substrats énergétiques.<br />
Une hypothèse immunitaire bien illustrée<br />
par la formule classique et empirique des<br />
entraîneurs “angine de forme”, laquelle<br />
pourrait représenter la limite avec le stade<br />
<strong>du</strong> surentraînement. Une hypothèse hormonale<br />
dans laquelle l’axe de régulation<br />
hypothalamo-hypophysaire et les glandes<br />
sécrétrices pourraient être impliqués.<br />
■C - Un diagnostic<br />
difficile<br />
Malgré les progrès dans la compréhension<br />
<strong>du</strong> surentraînement, qui ressemble<br />
beaucoup au syndrome de<br />
fatigue chronique qui peut toucher des<br />
sédentaires, il est difficile de proposer<br />
des critères biologiques simples et<br />
faibles pour son diagnostic positif. Le<br />
diagnostic <strong>du</strong> surentraînement reste<br />
actuellement clinique et peut être<br />
défini comme une baisse <strong>du</strong>rable de<br />
performances inexpliquée par une diminution<br />
de l’entraînement, ni par une<br />
pathologie intercurrente. La difficulté<br />
peut être de distinguer un état passager<br />
de fatigue rapidement résolutif avec<br />
un réel syndrome de surentraînement.<br />
■D - L’importance<br />
“des” interrogatoires<br />
La clinique <strong>du</strong> surentraînement repose<br />
sur un interrogatoire dirigé au mieux<br />
guidé par un questionnaire approprié.<br />
Il permettra de mettre en évidence des<br />
manifestations psycho-comportementales<br />
variées. Il devra être complété par<br />
une enquête nutritionnelle. Parfois, il faudra<br />
aussi savoir interroger l’entraîneur et<br />
consulter le car<strong>net</strong> d’entraînement <strong>du</strong><br />
<strong>sport</strong>if pour mettre en évidence le déséquilibre<br />
responsable. L’examen physique<br />
est souvent pauvre. Il peut retrouver des<br />
petits signes variés comme des modifications<br />
cardio-respiratoires, des modifications<br />
de l’équilibre staturo-pondéral,<br />
des signes de déséquilibre hormonal...<br />
Surtout, cet examen clinique cherchera<br />
à éliminer une pathologie intercurrente,<br />
le fait d’être <strong>sport</strong>if n’éliminant pas la<br />
possibilité d’être malade. Les tests d’effort,<br />
éventuellement réalisés sur le terrain<br />
apportent souvent des renseignements<br />
complémentaires cliniques et biologiques<br />
(cinétique des lactates) majeurs.<br />
■E - Le double intérêt<br />
<strong>du</strong> bilan biologique<br />
La réalisation d’un bilan biologique a un<br />
double intérêt, il permet d’abord d’éliminer<br />
une pathologie intercurrente et<br />
peut aider à confirmer le diagnostic. Le<br />
bilan de base sera donc simple, cherchant<br />
à éliminer une pathologie infectieuse<br />
virale et/ou bactérienne et un<br />
syndrome inflammatoire. Il pourra dans<br />
certains cas difficiles, ou chez des athlètes<br />
de haut niveau, être complété par<br />
un bilan immunitaire, hormonal et enzymatique.<br />
■F - Un traitement<br />
curatif simple<br />
Le traitement curatif <strong>du</strong> surentraînement<br />
est simple, c’est le repos plus ou moins<br />
actif. Sa <strong>du</strong>rée sera fonction de la profondeur<br />
<strong>du</strong> syndrome. Il pourra autoriser<br />
des activités physiques d’intensité<br />
modérée, parfois différentes de la discipline<br />
<strong>sport</strong>ive pour lutter contre la lassitude<br />
morale souvent associée.<br />
■G - Rien ne vaut le<br />
traitement préventif<br />
En fait, le traitement <strong>du</strong> surentraînement<br />
doit être préventif. Il repose sur l’établissement<br />
d’une confiance et d’une<br />
bonne collaboration entre le médecin, le<br />
<strong>sport</strong>if et l’entraîneur, chacun respectant<br />
sa “place”. Le couple <strong>sport</strong>if/entraîneur<br />
doit respecter une programmation de<br />
la saison <strong>sport</strong>ive avec une progressivité,<br />
une régularité et un équilibre entre<br />
les charges d’entraînement et les phases<br />
de récupération.<br />
L’équilibre nutritionnel occupe aussi une<br />
place majeure dans cet équilibre.<br />
Le <strong>sport</strong>if doit tenir à jour un car<strong>net</strong> d’entraînement<br />
qui comprendra bien sûr les<br />
séances d’entraînement réalisées. Sur ce car<strong>net</strong><br />
doivent aussi figurer des renseignements<br />
cliniques de base comme le poids, la fréquence<br />
cardiaque au réveil, les sensations<br />
personnelles, en particulier au décours des<br />
séances d’entraînement.<br />
Il est important que l’athlète réalise régulièrement<br />
des circuits “test” qui le renseigneront<br />
sur son état de “forme” ; une<br />
baisse des performances inexpliquée doit<br />
alerter et doit imposer une adaptation de<br />
l’entraînement.<br />
Le rôle <strong>du</strong> médecin sera d’écouter le <strong>sport</strong>if<br />
qui n’est pas un patient comme les<br />
autres. C’est ici que la possession d’un bilan<br />
de référence lorsque “tout va bien” prend<br />
toute son importance, la comparaison pouvant<br />
grandement aider au diagnostic.<br />
Dans l’idéal, et au moins chez tout <strong>sport</strong>if<br />
de haut niveau, ce bilan sera clinique avec<br />
un électrocardiogramme de repos et complété<br />
par un bilan biologique simple et<br />
par un test d’effort.<br />
■<br />
MÉDECINS DU SPORT 26 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
DOSSIER ><br />
Le surentraînement<br />
QUESTIONNAIRE DE SURENTRAÎNEMENT<br />
Nom : ....................... Prénom : ....................... Date <strong>du</strong> jour : .................................................<br />
Date de naissance : .....................................................................................................................<br />
Profession : ..................................................................................................................................<br />
Si vous êtes étudiant, êtes-vous en période d’examens ? OUI ❏ NON ❏<br />
● Discipline <strong>sport</strong>ive principale ? ..............................................................................................<br />
Niveau de pratique : Internat. ou National Régional ou Départ. Loisir<br />
Nombre d’heures d’entraînement réalisées dans ce dernier mois : ................................................<br />
Nombre d’heures réalisées cette dernière semaine dans la discipline principale : ...........................<br />
L’intensité de cet entraînement est : (entourer la mention utile)<br />
Extrêmement facile - Très facile - Facile - Modérée - Forte - Très forte - Extrêmement forte<br />
Nombre d’heures réalisées cette dernière semaine hors de cette discipline principale : ...................<br />
Nombre de compétitions dans le mois qui précède (en journées de compétition) : ........................<br />
Si vous pratiquez d’autres disciplines <strong>sport</strong>ives, citez les : ...............................................................<br />
● Y a-t-il eu au cours <strong>du</strong> dernier mois, un événement important ayant perturbé votre vie personnelle<br />
ou familiale ? OUI ❏ NON ❏<br />
● Avez-vous arrêté votre entraînement pour maladie ou blessure ? OUI ❏ NON ❏<br />
● Prenez-vous un traitement actuellement ? OUI ❏ NON ❏<br />
Lequel ?.......................................................................................................................................<br />
● Avez-vous effectué un stage récent en altitude (dans les derniers 15 jours) ? OUI ❏ NON ❏<br />
● Avez-vous été privé de sommeil dans la dernière semaine<br />
(décalage horaire ou autres raisons) ? OUI ❏ NON ❏<br />
● Avez-vous des troubles des règles ? OUI ❏ NON ❏<br />
Mettre une croix pour se situer entre ces deux extrêmes :<br />
Mon niveau de performance est : Excellent Mauvais<br />
Mon état physique : Grande forme Méforme<br />
Je me fatigue : Plus lentement Plus rapidement<br />
Je récupère de mon état de fatigue : Plus lentement Plus rapidement<br />
Je me sens : Très déten<strong>du</strong> Très anxieux<br />
J’ai la sensation que ma force musculaire a : Augmenté Diminué<br />
J’ai la sensation que mon en<strong>du</strong>rance a : Augmenté Diminué<br />
MÉDECINS DU SPORT 27 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Le surentraînement<br />
< DOSSIER ><br />
Ce dernier mois :<br />
1 Mon niveau de performance <strong>sport</strong>ive / mon état de forme a diminué OUI ❏ NON ❏<br />
2 Je ne soutiens pas autant mon attention OUI ❏ NON ❏<br />
3 Mes proches estiment que mon comportement a changé OUI ❏ NON ❏<br />
4 J’ai une sensation de poids sur la poitrine OUI ❏ NON ❏<br />
5 J’ai une sensation de palpitation OUI ❏ NON ❏<br />
6 J’ai une sensation de gorge serrée OUI ❏ NON ❏<br />
7 J’ai moins d’appétit qu’avant OUI ❏ NON ❏<br />
8 Je mange davantage OUI ❏ NON ❏<br />
9 Je dors moins bien OUI ❏ NON ❏<br />
10 Je somnole et baille dans la journée OUI ❏ NON ❏<br />
11 Les séances me paraissent trop rapprochées OUI ❏ NON ❏<br />
12 Mon désir a diminué OUI ❏ NON ❏<br />
13 Je fais des contre-performances OUI ❏ NON ❏<br />
14 Je m’enrhume fréquemment OUI ❏ NON ❏<br />
15 J’ai des problèmes de mémoire OUI ❏ NON ❏<br />
16 Je grossis OUI ❏ NON ❏<br />
17 Je me sens souvent fatigué OUI ❏ NON ❏<br />
18 Je me sens en état d’infériorité OUI ❏ NON ❏<br />
19 J’ai des crampes, douleurs musculaires fréquentes OUI ❏ NON ❏<br />
20 J’ai plus souvent mal à la tête OUI ❏ NON ❏<br />
21 Je manque d’entrain OUI ❏ NON ❏<br />
22 J’ai parfois des malaises ou des étourdissements OUI ❏ NON ❏<br />
23 Je me confie moins facilement OUI ❏ NON ❏<br />
24 Je suis souvent patraque OUI ❏ NON ❏<br />
25 J’ai plus souvent mal à la gorge OUI ❏ NON ❏<br />
26 Je me sens nerveux, ten<strong>du</strong>, inquiet OUI ❏ NON ❏<br />
27 Je supporte moins bien mon entraînement OUI ❏ NON ❏<br />
28 Mon cœur bat plus vite qu’avant au repos OUI ❏ NON ❏<br />
29 Mon cœur bat plus vite qu’avant à l’effort OUI ❏ NON ❏<br />
30 Je suis souvent mal fichu OUI ❏ NON ❏<br />
31 Je me fatigue plus facilement OUI ❏ NON ❏<br />
32 J’ai souvent des troubles digestifs OUI ❏ NON ❏<br />
33 J’ai envie de rester au lit OUI ❏ NON ❏<br />
34 J’ai moins confiance en moi OUI ❏ NON ❏<br />
35 Je me blesse facilement OUI ❏ NON ❏<br />
36 J’ai plus de mal à rassembler mes idées OUI ❏ NON ❏<br />
37 J’ai plus de mal à me concentrer dans mon activité <strong>sport</strong>ive OUI ❏ NON ❏<br />
38 Mes gestes <strong>sport</strong>ifs sont moins précis, moins habiles OUI ❏ NON ❏<br />
39 J’ai per<strong>du</strong> de la force, <strong>du</strong> punch OUI ❏ NON ❏<br />
40 J’ai l’impression de n’avoir personne de proche à qui parler OUI ❏ NON ❏<br />
41 Je dors plus OUI ❏ NON ❏<br />
42 Je tousse plus souvent OUI ❏ NON ❏<br />
43 Je prends moins de plaisir à mon activité <strong>sport</strong>ive OUI ❏ NON ❏<br />
44 Je prends moins de plaisir à mes loisirs OUI ❏ NON ❏<br />
45 Je m’irrite plus facilement OUI ❏ NON ❏<br />
46 J’ai une baisse de rendement dans mon activité scolaire ou professionnelle OUI ❏ NON ❏<br />
47 Mon entourage trouve que je deviens moins agréable à vivre OUI ❏ NON ❏<br />
48 Les séances <strong>sport</strong>ives me paraissent trop difficiles OUI ❏ NON ❏<br />
49 C’est ma faute si je réussis moins bien OUI ❏ NON ❏<br />
50 J’ai les jambes lourdes OUI ❏ NON ❏<br />
51 J’égare plus facilement les objets (clefs, etc.) OUI ❏ NON ❏<br />
52 Je suis pessimiste, j’ai des idées noires OUI ❏ NON ❏<br />
53 Je maigris OUI ❏ NON ❏<br />
54 Je me sens moins motivé, j’ai moins de volonté, moins de ténacité OUI ❏ NON ❏<br />
MÉDECINS DU SPORT 28 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
DOSSIER ><br />
Le surentraînement<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Approche clinique<br />
1. Favre Juvin A, Flore P, Rousseaux Blanchi MP.<br />
Approche clinique <strong>du</strong> surentraînement.<br />
Article en cours de publication : Sciences et<br />
<strong>sport</strong>s 2003.<br />
2. Fry RW, Morton AR, Keast D. Overtraining<br />
in athletes : un update. Sports Med<br />
1991 ; 12 (1) : 32-65.<br />
3. Lawrence E, Armstrong JL. The unknown<br />
mechanism of the overtraining syndrome.<br />
Sports Medecine 2002 ; 32 (3) : 185-200.<br />
4. Legros P et le groupe “surentraînement”<br />
(Desmarais Y, Jousselin E, Legros P, Medelli J,<br />
Paruit C, Serrurier B). Le surentraînement.<br />
Sciences et <strong>sport</strong>s 1992 ; 7 : 51-7.<br />
5. Legros P et le groupe “surentraînement”.<br />
Le surentraînement : diagnostic des manifestations<br />
psychocomportementales précoces.<br />
Sciences et <strong>sport</strong>s 1993 ; 8 : 71-4.<br />
6. Legros P, Bosquet L, Leger L. Blood lactate<br />
response to overtraining in male<br />
en<strong>du</strong>rance athletes. Eur J Appl Physiol<br />
2001 ; 84 : 107-14.<br />
7. Lehman M, Foster C, Keul J. overtraining<br />
in en<strong>du</strong>rance athletes : a brief review. Med<br />
Sci Sports Exerc 1993 ; 25 (7) : 854-62.<br />
8. Urhausen A, Kindermann W. Diagnosis<br />
of overtraining : what tools do we have ?<br />
Sports Med 2002 ; 32 (2) : 95-102.<br />
Physiopathologie et<br />
aspects biologiques<br />
9. Bosquet L. Le surentraînement dans les<br />
activités physiques de longue <strong>du</strong>rée. Etude<br />
de plusieurs marqueurs physiologiques.<br />
Thèse de doctorat en STAPS. Faculté des<br />
Sciences <strong>du</strong> <strong>sport</strong> de l’Université de Poitiers.<br />
Dec 2 000.<br />
10. Cleare AJ, O’Keane V, Miell J. Plasma<br />
leptin in chronic fatigue syndrome and a<br />
placebo-controlled study of the effects of<br />
low-dose hydrocortisone on leptin secretion.<br />
Clin Endocrinol 2001 ; 55 : 113-9.<br />
11. Fry A, Kraemer W. Resistance exercise<br />
overtraining and overreaching. Neuroendocrine<br />
responses. Sports Med 1997 ; 23 :<br />
106-29.<br />
12. Gastmann UA, Lehmann MJ. Overtraining<br />
and the BCAA hypothesis. Med Sci<br />
Sports Exerc 1998 ; 30 : 1173-8.<br />
13. Halliwell B. Free radicals and antioxidants:<br />
a personal view. Nutr Rev 1994 ; 52 : 253-65.<br />
14. Israel S. The problems of overtraining with<br />
reference to performance physiology and internal<br />
medicine. Med Sport 1976 ; 16:1-12.<br />
15. Lehmann M, Foster C, Dickhuth HH et<br />
al. Autonomic imbalance hypothesis and<br />
overtraining syndrome. Med Sci Sports Exerc<br />
1998 ; 30 (7) : 1140-5.<br />
16. Mackinnon L. Immunity in athletes. J<br />
Sports Med 1997 ; 18 (Suppl 1) : S 62-8.<br />
17. Newsholme EA, Leech T, Duester G.<br />
« L’esprit et le cerveau » et « Lorsque l’entraînement<br />
évolue mal » in : La course à<br />
pied. Bases scientifiques, entraînement<br />
et performances : 1998 ; 125-133 et 157-<br />
167.<br />
18. Petibois C, Cazorla G, Déléris G et al.<br />
L’examen sanguin pour la détection <strong>du</strong> surentraînement<br />
: état des connaissances. Rev<br />
Méd Int 2001 ; sous presse.<br />
19. Smith LL. Cytokine hypothesis of overtraining:<br />
a physiological adaptation to<br />
excessive stress ? Med Sci Sport Exerc 2000 ;<br />
32 : 317-31.<br />
20. Snyder AC. Overtraining and glycogen<br />
depletion hypothesis. Med Sci Sports Exerc<br />
1998 ; 30 : 1146-50.<br />
B U L L E T I N D ’ A B O N N E M E N T<br />
6 numéros par an<br />
Prix au numéro: 6,5 e*<br />
Abonnement: 36 e*<br />
Etudiant: 26,50 e* (joindre photocopie de la carte d’étudiant)<br />
* + 12,50 e par avion pour les DOM-TOM et la CEE<br />
+ 23,50 e par avion pour l’étranger autre que la CEE<br />
MDS <strong>61</strong><br />
❏ Pr ❏ Dr ❏ M. ❏ M me Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Spécialité<br />
❏ Rhumatologue ❏ Réé<strong>du</strong>cateur fonctionnel ❏ Médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong> ❏ Médecin généraliste<br />
❏ Autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .❏ Étudiant Année : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Adresse d’expédition : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Adresse et lieux d’exercice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Règlement<br />
Tél. : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ ; Fax : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _<br />
❏ Chèque à l’ordre d’Expressions Santé ❏ Carte bancaire N°<br />
Expire le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature obligatoire :<br />
Suggestions d’articles / commentaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏ Je désire recevoir une facture justificative (dé<strong>du</strong>ctible frais professionnels)<br />
Retourner ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre d’Expressions Santé<br />
2, rue de la Roquette - Passage <strong>du</strong> Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris - Tél. : 01 49 29 29 29 - Fax: 01 49 29 29 19.<br />
Un reçu vous sera envoyé.
Récupération après<br />
infection virale<br />
A propos de 2 cas de myocardite<br />
en athlétisme<br />
La fréquence et l’impact<br />
des infections virales<br />
chez les <strong>sport</strong>ifs sont<br />
souvent sous-estimés<br />
et des complications<br />
musculaires sont toujours<br />
à redouter. La survenue<br />
possible de myocardites<br />
doit inciter à la prudence<br />
lors de la reprise de<br />
l’entraînement intensif.<br />
Au cours de tout processus infectieux<br />
viral, il peut exister une atteinte<br />
musculaire dont l’expression<br />
est très variable. A côté des véritables<br />
myosites, les patients se plaignent fréquemment<br />
d’asthénie ou de myalgies.En<br />
fait,toute infection virale déclenche,chez<br />
le sujet atteint,des réactions musculaires.<br />
Certaines sont spécifiques et d’autres non<br />
spécifiques.<br />
Les atteintes spécifiques liées à l’agent<br />
causal sont souvent médiées par un processus<br />
immunitaire.<br />
Les réactions non spécifiques sont identiques,<br />
quel que soit l’agent infectieux<br />
impliqué.Ces atteintes musculaires peuvent<br />
apparaître précocement au cours<br />
de la maladie, cela dès la phase d’incubation,<br />
avant même qu’un processus<br />
catabolique musculaire ne s’installe.Au<br />
contraire, plusieurs virus sont susceptibles<br />
d’entraîner des atteintes subaiguës<br />
ou chroniques.<br />
INFECTIONS VIRALES ET<br />
CATABOLISME PROTÉIQUE<br />
Face à toute infection, les macrophages<br />
libèrent des cytokines qui, par leur<br />
action au niveau cérébral,font apparaître<br />
la fièvre. Une anorexie accompagne généralement<br />
ces mécanismes.Au cours<br />
d’un processus infectieux, l’apport alimentaire,ainsi<br />
insuffisant,ne comble pas<br />
les besoins issus <strong>du</strong> catabolisme protéique<br />
in<strong>du</strong>it par les cytokines.<br />
Les acides aminés libérés par le muscle<br />
squelettique, voire par le muscle cardiaque,<br />
sont réutilisés par le foie pour<br />
synthétiser des protéines de novo, afin<br />
de lutter contre l’infection.Le foie utilise<br />
également ces substrats pour la néoglycogenèse.<br />
Ces substrats protéiques servent de signal<br />
pour enclencher les défenses immunitaires<br />
au niveau de la moelle osseuse<br />
et des organes immuno-compétents. Le<br />
catabolisme musculaire est étroitement<br />
corrélé à l’importance et à la <strong>du</strong>rée de la<br />
fièvre dans la phase aiguë de l’infection.<br />
Ce sont les cytokines qui régulent les différentes<br />
réponses métaboliques (Fig.1).<br />
Sur le plan biochimique, il faut remarquer<br />
la diminution régulière d’activité<br />
de plusieurs enzymes de la glycolyse<br />
et des voies oxydatives. Le phénomène<br />
infectieux entraîne également des<br />
Anorexie<br />
Estomac<br />
Fièvre<br />
Cerveau<br />
Cœur<br />
Macrophages<br />
Muscles<br />
Drs Gérard Dine*,<br />
Jacques Pruvost**<br />
et Didier Polin***<br />
Mots clés<br />
Myocardite<br />
Athlétisme<br />
Infection virale<br />
modifications ultra-structurales musculaires,en<br />
particulier une dégénérescence<br />
myofibrillaire qui peut être visualisée par<br />
microscope électronique.<br />
CONSÉQUENCES<br />
PHYSIOPATHOLOGIQUES<br />
La dégradation des protéines musculaires<br />
lors de l’infection, ou au décours de<br />
l’infection,se manifeste cliniquement par<br />
une perte de la capacité à l’effort.Ainsi,<br />
après une infection fébrile d’une <strong>du</strong>rée<br />
d’une semaine, la force musculaire globale<br />
sur un effort de type isométrique est<br />
diminuée de 15 % environ. L’aptitude<br />
musculaire à l’effort est ré<strong>du</strong>ite de 25 %<br />
quand il s’agit d’un effort aérobie.Cette<br />
ré<strong>du</strong>ction plus importante s’explique à<br />
la fois par le catabolisme des protéines<br />
Glycogenèse<br />
Acides<br />
Aminés<br />
Foie<br />
Réactions<br />
à la phase<br />
aiguë<br />
Moelle<br />
osseuse<br />
Cellules immunocompétentes<br />
Mise au point<br />
* Institut de médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, Troyes.<br />
** Médecine et traumatologie <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, Marseille.<br />
*** Institut régional de médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, Rouen.<br />
Figure 1 : impact physio-pathologique de l’infection virale : rôle des cytokines.<br />
MÉDECINS DU SPORT 31 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Mise au point<br />
Mise au point<br />
<strong>du</strong> muscle cardiaque,mais aussi avec l’apparition<br />
d’anomalies circulatoires générées<br />
par l’alitement. L’estimation semiquantitative<br />
<strong>du</strong> catabolisme protéique<br />
musculaire peut être obtenue par mesure<br />
de la 3 méthyle-histidine dans les urines.<br />
Il faut, pour cela, placer le sujet en alimentation<br />
végétarienne, afin de ne pas<br />
avoir d’interférences vis-à-vis de la viande<br />
d’origine alimentaire.<br />
La convalescence métabolique postinfectieuse<br />
peut ainsi être appréciée.<br />
Elle est de 3 semaines pour une infection<br />
virale commune au cours de laquelle la<br />
<strong>du</strong>rée de l’épisode fébrile n’aurait été que<br />
de 24 ou 48 heures. Cette constatation<br />
est applicable lors d’une infection d’origine<br />
virale aussi banale que la grippe.<br />
Pour les infections virales les plus agressives<br />
ou les plus longues, la convalescence<br />
peut parfois s’allonger de façon<br />
spectaculaire.<br />
INFECTIONS VIRALES ET<br />
ACTIVITÉS ENZYMATIQUES<br />
MUSCULAIRES<br />
L’activité enzymatique musculaire peut<br />
être perturbée par l’alitement ren<strong>du</strong> nécessaire<br />
par la maladie virale. C’est surtout<br />
le processus infectieux lui-même qui<br />
perturbe l’activité enzymatique musculaire.On<br />
note,lors d’une infection banale,<br />
un impact négatif sur la citrate-synthétase,<br />
la lactico-déshydrogénase, la glycéraldéhyde<br />
3 phosphate déshydrogénase<br />
et la cytochrome oxydase. Les prostaglandines<br />
peuvent être également impliquées<br />
dans le processus de perte protidique<br />
musculaire.<br />
Au cours de l’épisode infectieux, il<br />
n’est pas prudent de conserver un<br />
entraînement musculaire intense,<br />
étant enten<strong>du</strong> que les impacts musculaires<br />
de l’exercice sont en tout point<br />
comparables aux phénomènes pervers<br />
in<strong>du</strong>its par l’infection elle-même (Fig.2).<br />
Le repos est donc largement souhaitable.<br />
La remise en route de l’exercice<br />
physique doit être progressive.Il faut<br />
commencer par le reconditionnement<br />
cardiovasculaire.Lors de la période aiguë<br />
de l’infection, on peut proposer au sujet<br />
d’alterner le décubitus et la position<br />
debout régulièrement toutes les demiheures.<br />
Une telle gymnastique préventive<br />
permet ensuite d’améliorer la réhabilitation<br />
musculaire post-infectieuse.<br />
Lorsque la fièvre et les autres symptômes<br />
ont disparu, en particulier les myalgies,<br />
la remise en route doit être progressive,<br />
Phosphocréatine<br />
(mol)<br />
0,02<br />
0,032<br />
0,003<br />
Normal<br />
0 5 10 15<br />
Temps (mn)<br />
Phosphocréatine<br />
(mol)<br />
0,02<br />
Post-infection<br />
0,032<br />
0,003<br />
0 5 10 15<br />
Temps (mn)<br />
Figure 2 : vitesse de récupération de la<br />
phosphocréatine analysée par spectroscopie<br />
P31.<br />
sauf s’il y a suspicion de myocardite.Un<br />
effort physique intempestif réalisé lors<br />
d’une période infectieuse ou post-infectieuse<br />
virale peut régulièrement se compliquer<br />
d’une décompensation myocardique,<br />
qui doit amener à la prudence<br />
quant à la reprise de l’exercice physique<br />
intense.<br />
ASTHÉNIE POST-VIRALE<br />
Plusieurs virus peuvent avoir des effets<br />
pervers à distance <strong>du</strong> processus infectieux<br />
lui-même. Les sujets décrivent généralement<br />
une grande difficulté à récupérer<br />
des efforts qu’ils accomplissent<br />
à nouveau.Ils se plaignent d’une fatigue<br />
plus ou moins chronique avec participation<br />
mentale. Ils décrivent des myalgies<br />
qui ne sont plus documentées biologiquement<br />
par l’élévation des CPK.Les<br />
explorations habituelles de type électroencéphalogramme,<br />
électro-nystagmogramme,<br />
électromyogramme sont négatives.<br />
Le bilan immunologique révèle<br />
régulièrement des anomalies des souspopulations<br />
lymphocytaires T,notamment<br />
les cellules NK. L’élévation des immuns<br />
complexes circulants est également notée.<br />
L’étude in vivo par résonance magnétique<br />
nucléaire au phosphore 31 met<br />
en évidence une acidose musculaire d’effort<br />
prématurée et intense. La chute <strong>du</strong><br />
pic de phosphocréatine est un élément<br />
significatif de documentation positive.<br />
La récupération <strong>du</strong> pH musculaire après<br />
effort est ralentie.Il existe en fait une acidose<br />
intracellulaire anormale.Beaucoup<br />
de virus peuvent entraîner des phénomènes<br />
post-viraux de ce type :EBV,CMV,<br />
adénovirus, virus coxsackie. L’intérêt<br />
d’une étude in vivo est d’objectiver le<br />
dysfonctionnement une fois les étiologies<br />
classiques d’asthénie éliminées.L’acidose<br />
cellulaire anormale notée tra<strong>du</strong>it<br />
l’insuffisance des processus oxydatifs<br />
musculaires, l’incapacité de la cellule<br />
musculaire à stabiliser le pH et la difficulté<br />
à éliminer l’acide lactique.L’hyperammoniémie<br />
cellulaire est régulièrement<br />
rencontrée.Il faut rappeler que de telles<br />
constatations sont aussi notées lors de<br />
tout effort musculaire intense. La<br />
conjonction des désordres physiologiques<br />
in<strong>du</strong>its par l’effort ne peut pas<br />
faire bon ménage avec les perturbations<br />
cellulaires post-virales. La compréhension<br />
des mécanismes impliqués est bien<br />
loin d’être acquise.<br />
Certains auteurs incriminent des perturbations<br />
auto-immunes avec pro<strong>du</strong>ction<br />
d’anticorps contre certaines protéines<br />
enzymatiques ou protéines<br />
tran<strong>sport</strong>euses <strong>du</strong> muscle.Ces désordres<br />
immunitaires ont été retrouvés au cours<br />
de myocardites post-virales. Les recherches<br />
menées actuellement dans<br />
le syndrome de fatigue chronique se<br />
tournent vers la dérégulation de la réaction<br />
immune après l’in<strong>du</strong>ction virale<br />
et mettent en cause le rôle des interférons,<br />
des protéines anti-virales et de<br />
certaines enzymes comme la RNase.<br />
Une des cibles de ces désordres régulationnels<br />
post-viraux pourrait être l’actine<br />
elle-même.<br />
QUELS RISQUES EN<br />
PRATIQUE SPORTIVE ?<br />
La survenue de myocardites au cours d’infections<br />
virales est une complication toujours<br />
redoutée des cardiologues et des<br />
pédiatres.<br />
Pour les médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, le diagnostic<br />
d’atteinte myocardique post-virale est<br />
habituellement soulevé dans le cadre des<br />
morts subites chez les jeunes <strong>sport</strong>ifs.En<br />
effet, les myocardites peuvent être responsables<br />
de mort subite au stade aigu.<br />
Sur le plan anatomo-pathologique,la nécrose<br />
cellulaire est alors associée à un infiltrat<br />
dense et inflammatoire principalement<br />
lymphocytaire.<br />
A un stade chronique, la maladie se manifeste<br />
par une fibrose cicatricielle avec<br />
quelques foyers inflammatoires (11).<br />
MÉDECINS DU SPORT 32 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Cas clinique N° 1<br />
Un malaise inexpliqué<br />
Une championne d’athlétisme à très haut niveau présente un malaise<br />
inexpliqué à l’occasion d’une séance de musculation en juin 1998.<br />
Cette <strong>sport</strong>ive est ensuite handicapée pendant plusieurs semaines par<br />
une dyspnée d’effort attribuée à une bronchite “traînante”.<br />
En septembre 1998, elle consulte le médecin en charge <strong>du</strong> suivi des<br />
équipes de France et décrit, à l’interrogatoire, des antécédents récents<br />
d’adénopathies cervicales multiples pouvant évoquer, a posteriori, une<br />
mononucléose infectieuse.<br />
Perturbations auto-immunes<br />
L’ECG de repos est normal. L’échocardiographie et la scintigraphie<br />
myocardique sont en faveur d’une myocardite évoluée. L’épreuve<br />
d’effort est ininterprétable <strong>du</strong> fait de l’importance de l’asthénie<br />
musculaire. La sérologie EBV est en faveur d’une réactivation virale<br />
à distance d’une infection inaugurale survenue un an plus tôt (4).<br />
Le profil immunitaire portant sur l’étude des lymphocytes NK en<br />
cytométrie de flux montre des perturbations de type auto-immun.<br />
Mise au point<br />
Mise au point<br />
Suspension<br />
Un traitement par glucocorticoïdes sous surveillance stricte hospitalière<br />
avec monitoring cardiaque est mis en place. Après amélioration de la<br />
symptomatologie et à la suite de cette hospitalisation, un certificat<br />
médical d’incompatibilité avec la pratique <strong>sport</strong>ive est prescrit pour<br />
plusieurs semaines.<br />
Myocardite et mort subite<br />
Une étude suédoise portant sur 16 cas<br />
de décès chez des coureurs d’orientation<br />
entre 1979 et 1992 a fait la preuve anatomo-pathologique<br />
que 5 cas (30 %)<br />
étaient en rapport avec une myocardite<br />
virale (12). Pour les auteurs nord-américains,<br />
la myocardite est la 3 e cause de<br />
mort subite aux USA :8 cas sur 158 dossiers,<br />
soit 6 % (16).<br />
Une étude italienne concernant 200 cas<br />
de morts subites, survenues entre 1978<br />
et 1993 chez des <strong>sport</strong>ifs de moins de<br />
35 ans, montre la responsabilité d’une<br />
myocardite dans 7,5 % des cas étudiés (3).<br />
Chlamydiae pneumoniae, cytomégalovirus,<br />
virus coxsackie et virus d’Epstein-<br />
Barr sont le plus souvent mis en cause.<br />
Les deux cas cliniques décrits ici montrent<br />
que,chez un <strong>sport</strong>if de haut-niveau,<br />
la possibilité d’une atteinte myocardique<br />
doit être aussi envisagée devant des douleurs<br />
thoraciques et/ou une dyspnée inhabituelle<br />
et récente (cas clinique n° 1).<br />
La symptomatologie peut être plus frustre<br />
avec une simple baisse des performances<br />
à l’effort (cas clinique n° 2).<br />
Ces 2 cas de myocardite permettent de<br />
mieux préciser l’approche cardiologique<br />
et médico-légale chez les <strong>sport</strong>ifs.Si l’ECG<br />
de repos oriente rarement le diagnostic,<br />
l’échocardiographie peut être faussement<br />
Cas clinique N° 2<br />
Fatigue musculaire<br />
Un champion de France présente, pendant la saison estivale 2000, une baisse<br />
de performances inexpliquée, alors que son entraînement est inchangé tant en<br />
qualité qu’en quantité.<br />
Le <strong>sport</strong>if décrit une fatigabilité musculaire anormale avec difficultés de<br />
récupération à l’entraînement et en compétition. L’ensemble des symptômes est<br />
mis sur le compte d’un choc psychologique en rapport avec un deuil familial brutal.<br />
Une épreuve d’effort douteuse<br />
En novembre 2000, six mois après le début de l’asthénie, une épreuve d’effort<br />
sur bicyclette ergométrique révèle la survenue d’un bloc de branche gauche<br />
complet pour un niveau de fréquence cardiaque à 120/mn. Ce bloc de branche<br />
n’avait jamais été décrit sur les épreuves d’effort antérieures.<br />
L’échocardiographie est normale, mais une scintigraphie myocardique montre<br />
une hétérogénéité de fixation antérolatérale au niveau <strong>du</strong> ventricule gauche.<br />
Le diagnostic de myocardite cicatrisée avec fibrose de remplacement est alors<br />
posé.<br />
Les analyses biologiques et les diverses sérologies virales ne permettent pas<br />
d’identifier le virus in<strong>du</strong>cteur de la myocardite. L’étude des sous-populations<br />
lymphocytaires et des lymphocytes NK en cytométrie de flux est normale en<br />
février 2001. Le profil immunitaire de ce patient n’est donc pas perturbé et ne<br />
révèle pas de prédisposition expliquant une agression virale sur le myocarde.<br />
La fin <strong>du</strong> haut-niveau<br />
Les tests d’effort sur bicyclette ergométrique pratiqués tous les six mois à<br />
partir de janvier 2001 montreront la persistance <strong>du</strong> bloc de branche complet.<br />
Ce <strong>sport</strong>if n’a pu reprendre l’entraînement intensif et a fortiori le <strong>sport</strong> de<br />
haut-niveau.<br />
MÉDECINS DU SPORT 33 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003
Mise au point<br />
rassurante à distance de l’infection<br />
inaugurale (cas clinique n° 2).L’épreuve<br />
d’effort à visée cardiologique est toujours<br />
contributive au diagnostic.Les médecins<br />
<strong>du</strong> <strong>sport</strong> doivent savoir poser son indication<br />
en cas de baisse <strong>du</strong>rable et inexpliquée<br />
des performances.<br />
IMPLICATIONS PRATIQUES<br />
Les infections virales sont fréquentes chez<br />
les <strong>sport</strong>ifs intensifs et leurs complications<br />
musculaires toujours à redouter.<br />
Mais la fréquence et l’impact de ces infections<br />
sont souvent sous-estimés.<br />
La survenue d’un tableau clinique<br />
avec symptômes localisés au-dessus<br />
et/ou au-dessous <strong>du</strong> cou associant<br />
myalgies, toux ou troubles digestifs<br />
et fièvre, doit faire évoquer une infection<br />
virale. L’encadrement médical<br />
des <strong>sport</strong>ifs intensifs devrait insister sur<br />
les conseils de prudence et de surveillance<br />
à la reprise après tout syndrome<br />
fébrile. Du fait de lésions<br />
musculaires toujours possibles, l’entraînement<br />
intensif ou la compétition<br />
seront absolument proscrits pendant<br />
3 semaines minimum (5).La reprise de<br />
l’entraînement doit être progressive<br />
avec un reconditionnement cardiovasculaire.<br />
CONCLUSION<br />
Rappelons que l’article L.3621-2 <strong>du</strong> code<br />
de la Santé publique impose aux fédérations<br />
d’organiser un suivi médical<br />
annuel systématisé pour leurs <strong>sport</strong>ifs<br />
inscrits sur les listes de haut-niveau.Pour<br />
ces <strong>sport</strong>ifs, une épreuve d’effort maximale<br />
doit être réalisée chaque année à la<br />
recherche d’éventuelles anomalies ou inadaptations<br />
survenant à l’effort. Du fait<br />
de difficultés pratiques pour la mise en<br />
œuvre de cette récente disposition préventive,<br />
son intérêt est encore trop souvent<br />
discuté, voire critiqué, par l’encadrement<br />
technique et médical des<br />
<strong>sport</strong>ifs.La survenue de deux cas de myocardite<br />
dans la population restreinte des<br />
<strong>sport</strong>ifs “Elite”en athlétisme et le retard<br />
au diagnostic (5 à 6 mois en moyenne<br />
Pour en savoir plus<br />
après la symptomatologie clinique inaugurale)<br />
prouvent que les pathologies virales<br />
intercurrentes peuvent être responsables<br />
de la survenue inopinée de<br />
pathologies cardiovasculaires graves.<br />
C’est un argument de plus pour continuer<br />
à imposer annuellement cette<br />
épreuve d’effort maximale avec enregistrement<br />
électrocardiographique à tous<br />
les <strong>sport</strong>ifs inscrits sur la liste ministérielle<br />
de haut-niveau, bientôt à tous les<br />
<strong>sport</strong>ifs inscrits en filière d’accès au hautniveau<br />
(espoirs et partenaires d’entraînement).<br />
■<br />
1. Arnold DL, Bore PJ, Radda GK et al. Excessive intracellular acidosis of skeletal<br />
muscle on exercise in a patient with a post-viral exhaustion/fatigue syndrome. A<br />
31 P Nuclear mag<strong>net</strong>ic resonance study. Lancet 1984 ; 1 : 1367-9.<br />
2. Aström E, Friman G, Pilstrom L. Effects of viral and myco-plasma infections<br />
on ultra-structure and enzyme activities in human skeletal muscle. Acta Path<br />
Microbiol Scand Sect 1976 ; A84 : 113-22.<br />
3. Basso C, Corrado D, Thiene G. Cardiovascular causes of sudden death in young<br />
indivi<strong>du</strong>al including athletes. Cardiol Rev 1999 ; 7 (3) : 127-35.<br />
4. Buisson M, Fleurent B, Mak M. Novel immunoblot assay using four recombinant<br />
antigens for diagnosis of Epstein Barr virus primary infection and reactivation.<br />
Journal of clinical microbiology 1999 ; 2709-14.<br />
5. Carre F, Guinot M, Bermon S. Hématologie et <strong>sport</strong>. Médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong> 2001 ;<br />
41 : 11-20.<br />
6. Cozzone PJ, Bendahan D. 31 P NMR spectroscopy of metabolic changes associated<br />
with muscles exercise : physiopathological applications. In : Gillies RJ,<br />
ed. NMR in physiology and biomedicine. Academic Press Inc 1994 ; p 389-403.<br />
7. Chemin P. Muscle, fatigue, <strong>sport</strong> et infection. Revue de Médecine Interne<br />
1999 ; 20 : 794-803.<br />
8. Dine G. Altérations musculaires observées lors de l’effort physique intense chez<br />
l’homme. in “Référence” Paris Elsevier, 1998 ; p 5-8.<br />
9. Dine G, Pruvost J. Récupération après infection virale. Deuxième Euro-congrès<br />
Médical d’Athlétisme. Paris, 2 septembre 2002.<br />
10. Dumoulin P. La mort subite au cours <strong>du</strong> <strong>sport</strong>. Médecins <strong>du</strong> <strong>sport</strong> 1997 ; 12 : 11-<br />
22.<br />
11. Fornes P, Lecomte D. Mort subite et activité physique et <strong>sport</strong>ive. Revue <strong>du</strong><br />
Praticien. 2001 ; 51 : 31-5.<br />
12. Friman G, Larsson E, Rolf C. Interaction between infection and exercise with<br />
special reference to myocarditis and the increased frequency of sudden deaths<br />
among young Swedish orienteers. Scand J Infect Dis 1997 ; suppl 104 : 41-9.<br />
13. Friman G, Ilback NG. Acute infection : metabolic responses, effects on performance,<br />
interaction with exercice, and myocarditis. Int J Sports Med 1998 ; 19<br />
(suppl 3) : 178-82.<br />
14. Jamal GA, Miller RG. Neurophysiology of postviral fatigue syndrome. Br Med<br />
Bull 1991 ; 47 : 815-25.<br />
15. Laure P, Dine G. Exploration et suivi biologique <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if. Paris : Masson, 2001.<br />
16. Maron BJ et al. Sudden death in young competitive athletes. JAMA 1996 ;<br />
276 : 199-204.<br />
17. Philip P, Bermon S. Intensive triathlon training in<strong>du</strong>ces low peripheral CD 34<br />
+ stem cells. Br J of Haematol 120 : 914-5.<br />
18. Sahling K, Edstrom L, Sjohom H. Fatigue and phosphocreatine depletion <strong>du</strong>ring<br />
carbon dioside-in<strong>du</strong>ces acidosis in rat muscle. Am J Physiol 1983 ; 245 :<br />
C15-C20.<br />
MÉDECINS DU SPORT 34 N°<strong>61</strong>-SEPTEMBRE/OCTOBRE 2003