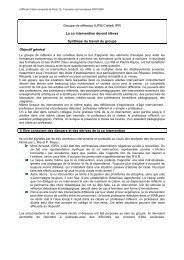droites parallèles
droites parallèles
droites parallèles
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Parallélisme<br />
Au CE2, les deux premières significations du parallélisme présentées – « <strong>droites</strong><br />
penchées pareil par rapport à une direction donnée » (situation « Les feuilles qui<br />
coulissent ») et « côtés opposés d'une forme familière » (situation « Trapèze à<br />
terminer ») – peuvent être abordées indépendamment de l'approche de la<br />
perpendicularité.<br />
La signification du parallélisme « <strong>droites</strong> d'écart constant » (situation « Sur la trace des<br />
roues ») abordée au CM1 suppose un travail préalable sur l'angle droit. La reconstitution<br />
d'un réseau de <strong>droites</strong> parallèles à une droite, traitée dans la situation « Parapuzzle »,<br />
permet une synthèse sur les différentes significations du parallélisme et sur les<br />
techniques de tracés rencontrées.<br />
Les procédures visées évoluent donc du tracé de parallèle par glissement de la règle ou<br />
report de traits intermédiaires vers la mesure d'un écart selon une direction<br />
perpendiculaire à une droite. Le recours à la double perpendicularité pourra être<br />
appréhendé au CM2 notamment dans le module sur les situations de synthèse.<br />
1. les feuilles qui coulissent (CE2)<br />
• Description rapide<br />
La première conception du parallélisme que nous voulons développer est celle de<br />
« <strong>droites</strong> penchées pareil par rapport à une direction donnée ». Nous nous intéressons<br />
donc à des familles de <strong>droites</strong> obtenues à partir de l'une d'entre elles par des translations<br />
(« glissement sans tourner »).<br />
Dans la situation « Les feuilles qui coulissent », nous proposons à l'élève de construire<br />
une droite parallèle à une droite donnée sans disposer du vocabulaire correspondant, la<br />
relation étant prise en charge par le contexte retenu. Le problème posé est un problème<br />
spatial. L'élève va le résoudre de manière perceptive, en mobilisant dans ce contexte ses<br />
connaissances en actes sur les <strong>droites</strong> parallèles pour anticiper le résultat d'un<br />
mouvement de translation.<br />
II s'agit d'une situation d'approche du concept de parallélisme. La connaissance du<br />
vocabulaire du registre géométrique (<strong>droites</strong> parallèles, angle...) n'est pas un pré-requis.<br />
• Objectifs<br />
– Établir la relation entre une action (le glissement sans tourner d'un trait droit) et le tracé<br />
d'un trait parallèle au trait donné.<br />
– Fabriquer un réseau de <strong>droites</strong> parallèles (« penchées pareil »).<br />
• Durée<br />
Deux séances d'environ 45 minutes.<br />
• Problème<br />
Construire la parallèle à une droite donnée passant par un point<br />
donné situé « loin » de la droite.<br />
• Procédures<br />
n° 1 : tracé du trait sans mettre en jeu le parallélisme.<br />
n° 2 : tracé de la parallèle au jugé, avec utilisation perceptive du parallélisme.<br />
n° 3 : tracé de la parallèle par glissement de la règle.<br />
n° 4 : tracé de la parallèle avec tracé d'une ou plusieurs parallèles intermédiaires.<br />
n° 5 : tracé de la parallèle en cherchant à utiliser un écart constant entre les deux <strong>droites</strong>,<br />
cet écart pouvant être pris selon une direction quelconque, parallèle au bord inférieur droit<br />
ou perpendiculaire au trait initial.<br />
n° 6 : construction d'un gabarit par pliage ou transparence pour reporter au niveau du<br />
point l'angle entre ce trait tracé sur la feuille et le bord inférieur droit.<br />
n° 7 : tracé instrumenté d'une perpendiculaire à la droite initiale et de la perpendiculaire à<br />
celle-ci passant par le point donné.
• Variables didactiques<br />
La distance du point donné à la droite donnée constitue la principale variable didactique<br />
de cette situation. Deux valeurs (2,5 cm et 12 cm) seront successivement données à cette<br />
distance. La seconde est choisie de manière à mettre en évidence les limites des<br />
procédures perceptives ou s'appuyant sur le glissement de la règle. Dans la deuxième<br />
phase, nous proposerons de tracer plusieurs parallèles à la droite donnée ; cela favorisera<br />
aussi les procédures 4 et 5.<br />
• Matériel<br />
– La boîte à outils complète.<br />
– Des guides (environ un pour six élèves, voir dessins page suivante) constitués d'une<br />
feuille cartonnée à bords non réguliers (découpée dans un format A3) et d'un calque<br />
scotché à la feuille cartonnée, de forme voisine. Le calque se replie sur la feuille<br />
cartonnée pour constituer une sorte de « feuille double » dans laquelle vont coulisser<br />
les feuilles de travail. Sur le calque, on a tracé un trait penché assez épais; il indique la<br />
direction du réseau de <strong>droites</strong> parallèles à construire. Il faut éviter les angles de 30°,<br />
45° ou 60° car l'équerre pourrait alors fournir des gabarits, ce qui risquerait d'entraîner<br />
des confusions avec l'usage de l'équerre pour la perpendicularité ! Pour tracer le<br />
calque, on utilisera la fiche 1 de façon à ce que tous les traits en jeu soient bien<br />
« penchés pareil ».<br />
– Trois feuilles de travail pour chaque élève comportant un bord droit, un trait de même<br />
direction que celui du calque par rapport au bord droit avec un point situé à environ<br />
2,5 cm de la droite (fiche 1), avec un point plus loin à environ 12 cm de la droite (fiche 2)<br />
ou avec une dizaine de points non alignés et non équidistants (fiche 3).<br />
– Un quart de la feuille présentant un réseau de <strong>droites</strong> parallèles (fiche 4) à coller dans<br />
le cahier pour chaque élève et une moitié de cette fiche 4 sur un transparent pour<br />
chaque boîte à outils.<br />
– Un guide et deux feuilles de travail de format plus important pour afficher au tableau au<br />
moment de la présentation de la situation.<br />
Exemple de dispositif<br />
feuille cartonnée (dos du guide)<br />
calque (face du guide)<br />
guide<br />
feuille de travail
DÉROULEMENT<br />
Première phase<br />
Tracer une droite parallèle à une droite donnée<br />
Etape 1 : le point est situé à environ 2,5 cm du trait<br />
Le maître montre un guide et une feuille de travail (fiche 1)<br />
agrandis qui sont décrits collectivement. Il explique ensuite le<br />
fonctionnement du dispositif : « Cette feuille coulisse dans ce<br />
guide, le bord droit de la feuille bien plaqué contre le bord droit du<br />
guide. » II le fait fonctionner et on constate qu'à un moment<br />
donné, le trait de la feuille est exactement sous le trait du guide :<br />
« Quand ça coulisse, à un moment on ne voit plus qu'un trait !<br />
On continue le mouvement et on constate que c'est ensuite le<br />
Fiche 1<br />
point qui passe sous le trait du guide.<br />
« Vous allez recevoir une feuille comme cette feuille de travail. Vous allez y tracer un trait<br />
qui passe par le point et qui sera caché par le trait du guide quand vous ferez coulisser la<br />
feuille dans le guide. Attention, vous n'aurez pas le guide pour tracer. »<br />
Pour faciliter la compréhension de la consigne et notamment de l'expression « caché<br />
par », il est important que le guide soit plus grand que les feuilles de travail et que le trait<br />
du guide soit assez long.<br />
Les enfants disposent d'une feuille chacun (fiche 1) et tracent individuellement. A cette<br />
étape, en début de cycle 3, il faut s'attendre à beaucoup de procédures sans recours au<br />
parallélisme et donc à beaucoup d'erreurs ; ce sont les procédures par glissement de la<br />
règle ou par tracé de traits parallèles intermédiaires qui sont visées ici.<br />
Etape 2 : mise en commun<br />
Quatre ou cinq productions, correspondant à des réponses variées, sont choisies par le<br />
maître et affichées, le bord droit étant orienté de manière aléatoire par rapport aux bords<br />
du tableau ; on veillera cependant à en dis-poser une ou deux avec le bord droit de la<br />
feuille de travail à l'horizontale.<br />
Exemples de premiers constats obtenus dans une classe de CE2 :<br />
– « Sur le numéro 4, le trait n'est pas penché comme l'autre, il est plus droit » ;<br />
– « Là, ça ne va pas car le trait est trop couché » ;<br />
– « Sur le 2, c'est bon parce que les traits se touchent pas » ;<br />
– « Là, on ne peut pas dire, il faut vérifier avec le guide » ;<br />
– « sur le 3, ça ne va pas, en bas l'écart, il est un peu plus grand qu'en haut » ;<br />
– « Le premier, il est bien, les traits sont bien comme ça », l'élève joignant le geste à la<br />
parole...<br />
Le maître intervient pour demander avant la vérification comment les élèves ont procédé.<br />
Les différents élèves présentent leur façon de faire :<br />
– « J'ai pris la règle, je l'ai posée et j'ai tracé et après je me suis rendue compte que<br />
j'allais trop bas » ;<br />
– « Si on met droit, ça va pas aller, il faut pencher mais pas trop énormément parce que<br />
sinon ça va toucher le rouge, il faut faire comme le rouge, penché », et il montre avec<br />
la main ;<br />
– « J'ai mis la règle contre le trait et j'ai déplacé en coulissant, en glissant ».<br />
Étape 3 : vérification<br />
On vérifie les productions avec le guide. La précision rigoureuse du tracé n'est pas un<br />
objectif. On peut se mettre d'accord sur une tolérance acceptable pour valider.<br />
Le mouvement de la feuille visualisé à travers le guide et le rapprochement progressif du<br />
trait de la feuille vers le trait du guide doivent permettre d'invalider ou de pronostiquer une<br />
validation avant que le trait de la feuille n'atteigne celui du guide. Les échanges dans des<br />
groupes de quatre ou six-autour d'un guide, les pronostics avant vérification complète<br />
devraient faciliter la perception de cette direction « penchée pareil » par rapport au bord
droit du guide ou de la feuille.<br />
Un temps de bilan permet de rapprocher réponses correctes et procédures pertinentes.<br />
Étape 4 : le point est situé à environ 12 cm du trait<br />
On propose une fiche 2 à chacun.<br />
On peut aussi choisir de proposer à nouveau une fiche 1 à certains<br />
de façon à permettre à ceux qui ont tracé leur premier trait sans<br />
aucune référence implicite au parallélisme de s'approprier une des<br />
méthodes exposées.<br />
Pour la fiche 2, la tâche est la même, mais l'éloignement du point<br />
va rendre plus délicat le tracé d'un trait acceptable et invalider les<br />
procédures basées sur un tracé s'appuyant seulement sur la<br />
perception. Pour la validation, on procède comme dans l'étape 3.<br />
Fiche 2<br />
Étape 5 : bilan<br />
Le bilan vise à rejeter le simple jugé et à mettre en évidence le glissement de la règle sans<br />
tourner, même si cette procédure pertinente est difficile à contrôler. Le tracé de <strong>droites</strong><br />
intermédiaires ou l'utilisation de gabarits (peu probable dans cette première situation...)<br />
peuvent la rendre plus fiable.<br />
Le recours à l'écart constant peut apparaître soit pour tracer, soit pour juger dans l'étape<br />
2, la règle (ou la ficelle) étant positionnée approximativement selon une direction fixe. La<br />
mesure de cet écart perpendiculairement au trait n'est pas un objectif de cette situation.<br />
L'introduction du terme « parallèle » n'est pas un objectif ; « penchées pareil » permet<br />
souvent de verbaliser ce que l'on voit ou ce que l'on cherche. S'il est formulé par les<br />
élèves, on peut chercher des exemples de <strong>droites</strong> perçues comme parallèles dans<br />
l'environnement familier des enfants.<br />
Deuxième phase<br />
Fabriquer un réseau de <strong>droites</strong> « penchées pareil »<br />
Le maître distribue une nouvelle feuille de travail à chaque élève<br />
sur laquelle il a tracé une droite et marqué une dizaine de<br />
points, non alignés et non équidistants (fiche 3).<br />
Il précise la tâche avec les élèves : « Dans les exercices précédents,<br />
vous aviez un trait et un point sur votre feuille de travail. Cette<br />
fois, vous avez toujours un trait mais plusieurs points. Qui peut<br />
Fiche 3<br />
expliquer ce que vous allez devoir faire »<br />
Étape 1 : réalisation individuelle<br />
On attend un réinvestissement des procédures explicitées dans la phase précédente.<br />
Étape 2 : premier tri, validation<br />
Affichage des productions et premier tri basé sur la perception (la production ne convient<br />
pas/la production semble convenir mais il faut vérifier). Rapide échange d'arguments puis<br />
validation effective par le glissement dans le dispositif.<br />
Etape 3 : trace écrite<br />
Le maître affiche les productions validées par le dispositif<br />
puis donne à chaque enfant une partie de l'exemplaire du<br />
réseau fourni en fiche 4 (un quart de feuille par élève). II<br />
peut le présenter comme réalisé avec un dispositif<br />
analogue mais plus précis.<br />
Ce document est collé dans le cahier et on note « feuille de<br />
traits penchés pareils » ou « feuilles de traits parallèles »<br />
selon ce qui a été dit dans la mise en commun.<br />
Un exemplaire du même document mais photocopié sur<br />
transparent est placé dans chaque boîte à outils (la moitié<br />
du transparent A4 par boîte).<br />
Fiche 4
2. Trapèze à terminer (CE2)<br />
• Description rapide<br />
Cette situation aborde une deuxième signification du parallélisme en mobilisant les<br />
connaissances implicites des élèves sur cette relation entre deux côtés opposés d'un<br />
trapèze.<br />
Nous avons choisi d'utiliser un trapèze plutôt qu'un rectangle alors que ce dernier objet est<br />
plus familier pour les élèves. Nous pensons éviter ainsi des confusions entre les relations<br />
de perpendicularité et de parallélisme en ce début d'apprentissage et garder le rectangle<br />
comme référence de l'angle droit (cf. situations « Rectangle à terminer »).<br />
Le trapèze proposé est isocèle (avec une nette différence de longueur entre les deux<br />
côtés parallèles). Nous faisons l'hypothèse que cet objet est suffisamment familier aux<br />
élèves pour leur permettre de résoudre le problème posé au moins de manière perceptive.<br />
La connaissance du vocabulaire du registre géométrique (parallèle, trapèze, côté...) et<br />
celle des instruments de tracés (réseau de <strong>droites</strong> parallèles, équerre...) ne sont pas des<br />
pré-requis !<br />
• Objectifs<br />
– Identifier le parallélisme de deux des côtés d'une forme familière.<br />
– Percevoir l'insuffisance des procédures au jugé ou utilisant un glissement.<br />
– Introduire le mot « parallèle ».<br />
• Durée<br />
Une séance d'une heure environ.<br />
• Problème<br />
Terminer un trapèze dessiné sur une feuille à bords arrondis comme indiqué ci-dessous.<br />
trapèze de référence trapèze à terminer partie 1, gardée partie 2, feuille<br />
par le maître de travail de l'élève<br />
La feuille sur laquelle est dessiné le trapèze à terminer est découpée en deux parties :<br />
– la partie gardée par le maître comporte un vide correspondant à la feuille de travail de<br />
l'élève ;<br />
– la feuille de travail de l'élève sur laquelle il doit construire le morceau man-quant du<br />
côté à tracer en ne disposant que d'un point du côté à tracer et d'une partie du côté<br />
opposé.<br />
• Variables didactiques<br />
La principale variable didactique utilisée dans cette situation porte sur la position relative<br />
des deux traits (le trait fourni et le trait à tracer). Trois cas seront envisagés, comme<br />
indiqué ci-dessous : les deux traits sont « bien en face », les deux traits sont « légèrement<br />
décalés », les deux traits sont « complètement décalés ».<br />
Nous utilisons aussi une seconde variable didactique : les longueurs du trait fourni et du<br />
trait à tracer. La longueur du trait fourni diminuera au fur et à mesure des étapes alors que<br />
celle du trait à tracer augmentera de façon à accentuer les erreurs dues aux tracés au<br />
jugé sans contrôle du parallélisme.<br />
• Procédures<br />
Pour le dessin du côté à terminer :<br />
– en référence à la forme globale par le tracé d'un trait au jugé ;
– en référence au parallélisme par le tracé d'un trait par glissement contrôlé de la règle ou<br />
par le recours à des traits intermédiaires (en utilisant par exemple les deux bords<br />
parallèles d'une règle) ;<br />
– en mesurant la distance point-trait (distance entre le point et le côté opposé du trapèze)<br />
et en la reportant pour obtenir un autre point, avec contrôle au jugé de la direction pour<br />
le report ou selon une perpendiculaire avec contrôle instrumenté de la direction pour le<br />
report ;<br />
– par tracé instrumenté du parallélisme (avec le réseau de <strong>droites</strong> parallèles fourni après<br />
la situation « Les feuilles qui coulissent », des gabarits ou la règle et l'équerre).<br />
• Matériel<br />
– Un trapèze de référence (fiche 1) et un exemplaire des fiches 2, 3 et 4 à reproduire sur<br />
des feuilles A3 et à découper suivant des bords non rectilignes pour la classe.<br />
fiche 1 fiche 2 fiche 3 fiche 4<br />
– La boîte à outils pour la géométrie.<br />
– Un crayon à papier et un feutre de couleur assez épais de façon à atténuer les<br />
problèmes de précision lors de la validation.<br />
– Trois trapèzes à terminer, pour chaque équipe de deux<br />
(fiches 2, 3 et 4), reproduits sans agrandissement sur une<br />
feuille A3 dont les bords seront découpés suivant des<br />
lignes courbes ; ces feuilles seront séparées en deux<br />
parties (une partie pour le maître et l'autre pour l'équipe<br />
d'élèves) comme indiqué précédemment.<br />
– Deux exemplaires de la fiche 5 (un par élève).<br />
Sur les fiches 2, 3 et 4, les traits de découpage n'ont pas été<br />
marqués car il est plus facile d'effectuer un découpage<br />
« flou » que de suivre une courbe ! Les points<br />
Fiche 5<br />
incontournables sont indiqués ; le maître devra vérifier que le point fourni est suffisamment<br />
visible.<br />
DÉROULEMENT<br />
Première phase Les deux traits sont bien en face<br />
La situation est décrite avec le mot « trapèze ». La connaissance du terme n'est pas un<br />
préalable à cette situation ; le maître peut aussi employer le mot « forme » par exemple.<br />
Étape 1 : mise en place et communication du problème<br />
Les élèves travaillent par deux. Chaque équipe est désignée par une lettre : A, B, C... Les<br />
trapèzes à terminer (fiche 2), préparés au préalable, sont désignés du nom des équipes A,<br />
B, C... dans l'espace prévu à cet effet sur la fiche.<br />
Le maître montre le trapèze de référence (fiche 1) puis le fixe au tableau dans une position<br />
quelconque, ses bases n'étant pas parallèles aux bords du tableau.<br />
Puis il montre le trapèze de la fiche 2 en disant : « On a commencé à reproduire le trapèze<br />
affiché sur cette feuille. Un côté est déjà dessiné. II reste ce côté à terminer. »<br />
Le maître découpe au vu de tous le trapèze suivant une ligne courbe passant par les<br />
points indiqués puis fixe les deux parties au tableau, en faisant en sorte que les bases ne<br />
soient pas en position horizontale ou verticale. Les autres trapèzes ayant été découpés<br />
auparavant par le maître pour gagner du temps, leurs parties 2 sont présentées aux<br />
élèves puis distribuées : « J'ai fait la même chose pour d'autres trapèzes à terminer. Voici<br />
le dessin à ter-miner de l'équipe A, voici le dessin à terminer de l'équipe B... »<br />
Le maître fixe toutes les parties 1 au tableau dans des positions aléatoires puis amène les<br />
élèves à reformuler le problème.
Étape 2 : recherche<br />
Les élèves peuvent effectuer des essais au crayon mais leur production finale sera tracée<br />
au feutre.<br />
Étape 3 : bilan<br />
Des erreurs sont attendues... notamment quand les tracés sont effectués uniquement au<br />
jugé. Elles peuvent aussi être dues à une utilisation spontanée et mal maîtrisée du<br />
glissement de la règle.<br />
Le maître affiche les productions correspondant aux parties 2 en demandant aux élèves<br />
de repérer les productions qui conviennent. Puis il les passe en revue en demandant à<br />
leurs auteurs de se prononcer sur leur production sous le contrôle de la classe. On ne vise<br />
là que des réponses établies perceptivement du type « c'est bon ! », « c'est pas bon ! »,<br />
« on ne peut pas dire », « c'est presque bon ! »...<br />
Dans cette première phase, la mise en commun sera rapide et conduite en termes de<br />
réussite ou de non-réussite sur les productions. L'explicitation des procédures n'est pas un<br />
objectif de cette phase; elle le sera dans les phases ultérieures qui correspondent à une<br />
reprise du même problème avec d'autres tracés.<br />
Une validation pratique par reconstitution du puzzle suivra ces jugements.<br />
Deuxième phase<br />
Les deux traits sont légèrement décalés<br />
Il s'agit de faire en sorte que les élèves, et notamment ceux qui ont travaillé au jugé,<br />
mobilisent la relation de parallélisme. Le problème est le même que dans la première<br />
phase mais on change de trapèze et les traits sont légèrement décalés (fiche 3).<br />
Le côté fourni à l'élève est plus petit de façon à rendre inefficaces les procédures au jugé<br />
qui nécessitent un support visuel plus important. Le côté à tracer reste long de façon à<br />
amplifier les erreurs dues à l'absence de prise en compte de la relation de parallélisme.<br />
Etapes 1 et 2 : communication du problème, recherche Les étapes 1 et 2 sont identiques à<br />
celles de la première phase.<br />
Étape 3 : bilan<br />
Le maître affiche les parties 2 avec le trait fourni en position horizontale. Il demande à<br />
différents élèves de venir mettre de côté toutes les productions qui ne conviennent pas en<br />
expliquant les raisons de leur choix. La mise en commun reste centrée sur la<br />
détermination « réussi/non réussi ». Cependant, comme il s'agit d'une reprise, le contrôle<br />
de la classe et les désaccords sur les productions litigieuses devraient amener un débat<br />
sur les procédures utilisées. Des désignations de la relation par des gestes devraient<br />
apparaître au cours du débat.<br />
Il est important de maintenir l'exigence de critique des productions avant la validation<br />
pratique avec la partie 1 pour amener l'idée d'un outil auxiliaire ou de tracés intermédiaires<br />
permettant le contrôle du glissement.<br />
Deuxième phase<br />
Les deux traits ne sont plus du tout en face<br />
La conduite de la troisième phase est identique à celle de la deuxième phase. On utilise<br />
cette fois le trapèze de la fiche 4. Le décalage des deux traits devrait permettre de<br />
dépasser la perception du parallélisme sous forme d'une figure prototypique — avec deux<br />
traits de longueurs voisines et disposés bien en face — pour l'approcher comme relation<br />
entre traits de « même direction ».<br />
Comme précédemment, la mise en commun a pour objectif de déterminer les productions<br />
réussies et non réussies avant de passer à la validation pratique. L'explicitation de toutes<br />
les procédures de construction possibles n'est pas un objectif, mais l'explicitation de celles<br />
qui sont utilisées devrait apparaître dans le débat concernant la validation. Ce débat doit<br />
faire ressortir que :<br />
– le côté à tracer ne peut pas être placé au jugé ; c'est une position particulière du côté
(direction) que l'on cherche ;<br />
– la règle glissée avec une grande précaution pour garder la même direction (ou la garder<br />
« penchée pareil ») ou le tracé de traits intermédiaires en utilisant les deux bords de la<br />
règle aide au tracé du bon segment.<br />
La validation effective permet de revenir sur le tri fait par anticipation et pourra<br />
éventuellement permettre de faire le lien entre procédures utilisées et validité de la<br />
production.<br />
II se peut que le maître soit confronté à une procédure utilisant le réseau de <strong>droites</strong><br />
parallèles fourni dans la boîte à outils et à des difficultés pour le tracé. On pourra mettre<br />
en évidence le fait qu'avec le réseau sur transparent disposé au-dessus de la feuille de<br />
travail, on va savoir sous quel trait du réseau doit se situer la solution. Le tracé peut<br />
s'effectuer en prenant un point de repère avec le réseau sur l'autre bord de la feuille de<br />
travail et en joignant ce point au point fourni, ou éventuellement par transparence en<br />
glissant le réseau sous la feuille de travail, ou encore en faisant une marque sur la feuille à<br />
travers le réseau à l'aide d'une pointe de compas ! Cependant, il est préférable que les<br />
procédures erronées soient amplement critiquées avant que ce réseau n'apparaisse<br />
comme utile.<br />
Quelle institutionnalisation <br />
À l'aide de productions valides et de productions invalides, la classe peut identifier des<br />
paires de traits solutions.<br />
Si le mot « parallèle » n'est pas encore apparu, il peut être donné à ce moment-là, avec<br />
référence à des réseaux connus de <strong>droites</strong> parallèles, à des gestes, à la situation « Les<br />
feuilles qui coulissent ». La trace écrite correspond alors à celle envisagée à la fin de cette<br />
dernière situation.<br />
La planche de la fiche 5 est fournie à chaque élève avec pour consigne de colorier en<br />
rouge, sur chaque vignette, les traits parallèles. La mise en commun qui suit a pour<br />
objectif de dépasser les arguments reposant sur la seule perception pour installer une<br />
procédure de validation à l'aide du réseau de traits parallèles. On peut alors découper des<br />
paires de traits parallèles et des paires de traits non parallèles dans la planche de la fiche<br />
5, les coller dans le cahier mémoire et écrire sous les vignettes : « ces deux traits sont<br />
parallèles » ou « ces deux traits ne sont pas parallèles ».