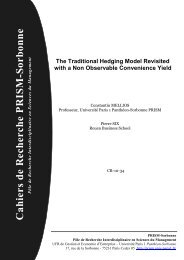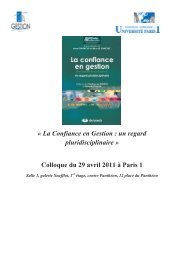Travail et violence domestique - Prism - Université Paris 1 Panthéon ...
Travail et violence domestique - Prism - Université Paris 1 Panthéon ...
Travail et violence domestique - Prism - Université Paris 1 Panthéon ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne<br />
Pôle de Recherche Interdisciplinaire en Sciences du Management<br />
<strong>Travail</strong> <strong>et</strong> <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong><br />
Nouchka Wielhorski<br />
Doctorante,<br />
Université <strong>Paris</strong> 1 Panthéon-Sorbonne, PRISM-Sorbonne<br />
CR-11-21<br />
PRISM-Sorbonne<br />
Pôle de Recherche Interdisciplinaire en Sciences du Management<br />
UFR de Gestion <strong>et</strong> Economie d’Entreprise – Université <strong>Paris</strong> 1 Panthéon-Sorbonne<br />
17, rue de la Sorbonne - 75231 <strong>Paris</strong> Cedex 05 http://prism.univ-paris1.fr/
Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne 11-21<br />
<strong>Travail</strong> <strong>et</strong> <strong>violence</strong> Domestique<br />
Nouchka Wielhorski<br />
Université <strong>Paris</strong> 1 – Panthéon-Sorbonne<br />
17, rue de la Sorbonne<br />
75005 PARIS<br />
01 40 46 28 74<br />
nouchka.wielhorski@ malix.univ-paris1.fr<br />
INTRODUCTION<br />
L’iconographie de la famille esquisse une représentation magnifiée de la<br />
protection originelle rythmée par des mécanismes quotidiens prévisibles. Mais<br />
c<strong>et</strong>te scénographie idyllique se transforme parfois en tragédies ordinaires. Or, si<br />
la relation intime constitue l’interstice secr<strong>et</strong> de l’individu, des comportements<br />
violents qui détériorent la santé <strong>et</strong> entament la dignité ne doivent pas être<br />
banalisés ou « considérés comme de simples affaires privées » (Hirigoyen,<br />
2005). De nature physique, psychologique, verbale ou sexuelle, la <strong>violence</strong><br />
familiale se manifeste au travers de comportements, d’actes <strong>et</strong> de paroles.<br />
Très répandue, la maltraitance <strong>domestique</strong> 1 demeure pourtant peu<br />
visible (INHES/OND, 2008 ; Marissal <strong>et</strong> Chevalley, 2007). En France, au cours<br />
des années 2005 <strong>et</strong> 2006 « sur les 1,6 million de personnes ayant déclaré avoir<br />
été victimes d’au moins un acte de <strong>violence</strong>s physiques, 50 % ont été victimes de<br />
<strong>violence</strong>s de la part d’une personne vivant avec elle » (OND, 2007). En 2009,<br />
165 personnes sont décédées victimes de leur partenaire : 140 femmes <strong>et</strong> 25<br />
hommes (OND, 2010).<br />
Les conséquences individuelles, sociales <strong>et</strong> organisationnelles de ces<br />
<strong>violence</strong>s sont multiples : dégradation de l’état de santé physique <strong>et</strong> mental,<br />
augmentation de l’absentéisme, baisse motivationnelle, baisse de la<br />
concentration, eff<strong>et</strong>s négatifs sur la carrière, le maintien dans l’emploi, <strong>et</strong>c.<br />
Depuis une trentaine d’années, des recherches sur le suj<strong>et</strong> ont émergé<br />
1 Relations intra ou hors ménage entr<strong>et</strong>enues avec des personnes ayant un lien familial ou intime.
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
essentiellement dans les pays anglo-saxons ; nombre de grandes entreprises se<br />
sont emparées de ces problématiques, levant de nombreuses résistances <strong>et</strong><br />
contribuant ainsi à la visibilité de ce phénomène social. Outre le drame humain<br />
qu’elle représente, la <strong>violence</strong> familiale pèse lourdement sur les économies<br />
nationales <strong>et</strong> organisationnelles. Annuellement les entreprises américaines<br />
perdent entre 3 <strong>et</strong> 5 milliards de dollars à cause de l’absentéisme professionnel<br />
consécutif des abus conjugaux (Engelken, 1987 dans Mighty, 1997). En France,<br />
la première estimation des répercussions économiques des <strong>violence</strong>s conjugales<br />
supportées par la collectivité avance le chiffre d’1 milliard d’euros par an<br />
(Marissal <strong>et</strong> Chevalley, 2007). Une enquête plus récente évalue le coût global de<br />
ces <strong>violence</strong>s à plus de 2,5 milliards d’euros par an dont 1 099 millions d’euros<br />
pour le poste de dépense le plus important correspondant aux « pertes de<br />
production dues aux décès, aux incarcérations <strong>et</strong> à l’absentéisme » (Nectoux <strong>et</strong><br />
al., 2010).<br />
L’immixtion des entreprises dans la sphère privée soulève pourtant de<br />
profondes réticences liées à la possibilité d’un contrôle social ou à la croyance en<br />
la séparation des rôles. A l’issue d’une brève revue de littérature explicitant le<br />
cadre conceptuel de la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> <strong>et</strong> de ses incidences tant<br />
individuelles, organisationnelles que professionnelles, nous exposerons les<br />
premiers résultats d’une étude exploratoire menée auprès de 12 personnes.<br />
I. CADRE CONCEPTUEL<br />
I.1 DU DICIBLE A L’INDICIBLE<br />
Symbole de protection, le foyer se transforme parfois en théâtre funeste<br />
où la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> prend la forme d’agressions physiques, verbales,<br />
psychologiques, d’intimidations, de privations financières ou matérielles, de<br />
viols... Elle est perpétrée par un partenaire intime dont le comportement est<br />
caractérisé par des menaces, des harcèlements, des tentatives d’isolement, des<br />
assauts verbaux <strong>et</strong> physiques répétés en vue de contrôler autrui (Browne 1993 ;<br />
Zachary, 2000 ; <strong>et</strong>c.). La <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> ne se limite cependant pas au seul<br />
partenaire, elle s’étend à toute personne entr<strong>et</strong>enant un lien familial ou intime<br />
avec la victime. L’élaboration d’un climat de crainte favorise un état général<br />
d’anxiété préjudiciable à la pleine participation de l’individu à la société<br />
(Mighty, 1997). Si notre époque tend à reconnaître pleinement la <strong>violence</strong><br />
psychologique, certains considèrent néanmoins que seule l’atteinte corporelle<br />
envers les personnes est mesurable (Chesnais, 1981). L’extériorité prime sur<br />
l’intériorité ; « la blessure des mots est d’autre nature que celle des coups ».<br />
Insister sur une <strong>violence</strong> de genre brise l’égalité entre les sexes <strong>et</strong> réaffirme<br />
« l’éternelle oppression masculine » (Badinter, 2003).<br />
I.2 TERRORISME PATRIARCAL VERSUS VIOLENCE COMMUNE DU COUPLE<br />
Page 2 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
La littérature différencie la <strong>violence</strong> sadique unilatérale du<br />
fonctionnement conflictuel bilatéral du couple. La sociologie américaine<br />
distingue le « terrorisme patriarcal » caractérisé par des mécanismes de contrôle<br />
de la « <strong>violence</strong> commune du couple » obéissant moins à un processus de<br />
supériorité de genre qu’à la survenue de conflits occasionnels <strong>et</strong> réciproques<br />
(Johnson, 1995). La <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> a des implications économiques,<br />
sociales <strong>et</strong> organisationnelles nombreuses.<br />
I.3 QUELQUES ETUDES GENERALES<br />
Selon les recherches menées en Allemagne, en Grande-Br<strong>et</strong>agne <strong>et</strong> en<br />
France, la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> traverse l’ensemble des classes sociales, des<br />
tranches d’âge, indépendamment de l’<strong>et</strong>hnie, du genre, du niveau de revenu <strong>et</strong><br />
de l’origine géographique (Jaspard, 2005 ; Smartt <strong>et</strong> Kury, 2007). L’Enquête<br />
nationale sur la <strong>violence</strong> familiale au sein des familles américaines a permis<br />
l’élaboration d’une échelle de mesure Conflict Tactics Scales (CTS) contestée<br />
mais très utilisée (Straus <strong>et</strong> Gelles, 1990). C<strong>et</strong>te étude avalise l’égalité<br />
hommes/femmes face à la <strong>violence</strong>. Cependant, les faits déclarés <strong>et</strong> recensés<br />
dans la plupart des enquêtes rapportent que la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> s’exerce<br />
davantage à l’encontre des femmes. La <strong>violence</strong> conjugale aux Etats-Unis<br />
représente 21 % de l’ensemble des crimes perpétrés envers les femmes contre<br />
2 % pour les hommes (Greenfield <strong>et</strong> al., 1998). En France, 10 % des femmes<br />
âgées de 20 à 59 ans sont en situation de <strong>violence</strong>s conjugales (Jaspard, 2005).<br />
Une enquête américaine menée auprès de salariés (femmes <strong>et</strong> hommes) a montré<br />
que plus de 10 % d’entre eux avaient subi un épisode de <strong>violence</strong> de la part du<br />
partenaire intime au cours des 12 derniers mois (Reeves <strong>et</strong> O’Leary-Kelly,<br />
2009).<br />
II. LES INCIDENCES INDIVIDUELLES,<br />
ORGANISATIONNELLES ET PROFESSIONNELLES DE<br />
LA VIOLENCE DOMESTIQUE<br />
II.1 CONSEQUENCES SUR LA SANTE PHYSIQUE ET MENTALE DES VICTIMES<br />
Les eff<strong>et</strong>s de la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> sur la santé physique <strong>et</strong> mentale<br />
des victimes sont directs <strong>et</strong>/ou indirects. Tandis que les lésions corporelles <strong>et</strong> les<br />
chocs traumatiques n’échappent pas à l’observateur, les impacts indirects<br />
perdurent au travers de douleurs, d’anxiété chronique, de dépressions, de<br />
troubles du sommeil, de poussées d’angoisse ou de séquelles neurologiques<br />
(Campbell, 2002 ; Coker <strong>et</strong> al., 2000 ; Henrion, 2001). « Les victimes de<br />
<strong>violence</strong>s conjugales peuvent présenter longtemps après la séparation des<br />
troubles de stress post-traumatique » dont la principale manifestation est la<br />
Page 3 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
reviviscence 2 (Hirigoyen, 2005). Agressions verbales <strong>et</strong> injures répétées<br />
entament l’estime de soi ; les reproches sur l’aspect physique ou la famille<br />
agissent sur la stabilité émotionnelle <strong>et</strong> sont susceptibles d’altérer les capacités<br />
personnelles, relationnelles voire professionnelles des personnes (André <strong>et</strong> F.<br />
Lelord, 1998 ; Henrion, 2001). Les femmes victimes présentent des taux plus<br />
élevés de suicide que les non victimes (Walby, 2000). Le risque de <strong>violence</strong> au<br />
travail est multiplié par deux lorsque la femme subit des <strong>violence</strong>s conjugales : le<br />
harcèlement dans l’entreprise se déploie avec moins de résistance sur une<br />
personne fragile (Hirigoyen, 1998 ; Jaspard, 2005).<br />
Le coût de ce fait social se chiffre en milliards de dollars pour les<br />
économies nationales en termes de dépenses de santé, de recours aux services de<br />
l’état, d’absentéisme (OMS, 2002) <strong>et</strong> de perte de productivité pour les<br />
organisations.<br />
II.2 MANIFESTATIONS DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE SUR LE LIEU DE<br />
TRAVAIL<br />
Environ 74 % des cibles de la <strong>violence</strong> conjugale aux Etats-Unis sont<br />
harcelées sur leur lieu de travail (Zachary, 2000) <strong>et</strong> entre 36 % <strong>et</strong> 75 % des<br />
employés victimes sont attaqués par leur partenaire pendant l’exercice de leur<br />
activité (Shepard <strong>et</strong> Pence, 1988 ; Swandberg <strong>et</strong> al., 2005 ; Taylor <strong>et</strong> Barusch,<br />
2004). L’homicide est la principale cause de mortalité sur le lieu de travail pour<br />
les femmes <strong>et</strong> la seconde pour les hommes (U.S. Department of Labor, 1994<br />
dans Moe <strong>et</strong> Bell, 2004). Outre les cibles principales, d’autres personnes au sein<br />
de l’entreprise sont exposées à des dommages collatéraux.<br />
II.3 CONSEQUENCES ORGANISATIONNELLES INDIRECTES DE LA VIOLENCE<br />
DOMESTIQUE<br />
Les eff<strong>et</strong>s indirects se devinent au travers d’une baisse de la<br />
performance des victimes liée à un absentéisme important, à des r<strong>et</strong>ards répétés,<br />
à une diminution de la concentration, à une estime de soi dégradée : autant<br />
d’éléments susceptibles de diminuer les opportunités d’évolution professionnelle<br />
ou d’entraîner la mise à l’écart (Anderson <strong>et</strong> Pearson, 2001 ; Farmer <strong>et</strong><br />
Tiefenthaler, 1997 ; O’Leary-Kelly <strong>et</strong> al., 2008 ; Reece, 2006, Wilkinson, 2001 ;<br />
<strong>et</strong>c.). Les employeurs américains dépensent annuellement entre 3 <strong>et</strong> 5 milliards<br />
pour faire face aux débordements provoqués par la <strong>violence</strong> conjugale (Mighty,<br />
1997 ; Swandberg <strong>et</strong> al. 2007 ; Zachary, 2000). Ces montants incluent les pertes<br />
liées à l’absentéisme, au turnover, aux frais médicaux <strong>et</strong> à une baisse générale de<br />
la productivité. Nombre d’études associent la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> à un fort taux<br />
d’absentéisme, à des r<strong>et</strong>ards importants <strong>et</strong> à des difficultés de concentration. Aux<br />
Etats-Unis, les femmes abusées perdent annuellement presque 8 millions de<br />
journées de travail soit un total de 728 millions de dollars (Max <strong>et</strong> al., 2004).<br />
Entre 23 % <strong>et</strong> 54 % des employés abusés déclarent avoir été absents pour des<br />
raisons de <strong>violence</strong>s conjugales (Taylor <strong>et</strong> Barusch, 2004). Un absentéisme<br />
fréquent, une baisse de la performance individuelle ou l’irruption du partenaire<br />
2 Un détail qui fait resurgir les situations traumatiques.<br />
Page 4 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
sur le lieu de travail sont des éléments susceptibles d’entraîner le licenciement du<br />
salarié (Johnson <strong>et</strong> Gardner, 1999 ; Reece, 2006). Entre 25 <strong>et</strong> 35 % des femmes<br />
battues perdent leur travail conséquemment à des épisodes de <strong>violence</strong><br />
conjugale. Ce phénomène constitue un frein au maintien dans l’emploi (Taylor <strong>et</strong><br />
Barusch, 2004).<br />
La baisse de concentration au travail est plus importante chez les<br />
victimes que chez les non victimes. Si les stigmates post-traumatiques persistent<br />
parfois longtemps après la séparation (Hirigoyen, 2005), les salariés dont<br />
l’expérience est lointaine ne présentent pas de différences dans le niveau de<br />
distraction au regard des non victimes. C<strong>et</strong>te variable peut se mesurer par la<br />
difficulté de concentration, par la fatigue éprouvée ou par le fait de ne pas avoir<br />
réalisé son travail quotidien (Reeves <strong>et</strong> O’Leary-Kelly, 2007, 2009).<br />
Nombre de recherches se sont intéressées au conflit de rôles entre<br />
travail <strong>et</strong> famille. Celles-ci m<strong>et</strong>tent en lumière l’impossibilité pour les individus<br />
de laisser entièrement de côté leurs problèmes ou leurs succès (Rothbach, 2001).<br />
En eff<strong>et</strong>, des émotions négatives dans un rôle peuvent être associées à un<br />
engagement plus faible dans un autre (Greenhaus and Beutell, 1985).<br />
III. METHODOLOGIE<br />
III.1 FIABILITE ET VALIDITE DE LA RECHERCHE<br />
L’objectif de l’étude est de comprendre l’impact de c<strong>et</strong>te problématique<br />
intrafamiliale sur les comportements individuels <strong>et</strong> les contextes organisationnels<br />
afin de mieux cerner les actions envisageables <strong>et</strong>/ou déjà mises en place. Une<br />
méthodologie qualitative semble appropriée à une question de recherche liée à<br />
l’intimité des histoires personnelles. La méthode de recueil des données fondée<br />
sur des entr<strong>et</strong>iens semi-directifs facilite le dévoilement. Notre étude exploratoire<br />
adopte le point de vue des victimes <strong>et</strong> repose sur un mode de raisonnement de<br />
type abductif : il s’agit à la fois de vérifier si les thèmes mis en lumière par la<br />
littérature anglo-saxonne sont transposables dans le contexte français <strong>et</strong> d’en<br />
décrire de nouveaux. Douze entr<strong>et</strong>iens ont été menés jusqu’à présent (8 victimes,<br />
2 représentants syndicaux FO/CGT salariés du constructeur automobile PSA<br />
Peugeot Citroën qui a inscrit c<strong>et</strong>te thématique dans un accord collectif, une<br />
responsable d’association <strong>et</strong> une professionnelle des ressources humaines). Seuls<br />
seront présentés ici les résultats de l’échantillon « victimes » : sur les 8<br />
personnes interrogées (7 femmes <strong>et</strong> 1 homme), 6 occupaient un emploi au<br />
moment de la relation violente. Nous avons effectué, à l’aide du logiciel<br />
Modalisa, une analyse thématique verticale <strong>et</strong> horizontale des occurrences. La<br />
taille de notre échantillon est à ce stade trop faible pour accéder à un niveau de<br />
confiance satisfaisant dans les résultats <strong>et</strong> atteindre le principe de saturation<br />
sémantique <strong>et</strong> de saturation théorique (Roussel <strong>et</strong> Wacheux, 2005).<br />
III.2. THEMES DE L’ANALYSE DE CONTENU THEMATIQUE<br />
Nous avons tenté de mesurer le concept de <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> au<br />
Page 5 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
travers de ses 4 formes principales (1) à savoir physique, psychologique, sexuelle<br />
<strong>et</strong> économique, (Hirigoyen 2005 ; Jaspard, 2005 ; Zachary, 2000, <strong>et</strong>c.) ; sa<br />
temporalité (2) <strong>et</strong> ses conséquences à la fois sur l’individu (3), sur l’organisation<br />
(4) <strong>et</strong> sur l’emploi (5). Nous avons distingué la temporalité actuelle/récente des<br />
faits violents (inférieure à 12 mois) de la temporalité éloignée du présent de<br />
l’individu (Reeves <strong>et</strong> O’Leary-Kelly, 2007, 2009). Nous avons modélisé 8<br />
catégories d’impacts à 3 niveaux différents (individuel, organisationnel <strong>et</strong><br />
professionnel). Les incidences individuelles se traduisent par des répercussions<br />
sur la santé psychique <strong>et</strong>/ou physique (Coker, 2000 ; Henrion, 2001 ; McCauley<br />
<strong>et</strong> al., 1995) <strong>et</strong> sur le niveau d’estime de soi, (André <strong>et</strong> Lelord, 1998). Les<br />
incidences organisationnelles sont celles qui, au-delà de l’individu, influent<br />
directement ou indirectement sur les entreprises. Parmi les plus récurrentes, la<br />
littérature a identifié, nous l’avons vu, l’absentéisme, la propension aux r<strong>et</strong>ards<br />
répétés (Anderson <strong>et</strong> Pearson, 2001 ; Bell <strong>et</strong> al., 2002 ; Brownell, 1996 ; Johnson<br />
and Gardner, 1999 ; O’Leary-Kelly <strong>et</strong> al., 2008 ; Reece, 2006 ; Taylor <strong>et</strong><br />
Barusch, 2004, <strong>et</strong>c.), un niveau élevé de distraction (Lloyd, 1997 ; Reeves <strong>et</strong><br />
O’Leary, 2007). Une rubrique a été créée pour le dévoilement de la <strong>violence</strong><br />
subie à l’employeur <strong>et</strong>/ou à un collègue (Reeves <strong>et</strong> O’Leary-Kelly, 2009). Nous<br />
avons également interrogé les personnes sur leurs attentes 3 en présentant trois<br />
modèles d’intervention : l’intégration des mesures dans la stratégie globale des<br />
DRH, le modèle de la négociation collective <strong>et</strong> le partenariat avec les services<br />
sociaux de proximité (Murray <strong>et</strong> Powell, 2007). Enfin la littérature distingue<br />
quatre principales incidences sur l’emploi : la perte d’emploi de la victime<br />
(Coker <strong>et</strong>.al., 2000 ; Farmer <strong>et</strong> Tiefenthaler, 1997 ; Moe and Bell, 2004),<br />
l’instabilité professionnelle (Browne <strong>et</strong> al., 1999), la difficulté à évoluer<br />
(Anderson <strong>et</strong> Pearson 2001 ; Reece, 2006 ; Wilkinson, 2001 ; <strong>et</strong>c.) <strong>et</strong> de manière<br />
générale une baisse d’efficacité.<br />
IV. RESULTATS<br />
III.1. FORMES DE VIOLENCE ET TEMPORALITE<br />
Sur les 8 victimes interrogées, 7 ont subi la forme physique de la<br />
<strong>violence</strong>. Agressions verbales, pressions psychologiques, dénigrements répétés,<br />
constituent les formes de <strong>violence</strong> les plus répandues : elles concernent tous nos<br />
répondants. La <strong>violence</strong> sexuelle, plus rare, s’accompagne de brutalités<br />
physiques <strong>et</strong> de pressions psychologiques : 2 femmes l’ont expérimentée. La<br />
<strong>violence</strong> économique consiste en une dépendance financière subie : elle concerne<br />
4 personnes. Quant au critère de la temporalité, il mesure la persistance des<br />
séquelles ; 2 répondants subissaient encore la <strong>violence</strong> au moment de l’entr<strong>et</strong>ien.<br />
III.2. INCIDENCES SUR LES INDIVIDUS<br />
3 Thème peu abordé par la littérature.<br />
Page 6 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
Les conséquences sur la santé physique <strong>et</strong> mentale concernent 7<br />
individus : états d’anxiété chronique, sentiments de peur, épisodes de dépression<br />
sévère, tentatives de suicide, hospitalisations <strong>et</strong> suivis psychiatriques. Parmi les 7<br />
personnes ayant abordé le thème de l’estime de soi, la plupart mentionnent la<br />
perspective de proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> prétendent être dotées d’un bon relationnel. Certaines,<br />
en revanche, manifestent repli sur soi, sentiment d’infériorité, difficulté à se<br />
proj<strong>et</strong>er. Au total seulement deux répondants sur huit ont présenté une faible<br />
estime de soi <strong>et</strong> un degré de résistance aux événements violents moins élevé que<br />
l’ensemble de l’échantillon.<br />
III.3. INCIDENCES ORGANISATIONNELLES<br />
Nous avons dégagé 5 principales incidences organisationnelles :<br />
absentéisme, r<strong>et</strong>ard, distraction, dévoilement <strong>et</strong> attentes. Elles représentent<br />
22,9 % des occurrences dont 1,1 % pour l’absentéisme <strong>et</strong> 2,9 % pour la<br />
distraction.<br />
a) Absentéisme<br />
Les résultats de notre analyse ont permis de m<strong>et</strong>tre en lumière un faible<br />
taux d’absentéisme malgré la régularité des <strong>violence</strong>s subies : 5 répondants<br />
affirment être capables de se rendre au travail quotidiennement ; 2 ont mentionné<br />
des absences régulières directement liées à la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong>.<br />
b) R<strong>et</strong>ard<br />
Ce critère, qui a émergé des études anglo-saxonnes, ne recueille aucune<br />
occurrence au sein de notre échantillon.<br />
c) Distraction<br />
A l’instar des études précédentes, le phénomène de la distraction au<br />
travail constitue l’impact le plus cité après le dévoilement <strong>et</strong> les attentes.<br />
e) Dévoilement <strong>et</strong> secr<strong>et</strong><br />
Six personnes ont évoqué ce thème ; pour l’une d’entre elle la<br />
confidence à un collègue a permis d’assouplir les tissus cicatriciels <strong>et</strong> d’éviter<br />
l’hospitalisation ; 3 victimes ont été confrontées au regard clairvoyant de<br />
collègues ou amis qui se sont aperçus de la maltraitance. Une personne a<br />
souligné toutefois les réticences inhérentes au dévoilement : aveu de faiblesse,<br />
sentiment de honte sociale <strong>et</strong> stratégie de protection.<br />
g) Les attentes<br />
La moitié des répondants a exprimé de fortes attentes vis-à-vis de<br />
l’organisation notamment en matière d’aide au logement, d’aide juridique <strong>et</strong> de<br />
soutien psychologique. Cependant, beaucoup ont affirmé l’importance de la<br />
préservation de l’anonymat au sein de l’organisation.<br />
Page 7 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
III.4. INCIDENCES SUR L’EMPLOI<br />
La littérature a souligné les incidences de la <strong>violence</strong> sur la carrière des<br />
victimes en termes de difficulté à évoluer, d’instabilité professionnelle ou de<br />
perte d’emploi. Notre échantillon rapporte un faible taux d’occurrences : 2<br />
personnes ont perdu leur travail indirectement du fait de la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong><br />
subie ; l’instabilité professionnelle <strong>et</strong> l’absence de promotion concernent<br />
respectivement 2 <strong>et</strong> 4 personnes. Nous ne pouvons toutefois pas affirmer que les<br />
<strong>violence</strong>s <strong>domestique</strong>s soient à l’origine de ces entraves à un déroulé de carrière<br />
progressif. L’efficacité professionnelle des individus est approchée par la<br />
réalisation des objectifs fixés : quatre personnes estiment les atteindre.<br />
Parmi les catégories qui ont émergé a posteriori une seule a fait l’obj<strong>et</strong><br />
d’une analyse de contenu ; elle renvoie aux actions concrètes menées par les<br />
victimes pour se soustraire de ces situations de <strong>violence</strong>. En eff<strong>et</strong>, les<br />
programmes de lutte déployés n’intègrent pas suffisamment le point de vue des<br />
victimes ; pourtant leur perception est centrale pour en améliorer l’efficacité.<br />
V. DISCUSSION<br />
A l’instar des recherches précédentes, la <strong>violence</strong> psychologique est<br />
surreprésentée, suivie de la <strong>violence</strong> physique, économique <strong>et</strong> sexuelle. Il<br />
n’existe pas de relation entre le type de <strong>violence</strong> subie <strong>et</strong> l’ampleur des<br />
incidences organisationnelles. En revanche, les personnes ayant cumulé au moins<br />
3 types de <strong>violence</strong> subissent davantage de séquelles individuelles que les autres<br />
personnes, entraînant, de ce fait, des impacts organisationnels plus conséquents.<br />
Un niveau élevé de persistance des stigmates post-traumatiques est à<br />
noter. Les entr<strong>et</strong>iens ont également mis en évidence la prévalence des incidences<br />
individuelles <strong>et</strong> organisationnelles sur les incidences en matière d’emploi à<br />
l’exception du sous-thème de l’évolution professionnelle. Nos analyses de<br />
contenu montrent l’importance des séquelles en termes de santé mentale,<br />
physique <strong>et</strong> d’estime de soi. Si le lien entre la temporalité de la <strong>violence</strong> <strong>et</strong> le<br />
niveau d’incidence organisationnelle n’est pas démontré, il existe en revanche<br />
une relation entre l’ampleur des conséquences individuelles <strong>et</strong> l’intensité des<br />
conséquences organisationnelles. Les incidences sur l’emploi augmentent en<br />
fonction des conséquences individuelles : les personnes ayant cumulé des<br />
<strong>violence</strong>s variées ont connu également les incidences individuelles les plus<br />
importantes ainsi que les eff<strong>et</strong>s organisationnels les plus tangibles <strong>et</strong> les impacts<br />
sur l’emploi les plus visibles, soit 3 personnes sur 4.<br />
Outre le lien entre cumul des <strong>violence</strong>s <strong>et</strong> importance des incidences,<br />
nous avons également observé un phénomène de cumul des types d’incidences.<br />
En eff<strong>et</strong>, les personnes dont les incidences organisationnelles furent/sont<br />
prégnantes, essentiellement en matière de distraction <strong>et</strong> d’absentéisme,<br />
connurent/connaissent des incidences significatives sur l’emploi notamment en<br />
Page 8 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
termes de capacité à évoluer professionnellement, de licenciement <strong>et</strong> de<br />
précarité.<br />
L’impact organisationnel le plus fréquemment cité après le dévoilement<br />
est la distraction (2,9 % des occurrences/50 % de l’effectif). Les conséquences de<br />
la <strong>violence</strong> sur la productivité résultent principalement d’un niveau de distraction<br />
au travail plus élevé. En eff<strong>et</strong>, les épisodes traumatiques subis diminuent la<br />
stabilité émotionnelle des victimes ainsi que leur implication. En revanche, nos<br />
résultats ne perm<strong>et</strong>tent pas de m<strong>et</strong>tre en avant un fort taux d’absentéisme chez<br />
c<strong>et</strong>te population : ce critère ne concerne que 2 personnes. Nous pouvons<br />
cependant affirmer que les journées de travail perdues sont directement liées à la<br />
<strong>violence</strong> <strong>domestique</strong>.<br />
Si le dévoilement des situations de <strong>violence</strong> entraîne un sentiment de<br />
soutien social, une personne a souligné toutefois le danger de la confidence : c<strong>et</strong><br />
aveu de faiblesse peut s’avérer préjudiciable au salarié, qui, déjà fragilisé par sa<br />
situation personnelle, risque d’être stigmatisé dans un contexte professionnel.<br />
Les incidences de la <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> sur l’emploi semblent peu<br />
significatives, excepté pour le critère de l’évolution professionnelle : 2 personnes<br />
ont perdu leur poste à cause de leur situation personnelle douloureuse, 2 autres<br />
ont rencontré une certaine instabilité professionnelle non nécessairement reliée<br />
aux <strong>violence</strong>s subies <strong>et</strong>, près de la moitié des répondants éprouve des difficultés<br />
à évoluer. Si l’organisation doit être à l’écoute des salariés qui l’animent, des<br />
limites toutefois à l’ingérence ont été soulignées : les programmes de prévention<br />
fragiliseraient les individus <strong>et</strong> détourneraient l’entreprise de son but premier.<br />
CONCLUSION<br />
Ce suj<strong>et</strong> sensible soulève de multiples réticences ; réticences d’abord de<br />
la part des victimes devant affronter les obstacles de la honte <strong>et</strong> de la culpabilité,<br />
réticences ensuite du corps social qui a longtemps fermé les yeux sur le huit clos<br />
familial, réticences enfin des firmes à s’immiscer dans les affaires privées des<br />
salariés. Notre étude exploratoire m<strong>et</strong> en évidence le poids du cumul des<br />
<strong>violence</strong>s sur les impacts organisationnels : l’addition des handicaps fragilise<br />
l’individu augmentant ainsi sa probabilité d’exposition aux incidences<br />
organisationnelles <strong>et</strong> sa perméabilité aux impacts négatifs sur l’emploi.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Anderson D. <strong>et</strong> Pearson Y. (2001), “The corporate attack on family <strong>violence</strong>”,<br />
Business and soci<strong>et</strong>y Review, No. 67 : p. 51-54.<br />
André C. <strong>et</strong> F. Lelord (1998), L’Estime de soi, s’aimer pour mieux vivre avec<br />
les autres, Odile Jacob poches éd. janvier 2002.<br />
Badinter E. (2003), Fausse route, Odile Jacob.<br />
Page 9 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
Bell M., Moe A. <strong>et</strong> Schweinle W. (2002), “Partner <strong>violence</strong> and work: Not just a<br />
domestic issue”, Academy of Management Best Papers Proceedings, p. 1-<br />
27.<br />
Browne A., (1993) “Violence against women by male partners: Prevalence,<br />
outcomes, and policy implications”, American Psychologist, Vol 48(10) :<br />
p. 1077-1087.<br />
Browne A., Salomon A., Bassuk, S. S. (1999) “The impact of recent partner<br />
<strong>violence</strong> on poor women’s capacity to maintain work”, Violence Against<br />
Women, 5(4) : p. 393-426.<br />
Brownell P. (1996), “Domestic <strong>violence</strong> in the workplace : An emergent issue.”<br />
Crisis Intervention, 3 : p. 129-141.<br />
Campbell J.C. (2002), “ Health consequences of intimate partner <strong>violence</strong> ”,<br />
The Lanc<strong>et</strong>, Vol 359, April 13 : p. 1331-1336.<br />
Chesnais J. C. (1981) Histoire de la <strong>violence</strong> en Occident, de 1800 à nos jours.<br />
<strong>Paris</strong>, Robert Laffont.<br />
Coker A., Smith P. H., McKeown R. E., King M. R. (2000), “Frequency and<br />
correlates of intimate partner <strong>violence</strong> by type : Physical, sexual, and<br />
psychological batterring”, American Journal of public health, Vol. 90,<br />
N° 4 : p. 553-559.<br />
Engelken C. (1987), “Fighting the costs of spouse abuse”, Personnel Journal<br />
66(3) : p. 31-34 dans Mighty E.J. (1997) “Conceptualizing Family<br />
<strong>violence</strong> as a workplace issue : a framework for research and practice”,<br />
Employee responsibilities and rights journal, 10(4) : p. 249-262.<br />
Farmer A. <strong>et</strong> Tiefenthaler J. (1997), “ An economic analysis of domestic<br />
<strong>violence</strong> ”, Review of social Economy, No. 55 : p.337-358.<br />
Greenfield, Rand, Craven, Klaus, Perkins, Ringel, Warchol, Maston, Fox<br />
(1998), Violence by intimates, analysis of data on crimes by current or<br />
former spouses, boyfriends, and girlfriends, U.S. Department of Justice,<br />
Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics.<br />
Greenhaus J. H. and Beutell N. J. (1985), “Sources of conflict b<strong>et</strong>ween work<br />
and family roles”, Academy of management review, vol. 10 n°1 : p. 76-88.<br />
Henrion R. (2001) Les femmes victimes de <strong>violence</strong>s conjugales, le rôle des<br />
professionnels de santé, La documentation Française.<br />
Hirigoyen M. F. (1998), Le harcèlement moral, la <strong>violence</strong> perverse au<br />
quotidien, Syros.<br />
Hirigoyen M.F. (2005), Femmes sous emprise, les ressorts de la <strong>violence</strong> dans<br />
le couple, Oh ! Editions.<br />
Page 10 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
Jaspard M. (2005), Les Violences contre les femmes, <strong>Paris</strong>, La Découverte,<br />
collection « Repères ».<br />
Johnson M.P. (1995), “Patriarchal terrorism and common couple <strong>violence</strong> : two<br />
forms of <strong>violence</strong> against women”, Journal of Marriage and the family,<br />
No.57 : p. 283-294.<br />
Johnson P.R. <strong>et</strong> Gardner S. (1999), “Domestic <strong>violence</strong> and the workplace :<br />
developing a company response”, Journal of management development,<br />
18(7) : p. 590-597.<br />
Lloyd S. (1997), “The effects of domestic <strong>violence</strong> on women’s employment”,<br />
Law<br />
<strong>et</strong><br />
Policy, 19 : p. 139-167.<br />
Marissal J.P. <strong>et</strong> Chevalley C. (2007), Evaluation des répercussions<br />
économiques des <strong>violence</strong>s conjugales en France, La documentation<br />
Française.<br />
Max W., Rice D. P., Finkelstein E., Bardwell R. A. <strong>et</strong> Leadb<strong>et</strong>ter S. (2004),<br />
“The economic toll of intimate partner <strong>violence</strong> against women in the<br />
United States”, Violence and Victims 19(3) : p. 259–272.<br />
McCauley J. <strong>et</strong> al. (1995), “ The battering syndrome”, Annals of Internal<br />
Medecine, 123 : p. 737-746.<br />
Mighty E.J. (1997), “Conceptualizing Family <strong>violence</strong> as a workplace issue : a<br />
framework for research and practice”, Employee responsibilities and<br />
rights journal, 10(4) : p. 249-262.<br />
Moe A. <strong>et</strong> Bell M. (2004), “Abject economics: The effects of battering and<br />
<strong>violence</strong> on women’s work and employability”, Violence Against Women,<br />
10(1) : p. 29-55.<br />
Murray S. <strong>et</strong> Powell A. (2007), “Family <strong>violence</strong> prevention using workplaces<br />
as sites of intervention”, Research and practice in Human resource<br />
management, 15(2) : p. 62-74.<br />
Nectoux M., Mugnier C., Baffert S., Albagly M., Thélot B. (2010)<br />
« Evaluation économique des <strong>violence</strong>s conjugales en France”, Santé<br />
publique, volume 22, n°4, p.405-416.<br />
Observatoire national de la délinquance - OND (2008), Eléments de mesure<br />
des <strong>violence</strong>s entre conjoints - dossier II : Crimes <strong>et</strong> délits constatés.<br />
Observatoire national de la délinquance - OND (2007), « Enquête de<br />
victimation ».<br />
Page 11 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
INHESJ/ONDRP - Repères 14 - (2010) « La criminalité en France Rapport de<br />
l’Observatoire national de la délinquance <strong>et</strong> des réponses pénales »<br />
O’Leary-Kelly A., Lean E., Reeves C. <strong>et</strong> Randel J. (2008), “Coming into the<br />
light : intimate partner <strong>violence</strong> and its effects at work ”, may, Academy<br />
of Management Perspectives No. 22 : p. 57-72.<br />
Organisation mondiale de la Santé – OMS (2002), Rapport mondial sur la<br />
<strong>violence</strong> <strong>et</strong> la santé sous la direction de Etienne G. Krug, Linda L.<br />
Dahlberg, James A. Mercy, Anthony Zwi <strong>et</strong> Rafael Lozano-Ascencio,<br />
Genève.<br />
Reece Laurie L. (2006), “Understanding the Impact of Domestic Violence on<br />
the Workplace”, Employment Relations Today,Wiley InterScience, p. 49-<br />
56.<br />
Reeves C.A. <strong>et</strong> O’Leary-Kelly A. (2007), “The effects and costs of intimate<br />
partner <strong>violence</strong> on organizations”, Journal of interpersonal Violence,<br />
22(3) : p. 327-344.<br />
Reeves C.A. <strong>et</strong> O’Leary-Kelly A. (2009), Study of the Effects of Intimate<br />
Partner Violence on the Workplace.<br />
Rothbard N.P. (2001), “Enriching or depl<strong>et</strong>ing The dynamics of engagement<br />
in work and family roles”, Administrative Science Quarterly, 46 : p.<br />
655-684.<br />
Roussel P. <strong>et</strong> Wacheux F. (2005), Management des Ressources Humaines,<br />
méthodes de recherches en sciences humaines <strong>et</strong> sociales, De Boech.<br />
Shepard M. <strong>et</strong> Pence E. (1988), “The effect of battering on the employment<br />
status of women” Affilia, 3(2) : p. 55-61.<br />
Smartt U. <strong>et</strong> Kury H. (2007), “Domestic <strong>violence</strong> : comparative analysis of<br />
German and U.K. research findings”, Social science quarterly, No. 88(5),<br />
p.1263- 1280.<br />
Straus M. A. <strong>et</strong> Gelles R.J. (1990), Physical <strong>violence</strong> in American families :<br />
Risk factors and adaptations to <strong>violence</strong> in 8 145 families, New<br />
Brunswick (First Paperback edition 1995).<br />
Swandberg J., Logan T.K., Macke C. (2005), “Intimate partner <strong>violence</strong>,<br />
employment and the workplace”, Trauma, Violence <strong>et</strong> Abuse, Vol. 4, No.<br />
X : p. 1-25.<br />
Taylor M. J. <strong>et</strong> Barusch, A. S. (2004), “Personal, family, and multiple barriers<br />
of long-term welfare recipients”, Social Work, 49(2) : p. 175-183.<br />
Page 12 sur 13
N.WIELHORSKI /Cahiers de Recherche PRISM-Sorbonne / CR 11-21<br />
Walby S. (2004), The cost of domestic <strong>violence</strong>, London: Department of Trade<br />
and Industry.<br />
Wilkinson C.W. (2001), “Violence prevention at work – A business<br />
perspective”, American journal of preventive medicine 20(2) :<br />
p.155-160.<br />
Zachary, M. K. (2000), “Labor law for supervisors: Domestic <strong>violence</strong> as a<br />
workplace issue. Supervision”, 61(4) : p. 23-26.<br />
Page 13 sur 13
Liste des cahiers de recherche du PRISM – ANNEE 2011<br />
N° Titre Auteurs<br />
CR-11-01 La RSE, entre universalisme <strong>et</strong> contingences : le cas de la côte<br />
d’ivoire<br />
D. Gnanzou<br />
C.H. D’Arcimoles<br />
S. Gaultier - Gaillard<br />
CR-11-02 Diversité au sein des organes de direction <strong>et</strong> Gouvernance des<br />
entreprises<br />
H. Ben Ayed<br />
S. Saint-Michel<br />
CR-11-03 La gouvernance des entreprises socialement responsables J-J. Pluchart<br />
CR-11-04<br />
CR-11-05<br />
L’évaluation de la performance individuelle au travail confrontée à<br />
la logique partenariale <strong>et</strong> justicielle de la RSE<br />
Mise en œuvre opérationnelle de la RSE : Une étude descriptive<br />
<strong>et</strong> comparative des pratiques de deux entreprises industrielles en<br />
Côte d’Ivoire.<br />
B. Condomines<br />
D. Gnanzou<br />
CR-11-06 Responsabilité Sociale de l’Entreprise <strong>et</strong> Publicité :<br />
vers une validation du statut médiateur de l’attitude envers la<br />
marque au sein de la relation entre la responsabilité sociale de<br />
l’entreprise communiquante <strong>et</strong> la confiance envers la marque<br />
CR-11-07 C’est l’heure du goûter !<br />
Les représentations par les 7-11 ans d’un repas dédié à l’enfance<br />
CR-11-08<br />
Une approche exploratoire de l’influence des facteurs<br />
situationnels sur le comportement d’achat en ligne :<br />
Cas de l’achat de vêtement en ligne<br />
CR-11-09 Brand content <strong>et</strong> génération Z :<br />
L’avenir des marques doit-il passer par Leurs contenus <br />
CR-11-10 Les Compagnons réussissent-ils comme les autres <br />
Proposition d’une typologie des attentes en termes de carrière au<br />
sein de l’AOCDTF<br />
S.Herault<br />
P. Ezan<br />
M.Goll<strong>et</strong>y<br />
C.Damay<br />
V. Nicolas-Hémar<br />
M. Ghaibi<br />
E.Cherif<br />
E.Hennequin<br />
D.Abonneau<br />
CR-11-11 Surmonter les difficultés de la méthode<br />
G.Chanson<br />
QCA grâce au protocole SC-QCA<br />
CR-11-12 Les marques alimentaires <strong>et</strong> les enfants :<br />
Quel rôle jouent-elles lors des goûters partagés entre pairs <br />
P. Ezan<br />
M.Goll<strong>et</strong>y<br />
C.Damay<br />
V. Nicolas-Hémar<br />
CR-11-13 GRH <strong>et</strong> télétravail : quel cadre légal J.Abou Hamad<br />
CR-11-14<br />
CR-11-15<br />
L’externalisation de la fonction comptable à l’épreuve de la<br />
théorie du signal.<br />
A researcher's guide to innate consumer behaviour: integrating<br />
evolutionary life sciences into mark<strong>et</strong>ing.<br />
G.Chanson<br />
V.Rougès<br />
F.T.Wehrle<br />
CR-11-16 Les impératifs hypothétiques d’une communication de crise<br />
Réussie.<br />
M.Cros<br />
S.Gaultier-Gaillard<br />
CR-11-17 Etude théorique <strong>et</strong> méthodologique sur le thème de la<br />
S.Kilic<br />
conciliation vie privée-vie professionnelle des salariés.<br />
CR-11-18 Regard épistémologique sur les sciences de gestion A.Le Flanchec<br />
CR-11-19 Implied distribution as a function of the volatility smile B.Tavin<br />
CR-11-20<br />
Financement de l’innovation, performance entrepreneuriale <strong>et</strong><br />
caractéristiques du capital-risque en Europe<br />
J.F Sattin
CR-11-21 <strong>Travail</strong> <strong>et</strong> <strong>violence</strong> <strong>domestique</strong> N.Wielhorski