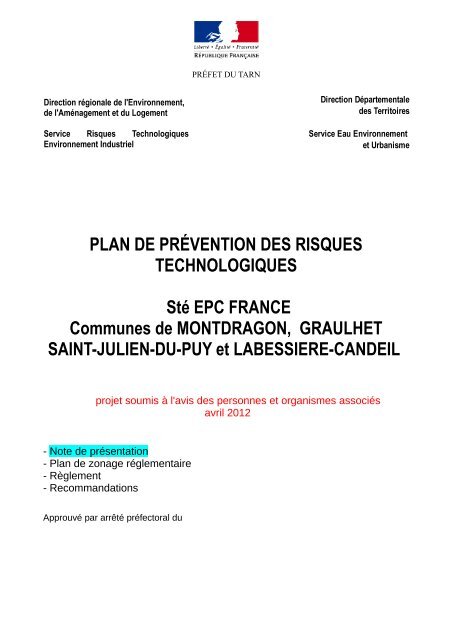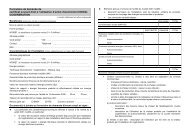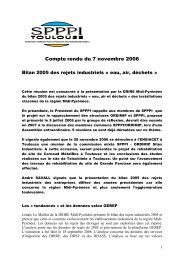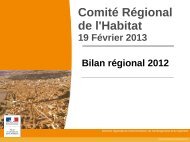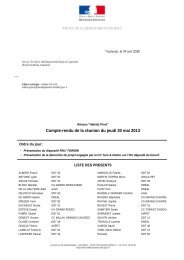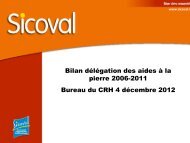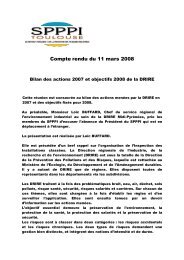Note de présentation POA - DREAL Midi-Pyrénées
Note de présentation POA - DREAL Midi-Pyrénées
Note de présentation POA - DREAL Midi-Pyrénées
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PRÉFET DU TARN<br />
Direction régionale <strong>de</strong> l'Environnement,<br />
<strong>de</strong> l'Aménagement et du Logement<br />
Service Risques Technologiques<br />
Environnement Industriel<br />
Direction Départementale<br />
<strong>de</strong>s Territoires<br />
Service Eau Environnement<br />
et Urbanisme<br />
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES<br />
TECHNOLOGIQUES<br />
Sté EPC FRANCE<br />
Communes <strong>de</strong> MONTDRAGON, GRAULHET<br />
SAINT-JULIEN-DU-PUY et LABESSIERE-CANDEIL<br />
projet soumis à l'avis <strong>de</strong>s personnes et organismes associés<br />
avril 2012<br />
- <strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation<br />
- Plan <strong>de</strong> zonage réglementaire<br />
- Règlement<br />
- Recommandations<br />
Approuvé par arrêté préfectoral du
SOMMAIRE<br />
I.INTRODUCTION.........................................................................................................................10<br />
II. PRÉSENTATION DU SITE .......................................................................................................11<br />
II.1 - La société EPC France .................................................................................................11<br />
II.2 - Le site <strong>de</strong> Montdragon....................................................................................................11<br />
II.2.1 - Implantation.............................................................................................................12<br />
II.2.2 - Activités....................................................................................................................13<br />
II.3 - Description <strong>de</strong>s potentiels <strong>de</strong> dangers du site.............................................................13<br />
III. ÉTAT ACTUEL DE LA GESTION DU RISQUE SUR LE TERRITOIRE....................................14<br />
III.1 - Conditions actuelles <strong>de</strong> la prévention <strong>de</strong>s risques sur le site...................................14<br />
III.1.1 - Principales mesures mises en œuvre sur le site pour réduire le risque à la<br />
source..................................................................................................................................14<br />
III.1.2 - Contrôles externes réalisés...................................................................................15<br />
III.2 - État actuel du risque technologique sur le territoire..................................................15<br />
IV. PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PPRT............................................................................15<br />
IV.1 - Raisons <strong>de</strong> la prescription du PPRT............................................................................15<br />
IV.2 - Rappel <strong>de</strong> la procédure.................................................................................................16<br />
IV.3 - Périmètre d’étu<strong>de</strong>..........................................................................................................16<br />
IV.4 - Périmètre d’exposition aux risques.............................................................................19<br />
IV.5 - Les acteurs associés ....................................................................................................19<br />
IV.6 - Le déroulement <strong>de</strong> la procédure d’élaboration et <strong>de</strong> concertation............................19<br />
V. PRÉSENTATION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX.............................................................20<br />
V.1 - Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers et analyse <strong>de</strong> risque.........................................................................20<br />
V.1.1 - L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers..................................................................................................20<br />
V.1.2 - L’analyse <strong>de</strong> risques...............................................................................................20<br />
V.2 - Description <strong>de</strong>s phénomènes dangereux.....................................................................21<br />
V.2.1 - Type d’effets.............................................................................................................21<br />
V.2.2 - Intensité <strong>de</strong>s effets..................................................................................................21<br />
V.2.3 - Probabilité d'occurrence.........................................................................................21<br />
V.2.4 - Cinétique..................................................................................................................22<br />
V.3 - Exhaustivité <strong>de</strong>s phénomènes dangereux décrits dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> danger...............23<br />
V.4 - Phénomènes dangereux listés dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers.............................................23<br />
V.5 -Sélection <strong>de</strong>s phénomènes dangereux..........................................................................24<br />
V.6 - Phénomènes dangereux retenus dans le cadre du PPRT...........................................24<br />
VI. CARACTÉRISATION DES ALÉAS ET DES ENJEUX.............................................................24<br />
VI.1 - Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> qualification <strong>de</strong> l’aléa...............................................................................24<br />
VI.2 - La <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s enjeux............................................................................................27<br />
VI.2.1 - Objectifs <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s enjeux.........................................................................27<br />
VI.2.2 - Méthodologie appliquée........................................................................................27<br />
VI.2.3 - Les enjeux incontournables..................................................................................27<br />
VI.2.3.1 - Qualification <strong>de</strong> l’urbanisation existante..........................................................................27<br />
VI.2.3.2 - Établissements recevant du public (ERP).......................................................................28<br />
VI.2.3.3 - Infrastructures <strong>de</strong> transports............................................................................................28<br />
VI.2.3.4 - Usages <strong>de</strong>s espaces publics ouverts..............................................................................29<br />
VI.2.3.5 - Ouvrages et équipements d'intérêt général.....................................................................29<br />
VI.2.4 - Les enjeux complémentaires................................................................................29<br />
VI.2.4.1 - Estimation globale <strong>de</strong> la population rési<strong>de</strong>nte.................................................................29<br />
VI.2.4.2 - Estimation globale <strong>de</strong>s emplois.......................................................................................30<br />
VI.2.5 - Les enjeux connexes.............................................................................................31<br />
VI.2.5.1 - Perspectives <strong>de</strong> développement......................................................................................31<br />
VI.2.5.2 - Enjeux économiques, environnementaux et patrimoniaux..............................................31<br />
VI.3 - Superposition <strong>de</strong>s aléas et <strong>de</strong>s enjeux........................................................................31<br />
VI.4 - Zonage brut....................................................................................................................33<br />
VII. LA STRATÉGIE DU PPRT......................................................................................................35<br />
VII.1 - Les principales orientations proposées ....................................................................35<br />
VII.1.1 - Encadrer l’urbanisation future ou l’évolution <strong>de</strong> l’urbanisation existante.......35<br />
VII.1.1.1 - La zone R ......................................................................................................................35<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 3
VII.1.1.2 - La zone r ........................................................................................................................ 35<br />
VII.1.1.3 - La zone B........................................................................................................................ 35<br />
VII.1.1.4 - La zone b........................................................................................................................ 35<br />
VII.1.2 - Agir sur l’existant par <strong>de</strong>s mesures foncières ....................................................35<br />
VII.1.3 - Mesures <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s populations..............................................................36<br />
VII.2 - Les choix retenus en fonction du contexte local.......................................................36<br />
VIII.BILAN DE LA CONCERTATION.............................................................................................37<br />
VIII.1 - Modalités <strong>de</strong> la concertation.......................................................................................37<br />
VIII.2 - Première réunion CLIC du 9 juillet 2009....................................................................37<br />
VIII.3 - Réunion d’association du 14 octobre 2009................................................................37<br />
VIII.4 - Deuxième réunion CLIC du 9 décembre 2010............................................................38<br />
VIII.5 - Troisième réunion CLIC et <strong>de</strong>uxième réunion d'association du 18 mai 2011..........38<br />
VIII.6 - Troisième réunion CLIC du .........................................................................................39<br />
VIII.7 - Avis <strong>de</strong>s personnes et organismes associés............................................................39<br />
VIII.8 - Prise en compte <strong>de</strong> la concertation ...........................................................................39<br />
VIII.9 - Enquête publique et avis du commissaire enquêteur...............................................39<br />
IX. LES PIÈCES RÉGLEMENTAIRES...........................................................................................40<br />
IX.1 - Le Plan <strong>de</strong> zonage réglementaire.................................................................................40<br />
IX.2 - Le Règlement.................................................................................................................40<br />
IX.3 - Les Recommandations..................................................................................................41<br />
FIGURES<br />
Figure 1 : Carte <strong>de</strong> localisation du site EPC France.................................................................13<br />
Figure 2 : Cartographie du périmètre d’étu<strong>de</strong>............................................................................18<br />
Figure 4 : Cartographie <strong>de</strong>s aléas surpression..........................................................................26<br />
Figure 5: Carte <strong>de</strong> superposition <strong>de</strong> l’aléa surpression et <strong>de</strong>s enjeux recensés....................32<br />
Figure 6: Plan <strong>de</strong> zonage brut.....................................................................................................35<br />
TABLEAUX<br />
Tableau 1 : Type d'effets possibles sur le site EPC France.............................................................21<br />
Tableau 2 : Valeurs <strong>de</strong> référence <strong>de</strong>s seuils d'effets <strong>de</strong>s phénomènes dangereux (Arrêté du 29<br />
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte <strong>de</strong> la probabilité d’occurrence, <strong>de</strong> la<br />
cinétique, <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s effets et <strong>de</strong> la gravité <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts potentiels dans<br />
les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s installations classées soumises à autorisation)......................................21<br />
Tableau 3 : Échelle <strong>de</strong> probabilité (Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à<br />
la prise en compte <strong>de</strong> la probabilité d’occurrence, <strong>de</strong> la cinétique, <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s effets et <strong>de</strong> la<br />
gravité <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts potentiels dans les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s installations<br />
classées soumises à autorisation)...................................................................................................22<br />
Tableau 4 : Phénomènes dangereux décrits dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers.............................................23<br />
Tableau 5 : Échelle <strong>de</strong>s niveau d'aléas (Gui<strong>de</strong> méthodologique sur “ Le plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s<br />
risques technologiques (PPRT) réalisé par le MEEDDM)..................................................................23<br />
Tableau 6 : tableau gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> correspondance entre les niveaux d'aléas et les principes <strong>de</strong> la<br />
règlementation...............................................................................................................................................33<br />
Tableau 7 : Grands principes du zonage réglementaire..........................................................................41<br />
4
ANNEXES<br />
Annexe 1 : arrêté préfectoral du 25 mai 2009 prescrivant le PPRT EPC France et arrêtés <strong>de</strong><br />
prorogation <strong>de</strong>s 8 décembre 2010 et ................<br />
Annexe 2 : arrêté préfectoral du 25 mai 2009 constituant le CLIC Nitrobickford et arrêté<br />
préfectoral du ..................... constituant la commission <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> site EPC France<br />
Annexe 3 – Principaux textes <strong>de</strong> référence<br />
- Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à<br />
la prévention <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts majeurs impliquant <strong>de</strong>s substances ou <strong>de</strong>s préparations<br />
dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la<br />
protection <strong>de</strong> l'environnement soumises à autorisation<br />
- Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte <strong>de</strong> la<br />
probabilité d'occurrence, <strong>de</strong> la cinétique, <strong>de</strong> l'intensité <strong>de</strong>s effets et <strong>de</strong> la gravité <strong>de</strong>s<br />
conséquences <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts potentiels dans les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s installations<br />
classées soumises à autorisation<br />
- Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s risques<br />
technologiques [aujourd'hui codifié dans le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'environnement aux articles R515-39<br />
et suivants]<br />
- Circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
dangers, à l'appréciation <strong>de</strong> la démarche <strong>de</strong> réduction du risque à la source et aux plans<br />
<strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en<br />
application <strong>de</strong> la loi du 30 juillet 2003 texte disponible à l’adresse suivante :<br />
http://www.ineris.fr/aida/q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.12386<br />
- Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28 décembre 2006 relative à la mise à disposition<br />
du gui<strong>de</strong> d'élaboration et <strong>de</strong> lecture <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers pour les établissements soumis<br />
à autorisation avec servitu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s fiches d'application <strong>de</strong>s textes réglementaires récents<br />
texte disponible à l'adresse suivante : http://aida.ineris.fr/textes/circulaires/text4549.htm<br />
- Gui<strong>de</strong> méthodologique « Le plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s risques technologiques (PPRT) »<br />
réalisé par le MEDAD (non fourni mais consultable sur le site internet du MEDDTL à<br />
l'adresse suivante :<br />
Texte disponible à l'adresse suivante : http://www.<strong>de</strong>veloppement-durable.gouv.fr/spip.php<br />
page=article&id_article=12775<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 5
Annexe 4 – Avis <strong>de</strong>s personnes et organismes associés :<br />
sera complété après la consultation <strong>de</strong>s personnes et organismes associés<br />
Annexe 5 – Références réglementaires relatives aux ai<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l'État concernant le<br />
financement <strong>de</strong>s prescriptions obligatoires<br />
Annexe 6 – Rapport et conclusions motivées du Commissaire enquêteur<br />
sera complété après l'enquête publique
ÉLÉMENTS DE TERMINOLOGIE<br />
Abréviations<br />
AS : Autorisation avec Servitu<strong>de</strong>s (article L 515-8 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Environnement)<br />
CLIC : Comité Local d’Information et <strong>de</strong> Concertation<br />
DICRIM : Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs<br />
DDT: Direction Départementale <strong>de</strong>s Territoires (ex DDEA)<br />
DDRM : Dossier Départemental <strong>de</strong>s Risques Majeurs<br />
DRIRE : Direction Régionale <strong>de</strong> l’Industrie, <strong>de</strong> la Recherche et <strong>de</strong> l’Environnement<br />
<strong>DREAL</strong> : Direction Régionale <strong>de</strong> l'environnement, <strong>de</strong> l'Aménagement et du Logement (ex DRIRE)<br />
INERIS : Institut National <strong>de</strong> l’Environnement Industriel et Risques<br />
MEDDTL : Ministère <strong>de</strong> l'Ecologie, du Développement durable, <strong>de</strong>s Transports et du Logement (a<br />
succédé au MEEDDM)<br />
PLU / POS : Plan Local d’Urbanisme / Plan d’Occupation <strong>de</strong>s Sols<br />
POI : Plan d’Opération Interne<br />
PPI : Plan Particulier d’Intervention<br />
PPRT : Plan <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques Technologiques<br />
Définitions<br />
Danger : cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (ammoniac, chlore, …), à<br />
un système technique (mise sous pression d’un gaz…), à une disposition (élévation d’une charge,<br />
…), à un organisme (microbes), etc., <strong>de</strong> nature à entraîner un dommage sur un “ élément<br />
vulnérable ” (sont ainsi rattachées à la notion <strong>de</strong> “ danger ” les notions d’inflammabilité ou<br />
d’explosivité, <strong>de</strong> toxicité, <strong>de</strong> caractère infectieux etc… inhérentes à un produit et celle d’énergie<br />
disponible (pneumatique ou potentielle) qui caractérisent le danger).<br />
Risque : le risque constitue une “ potentialité ”. Il ne se “ réalise ” qu’à travers “ l’événement<br />
acci<strong>de</strong>ntel ”, c’est à dire à travers la réunion et la réalisation d’un certain nombre <strong>de</strong> conditions et la<br />
conjonction d’un certain nombre <strong>de</strong> circonstances qui conduisent, d’abord, à l’apparition d’un (ou<br />
plusieurs) élément(s) initiateur(s) qui permettent, ensuite, le développement et la propagation <strong>de</strong><br />
phénomènes permettant au “ danger ” <strong>de</strong> s’exprimer, en donnant lieu d’abord à l’apparition d’effets<br />
et ensuite en portant atteinte à un (ou plusieurs) élément(s) vulnérable(s).<br />
Potentiel <strong>de</strong> danger (ou “ source <strong>de</strong> danger ” ou “ élément porteur <strong>de</strong> danger ”) : système<br />
comportant un (ou plusieurs) dangers.<br />
Ex : un stockage d’ammoniac est porteur du danger lié à la toxicité du produit contenu, un<br />
stockage <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong> inflammable est porteur du danger lié à l’inflammabilité du produit contenu…<br />
Phénomène dangereux : libération d’énergie ou <strong>de</strong> substances produisant <strong>de</strong>s effets, au sens <strong>de</strong><br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 7
l’arrêté du 29 septembre 2005, susceptible d’infliger un dommage à <strong>de</strong>s cibles sans préjuger <strong>de</strong><br />
l’existence <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières.<br />
Ex : dispersion d’un nuage toxique, incendie, explosion…<br />
Effets d’un phénomène dangereux : ce terme décrit les caractéristiques <strong>de</strong>s phénomènes<br />
physiques, chimiques… associés à un phénomène dangereux concerné : flux thermique,<br />
concentration toxique, surpression…<br />
Acci<strong>de</strong>nt : événement non désiré, tel qu’une émission <strong>de</strong> substance toxique, un incendie ou une<br />
explosion, résultant <strong>de</strong> développements incontrôlés survenus au cours <strong>de</strong> l’exploitation d’un<br />
établissement, entraînant <strong>de</strong>s conséquences/dommages vis à vis <strong>de</strong>s personnes, <strong>de</strong>s biens ou <strong>de</strong><br />
l’environnement et <strong>de</strong> l’entreprise en général. C’est la réalisation d’un phénomène dangereux,<br />
combinée à la présence <strong>de</strong> cibles vulnérables exposées aux effets <strong>de</strong> ce phénomène.<br />
Acci<strong>de</strong>nt Majeur : événement non désiré, tel qu’une émission <strong>de</strong> substance toxique, un incendie<br />
ou une explosion, résultant <strong>de</strong> développements incontrôlés survenus au cours <strong>de</strong> l’exploitation<br />
d’un établissement, entraînant, pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’environnement, <strong>de</strong>s conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou<br />
plusieurs substances ou préparations dangereuses.<br />
Aléa : probabilité qu’un phénomène acci<strong>de</strong>ntel produise en un point donné <strong>de</strong>s effets d’une<br />
intensité donnée, au cours d’une pério<strong>de</strong> déterminée. L’aléa est donc l’expression, pour un type<br />
d’acci<strong>de</strong>nt donné, du couple “ probabilité d’occurrence x intensité <strong>de</strong>s effets ”.<br />
Cinétique : vitesse d’enchaînement <strong>de</strong>s évènements constituant une séquence acci<strong>de</strong>ntelle, <strong>de</strong><br />
l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables.<br />
Probabilité d’occurrence : au sens <strong>de</strong> l’article L. 512-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement, la probabilité<br />
d’occurrence d’un acci<strong>de</strong>nt est assimilée à sa fréquence d’occurrence future estimée sur<br />
l’installation considérée. Elle est en général différente <strong>de</strong> la fréquence historique et peut s’écarter,<br />
pour une installation donnée, <strong>de</strong> la probabilité d’occurrence moyenne évaluée sur un ensemble<br />
d’installations similaires.<br />
Probabilité d’occurrence d’un phénomène dangereux : cette probabilité est obtenue par agrégation<br />
<strong>de</strong>s probabilités <strong>de</strong> ces scénarios conduisant à un même phénomène, ce qui correspond à la<br />
combinaison <strong>de</strong>s probabilités <strong>de</strong> ces scénarios selon <strong>de</strong>s règles logiques (ET/OU). Elle<br />
correspond à la probabilité d’avoir <strong>de</strong>s effets d’une intensité donnée (et non <strong>de</strong>s conséquences).<br />
Gravité : on distingue l’intensité <strong>de</strong>s effets d’un phénomène dangereux <strong>de</strong> la gravité <strong>de</strong>s<br />
conséquences découlant <strong>de</strong> l’exposition <strong>de</strong> cibles <strong>de</strong> vulnérabilités données à ces effets.<br />
La gravité <strong>de</strong>s conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts<br />
visés à l’article L. 511-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement, résulte <strong>de</strong> la combinaison en un point <strong>de</strong><br />
l’espace <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s effets d’un phénomène dangereux et <strong>de</strong> la vulnérabilité <strong>de</strong>s personnes<br />
potentiellement exposées.<br />
Intensité <strong>de</strong>s effets d’un phénomène dangereux : mesure physique <strong>de</strong> l’intensité du phénomène<br />
(thermique, toxique, surpression, projections). Les échelles d’évaluation <strong>de</strong> l’intensité se réfèrent à<br />
<strong>de</strong>s seuils d’effets moyens conventionnels sur <strong>de</strong>s types d’éléments vulnérables (ou cibles) tels<br />
que “ homme ”, “ structure ”. Elles sont définies, pour les installations classées, dans l’arrêté du 29<br />
septembre 2005. L’intensité ne tient pas compte <strong>de</strong> l’existence ou non <strong>de</strong> cibles exposées. Elle est<br />
cartographiée sous la forme <strong>de</strong> zones d’effets pour les différents seuils.<br />
Enjeux (ou éléments vulnérables) : éléments tels que les personnes, les biens ou les différentes<br />
composantes <strong>de</strong> l’environnement susceptibles, du fait <strong>de</strong> l’exposition au danger, <strong>de</strong> subir, en<br />
certaines circonstances, <strong>de</strong>s dommages. Le terme “ cible ” est parfois utilisé à la place d’élément<br />
vulnérable. Cette définition est à rapprocher <strong>de</strong> la notion “ d’intérêt à protéger ” <strong>de</strong> la législation sur<br />
les installations classées (art. L. 511-1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement).<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 8
Mesure (ou Barrière) <strong>de</strong> sécurité : ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnel<br />
nécessaires et suffisants pour assurer une fonction <strong>de</strong> sécurité en réduisant la probabilité<br />
d’occurrence et/ou les effets et conséquences d’un événement indésirable. Les principales actions<br />
sont : empêcher, éviter, détecter, contrôler, limiter.<br />
Mesure (ou Barrière) <strong>de</strong> prévention : mesures visant à prévenir un risque en réduisant la<br />
probabilité d’occurrence d’un phénomène dangereux.<br />
Ex : détecteur <strong>de</strong> niveau haut alertant ou stoppant tout remplissage avant son débor<strong>de</strong>ment<br />
Mesure (ou Barrière) <strong>de</strong> limitation : mesure visant à limiter les effets d’un phénomènes dangereux,<br />
sans en modifier la probabilité d’occurrence. Ceci peut être réaliser par <strong>de</strong>s mesures passives<br />
(Ex : murs coupe-feu, confinement d’une unité), automatiques (ex : fermeture <strong>de</strong> vannes asservie<br />
à une détection, ri<strong>de</strong>aux d’eau asservis à une détection) ou actives (plan d’urgence interne).<br />
Mesure (ou Barrière) <strong>de</strong> protection : mesure visant à limiter l’étendue ou/et la gravité <strong>de</strong>s<br />
conséquences d’un acci<strong>de</strong>nt sur les éléments vulnérables, sans modifier la probabilité<br />
d’occurrence du phénomène dangereux (Ex : maîtrise <strong>de</strong> l’urbanisation, plan <strong>de</strong> secours<br />
externe…)<br />
Efficacité (pour une barrière <strong>de</strong> sécurité) ou Capacité <strong>de</strong> réalisation : capacité à remplir la<br />
mission/fonction <strong>de</strong> sécurité qui lui est confiée pour une durée donnée et dans son contexte<br />
d’utilisation. En général, cette efficacité s’exprime en pourcentage d’accomplissement <strong>de</strong> la<br />
fonction définie. Ce pourcentage peut varier pendant la durée <strong>de</strong> sollicitation <strong>de</strong> la barrière <strong>de</strong><br />
sécurité. Cette efficacité est évaluée par rapport aux principes <strong>de</strong> dimensionnement adapté et <strong>de</strong><br />
résistance aux contraintes spécifiques.<br />
Performances <strong>de</strong>s barrières : l’évaluation <strong>de</strong> la performance se fait au travers <strong>de</strong> leur efficacité, <strong>de</strong><br />
leur temps <strong>de</strong> réponse et <strong>de</strong> leur niveau <strong>de</strong> confiance au regard <strong>de</strong> leur architecture.<br />
Effets dominos : action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un<br />
établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un<br />
établissement voisin, conduisant à une aggravation générale <strong>de</strong>s effets du premier phénomène.<br />
Périmètre d’étu<strong>de</strong> : courbe enveloppe <strong>de</strong>s zones soumises à <strong>de</strong>s effets liés à certains<br />
phénomènes dangereux dans laquelle est menée la démarche PPRT.<br />
Périmètre d’exposition aux risques : Périmètre réglementé par le PPRT.<br />
Terme source : Ensemble <strong>de</strong>s paramètres caractérisant l'évènement redouté à l'origine du<br />
phénomène dangereux.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 9
I. INTRODUCTION<br />
Le 21 septembre 2001, une explosion sur le site chimique d’AZF à Toulouse causait 30<br />
décès et <strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> blessés. Depuis cette catastrophe, <strong>de</strong> nombreuses dispositions ont été<br />
prises par le gouvernement afin <strong>de</strong> réduire le risque industriel en France.<br />
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention <strong>de</strong>s risques technologiques et naturels<br />
et à la réparation <strong>de</strong>s dommages apporte <strong>de</strong>s réponses à certaines carences <strong>de</strong>s lois existantes<br />
en matière <strong>de</strong> risque technologique (notamment en ce qui concerne les installations industrielles<br />
existantes) et naturel. En particulier, l’acci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Toulouse a montré combien les conséquences<br />
d’un acci<strong>de</strong>nt en zone urbanisée peuvent être dramatiques pour les populations. Celui-ci a été à<br />
l’origine <strong>de</strong> la réflexion qui a conduit à la rédaction du volet technologique <strong>de</strong> la loi.<br />
Pour résorber les situations où la proximité <strong>de</strong> zones urbanisées est susceptible d’aggraver<br />
fortement les conséquences d’acci<strong>de</strong>nts majeurs autour <strong>de</strong>s sites à risques, le chapitre II <strong>de</strong> la loi<br />
prévoit un nouvel outil <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong> l’urbanisation : le Plan <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques<br />
Technologiques (PPRT).<br />
Les PPRT ont pour objectif <strong>de</strong> mieux protéger les personnes installées à proximité <strong>de</strong> sites<br />
industriels SEVESO AS. Ils contiennent <strong>de</strong>s mesures qui ont <strong>de</strong>ux objectifs :<br />
- réduire les risques sur le site,<br />
- diminuer l’exposition <strong>de</strong>s riverains en agissant sur l’urbanisation présente et future.<br />
Les modalités d’application du PPRT sont définies dans le décret n°2005-1130 du 7 septembre<br />
2005 relatif au plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s risques technologiques aujourd’hui codifié sous les articles<br />
R515-39 et suivants du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement.<br />
L’établissement exploité à Montdragon par la société EPC France, classé Seveso seuil haut (AS),<br />
doit répondre à l’ensemble <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong>s textes réglementaires et fait donc l’objet du présent<br />
PPRT.<br />
La procédure officielle d’élaboration du PPRT pour le site EPC France à Montdragon a été lancée<br />
par l’arrêté préfectoral <strong>de</strong> prescription du 25 mai 2009.<br />
Cette prescription a également fait l'objet d'une réunion le 7 juillet 2009 au cours <strong>de</strong> laquelle un<br />
Comité Local d’Information et <strong>de</strong> Concertation (CLIC) a été installé. Le CLIC a pour mission <strong>de</strong><br />
créer un cadre d’échange et d’information entre ses différents représentants (Etat, exploitants,<br />
collectivités locales, associations, riverains). Depuis la parution du décret 2012-189 du 7 février<br />
2012, ce comité <strong>de</strong>vient, à compter du prochain renouvellement <strong>de</strong> ses membres, la Commission<br />
<strong>de</strong> Suivi <strong>de</strong> Site.<br />
La <strong>DREAL</strong> <strong>Midi</strong>-Pyrénées, en charge du projet, a instruit la caractérisation <strong>de</strong>s aléas<br />
technologiques sur la base <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s dangers fournie par EPC France. La société ARTELIA ,<br />
en lien avec la DDT du Tarn, a réalisé l’analyse <strong>de</strong>s enjeux, la superposition <strong>de</strong>s aléas et <strong>de</strong>s<br />
enjeux et le plan <strong>de</strong> zonage réglementaire, le règlement ayant été élaboré par la <strong>DREAL</strong> avec<br />
l'appui <strong>de</strong> la DDT du Tarn.<br />
Une première réunion d’association réunissant les différents acteurs associés s’est tenue le 14<br />
octobre 2009 pour présenter essentiellement l’état d’avancement <strong>de</strong> la séquence d’étu<strong>de</strong><br />
technique à savoir les différentes cartes relatives aux aléas, ainsi que le déroulement prévisible <strong>de</strong><br />
l'instruction du PPRT.<br />
Lors d'une secon<strong>de</strong> réunion le 18 mai 2011, les enjeux recensés dans le périmètre d'étu<strong>de</strong>s ont<br />
été présentés aux personnes et organismes associés. La stratégie du PPRT a été également<br />
présentée et arrêtée au cours <strong>de</strong> cette réunion.<br />
A compléter :<br />
Les différents documents du PPRT ont été présentés aux personnes et organismes associés lors<br />
<strong>de</strong> la consultation officielle prévue par les textes.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 10
Le CLIC a donné un avis favorable au projet <strong>de</strong> PPRT le jj/mm/aaaa.<br />
Lors <strong>de</strong> ces différentes réunions, les différents acteurs concernés ont été associés à la démarche<br />
et ont fait valoir leurs idées dans le respect <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s risques.<br />
Cette note <strong>de</strong> présentation vise notamment à expliquer et justifier la démarche du PPRT et son<br />
contenu. Elle accompagne le règlement, le plan <strong>de</strong> zonage réglementaire et les recommandations.<br />
II. PRÉSENTATION DU SITE<br />
II.1 - LA SOCIÉTÉ EPC FRANCE<br />
La société EPC France S.A.S., d’un capital <strong>de</strong> 1 232 000 euros, a été constituée par absorption, à<br />
la suite d'une transmission universelle <strong>de</strong> patrimoine, <strong>de</strong> la société SNC NitroBickford , qui en était<br />
<strong>de</strong>venue l'unique actionnaire. Cette réorganisation a entrainé la disparition <strong>de</strong> la personne morale<br />
<strong>de</strong> l'exploitant antérieur et a nécessité un changement d'exploitant.<br />
Ce changement d'exploitant a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Tarn en date du 17 février 2012<br />
qui a autorisé la succession <strong>de</strong> la société Nitrobickford par la société EPC France, au vu <strong>de</strong>s<br />
garanties techniques et financières présentées par cette <strong>de</strong>rnière, ainsqi que le prévoit la<br />
règlementation <strong>de</strong>s sites ICPE classés Seveso seuil haut (AS).<br />
La société EPC France, dont le siège social est à Saint Martin <strong>de</strong> Crau dans les Bouches-du-<br />
Rhône , est spécialisée dans la fabrication, le stockage et la distribution d’explosifs industriels et<br />
accessoires <strong>de</strong> tir. Elle commercialise les explosifs, accessoires <strong>de</strong> tir et <strong>de</strong> minage à travers un<br />
réseau <strong>de</strong> 12 dépôts régionaux <strong>de</strong> distribution en France, permettant d’assurer un service <strong>de</strong><br />
proximité à la clientèle <strong>de</strong>s carrières et <strong>de</strong>s opérateurs du domaine <strong>de</strong>s Travaux Publics.<br />
Elle dispose sur le territoire national <strong>de</strong> :<br />
• une usine <strong>de</strong> fabrication d'explosifs située à st Martin <strong>de</strong> Crau dans le 13,<br />
• 5 directions régionales<br />
• 12 dépôts régionaux d'explosifs représentant une capacité <strong>de</strong> stockage totale <strong>de</strong> 2000<br />
tonnes d'explosifs<br />
• 18 unités mobiles <strong>de</strong> fabrication d'explosifs permettant la fabrication directe <strong>de</strong>s<br />
explosifs sur le lieu d'emploi à partir <strong>de</strong> composés qui ne sont pas individuellement<br />
explosifs,<br />
• 60 camions <strong>de</strong> livraison<br />
avec environ 240 personnes employées.<br />
II.2 - LE SITE DE MONTDRAGON<br />
La société EPC France exploite un établissement <strong>de</strong> stockage d’explosifs civils sur la commune <strong>de</strong><br />
Montdragon dans le département du Tarn, dont la fonction principale est l’entreposage et la<br />
distribution <strong>de</strong> produits explosifs pour les chantiers utilisateurs (mines, carrières et chantiers <strong>de</strong><br />
travaux publics).<br />
Le dépôt d’explosifs a été mis en service en 1978, conformément aux dispositions <strong>de</strong> l’arrêté<br />
préfectoral d’exploiter du 9 août 1977, complété par plusieurs arrêtés dont le <strong>de</strong>rnier est daté du 3<br />
novembre 2005.<br />
Le site est un établissement AS, SEVESO seuil haut, du fait qu’il stocke plus <strong>de</strong> 10 tonnes <strong>de</strong><br />
produits explosifs.<br />
Un arrêté <strong>de</strong> changement d’exploitant du 17 février 2012 a autorisé son exploitation par la société<br />
EPC France SA , en succession <strong>de</strong> la société NITROBICKFORD . Cet arrêté a également sévérisé<br />
les prescriptions applicables à l'établissement.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 11
Le site, d’une superficie <strong>de</strong> 4 hectares, s’organise en <strong>de</strong>ux zones :<br />
• une zone constituant l’enceinte pyrotechnique comprenant :<br />
• trois dépôts d’explosifs d’une capacité maximale autorisée <strong>de</strong> 40 tonnes chacun,<br />
disposant d’un quai <strong>de</strong> chargement/ déchargement commun.<br />
Ces trois dépôts sont constitués par <strong>de</strong>s igloos. Leur construction est soumise à<br />
<strong>de</strong>s règles strictes en ce qui concerne leur résistance à la contrainte extérieure due<br />
à l’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> choc et à <strong>de</strong>s projections à vitesse élevée. De tels dépôts présentent un<br />
certain nombre d’avantages lié au fait que les éclats les plus contraignants sont<br />
piégés par la structure, et que l’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> choc est atténuée en particulier à l’arrière<br />
du dépôt. Ils constituent donc l’état <strong>de</strong> l’art en matière <strong>de</strong> stockage d’explosifs civils.<br />
Un merlon <strong>de</strong> terre constitué par le décaissement <strong>de</strong> la colline voisine est placé<br />
<strong>de</strong>vant la faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> chaque bâtiment. Il s’agit d’une élévation naturelle <strong>de</strong> terrain<br />
<strong>de</strong>stinée à servir d’écran. Son utilité est donc essentiellement d’arrêter les<br />
projections <strong>de</strong> fragments qui les atteignent.<br />
• un quatrième dépôt igloo <strong>de</strong>stiné au stockage <strong>de</strong>s détonateurs<br />
• un bâtiment constituant le local <strong>de</strong> dégroupage <strong>de</strong>s détonateurs. En effet,<br />
l'ouverture <strong>de</strong>s emballages agréés au transport est interdite dans les dépôts<br />
principaux. Les emballages <strong>de</strong> détonateurs ne peuvent être ouverts que dans un<br />
local ou le tonnage est beaucoup plus limité, cela afin <strong>de</strong> contenir les effets d'une<br />
éventuelle explosion à <strong>de</strong>s distances plus réduites.<br />
• une zone administrative regroupant les bureaux, un ancien bâtiment d'habitation converti<br />
en salle <strong>de</strong> réunion, les garages <strong>de</strong> camions et un local <strong>de</strong> stockage d’accessoires <strong>de</strong> tir,<br />
inertes.<br />
II.2.1 - IMPLANTATION<br />
La carte ci <strong>de</strong>ssous localise le site par rapport aux agglomérations voisines.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 12
Copyright IGN scan 1000<br />
II.2.2 - ACTIVITÉS<br />
Figure 1 : Carte <strong>de</strong> localisation du site EPC France<br />
L'activité exercée sur le site <strong>de</strong> Montdragon est essentiellement constituée par la logistique liée à<br />
la distribution <strong>de</strong>s produits explosifs vers les utilisateurs finaux que sont les carriers et les<br />
entreprises <strong>de</strong> TP spécialisées.<br />
Les produits sont reçus par camions gros porteurs, limités réglementairement à 16 tonnes <strong>de</strong><br />
produits explosifs par unité <strong>de</strong> transport, à raison d'un par semaine environ, compte tenu <strong>de</strong> la<br />
séparation exigée entre les détonateurs et les explosifs. Les produits sont mis en dépôts dans les<br />
quatre igloos, l'état <strong>de</strong>s stocks étant toujours vérifié avant la livraison pour prévoir<br />
l'approvisionnement <strong>de</strong>s dépôts sans craindre un dépassement <strong>de</strong>s quantités autorisées.<br />
Les comman<strong>de</strong>s passées par les utilisateurs finaux sont reçues au fil <strong>de</strong> l'eau, elles sont préparées<br />
chaque après midi par le magasinier et acheminées sur les lieux d'utilisation par camion agréé<br />
ADR qui partent <strong>de</strong> l'établissement tous les matins.<br />
EPC France fournit également <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> mise en œuvre directe par ses personnels <strong>de</strong>s<br />
explosifs sur les chantiers <strong>de</strong> carrières ou <strong>de</strong> TP qu'elle alimente.<br />
Une autre activité est implantée sur le site EPC, consistant en la gestion d'une base d'unité mobile<br />
<strong>de</strong> fabrication d'explosifs directement sur les lieux d'emploi, ce matériel présentant l'avantage <strong>de</strong><br />
ne fabriquer l'explosif qu'au moment du chargement dans les trous <strong>de</strong> mines et le transport ne<br />
concernant que <strong>de</strong>s produits comburants mais non explosifs.<br />
II.3 - DESCRIPTION DES POTENTIELS DE DANGERS DU SITE<br />
Le principal risque provenant <strong>de</strong> l’établissement EPC France est le risque d’explosion (effet <strong>de</strong><br />
surpression) lié à la présence <strong>de</strong>s explosifs.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 13
Les produits explosifs sont répartis suivant la nature <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> leur explosion, <strong>de</strong> leur<br />
combustion et/ou <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> sensibilité.<br />
Les produits stockés sur le site <strong>de</strong> Montdragon, <strong>de</strong> par leur composition, sont <strong>de</strong>s produits<br />
comportant essentiellement un danger d’explosion en masse, c’est-à-dire affectant <strong>de</strong> façon<br />
pratiquement instantanée la quasi-totalité du stockage. Certains produits, notamment en raison <strong>de</strong><br />
leurs conditions d’emballage, peuvent toutefois être considérés comme <strong>de</strong>s matières ne<br />
comportant qu’un danger mineur en cas <strong>de</strong> mise à feu ou d’amorçage.<br />
Les quantités maximales <strong>de</strong> produits pyrotechniques susceptibles d'être présentes sur le site sont<br />
<strong>de</strong> 3 fois 40 tonnes et 1025 kg <strong>de</strong> matière active pour les détonateurs soit environ 1 025 000<br />
détonateurs.<br />
III. ÉTAT ACTUEL DE LA GESTION DU RISQUE SUR LE<br />
TERRITOIRE<br />
Le risque technologique est constitué <strong>de</strong> trois composantes :<br />
- l’intensité <strong>de</strong>s phénomènes dangereux,<br />
- la probabilité d’occurrence <strong>de</strong> ces phénomènes dangereux,<br />
- la vulnérabilité <strong>de</strong>s enjeux pouvant être impactés par ces phénomènes dangereux.<br />
Gérer le risque technologique, c’est donc agir sur l’un <strong>de</strong> ces trois éléments avec, d’un point <strong>de</strong><br />
vue global, plusieurs niveaux d’intervention complémentaires :<br />
- La maîtrise du risque à la source, permettant d’atteindre, dans <strong>de</strong>s conditions<br />
économiquement acceptables, un niveau <strong>de</strong> risque aussi bas que possible, compte tenu <strong>de</strong><br />
l’état <strong>de</strong>s connaissances et <strong>de</strong>s pratiques ainsi que <strong>de</strong> la vulnérabilité <strong>de</strong> l’environnement <strong>de</strong><br />
l’installation.<br />
- La maîtrise <strong>de</strong> l’urbanisation, elle consiste à limiter les enjeux exposés au danger, à les<br />
rendre moins vulnérables, et à ne pas aggraver les effets <strong>de</strong> certains phénomènes dangereux.<br />
Elle vise à permettre un développement durable <strong>de</strong>s territoires, en assurant une sécurité<br />
maximale <strong>de</strong>s personnes.<br />
- La maîtrise <strong>de</strong>s secours a pour objectif, quand le phénomène se déclenche, d’être la plus<br />
efficace possible en terme <strong>de</strong> secours, d’évacuation <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong> gestion du<br />
phénomène, ce qui nécessite une préparation préalable.<br />
- L’information <strong>de</strong>s citoyens leur permet <strong>de</strong> prendre certaines décisions comportementales<br />
pour mieux réagir en cas <strong>de</strong> crise.<br />
III.1 - CONDITIONS ACTUELLES DE LA PRÉVENTION DES RISQUES SUR LE SITE<br />
III.1.1 - PRINCIPALES MESURES MISES EN ŒUVRE SUR LE SITE POUR RÉDUIRE LE<br />
RISQUE À LA SOURCE<br />
L’examen <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong> la société EPC France (la <strong>de</strong>rnière étu<strong>de</strong> date <strong>de</strong> octobre<br />
2005 avec une mise à jour en janvier 2008) a permis d'i<strong>de</strong>ntifier les installations ayant un potentiel<br />
<strong>de</strong> danger sur le site et les mesures <strong>de</strong> sécurité à mettre en place ou à renforcer par l'exploitant<br />
afin <strong>de</strong> diminuer le risque à la source.<br />
En matière <strong>de</strong> pyrotechnie, les mesures <strong>de</strong> réduction du risque à la source consistent<br />
essentiellement, une fois que les quantités stockées sont optimisées, à isoler au maximum ou<br />
organiser les dépôts et les ateliers <strong>de</strong> manière à ce que les zones <strong>de</strong> risques couvrent le minimum<br />
d'enjeux du territoire. Ainsi, une mesure très importante en matière <strong>de</strong> réduction du risque à la<br />
source consiste au découplage <strong>de</strong>s charges, c'est à dire à la non transmission <strong>de</strong> la détonation<br />
provenant d'un dépôt ou d'une installation aux autres dépôts ou installations présents dans<br />
l'établissement . Ainsi, une mesure récente a concerné le déplacement et la fiabilisation du quai <strong>de</strong><br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 14
chargement/déchargement, consécutivement à un changement <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s distances<br />
<strong>de</strong> découplage adopté au plan national. Ces mesures ont été intégrées à l'arrêté préfectoral <strong>de</strong><br />
changement d'exploitant du 17 février 2012.<br />
En ce qui concerne l'optimisation <strong>de</strong>s volumes <strong>de</strong> stockage, l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers justifie les volumes<br />
autorisés compte tenu <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> rotation <strong>de</strong>s produits et <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong> stock minimum en<br />
relation avec le nombre <strong>de</strong> références distinctes <strong>de</strong> produits.<br />
III.1.2 - CONTRÔLES EXTERNES RÉALISÉS<br />
L’usine fait l’objet d’un suivi régulier <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> l’inspection <strong>de</strong>s installations classées qui vérifie<br />
notamment que :<br />
• les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux réglementant les différentes activités<br />
sont bien mises en œuvre, notamment au travers <strong>de</strong> visites <strong>de</strong> contrôle réalisées au moins<br />
une fois par an,<br />
• l'établissement dispose d’un Plan d’Opération Interne à jour et opérationnel.<br />
Ce P.O.I., dont la mise en œuvre est <strong>de</strong> la responsabilité <strong>de</strong> l’exploitant <strong>de</strong> l’usine, doit permettre<br />
<strong>de</strong> gérer les situations pour lesquelles les effets liés à certains phénomènes dangereux ne sortent<br />
pas <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> l’établissement. Il est testé régulièrement, au moins une fois par an, par<br />
l’exploitant.<br />
III.2 - ÉTAT ACTUEL DU RISQUE TECHNOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE<br />
L’examen <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers par l’inspection <strong>de</strong>s installations classées donne lieu à un rapport<br />
portant à la connaissance <strong>de</strong>s services concernés les différentes zones d’effet liées aux<br />
phénomènes dangereux i<strong>de</strong>ntifiés présentant un risque pour les personnes situées à l’extérieur <strong>de</strong><br />
l’emprise foncière <strong>de</strong> l’établissement, ces éléments pouvant notamment être utilisés pour la<br />
maîtrise <strong>de</strong> l’urbanisation. Le <strong>de</strong>rnier rapport en vue du porté à connaissance <strong>de</strong>s maires<br />
concernés a été signé le 13 décembre 2002.<br />
Un plan <strong>de</strong> secours existe et est mis en œuvre par la Préfecture. Il s’agit du Plan Particulier<br />
d’Intervention (PPI). Le PPI du site <strong>de</strong> EPC France a été approuvé par arrêté préfectoral du 30<br />
décembre 2008, et prend en compte, dans son étendue géographique, l’enveloppe maximale <strong>de</strong>s<br />
phénomènes dangereux physiquement possibles même si leur probabilité d’occurrence est très<br />
faible. Il est régulièrement mis à jour et testé à minima tous les cinq ans, le <strong>de</strong>rnier exercice ayant<br />
été réalisé en fin d'année 2011.<br />
Enfin, l’information <strong>de</strong>s populations est régulièrement organisée par la distribution <strong>de</strong> plaquettes<br />
d’information dans la zone impactée par le PPI. Il faut également noter l’existence d’un Comité<br />
Local d’Information et <strong>de</strong> Concertation (CLIC) dénommé “ CLIC EPC France ” créé par arrêté<br />
préfectoral du 25 mai 2009, comité qui se verra substituer une Commission <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> site à<br />
compter <strong>de</strong> la prochaine date <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong> ses membres (cf annexe 2).<br />
IV. PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PPRT<br />
IV.1 - RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPRT<br />
Conformément à l’article L. 515-15 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Environnement, l'État doit élaborer et mettre en<br />
œuvre un Plan <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques Technologiques (PPRT) pour chaque établissement<br />
soumis à autorisation avec servitu<strong>de</strong>s (AS), susceptible d’engendrer <strong>de</strong>s phénomènes dangereux<br />
ayant <strong>de</strong>s effets à l’extérieur du site. Au vu <strong>de</strong>s éléments exposés précé<strong>de</strong>mment, un PPRT doit<br />
être élaboré autour <strong>de</strong> l’établissement <strong>de</strong> la société EPC France à Montdragon.<br />
Le PPRT, <strong>de</strong> par les mesures qu’il prescrit, tant sur l’existant que sur l’urbanisation à venir, doit<br />
permettre <strong>de</strong> garantir que les occupations et utilisations du sol pouvant être atteintes par les effets<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 15
<strong>de</strong> ces phénomènes dangereux soient compatibles avec le niveau d’aléa.<br />
Le PPRT vient compléter la mise en œuvre du volet “ maîtrise <strong>de</strong> l’urbanisation ” <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong><br />
prévention du risque autour <strong>de</strong>s sites industriels soumis à autorisation avec servitu<strong>de</strong>s et classés<br />
Seveso Seuil Haut. Il constitue un élément du dispositif d’ensemble fondé sur la maîtrise du risque<br />
à la source assurée en amont par la procédure installation classée et en intégrant en aval la<br />
mobilisation <strong>de</strong>s secours dans le cadre du plan particulier d’intervention (PPI).<br />
Le PPRT, une fois approuvé, vaut servitu<strong>de</strong>s d’utilité publique. Il est porté à la connaissance <strong>de</strong>s<br />
maires <strong>de</strong>s communes situées dans le périmètre du plan en application <strong>de</strong> l’article L. 121-2 du<br />
co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme et est annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-<br />
1 du même co<strong>de</strong>.<br />
En l’absence <strong>de</strong> Plan Local d'Urbanisme, le PPRT s’applique seul, sous réserve d’avoir fait l’objet<br />
<strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> publicité prévues au décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux Plans<br />
<strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques Technologiques, codifié <strong>de</strong>puis sa parution par les articles R. 515-39 à<br />
R. 515-50 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement.<br />
IV.2 - RAPPEL DE LA PROCÉDURE<br />
Les modalités d’élaboration du PPRT sont définies d'une part par les articles R. 515-39 à R. 515-<br />
50 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement ainsi que par un gui<strong>de</strong> méthodologique élaboré par le Ministère <strong>de</strong><br />
l’Ecologie, <strong>de</strong> l'Énergie, du Développement Durable et <strong>de</strong> la Mer (MEEDDM).<br />
Conformément à l’article R. 515-40 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement, l’élaboration du PPRT autour du<br />
site EPC France a été prescrite par arrêté préfectoral du 25 mai 2009.<br />
Le PPRT <strong>de</strong>vant être approuvé dans les 18 mois suivant l’intervention <strong>de</strong> l’arrêté préfectoral <strong>de</strong><br />
prescription, ce <strong>de</strong>rnier a déjà été prorogé par plusieurs arrêtés préfectoraux dont le <strong>de</strong>rnier date<br />
<strong>de</strong> 23 mars 2012 (cf annexe 1).<br />
L’ arrêté <strong>de</strong> prescription détermine :<br />
le périmètre d’étu<strong>de</strong> du plan,<br />
la nature <strong>de</strong>s risques pris en compte,<br />
les services instructeurs,<br />
la liste <strong>de</strong>s personnes et organismes associés.<br />
Durant toute la pério<strong>de</strong> d’élaboration du projet <strong>de</strong> plan, l’ensemble <strong>de</strong>s personnes concernées<br />
(exploitant, collectivités locales, État, association…) est informé et consulté via les modalités<br />
d’association et <strong>de</strong> concertation définies dans l’arrêté préfectoral <strong>de</strong> prescription.<br />
Le projet <strong>de</strong> plan, éventuellement modifié pour tenir compte <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> la concertation et <strong>de</strong>s<br />
avis émis par les organismes associés, est ensuite soumis à enquête publique.<br />
A l’issue <strong>de</strong> cette enquête, le plan éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral.<br />
IV.3 - PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE<br />
Le périmètre d’étu<strong>de</strong> du PPRT est défini par la courbe enveloppe <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong>s phénomènes<br />
dangereux décrits dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong> l’exploitant, après exclusion <strong>de</strong>s phénomènes<br />
dangereux dont la probabilité est rendue suffisamment faible par les mesures <strong>de</strong> prévention mises<br />
en œuvre ou prescrites aux exploitants <strong>de</strong>s installations classées à l’origine <strong>de</strong>s risques, en<br />
application <strong>de</strong>s critères nationaux définis par la circulaire du 3 octobre 2005. Il contient le futur<br />
périmètre d’exposition aux risques, c’est à dire le périmètre réglementé par le PPRT.<br />
Concernant le site EPC France, le phénomène dangereux donnant les zones d’effets les plus<br />
importantes est l’initiation du phénomène pyrotechnique <strong>de</strong>s dépôts d'objets pyrotechniques qui<br />
contiennent <strong>de</strong>s produits pouvant détoner, c'est-à-dire ceux classés en division <strong>de</strong> risque 1.1.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 16
Le périmètre d’étu<strong>de</strong> pris en compte pour la mise en place du PPRT autour du site EPC France a<br />
donc été défini par la courbe enveloppe <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> surpression issus <strong>de</strong>s dépôts igloo<br />
n° 1, 2 et 3, soit l’agrégation <strong>de</strong> plusieurs pseudo cercles d'un rayon <strong>de</strong> 1 505 mètres.<br />
D'une superficie d’environ 710 hectares, elle impacte le territoire <strong>de</strong>s communes <strong>de</strong> Montdragon,<br />
Labessière-Can<strong>de</strong>il et Saint-Julien-du-Puy pour l'essentiel, la commune <strong>de</strong> Graulhet n'étant<br />
concernée que par une zone <strong>de</strong> 60 ha environ.<br />
Le périmètre d'étu<strong>de</strong> est représenté sur la figure 2 en page suivante.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 17
Copyright IGN Scan 25<br />
Figure 2 : Cartographie du périmètre d’étu<strong>de</strong>
IV.4 - PÉRIMÈTRE D’EXPOSITION AUX RISQUES<br />
Dans le cas du PPRT EPC France, le périmètre d’exposition aux risques correspond à la zone<br />
enveloppe <strong>de</strong>s zones d'effet <strong>de</strong>s différents phénomènes dangereux que l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers a<br />
étudié.<br />
Il est représenté sur le plan <strong>de</strong> zonage réglementaire et correspond au périmètre réglementé par<br />
le PPRT.<br />
IV.5 - LES ACTEURS ASSOCIÉS<br />
La conduite du PPRT est menée avec les différents acteurs impliqués afin d’instaurer un climat <strong>de</strong><br />
concertation nécessaire à l’appropriation <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong>s choix qui fon<strong>de</strong>nt le projet <strong>de</strong> PPRT. Il<br />
est ainsi plus aisé d’aboutir à une vision commune <strong>de</strong> la démarche <strong>de</strong> prévention.<br />
Conformément à l’arrêté préfectoral du 25 mai 2009 prescrivant l’élaboration du PPRT, les<br />
personnes et organismes associés pour la mise en place du PPRT autour du site EPC France<br />
sont les représentants <strong>de</strong> :<br />
- la société exploitant les installations à l’origine du risque,<br />
- les maires <strong>de</strong>s commune <strong>de</strong> Montdragon, Labessière-Can<strong>de</strong>il, Saint-Julien-du-Puy<br />
et Graulhet<br />
- les représentants <strong>de</strong>s communautés <strong>de</strong> communes du Lautrécois et Tarn et Dadou<br />
- le Comité Local d’Information et <strong>de</strong> Concertation (CLIC) EPC France ,<br />
- le Conseil Général <strong>de</strong> la Tarn,<br />
IV.6 - LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION ET DE CONCERTATION<br />
Suite à la consultation <strong>de</strong>s communes sur les modalités <strong>de</strong> la concertation, l’arrêté préfectoral <strong>de</strong><br />
prescription a été signé le 25 mai 2009.<br />
Une première réunion du CLIC s’est tenue le 9 juillet 2009 au cours <strong>de</strong> laquelle la procédure<br />
d’élaboration du PPRT a été présentée.<br />
L'examen <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> dangers a permis la formalisation par la <strong>DREAL</strong> <strong>de</strong> la carte d'aléas et sa<br />
présentation, ainsi que <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> règlementation prévus par le gui<strong>de</strong> national, lors <strong>de</strong> la<br />
réunion d'association du 14 octobre 2009<br />
Les enjeux du territoire recensés par la DDT du Tarn ainsi que les éléments <strong>de</strong> stratégie proposés<br />
par la <strong>DREAL</strong> <strong>Midi</strong> Pyrénées ont été exposés aux membres associés lors <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième réunion<br />
d'association qui s'est tenue dans les locaux municipaux <strong>de</strong> Montdragon le 18 mai 2011.<br />
Au cours <strong>de</strong> cette réunion les mesures proposées pour la maîtrise <strong>de</strong> l'urbanisation existante et<br />
future ont été validées par les personnes et organismes associées.<br />
A compléter par:<br />
-consultation officielle <strong>de</strong>s personnes et organismes associés<br />
-avis du CLIC sur les projets <strong>de</strong> documents du PPRT,<br />
Tout au long <strong>de</strong> l'élaboration du PPRT, le public a pu émettre ses observations sur un registre<br />
prévu à cet effet ouvert en mairies <strong>de</strong> Montdragon, Labessière-Can<strong>de</strong>il, Saint-Julien-du-Puy et<br />
Graulhet ou par courrier adressé à la Préfecture <strong>de</strong> la Tarn.<br />
Observations recensées : ............................<br />
La concertation a donc pris fin le jj/mm/aaaa.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 19
V. PRÉSENTATION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX<br />
V.1 - ÉTUDE DE DANGERS ET ANALYSE DE RISQUE<br />
V.1.1 - L’ÉTUDE DE DANGERS<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers, réalisée par l’exploitant, sous sa responsabilité, constitue le point <strong>de</strong> départ<br />
<strong>de</strong> la maîtrise <strong>de</strong>s risques sur le site. Établie selon une méthodologie bien définie, elle doit<br />
permettre :<br />
• <strong>de</strong> dresser un état <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong>s phénomènes dangereux et acci<strong>de</strong>nts majeurs<br />
susceptibles <strong>de</strong> survenir sur le site,<br />
• établir le cas échéant un programme d’améliorations <strong>de</strong> la sécurité,<br />
• <strong>de</strong> justifier que, dans <strong>de</strong>s conditions économiquement acceptables, un niveau <strong>de</strong> risque<br />
aussi bas que possible est atteint, compte tenu <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>s connaissances et <strong>de</strong>s<br />
pratiques ainsi que <strong>de</strong> la vulnérabilité <strong>de</strong> l’environnement <strong>de</strong> l’installation.<br />
Cette évaluation du niveau <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s risques présenté par l’établissement se fait au moyen<br />
<strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s risques, en évaluant les mesures <strong>de</strong> sécurité mises en place par l’exploitant,<br />
ainsi que l’importance <strong>de</strong>s dispositifs et dispositions d’exploitation, techniques, humains ou<br />
organisationnels, qui concourent à cette maîtrise. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux<br />
phénomènes dangereux et acci<strong>de</strong>nts potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans<br />
justification préalable explicite.<br />
Elle porte sur l’ensemble <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fonctionnement envisageables pour les installations, y<br />
compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles<br />
d’affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, <strong>de</strong> manière d’autant plus approfondie<br />
que les risques et les dangers sont importants. Elle conduit l’exploitant <strong>de</strong>s installations à i<strong>de</strong>ntifier<br />
et hiérarchiser les points critiques en terme <strong>de</strong> sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi<br />
qu’au retour d’expérience <strong>de</strong> toute nature.<br />
Obligation est faite aux exploitants <strong>de</strong> réactualiser cette étu<strong>de</strong> à chaque modification notable <strong>de</strong>s<br />
installations, ou, à minima tous les 5 ans, en tenant compte du retour d’expérience et <strong>de</strong>s<br />
avancées techniques, afin d’avoir une approche dynamique <strong>de</strong> la gestion du risque.<br />
V.1.2 - L’ANALYSE DE RISQUES<br />
La société EPC France a primitivement élaboré l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> danger se rapportant à l’établissement<br />
<strong>de</strong> Montdragon en fin d’année 2005.<br />
Parallèlement, et conformément à l’arrêté préfectoral complémentaire du 19 juillet 2007, un<br />
complément à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> danger, mis à jour en <strong>de</strong>rnier lieu en janvier 2008, a été réalisé pour<br />
apporter les éléments nécessaires à l’élaboration du Plan <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques<br />
Technologiques.<br />
L’ étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> danger initiale <strong>de</strong> 2005 comporte une analyse <strong>de</strong> risques basée sur les règles décrites<br />
dans l’arrêté ministériel du 28 septembre 1980, qui définissait les règles <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong>s<br />
distances d’isolement relatives aux installations pyrotechniques. Aujourd’hui, ce texte est abrogé et<br />
remplacé par l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 qui a rendu compatible la réglementation<br />
spécifique <strong>de</strong>s établissements pyrotechniques avec les nouvelles dispositions du co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’environnement relatives à la maîtrise <strong>de</strong>s risques, notamment en termes <strong>de</strong> probabilité<br />
d’occurrence, <strong>de</strong> cinétique, d’intensité <strong>de</strong>s effets et <strong>de</strong> gravité <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts<br />
potentiels, découlant <strong>de</strong> la loi risques du 30 juillet 2003.<br />
20
Au regard <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> risques réalisée pour le site <strong>de</strong> Montdragon, la société EPC France :<br />
• n’a i<strong>de</strong>ntifié aucun phénomène dangereux pouvant conduire à <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts majeurs<br />
qu’elle juge inacceptable,<br />
• a établi une liste <strong>de</strong>s phénomènes dangereux qui, du fait <strong>de</strong> leur probabilité d’occurrence<br />
et <strong>de</strong> leur gravité, peuvent impacter <strong>de</strong>s tiers en <strong>de</strong>hors du site et doivent donc faire l’objet<br />
<strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong> l’urbanisation prévues dans le cadre du PPRT<br />
V.2 - DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX<br />
L’ensemble <strong>de</strong>s phénomènes dangereux susceptibles d’avoir <strong>de</strong>s effets à l’extérieur du site sont<br />
étudiés dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers.<br />
Pour chacun <strong>de</strong>s phénomènes dangereux, leur probabilité d’occurrence, leur cinétique et<br />
l’intensité <strong>de</strong> leurs effets doivent être caractérisés. Cette évaluation est faite selon les éléments<br />
définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte<br />
<strong>de</strong> la probabilité d’occurrence, <strong>de</strong> la cinétique, <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s effets et <strong>de</strong> la gravité <strong>de</strong>s<br />
conséquences <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts potentiels dans les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s installations classées<br />
soumises à autorisation.<br />
V.2.1 - TYPE D’EFFETS<br />
Au vu <strong>de</strong>s potentiels <strong>de</strong> dangers présents sur le site, les principaux effets attendus pour les<br />
phénomènes dangereux du site sont repris dans le tableau suivant :<br />
Phénomènes<br />
dangereux<br />
Leurs effets<br />
Leurs conséquences sur les personnes<br />
Explosion Création d’une on<strong>de</strong> <strong>de</strong> choc Lésions internes aux poumons et tympans<br />
Brûlures éventuelles<br />
Voire effets mortels en cas d’effondrement <strong>de</strong>s<br />
structures porteuses ou projection du corps<br />
V.2.2 - INTENSITÉ DES EFFETS<br />
Tableau 1 : Type d'effets possibles sur le site EPC France<br />
L’intensité <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong>s phénomènes dangereux est définie par rapport à <strong>de</strong>s valeurs <strong>de</strong><br />
référence exprimées sous formes <strong>de</strong> seuils toxiques, <strong>de</strong> surpression, thermiques, pour les<br />
hommes et les structures.<br />
Les valeurs <strong>de</strong> référence <strong>de</strong>s seuils d’effets pour les effets sur l’homme sont les suivantes :<br />
Conséquences sur<br />
l’homme<br />
Seuils d’effets <strong>de</strong><br />
surpression<br />
Zone <strong>de</strong> dangers très<br />
graves (effets létaux<br />
significatifs)<br />
Zones <strong>de</strong> dangers<br />
graves (effets létaux)<br />
Zones <strong>de</strong> dangers<br />
significatifs (effets<br />
irréversibles sur la<br />
vie humaine)<br />
Zone <strong>de</strong>s effets<br />
indirects (par bris <strong>de</strong><br />
vitre)<br />
200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar<br />
Tableau 2 : Valeurs <strong>de</strong> référence <strong>de</strong>s seuils d'effets <strong>de</strong>s phénomènes dangereux (Arrêté du 29<br />
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte <strong>de</strong> la probabilité d’occurrence, <strong>de</strong> la<br />
cinétique, <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s effets et <strong>de</strong> la gravité <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts potentiels dans<br />
les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s installations classées soumises à autorisation)<br />
Des valeurs <strong>de</strong> référence <strong>de</strong>s seuils d’effets <strong>de</strong> surpression et thermiques ont également été<br />
définies pour les effets sur les structures dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.<br />
V.2.3 - PROBABILITÉ D'OCCURRENCE<br />
L’estimation <strong>de</strong> la probabilité d’occurrence <strong>de</strong>s phénomènes dangereux est, du fait <strong>de</strong> leur rareté,<br />
délicate. Elle peut s’effectuer selon une approche qualitative, semi-quantitative ou purement<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 21
quantitative.<br />
Afin d’homogénéiser les résultats obtenus, selon la métho<strong>de</strong> employée, l’arrêté ministériel du 29<br />
septembre 2005 définit 5 classes <strong>de</strong> probabilité croissante allant <strong>de</strong> E à A.<br />
La correspondance entre la classe <strong>de</strong> probabilité et le résultat obtenu en fonction <strong>de</strong> l’approche<br />
employée est explicite dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssous. Ce <strong>de</strong>rnier doit être lu <strong>de</strong> la manière suivante :<br />
selon la métho<strong>de</strong> qualitative, la classe E est attribuée au phénomène dangereux possible mais<br />
extrêmement peu probable. Ce qui quantitativement, correspond à un phénomène dangereux<br />
ayant une fréquence d’occurrence d’au plus 10 -5 , soit 1 fois tous les 100.000 ans ou 1 événement<br />
pour 100.000 installations.<br />
La métho<strong>de</strong> retenue par la société EPC France est la métho<strong>de</strong> quantitative, en référence à une<br />
circulaire qui précise, au vu du riche retour d'expérience <strong>de</strong> la pyrotechnie, les probabilités à<br />
retenir pour chacune <strong>de</strong>s activités exercées. Tous les phénomènes dangereux étudiés ont une<br />
probabilité <strong>de</strong> classe D.<br />
Classe <strong>de</strong><br />
probabilité<br />
Type<br />
d’appréciation<br />
Qualitative<br />
(les définitions<br />
entre guillemets<br />
ne sont valables<br />
que si le nombre<br />
d’installations et<br />
le retour<br />
d’expérience<br />
sont suffisants)<br />
Semi<br />
Quantitative<br />
Quantitative<br />
(par unité et par<br />
an)<br />
E D C B A<br />
“ événement<br />
possible mais<br />
extrêmement peu<br />
probable ” :<br />
n’est pas<br />
impossible au vu<br />
<strong>de</strong>s<br />
connaissances<br />
actuelles, mais<br />
non rencontré au<br />
niveau mondial<br />
sur un très grand<br />
nombre d’années<br />
installations<br />
“ événement très<br />
improbable ” :<br />
s’est déjà produit<br />
dans ce secteur<br />
d’activité mais a<br />
fait l’objet <strong>de</strong><br />
mesures<br />
correctives<br />
réduisant<br />
significativement<br />
sa probabilité<br />
“ événement<br />
improbable ” :<br />
un événement<br />
similaire déjà<br />
rencontré dans le<br />
secteur d’activité<br />
ou dans ce type<br />
d’organisation au<br />
niveau mondial,<br />
sans que les<br />
éventuelles<br />
corrections<br />
intervenues<br />
apportent une<br />
garantie <strong>de</strong><br />
réduction<br />
significative <strong>de</strong><br />
sa probabilité<br />
“ événement<br />
probable ” :<br />
s’est produit et /<br />
ou peut se<br />
produire pendant<br />
la durée <strong>de</strong> vie<br />
<strong>de</strong> l’installation<br />
“ événement<br />
courant ” :<br />
s’est produit et /<br />
ou peut se<br />
produire à<br />
plusieurs<br />
reprises pendant<br />
la durée <strong>de</strong> vie<br />
<strong>de</strong> l’installation,<br />
malgré<br />
d’éventuelles<br />
mesures<br />
correctives<br />
Cette échelle intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet <strong>de</strong> tenir<br />
compte <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s risques mises en place, conformément à l’article 4 <strong>de</strong><br />
l’arrêté du 29 septembre 2005<br />
10 -5 10 -4<br />
10 -3<br />
10 -2<br />
Tableau 3 : Échelle <strong>de</strong> probabilité (Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la<br />
prise en compte <strong>de</strong> la probabilité d’occurrence, <strong>de</strong> la cinétique, <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s effets et <strong>de</strong> la<br />
gravité <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts potentiels dans les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s installations<br />
classées soumises à autorisation).<br />
V.2.4 - CINÉTIQUE<br />
L’évaluation <strong>de</strong> la cinétique d’évolution <strong>de</strong>s phénomènes dangereux et <strong>de</strong> propagation <strong>de</strong> leurs<br />
effets tient compte <strong>de</strong> la cinétique <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> sécurité, afin <strong>de</strong> permettre la<br />
planification et le choix <strong>de</strong>s éventuelles mesures à prendre à l’extérieur du site.<br />
22
Une cinétique est qualifiée <strong>de</strong> lente si elle permet la mise en œuvre <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> sécurités<br />
suffisantes pour protéger les populations avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du<br />
phénomène dangereux.<br />
L'exploitant a i<strong>de</strong>ntifié dans son étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s phénomènes dangereux uniquement à<br />
cinétique rapi<strong>de</strong>.<br />
V.3 - EXHAUSTIVITÉ DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX DÉCRITS DANS L'ÉTUDE DE DANGER<br />
La société EPC France a transmis, conformément à l’arrêté préfectoral complémentaire du 19<br />
juillet 2007, un complément d' étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers pour permettre à l’inspection <strong>de</strong>s installations<br />
classées <strong>de</strong> réaliser la carte <strong>de</strong>s aléas.<br />
Après analyse, compléments et corrections, cette étu<strong>de</strong> a été jugée conforme aux exigences<br />
réglementaires concernant les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s installations soumises à autorisation avec<br />
servitu<strong>de</strong>s, installation Seveso Seuil Haut.<br />
V.4 - PHÉNOMÈNES DANGEREUX LISTÉS DANS L’ÉTUDE DE DANGERS<br />
Le Tableau 4 ci <strong>de</strong>ssous liste l’ensemble <strong>de</strong>s phénomènes dangereux étudiés par la société EPC<br />
France dans son étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers.<br />
Installations<br />
Quantité<br />
d'explosifs<br />
Classe<br />
probabilité<br />
Type<br />
d'effet<br />
Rayon <strong>de</strong>s<br />
effets létaux<br />
significatifs<br />
en m (1)<br />
Rayon <strong>de</strong>s<br />
premiers<br />
effets<br />
létaux (1)<br />
Rayon <strong>de</strong>s<br />
effets<br />
irréversibles<br />
(1)<br />
Rayon <strong>de</strong>s effets<br />
bris <strong>de</strong> vitres<br />
Igloo n°1 40 000 kg D Surpression 274 513 753 1505<br />
Igloo n°2 40 000 kg D Surpression 274 513 753 1505<br />
Igloo n°3 40 000 kg D Surpression 274 513 753 1505<br />
Véhicule <strong>de</strong><br />
transport<br />
Dépôt 4 <strong>de</strong><br />
détonateurs<br />
16 000 kg D Surpression 202 378 554 1109<br />
1000 kg D Surpression 80 150 220 440<br />
Palette 1000 kg D Surpression 80 150 200 440<br />
Dépôt 5 25 kg C Surpression 23 44 64 129<br />
Sac ou carton 25 kg D Surpression 23 44 64 129<br />
(1) Probabilité, intensités, et cinétique ont été évaluées au sens <strong>de</strong> l'arrêté ministériel du 29 septembre<br />
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte <strong>de</strong> la probabilité d'occurrence, <strong>de</strong> la cinétique et <strong>de</strong> la<br />
gravité <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts potentiels dans les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dangers <strong>de</strong>s installations classées<br />
soumises à autorisation<br />
Tableau 4 : Phénomènes dangereux décrits dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 23
V.5 -SÉLECTION DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX<br />
A partir <strong>de</strong>s phénomènes dangereux issus <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s dangers, il s’agit <strong>de</strong> sélectionner les<br />
phénomènes dangereux pertinents pour réaliser l’analyse et la carte <strong>de</strong>s aléas du PPRT.<br />
Les phénomènes dangereux dont la probabilité est rendue suffisamment faible peuvent être exclus<br />
du champ PPRT, sous certaines conditions relatives aux mesures <strong>de</strong> sécurité. En revanche, ces<br />
phénomènes dangereux sont toujours pris en compte dans l’élaboration <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> secours.<br />
Dans le cas d’espèces, aucun phénomène dangereux étudié par l’exploitant dans son étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
dangers n’a une classe <strong>de</strong> probabilité E, au sens <strong>de</strong> l’arrêté du 29 septembre 2005, et donc aucun<br />
phénomène ne peut être exclu pour réaliser le PPRT.<br />
V.6 - PHÉNOMÈNES DANGEREUX RETENUS DANS LE CADRE DU PPRT<br />
Les phénomènes dangereux retenus pour l’élaboration <strong>de</strong> la carte d’aléas sont les phénomènes<br />
dangereux dont les conséquences sortent <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> propriété et qui ne sont pas exclus du<br />
champ du PPRT.<br />
Tous les phénomènes dangereux modélisés par l'exploitant ayant <strong>de</strong>s conséquences potentielles à<br />
l'extérieur du site listés dans le tableau 4 ci -<strong>de</strong>ssus sont donc retenus pour l'élaboration du PPRT.<br />
VI. CARACTÉRISATION DES ALÉAS ET DES ENJEUX<br />
En leur qualité <strong>de</strong> services déconcentrés <strong>de</strong> l'État, au vu <strong>de</strong> leurs domaines <strong>de</strong> compétences<br />
respectifs, et conformément à la circulaire du 27 juillet 2005, la <strong>DREAL</strong> <strong>Midi</strong>-Pyrénées et la<br />
Direction Départementale <strong>de</strong>s Territoires (DDT) du Tarn sont chargées <strong>de</strong> l’élaboration du<br />
PPRT sous l’autorité du Préfet <strong>de</strong> la Tarn.<br />
VI.1 - LE MODE DE QUALIFICATION DE L’ALÉA<br />
L’aléa technologique est une composante du risque industriel. Il désigne la probabilité qu’un<br />
phénomène dangereux produise, en un point donné du territoire, <strong>de</strong>s effets d’une intensité<br />
physique définie.<br />
La détermination <strong>de</strong>s aléas, faite à partir <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers réalisée par l’exploitant, est<br />
effectué par l’inspection <strong>de</strong>s installations classées (<strong>DREAL</strong>) qui doit dans un premier temps<br />
sélectionner les phénomènes dangereux retenus pour le PPRT.<br />
L’i<strong>de</strong>ntification d’un niveau d’aléa consiste à attribuer, en chaque point inclus dans le périmètre<br />
d’exposition aux risques, un <strong>de</strong>s 7 niveaux d’aléas définis ci-après pour chaque type d’effet, à<br />
partir du niveau d’intensité <strong>de</strong>s effets attendus en ce point et du cumul <strong>de</strong>s probabilités<br />
d’occurrence.<br />
Les sept niveaux d’aléa sont ainsi définis : Très Fort plus (TF + ), Très Fort (TF), Fort plus (F + ), Fort<br />
(F), Moyen plus (M + ), Moyen (M), Faible (Fai). Les classes <strong>de</strong> probabilités sont celles reprises<br />
dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.<br />
24
Niveau maximal<br />
d’intensité <strong>de</strong> l’effet<br />
toxique, thermique ou<br />
surpression sur les<br />
personnes en un point<br />
donné<br />
Cumul <strong>de</strong>s classes <strong>de</strong><br />
probabilités<br />
d’occurrence <strong>de</strong>s<br />
phénomènes<br />
dangereux en un point<br />
donné<br />
Très Grave Grave Significatif<br />
Indirect par<br />
bris <strong>de</strong> vitre<br />
(uniquement<br />
pour effet <strong>de</strong><br />
suppression)<br />
> D 5E à D < 5E > D 5E à D < 5E > D 5E à D < 5E Tous<br />
Niveau d’aléa TF + TF F + F M + M Fai<br />
Tableau 5 : Échelle <strong>de</strong>s niveau d'aléas (Gui<strong>de</strong> méthodologique sur “ Le plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s<br />
risques technologiques (PPRT) réalisé par le MEEDDM)<br />
Ainsi, l’attribution d’un niveau d’aléa Très Fort ‘plus’ (TF + ) à un point donné du périmètre<br />
d’exposition aux risques signifie que ce point est soumis potentiellement à un effet dont les<br />
conséquences sur la vie humaine sont jugées très graves et dont le cumul <strong>de</strong>s classes <strong>de</strong><br />
probabilité d’occurrence <strong>de</strong>s phénomènes dangereux conduisant à cet effet et à ce niveau<br />
d’intensité est strictement supérieur à D (évènement très improbable).<br />
Pour l’établissement EPC France, le travail réalisé à partir <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers a permis à<br />
l’inspection <strong>de</strong>s installations classées d’établir la liste <strong>de</strong>s phénomènes dangereux à prendre en<br />
compte pour la réalisation <strong>de</strong> la cartographie (cf. § V.4, Tableau 4).<br />
A partir <strong>de</strong> ces données, les cartographies <strong>de</strong>s aléas mise en forme avec le logiciel SIGALEA<br />
développé par l’INERIS pour le compte du MEDDTL figure en page suivante. Ces cartographies<br />
font apparaître le zonage construit par nature d’effet en fonction <strong>de</strong> l’intensité et <strong>de</strong> la probabilité<br />
<strong>de</strong>s phénomènes dangereux pouvant impacter un point donné.<br />
La cartographie <strong>de</strong>s aléas exposée à la page suivante représente les différents niveaux d’aléas<br />
en tout point du périmètre d’exposition aux risques engendrés par un effet <strong>de</strong> surpression.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 25
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation<br />
Figure 4 : Cartographie <strong>de</strong>s aléas surpression
VI.2 - LA DESCRIPTION DES ENJEUX<br />
VI.2.1 - OBJECTIFS DE L’ANALYSE DES ENJEUX<br />
L’analyse <strong>de</strong>s enjeux :<br />
• i<strong>de</strong>ntifie les éléments d’occupation du sol qui feront potentiellement l’objet d’une<br />
réglementation,<br />
• constitue le socle <strong>de</strong> connaissance à partir duquel pourra être réalisé, si nécessaire, un<br />
programme d'investigations complémentaires.<br />
VI.2.2 - MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE<br />
L’inventaire et la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s enjeux situés dans le périmètre d’étu<strong>de</strong> du PPRT <strong>de</strong> la société<br />
EPC implantée sur la commune <strong>de</strong> Montdragon dans le Tarn. Le périmètre d’étu<strong>de</strong> est situé sur<br />
les communes <strong>de</strong> Montdragon, Labessière-Can<strong>de</strong>il, Graulhet et Saint-Julien-du-Puy.<br />
Les enjeux recensés correspon<strong>de</strong>nt aux personnes, aux activités, aux biens, aux éléments <strong>de</strong><br />
patrimoine environnementaux ou culturels.<br />
Trois niveaux d’analyse sont distingués :<br />
− les éléments incontournables :<br />
∗ urbanisation existante ;<br />
∗ principaux établissements recevant du public (ERP) ;<br />
∗ infrastructures <strong>de</strong> transport ;<br />
∗ usages <strong>de</strong>s espaces publics ouverts ;<br />
∗ ouvrages et équipements d’intérêt général ;<br />
− les éléments complémentaires :<br />
−<br />
∗ estimation globale <strong>de</strong>s populations rési<strong>de</strong>ntes ;<br />
∗ estimation globale <strong>de</strong>s emplois ;<br />
les éléments connexes disponibles pouvant apporter une connaissance générale du<br />
territoire :<br />
∗ perspectives <strong>de</strong> développement contenues dans les documents d’urbanisme ;<br />
∗<br />
enjeux économiques, environnementaux et patrimoniaux particuliers.<br />
VI.2.3 - LES ENJEUX INCONTOURNABLES<br />
L’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> ces enjeux a donné lieu à la carte <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s enjeux présentée ciaprès.<br />
VI.2.3.1 - Qualification <strong>de</strong> l’urbanisation existante<br />
Les informations sur les enjeux liés à l’urbanisation existante ont été renseignées<br />
essentiellement sur la base <strong>de</strong>s informations fournies par la Direction Départementale <strong>de</strong>s<br />
Territoires du Tarn.<br />
• Habitat<br />
Le périmètre d’étu<strong>de</strong> est situé dans une zone à caractère rural composée <strong>de</strong> quelques<br />
hameaux d’habitats diffus et d’un groupement d’habitats individuels au Sud sur la<br />
commune <strong>de</strong> Saint-Julien-du-Puy.<br />
• Activités<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 27
Le périmètre d’étu<strong>de</strong> est occupé par six entreprises dont EPC au centre et<br />
l’Etablissement Public Départemental TRYFIL à l’Ouest.<br />
Il existe notamment quelques exploitations agricoles ainsi qu’une carrière MALET en fin<br />
d’exploitation (au Nord-Ouest du périmètre d’étu<strong>de</strong>).<br />
• Equipements<br />
Il n’y a pas d’équipement particulier répertorié sur le périmètre d’étu<strong>de</strong>.<br />
VI.2.3.2 - Établissements recevant du public (ERP)<br />
Aucun établissement recevant du public n’a été référencé dans le périmètre d’étu<strong>de</strong>.<br />
VI.2.3.3 - Infrastructures <strong>de</strong> transports<br />
L'objectif est d'i<strong>de</strong>ntifier les infrastructures <strong>de</strong> transports sous une triple approche :<br />
• l'exposition aux risques <strong>de</strong>s personnes qui empruntent ces infrastructures ;<br />
• la possibilité d'utiliser ces infrastructures pour acheminer les secours et pour évacuer les<br />
populations exposées ;<br />
• leurs liens avec les installations à l'origine du PPRT.<br />
• Infrastructures routières<br />
Les infrastructures routières traversant le périmètre d’étu<strong>de</strong> sont peu nombreuses. Les<br />
données suivantes sont fournies par le Conseil Général du Tarn :<br />
− la RD 631, traversant le périmètre d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> part en part (axe Ouest /<br />
Est) ; le trafic est <strong>de</strong> 4172 véhicules/jour, dont 320 <strong>de</strong> poids lourds (relevé<br />
<strong>de</strong> comptages permanents effectué en 2010);<br />
−<br />
les voiries <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte locale.<br />
• Infrastructures ferroviaires<br />
Il n’y a pas d’infrastructure ferroviaire dans le périmètre d’étu<strong>de</strong>.<br />
• Infrastructures hydrauliques<br />
Il n’y a pas d’infrastructure hydraulique <strong>de</strong> transport dans le périmètre d’étu<strong>de</strong>.<br />
• Itinéraires <strong>de</strong> Transport <strong>de</strong> Marchandises Dangereuses<br />
Les Transports <strong>de</strong> Matières Dangereuses (TMD) liés à l’activité du site EPC empruntent<br />
les routes <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte locale ainsi que la RD 631.<br />
Le flux annuel d’approvisionnement du site est <strong>de</strong> 93 camions. Ces transports sont<br />
répartis <strong>de</strong> la façon suivante :<br />
− 15 approvisionnements en explosifs en provenance <strong>de</strong> l'usine ORICA<br />
situé en Allemagne (Dynamite) ;<br />
−<br />
66 approvisionnements en explosifs en provenance <strong>de</strong> l'usine<br />
NITROCHIMIE <strong>de</strong> ST MARTIN DE CRAU (gels et émulsions) ;<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 28
−<br />
12 approvisionnements en détonateurs et cor<strong>de</strong>au en provenance <strong>de</strong><br />
l'usine Davey Bickford d’HERY.<br />
− Pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> sécurité, EPC ne communique pas le flux <strong>de</strong> transport au<br />
départ du site.<br />
• Itinéraires <strong>de</strong> bus<br />
Il n’y a pas d’itinéraire <strong>de</strong> bus traversant le périmètre d’étu<strong>de</strong>.<br />
VI.2.3.4 - Usages <strong>de</strong>s espaces publics ouverts<br />
−<br />
L'objectif est <strong>de</strong> localiser les espaces publics ouverts utilisés <strong>de</strong> façon temporaire ou<br />
permanente et susceptibles <strong>de</strong> rassembler un nombre important <strong>de</strong> personnes.<br />
Espaces à usage permanent<br />
Les accès aux sites EPC sont fermés par <strong>de</strong>s clôtures et portails d’entrée.<br />
Les parkings <strong>de</strong>s autres activités sont privés mais restent ouverts au public.<br />
Espaces à usage périodique ou occasionnel<br />
Aucun espace public ouvert à usage périodique ou occasionnel n’est répertorié sur le périmètre<br />
d’étu<strong>de</strong>.<br />
VI.2.3.5 - Ouvrages et équipements d'intérêt général<br />
Des lignes électriques et téléphoniques assurent la <strong>de</strong>sserte locale en énergie.<br />
Il existe plusieurs activités constituant <strong>de</strong>s équipements d’intérêt général sur le périmètre<br />
d’étu<strong>de</strong> :<br />
− L’Etablissement Public Départemental TRYFIL, à l’Ouest, qui traite et valorise<br />
<strong>de</strong>s déchets ménagers. Cette activité produit notamment du biogaz ;<br />
− l’entreprise OCCITANIS <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s déchets dangereux, située à l’Ouest ;<br />
−<br />
la centrale hydroélectrique privée, sur la rivière le Dadou au Sud, qui produit <strong>de</strong><br />
l’électricité revendue à EDF.<br />
VI.2.4 - LES ENJEUX COMPLÉMENTAIRES<br />
Les enjeux complémentaires décrits ci-après permettent d’apporter une connaissance générale<br />
du territoire exposé.<br />
VI.2.4.1 - Estimation globale <strong>de</strong> la population rési<strong>de</strong>nte<br />
L’INSEE met à disposition plusieurs indicateurs sur la population et les logements.<br />
Les <strong>de</strong>rnières données démographiques pour les communes <strong>de</strong> Montdragon,<br />
Labessière-Can<strong>de</strong>il, Graulhet et Saint-Julien-du-Puy, issues du nouveau mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
recensement, sont les suivantes :<br />
Commune Population 2009<br />
Montdragon 614<br />
Labessière-Can<strong>de</strong>il 757<br />
Graulhet 12 393<br />
Saint-Julien-du-Puy 405<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 29
Les données relatives à l’évolution <strong>de</strong> la population <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux communes dans les<br />
40 <strong>de</strong>rnières années et issues <strong>de</strong> l’INSEE sont retranscrites ci-après :<br />
Population<br />
Commune 1968 1975 1982 1990 1999<br />
Montdragon 366 371 386 411 422<br />
Labessière-Can<strong>de</strong>il 594 553 692 736 674<br />
Graulhet 12 073 14 097 13 543 13 523 12 656<br />
Saint-Julien-du-Puy 403 391 390 348 354<br />
Evolution moyenne annuelle <strong>de</strong> la population<br />
Commune 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999<br />
Montdragon +0,2 % +0,6 % +0,8 % +0,3 %<br />
Labessière-Can<strong>de</strong>il -1,0 % +3,2 % +0,8 % -1 %<br />
Graulhet +2,2 % -0,6 % +0 % -0,7 %<br />
Saint-Julien-du-Puy -0,4 % +0 % -1,4 % +0,2 %<br />
La commune <strong>de</strong> Montdragon a connu une augmentation globale <strong>de</strong> sa population dans les<br />
années 1968 à aujourd’hui avec une croissance plus très significative <strong>de</strong>puis 1999. La<br />
commune compte aujourd’hui plus <strong>de</strong> 614 habitants.<br />
La commune <strong>de</strong> Labessière-Can<strong>de</strong>il a connu une variation <strong>de</strong> sa population oscillante <strong>de</strong>puis<br />
1968, avec une forte augmentation dans les années 1975-1982. Depuis, la commune compte<br />
aujourd’hui plus <strong>de</strong> 757 habitants.<br />
La commune <strong>de</strong> Graulhet, la plus importante du PPRT, a vu sa population augmenter<br />
significativement dans les années 1968 à 1975. Entre 1975 à 2008, on peut observer une<br />
diminution constante <strong>de</strong> cette population. Depuis 2008, la courbe tend à s’inverser et la<br />
commune compte aujourd’hui plus <strong>de</strong> 12 393 habitants.<br />
Enfin, la commune <strong>de</strong> Saint-Julien-du-Puy a connu une diminution globale <strong>de</strong> sa population<br />
dans les années 1968 à 1990 avec une stagnation dans entre les années 1975 et 1982.<br />
Depuis, la population augmente progressivement pour atteindre aujourd’hui 405 habitants.<br />
Au niveau du périmètre d’étu<strong>de</strong>, la population totale recensée est <strong>de</strong> 118 habitants dont 47 sur<br />
la commune <strong>de</strong> Montdragon, 12 sur la commune <strong>de</strong> Labessière-Can<strong>de</strong>il, 6 sur la commune <strong>de</strong><br />
Graulhet et 53 sur la commune <strong>de</strong> Saint-Julien-du-Puy.<br />
VI.2.4.2 - Estimation globale <strong>de</strong>s emplois<br />
Dans le périmètre d’étu<strong>de</strong>, il y a 50 emplois répertoriés. Les employeurs principaux sont<br />
OCCITANIS (17 emplois), EPC France (14 emplois) et TRYFIL (8 emplois).<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 30
VI.2.5 - LES ENJEUX CONNEXES<br />
VI.2.5.1 - Perspectives <strong>de</strong> développement<br />
La commune <strong>de</strong> Graulhet possè<strong>de</strong> un Plan Local d’Urbanisme approuvé en mai 2004.<br />
Le périmètre d’étu<strong>de</strong> est concerné par 3 zones <strong>de</strong> ce PLU :<br />
− la zone N, zone naturelle ;<br />
− la zone A, zone agricole ;<br />
−<br />
la zone Ux, zone urbanisée non raccordée au réseau public<br />
d’assainissement. Dans le périmètre d’étu<strong>de</strong>, cette zone correspond au<br />
site <strong>de</strong> l’Etablissement Public Départemental TRYFIL.<br />
Les communes <strong>de</strong> Montdragon, Labessière-Con<strong>de</strong>il et Saint-Julien-du-Puy, possè<strong>de</strong>nt<br />
une carte communale. Le périmètre d’étu<strong>de</strong> se situe majoritairement en zone N (zone<br />
naturelle). Cependant, <strong>de</strong>ux zones U (zones urbanisables) sont présentes :<br />
−<br />
−<br />
sur la commune <strong>de</strong> Saint-Julien-du-Puy, au lieu-dit « La Pauquié » au<br />
Sud du périmètre d’étu<strong>de</strong> ;<br />
sur la commune <strong>de</strong> Montdragon, au lieu-dit « La Condomine » à l’Est du<br />
périmètre d’étu<strong>de</strong>.<br />
Ces cartes communales n’ont pas <strong>de</strong> règlement particulier. C’est le RNU (Règlement National<br />
<strong>de</strong> l’Urbanisme) qui s’applique.<br />
VI.2.5.2 - Enjeux économiques, environnementaux et patrimoniaux<br />
Le site d’EPC France constitue un enjeu économique important sur le périmètre d’étu<strong>de</strong>.<br />
Les sites <strong>de</strong> l’Etablissement Public Département TRYFIL et <strong>de</strong> l’entreprise OCCITANIS<br />
constituent <strong>de</strong>s enjeux économiques et environnementaux sur le périmètre d’étu<strong>de</strong>.<br />
En termes d’enjeux environnementaux, il faut signaler l’existence au niveau du périmètre<br />
d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la ZNIEFF (type 1) Z1P20500 « Coteaux secs du Causse et <strong>de</strong> la Rougeanelle ».<br />
Cette ZNIEFF traverse <strong>de</strong> part en part le périmètre d’étu<strong>de</strong> (axe Ouest / Est) et recouvre plus<br />
<strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> sa surface.<br />
La cartographie correspondante est disponible sur le site <strong>de</strong> la <strong>DREAL</strong> <strong>Midi</strong>-Pyrénées :<br />
http://www.midi-pyrenees.<strong>de</strong>veloppement-durable.gouv.fr .<br />
VI.3 - SUPERPOSITION DES ALÉAS ET DES ENJEUX<br />
La phase préalable d’analyse <strong>de</strong>s enjeux fournit une <strong>de</strong>scription, une image du territoire<br />
exposé. Lors <strong>de</strong> cette phase d’analyse <strong>de</strong>s enjeux, les aléas en tant que tels n’ont pas été pris<br />
en compte (types d’aléas, niveaux d’aléas…). La superposition <strong>de</strong> la carte <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s<br />
enjeux et <strong>de</strong> la cartographie <strong>de</strong>s aléas va permettre d’avoir une perception <strong>de</strong> l’impact global<br />
<strong>de</strong>s aléas sur le territoire.<br />
D’autre part, la superposition <strong>de</strong>s aléas et <strong>de</strong>s enjeux constitue le fon<strong>de</strong>ment technique <strong>de</strong> la<br />
démarche <strong>de</strong> finalisation <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s nécessaires à l’élaboration du PPRT.<br />
Cette superposition permet :<br />
−<br />
−<br />
<strong>de</strong> définir un zonage brut, résultant <strong>de</strong> la traduction sur une photographie aérienne du<br />
tableau <strong>de</strong> correspondance entre les niveaux d’aléas et les principes <strong>de</strong> réglementation ;<br />
d’i<strong>de</strong>ntifier, si nécessaire, <strong>de</strong>s investigations complémentaires dont l’objectif est<br />
d’apporter <strong>de</strong>s éléments permettant <strong>de</strong> mieux adapter la réponse réglementaire du<br />
PPRT, en gardant à l’esprit qu’il s’agit <strong>de</strong> protéger les personnes et non les biens.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 31
Figure 5: Carte <strong>de</strong> superposition <strong>de</strong> l’aléa surpression et <strong>de</strong>s enjeux recensés
VI.4 - ZONAGE BRUT<br />
Le zonage brut est établi à partir <strong>de</strong>s aléas, avec la prise en compte <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s types<br />
d’effets (thermique, surpression). Il est conçu sur la base <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> zonage <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong><br />
l’urbanisation future.<br />
Lorsqu’une même zone est potentiellement affectée par plusieurs niveaux d’aléa, le niveau <strong>de</strong><br />
réglementation (et donc la couleur retenue) correspond au niveau d’aléa le plus élevé.<br />
Niveau maximal<br />
d’intensité <strong>de</strong><br />
l’effet toxique,<br />
thermique, ou<br />
surpression sur<br />
les personnes, en<br />
un point donné<br />
Cumul <strong>de</strong>s<br />
classes <strong>de</strong><br />
probabilités<br />
d’occurrence <strong>de</strong>s<br />
phénomènes<br />
dangereux en un<br />
point donné<br />
Très Grave Grave Significatif<br />
Indirect par bris <strong>de</strong><br />
vitre (uniquement pour<br />
effet <strong>de</strong> surpression)<br />
>D 5Eà D D 5E à D D 5E à D D
Figure 7: Carte <strong>de</strong> zonage brut
VII. LA STRATÉGIE DU PPRT<br />
VII.1 - LES PRINCIPALES ORIENTATIONS PROPOSÉES<br />
Il est important <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce les principales orientations à partir <strong>de</strong>squelles <strong>de</strong>s choix<br />
justifiés sont à effectuer. Ces choix orientent le règlement du PPRT EPC France vers certaines<br />
dispositions locales.<br />
VII.1.1 - ENCADRER L’URBANISATION FUTURE OU L’ÉVOLUTION DE L’URBANISATION<br />
EXISTANTE<br />
VII.1.1.1 - La zone R<br />
Cette zone est par définition inconstructible sauf pour quelques spécificités, comme <strong>de</strong>s<br />
constructions permettant <strong>de</strong> réduire le risque ou liées directement à EPC France.<br />
VII.1.1.2 - La zone r<br />
Cette zone correspond aux niveaux d'aléa surpression F+ et F. Le gui<strong>de</strong> précise qu’un<br />
principe d’interdiction est à retenir avec quelques aménagements tolérés, dans la<br />
mesure où ils n’augmentent pas l’exposition au risque <strong>de</strong>s personnes.<br />
Cette zone est d’emprise limitée, sans aucun enjeu, notamment sans bâti existant. L’orientation<br />
choisie est donc <strong>de</strong> n’autoriser, en termes <strong>de</strong> constructions nouvelles, au titre du PPRT, que <strong>de</strong>s<br />
constructions liées directement à l’établissement EPC France à l’origine du PPRT.<br />
VII.1.1.3 - La zone B<br />
Représentée en bleu foncé sur le plan <strong>de</strong> zonage brut, cette zone correspond à un niveau<br />
d'aléa surpression M ou M+. Le gui<strong>de</strong> préconise que les constructions possibles n’augmentent<br />
pas la population exposée et que <strong>de</strong>s dispositions constructives soient prescrites pour le bâti<br />
futur comme pour l’existant.<br />
Bien que moyennement exposée au risque, l'orientation choisie est d’adopter également un<br />
principe d’interdiction sur cette zone compte tenu <strong>de</strong> son emprise limitée et <strong>de</strong> l’absence<br />
d’enjeux au sein <strong>de</strong> cette zone. Des bâtiments d'activité nouveaux sans présence humaine ou<br />
présence humaine réduite pourront toutefois être autorisés, dans la mesure où ils ne peuvent<br />
être implantés à l'extérieur <strong>de</strong> la zone dans <strong>de</strong>s conditions économiques acceptables.<br />
VII.1.1.4 - La zone b<br />
Cette zone correspond à un niveau d'aléa surpression Fai. La zone d’aléa Fai n’est<br />
réglementée que pour l'effet <strong>de</strong> surpression. S'agissant <strong>de</strong>s mesures physiques <strong>de</strong> protection<br />
<strong>de</strong>s immeubles d'habitation préexistant au PPRT, l'application <strong>de</strong>s principes du gui<strong>de</strong> PPRT<br />
édité en 2007 conduit à édicter <strong>de</strong>s recommandations pour le renforcement <strong>de</strong>s immeubles<br />
bâtis en zone d'aléa faible <strong>de</strong> surpression. Cependant, le retour d’expérience <strong>de</strong> l’acci<strong>de</strong>nt<br />
d’AZF et les étu<strong>de</strong>s techniques réalisées sur les premiers PPRT montrent que certaines<br />
mesures simples et faciles à i<strong>de</strong>ntifier étaient particulièrement judicieuses dans cette zone<br />
(protection <strong>de</strong>s ouvertures vitrées et le cas échéant passage <strong>de</strong> toitures en grands éléments à<br />
<strong>de</strong>s toitures en petits éléments). Il parait donc judicieux <strong>de</strong> prescrire un objectif <strong>de</strong> résistance<br />
<strong>de</strong>s ouvertures vitrées et <strong>de</strong> la toiture dans ces zones, afin <strong>de</strong> protéger la vie <strong>de</strong>s personnes.<br />
Une telle prescription ne nécessite néanmoins pas d’investigation complémentaire. De plus, le<br />
passage <strong>de</strong> recommandation à prescription ouvre droit à crédit d’impôts. Cette approche est<br />
développée dans un gui<strong>de</strong> national apportant <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> précision sur les stratégies <strong>de</strong><br />
réduction <strong>de</strong> la vulnérabilité du bâti existant dans l'élaboration <strong>de</strong>s PPRT datant <strong>de</strong> décembre<br />
2008.<br />
Ce secteur, à vocation rési<strong>de</strong>ntielle rurale et agricole, est le seul comportant <strong>de</strong>s enjeux repérés<br />
précé<strong>de</strong>mment : habitations et exploitations agricoles ou industrielles. Il est proposé que <strong>de</strong><br />
nouvelles constructions soient autorisées sous conditions à l'intérieur <strong>de</strong> cette zone b dans les<br />
seuls secteurs précé<strong>de</strong>mment réservés à cet effet dans les documents d'urbanisme<br />
préexistants, repérés b1 sur le plan <strong>de</strong> zonage règlementaire ci-après et situés sur la commune<br />
<strong>de</strong> Saint-Julien-du-Puy pour le secteur au sud <strong>de</strong> la zone et <strong>de</strong> Montdragon pour le secteur à<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 35
l'ouest <strong>de</strong> la zone d'étu<strong>de</strong>.<br />
VII.1.2 - AGIR SUR L’EXISTANT PAR DES MESURES FONCIÈRES<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s enjeux présents sur le territoire a permis <strong>de</strong> constater qu’aucun bâti existant, à<br />
l’exception <strong>de</strong>s installations <strong>de</strong> EPC France, ne se situait dans les zones d’aléa Très Fort Plus<br />
(TF+) à Fort (F).<br />
Aucun secteur d’expropriation ou <strong>de</strong> délaissement possible n’est donc à déterminer.<br />
VII.1.3 - MESURES DE PROTECTION DES POPULATIONS<br />
Des mesures particulières peuvent être édictées par le PPRT concernant l'usage <strong>de</strong> voies <strong>de</strong><br />
circulation ou d'infrastructures particulières. Il n'en existe pas dans le cas étudié.<br />
VII.2 - LES CHOIX RETENUS EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL<br />
D’un point <strong>de</strong> vue stratégique la marge <strong>de</strong> manœuvre est faible, aucune mesure<br />
supplémentaire <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s risques à la source n’est possible.<br />
Les orientations ont été définies d'après les propositions <strong>de</strong> l'Etat, actées lors <strong>de</strong> la réunion<br />
d'association du 18 mai 2011 (à compléter : ainsi que par l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s avis émis par les<br />
personnes et organismes associés et du bilan <strong>de</strong> la concertation).<br />
Compte tenu du contexte local, les choix retenus sont les suivants :<br />
• les zones R et r sont fusionnées en une seule zone d'interdiction R dans un souci <strong>de</strong><br />
meilleure lisibilité et compte tenu <strong>de</strong> l'absence d'enjeux existants ou prévus i<strong>de</strong>ntifiés sur<br />
ce territoire. Seules seront autorisées les constructions nouvelles liées directement à<br />
l’établissement EPC France ou celles dont la finalité serait la réduction <strong>de</strong>s risques;<br />
• dans la zones B, le principe retenu est <strong>de</strong> ne pas exposer <strong>de</strong> personnes aux risques.<br />
Seules sont autorisées, en termes <strong>de</strong> constructions nouvelles et sous conditions, les<br />
bâtiments d'activité sans présence humaine ou avec présence humaine réduite. Sont<br />
également autorisées les extensions <strong>de</strong> bâtiments existants, sous conditions.<br />
• dans la zone b, le principe <strong>de</strong> limiter le nombre <strong>de</strong> personnes exposées est retenu sans<br />
pour autant être trop restrictif. En termes <strong>de</strong> constructions nouvelles, sont notamment<br />
autorisées les constructions d’installations classées compatibles avec les risques<br />
technologiques, les constructions <strong>de</strong> bâtiments nouveaux à usage d’activité, <strong>de</strong><br />
stockage nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que les extensions <strong>de</strong> certains<br />
bâtiments (agricoles, habitation…). A l'intérieur <strong>de</strong>s secteurs b1, la construction <strong>de</strong><br />
nouvelles habitations est autorisée sous conditions, notamment avec un COS limité à<br />
0,2 pour éviter une <strong>de</strong>nsification trop importante <strong>de</strong> ces secteurs.<br />
In fine, il est donc retenu trois zones (R, B et b) dans le zonage réglementaire.<br />
Aléa surpression Zonage brut Zonage règlementaire<br />
TF+ R3 R<br />
TF R2 R<br />
TF R1 R<br />
F+ r3 R<br />
F r2 R<br />
F r1 R<br />
M+ B3 B<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 36
Aléa surpression Zonage brut Zonage règlementaire<br />
M B2 B<br />
M B1 B<br />
Fai b1 b<br />
Enfin, il est rappelé que chaque commune concernée a la possibilité d’instaurer un droit <strong>de</strong><br />
préemption sur l’ensemble du périmètre d’exposition aux risques et que les terrains ainsi acquis<br />
peuvent être rétrocédés à l’exploitant à l’origine du risque.<br />
La stratégie du PPRT <strong>de</strong> EPC France a permis <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s choix adaptés au<br />
contexte local. La phase suivante consiste à traduire ces choix dans le plan <strong>de</strong> zonage<br />
réglementaire et dans le règlement.<br />
VIII. BILAN DE LA CONCERTATION<br />
VIII.1 - MODALITÉS DE LA CONCERTATION<br />
Les modalités <strong>de</strong> concertation ont été définies dans l'arrêté préfectoral <strong>de</strong> prescription du PPRT<br />
EPC France du 25 mai 2009. Elles prévoyaient les dispositions suivantes :<br />
• « les documents d'élaboration sont tenus à la disposition du public aux heures<br />
d'ouverture à la mairie <strong>de</strong>. Ils sont également accessibles sur le site internet <strong>de</strong> la<br />
<strong>DREAL</strong> <strong>Midi</strong>-Pyrénées (http://www.midi-pyrenees.<strong>de</strong>veloppement-durable.gouv.fr),<br />
• les observations du public sont recueillies sur un registre prévu à cet effet en mairies <strong>de</strong><br />
Montdragon, Labessière-Can<strong>de</strong>il, Saint-Julien-du-Puy et Graulhet. Le public peut<br />
également exprimer ses observations par courrier adressé à la Préfecture <strong>de</strong> la Tarn.<br />
Le cas échéant, une ou plusieurs réunions publiques pourront être organisées.<br />
• Le bilan <strong>de</strong> la concertation est communiqué aux personnes et organismes associés et<br />
mis à disposition du public à la Préfecture du Tarn, à la sous préfecture <strong>de</strong> Castres et<br />
en mairies <strong>de</strong> Montdragon, Labessière-Can<strong>de</strong>il, Saint-Julien-du-Puy et Graulhet ».<br />
VIII.2 - PREMIÈRE RÉUNION CLIC DU 9 JUILLET 2009<br />
La démarche et les procédures afférentes du PPRT ont été présentés aux membres du CLIC<br />
lors <strong>de</strong> la réunion du 9 juillet 2009. Le compte rendu <strong>de</strong> cette réunion, ainsi que les<br />
présentations qui y ont été faites sont en ligne sur le site internet <strong>de</strong> la <strong>DREAL</strong> <strong>Midi</strong>-Pyrénées à<br />
l'adresse suivante :<br />
http://www.midi-pyrenees.<strong>de</strong>veloppement-durable.gouv.fr/reunion-2009-a7188.html<br />
VIII.3 - RÉUNION D’ASSOCIATION DU 14 OCTOBRE 2009<br />
Une réunion <strong>de</strong>s personnes et organismes associés à l'élaboration du Plan <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s<br />
Risques Technologiques autour du site <strong>de</strong> la société NITRO-BICKFORD s'est tenue le 14<br />
octobre 2009 en mairie <strong>de</strong> MONTDRAGON, sous la prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Mme Françoise HUPPE,<br />
Secrétaire Générale <strong>de</strong> la sous préfecture <strong>de</strong> Castres, en l'absence <strong>de</strong> M. le sous préfet <strong>de</strong><br />
CASTRES, retenu par ailleurs.<br />
Cette réunion a permis <strong>de</strong> rappeler les finalités <strong>de</strong> la démarche PPRT ainsi que les principes <strong>de</strong><br />
règlementation <strong>de</strong>s différentes zones.<br />
La carte <strong>de</strong>s aléas technologiques a été présentée. Cette carte résulte <strong>de</strong> l'analyse <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> dangers fournie par l'exploitant qui a recensé la totalité <strong>de</strong>s phénomènes dangereux<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 37
susceptibles <strong>de</strong> survenir du fait <strong>de</strong> cette activité, en établissant pour chaque phénomène une<br />
probabilité d'occurrence et une intensité <strong>de</strong>s effets :<br />
• probabilité d'occurrence classée en D sur une échelle <strong>de</strong> E à A, <strong>de</strong> la plus faible à la<br />
plus gran<strong>de</strong> probabilité d'occurrence, pour les activités exercées dans le dépôt. Ces<br />
activités se limitent à la réception, au stockage, à la préparation <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>s et à<br />
l'expédition <strong>de</strong> produits explosifs civils, sans manipulation <strong>de</strong> substances explosives, les<br />
emballages <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>s explosifs n'étant pas ouverts, sauf pour les détonateurs.<br />
• intensité <strong>de</strong>s effets par application <strong>de</strong> formules <strong>de</strong> calcul applicables à ce type d'activité,<br />
fonction essentiellement <strong>de</strong> la masse <strong>de</strong>s explosifs et <strong>de</strong> leurs caractéristiques<br />
intrinsèques (équivalent TNT). Ces formules délimitent <strong>de</strong>s zones d'effet respectivement<br />
très graves, graves, significatifs pour la vie humaine et occasionnant <strong>de</strong>s effets indirects<br />
par bris <strong>de</strong> vitres.<br />
La combinaison <strong>de</strong> cette intensité d'effets et <strong>de</strong> la probabilité d'occurence constitue l'aléa<br />
technologique avec 7 niveaux d'aleas croissants: faible (FAI); moyen (M); moyen plus (M+); fort<br />
(F); fort plus (F+); très fort (TF) et très fort plus (TF+).<br />
La situation administrative du dépôt Nitro-Bickford a été également évoquée, pour indiquer que<br />
la démarche <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s risques réalisée par l'exploitant a montré que tous les évènements<br />
redoutés recensés sont, au plan <strong>de</strong> la gravité, jugés acceptables par rapport à la<br />
réglementation <strong>de</strong>s installations Seveso.<br />
Au chapitre <strong>de</strong>s questions diverses, les réponses suivantes ont été apportées :<br />
• au sujet du développement possible <strong>de</strong> champs <strong>de</strong> panneaux photovoltaïques , il a été<br />
indiqué que la finalité du PPRT concerne exclusivement la protection <strong>de</strong>s personnes, et<br />
donc que le développement <strong>de</strong> cette activité ne saurait être réglementé dans ce cadre ;<br />
• s'agissant <strong>de</strong>s entreprises intervenantes à l'intérieur du périmètre telles que entreprises<br />
<strong>de</strong> voirie, téléphonie, edf ou autres, le PPRT pourra <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r que le donneur d'ordre<br />
leur assure une information spécifique sur les risques encourus<br />
• l'exploitant du dépôt Nitro-Bickford indique en outre que l'urbanisation autour <strong>de</strong> son<br />
établissement a été bien préservée par la politique <strong>de</strong> la mairie <strong>de</strong> limitation <strong>de</strong> la<br />
construction développée par la mairie <strong>de</strong> Montdragon .<br />
VIII.4 - DEUXIÈME RÉUNION CLIC DU 9 DÉCEMBRE 2010<br />
Cette réunion a constitué la réunion annuelle du CLIC et a été consacrée au bilan d'activité <strong>de</strong><br />
l'établissement Nitrobickford, y compris le retour d'expérience <strong>de</strong>s exercices du plan d'opération<br />
interne, ainsi qu'au bilan <strong>de</strong>s inspections conduites sur le site par les services <strong>de</strong> la <strong>DREAL</strong> au<br />
titre <strong>de</strong> l'inspection <strong>de</strong>s installations classées.<br />
VIII.5 - TROISIÈME RÉUNION CLIC ET DEUXIÈME RÉUNION D'ASSOCIATION DU 18 MAI 2011<br />
Une réunion <strong>de</strong>s personnes et organismes associés à l'élaboration du Plan <strong>de</strong> Prévention<br />
<strong>de</strong>s Risques Technologiques autour du site <strong>de</strong> la société NITRO-BICKFORD s'est tenue le<br />
18 mai 2011 en mairie <strong>de</strong> MONTDRAGON, sous la prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> M. Colin MIEGE, Sous-<br />
Préfet <strong>de</strong> Castres. Cette réunion a également constitué la réunion annuelle du CLIC.<br />
Au cours <strong>de</strong> cette réunion, les services <strong>de</strong> la DDT 81 ont présenté successivement :<br />
• la carte <strong>de</strong> recensement <strong>de</strong>s enjeux dans les zones d'aléas couvertes par le PPRT;<br />
• la carte <strong>de</strong> superposition <strong>de</strong>s aléas et <strong>de</strong>s enjeux ;<br />
• la carte <strong>de</strong>s données d'urbanisme : PLU pour la commune <strong>de</strong> Graulhet avec une zone<br />
Ux , carte communale pour les communes <strong>de</strong> St Julien -du-Puy et Montdragon avec<br />
<strong>de</strong>ux secteurs <strong>de</strong> construction possible, RNU pour Labéssière-Can<strong>de</strong>il ;<br />
• La carte <strong>de</strong> superposition <strong>de</strong>s aléas et <strong>de</strong>s donnés d'urbanisme ;<br />
• Un projet <strong>de</strong> carte <strong>de</strong> zonage avec trois zones retenues :<br />
• zone R pour les aléas Très forts plus à forts<br />
• zone B pour les aléas moyens plus à moyens<br />
• zone b pour les aléas faibles, avec <strong>de</strong>ux sous secteurs b1.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 38
Des précisions sont apportées concernant l'implantation <strong>de</strong>s personnels <strong>de</strong> Trifyl, <strong>de</strong>vant être<br />
rassemblés dans <strong>de</strong>s locaux qui sont apparemment en <strong>de</strong>hors du périmètre d'étu<strong>de</strong> du PPRT,<br />
ainsi que sur une maison d'habitation située également en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> ce périmètre.<br />
Les services <strong>de</strong> la <strong>DREAL</strong> <strong>Midi</strong>-Pyrénées, Division Risques acci<strong>de</strong>ntels, ont présenté ensuite<br />
les gran<strong>de</strong>s lignes du projet <strong>de</strong> règlement élaboré conjointement avec la DDT 81, en fonction<br />
<strong>de</strong>s zones considérées, respectivement pour la réglementation <strong>de</strong>s projets futurs et pour les<br />
mesures <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s populations par le renforcement du bâti existant, limitées ici aux<br />
mesures <strong>de</strong> protection contre les bris <strong>de</strong> vitres en cas d'explosion.<br />
S'agissant <strong>de</strong> ces mesures <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s populations par renforcement du bâti existant, il<br />
est indiqué qu'elles peuvent être soit simplement recommandées, soit prescrites, les rendant<br />
ainsi obligatoires dans un délai maximum <strong>de</strong> cinq ans suivant l'approbation du PPRT.<br />
Cependant, comme déjà indiqué, le retour d’expérience <strong>de</strong> l’acci<strong>de</strong>nt d’AZF et les étu<strong>de</strong>s<br />
techniques réalisées sur les premiers PPRT montrent que certaines mesures simples et faciles<br />
à i<strong>de</strong>ntifier étaient particulièrement judicieuses dans cette zone (protection <strong>de</strong>s ouvertures<br />
vitrées et le cas échéant passage <strong>de</strong> toitures en grands éléments à <strong>de</strong>s toitures en petits<br />
éléments). Il parait donc judicieux <strong>de</strong> prescrire un objectif <strong>de</strong> résistance <strong>de</strong>s ouvertures vitrées<br />
et <strong>de</strong> la toiture dans ces zones, afin <strong>de</strong> protéger la vie <strong>de</strong>s personnes. Une telle prescription ne<br />
nécessite néanmoins pas d’investigation complémentaire. De plus, le passage <strong>de</strong><br />
recommandation à prescription ouvre droit à crédit d’impôts. Cette approche est développée<br />
dans un gui<strong>de</strong> national apportant <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> précision sur les stratégies <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong><br />
la vulnérabilité du bâti existant dans l'élaboration <strong>de</strong>s PPRT datant <strong>de</strong> décembre 2008. La<br />
proposition <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> l'Etat sur ce point est donc que les mesures soient prescrites, dans<br />
un souci d'efficacité <strong>de</strong> la mesure mais également pour que les propriétaires <strong>de</strong>s biens<br />
concernés puissent bénéficier <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s financières existant aujourd'hui (crédit d'impôt<br />
notamment) et en discussion pour l'avenir (complément d'ai<strong>de</strong> possible par les industriels et les<br />
Collectivités territoriales).<br />
Suite à diverses discussions, les points suivants ont émergé :<br />
• la possibilité d'implanter <strong>de</strong> nouvelles ICPE compatibles en zone B n'est pas<br />
nécessaire ;<br />
• le COS réduit <strong>de</strong> 0,2, permettant d'éviter les zones d'habitat <strong>de</strong>nse, sera imposé aux<br />
nouvelles constructions à usage d'habitation autorisées dans les secteurs b1 ;<br />
• le règlement du PPRT ne <strong>de</strong>vrait pas autoriser <strong>de</strong> nouvelles constructions à usage<br />
d'habitations dans la zone urbanisable réservée par le PLU <strong>de</strong> Graulhet, et sur laquelle<br />
est déjà implanté un centre d'enfouissement <strong>de</strong> déchets ;<br />
• les mesures <strong>de</strong> renforcement du bâti existant seront prescrites dans un délai <strong>de</strong> cinq<br />
ans.<br />
A la suite <strong>de</strong> cette présentation, il a été indiqué que la prochaine étape d'élaboration du PPRT<br />
sera consacrée à la consultation officielle <strong>de</strong>s personnes et organismes associés sur les projets<br />
<strong>de</strong> documents du PPRT. Le CLIC étant organisme associé, une nouvelle réunion <strong>de</strong> cette<br />
instance sera organisée dans les <strong>de</strong>ux mois suivants cette consultation afin <strong>de</strong> recueillir son<br />
avis.<br />
Les présentations et le compte rendu intégral <strong>de</strong> cette réunion figurent en ligne à l'adresse<br />
suivante :<br />
http://www.midi-pyrenees.<strong>de</strong>veloppement-durable.gouv.fr/nitro-bickford-a-montdragona5795.html<br />
VIII.6 - TROISIÈME RÉUNION CLIC DU .................<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 39
A compléter<br />
VIII.7 - AVIS DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIÉS<br />
A compléter<br />
•Avis du Conseil Général <strong>de</strong> Tarn : A compléter<br />
•Avis du CLIC <strong>de</strong> Montdragon : A compléter<br />
•Avis <strong>de</strong> la société EPC France : A compléter<br />
•Avis <strong>de</strong> la Commune <strong>de</strong> Montdragon : A compléter<br />
•Avis du maire <strong>de</strong> .....A compléter<br />
•Avis du Conseil Régional <strong>de</strong> <strong>Midi</strong>-Pyrénées A compléter<br />
VIII.8 - PRISE EN COMPTE DE LA CONCERTATION<br />
A compléter<br />
VIII.9 - ENQUÊTE PUBLIQUE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR<br />
• A compléter<br />
IX. LES PIÈCES RÉGLEMENTAIRES<br />
La présente note est accompagnée <strong>de</strong>s pièces réglementaires suivantes :<br />
IX.1 - LE PLAN DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE<br />
Le plan <strong>de</strong> zonage réglementaire est le document cartographique <strong>de</strong> référence qui permet <strong>de</strong><br />
localiser géographiquement les zones et les secteurs dans lesquels s’appliquent les différentes<br />
dispositions retenues. Le plan <strong>de</strong> zonage réglementaire et le règlement expriment les choix<br />
issus <strong>de</strong> la phase <strong>de</strong> stratégie du PPRT, fondés sur la connaissance <strong>de</strong>s aléas, <strong>de</strong>s enjeux<br />
exposés, <strong>de</strong> leur niveau <strong>de</strong> vulnérabilité et <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> mesures<br />
supplémentaires <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s risques à la source.<br />
Le plan délimite :<br />
- le périmètre d’exposition aux risques qui correspond au périmètre réglementé par<br />
le PPRT ;<br />
- les zones dans lesquelles sont applicables :<br />
- <strong>de</strong>s interdictions ;<br />
- <strong>de</strong>s prescriptions homogènes ;<br />
- <strong>de</strong>s recommandations.<br />
Les différentes zones sont i<strong>de</strong>ntifiées <strong>de</strong> la manière suivante :<br />
Périmètre et zones<br />
Périmètre<br />
d'exposition aux<br />
risques<br />
Emprise <strong>de</strong><br />
l'établissement à<br />
l'origine du<br />
PPRT<br />
Interdiction<br />
stricte<br />
Couleur ou graphisme<br />
<strong>de</strong>s zones<br />
réglementées<br />
Dénomination<br />
<strong>de</strong>s zones<br />
réglementées<br />
Définition <strong>de</strong>s zones réglementées<br />
/ /<br />
/<br />
R<br />
Emprise foncière <strong>de</strong>s installations, objet du<br />
PPRT, par convention grisée<br />
Zones exposées à un niveau d’aléas très fort<br />
(TF +), par convention rouge foncé (R) dans<br />
lesquelles notamment les nouvelles<br />
constructions sont interdites<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 40
Admis sous<br />
réserve<br />
Admis sous<br />
réserve<br />
B<br />
b<br />
Zones exposées à un niveau d’aléa moyen<br />
(M + pour un aléa toxique et M à M + pour un<br />
aléa <strong>de</strong> surpression) sur lesquelles quelques<br />
constructions sont possibles sous réserve :<br />
que ce soient <strong>de</strong>s constructions, en faible<br />
<strong>de</strong>nsité, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts creuses ;<br />
ou que ce soient <strong>de</strong>s aménagements <strong>de</strong><br />
constructions existantes non <strong>de</strong>stinés à<br />
accueillir <strong>de</strong> nouvelles populations ;<br />
<strong>de</strong> prescriptions adaptées à l’aléa.<br />
Zones exposées à un niveau d’aléa moyen<br />
ou faible (M pour un aléa toxique et Fai pour<br />
un aléa <strong>de</strong> surpression) sur lesquelles <strong>de</strong>s<br />
constructions sont possibles sous conditions.<br />
Certaines recommandations sont également<br />
émises.<br />
Tableau 7 : Grands principes du zonage réglementaire<br />
IX.2 - LE RÈGLEMENT<br />
Le règlement fixe les conditions d’occupation et d’utilisation du sol à l’intérieur <strong>de</strong> chaque zone<br />
colorée et indicée sur la cartographie. Son objet est d’énoncer <strong>de</strong>s règles d’urbanisme<br />
applicables aux constructions nouvelles prévues dans les secteurs concernés par l’aléa et aux<br />
constructions existantes dans ces mêmes secteurs d’aléa. Dans le règlement, <strong>de</strong>s<br />
aménagements ou <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> constructions peuvent y être interdits ou subordonnés au<br />
respect <strong>de</strong> prescriptions.<br />
• Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire<br />
entreprendre <strong>de</strong>s constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice <strong>de</strong>s<br />
autres dispositions législatives ou réglementaires qui trouveraient à s'appliquer.<br />
• Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime <strong>de</strong><br />
déclaration ou d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule<br />
responsabilité <strong>de</strong> leurs auteurs dans le respect <strong>de</strong>s dispositions du présent PPRT.<br />
Le document se compose <strong>de</strong> 3 parties distinctes :<br />
- Une première partie précisant les conditions générales d’application du<br />
règlement du PPRT<br />
- Une <strong>de</strong>uxième partie précisant les règles d’urbanisme applicables aux<br />
différentes zones cartographiées sur le plan <strong>de</strong> zonage règlementaire pour les<br />
constructions neuves et existantes<br />
Une troisième partie liste les mesures <strong>de</strong> protection, <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong><br />
prescrites dans le cadre <strong>de</strong> ce PPRT. Celles-ci doivent être prises par les propriétaires et<br />
exploitants.<br />
IX.3 - LES RECOMMANDATIONS<br />
Le PPRT propose également <strong>de</strong>s recommandations, sans valeur contraignante, tendant à<br />
renforcer la protection <strong>de</strong>s populations face aux risques encourus. Elles s’appliquent à<br />
l’aménagement, à l’utilisation et à l’exploitation <strong>de</strong>s constructions, ouvrages, voies <strong>de</strong><br />
communication.<br />
Elles sont décrites dans un document séparé accompagnant le projet du PPRT et sont relatives<br />
à l’aménagement <strong>de</strong>s constructions / infrastructures concernées par un aléa <strong>de</strong> surpression Fai.<br />
<strong>Note</strong> <strong>de</strong> présentation 41