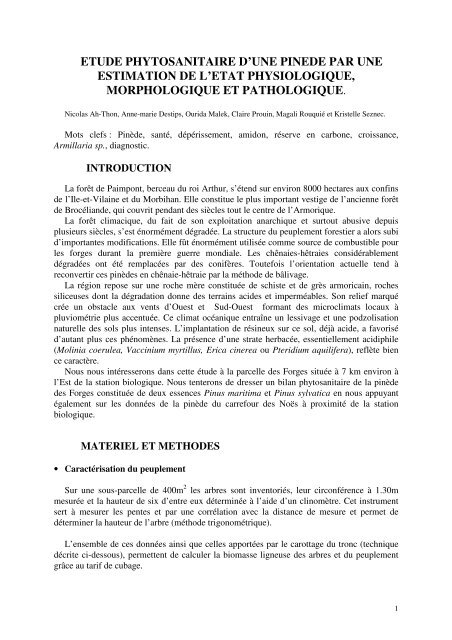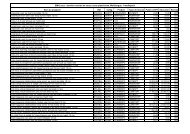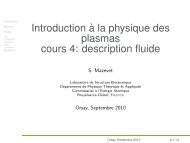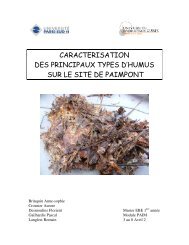ETUDE PHYTOSANITAIRE D'UNE PINEDE PAR UNE ESTIMATION ...
ETUDE PHYTOSANITAIRE D'UNE PINEDE PAR UNE ESTIMATION ...
ETUDE PHYTOSANITAIRE D'UNE PINEDE PAR UNE ESTIMATION ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>ETUDE</strong> <strong>PHYTOSANITAIRE</strong> D’<strong>UNE</strong> <strong>PINEDE</strong> <strong>PAR</strong> <strong>UNE</strong><br />
<strong>ESTIMATION</strong> DE L’ETAT PHYSIOLOGIQUE,<br />
MORPHOLOGIQUE ET PATHOLOGIQUE.<br />
Nicolas Ah-Thon, Anne-marie Destips, Ourida Malek, Claire Prouin, Magali Rouquié et Kristelle Seznec.<br />
Mots clefs : Pinède, santé, dépérissement, amidon, réserve en carbone, croissance,<br />
Armillaria sp., diagnostic.<br />
INTRODUCTION<br />
La forêt de Paimpont, berceau du roi Arthur, s’étend sur environ 8000 hectares aux confins<br />
de l’Ile-et-Vilaine et du Morbihan. Elle constitue le plus important vestige de l’ancienne forêt<br />
de Brocéliande, qui couvrit pendant des siècles tout le centre de l’Armorique.<br />
La forêt climacique, du fait de son exploitation anarchique et surtout abusive depuis<br />
plusieurs siècles, s’est énormément dégradée. La structure du peuplement forestier a alors subi<br />
d’importantes modifications. Elle fût énormément utilisée comme source de combustible pour<br />
les forges durant la première guerre mondiale. Les chênaies-hêtraies considérablement<br />
dégradées ont été remplacées par des conifères. Toutefois l’orientation actuelle tend à<br />
reconvertir ces pinèdes en chênaie-hêtraie par la méthode de bâlivage.<br />
La région repose sur une roche mère constituée de schiste et de grès armoricain, roches<br />
siliceuses dont la dégradation donne des terrains acides et imperméables. Son relief marqué<br />
crée un obstacle aux vents d’Ouest et Sud-Ouest formant des microclimats locaux à<br />
pluviométrie plus accentuée. Ce climat océanique entraîne un lessivage et une podzolisation<br />
naturelle des sols plus intenses. L’implantation de résineux sur ce sol, déjà acide, a favorisé<br />
d’autant plus ces phénomènes. La présence d’une strate herbacée, essentiellement acidiphile<br />
(Molinia coerulea, Vaccinium myrtillus, Erica cinerea ou Pteridium aquilifera), reflète bien<br />
ce caractère.<br />
Nous nous intéresserons dans cette étude à la parcelle des Forges située à 7 km environ à<br />
l’Est de la station biologique. Nous tenterons de dresser un bilan phytosanitaire de la pinède<br />
des Forges constituée de deux essences Pinus maritima et Pinus sylvatica en nous appuyant<br />
également sur les données de la pinède du carrefour des Noës à proximité de la station<br />
biologique.<br />
MATERIEL ET METHODES<br />
• Caractérisation du peuplement<br />
Sur une sous-parcelle de 400m 2 les arbres sont inventoriés, leur circonférence à 1.30m<br />
mesurée et la hauteur de six d’entre eux déterminée à l’aide d’un clinomètre. Cet instrument<br />
sert à mesurer les pentes et par une corrélation avec la distance de mesure et permet de<br />
déterminer la hauteur de l’arbre (méthode trigonométrique).<br />
L’ensemble de ces données ainsi que celles apportées par le carottage du tronc (technique<br />
décrite ci-dessous), permettent de calculer la biomasse ligneuse des arbres et du peuplement<br />
grâce au tarif de cubage.<br />
1
Biomasse du peuplement = biomasse arbre i = G*f*h<br />
où la surface terrière G = C² 1,30 /4Π (cm²/ha)<br />
h : hauteur moyenne<br />
f : coefficient de forme<br />
Le taux de carbone correspond à 50% de la biomasse du peuplement (50% de la matière<br />
fraîche).<br />
• Détermination des classes de dépérissement et carottage :<br />
Sur une parcelle d’un hectare, on identifie les essences et mesure la circonférence à 1.30m<br />
de 30 arbres pris aléatoirement. La hauteur totale ainsi que celle du houppier est aussi mesurée<br />
pour chacun d’entre eux afin de calculer la hauteur relative du houppier.<br />
Un des critères morphologiques de dépérissement est la perte foliaire, c’est-à-dire le<br />
manque de feuilles du houppier par rapport au houppier complet d’un arbre de même essence,<br />
au même âge, placé dans les mêmes conditions de concurrence. Celle-ci est évaluée<br />
visuellement pour les 30 arbres.<br />
Les arbres sont répartis selon 4 classes de perte foliaire classe 1 : 0 à 30%<br />
classe 2 : 30 à 60%<br />
classe 3 : >60%<br />
classe 4 : 100%<br />
Autre critère, la présence/absence au niveau du collet d’un champignon pathogène,<br />
Armillaria sp., parasite du système racinaire.<br />
Enfin, des carottes de 5 mm de diamètre sont prélevées à l’aide d’une tarière de Pressler:<br />
une au niveau du tronc à 1.30m et une dans une racine. Les carottes de tronc permettent une<br />
étude dendrochronologique à partir des cernes. Leur largeur dépend de l’espèce, de l’âge, de la<br />
compétition intraspécifique et de l’environnement (sol, bilan hydrique, climat, compétition<br />
interspécifique, ravageurs...). La mesure des cernes permet d’avoir une représentation<br />
moyenne de la croissance radiale sur 50 ans par classe d’arbre et d’étudier sa corrélation avec<br />
l’état de santé du sujet. La proportion de bois vivant (aubier) est déterminée visuellement par<br />
l’obstruation des vaisseaux sur la carotte.<br />
Les carottes de racine serviront à estimer la quantité d’amidon.<br />
• Evaluation de la teneur en amidon<br />
Mise au point à partir de la méthode de Wargo et utilisée pour des essences telles que<br />
chêne et le hêtre, nous avons tenté de l’adapter au pin.<br />
Des carottes de quelques centimètres sont prélevées, à l’aide d’une tarière, sur les racines<br />
dans toutes les classes de dépérissement. Pour préserver leur fraîcheur, elles sont conservées<br />
au froid jusqu'à l’analyse. L’échantillon est ensuite plané puis trempé dans une solution de<br />
lugol (révélateur de la présence d’amidon) pendant 5 minutes afin d’obtenir une coloration<br />
marquée. La détermination de la couleur s’effectue sur le premier centimètre de la carotte, où<br />
les cernes sont encore fonctionnels. Un code couleur (code Munsell utilisé en pédologie) est<br />
utilisé pour mémoriser celle de la carotte car elle est superficielle et s’atténue au bout de<br />
quelques minutes.<br />
2
La coloration n’étant pas toujours homogène, des zones de couleurs différentes sont<br />
distinguées.<br />
Nous avons établi un code couleur pour les Pinacées en tenant compte des nuances<br />
observées :<br />
classe 0 : « Brique clair » (code Munsell 10R 6/8)<br />
classe 1 : « Brique » (code Munsell 10R 5/6-4/8)<br />
classe 2 : « Brique foncé » (code Munsell 10R 4/3-4/4-3/6)<br />
classe 3 : « Marron » (code Munsell 10R 3/3-3/4 et 2.5YR 2/4)<br />
classe 4 : « Marron foncé/Noir » (code Munsell 10R 2/1-2/2)<br />
La note finale est obtenue comme suit :<br />
note finale = (Li*Ci)<br />
Li : longueur de carotte colorée par la couleur i<br />
Ci : code correspondant à la couleur i<br />
Logiquement la coloration et la note finale sont plus élevées lorsqu’il y a plus d’amidon<br />
(vérifié chez le hêtre et le pin par dosage enzymatique).<br />
• Détermination de l’indice foliaire<br />
L’indice foliaire (LAI) du peuplement est déteminé par des photographies hémisphériques<br />
de la canopée tous les 20m en suivant les deux médianes des côtés de la parcelle. Les images<br />
numérisées sont ensuite traitées au moyen du logiciel « Gap Light Analyzer » version 2.<br />
RESULTATS<br />
• Caractérisation des deux peuplements de pinède.<br />
Pinède des Forges.<br />
Ce peuplement est une futaie régulière (figure 1) dont les brins ont une circonférence<br />
comprise entre 30 et 195 cm. On trouve une densité de 550 brins par hectare.<br />
Pinède du carrefour des Noës (figure 2).<br />
Le peuplement est une futaie régulière dont l’ensemble des brins varie entre 35 et 160 cm<br />
de circonférence. La densité est de 550 brins de Pin par hectare en mélange avec des feuillus<br />
(densité totale : 1200 brins/ha).<br />
Les LAI des deux parcelles sont homogènes (figure 3). Pour la pinède des Forges les<br />
valeurs des parcelles varient entre 3,5 et 5. Les LAI de la pinède du carrefour des Noës<br />
varient, elles, entre 2 ,5 et 3,5. La valeur moyenne des LAI des Forges est supérieure à celle du<br />
carrefour des Noës, réciproquement 3,9 et 2,8. Le peuplement des Forges est moins dense il y<br />
a donc plus d’espace entre les arbres et par conséquent ils peuvent avoir une plus grande<br />
surface foliaire.<br />
3
nb de brins<br />
3,00<br />
2,00<br />
1,00<br />
0,00<br />
0-5<br />
10-15<br />
20-25<br />
30-35<br />
40-45<br />
50-55<br />
60-65<br />
70-75<br />
80-85<br />
90-95<br />
100-105<br />
110-115<br />
120-125<br />
130-135<br />
140-145<br />
150-155<br />
160-165<br />
170-175<br />
180-185<br />
190-195<br />
circonférence à 1m30 (cm)<br />
Figure 1 : Relation entre la note de dépérissement et la surface d'aubier chez le Pin maritime<br />
6<br />
5<br />
4<br />
Nombre de brins<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0-5<br />
5-10<br />
10-15<br />
15-20<br />
20-25<br />
25-30<br />
30-35<br />
35-40<br />
40-45<br />
45-50<br />
50-55<br />
55-60<br />
60-65<br />
65-70<br />
70-75<br />
75-80<br />
80-85<br />
85-90<br />
90-95<br />
95-100<br />
100-105<br />
105-110<br />
110-115<br />
115-120<br />
120-125<br />
125-130<br />
130-135<br />
135-140<br />
140-145<br />
145-150<br />
150-155<br />
155-160<br />
Circonférence à 1m30<br />
Figure 2 : Relation entre la note de dépérissement et la surface d'aubier chez le Pin sylvestre<br />
4
6<br />
5<br />
Valeur du LAI<br />
4<br />
3<br />
2<br />
LA I N oës<br />
LA I F orges<br />
1<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
n ° d e p a rc e lle<br />
Figure 3 : Répartition du LAI pour chaque parcelle<br />
• Caractéristiques des 15 Pins analysés sur la pinède des Forges (tableau I).<br />
Ce peuplement est âgé d’environ 70 ans. Les arbres mesurés ont entre 42 et 100 ans et se<br />
répartissent majoritairement dans les classes 1 et 2. Aucune relation entre la classe de<br />
dépérissement et l’âge des arbres n’a été observée.<br />
Tableau I : Répartition des classes de dépérissement et des âges<br />
E ssence classe Ag e (ans) Essence classe Ag e (ans)<br />
P in m aritim e 1 59 Pin m aritim e 3 75<br />
P in m aritim e 1 >50 Pin m aritim e 3 62<br />
P in m aritim e 2 69 Pin m aritim e 4 42<br />
P in m aritim e 2 >59 P in sylvestre 1 68<br />
P in m aritim e 2 100 P in sylvestre 1 79<br />
P in m aritim e 2 60 P in sylvestre 1 >65<br />
P in m aritim e 3 74 P in sylvestre 2 100<br />
Pin sylvestre 2 79<br />
• Evolution de la biomasse au cours du temps sur la parcelle des Forges (figure 4).<br />
L’accumulation de carbone est irrégulière au cours du temps. On peut remarquer quelques<br />
accidents pour les années 1976,1990 et 1996.<br />
10<br />
G en m²/ha<br />
8<br />
6<br />
4<br />
197<br />
4<br />
197<br />
9<br />
198<br />
4<br />
198<br />
9<br />
199<br />
4<br />
199<br />
9<br />
années<br />
Figure 4 : Evolution de la biomasse ligneuse dans la pinède des Forges<br />
5
• Etude de la croissance radiale en fonction de la classe de dépérissement.<br />
On a calculé l’accroissement moyen pour chaque classe de dépérissement. Pour les deux<br />
espèces de Pin on remarque que la croissance est irrégulière selon les années.<br />
Pour le Pin maritime (figure 5).<br />
Les accroissements sont décalés selon les classes de dépérissement, plus ces dernières sont<br />
élevées plus l’accroissement est faible. Les classes 1,2 et 3 ont une évolution parallèle<br />
d’autant plus marquée à la fin des années 70.<br />
Pour le Pin sylvestre (figure 6)<br />
Seules les classes 1 et 2 sont représentées pour cette espèce. On observe également une<br />
évolution en parallèle de la croissance. Ici aussi la classe la plus élevée a la croissance la plus<br />
faible. Toutefois en 1998 l’accroissement pour la classe 2 est plus important que celle de la<br />
classe 1.<br />
Accroissement en cm<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
Pin maritime classe 1<br />
Pin maritime classe 2<br />
Pin maritime classe 3<br />
Pin maritime classe 4<br />
1952<br />
1954<br />
1956<br />
1958<br />
1960<br />
1962<br />
1964<br />
1966<br />
1968<br />
1970<br />
1972<br />
1974<br />
1976<br />
1978<br />
1980<br />
1982<br />
1984<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
Année<br />
Figure 5 : Accroissement annuel moyen par classe chez le Pin maritime<br />
3<br />
Accroissement en cm<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
Pin sylvestre classe 1<br />
Pin sylvestre classe 2<br />
0<br />
1952<br />
1954<br />
1956<br />
1958<br />
1960<br />
1962<br />
1964<br />
1966<br />
1968<br />
1970<br />
1972<br />
1974<br />
1976<br />
1978<br />
Année<br />
1980<br />
1982<br />
1984<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
Figure 6 : Accroissement annuel moyen par classe chez le Pin sylvestre<br />
6
• Relation entre la surface terrière et la classe de dépérissement.<br />
Pour le Pin maritime il existe une faible corrélation négative entre le dépérissement et la<br />
surface terrière comme nous le montre le R² de 13% (figure 7). Plus la classe de<br />
dépérissement est élevée plus la surface terrière est faible. Par contre il n’existe pas de relation<br />
dans le cas du Pin sylvestre car on trouve un R² de 0% (figure 8).<br />
surface terrière (cm²)<br />
4000,00<br />
3500,00<br />
3000,00<br />
2500,00<br />
2000,00<br />
1500,00<br />
1000,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
R 2 = 0,1317<br />
0 1 2 3 4<br />
note de dépérissement<br />
Figure 7 : Relation entre la note de dépérissement et la surface terrière chez le Pin maritime<br />
Figure 8 : Relation entre la note de dépérissement et la surface terrière chez le Pin sylvestre<br />
7
• Relation entre la note d’amidon et la classe de dépérissement.<br />
Une estimation des teneurs en amidon racinaire sur l’échantillon de cinq Pins sylvestres<br />
montre qu’il existe une forte corrélation (R²=95% voir figure 9) entre ces deux paramètres.<br />
Cette forte corrélation peut être tributaire de la taille relativement faible de l’échantillon. En<br />
effet sur un échantillon de dix Pins maritimes on ne révèle pas de corrélation (R²=2% voir<br />
figure 10).<br />
Figure 9 : Relation entre la note de dépérissement et la note amidon chez le Pin maritime<br />
Figure 10 : relation entre la note de dépérissement et la note amidon chez le Pin sylvestre<br />
8
• Relation entre la surface d’aubier et la classe de dépérissement.<br />
Nous avons cherché à déterminer si la surface d’aubier est un bon indicateur de la santé de<br />
l’arbre. Chez le Pin maritime il existe une corrélation statistiquement significative (R²=33%<br />
voir figure 11). Une grande largeur d’aubier correspond à un bon état phytosanitaire. L’étude<br />
du Pin sylvestre quand à elle ne nous permet pas de révéler une corrélation significative<br />
(R²=6% voir figure 12).<br />
Figure 11 : Relation entre la note de dépérissement et la surface d'aubier chez le Pin maritime<br />
Figure 12 : Relation entre la note de dépérissement et la surface d'aubier chez le Pin maritime<br />
DISCUSSION<br />
Les parcelles des Forges et du carrefour des Noës ont le même régime sylvicole (figures 1<br />
et 2), futaie régulière avec peu de jeunes plants, et de densité équivalente en ce qui concerne<br />
les essences de Pins. D’un point de vue purement morphologique, on a deux peuplements<br />
relativement homogènes, âgés d’environ 70 ans (tableau 1), avec une majorité d’arbres<br />
présentant une perte foliaire inférieure à 60% (classe de dépérissement 1 et 2).<br />
L’indice foliaire apparaît homogène dans les deux sites mais il est plus élevé au niveau de<br />
la station des Forges (figure 3). La densité de brins à l’hectare y est plus faible d’où un<br />
espacement plus grand entre les brins et un plus grand angle du houppier.<br />
On peut également remarquer une absence de champignon pathogène, comme la Collybie,<br />
mais la présence d’Armillaria sp. sur un arbre de classe 1 sans symptômes d’attaque. Il s’agit<br />
donc d’un parasite secondaire dans la mesure où il attend l’affaiblissement du sujet pour<br />
intervenir. Nous avons étudié ensuite la teneur en amidon. La classe 3 majoritairement<br />
9
eprésentée dans le peuplement reflète également une activité correcte de mise en réserve par<br />
les racines.<br />
Dans l’histoire des parcelles, plusieurs événements se sont succédés, pouvant les affaiblir à<br />
chaque fois un peu plus. D’après l’analyse de la vitesse d’accroissement de la biomasse<br />
(figure 4), trois années semblent importantes pour le peuplement : 1976, 1990 et 1996. Les<br />
deux premières correspondent respectivement à des conséquences de phénomènes climatiques<br />
(le gel) et physiques (l’incendie). Par contre, le site des Forges a subi récemment une attaque<br />
de parasites, sans doute en 1996. La biomasse ligneuse augmente depuis les 3 dernières<br />
années.<br />
L’étude succinte du peuplement nous conduit à conclure à un faible dépérissement de la<br />
pinède. Nous allons maintenant essayer de savoir s’il existe une corrélation entre les différents<br />
critères étudiés sur ce peuplement.<br />
A partir des études de perte foliaire (figures 5 et 6), il semblerait que depuis 1970<br />
l’influence du dépérissement se fasse ressentir, surtout dans les deux dernières années pour les<br />
deux essences. En effet, il existe une faible corrélation entre les classes de dépérissement et la<br />
surface terrière ( figures 7 et 8). Une confirmation est nécessaire puisque un faible effectif a<br />
été échantillonné.<br />
Pour Pinus maritima, la surface d’aubier serait un bon critère d’estimation de la santé du<br />
peuplement (figures 11 et 12). En effet, la vitalité de l’arbre dépend de son état sanitaire. La<br />
quantité de bois vivant diminue car l’arbre a une moindre surface photosynthétique. Ce critère<br />
n’est pas retenu pour Pinus sylvatica.<br />
La teneur en amidon des racines ne semble pas être un bon critère de diagnostic pour les<br />
Pinacées malgré la faible corrélation visible chez le Pin sylvestre (figures 9 et 10).<br />
Théoriquement, la réserve en amidon est fonction de la surface foliaire, la photosynthèse étant<br />
le mécanisme source de la production de sucres.<br />
D’après ces études, les marqueurs de dépérissement dépendraient de l’espèce. Les différentes<br />
espèces ne réagissent pas de la même manière aux attaques extérieures.<br />
Finalement, de nombreuses critiques sont à apporter à nos résultats.<br />
Il faut noter que la méthode utilisée, consistant en une appréciation visuelle du houppier<br />
des arbres, est extrêmement subjective. En effet, la note donnée à un même pied peut varier<br />
considérablement d’un observateur à l’autre. Même si l’évaluation était homogène, il reste<br />
toujours le problème de l’ « arbre de référence » : l’arbre sain sur lequel se base la notation.<br />
On ne peut donc pas objectivement faire un bilan de santé global pour cette parcelle, mais<br />
seulement établir une comparaison qualitative des arbres des différentes classes de<br />
dépérissement.<br />
Une autre remarque est à apporter. Pour l’établissement du code de couleur de la teneur en<br />
amidon des racines, nous avons utilisé la méthode décrite pour les espèces caducifoliées<br />
(d’après le mémoire de stage de Fanget G.). Or les classes sont établies qualitativement. La<br />
corrélation entre la couleur et le taux d’amidon n’est pas vérifiée. La détermination de la<br />
teneur en amidon par une méthode enzymatique confirmerait et affinerait notre code.<br />
Il faut noter également le nombre réduit d’arbres inventoriés, celui-ci pouvant rendre les<br />
résultats peu significatifs et influencer sur la représentativité de l’aire étudiée par rapport à<br />
l’ensemble de la parcelle.<br />
Par ailleurs, nous avons recherché une relation entre des facteurs concernant tout le<br />
peuplement et d’autres se reportant seulement à quelques individus (toujours choisis plus ou<br />
moins aléatoirement). Cependant, une échelle n’est pas nécessairement le reflet de l’autre, la<br />
conversion entraînant une accumulation d’erreurs.<br />
10
CONCLUSION<br />
Au cours de cette étude sur les deux parcelles, l’état phytosanitaire des résineux n’apparaît<br />
pas dramatique, il apparaît même plutôt satisfaisant.<br />
L’observation à plusieurs reprises d’Armillaria sp. et de chenilles processionnaires du Pin<br />
(Thaumetopoea pityocampa) indique qu’il faudrait faire en parallèle une étude d’abondance<br />
de parasites. S’il existe une corrélation positive entre le dépérissement et la présence de<br />
parasites il sera nécesssaire de rechercher des moyens de lutte contre cette nuisance.<br />
De plus, afin de préciser et compléter les résultats, il faudrait aussi réaliser une étude plus<br />
approfondie des facteurs environnementaux influant sur l’état de la végétation tels que la<br />
topographie, les stress climatiques, la pollution locale qui pourraient expliquer l’état de santé<br />
des peuplements. Là encore, il serait peut-être possible de mettre en place des méthodes de<br />
lutte et de prévention.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
BOUYER, J. (1996) Méthodes stastistiques. ESTEM, INSERM. 354 p.<br />
FANGET, G. (1998) Etude méthodologique d’appréciation détaillée des symptômes de<br />
dommages forestiers sur des placettes de suivi dans des écosystèmes forestiers et sur<br />
quelques massifs dépérissants sur trois essences feuillues. Rapport de fin d’études de la<br />
FIF, 82 p.<br />
HARTMAN, NIENHAUS, BUTIN. (1991) Les symptômes de dépérissement des arbres<br />
forestiers. IDF, 255 p.<br />
LANIER, L. (1994) Précis de sylviculture. Seconde édition, ENGREF, Nancy, 476 p.<br />
<strong>PAR</strong>DE, J., BOUCLON, J. (1988) Dendrométrie. Seconde édition, ENGREF, Nancy,327 p.<br />
RAMEAU, J.C., MANSION, D., DUME, G. (1993) Flore forestière française, volume 1.IDF,<br />
2421 p.<br />
TOUFFET, J. (1970) Aperçu sur la végétation de la région de Paimpont. Série H, Botanica<br />
Rhedonica, 29-64 p.<br />
11