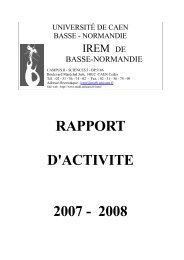Le chapitre Probabilités en troisième - Le portail des IREM
Le chapitre Probabilités en troisième - Le portail des IREM
Le chapitre Probabilités en troisième - Le portail des IREM
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REPERES - <strong>IREM</strong>. N° 78 - janvier 2010LE CHAPITRE PROBABILITESEN TROISIEMEface bleue ou rouge suivant les jetons) 50 foiset noter le nombre de fois qu’apparaît chacune<strong>des</strong> faces.<strong>Le</strong> matériel utilisé est un lot de jetons bicolores(blanc et bleu ou blanc et rouge) que j’aicommandé chez un marchand de matérielpour école primaire (Celda). Nous avons comm<strong>en</strong>cépar nous mettre d’accord sur le fait quetous les jetons donnés étai<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tiques,donc il n’y avait pas de face qui devait être privilégiée.Puis nous avons défini notre façon delancer le jeton et de lire le résultat : nousavons décidé de jeter le jeton <strong>en</strong> l’air, l’attraperpuis le retourner et lire la face du <strong>des</strong>sus.Généralem<strong>en</strong>t, les élèves se sont partagéles tâches, l’un effectuant le lancer etl’autre notant le résultat ; puis ils comptabilis<strong>en</strong>tles apparitions de chacune <strong>des</strong> faces. Cesrésultats sont <strong>en</strong>suite notés sur une feuille detableur vidéo projetée comme pour l’activitéprécéd<strong>en</strong>te.Voici, page ci-contre, dans les colonnes 2et 3, les résultats obt<strong>en</strong>us par les 21 élèves.Nous constatons que les résultats sont disparateset que personne n’a trouvé le mêm<strong>en</strong>ombre de blancs que de couleurs. Pourtant,cela ne fait pas changer les élèves d’avis surle fait que le nombre de chances d’avoir un côtéou l’autre est le même. <strong>Le</strong>s élèves ont alors notésur leur cahier d’exercice « On peut dire quele jeton est symétrique donc il y a autant dechances qu’il tombe sur la couleur que sur leblanc. En terme de chance : 1 chance sur 2 ».Considérant que tous les essais étai<strong>en</strong>t faitsavec le même matériel et dans les mêmesconditions, nous cumulons alors les résultats.Dans les colonnes 4 et 5, le cumul a étéfait de haut <strong>en</strong> bas, et dans les colonnes 6 et7, il a été fait de bas <strong>en</strong> haut.Nous observons dans les colonnes 4 et 5que le nombre de blancs est toujours supérieurau nombre de couleurs. Mais dans les colonnes6 et 7, nous voyons que le nombre de couleursest supérieur au nombre de blancs puis les résultatss’équilibr<strong>en</strong>t d’abord pour finalem<strong>en</strong>tdonner un nombre de blancs supérieur. Nous<strong>en</strong> déduisons que la façon de cumuler peut am<strong>en</strong>erdiffér<strong>en</strong>tes interprétations.Grâce à aux colonnes 6 et 7, j’ai aussi purev<strong>en</strong>ir sur l’idée intuitive mais fausse que « plusle nombre de lancer est important, plus lerésultat est juste ». Or dans ces colonnes, lerésultat att<strong>en</strong>du est obt<strong>en</strong>u (400 pour chaque)puis on le « perd ». J’<strong>en</strong> ai profité pour insistersur le fait que l’augm<strong>en</strong>tation du nombrede lancers réduit généralem<strong>en</strong>t l’écart <strong>en</strong>trela valeur théorique et la valeur expérim<strong>en</strong>tale,mais nous pouvons avoir la réponse att<strong>en</strong>due(ici à 400 lancers), puis la perdre...Cette activité a nécessité <strong>en</strong>viron troisquarts d’heure. Elle a permis d’insistersur le fait que l’augm<strong>en</strong>tation du nombrede tirages ne donne pas pour autant lavaleur att<strong>en</strong>due : cela ne fait que minimiserl’écart <strong>en</strong>tre la valeur att<strong>en</strong>due et lavaleur expérim<strong>en</strong>tale ; mais nous pouvonstout à fait r<strong>en</strong>contrer la valeur att<strong>en</strong>due aubout d’un certain nombre de tirages et neplus l’avoir après. Elle a égalem<strong>en</strong>t permisd’insister sur les deux approches possibleset le li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre les deux. <strong>Le</strong>s élèves ont notésur le cahier d’exercice que, dans le cas dulancer de jetons, on estime le résultat a prioriet que dans le cas de la bouteille mystère,on avait estimé le résultat aprèsl’expéri<strong>en</strong>ce, donc nous avons estimé lerésultat a posteriori. En passant, cela a permisaux élèves latinistes de rappeler àtous qu’il ne faut pas mettre d’acc<strong>en</strong>t surle « a » de a priori et de a posteriori.62