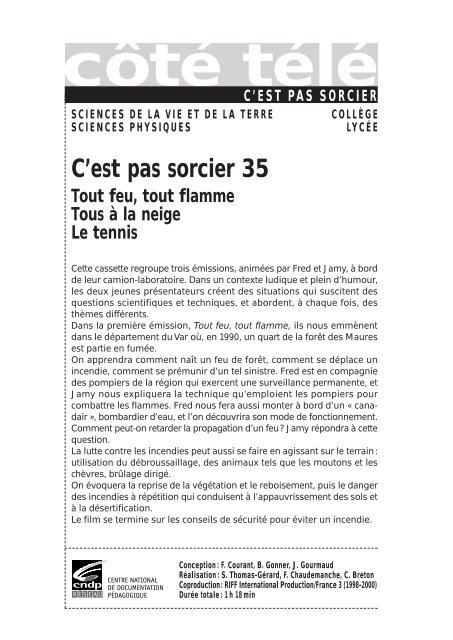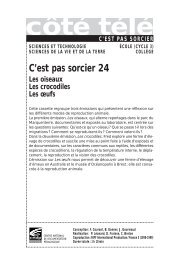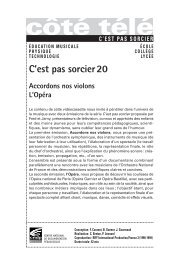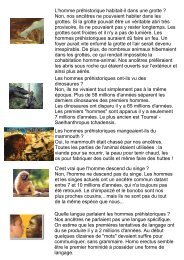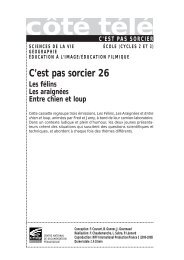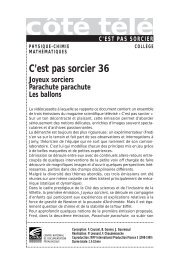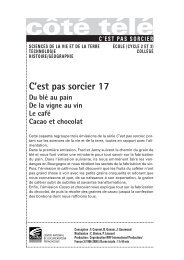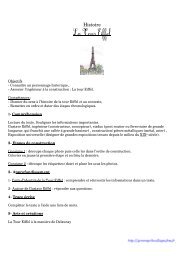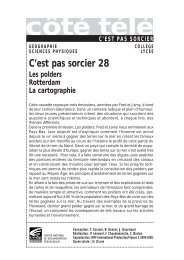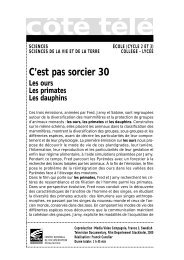Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
côté téléSCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRESCIENCES PHYSIQUESC’est <strong>pas</strong> <strong>sorcier</strong> <strong>35</strong>Tout feu, tout flammeTous à la neigeLe tennisC’EST PAS SORCIERCOLLÈGELYCÉECette cassette regroupe trois émissions, animées par Fred et Jamy, à bordde leur camion-laboratoire. Dans un contexte ludique et plein d’humour,les deux jeunes présentateurs créent des situations qui suscitent desquestions scientifiques et techniques, et abordent, à chaque fois, desthèmes différents.Dans la première émission, Tout feu, tout flamme, ils nous emmènentdans le département du Var où, en 1990, un quart de la forêt des Mauresest partie en fumée.On apprendra comment naît un feu de forêt, comment se déplace unincendie, comment se prémunir d’un tel sinistre. Fred est en compagniedes pompiers de la région qui exercent une surveillance permanente, etJamy nous expliquera la technique qu’emploient les pompiers pourcombattre les flammes. Fred nous fera aussi monter à bord d’un « canadair», bombardier d’eau, et l’on découvrira son mode de fonctionnement.Comment peut-on retarder la propagation d’un feu? Jamy répondra à cettequestion.La lutte contre les incendies peut aussi se faire en agissant sur le terrain :utilisation du débroussaillage, des animaux tels que les moutons et leschèvres, brûlage dirigé.On évoquera la reprise de la végétation et le reboisement, puis le dangerdes incendies à répétition qui conduisent à l’appauvrissement des sols età la désertification.Le film se termine sur les conseils de sécurité pour éviter un incendie.Conception : F. Courant, B. Gonner, J. GourmaudRéalisation : S. Thomas-Gérard, F. Chaudemanche, C. BretonCoproduction : RIFF International Production/France 3 (1998-2000)Durée totale : 1 h 18 min
Dans la deuxième émission, Tous à la neige, Sabine invite Fred et Jamyà <strong>pas</strong>ser un week-end à la neige.Dans le superbe décor de la vallée de Chamonix, nos amis vont nousfaire découvrir comment se forment les cristaux de glace, comment fonctionneun canon à neige, les positions que l’on doit adopter pour aller viteen skiant, pourquoi les skis glissent ; nous saurons aussi tout sur le skimoderne.En prenant le téléphérique de l’Aiguille du midi, Jamy et Fred nous expliquerontle fonctionnement des câbles qui permettent la montée vers lesplus hauts sommets, et nous apprendrons comment s’est construit cetéléphérique.Sabine et Fred partent en compagnie d’un guide faire du ski hors piste :quelles précautions faut-il prendre pour une telle randonnée?Qu’est-ce qu’une avalanche et pourquoi se déclenche-t-elle ? Jamy endonnera l’explication. Il nous expliquera aussi pourquoi il est difficile derespirer en altitude.Le film se termine sur l’ascension du Mont Blanc.Fred s’entraîne au tennis avec l’ambition de participer au tournoi surterre battue de Monte-Carlo. Cette troisième émission, Le tennis, nousinvite à retrouver les principaux champions du jour, et l’on apprendrace qu’est l’ATP (Association des joueurs de tennis professionnels) etquels sont les tournois du grand schelem. En parcourant le Royal SportingClub de Monte-Carlo, on fera l’historique du tennis depuis le jeu depaume jusqu’à nos jours ; on nous expliquera tout sur les raquettes : leurévolution, le cordage, la tension des cordes.Une démonstration de service par le détenteur du record du monde devitesse (240 km/h) sera faite et, avec Henri Leconte, on verra les différentseffets que l’on peut donner à la balle; le coup droit lifté et le revers coupén’auront plus de secret quand Jamy en donnera une explication imagée.On verra ensuite la constitution et la fabrication des balles, la préparationd’un court en terre battue. L’émission se termine avec les traumatismesengendrés par le tennis (épicondylite, douleurs à l’épaule et aux abdominaux)et la préparation mentale du champion.DISCIPLINESS, CLASSES ET PROGRAMMESTout feu, tout flamme– SVT, collège, 6 e : Découverte d’un milieu naturel.– Sciences physiques, collège, 4 e : Qu’est-ce que brûler? Réaliser et décrireune expérience de combustion.– SVT et sciences physiques, collège, 3 e : Approche transdisciplinaire del’environnement.– SVT, lycée, 1 re ES : Importance et gestion des écosystèmes forestiers ;participation du bois aux grands équilibres de la planète.La forêt participe aux cycles de l’eau et du carbone ; elle représente unstock biologique de carbone. Sa destruction massive par des phénomènesnaturels ou par l’homme (incendies, combustion, etc.) peutperturber ces grands cycles.. 2 C’EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
Tous à la neige– Sciences physiques, collège, 5 e : Observations de solides et de liquidesfamiliers ; propriétés spécifiques de chaque état ; mettre en évidence laforme propre de l’eau solide (glace).– SVT, collège, 5 e : Comparaison des fréquences respiratoire et cardiaqueau repos et au cours d’une activité physique.– Sciences physiques, collège, 3 e : Être capable d’utiliser la conditiond’équilibre ; équilibre ou non équilibre d’un objet soumis à deux forcescolinéaires.– SVT, collège, 2 nde : Relations entre activité physique et paramètresphysiologiques.L’augmentation de l’activité physique s’accompagne d’un accroissementde la consommation de dioxygène et de nutriments par les cellulesmusculaires. L’effort physique est associé à la variation de l’activité dessystèmes circulatoire et respiratoire.Le tennis– SVT, collège, 5 e : Anatomie musculaire ; muscles au repos, musclescontractés.Contractions et relâchements coordonnés des muscles assurent les mouvementsentraînant le déplacement des os sur lesquels ils sont fixés pardes tendons.– Sciences physiques, collège, 3 e : Notion de trajectoire.À partir de situations mises en scène en classe ou de documents vidéo,inventorier les actions de contact ou à distance.Action exercée sur un objet par un autre objet, effets observés.Identifier l’objet d’étude sur lequel s’exerce l’action, distinguer les différentseffets de l’action.OBJECTIFS DE LA SÉRIE– Expliquer le monde qui nous entoure, mais aussi les technologies auservice de notre vie quotidienne. C’est ainsi qu’à bord de leur gigantesquecamion-laboratoire, Frédéric Courant et Jamy Gourmaud, les deux dynamiquesanimateurs de l’émission, nous emmènent vers des sites insoliteset parfois spectaculaires.– Faire découvrir des lieux auxquels on n’a <strong>pas</strong> toujours accès et nous guiderainsi au cœur du sujet. C’est Fred, curieux et aventurier, qui mèneles observations « grandeur nature ».– Mettre en évidence des observations, grâce à des expériences simples réaliséesdans le camion-laboratoire. C’est le rôle de Jamy, érudit et pédagogue.– Illustrer de façon claire et ludique des théories scientifiques et diversphénomènes de la nature, grâce à des expériences et des maquettesanimées, colorées et astucieuses.– Comprendre « comment ça marche » à chacune des étapes de ce voyageau cœur de la science et de la découverte. La porte s’ouvre et le téléspectateur<strong>pas</strong>se du laboratoire à la réalité, de la théorie à la pratique.– Rencontrer des hommes de terrain: spécialistes, chercheurs, aventuriers,ingénieurs, sportifs. Leurs interventions viennent compléter les repor-. 3 C ’ EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
tages et les images insolites et inédites, que nous fait découvrir le sympathiqueduo des jeunes animateurs.– Amener le public à constater que l’on peut aussi apprendre en <strong>pas</strong>santvingt-six minutes divertissantes, et que la science, finalement, « c’est<strong>pas</strong> <strong>sorcier</strong> » !OBJECTIFS DES ÉMISSIONSTout feu, tout flamme– Prendre conscience qu’il faut protéger notre environnement, et particulièrementla forêt.– Les combustions dans l’air, la pyrolyse.Tous à la neige– L’eau à l’état solide : les cristaux de glace et la formation de la neige.– Montrer pourquoi on a du mal à respirer en montagne.Le tennis– Mise en évidence de la trajectoire d’un mobile.– Interactions entre deux solides.– Traumatismes des tendons.MOTS-CLÉSTout feu, tout flammeEssences, pyrolyse, terpènes, produit moussant, propagation, dilatation.Tous à la neigeCristal, changement d’état, câble porteur, câble tracteur.. 4 C ’ EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
DÉCOUPAGE NARRATIFTout feu, tout flamme00min 00sGénérique et début de l’émission.Fred est aux environs de Marseille dans une forêt qui vient de brûler ; ilpart dans les Maures où, en 1990, de violents incendies ont détruit unquart de la forêt.Interview de Rémy Schmitt (Office National des Forêts).02 min 00 sPrésentation de la forêt méditerranéenne et de ses espèces.Comment prend le feu ? Explication animée.04 min 00 sLes essences méditerranéennes.Comment le feu brûle-t-il ? La pyrolyse.Comment se déclare un incendie? Spots publicitaires des années 1960 surce thème.06 min 00 sLa mesure de la teneur en eau des végétaux.Interview de Raphaël Grossiord (INRA).La propagation d’un incendie par le vent ; explication animée.Détermination du risque d’incendie.Interview de Philippe Nardin (chef d’État major – CIRCOSC).08 min 15 sLa surveillance au sol par l’Office National des Forêts.Interview de Alain Lavignac (guetteur-tour du Mont Jean).Jamy explique le phénomène physique de la propagation de la chaleur.Exemples lors d’incendies dans le département du Var.11 min 15 sLes pompiers : la reconnaissance des départs de feu et la pratique ducombat des incendies ; explication animée.Interview de Richard Salomon (caporal chef – Groupe Cogolin).14 min 45 sLes bombardiers d’eau.Leur fonctionnement, le remplissage des réservoirs.17 min 00 sPourquoi utilise-t-on des produits moussants? Explication expérimentale.Le largage de l’eau par les canadairs.Interview de Christian Thooris (chef de secteur canadair).L’utilisation de « retardant » qui capte la chaleur. Comment doit-on le placer?Interview de René Dies (commandant – Service d’Incendie et de Secours).20 min 30 sLes coupe-feu et le débroussaillage.L’emploi des animaux (moutons, chèvres).Le brûlage dirigé.Interview de François Binggeli (Espaces méditerranéens).. 5 C ’ EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
23 min 00 sLa reprise de la végétation et le reboisement.Le danger des incendies à répétition ; explication animée.25 min 00 sLe reboisement et les conseils de sécurité.Générique de fin.Tous à la neige26 min 00 sGénérique et début de l’émission.Du haut de l’aiguille du midi. Historique et présentation des activités dela montagne dans la vallée de Chamonix.28 min 30 sLes cristaux de glace, leur forme et leur formation.30 min 30 sLe canon à neige, son mode de fonctionnement ; explication animée.31 min 30 sLa position de recherche de vitesse et les conseils de Luc Alphand pouraller vite en ski.34 min 30 sPourquoi les skis glissent-ils ?Comment le fartage améliore-t-il la glisse ?Interview de Vanko Maruzzi (École Nationale de ski et d’alpinisme).36 min 30 sLe skis modernes et le snowboard.Interview de Tony Roos (École du ski français – Argentière).38 min 00 sLe fonctionnement d’un téléphérique ; explication imagée.Comment évacuer les cabines en cas de panne ?Interview de Olivier Vezinhet (directeur opérations – Grands Montets).41 min 00 sLe ski hors piste ; les précautions à prendre.Interview de Raymond Ducroz (guide de haute montagne – Chamonix).44 min 30 sLes avalanches. Explications du déclenchement d’une avalanche.Quelques exemples. Le déclenchement volontaire des avalanches.46 min 30 sLe manque d’oxygène en montagne. Explication du manque de tonusmusculaire.48 min 00 sL’ascension du Mont Blanc.La luge, le bob.Générique de fin.. 6 C ’ EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
Le tennis52 min 00 sGénérique et début de l’émission.Fred part à Monte-Carlo dans l’espoir de participer au tournoi de tennis.Présentation du tournoi et des principaux joueurs.54 min 15 sLes conditions d’inscription. Le classement ATP. Les tournois du grandschelem.55 min 00 sL’ancêtre du tennis : le jeu de paume ; principe de ce jeu, évolution versle jeu moderne.56 min 30 sPourquoi les raquettes sont-elles cordées ? Explication imagée.Pourquoi faut-il centrer la balle ? Explication théorique.59 min 15 sLes cordages, leurs réglages. Explication de la tension du cordage.Interview de Bruno Jalosinski (cordeur).Les différents matériaux : le boyau, le synthétique.Interview de Jean-Jacques Poupon (cordeur).1 h 02 min 30 sLes raquettes : leur évolution au cours du temps.Interview de Patrice Dominguez.1 h 04 min 30 sLa vitesse au service, sa mesure.Comment servir vite ? Explication théorique.1 h 07 min 00 sLa perception de la balle par les joueurs.Interview de Henri Leconte.1 h 08 min 00 sLes effets donnés à une balle : le coup droit lifté et le revers coupé avecexplications théoriques, l’amorti, le « <strong>pas</strong>sing », le lob.1 h 12 min 00 sLes balles. Pourquoi doit-on changer souvent de balle ? Leur constitutionet leur fabrication.1 h 13 min 30 sLa terre battue.La préparation du court.Interview de Michel Garcia (préparateur terre battue).1 h 14 min 15 sLes traumatismes du tennis: l’épicondylite, les traumatismes de l’épaule,des abdominaux.Interview de Paul Dorochenco (kinésithérapeute).1 h 15 min 15 sFred renonce à participer.Générique de fin.. 7 C ’ EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
PRÉSENTATION NOTIONNELLEPOUR UNE EXPLOITATION PÉDAGOGIQUETout feu, tout flammeL’utilisation du document peut se faire par plusieurs entrées possibles :– On peut utiliser la totalité du document en SVT comme introduction àl’importance des écosystèmes forestiers et de leur gestion (cf. programmede 1 re ES) avec un questionnaire pour montrer que sa destruction massivepar des phénomènes naturels ou par l’homme (incendies, combustion,etc.) peut perturber ces grands cycles.– Une étude sur « comment le feu brûle-t-il ? » peut aussi être menée enutilisant deux minutes de ce document (de 04 min à 06 min). Après projection,une activité documentaire avec questionnement sur la combustionpeut être réalisée en classe de physique de 4 e .– Au collège, classe de 3 e , ce document pourra servir de base à une étudecoordonnée physique-chimie – SVT – éducation civique : « Approchetransdisciplinaire de l’environnement ».Tous à la neige– En classe de 5 e , on peut illustrer l’eau à l’état solide en montrant ledocument (de 02min 30s à 05min 30s) qui explique la forme des cristauxde glace et la fabrication de la neige par les canons à neige.– En classe de 3 e en sciences physiques :- la partie modification d’un mouvement par frottement peut trouverune illustration avec l’explication de « pourquoi les skis glissent-ils »et l’utilisation du fartage (08 min 30 s à 10 min 30 s) ;- après questionnement sur l’équilibre d’un système sur un plan incliné,on peut illustrer le propos à partir de la partie du film concernant ledépart des avalanches (de 18 min 00 s à 20 min 30 s).– En SVT, en classe de 2 nde , pour illustrer les relations entre activité physiqueet paramètres physiologiques, on peut utiliser la partie du film traitantdu manque d’oxygène en montagne, avec pour conséquence lemanque de tonus musculaire (de 20 min 30 s à 22 min 00 s).Le tennis– Ce document peut être exploité en TPE à propos du thème « Espace etmouvement », en collaboration avec le professeur d’EPS, pour étudierles différents effets que peut prendre une balle de tennis avec explicationsthéoriques (de 16 min 00 s à 19 min 30 s).– Au collège, ce document pourra servir de base à une étude des différentestrajectoires suivies par une balle suivant l’effet qu’elle a (de16 min 00 s à 19 min 30 s).– En 3 e , on pourra illustrer la notion d’interaction entre deux solides en prenantpour exemple le cordage de la raquette (de 04min 30s à 07min 15s).– En physique 1 re S, on peut utiliser la partie du film concernant le service(de 12 min 30 s à 15 min 00 s) pour illustrer la vitesse linéaire et la vitesseangulaire.. 8 C ’ EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
– En SVT, classe de 5 e , on pourra illustrer la partie : Identifier, à partir dedocuments, la nature d’une lésion du squelette ou de la musculatureaffectant le mouvement, en utilisant le film expliquant le tennis-elbow(de 22 min 15 s à 24 min 15 s).. 9 C ’ EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
. 11 C ’ EST PAS SORCIER <strong>35</strong> .
Livret rédigé par Yves Weiss © CNDP, 2001Programmes audiovisuels libérés de droits pour une utilisation en classeDepuis janvier 1995, la politique de soutien du ministère de l’Éducation nationale en matièred’achat de droits a permis d’acquérir près de 400 heures de programmes. Cette action s’inscritdans le cadre de la politique ministérielle qui favorise l’utilisation, dans les écoles et les établissementsscolaires, par les enseignants, de programmes audiovisuels en conformité avec lecode de la Propriété littéraire et artistique. Elle en permet l’usage licite (droit d’enregistrementau moment de la télédiffusion, droit d’utilisation de vidéocassettes dans les établissementsd’enseignement en France et à l’étranger dépendant du ministère). Cette sélectionmarque l’intérêt du ministère pour des œuvres qui, de par leur thème et leur qualité, sont susceptiblesd’être exploitées en classe. C’est l’outil télévisuel en tant que tel, pouvant être utilisécomme support de cours ou comme objet d’une étude critique, qui est mis à votre disposition.Pour une information plus complète sur les actions du ministère en matière d’audiovisuel,un forum et une rubrique « Les ressources audiovisuelles » sont ouverts sur le serveur Internetdu ministère : éducnet.éducation.fr (rubrique « Ressources multimédias »).