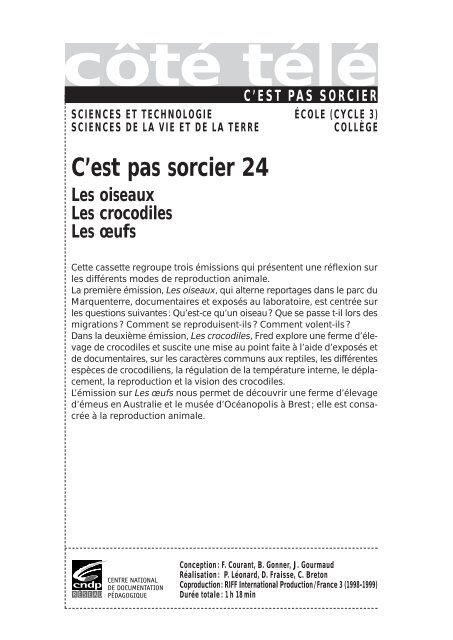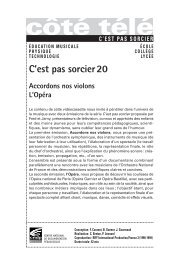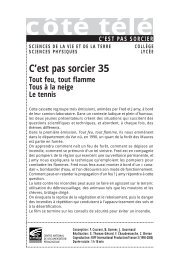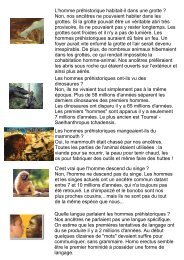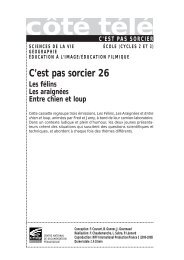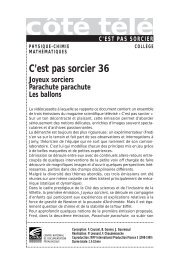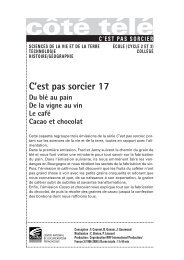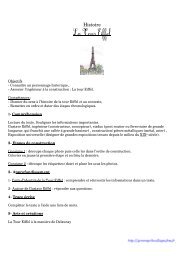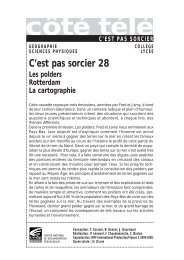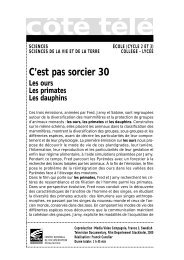C'est pas sorcier 24 - pupitre
C'est pas sorcier 24 - pupitre
C'est pas sorcier 24 - pupitre
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
côté téléC’est <strong>pas</strong> <strong>sorcier</strong> <strong>24</strong>Les oiseauxLes crocodilesLes œufsC’EST PAS SORCIERSCIENCES ET TECHNOLOGIE ÉCOLE (CYCLE 3)SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRECOLLÈGECette cassette regroupe trois émissions qui présentent une réflexion surles différents modes de reproduction animale.La première émission, Les oiseaux, qui alterne reportages dans le parc duMarquenterre, documentaires et exposés au laboratoire, est centrée surles questions suivantes: Qu’est-ce qu’un oiseau? Que se <strong>pas</strong>se t-il lors desmigrations ? Comment se reproduisent-ils ? Comment volent-ils ?Dans la deuxième émission, Les crocodiles, Fred explore une ferme d’élevagede crocodiles et suscite une mise au point faite à l’aide d’exposés etde documentaires, sur les caractères communs aux reptiles, les différentesespèces de crocodiliens, la régulation de la température interne, le déplacement,la reproduction et la vision des crocodiles.L’émission sur Les œufs nous permet de découvrir une ferme d’élevaged’émeus en Australie et le musée d’Océanopolis à Brest ; elle est consacréeà la reproduction animale.Conception : F. Courant, B. Gonner, J. GourmaudRéalisation : P. Léonard, D. Fraisse, C. BretonCoproduction : RIFF International Production / France 3 (1998-1999)Durée totale : 1 h 18 min
DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMESSciences et technologie, école élémentaire, cycle 3 : Unité et diversité dumonde vivant : les stades de développement d’un être vivant (végétalou animal) ; les divers modes de reproduction (animale et végétale).SVT, collège, 6 e : Diversité, parenté et unité des êtres vivants. Un élevageou une culture.SVT, collège, cycle central : Êtres vivants dans leur milieu : reproductionsexuée et pérennité des espèces dans les milieux.OBJECTIFS DE LA SÉRIE– Expliquer le monde qui nous entoure, mais aussi les technologies auservice de notre vie quotidienne. C’est ainsi qu’à bord de leur gigantesquecamion-laboratoire, Frédéric Courant et Jamy Gourmaud, les deux dynamiquesanimateurs de l’émission, nous amènent vers des sites insoliteset parfois spectaculaires.– Faire découvrir des lieux auxquels on n’a <strong>pas</strong> toujours accès et nousguider au cœur du sujet. Ce sont Fred et Jamy, curieux et aventuriers,qui mènent les observations « grandeur nature ».– Mettre en évidence des observations, grâce à des expériences simplesréalisées dans le camion-laboratoire. C’est le rôle de Jamy, érudit etpédagogue.– Illustrer de façon claire et ludique des théories scientifiques et diversphénomènes de la nature, grâce à des expériences et des maquettesanimées, colorées et astucieuses.– Comprendre « comment ça marche » à chacune des étapes de ce voyageau cœur de la science et de la découverte. La porte s’ouvre et le téléspectateur<strong>pas</strong>se du laboratoire à la réalité, de la théorie à la pratique.– Rencontrer des hommes de terrain: spécialistes, chercheurs, aventuriers,ingénieurs, sportifs. Leurs interventions viennent compléter les reportageset les images insolites et inédites, que nous fait découvrir le sympathiqueduo de jeunes animateurs.– Amener le public à constater que l’on peut aussi apprendre en <strong>pas</strong>santvingt-six minutes divertissantes, et que la science, finalement, « c’est<strong>pas</strong> <strong>sorcier</strong> » !LES OBJECTIFS DES ÉMISSIONSObjectifs communs de ces trois émissions :– Réaliser des expériences ou manipuler des maquettes pour apporter desréponses à des questions ou des problèmes formulés au cours de la partieenquête sur le terrain.Concernant la reproduction– Décrire comment se forme un œuf de poule.– Comprendre que chez toutes les espèces, la femelle produit des ovules.– Réaliser la nécessité de la fécondation : fusion entre le gamète mâle etle gamète femelle qui produit la cellule œuf.– Comprendre le rôle du mâle et celui de la femelle.– Distinguer la fécondation externe et la fécondation interne.– Différencier les espèces ovipares et vivipares.2C’EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
– Décrire le développement embryonnaire chez les oiseaux.– Établir les soins apportés aux œufs et aux jeunes.Les oiseaux– Dégager les caractères communs aux oiseaux.– Découvrir des cas de migrations et comprendre pourquoi des oiseauxmigrent et comment ils font pour se repérer.– Comprendre l’organisation de l’aile et son fonctionnement lors du vol.Les crocodiles– Dégager les caractères communs aux reptiles.– Distinguer différentes espèces de crocodiles.– Comprendre comment l’animal régule, dans une certaine mesure, satempérature interne.– Décrire son mode de locomotion sur terre et dans l’eau.MOTS-CLÉSOiseaux, migration, œuf, ovule, gamète, fécondation, développementembryonnaire, reptiles, crocodiliens, éclosion, ovipare, vivipare, accouplement,hermaphrodisme.3C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
DÉCOUPAGE ET STRUCTURELes oiseaux00min 00s: Générique et début de l’émission.01 min 35 s : Localisation du parc du Marquenterre.02min 00s: Présentation des lieux et des oiseaux. Fred découvre le parc,puis on nous présente quelques espèces d’oiseaux (voix-off).03 min 57 s : Au laboratoire, Jamy expose, à l’aide de maquettes, lescaractères communs aux oiseaux.05 min 20 s : Les migrations. Dans le parc, la découverte d’une cigognedans son nid permet d’introduire le thème des migrations.06 min 28 s : Au laboratoire, Jamy illustre le trajet d’oiseaux migrateurs(cigogne et coucou).Interview de Philippe Carruette (Parc du Marquenterre).07min 18s: Dans le parc, on voit d’autres migrateurs (la Bernache), puis aulaboratoire Jamy aborde la question: pourquoi migrer? Un documentaire(voix-off) montre des hirondelles et des fauvettes qui préparent leur départ.09 min 37 s : Fred est attendri par la présence de trois jeunes cigognesdans le nid et s’interroge sur les moyens utilisés par les oiseaux pourse repérer durant les migrations.10 min 11 s : Jamy, avec ses maquettes et ses schémas, expose l’importancede la mémoire visuelle, de l’orientation par rapport au Soleil etaux étoiles, de la sensibilité au champ magnétique terrestre.12min 30s: Un documentaire en voix-off traite des nombreuses pertes aucours des migrations. Puis, dans le parc, un spécialiste décrypte unebague.14 min 00 s : Un court reportage présente la capture, le bagage et lecomptage des oiseaux.Interview de Gérard Ranvier (Animateur nature).14 min 45 s : La reproduction. Ce thème est introduit par un document(voix-off) sur la construction du nid chez diverses espèces (canard, mouette,avocette, etc.).Interview de Stéphanie Nicolet (Animateur nature).15 min 50 s : Fred découvre une tour permettant d’observer la coloniedes hérons.16 min 50 s : Au laboratoire, Jamy présente comment se forme un œufet aborde les notions suivantes : ovule, fécondation interne, œuf.18 min 05 s : Dans le parc, un cygne couve.18min 55s:Au laboratoire, le développement embryonnaire est illustréà partir d’une maquette.20 min 05 s : Un documentaire en voix-off présente des éclosions et lessoins apportés aux jeunes.4C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
20min 50s: Les plumes et le vol. Dans le parc, la vue de canards plongeantdans l’eau amène Fred à s’intéresser aux plumes: manipulation et observationau microscope.22 min 30 s : Dans le parc, de jeunes hérons apprennent à voler.22min 55s: Au laboratoire, on découvre la structure et le fonctionnementde l’aile.23min 40s: Un documentaire en voix-off montre le vol au ralenti et traitede la dépense énergétique particulièrement importante.<strong>24</strong>min 10s: Les oiseaux blessés. La vue d’oiseaux convalescents dorlotésdans le parc amène à s’interroger sur ce qu’il faut faire quand on trouveun oiseau blessé.25 min 25 s : Fred relâche un oiseau.25 min 50 s : Générique de fin.Les crocodiles26 min 00 s : Générique et début de l’émission.27min 50s: Présentation des lieux, des crocodiles et des reptiles. Fred està Pierrelatte dans la Drôme où se trouve une ferme abritant 350 crocodilesdans des bassins contenant de l’eau à 28 °C.Interview de Luc Fougeirol (Ferme aux crocodiles Pierrelatte).29 min 30 s : Au laboratoire, des caractères communs aux reptiles sontdégagés : peau avec écailles, œufs pondus, <strong>pas</strong> de véritable thermorégulation.30 min 30 s : Un documentaire en voix-off présente diverses espèces dereptiles : serpents, lézards, tortues, etc.31 min 10 s : Fred s’intéresse aux crocodiliens et apprend à distinguerl’alligator (caïman), le crocodile et le gavial.32 min 15 s : Au laboratoire, exposé sur les différences entre crocodile etalligator.33 min 00 s : Documentaire en voix-off sur différentes espèces de gavial,alligator, caïman et crocodile.34 min 10 s : Régulation de la température interne. Fred s’intéresse aucrocodile du Nil qui atteint 6 m à l’âge adulte et introduit le problèmede la thermorégulation.34min 40s: Au laboratoire, à l’aide de maquettes, on nous explique commentle crocodile peut accumuler de la chaleur, mais aussi en dissiper.37 min 55 s : L’alimentation. Fred donne à manger aux crocodiles : descarcasses de volaille à raison de 2 à 3 kg par semaine.38 min 40 s : Documentaire en voix-off sur la chasse à l’affût du crocodileet sur son régime alimentaire.39 min 50 s : La locomotion. Fred donne des soins à une femelle blessée,découvre les pattes palmées de l’animal et aborde le déplacementdans l’eau. Ce thème est repris au laboratoire, puis (42 min 00 s) dans undocumentaire.5C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
42 min 28 s : La reproduction. Dans la ferme, Fred apprend à distinguer lemâle et la femelle ; ce point est approfondi au laboratoire.43 min 50 s : Documentaire sur le comportement du mâle et sur l’accouplement.44 min 10 s : Fred découvre un nid de crocodile et présente quelquesnotions sur la reproduction : une femelle pond de 10 à 50 œufs ; les œufsrestent trois mois dans le nid avant l’éclosion ; le sexe du jeune dépendde la température.45min 35s: Au laboratoire, Jamy présente le déterminisme du sexe chezl’Homme et chez le crocodile.48min 00s: Documentaire en voix-off qui montre la fabrication du nid, lasurveillance des œufs et des jeunes.49 min 40 s : Documentaire sur l’intérêt de la peau de crocodile en maroquineriequi entraîne un braconnage intense.50 min 15 s : Fred découvre que les yeux des crocodiles brillent la nuit.Au laboratoire, le fonctionnement des yeux du crocodile est illustré àpartir de maquettes et de schémas.51 min 40 s : Dans la ferme, il manque un crocodile.Panique et générique de fin.Les œufs52 min 00 s : Générique et début de l’émission.53 min 45 s : Fred arrive en bord de mer et découvre diverses espècesqui pondent des œufs : crabes, raie. Ailleurs, il trouve des œufs d’escargots,de poule.55 min 25 s : Documentaire qui présente des œufs de papillon, serpent,seiche, grenouille et crapaud.56 min 10 s : Fred s’interroge : y a t-il toujours un poussin dans un œuf ?Au laboratoire, maquettes et schémas permettent de découvrir l’appareilreproducteur de la poule, la production d’un œuf non fécondé ouovule et la nécessité de la fécondation pour obtenir un œuf.57 min 35 s : Après un bref <strong>pas</strong>sage par la basse-cour, on revient au laboratoireoù Jamy nous apprend que chez les mammifères aussi, la femelleproduit un ovule qui, après fécondation, devient un œuf qui se divise ets’implante dans la paroi utérine.58 min 55 s : Documentaire en voix-off sur la basse-cour et sur un élevagede poules pondeuses pour souligner la nécessité de l’accouplementpour avoir des poussins.59 min 15 s : Fred découvre un élevage d’émeus et présente les différencesentre l’émeu et l’autruche.Interview de Jean-Pierre Fourny (Responsable d’élevage – France Autruches):il élève l’émeu pour sa viande.1 h 00 min 30 s : Au laboratoire, une maquette permet de comprendrecomment est fabriqué l’ovule puis au niveau de l’oviducte : les réserves(albumen), les membranes et la coquille.6C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
1 h 02 min 00 s : Fred démontre que l’œuf d’autruche a une coquille trèssolide. Un documentaire montre comment le vautour casse un œuf.1 h 03 min 00 s : Fred nous emmène dans l’incubateur et réalise le testqui permet de savoir si l’œuf est fécondé.1h 04min 15s: Au laboratoire, on s’intéresse au développement embryonnaireet à la nutrition de l’embryon à partir des réserves de l’œuf.1h 05min 15s: Fred poursuit ses investigations dans l’écloserie. Au laboratoire,la respiration de l’embryon est expliquée à partir de maquettes etschémas.1 h 06 min 30 s : Fred assiste à l’éclosion des petits émeus. Suit un documentaireconsacré à l’identification des petits, à la reconnaissance desmâles et femelles et aux soins apportés aux jeunes.1 h 07 min 50 s : Document sur les courses d’autruches.1h 08min 00s: Fred découvre le musée Océanopolis à Brest et, plus particulièrement,la reproduction du turbot.1h 09min 05s: Au laboratoire, on aborde les différents dispositifs concernantla reproduction chez les vertébrés : oviparité chez les poissons,amphibiens, reptiles, oiseaux et viviparité chez les mammifères.1 h 10 min 10 s : Documentaire en voix-off sur des mammifères qui pondentdes œufs : ornithorynque et échidné, et sur les mammifères qui accouchentdans l’eau.1 h 11 min 00 s : Au musée Océanopolis, Fred poursuit son enquête ets’intéresse aux requins. Des compléments sur la roussette sont fournisdans un documentaire : embryon et éclosion.Interview de Yann Le Nozerh (Biologiste marin – Océanopolis).1h 12min 40s: Comment peut-on distinguer le mâle et la femelle chez lesrequins? Puis, au laboratoire, Jamy expose la reproduction chez les poissons: production des gamètes, fécondation externe.1 h 14 min 19 s : Documentaire livrant des informations sur l’éclosion desalevins de truite puis sur la production des gamètes chez les oursins.1 h 14 min 55 s : Fred se penche sur le cas de la coquille Saint-Jacques etintroduit la notion d’hermaphrodisme. En voix-off, des images sur lareproduction de ce mollusque puis de la dorade royale.1 h 16 min 20 s : L’hippocampe est maintenant l’objet de l’étude : c’est lemâle qui porte les œufs. Des images en voix-off montrent l’éjection desjeunes par le mâle.1 h 17 min 40 s : Au laboratoire, à chacun son œuf de Pâques.Générique de fin.7C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
PRÉSENTATION NOTIONNELLEPOUR UNE EXPLOITATION PÉDAGOGIQUELes pistes ne sont que des propositions qui s’adressent en priorité auxélèves du cycle 3 de l’école élémentaire et du collège (6 e , 5 e , 4 e ).Activité 1 : Comment se reproduisent les oiseaux ?Pour obtenir les représentations des élèves concernant la reproductionchez les ovipares, on peut poser les questions suivantes: Que trouve-t-ondans un œuf de poule ? Que peut-il donner ?Après analyse, on va soumettre aux élèves, les différents types deréponses obtenues et dégager des questions essentielles qui demandentinvestigation :– Que faut-il pour obtenir des oisillons ?– Que produit la femelle ? Que produit le mâle ?– D’où sort le poussin? Que se <strong>pas</strong>se-t-il dans l’œuf durant la couvaison?– Quels soins les parents apportent-t-ils aux œufs et aux jeunes ?Travail d’enquête en groupe à partir de l’extrait de l’émission sur lesoiseaux (de 14 min 45 s à 20 min 50 s).Les élèves ont pris connaissance des questions, regardent le film et, pargroupe, produisent un écrit présentant les réponses qu’ils ont obtenues(sur une grande feuille qui sera affichée au tableau, par exemple).Temps d’échange en classe entière: chaque groupe présente sa production.À partir de cet échange, le professeur peut proposer un écrit qui résume lesinformations contenues dans le film sur la reproduction des oiseaux.Dans le cas des oiseaux, la femelle produit des ovules entourés deréserves et d’une coquille ; le mâle produit des spermatozoïdes. Pourobtenir un œuf fécondé, il doit y avoir un accouplement au cours duquelles spermatozoïdes sont déposés dans l’appareil génital femelle. La fécondation,fusion entre un gamète mâle et un ovule, produit un œuf fécondé.La poule peut pondre des œufs non fécondés (ovules) ou des œufs fécondés.Dans l’œuf, un embryon se développe à partir des réserves, il respireà travers la coquille; le jeune sort d’un œuf. Les oiseaux sont ovipares. Lesparents prennent soin des œufs en fabriquant un nid et en couvant. Chezde nombreuses espèces, les parents s’occupent des jeunes.Activité 2 : Comment se reproduisent les crocodiles ?Utiliser l’extrait de la seconde émission de 42 min 28 s à 49 min 40 s.On peut proposer aux élèves d’enquêter à partir de questions voisines decelles formulées dans l’activité 1 : Que faut-il pour obtenir de jeunes crocodiles? Que produit la femelle ? Le mâle ? Comment peut-on distinguerle mâle et la femelle ? D’où sortent les jeunes ? Que se <strong>pas</strong>se-t-il dansl’œuf ? Quels soins les parents apportent-ils aux œufs et aux jeunes ?Après le travail de recherche et les échanges entre les groupes qui suivront,le professeur peut résumer les informations essentielles contenuesdans le film.Les crocodiles présentent un cas très voisin : il y a des mâles et desfemelles, la fécondation est interne et nécessite un accouplement, lesœufs sont pondus dans un nid. Certaines espèces prennent soin desœufs et des jeunes.8C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
On peut également essayer de faire découvrir l’organisation généralede cette émission en demandant aux élèves de caractériser le type dedocument présenté ; pour cela, on peut fournir un tableau de ce type.Temps (affichésur le magnétoscope)42 min 28 s à 43 min 50 s43 min 50 s à 44 min 10 s44 min 10 s à 45 min 35 s45 min 35 s à 48 min 00 s48 min 00 s à 49 min 40 sType de documentReportage dans lafermeDocumentaireReportage dans lafermeLaboratoire, exposéavec maquettes etschémasDocumentaireInformations scientifiquesconcernant lareproductionCaractères sexuels secondairesComportement du mâle etaccouplementLa femelle pond des œufs,dans un nid creusé dans laterre. Les œufs incubenttrois mois ; le jeune sortd'un œuf.Extrait que l'on peut supprimercar il aborde desnotions un peu compliquéesFabrication du nid, ponte,risques encourus par lesœufs et les jeunes et surveillancede la femelleActivité 3 : Comment se reproduisent les poissons ?Utiliser l’extrait de l’émission sur Les œufs de 1h 11min 00s à 1h 14min 55s.On demande aux élèves de s’intéresser au cas de la truite et de la roussetteet de rechercher les réponses aux questions suivantes : D’où sort lejeune ? Que produit la femelle ? Le mâle ? Où se fait la fécondation ?Chez la truite, la femelle rejette des ovules et le mâle des spermatozoïdes; la fécondation se fait dans l’eau ; le jeune sort d’un œuf.Chez la roussette, il y a un accouplement et la fécondation est interne ; lejeune sort de l’œuf pondu par la femelle, dans l’eau.Activité 4 : Peut-on parler d’œuf chez d’autres espèces ?Extrait de l’émission Les œufs de 53 min 45 s à 56 min 10 s.On peut demander aux élèves de compléter un tableau pour résumerles informations.Espèces présentéesCrabeRaieEscargotPoulePapillonSerpentSeicheCrapaudGrenouilleOù se trouvent les œufs ?Sous l’abdomen de la femelleDans l’eauDans la terreDans un nidSur une feuilleSur la terreDans l’eauDans l’eauDans l’eau9C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
Activité 5 : Le jeune sort-il toujours d’un œuf ?Extrait de 1 h 09 min 05 s à 1 h 10 min 10 s.Il s’agit d’une synthèse sur les divers modes de reproduction animalechez les vertébrés, faite sous la forme d’un exposé dans le laboratoire.À nouveau, les élèves peuvent retenir l’essentiel, dans un tableau.AnimauxcitésPoissonsAmphibiensReptilesOiseauxMammifèresD'où sortle jeune ?Œuf(oviparité)Œuf(oviparité)Œuf(oviparité)Œuf(oviparité)Voies génitalesde lafemelle(viviparité)Où se trouvel'œuf ?EauEauSur terreSur terreDansles voiesgénitalesOù se fait lafécondation ?EauFécondationexterneSauf rares cas(des requins)EauFécondationexterneDans les voiesgénitalesFécondationinterneDans les voiesgénitalesFécondationinterneDans les voiesgénitalesFécondationinterneY a-t-il unaccouplement ?NonSauf rares cas(requins)Non (il peut yavoir un pseudoaccouplement)OuiOuiOuiActivité 6 :Y a-t-il toujours un mâle et une femelle ?Extrait de 1 h 14 min 55 s à 1 h 16 min 20 s qui traite en priorité la coquilleSaint-Jacques.Les élèves vont découvrir que chez certaines espèces, chaque individu està la fois mâle et femelle, c’est-à-dire hermaphrodite. Une informationimportante est donnée rapidement: l’individu ne peut <strong>pas</strong> s’autoféconder.Les gamètes mâles et femelles sont relâchés dans l’eau, la fécondation estexterne.Activité 7 : Les soins apportés aux œufs sont-ils toujours le faitde la femelle ?Extrait de 1h 16min 20s à 1h 17min 40s qui présente le cas de l’hippocampe.On peut demander aux élèves de produire un texte scientifique quidégage les rôles respectifs de la femelle et du mâle. Quelques questionspeuvent guider leur recherche.Que produit la femelle ? Le mâle ? Où se fait la fécondation ? D’où sortentles jeunes ? Qui prend soin des œufs ?10C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
Notions abordées dans l’émission sur les œufsCette émission permet de généraliser et de présenter des modes dereproduction qui diffèrent :– Il y a des cas d’hermaphrodisme.– Chez la plupart des espèces, la femelle produit des ovules et il y a fabricationd’un œuf à partir d’une fécondation.– La fécondation peut se faire dans l’eau (fécondation externe) ou dansles voies génitales de la femelle (fécondation interne).– Le jeune peut sortir d’un œuf (ovipare) ou du ventre de la femelle (vivipare).– L’embryon se forme à partir des réserves de l’œuf chez les ovipares oùil est nourri par l’organisme maternel chez les vivipares.– Certaines espèces produisent de nombreux œufs, abandonnés dansle milieu ; dans ce cas, les pertes sont importantes.– D’autres produisent beaucoup moins d’œufs, prennent soin des œufset des jeunes : les pertes sont nettement moins importantes.DOCUMENTATIONOuvrages destinés à l’enseignement élémentaire– Les animaux, les élevages, Guide du maître, collection Tavernier, Bordas.– Enseigner la Biologie-Géologie à l’école élémentaire, collection Tavernier,Bordas.– Les manuels Bordas, collection Tavernier, Sciences et technologie, CE2et CM.– DE VECCHI G., GIORDAN A., L’enseignement scientifique : comment fairepour que « ça marche » ?, Z’Éditions.– ASTOLFI Jean-Pierre, PETERFALVI Brigitte, VÉRIN Anne, Comment les enfantsapprennent les sciences, Retz, 1998.– ANTHEAUME Pierre, DUPONT Michelle, MAUREL Maurice, Découverte duvivant et de la terre, Hachette-Éducation, 1997.– BOYER Catherine, GADPAILLE Alain, POMMIER Patrick, Unité et diversité dumonde vivant, coll. « Sciences et technologie à l’école », Delagrave-CNDP, 2001.Cédéroms– Nature interactive, Hachette multimédia.– Encyclopédie de la nature, Larousse.– Encyclopédie des animaux de la nature, TLC-Edusoft.– L’étang, un écosystème, CNDP, 2001, réf. 755 A0114, 44,21 €/290 F.VidéocassettesNaissance 1 et 2, CNDP.Sites internet– Educasource (www.educasource.education.fr/) propose à la rubriqueécologie 60 sites dont Réseau école et nature : éducation à l’environnement(www.ecole-et-nature.org/), Milieux aquatiques, faune et flore.11 C ’ EST PAS SORCIER <strong>24</strong> .
– Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement :www.environnement.gouv.fr– Parcs nationaux de France : www.parcsnationaux-fr.comDonne accès aux sites des sept parcs nationaux : les Cévennes, lesÉcrins, la Guadeloupe, le Mercantour, Port-Cros, les Pyrénées, la Vanoise.– Parcs naturels régionaux de France: www.parcs-naturels-regionaux.tm.frLa page d’accueil propose entre autre la rubrique « Les 38 parcs » quivous permet d’avoir accès au site de chaque parc, par exemple, LeMarquenterre : www.marcanterra.com– Réserves naturelles : www.reserves-naturelles.orgLa page d’accueil donne accès aux sites régionaux.– Ligue pour la protection des oiseaux : www.lpo.birdlife.asso.fr– IFREMER (www.ifremer.fr) propose entre autre, des dossiers pédagogiques,une information sur des actions pédagogiques avec accueild’élèves et des extraits de la photothèque.– Océanopolis (www.oceanopolis.com) permet de découvrir ce muséeinstallé à Brest et consacré à la mer.– Site de la main à la pâte : www.inrp.fr/lamap– Museum national d’histoire naturelle de Paris (www.mnhn.fr).Livret rédigé par Patrick Pommier © CNDP, 2001Programmes audiovisuels libérés de droits pour une utilisation en classeDepuis janvier 1995, la politique de soutien du ministère de l’Éducation nationale en matièred’achat de droits a permis d’acquérir près de 400 heures de programmes. Cette action s’inscritdans le cadre de la politique ministérielle qui favorise l’utilisation, dans les écoles et les établissementsscolaires, par les enseignants, de programmes audiovisuels en conformité avec lecode de la Propriété littéraire et artistique. Elle en permet l’usage licite (droit d’enregistrementau moment de la télédiffusion, droit d’utilisation de vidéocassettes dans les établissementsd’enseignement en France et à l’étranger dépendant du ministère). Cette sélectionmarque l’intérêt du ministère pour des œuvres qui, de par leur thème et leur qualité, sont susceptiblesd’être exploitées en classe. C’est l’outil télévisuel en tant que tel, pouvant être utilisécomme support de cours ou comme objet d’une étude critique, qui est mis à votre disposition.Pour une information plus complète sur les actions du ministère en matière d’audiovisuel,un forum et une rubrique « Les ressources audiovisuelles » sont ouverts sur le serveur Internetdu ministère : éducnet.éducation.fr (rubrique « Ressources multimédias »).