Toute culture véritable est prospective. Elle n'est point la stérile - INRP
Toute culture véritable est prospective. Elle n'est point la stérile - INRP
Toute culture véritable est prospective. Elle n'est point la stérile - INRP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
nature des annotations (14), d’abandonner progressivement<br />
l’emprunt au profit d’annotations issues<br />
d’interactions avec le texte. Dans le premier album<br />
annoté, L’invité, l’emprunt <strong>est</strong> présent à hauteur de<br />
91,66 %. S’il r<strong>est</strong>e encore très fréquent dans Des<br />
bosses étranges (83,43 %), il tombe à 38,22 % pour<br />
Ming Lo dép<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> montagne puis à 7,40 % pour Sale<br />
menteur !<br />
Annotations et parcours de lecture<br />
L’abandon de l’emprunt a pour corol<strong>la</strong>ire <strong>la</strong> personnalisation<br />
des annotations. L’annotation <strong>est</strong> selon<br />
J. Virbel une technique empirique et individualisée de<br />
mémorisation et de capitalisation de résultats de<br />
lecture (15). La grande diversité des annotations produites<br />
par l’ensemble des élèves ne doit donc pas<br />
surprendre. Chaque élève a généré de trois à cinq<br />
types d’annotations auxquelles il a recours tout au<br />
long de sa lecture, puis qu’il reprend et qu’il adapte<br />
d’une histoire à l’autre. Il <strong>est</strong> impossible de dresser ici<br />
une typologie fine des annotations produites. Tout au<br />
plus peut-on établir des groupements qui rendent<br />
compte des procédures interactives engagées par les<br />
lecteurs avec le texte.<br />
On observe en premier lieu des reformu<strong>la</strong>tions périphrastiques<br />
d’un segment évalué comme important<br />
par le lecteur et dont <strong>la</strong> forme synthétique favorise <strong>la</strong><br />
mémorisation ou/et <strong>la</strong> réactivation lors de <strong>la</strong> relecture<br />
de l’annotation. Parfois, les reformu<strong>la</strong>tions s’apparentent<br />
à une réinterprétation, à un réajustement d’un<br />
segment ; se redire les choses, avec ses propres<br />
mots pour mieux les comprendre, mieux les intérioriser<br />
ou pour s’assurer que l’on a bien compris. On<br />
relève également des commentaires de formes<br />
diverses. À <strong>la</strong> marge des réactions au texte, on trouve<br />
les commentaires légendant une illustration de l’album.<br />
Le commentaire sert encore tantôt à émettre<br />
des jugements de valeur sur <strong>la</strong> narration, tantôt à<br />
discuter l’attitude de tel personnage. On peut<br />
rapprocher de cette dernière forme de commentaire<br />
des qu<strong>est</strong>ions interrogeant les choix diégétiques.<br />
C’<strong>est</strong> le cas lorsque des élèves interrogent <strong>la</strong> phase<br />
de complication et proposent d’emblée dans leur<br />
qu<strong>est</strong>ion une résolution tangible au problème rencontré<br />
par le héros. S’ils traduisent une bonne<br />
compréhension de l’histoire, les qu<strong>est</strong>ionnements de<br />
ce type n’en sont pas moins <strong>la</strong> marque d’une posture<br />
inappropriée d’un lecteur qui rompt en quelque sorte<br />
le pacte tacite passé avec le texte selon lequel, pour<br />
reprendre N. Carpentiers, le lecteur, s’il <strong>est</strong> conscient<br />
du caractère fictif des événements narrés, croit<br />
toujours, dans une certaine mesure, à l’histoire qui lui<br />
<strong>est</strong> racontée (16). D’autres qu<strong>est</strong>ions par contre rendent<br />
compte de l’inadéquation entre les attentes du<br />
lecteur et ce qu’il découvre de l’histoire. Il en <strong>est</strong> ainsi<br />
dans L’invité où une élève interroge à partir du titre <strong>la</strong><br />
SI présentant un héros prêt à passer une soirée seul<br />
et qui note « Pourquoi l’invité ? ». On peut enfin lier à<br />
cette dernière catégorie de qu<strong>est</strong>ions les annotations<br />
qui émettent des hypothèses sur <strong>la</strong> psychologie, les<br />
pensées ou les actions d’un personnage.<br />
La catégorisation succincte présentée ci-dessus ne<br />
permet pas d’accéder à l’explicitation de cette part<br />
proprement individuelle et autobiographique dans <strong>la</strong><br />
construction du sens (d’un sens) ou d’une interprétation<br />
d’un texte à travers sa lecture (17) que permet<br />
de son côté l’annotation. C’<strong>est</strong> pourtant cette qu<strong>est</strong>ion<br />
qui nous préoccupe. Nous voudrions montrer à<br />
partir de l’observation de deux exemples en quoi <strong>la</strong><br />
demande de produire par écrit une annotation contribue<br />
à établir une re<strong>la</strong>tion dialogique avec le texte, en<br />
quoi celle-ci favorise et témoigne à son tour d’une<br />
activité effective de compréhension et d’interprétation<br />
du texte (18).<br />
Lysiane : 1. Comment va-t-il dép<strong>la</strong>cer <strong>la</strong> montagne ?<br />
2. pierres et cailloux. 3. malheur. 4. homme. 5. Il vit le<br />
sage. 6. Comment vont-ils faire ? 7. Ming Lo se fait mal.<br />
8. Comment vont-ils faire ? 9. Mais ça ne marche pas.<br />
10. Pourquoi beaucoup de pains et de gâteaux ? 11. La<br />
montagne n’a plus de pains et de gâteaux. 12. Pourquoi<br />
<strong>la</strong> femme de Ming Lo ne va pas avec lui ? 13. La montagne<br />
ne bouge pas et c’<strong>est</strong> Ming Lo qui va bouger.<br />
14. La femme de Ming Lo apprend à faire <strong>la</strong> danse de <strong>la</strong><br />
montagne qui bouge. 15. Ming Lo bouge à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong><br />
montagne. 16. Ming Lo et sa femme sont contents.<br />
17. Ming Lo et sa femme sont contents.<br />
Chez Lysiane, l’annotation 1 émane par inférence<br />
de <strong>la</strong> lecture du titre et de <strong>la</strong> première page. En énonçant<br />
l’enjeu avant même qu’il n’apparaisse dans l’histoire,<br />
elle att<strong>est</strong>e de <strong>la</strong> bonne compréhension du<br />
texte. Comme en témoignent les annotations suivantes,<br />
cette qu<strong>est</strong>ion à l’initiale du texte guide <strong>la</strong><br />
lecture. En ouvrant sur <strong>la</strong> recherche d’une réponse<br />
satisfaisante, elle suscite l’anticipation et l’évaluation<br />
des actions menées par Ming Lo pour résoudre son<br />
problème. Les qu<strong>est</strong>ions en 6, 8 et 10 n’expriment<br />
pas moins le doute sur l’efficacité des solutions proposées<br />
par le sage à Ming Lo, tandis qu’en 12 l’intervention<br />
de <strong>la</strong> femme de Ming Lo <strong>est</strong> considérée<br />
Des g<strong>est</strong>es pour lire 41






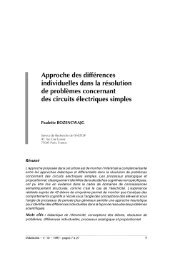




![RH015-016 [Técharger pdf] - Institut français de l'éducation](https://img.yumpu.com/18592417/1/167x260/rh015-016-techarger-pdf-institut-francais-de-leducation.jpg?quality=85)


![RH039-040 [Técharger pdf] - INRP](https://img.yumpu.com/17725763/1/167x260/rh039-040-techarger-pdf-inrp.jpg?quality=85)


