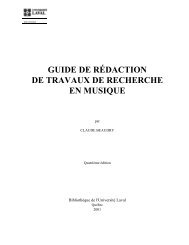numéro 27 - Faculté de musique - Université Laval
numéro 27 - Faculté de musique - Université Laval
numéro 27 - Faculté de musique - Université Laval
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
28RECHERCHE EN ÉDUCATION MUSICALEpatates ») 14 . En d’autres termes, l’enfant apprend surtout dans <strong>de</strong>s actions régulées par <strong>de</strong>séchanges sociaux (Swanick et Tillman, 1986). Pour Imberty et Miroudot (2001, p. 98 etsuiv.), en <strong>musique</strong>, cette régulation consistera surtout à faire cohabiter <strong>de</strong>s schémas (figuresarchétypales puisées/tirées par l’enfant <strong>de</strong> son environnement musical, mais discontinues etpeu susceptibles d’évolution) et <strong>de</strong>s schèmes tonals (cadres <strong>de</strong> pensée et d’action évolutifs,apportant la continuité temporelle et la maîtrise <strong>de</strong>s productions), en sachant que « lesschèmes confèrent fonction et signification aux schémas, qui en retour organisent le détail<strong>de</strong> la production » (Miroudot, 2001, p. 149). Il ne s’agit donc là ni d’un rééquilibrage enfaveur <strong>de</strong> la quantité <strong>de</strong> pratique ou <strong>de</strong> l’ouverture <strong>de</strong> l’environnement (chant <strong>de</strong>sréformateurs), ni d’une mise à disposition d’un catalogue <strong>de</strong> bons exemples résumant leslangages et les styles qui conviennent (chant <strong>de</strong>s conservateurs) : il s’agit <strong>de</strong> permettre àl’enfant <strong>de</strong> confronter ses représentations au réel par <strong>de</strong>s actions et <strong>de</strong>s productionsmusicales où il expérimentera la vection temporelle qui habite et donne sens, dans notreculture, au dynamisme musical 15 . On sait par exemple que les schèmes tonals sontstructurés par <strong>de</strong>s repères stables qui évoluent à partir <strong>de</strong> pivots rythmiques puismélodiques : l’enfant sait qu’à un endroit (pivot), son improvisation <strong>de</strong>vrait « retomber surses pattes » et il l’organise temporellement en fonction <strong>de</strong> ces repères (Mialaret, 1997). Cesrepères évoluent ensuite vers un schème ca<strong>de</strong>ntiel (formule terminale à partir <strong>de</strong> laquelle sestructure la phrase tonale) qui marque un début d’assimilation <strong>de</strong> la syntaxe tonale(variante musicale d’un principe <strong>de</strong> détente/tension/résolution partagé par différentesformes <strong>de</strong> récit). Ces schèmes n’offrent d’abord qu’une maîtrise partielle et irréversible du<strong>de</strong>venir musical — schèmes d’ordre — puis ils évoluent vers une pensée <strong>de</strong> la formemusicale plus globale et réversible — schèmes <strong>de</strong> relation d’ordre (Imberty, 1969 ;Miroudot, 2000, p. 111 et suiv.). Cette acquisition permet <strong>de</strong> reprendre son idée musicaleen cours <strong>de</strong> route quand on s’est trompé ou quand on veut la varier ; elle permet aussi <strong>de</strong> nepas glisser toujours d’un extrait à l’autre dans un pot pourri semi-involontaire quand on nese souvient plus très bien d’une chanson (ces <strong>de</strong>ux états étant les plus facilementobservables).Ces mécanismes cognitifs spécifiques sont tout aussi complexes que ceux dont on tientcompte aujourd’hui dans la didactique <strong>de</strong>s maths ou du français. Mais la formation <strong>de</strong>senseignants <strong>de</strong> <strong>musique</strong> pourra-t-elle un jour penser les siens, rivés qu’ils sont au langagetonal qui leur permet d’apparaître dans notre culture ? Peut-on croire ici à un simple14 Est-ce là une démarche qualitativement différente <strong>de</strong> celle par laquelle les discours d’esthétique, <strong>de</strong> ÉlieFaure à Daniel Arasse, nous apprendront à lire la complexité et la fabuleuse richesse sémantique <strong>de</strong> cesimages où d’abord, on ne voyait rien ?15 « Ce n’est qu’en produisant <strong>de</strong> la <strong>musique</strong> que l’enfant pourra se rendre compte, ressentir que l’unitétemporelle et dynamique (la cohésion) subsiste au-<strong>de</strong>là d’une segmentation rythmique ou malgrél’apparition d’une secon<strong>de</strong> hauteur repère [Pivots rythmiques et mélodiques]. Ce n’est sans doute pas enécoutant les productions d’adultes pour qui l’unité temporelle n’a pas besoin d’être autant soulignée etest bien davantage dissociée <strong>de</strong>s aspects rythmiques. » (Miroudot, 2000, p. 213) Voir aussi, pour <strong>de</strong>sexemples didactiques : Zurcher (1996).