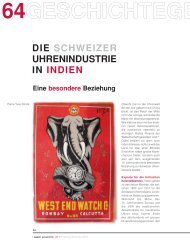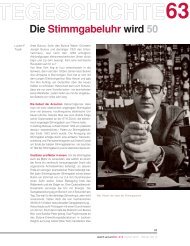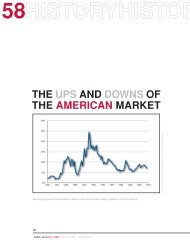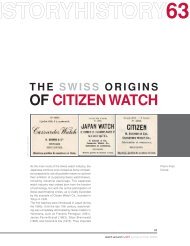Mise en page 1 - Watch Around
Mise en page 1 - Watch Around
Mise en page 1 - Watch Around
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
HNIQUETECHNIQUPage de gauche: la sphère armillaire (aussi appeléeastrolabe sphérique) miniature de laiton est un objetdocum<strong>en</strong>taire mais aussi un cadran solaire.L’astrolabe d’Al Sarraj est un instrum<strong>en</strong>t de mesure fascinantdont émane une séduction magique.Chacun d’<strong>en</strong>tre nous a contemplé, une nuit, le cielétoilé. Et chacun d’<strong>en</strong>tre nous a t<strong>en</strong>té de se représ<strong>en</strong>terla taille de l’univers et les distances qui noussépar<strong>en</strong>t des points luminesc<strong>en</strong>ts, là-haut, trèsloin. Plus nous <strong>en</strong> savons sur cet infini qui nous<strong>en</strong>toure, plus nos questions à son propos sontinsondables et plus il est difficile de s’appuyer, pourcompr<strong>en</strong>dre, sur l’expéri<strong>en</strong>ce accumulée jusqu’ici.Les étoiles que nous voyons sont éloignées de milliersd’années-lumière, cela ne les empêche pasd’appart<strong>en</strong>ir à la Voie lactée, donc à la galaxie dontfait partie notre système solaire. Or, l’universcompte d’innombrables autres galaxies.En regardant scintiller les étoiles, nous devonsaussi réviser notre compréh<strong>en</strong>sion du temps, carce que nous voyons n’existe pas au mom<strong>en</strong>t oùnous le captons. Nous voyons chaque étoile au firmam<strong>en</strong>ttelle qu’elle fut un jour dans un lointainpassé. La lueur de bi<strong>en</strong> des étoiles nous parvi<strong>en</strong>td’une époque où le g<strong>en</strong>re humain n’existait pas<strong>en</strong>core sur la terre. Et nul ne sait si les étoiles qu<strong>en</strong>ous voyons exist<strong>en</strong>t toujours.La géographie du ciel. Le soleil et les astres décriv<strong>en</strong>tune courbe au-dessus de l’horizon et le zénithde chaque corps céleste s’inscrit au Sud. Ce mouvem<strong>en</strong>tse déroule toujours de la même manière età la même vitesse, ce qui incite les hommes depuisdes temps immémoriaux à tirer parti des mouvem<strong>en</strong>tsdes corps célestes pour déterminer le tempssur terre. Comme les intervalles <strong>en</strong>tre les étoiles nese modifi<strong>en</strong>t pas avec le temps, cela a donné naissanceà la représ<strong>en</strong>tation d’un univers, dont la Terreserait le c<strong>en</strong>tre autour duquel les étoiles tournerai<strong>en</strong>t<strong>en</strong> une l<strong>en</strong>te et gigantesque rotation. Cettereprés<strong>en</strong>tation est certes dém<strong>en</strong>tie depuis fort longtemps,mais elle r<strong>en</strong>d service aujourd’hui <strong>en</strong>corequand il s’agit d’imaginer dans quelle direction lesétoiles se meuv<strong>en</strong>t la nuit.Le langage reflète d’ailleurs les croyances anci<strong>en</strong>nes.On dit: «le soleil se couche» au lieu de: «nous nousdétournons du soleil». Lorsqu’on a une représ<strong>en</strong>tationdu monde où la tête est <strong>en</strong> haut et les pieds <strong>en</strong>bas, il est forcém<strong>en</strong>t difficile de s’imaginer qu’on estsur une boule où le haut et le bas ne sont pas définis.Le ciel sur un disque de laiton. Si l’on veutconstruire un modèle de ce concept, il est obligatoirem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> forme de boule, sauf si l’on réussit àprojeter sa surface sphérique sur une ét<strong>en</strong>dueplane sans trop de distorsions, à la manière descartes géographiques. Au II e siècle avant J.-C.déjà, le géomètre et astronome Apollonius dePerga conçut la projection stéréographique, qui seprêtait bi<strong>en</strong> à l’observation du ciel; elle fut adoptéeaux al<strong>en</strong>tours de l’an 150 avant J.-C. par le célèbreastronome Hipparque de Nicée: la demisphèreNord du ciel, avec le pôle Nord <strong>en</strong> sonc<strong>en</strong>tre, est projetée sur un disque dont les bordsfigur<strong>en</strong>t le tropique du Capricorne. Ce principe estTimm Delfs43watch around n o 006 automne 2008 – hiver 2009 |
TECHNIQUETECHN<strong>en</strong> usage de nos jours <strong>en</strong>core pour les cartes duciel rotatives que l’on trouve dans le commerce etque l’on nomme aussi planisphères célestes.L’instrum<strong>en</strong>t qui n’allait voir le jour que cinq sièclesaprès Hipparque fut baptisé « AstrolabiumPlanisphaerium», soit «observatoire d’étoiles sursurface plane». Au X e siècle, cet instrum<strong>en</strong>t arriva <strong>en</strong>Europe via l’Espagne, <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance du mondearabe, et fut donc difficilem<strong>en</strong>t accepté <strong>en</strong> terre chréti<strong>en</strong>ne.Convaincus de son utilité, les savants l’importai<strong>en</strong>tclandestinem<strong>en</strong>t et ne l’utilisai<strong>en</strong>t qu’<strong>en</strong> grandsecret. Or, il n’était pas possible de le produire <strong>en</strong>Europe, car les connaissances <strong>en</strong> mathématiques et<strong>en</strong> astronomie y étai<strong>en</strong>t alors insuffisantes.Comm<strong>en</strong>t ça marche. L’astrolabe est un instrum<strong>en</strong>tde laiton <strong>en</strong> forme de disque, dont les deuxfaces ont des fonctions différ<strong>en</strong>tes. Il permet dedéterminer l’heure locale, de jour et de nuit. La faceprincipale porte une représ<strong>en</strong>tation simplifiée de lavoûte céleste, où les étoiles sont figurées par despointes disposées sur une armature appelée rete(mot itali<strong>en</strong> signifiant filet, réseau). La rete pivoteautour d’un axe c<strong>en</strong>tral qui coïncide avec le pôleNord céleste. Près de ce point se situe l’étoilePolaire. Sous l’armature se trouve un plateau amovibleappelé tympanum, sur lequel sont dessinésl’horizon ainsi qu’un système de coordonnées dansla représ<strong>en</strong>tation du ciel. Ce plateau peut généralem<strong>en</strong>tpivoter et indiquer des latitudes différ<strong>en</strong>tes.Un dispositif servant à mesurer la hauteur descorps célestes au-dessus de l’horizon se trouve audos de l’astrolabe. Une étoile disposée sur la reteest pointée à l’aide de l’alidade (bras tournant attaché<strong>en</strong> son c<strong>en</strong>tre), permettant de lire, sur les repèresextérieurs du disque, l’angle que forme lahauteur de l’étoile avec l’horizon. Puis on fait pivoterla rete de manière à ce que l’étoile mesuréerecoupe sur le tympanum l’indication de hauteurcorrespondante. Sur le cercle exc<strong>en</strong>tré de l’écliptique,qui se trouve égalem<strong>en</strong>t sur la rete, un pointeurou un fil est am<strong>en</strong>é au-dessus du signe duzodiaque où se trouve le soleil et indique alorsl’heure sur une échelle de 24 heures.Avec l’inv<strong>en</strong>tion, au XIV e siècle, de l’horloge mécanique,l’astrolabe a souv<strong>en</strong>t été monté dans decomplexes horloges astronomiques pour simulerle défilem<strong>en</strong>t des constellations.Le travail à la scie à découper exige une main très sûreet un œil expert.Même les cartes de visite de Martin Brunold sont de petitesœuvres d’art.44| watch around n o 006 automne 2008 – hiver 2009
IQUETECHNIQUEUn maître autodidacte. Martin Brunold a toujourséprouvé une passion pour l’astronomie. Il était fascinépar les méthodes de mesure et les inv<strong>en</strong>tionsdes pionniers, qui avai<strong>en</strong>t dû si souv<strong>en</strong>t se confronteraux préjugés de l’Eglise pour faire valoir leursavoir, parfois au prix de leur liberté, sinon au prixde leur vie. Il a passé son temps libre à fouiller lesbibliothèques, <strong>en</strong> quête de vieilles cartes du ciel etdu système planétaire; il a hanté les boutiques d’antiquaireset, plus tard, s’est mis à fureter sur Internet<strong>en</strong> quête de vieux et rares grimoires. Depuis lors, ilpossède une formidable collection d’écrits sur l’histoirede l’astronomie, un domaine qu’il maîtriseparfaitem<strong>en</strong>t.Comme les instrum<strong>en</strong>ts de mesure sont rares etchers, Brunold décida de se former <strong>en</strong> autodidacteà leur fabrication. Ses copies s’appui<strong>en</strong>t étroitem<strong>en</strong>tsur les antiques outils originaux et ne sontpas modernisées. Au prix de quelques corrections,elles sont néanmoins utilisables de nos jours.Brunold, qui avait comm<strong>en</strong>cé une vie professionnelled’<strong>en</strong>seignant avant de dev<strong>en</strong>ir photographepour la police, développa une telle dextérité qu’ildécida de fabriquer plusieurs exemplaires de chaqueinstrum<strong>en</strong>t. Cela se justifiait <strong>en</strong> raison du coûtunitaire de chaque chablon. Les gravures étai<strong>en</strong>t<strong>en</strong>suite réalisées par galvanoplastie sur des plaquesde laiton par des spécialistes. Puis Brunoldpassait des heures à chantourner les détails à lascie à découper avant de les ébarber.Les instrum<strong>en</strong>ts de précision de Martin Brunold sontdev<strong>en</strong>us des pièces de collection convoitées par uncercle étroit de connaisseurs. Ils sont tous fonctionnelset répond<strong>en</strong>t aux exig<strong>en</strong>ces sci<strong>en</strong>tifiques. Maisils constitu<strong>en</strong>t avant tout de très beaux objets, hautem<strong>en</strong>tdécoratifs, qui ramèn<strong>en</strong>t l’amateur éclairéaux origines de la mesure du temps et redonn<strong>en</strong>t vieà l’antique connaissance, largem<strong>en</strong>t perdue de nosjours, de la mécanique céleste. Chaque instrum<strong>en</strong>tqui sort de l’atelier de Martin Brunold est livré avecun mode d’emploi détaillé mais, à l’int<strong>en</strong>tion de ceuxqui souhaiterai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> savoir davantage, MartinBrunold a écrit un ouvrage distrayant, à mi-chemin<strong>en</strong>tre le roman et les instructions de service: DerMessinghimmel (le Ciel de laiton). •Ces disques sont déjà gravés et découpés. Ils n’att<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tplus que les finitions.Martin Brunold: Der Messinghimmel, Ed. Institutl’homme et le temps, Musée international de l’horlogerie(MIH) de La Chaux-de-Fonds, 2001. 155 p.45watch around n o 006 automne 2008 – hiver 2009 |