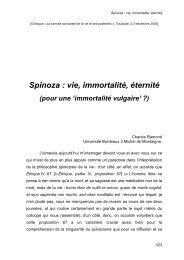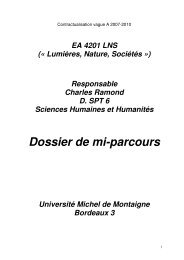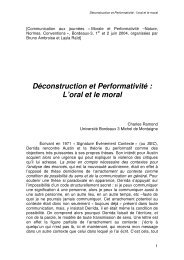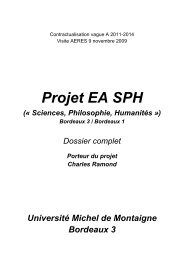You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Sur</strong> <strong>un</strong> <strong>verbe</strong> <strong>manquant</strong>(Espace qualifié et espace quantifiédans la philosophie <strong>de</strong> Spinoza)1 La question <strong>de</strong> l’espace est difficile d’abord en ce que nousdistinguons mal les propriétés <strong>de</strong> l’espace <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s corps quenous situons « dans l’espace » : « nous entendons par corps toutequantité longue, large et profon<strong>de</strong>, limitée par quelque figureprécise, [...] divisible et composée <strong>de</strong> parties » 2 . Les termes « corps » , « espace », « étendue » , « gran<strong>de</strong>ur » et« matière » sont alors équivalents, l’espace <strong>un</strong>eabstraction tirée <strong>de</strong> la seule réalité corporelle, et rien ne vient plusen soutenir ni rassembler la matière <strong>un</strong>iverselle, « parties etparties » juxtaposées à l’infini.Pour Spinoza, <strong>un</strong>e telle confusion est cependant absur<strong>de</strong>.Nous <strong>de</strong>vons reconnaître, au contraire, <strong>un</strong>e différence <strong>de</strong> natureentre l’étendue et les corps étendus, <strong>de</strong> telle sorte que l’étendue1 Article écrit à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> Renaud Barbaras, publié dans larevue Epokhè, n° 4 (« L’espace lui-même »), mars 1994, 31-43 ;entièrement revu pour la présente édition.2 E I 15 sc.
SUR UN VERBE MANQUANT (L’ESPACE CHEZ SPINOZA) 303invicem separari ; at non quatenus substantia est corporea ;eatenus enim neque separatur neque dividitur. Porro, aqua,quatenus aqua, generatur et corrumpitur ; at, quatenus substantia,nec generatur nec corrumpitur> 7 . Comme nous l’avons montréailleurs 8 , Spinoza ne peut révéler ici <strong>un</strong>e étendue indivisible aufon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’étendue divisible que par l’adoption simultanéed’<strong>un</strong> point <strong>de</strong> vue qualitatif et d’<strong>un</strong> point <strong>de</strong> vue quantitatif surl’étendue. Cette « eau » qui, par sa transparence, sa plasticité, soncôté accueillant, est <strong>un</strong>e bonne image <strong>de</strong> l’étendue, est indivisibleen effet à condition <strong>de</strong> considérer en elle la qualité d’eau, tandisqu’on peut toujours partager le contenu d’<strong>un</strong>e bouteille (c’est-àdirel’eau envisagée d’<strong>un</strong> point <strong>de</strong> vue quantitatif). Selon cetexemple, donc, tout corps étendu est quantitativement divisible,tandis que la qualité qu’est l’étendue ne le serait pas. Un corpspourra donc être dit plus ou moins long, large, profond, mais pas« plus ou moins étendu » : car, si peu étendu qu’il soit, ilenveloppera l’intégralité <strong>de</strong>s déterminations <strong>de</strong> l’étendue ;l’<strong>un</strong>ivers dans son ensemble (ou facies totius <strong>un</strong>iversi 9 )contiendrait ainsi, quantitativement, tous les corps étendus, dont lemoindre envelopperait (qualitativement) l’attribut « étendue »,c’est-à-dire l’essence <strong>de</strong> Dieu 10 .Toute la difficulté, on le sent immédiatement, est alors <strong>de</strong>déterminer les rapports entre cette étendue substantielle, ou « faitd’être étendu », et l’étendue corporelle, ou extension effectivedans les trois dimensions. Est-il possible, en effet, <strong>de</strong> concevoirquoi que soit d’autre, sous le « fait d’être étendu », que les troisdimensions <strong>de</strong> l’étendue comm<strong>un</strong>e ? Autrement dit, peut-onmaintenir <strong>un</strong> espace conceptuel entre ces <strong>de</strong>ux notions ? Ou n’y a-t-il pas plutôt ici <strong>un</strong>e illusion <strong>de</strong> la pensée ? 11 Spinoza donne <strong>un</strong>eindication, en procédant par analogie : « il n’est pas moins absur<strong>de</strong><strong>de</strong> supposer que la substance corporelle est composée <strong>de</strong> corps ou7 E, Ibid.8 Voir ci-<strong>de</strong>ssus note 2.9 Lettre 64.10 Car (E I déf 4) l’attribut est « ce que l’enten<strong>de</strong>ment perçoit d’<strong>un</strong>esubstance comme constituant son essence » .11 Spinoza dénonce les illusions <strong>de</strong> la pensée, par exemple dans laLettre 9 à Simon <strong>de</strong> Vries (à propos <strong>de</strong> « l’espace enfermé par <strong>de</strong>uxdroites »).
304 SPINOZA ET LA PENSÉE MODERNE<strong>de</strong> parties, que <strong>de</strong> supposer le corps formé <strong>de</strong> surfaces, la surface<strong>de</strong> lignes, la ligne, enfin, <strong>de</strong> points » 12 .Nous avons là, malgré la forme négative et réfutative <strong>de</strong>l’énoncé, l’expression d’<strong>un</strong>e doctrine positive et constante chezSpinoza, selon laquelle <strong>de</strong>s réalités d’<strong>un</strong>e dimension inférieure nepeuvent jamais être considérées comme <strong>de</strong>s constituants d’<strong>un</strong>eréalité <strong>de</strong> dimension supérieure ; car il y a toujours homogénéité<strong>de</strong> dimension entre les constituants et le tout qu’ils constituent.Ainsi, <strong>un</strong> nombre ne peut être obtenu par l’addition <strong>de</strong> zéros, <strong>un</strong>moment par l’addition d’instants, et, à l’autre extrémité dusystème, il n’existe inversement auc<strong>un</strong>e infériorité ontologique <strong>de</strong>sattributs par rapport à Dieu 13 . Comme Aristote, et comme plus tardBergson, Spinoza considère donc surfaces, lignes et points, noncomme <strong>de</strong>s réalités capables <strong>de</strong> constituer, mais comme <strong>de</strong>s limitesvirtuelles <strong>de</strong>s corps, <strong>de</strong>s surfaces et <strong>de</strong>s lignes 14 . Poursuivantl’analogie, nous aurons alors <strong>un</strong> moyen <strong>de</strong> déterminerpositivement, chez Spinoza, l’étendue substance, ou attributétendue : si en effet <strong>un</strong> point est <strong>un</strong>e limite par rapport à <strong>un</strong>e ligne,<strong>un</strong>e ligne par rapport à <strong>un</strong>e surface, <strong>un</strong>e surface par rapport à <strong>un</strong>corps étendu, le concept <strong>de</strong> l’étendue indivisible pourrait donc être« ce dont la limite est <strong>un</strong> corps en trois dimensions ». L’étendueattribut ne serait alors pas plus « composée » <strong>de</strong> corps que lescorps ne sont « composés » <strong>de</strong> surfaces, ni les surfaces, <strong>de</strong> lignes,ni les lignes, <strong>de</strong> points, ne serait donc pas « composée » <strong>de</strong>s trois12 E I 15 sc.13 Comme l’a surabondamment montré Gueroult dans son Spinoza(Paris : Aubier Montaigne, I, 1968 ; II, 1974). On se référera également,dans cet ouvrage, à l’Appendice n° 10, remarquable entre tous, consacré àla « réfutation spinoziste <strong>de</strong> la conception cartésienne <strong>de</strong>s corps » (529-556).14Aristote, Physique VI 1, 231 a sq. ; Bergson, L’évolutioncréatrice, p. 571-572 (Paris : PUF, éd. du Centenaire). Voir aussi, dans lemême sens, Kant, Critique <strong>de</strong> la raison pure, Anticipations <strong>de</strong> laperception ; « L’espace ne se compose donc que d’espaces, et le tempsque <strong>de</strong> temps » (Paris, Gallimard, Pléia<strong>de</strong>, p. 909 = Ak III 154). Point <strong>de</strong> vuecontraire in Dieudonné, Pour l’honneur <strong>de</strong> l’esprit humain (Paris,Hachette, 1987 [rééd.] pp. 228-229).
SUR UN VERBE MANQUANT (L’ESPACE CHEZ SPINOZA) 305dimensions <strong>de</strong>s corps, et pourrait par conséquent être distinguée <strong>de</strong>ceux-ci, comme le veut Spinoza ; mais, <strong>de</strong> même qu’on peuttoujours limiter <strong>un</strong>e ligne par <strong>un</strong> point, <strong>un</strong>e surface par <strong>un</strong>e ligne,et <strong>un</strong> corps étendu par <strong>un</strong>e surface, on pourrait limiter cetteétendue substance par les corps étendus en trois dimensions.L’étendue attribut (indivisible et qualitative) pourrait ainsi êtredéfinie « ce dont les limites potentielles sont les corps étendus(divisibles quantitativement), bien qu’elle ne soit auc<strong>un</strong>ementconstituée par eux ». Nous tenons donc, maintenant, <strong>un</strong>e définitionnominale claire : mais pouvons-nous la tenir pour <strong>un</strong>e définitionréelle ? Pouvons-nous, autrement dit, nous faire <strong>un</strong>e idée claire etdistincte d’<strong>un</strong> « objet » ainsi défini ? Et d’autre part, les textes <strong>de</strong>Spinoza confirment-ils ou non <strong>un</strong>e telle conjoncture ? C’est ce quenous allons maintenant examiner.Un fait remarquable, d’abord : Spinoza ne définit jamaisl’étendue attribut. Dans les premiers écrits, les définitions <strong>de</strong>l’étendue concernent <strong>de</strong> toute évi<strong>de</strong>nce l’étendue au sens courant,c’est-à-dire l’étendue en trois dimensions, dont nous avons montréplus haut qu’elle se distingue malaisément <strong>de</strong> la corporéité : dansles Principia, par exemple, « la substance qui est le sujet immédiat<strong>de</strong> l’étendue , et <strong>de</strong>sacci<strong>de</strong>nts qui présupposent l’étendue, comme <strong>de</strong> la figure, <strong>de</strong> lasituation, du mouvement local, etc., est appelée Corps 15 -ladéfinition du « corps » comme « sujet immédiat » <strong>de</strong> l’étenduesupprimant <strong>de</strong> fait, ici, toute différence entre les <strong>de</strong>ux ; plus loin :« en sus <strong>de</strong>s qualités sensibles, il ne reste rien, dans <strong>un</strong> corps, quel’étendue et ses affections » 16 -paroù sont donc clairement i<strong>de</strong>ntifiés, encore <strong>un</strong>e fois, le corps en sonessence (la corporéité) et l’étendue 17 ; jusqu’à la formulation trèsexplicite : « la nature du corps, autrement dit <strong>de</strong> la matière,consiste dans la seule étendue » 18 . Les définitions positives <strong>de</strong> l’étendue,15 Principia I déf 7.16 Principia II ax 7.17 Voir aussi Principia II déf 1 : extensio est id, quod tribusdimensionibus constat ; non autem per extensionem intelligimus actumexistendi, aut aliquid a quantitate distinctum.18 Principia II 2.
306 SPINOZA ET LA PENSÉE MODERNE<strong>de</strong> la matière, ou du corps sont donc ici équivalentes 19 .Dans l’Éthique, Spinoza sépare au contraire, d’<strong>un</strong> côté lamatière, les corps, et l’étendue imaginée, et <strong>de</strong> l’autre l’étendueconçue, ou attribut étendue. Les évocations <strong>de</strong> cette étenduesubstantielle y sont cependant négatives. « L’étendue est <strong>un</strong>attribut <strong>de</strong> Dieu, autrement dit Dieu est chose étendue », écrit sansdoute Spinoza en Éthique II 2 : mais cette proposition n’est pasdémontrée, Spinoza invitant le lecteur à faire lui-même ladémonstration en se calquant sur celle <strong>de</strong> la propositionprécé<strong>de</strong>nte 20 -fait notable, sur lequel nous allons revenir. Quoiqu’il en soit, le caractère attributif <strong>de</strong> l’étendue substantielle n’estpas tiré d’<strong>un</strong>e détermination positive <strong>de</strong> celle-ci -pas plus que lecaractère attributif <strong>de</strong> la pensée n’était d’ailleurs tiré, en Éthique II1 démonstration, d’<strong>un</strong>e détermination positive <strong>de</strong> la pensée. Sinous remontons, <strong>de</strong> référence en référence, le fil <strong>de</strong>sdémonstrations dans l’Éthique, nous trouvons il est vrai, dès ledébut <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> partie, <strong>un</strong>e définition du corps comme « mo<strong>de</strong>qui exprime l’essence <strong>de</strong> Dieu, en tant qu’on la considère commechose étendue d’<strong>un</strong>e manière précisément déterminée » . Le changement <strong>de</strong> perspective estnet, par rapport aux premiers écrits : ici, le corps n’est plus le« sujet immédiat » <strong>de</strong> l’étendue, mais l’« exprime » ; elle lui estdonc « antérieure en nature », comme il convient pour <strong>un</strong>esubstance vis-à-vis <strong>de</strong> ses affections, alors que, plus haut,l’étendue semblait plutôt sinon postérieure en nature, du moinséquivalente, à la corporéité. Mais cette postériorité <strong>de</strong> la corporéitépar rapport à l’étendue attribut ne nous donne toujours pas <strong>de</strong>19 Principia II déf 8 : Motus localis est translatio <strong>un</strong>ius partismateriae, sive <strong>un</strong>ius corporis, ex viciniâ eorum corporum, quae illudimmediatè conting<strong>un</strong>t, et tanquam quiescentia spectantur, in viciniamaliorum (« Le mouvement dans l’espace est le transport d’<strong>un</strong>e partie <strong>de</strong> lamatière, c’est-à-dire d’<strong>un</strong> corps, du voisinage <strong>de</strong>s corps qui le touchentimmédiatement et sont considérés comme immobiles, dans le voisinaged’autres corps » -traduction Appuhn). L’équivalence matière/corps,explicite dans l’expression pars materiae, sive corporis, est bien mise envaleur dans la traduction d’Appuhn (« <strong>un</strong>e partie <strong>de</strong> la matière, c’est-àdired’<strong>un</strong> corps »).20 E II 2 dém : hujus eo<strong>de</strong>m modo procedit, ac <strong>de</strong>monstratiopraece<strong>de</strong>ntis propositionis.
SUR UN VERBE MANQUANT (L’ESPACE CHEZ SPINOZA) 307détermination positive <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière. Spinoza renvoie, en cetendroit, à Éthique I 25 corollaire, selon lequel « les chosesparticulières ne sont rien si ce n’est <strong>de</strong>s affections <strong>de</strong>s attributs <strong>de</strong>Dieu, autrement dit <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s, par lesquels les attributs <strong>de</strong> Dieusont exprimés d’<strong>un</strong>e manière précisément déterminée » 21 . Rien ici,on le voit, sur la nature <strong>de</strong> l’étendue. Un <strong>de</strong>rnier renvoi nous mèneen Éthique I 15 et à Éthique I définition 5 ; mais auc<strong>un</strong> <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>uxtextes 22 ne concerne directement l’étendue substantielle, dont oncherche finalement en vain, dans l’Éthique, <strong>un</strong>e définition oumême <strong>un</strong>e caractérisation -par où nous sommes donc nonseulement autorisés, mais même légitimés (si nous voulonsaccomplir notre tâche d’interprètes et d’historiens) à émettre <strong>de</strong>sconjectures.Mettre <strong>un</strong>e étendue substantielle indivisible, et accessible àla seule intelligence, au cœur <strong>de</strong> la moindre parcelle <strong>de</strong> matièrecorporelle consiste, au fond, à faire <strong>de</strong> cette étendue l’étoffe même<strong>de</strong>s choses. Comme les lignes <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux câbles, se croisant,engendrent <strong>un</strong> point, comme le plan <strong>de</strong> la mer, et celui du ciel, serencontrant, engendrent la ligne d’horizon, comme l’empreinted’<strong>un</strong> pied dans le sable engendre <strong>un</strong>e surface complexe, ainsi, lescorps étendus en largeur, hauteur et profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>vraient êtreconçus comme les concrétions passagères formées par <strong>de</strong>s replissur elle-même <strong>de</strong> l’étendue substantielle, à la façon dont les diverscourants qui agitent l’eau d’<strong>un</strong>e même rivière font naîtred’épisodiques et stables tourbillons. Une telle vision obligerait àreconnaître, dans l’étendue substantielle, ou étendue attribut, <strong>un</strong>evariété qualitative bien plus gran<strong>de</strong> que celle que nous prêtons àl’étendue couramment entendue, divisible, homogène, etquantitative 23 . Mais approchons-nous <strong>de</strong> la vérité <strong>de</strong> l’étendue en21 E I 25 cor : Res particulares nihil s<strong>un</strong>t, nisi Dei attributorumaffectiones, sive modi, quibus Dei attributa certo et <strong>de</strong>terminato modoexprim<strong>un</strong>tur.22 E I 15 : « Tout ce qui est, est en Dieu, et rien ne peut sans Dieuêtre ni être conçu » .23 La fécondité du pli est évoquée avec bonheur par Michel Serres(Les Cinq Sens. Paris : Grasset, 1985) ; ainsi que (dans <strong>un</strong>e perspectivetrès différente <strong>de</strong> celle qui est ici la nôtre) les variations qualitatives fines<strong>de</strong> l’aspect <strong>de</strong> la mer, invisibles au « fonctionnaire <strong>de</strong> contrôle » (p. 274),mais perceptibles à l’« homme <strong>de</strong> mer » (ibid.) : « Là ou l’ancien savant
308 SPINOZA ET LA PENSÉE MODERNEla concevant toujours semblable à elle-même, toujours homogène,et dans laquelle, comme dit le Chat qui S’en Va Tout Seul, « touslieux se valent pour moi » 24 ? Ou au contraire en la concevantcomme fondamentalement hétérogène, qualitativementdifférenciée ? Bergson avait soulevé <strong>un</strong>e hypothèse semblabledans les Données Immédiates : faisant remarquer la capacité <strong>de</strong>certains animaux à s’orienter, il écrivait en effet : « l’espace n’estpas aussi homogène pour l’animal que pour nous, et lesdéterminations <strong>de</strong> l’espace, ou directions, ne revêtent point pourlui <strong>un</strong>e forme purement géométrique. Chac<strong>un</strong>e d’elle luiapparaîtrait avec sa nuance, sa qualité propre. On comprendra lapossibilité d’<strong>un</strong>e perception <strong>de</strong> ce genre, si l’on songe que nousdistinguons nous-mêmes notre droite <strong>de</strong> notre gauche par <strong>un</strong>sentiment naturel, et que ces <strong>de</strong>ux déterminations <strong>de</strong> notre propreétendue, nous présentent bien alors <strong>un</strong>e différence <strong>de</strong> qualité ;c’est même pourquoi nous échouons à les définir. A vrai dire, lesdifférences qualitatives sont partout dans la nature ; et l’on ne voitpas pourquoi <strong>de</strong>ux directions concrètes ne seraient point aussimarquées dans l’aperception immédiate que <strong>de</strong>ux couleurs » 25 .Même remarque chez Kant dans l’opuscule <strong>de</strong> 1786 Qu’est-ce ques’orienter dans la pensée 26 . Mais si l’intelligence se marque à lacapacité <strong>de</strong> produire la conception d’<strong>un</strong> espace homogène, c’est-àdire<strong>de</strong> prendre du recul par rapport aux suggestions <strong>de</strong> l’étenduesubstantielle et qualitative, inversement, on <strong>de</strong>vra conjecturer queles « choses singulières » sont d’autant plus soumises à <strong>de</strong> tellessuggestions qu’elles ont moins d’intelligence et d’autonomie. Leschoses singulières les plus frustres et les moins autonomeslaisseraient ainsi <strong>de</strong>viner, mieux que les êtres vivants ou les êtresintelligents, les forces et les directions <strong>de</strong> cette étenduene percevait que du monotone, le patron voyait évi<strong>de</strong>mment <strong>un</strong> corpsstrié, nué, tigré, chiné, zébré, exactement différencié, <strong>un</strong>e surface où ilrepérait les régions locales, où le point, à chaque instant et sous lebrouillard même, se trouvait déjà fait ; là où l’ancien savant ne voyait que<strong>de</strong> l’instable, le patron percevait <strong>un</strong> espace qui ne changeait que peu »(275-276).24 Kipling, Histoires comme ça.25 Bergson, Essai sur les Données Immédiates <strong>de</strong> la Conscience,p. 65 (éd. du centenaire).26 Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée. Paris : Vrin, 1978(traduction et commentaires par A. Philonenko), p. 77.
SUR UN VERBE MANQUANT (L’ESPACE CHEZ SPINOZA) 309substantielle. Serait-il absur<strong>de</strong> en effet, <strong>de</strong> voir, dans les corporasimplicissima 27 , les produits <strong>de</strong>s agitations les plus superficielles<strong>de</strong> l’étendue, tandis que les corps célestes, en leurs mouvementsamples et réguliers, en révéleraient <strong>de</strong>s courants plus profonds ?N’est-ce pas là <strong>un</strong>e vision <strong>de</strong>s choses au moins aussi acceptableque celle par laquelle nous disons percevoir, dans l’organisationgénérale <strong>de</strong> l’<strong>un</strong>ivers, <strong>de</strong>s planètes, <strong>de</strong>s étoiles et <strong>de</strong>s galaxiesséparées par <strong>un</strong> espace neutre, homogène, et « attirées » néanmoinsles <strong>un</strong>es vers les autres, à <strong>de</strong>s distances immenses, pard’incompréhensibles et mystérieuses « forces », nous obligeantainsi à faire <strong>de</strong> cet espace, contradictoirement, à la fois <strong>un</strong>e pureséparation et <strong>un</strong> in<strong>de</strong>structible lien, le lieu du vi<strong>de</strong> et celui duplein ? La conception <strong>de</strong> l’étendue par la qualité pourrait bien êtrealors, comme le pensait Spinoza, plus adéquate que l’imaginationd’<strong>un</strong> espace abstrait, divisible, homogène et indifférencié.Spinoza a-t-il lui-même considéré les corps étendus comme<strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> l’étendue substantielle ? Les toutes <strong>de</strong>rnièreslettres que nous avons <strong>de</strong> lui permettent <strong>de</strong> l’affirmer. En mai1676, il déclare à Tschirnhaus considérer comme impossible lepassage <strong>de</strong> l’attribut étendue aux mo<strong>de</strong>s étendus : il lui est« extrêmement difficile » <strong>de</strong> « concevoir comment on peutdémontrer a priori l’existence <strong>de</strong> corps qui ont <strong>de</strong>s mouvements et<strong>de</strong>s figures alors que rien <strong>de</strong> tel ne se rencontre dans l’étenduequand on la considère absolument » 28 . Et cependant, la philosophie<strong>de</strong> Spinoza exige nécessairement <strong>un</strong>e comm<strong>un</strong>e mesure ; car s’iln’y avait rien <strong>de</strong> comm<strong>un</strong> entre l’attribut étendue et les chosesétendues, comment pourrait-on placer la première au cœur <strong>de</strong>ssecon<strong>de</strong>s, et, tout simplement, utiliser pour les désigner le mêmeterme d’« étendue » ? « Tous les corps », en effet, « conviennenten certaines choses, et d’abord en ceci qu’ils enveloppent leconcept d’<strong>un</strong> seul et même attribut » (Éthique II 13, lemme 2 etdémonstration) ; et <strong>un</strong> corps « exprime l’essence <strong>de</strong> Dieu, en tantqu’on la considère comme chose étendue, d’<strong>un</strong>e manièreprécisément déterminée » (II déf 1). Quelques jours plus tard, <strong>de</strong>fait, Spinoza rejette la difficulté sur Descartes (comme si, à partird’autres principes, on pouvait la lever) : « De l’étendue,maintenant, telle que la conçoit Descartes, c’est-à-dire comme <strong>un</strong>e27 E II 13, lemme VII.28 Lettre 80.
310 SPINOZA ET LA PENSÉE MODERNEmasse au repos , il n’est pas seulementdifficile, mais complètement impossible <strong>de</strong> tirer par démonstrationl’existence <strong>de</strong>s corps » 29 .Mais si la « démonstration <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong>s corps à partir <strong>de</strong>l’étendue » est impossible lorsque l’étendue est considéré comme« <strong>un</strong>e masse au repos », peut-être <strong>de</strong>viendra-t-elle possible sil’étendue substantielle est douée <strong>de</strong> dynamisme ? Tel estincontestablement le sens <strong>de</strong> la troisième lettre à Tschirnhaus, <strong>de</strong>juillet 1676 : Spinoza n’y déclare plus seulement la question« extrêmement difficile » en elle-même, ou « impossible » d’aprèsles principes « absur<strong>de</strong>s » <strong>de</strong> Descartes, mais évoque clairement<strong>un</strong>e solution possible à partir <strong>de</strong> ses propres principes : « [lamatière] doit nécessairement être expliquée par <strong>un</strong> attribut quiexprime <strong>un</strong>e essence éternelle et infinie » . Comme le montre le contexte, Spinoza entend, par« expliquer la matière », « expliquer ou démontrer a priori lavariété <strong>de</strong>s choses » . Bien qu’il reconnaisse dansla suite <strong>de</strong> la lettre lui avoir été « impossible jusqu’ici <strong>de</strong> riendisposer avec ordre sur ce sujet », Spinoza montre donc ici lavoie : seule <strong>un</strong>e conception dynamique <strong>de</strong> l’étendue permettra <strong>de</strong>comprendre la production <strong>de</strong>s choses matérielles. En comparantplus haut l’étendue substantielle spinoziste à <strong>un</strong> fleuve, quiavancerait toujours, avec ses courants profonds et son agitation <strong>de</strong>surface, et les corps étendus aux configurations momentanéescréées par ce mouvement même, nous allions donc probablementdans <strong>un</strong>e direction indiquée par la doctrine, puisque, comme onsait, l’expression la plus immédiate <strong>de</strong> l’attribut étendue, ou« mo<strong>de</strong> infini immédiat » <strong>de</strong> l’étendue, est selon Spinoza « lemouvement et le repos » 30 . Or, si nous attribuons volontiers le29 Lettre 81.30 Lettre 64. Voir S. Zac, « Les thèmes spinozistes dans laphilosophie <strong>de</strong> Bergson », in Essais spinozistes (Paris : Vrin, 1987),notamment p. 133 sq., où Zac compare <strong>de</strong> façon précise et nuancée lesthèse spinozistes et l’« élan vital » bergsonien. <strong>Sur</strong> les rapportsBergson/Spinoza, on pourra également se reporter aux articles <strong>de</strong> R.-M.Mossé-Basti<strong>de</strong> (« Bergson et Spinoza », in Revue <strong>de</strong> Métaphysique et <strong>de</strong>Morale 54, 1949, p. 67-82), Giovanni Cairola (« Bergson e Spinoza » inRivista di Filosofia, 1949 a, XL, serie III, vol. IV, f. 4, p. 406-417), etFrançois d’Hautefeuille (« Bergson et Spinoza », in Revue <strong>de</strong>
SUR UN VERBE MANQUANT (L’ESPACE CHEZ SPINOZA) 311mouvement et le repos aux corps situés dans l’espace, jamais,semble-t-il, nous n’attribuons spontanément <strong>de</strong> tellesdéterminations à l’espace lui-même : nous plaçons <strong>de</strong>s corpsmobiles dans <strong>un</strong> espace inerte, quand Spinoza engendre lemouvement à partir <strong>de</strong> l’étendue, et les corps à partir dumouvement 31 .Encore faut-il distinguer le mouvement « extérieur », quidétermine les positions et les rencontres, les compositions et lesdécompositions, bref, tout ce que Spinoza décrit dans le début la« physique » <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l’Éthique 32 ; et le mouvement« intérieur », c’est-à-dire la proportion précisément déterminée <strong>de</strong>repos et <strong>de</strong> mouvement qui, faisant <strong>de</strong> chaque « chose singulière »étendue <strong>un</strong> individu 33 , constitue en réalité la « nature »permanente, ou l’essence <strong>de</strong> cette chose, comme l’expliqueSpinoza dans la <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> sa « physique » 34 . Le premiertype <strong>de</strong> mouvement exprime indirectement la puissance <strong>de</strong>l’étendue, le second l’exprime directement. Or, le trait comm<strong>un</strong> àtoutes les choses singulières, étendues, définies par <strong>un</strong>e proportionprécisément déterminée <strong>de</strong> mouvement et <strong>de</strong> repos, est <strong>un</strong>etendance à maintenir constante cette proportion. Les êtres les plussimples y parviennent difficilement, les êtres plus puissants et pluscomposés y parviennent mieux, « et, continuant ainsi à l’infini,nous concevons que la nature entière est <strong>un</strong> seul individu dont lesparties, c’est-à-dire tous les corps, varient d’<strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong>manières, sans auc<strong>un</strong> changement <strong>de</strong> l’individu total » 35 . Déchiffrée à travers lescomportements <strong>de</strong>s corps étendus, l’étendue substantiellemontrerait donc ici <strong>un</strong>e inertie essentielle, l’individu total neconservant son être (ne « retenant sa nature » 36 ) que parce que rienMétaphysique et <strong>de</strong> Morale, 65-4, 1960, p. 463-474).31 Lettre 2 : extensio per se, et in se concipitur ; at motus non i<strong>de</strong>m.Nam concipitur in alio, et ipsius conceptus involvit extensionem(« l’étendue se conçoit en soi et par soi, mais non le mouvement qui seconçoit en autre chose, et dont le concept enveloppe l’étendue »).32 E II 13 sq. jusqu’à la « définition » non comprise.33 E II 13 déf.34 E II 13 à partir <strong>de</strong> la définition (soit les textes commençant avecl’axiome 3 »).35 E II 13 lemme VII sc.36 E II 13 lemme IV et sq. : suam naturam retinere.
312 SPINOZA ET LA PENSÉE MODERNEne peut venir s’opposer à <strong>un</strong>e telle conservation.Spinoza, cependant, dans la troisième partie <strong>de</strong> l’Éthique, neparle plus <strong>de</strong> « retenir sa nature » , mais<strong>de</strong> « faire effort » ; « chaque chose, autant qu’il est enelle, s’efforce <strong>de</strong> persévérer dans l’être » 37 . En cela,tout corps étendu exprime, comme toute pensée, « l’essence active<strong>de</strong> Dieu » 38 . La détermination du mo<strong>de</strong> d’être <strong>de</strong> l’étendue parl’examen du mo<strong>de</strong> d’être <strong>de</strong> ses productions corporelles sembledonc donner lieu ici à <strong>un</strong>e hésitation entre « inertie » et « effort ».Dans le cadre général du système, <strong>un</strong>e telle hésitation n’a pas lieud’être, puisque Spinoza démontre <strong>un</strong>iversellement, au début <strong>de</strong> latroisième partie <strong>de</strong> l’Éthique, l’équivalence entre l’inertie etl’effort 39 . Il nous semble cependant significatif d’avoir cru la voirsurgir à propos du cas particulier <strong>de</strong> l’étendue, alors qu’elle neserait jamais apparue à propos <strong>de</strong> la pensée. Le « parallélisme » 40<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s d’activité <strong>de</strong> la pensée et <strong>de</strong> l’étendue rencontre ici <strong>un</strong>edifficulté nouvelle 41 , car, tandis qu’à l’attribut « pensée »correspond le <strong>verbe</strong> « penser », qui désigne <strong>un</strong> type d’activitéparfaitement définissable, en revanche, auc<strong>un</strong> <strong>verbe</strong> ne correspondprécisément à l’attribut « étendue » ; comme s’il était impossible<strong>de</strong> désigner par <strong>un</strong> mot usuel l’activité propre à l’étendue -oucomme s’il était impossible <strong>de</strong> concevoir <strong>un</strong>e étendue commeactive.Les <strong>de</strong>ux premières propositions <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>l’Éthique sont en effet à ce point parallèles que Spinoza ne donnepas la démonstration <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong>, invitant à « procé<strong>de</strong>r <strong>de</strong> lamême façon » que dans la première. Il s’agit <strong>de</strong> démontrer,d’abord, que « la pensée est <strong>un</strong> attribut <strong>de</strong> Dieu, autrement dit37 E III 6.38 Voir Pensées métaphysiques II I 1 ; et E II 3 sc : « en outre, nousavons montré (I 34) que la puissance <strong>de</strong> Dieu n’est rien d’autre quel’essence active <strong>de</strong> Dieu » .39 C’est le sens <strong>de</strong> l’enchaînement <strong>de</strong>s propositions 4 à 7 <strong>de</strong> latroisième partie.40 Terme qui ne figure pas chez Spinoza, mais sur lequel se sontaccordés ses commentateurs.41 En plus <strong>de</strong> toutes celles analysées par Gueroult au début <strong>de</strong> sonSpinoza II, avec <strong>un</strong> incroyable raffinement.
SUR UN VERBE MANQUANT (L’ESPACE CHEZ SPINOZA) 313[que] Dieu est chose pensante » (proposition 1) ; puis,parallèlement, que « la pensée est <strong>un</strong> attribut <strong>de</strong> Dieu, autrementdit [que] Dieu est chose étendue » (proposition 2). Comme l’a faitremarquer Gueroult, le décalque <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> démonstration surla première se fait facilement 42 . Mais il n’en va pas <strong>de</strong> même pourles scolies. « Cette proposition est encore évi<strong>de</strong>nte », écrit Spinozadans le scolie <strong>de</strong> la proposition 1, « par cela seul que nous pouvonsconcevoir <strong>un</strong> être infini pensant ». Et il poursuit :(1) « Plus en effet <strong>un</strong> être pensant peut penser <strong>de</strong> choses, plus nousconcevons qu’il contient <strong>de</strong> réalité ou <strong>de</strong> perfection, donc<strong>un</strong> être qui peut penser <strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> choses en <strong>un</strong>einfinité <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s, est nécessairement infini par la vertudu penser » 43 .En vertu du parallélisme <strong>de</strong> la pensée et <strong>de</strong> l’étendue, on<strong>de</strong>vrait donc pouvoir adapter <strong>un</strong> tel passage à l’étendue : que« l’étendue est <strong>un</strong> attribut <strong>de</strong> Dieu, autrement dit que Dieu estchose étendue », serait donc « encore évi<strong>de</strong>nt », selon <strong>un</strong> scoliecalqué sur celui <strong>de</strong> la proposition 1, « par cela seul que nouspouvons concevoir <strong>un</strong> être infini étendu ». On poursuivrait alors :(2) « Plus, en effet <strong>un</strong> être étendu peut [...] <strong>de</strong> choses,plus nous concevons qu’il contient <strong>de</strong> réalité ou <strong>de</strong>perfection, donc <strong>un</strong> être qui peut [...] <strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong>choses en <strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s est nécessairement infinipar la vertu du [...] ».La difficulté vient ici du fait que plusieurs <strong>verbe</strong>s peuventlégitimement se disputer la place <strong>manquant</strong>e, sans qu’auc<strong>un</strong> nes’impose à l’évi<strong>de</strong>nce.1. Du strict point <strong>de</strong> vue du parallélisme <strong>de</strong>s termes, puisque« penser » correspond à l’attribut « pensée », à l’attribut « étendue » <strong>de</strong>vraitcorrespondre le <strong>verbe</strong> « étendre » :42 Gueroult II, p. 40, § III.43 E II I sc (que nous n’avons pas cité intégralement).
314 SPINOZA ET LA PENSÉE MODERNE(3) « Plus <strong>un</strong> être étendu peut étendre <strong>de</strong> choses, plusnous concevons qu’il contient <strong>de</strong> réalité ou <strong>de</strong> perfection,donc <strong>un</strong> être qui peut étendre <strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> choses en<strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s, est nécessairement infini par lavertu <strong>de</strong> l’étendre ».« Étendre », employé transitivement est synonyme <strong>de</strong>« déployer », <strong>de</strong> « déplier », et, dans <strong>un</strong> contexte spinoziste,pourrait donc être interprété en « expliquer » , <strong>verbe</strong>qui redouble parfois, dans l’Éthique, le <strong>verbe</strong> « exprimer »,précisément à propos <strong>de</strong>s attributs 44 . On écrirait donc :(4) « Plus <strong>un</strong> être étendu peut expliquer/déplier <strong>de</strong>choses, plus nous concevons qu’il contient <strong>de</strong> réalité ou<strong>de</strong> perfection, donc <strong>un</strong> être qui peut expliquer/déplier<strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> choses en <strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s estnécessairement infini par la vertu <strong>de</strong> l’expliquer (dudéplier) ».Une telle hypothèse rencontre cependant <strong>de</strong>ux objectionsimportantes : d’abord la valeur linguistique <strong>de</strong> « expliquer » estbien plus large que celle d’« étendre » ; « expliquer » peuts’appliquer à tout mo<strong>de</strong> « expliquant » <strong>un</strong> attribut, ou« s’expliquant » par lui ; le terme peut donc servir à caractériserl’activité propre à l’attribut « étendue ». D’autre part, Spinozan’emploie, dans l’Éthique, le <strong>verbe</strong> exten<strong>de</strong>re que sous la forme« s’étendre» , et, pour la plupart <strong>de</strong>s occurrences,<strong>de</strong> façon métaphorique 45 .2. Le transitif « mouvoir » conviendrait très bienà la structure grammaticale du scolie :(5) « Plus <strong>un</strong> être étendu peut mouvoir <strong>de</strong> choses, plusnous concevons qu’il contient <strong>de</strong> réalité ou <strong>de</strong> perfection,donc <strong>un</strong> être qui peut mouvoir <strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> choses en44 Voir par exemple E I 20 dém ; II 5 ; II 7 sc.45 La plupart <strong>de</strong>s occurrences sont regroupées en II 49 sc, où ils’agit pour Spinoza <strong>de</strong> réfuter la thèse cartésienne selon laquelle lavolonté « s’étend » plus loin que l’enten<strong>de</strong>ment.
SUR UN VERBE MANQUANT (L’ESPACE CHEZ SPINOZA) 315<strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s est nécessairement infini par lavertu du mouvoir ».Le sens général est intuitivement acceptable, et s’accor<strong>de</strong>avec ce que nous avons déjà reconnu du dynamisme enveloppédans l’attribut étendue chez Spinoza. Les difficultés sont ici d’<strong>un</strong>autre ordre : d’abord au <strong>verbe</strong> « mouvoir » correspond, dans lesystème, le substantif « mouvement » . On necomprendrait donc pas, si « mouvoir » exprimait pleinementl’essence active d’<strong>un</strong> attribut <strong>de</strong> la substance, que cet attribut ne senomme pas le « mouvement », puisque le terme existe et puisqueSpinoza, loin <strong>de</strong> le négliger, l’emploie très fréquemment. Tel n’estpourtant pas le cas, et nous avons que Spinoza fait du mouvement<strong>un</strong> mo<strong>de</strong>, et non <strong>un</strong> attribut. De ce fait, le terme « mouvoir » nepeut prétendre caractériser adéquatement le dynamisme <strong>de</strong>l’attribut étendue.3. Le parallélisme prend, en Éthique II 7 et corollaire, <strong>un</strong>eforme plus large : « l’ordre et la connexion <strong>de</strong>s idées sont lesmêmes que l’ordre et la connexion <strong>de</strong>s choses » ; d’où suit que « lapuissance <strong>de</strong> penser <strong>de</strong> Dieu est égale à sa puissance actuelled’agir » . Spinoza instaure <strong>un</strong> parallélisme entre <strong>un</strong>e « puissance<strong>de</strong> penser » et... autre chose ; comment ne pas faire au moinsl’hypothèse que cette « autre chose » désigne l’autre attribut quenous connaissons, à savoir l’attribut étendue ? Dans le texte <strong>de</strong> laproposition 7, en effet, Spinoza met bien en parallèle <strong>de</strong>s « idées »et <strong>de</strong>s « choses » ; or nos idées ont pour objet, pour la plupart, <strong>de</strong>s« choses étendues », c’est-à-dire <strong>de</strong>s corps : par exemple, selonÉthique II 13, « l’objet <strong>de</strong> l’idée constituant l’âme humaine est lecorps, c’est-à-dire <strong>un</strong> certain mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’étendue existant en acte, etn’est rien d’autre » 46 . Est-il donc acceptable <strong>de</strong> voir dans la« puissance d’agir » <strong>un</strong>e évocation du dynamisme <strong>de</strong> l’attributétendue, comme dans la « puissance <strong>de</strong> penser » la désignation dudynamisme propre à l’attribut pensée ? Oui en <strong>un</strong> sens, d’autantque Spinoza explicite, en Éthique II 17 corollaire, la « puissance<strong>de</strong> penser » par référence à l’existence <strong>de</strong>s choses en Dieu46 E II 13 : Objectum i<strong>de</strong>ae humanam mentam constituentis estcorpus, sive certus extensionis modus actu existens, et nihil aliud.
316 SPINOZA ET LA PENSÉE MODERNE« objectivement », et la « puissance d’agir » par référence àl’existence <strong>de</strong>s choses en Dieu « formellement » 47 . Or, exister« formellement », c’est, pour les objets, exister « hors <strong>de</strong> nous »,c’est-à-dire exister comme étendus dans le mon<strong>de</strong> extérieur ; etexister « objectivement », c’est, pour ces mêmes objets, exister entant qu’idées, comme l’illustre très clairement Descartes dans <strong>un</strong>passage <strong>de</strong>s Réponses aux premières objections : « l’idée du soleilest le soleil même existant dans l’enten<strong>de</strong>ment, non pas à la véritéformellement, comme il est au ciel, mais objectivement, c’est-àdireen la manière que les objets ont coutume d’exister dansl’enten<strong>de</strong>ment » 48 . L’existence « formelle » désigne doncgénéralement l’existence <strong>de</strong> choses étendues. Le scolie parallèle <strong>de</strong>Éthique II 1 scolie énoncerait donc d’abord : « Cette proposition [àsavoir « l’étendue est <strong>un</strong> attribut <strong>de</strong> Dieu, autrement dit Dieu estchose étendue »] est encore évi<strong>de</strong>nte par cela seul que nouspouvons concevoir <strong>un</strong> être infini agissant ». Et poursuivrait :(6) « Plus en effet <strong>un</strong> être étendu peut agir <strong>de</strong> choses,plus nous concevons qu’il contient <strong>de</strong> réalité ou <strong>de</strong>perfection, donc <strong>un</strong> être qui peut agir <strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong>choses en <strong>un</strong>e infinité <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s est nécessairement infinipar la vertu <strong>de</strong> l’agir ».Les défauts d’<strong>un</strong>e telle hypothèse apparaissent alorsclairement : comme « expliquer », « agir » est <strong>un</strong> terme trop largepour l’étendue ; car tous les attributs sont également agissants : la« puissance d’agir » ne détermine donc rien <strong>de</strong> spécifique àl’étendue. D’autre part, au <strong>verbe</strong> « agir » correspond, dans le47 E II 7 cor : « il suit <strong>de</strong> là que la puissance <strong>de</strong> penser <strong>de</strong> Dieu estégale à sa puissance d’agir, c’est-à-dire tout ce qui suit formellement <strong>de</strong> lanature infinie <strong>de</strong> Dieu suit aussi en Dieu objectivement dans le mêmeordre et avec la même connexion <strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong> Dieu ».48 Descartes, Premières Réponses, éd. Alquié II, p. 521. Voir aussiSpinoza, Lettre 32: « je crois qu’il y a dans la nature <strong>un</strong>e puissance infinie<strong>de</strong> penser, laquelle, en tant qu’infinie, contient en soi la nature touteentière objectivement, et <strong>de</strong> laquelle les pensées s’enchaînent <strong>de</strong> la mêmefaçon que la nature, son idéat » . Nous traduisons.