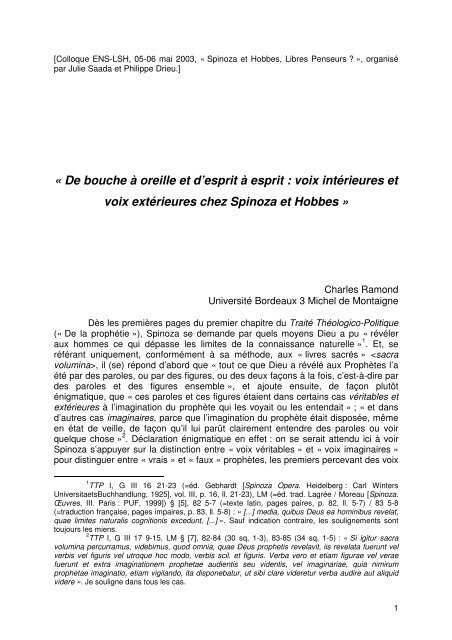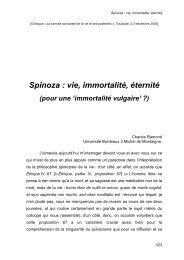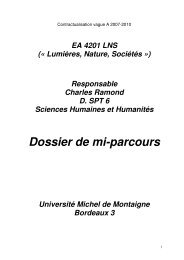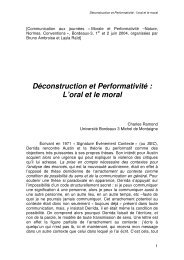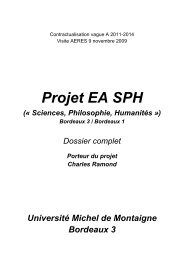voix intérieures et voix extérieures chez Spinoza et Hobbes
voix intérieures et voix extérieures chez Spinoza et Hobbes
voix intérieures et voix extérieures chez Spinoza et Hobbes
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
[Colloque ENS-LSH, 05-06 mai 2003, « <strong>Spinoza</strong> <strong>et</strong> <strong>Hobbes</strong>, Libres Penseurs ? », organisé<br />
par Julie Saada <strong>et</strong> Philippe Drieu.]<br />
« De bouche à oreille <strong>et</strong> d’esprit à esprit : <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>voix</strong> <strong>extérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Spinoza</strong> <strong>et</strong> <strong>Hobbes</strong> »<br />
Charles Ramond<br />
Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne<br />
Dès les premières pages du premier chapitre du Traité Théologico-Politique<br />
(« De la prophétie »), <strong>Spinoza</strong> se demande par quels moyens Dieu a pu « révéler<br />
aux hommes ce qui dépasse les limites de la connaissance naturelle » 1 . Et, se<br />
référant uniquement, conformément à sa méthode, aux « livres sacrés » , il (se) répond d’abord que « tout ce que Dieu a révélé aux Prophètes l’a<br />
été par des paroles, ou par des figures, ou des deux façons à la fois, c’est-à-dire par<br />
des paroles <strong>et</strong> des figures ensemble », <strong>et</strong> ajoute ensuite, de façon plutôt<br />
énigmatique, que « ces paroles <strong>et</strong> ces figures étaient dans certains cas véritables <strong>et</strong><br />
<strong>extérieures</strong> à l’imagination du prophète qui les voyait ou les entendait » ; « <strong>et</strong> dans<br />
d’autres cas imaginaires, parce que l’imagination du prophète était disposée, même<br />
en état de veille, de façon qu’il lui parût clairement entendre des paroles ou voir<br />
quelque chose » 2 . Déclaration énigmatique en eff<strong>et</strong> : on se serait attendu ici à voir<br />
<strong>Spinoza</strong> s’appuyer sur la distinction entre « <strong>voix</strong> véritables » <strong>et</strong> « <strong>voix</strong> imaginaires »<br />
pour distinguer entre « vrais » <strong>et</strong> « faux » prophètes, les premiers percevant des <strong>voix</strong><br />
1 TTP I, G III 16 21-23 (=éd. Gebhardt [<strong>Spinoza</strong> Opera. Heidelberg : Carl Winters<br />
Universita<strong>et</strong>sBuchhandlung, 1925], vol. III, p. 16, ll. 21-23), LM (=éd. trad. Lagrée / Moreau [<strong>Spinoza</strong>.<br />
Œuvres, III. Paris : PUF, 1999]) § [5], 82 5-7 (=texte latin, pages paires, p. 82, ll. 5-7) / 83 5-8<br />
(=traduction française, pages impaires, p. 83, ll. 5-8) : « [...] media, quibus Deus ea hominibus revelat,<br />
quae limites naturalis cognitionis excedunt, [...] ». Sauf indication contraire, les soulignements sont<br />
toujours les miens.<br />
2 TTP I, G III 17 9-15, LM § [7], 82-84 (30 sq, 1-3), 83-85 (34 sq, 1-5) : « Si igitur sacra<br />
volumina percurramus, videbimus, quod omnia, quae Deus proph<strong>et</strong>is revelavit, iis revelata fuerunt vel<br />
verbis vel figuris vel utroque hoc modo, verbis scil. <strong>et</strong> figuris. Verba vero <strong>et</strong> <strong>et</strong>iam figurae vel verae<br />
fuerunt <strong>et</strong> extra imaginationem proph<strong>et</strong>ae audientis seu videntis, vel imaginariae, quia nimirum<br />
proph<strong>et</strong>ae imaginatio, <strong>et</strong>iam vigilando, ita disponebatur, ut sibi clare vider<strong>et</strong>ur verba audire aut aliquid<br />
videre ». Je souligne dans tous les cas.<br />
1
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
« <strong>extérieures</strong> à leur imagination », pour reprendre la formule de <strong>Spinoza</strong>, c’est-à-dire<br />
de vraies <strong>voix</strong>, les autres (fous ou charlatans plutôt que prophètes) se contentant,<br />
comme on dit, d’« entendre des <strong>voix</strong> », c’est-à-dire faisant passer des <strong>voix</strong><br />
« <strong>intérieures</strong> » pour des messages divins. Et néanmoins, <strong>Spinoza</strong>, à l’image du texte<br />
sacré, semble indifférent à c<strong>et</strong>te distinction. Il accorde que, si certains prophètes,<br />
comme Moïse ou Samuel, ont prophétisé à partir de <strong>voix</strong> réellement entendues,<br />
<strong>extérieures</strong> 3 , d’autres, comme Abimélech, peuvent conserver le titre de prophètes<br />
(ne passent donc pas pour fous), bien qu’ils aient entendu, dit <strong>Spinoza</strong>, des « <strong>voix</strong><br />
imaginaires », parce qu’entendues « en songe », c’est-à-dire, précise <strong>Spinoza</strong>, « au<br />
moment où l’imagination est le plus apte naturellement à former l’image de choses<br />
qui ne sont pas » -je souligne c<strong>et</strong>te fin de phrase, pour le moins inattendue pour<br />
parler des songes d’un prophète attesté 4 . De même, pour ce qui est des visions,<br />
<strong>Spinoza</strong> reconnaît que David a eu des « visions réelles » 5 , mais que Joseph a eu<br />
des « visions imaginaires » 6 , ce qui n’empêche pas Joseph d’être prophète autant<br />
que David. Il est vrai que, sur le fond, il paraît très difficile de distinguer entre une<br />
« perception imaginaire » <strong>et</strong> une « perception réelle », dans la mesure où la notion<br />
de « perception imaginaire » semble contradictoire, puisque toute perception semble<br />
par définition s’attester elle-même comme perception, donc comme perception<br />
« réelle » (comment est-il possible, par exemple, d’entendre une <strong>voix</strong> qui n’existe<br />
pas, puisque l’audition est le seul moyen d’attester de la réalité de ce qu’on entend ?<br />
Cela semble absurde). Inversement renoncer à distinguer entre visions ou <strong>voix</strong><br />
« réelles » <strong>et</strong> « imaginaires » reviendrait à considérer toute perception comme une<br />
hallucination ou un fantasme, conclusion au coût théorique à première vue<br />
exorbitant. On devine ici que c<strong>et</strong>te question de l’intériorité ou de l’extériorité des <strong>voix</strong><br />
perçues par les prophètes indique un très intéressant problème théorique, qui<br />
s’étend d’ailleurs bien au-delà –je vais essayer de le montrer– du contexte<br />
théologico-politique où il apparaît, tant <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> que <strong>chez</strong> <strong>Spinoza</strong>.<br />
Et en eff<strong>et</strong>, si Moïse se distingue de tous les autres prophètes, selon le texte<br />
sacré, c’est bien parce qu’il a perçu une « vraie <strong>voix</strong> » venant de Dieu, <strong>et</strong> donc une<br />
<strong>voix</strong> qui attestait par elle-même, comme le fait ordinairement toute <strong>voix</strong> perçue, la<br />
présence d’un suj<strong>et</strong> parlant effectivement extérieur <strong>et</strong> existant. Se référant à<br />
3 TTP I, LM [8], 84-85 ; G III 17 16-23. Voce enim vera revelavit Deus Mosi Leges, quas<br />
Hebraeis praescribi volebat (« C’est par une <strong>voix</strong> véritable que Dieu a révélé à Moïse les lois qu’il<br />
voulait prescrire aux Hébreux » –LM 84 4-5 / 85 6-7 ; G III 17 16-17).<br />
4 TTP I, LM [10] : « La <strong>voix</strong> qu’entendit Abimélech était imaginaire. En eff<strong>et</strong>, la Genèse dit<br />
(20 : 6) : Et Dieu lui dit dans ses songes, <strong>et</strong>c. Ce n’était donc pas pendant la veille qu’il pouvait<br />
imaginer la volonté de Dieu, mais seulement pendant son sommeil (c’est-à-dire au moment où<br />
l’imagination est le plus apte naturellement à former l’image de choses qui ne sont pas) (Vox, quam<br />
Abimelech audivit, imaginaria fuit. Nam dicitur Gen. cap. XX. v. 6. Et dixit ipsi Deus in somnis <strong>et</strong>c.<br />
Quare hic non vigilando, sed tantum in somnis (tempore scilic<strong>et</strong>, quo imaginatio maxime naturaliter<br />
apta est ad res, quae non sunt, imaginandum) Dei voluntatem imaginari potuit.<br />
5 TTP I, LM [14], 88 23-32 / 89 29-38 : « Qu’une révélation ait eu lieu par des images seules,<br />
c’est ce qui est évident par le premier livre des Paralipomènes (chap. 21) où Dieu montre sa colère à<br />
David par un ange qui tient une épée à la main [...]. Maïmonide <strong>et</strong> d’autres veulent que c<strong>et</strong>te histoire<br />
[...] soit arrivée en songe, <strong>et</strong> ils nient que quelqu’un ait pu, les yeux ouverts, voir un ange. Mais c’est un<br />
pur bavardage [...] » (Quod revelatio per solas imagines contigit, pat<strong>et</strong> ex primo Paralip. Cap. XXI., ubi<br />
Deus Davidi iram suam ostendit per angelum gladium manu prehendentem [...]. Et quamvis<br />
Maimonides <strong>et</strong> alii hanc historiam [...] in somnis contigisse volunt, non vero, quod aliquis oculis apertis<br />
angelum videre potuerit, illi sane garriunt. –G III 19 24-31).<br />
6 TTP I, LM [15], 90 1-3, 91 3-5 : « En revanche, c’est au contraire par des images qui<br />
n’étaient pas réelles, mais qui dépendaient de la seule imagination du prophète, que Dieu a révélé à<br />
Joseph sa future élévation » (Imaginibus vero non realibus, sed a sola imaginatione proph<strong>et</strong>ae<br />
dependentibus revelavit Deus Josepho dominium sibi futurum –G III 19 34-35).<br />
2
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
Nombres 12, 6-7 (« Si quelqu’un de vous est prophète de Dieu, je me révèlerai à lui<br />
dans une vision <strong>et</strong> je lui parlerai dans des songes. Mais ce n’est pas ainsi que je me<br />
révèle à Moïse : je lui parle de ma bouche à sa bouche , dans<br />
une vision sans énigme, <strong>et</strong> il voit l’image de Dieu » 7 ), <strong>Spinoza</strong> commente : « Il est<br />
donc indubitable que les autres prophètes n’ont pas entendu une <strong>voix</strong> véritable<br />
» 8 . Finalement, Moïse est le seul que Dieu ait connu « face à face »<br />
, « ce qui », explique <strong>Spinoza</strong>, « doit s’entendre pour la <strong>voix</strong><br />
seule, car Moïse lui-même n’avait jamais vu le visage de Dieu » 9 .<br />
Moïse est ainsi le prophète par excellence, en ce qu’il a avec Dieu une<br />
rencontre réelle, dans l’extériorité, <strong>et</strong> non une hallucination, ou un songe, dont la<br />
source peut toujours être attribuée à l’intériorité d’une imagination trop vive. Et c’est<br />
bien à ce titre de représentant par excellence de l’extériorité qu’il est opposé au<br />
Christ par <strong>Spinoza</strong>, dans une comparaison célèbre : « je ne crois pas que quiconque<br />
», écrit en eff<strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong>, « ait dépassé les autres hommes pour<br />
atteindre à une telle perfection, sauf le Christ, à qui les décr<strong>et</strong>s de Dieu qui<br />
conduisent les hommes au salut ont été révélés sans paroles <strong>et</strong> sans visions , mais d’une façon immédiate 10 .<br />
Ainsi, le Christ n’a pas « entendu » la <strong>voix</strong> de Dieu, mais « est » directement la <strong>voix</strong><br />
de Dieu 11 . C’est pourquoi, conclut <strong>Spinoza</strong>, « si Moïse parlait à Dieu face à face,<br />
comme un homme à son compagnon (c’est-à-dire, par l’intermédiaire de leurs deux<br />
corps), le Christ, lui, communiquait avec Dieu d’esprit à esprit » 12 –c’est-à-dire, on le voit, sans aucun intermédiaire, <strong>et</strong><br />
donc sans aucune extériorité.<br />
On touche ici du doigt, me semble-t-il, le double traitement que <strong>Spinoza</strong><br />
accorde à la notion d’extériorité : d’un côté, en Moïse, elle se voit conférer une valeur<br />
hautement positive, puisque Moïse est le seul dont on puisse dire qu’il n’a pas rêvé<br />
ou imaginé la <strong>voix</strong> de Dieu, mais qu’il l’a bel <strong>et</strong> bien perçue, <strong>et</strong> lui seul, comme une<br />
manifestation extérieure provenant d’un être extérieur ; de l’autre, conformément à la<br />
pensée générale de <strong>Spinoza</strong>, le Christ est encore au-dessus de Moïse, si bien que la<br />
rencontre mosaïque de Dieu en extériorité se voit quelque peu dévaluée par rapport<br />
à la possession immédiate <strong>et</strong> intime qu’en a, ou qu’en est, le Christ.<br />
Ce balancement est d’ailleurs caractéristique du Traité Théologico-Politique.<br />
D’un côté l’extériorité y est valorisée au point d’être par exemple le passage obligé<br />
vers le salut, dans la doctrine de la « vraie règle de vie » ,<br />
7<br />
TTP I, LM [17], 90 19-24 / 91 23-29 ; G III 20 16-21.<br />
8<br />
Ibid.<br />
9<br />
Ibid. : quod quidem intelligendum est per solam vocem ; nam nec Moses ipse faciem<br />
unquam viderat. <strong>Spinoza</strong> se réfère ici à Exode, chp 33.<br />
10<br />
TTP I, LM [18], 92 12-15 / 93 14-18 ; G III 21 3-6.<br />
11<br />
TTP I, LM [18], 92 15-18 : « De sorte que Dieu s’est manifesté aux apôtres par<br />
l’intermédiaire de l’esprit du Christ, comme autrefois à Moïse par le moyen d’une <strong>voix</strong> aérienne. Et<br />
ainsi la <strong>voix</strong> du Christ, de la même façon que celle que Moïse avait entendue, peut être appelée la <strong>voix</strong><br />
de Dieu » : adeo ut Deus per mentem Christi sese apostolis manifestaverit, ut olim Mosi mediante voce<br />
aera. Et ideo vox Christi, sicuti illa, quam Moses audiebat, vox Dei vocari potest. (LM 93 18-23 ; G III<br />
21 6-9).<br />
12TTP<br />
I, LM [19], 92 29-32 : Quare, si Moses cum Deo de facie ad faciem, ut vir cum socio<br />
sol<strong>et</strong> (hoc est, mediantibus duobus corporibus), loquebatur, Christus quidem de mente ad mentem<br />
cum Deo communicavit. (G III 21 19-22).<br />
13<br />
TTP V : « Isaïe n’enseigne rien plus clairement : la loi divine prise absolument signifie la loi<br />
universelle consistant dans la vraie règle de vie, <strong>et</strong> non pas les cérémonies ». G III 69 24-26, LM 211<br />
5-7. Les « cérémonies », bien qu’elles soient des actions <strong>extérieures</strong>, ne participent donc pas de la<br />
3
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
ensemble d’actions, ou de comportements extérieurs par lesquels les ignorants<br />
pourront être sauvés en dépit de leur ignorance –Moïse n’enseignant d’ailleurs rien<br />
d’autre qu’une règle de vie aux Hébreux 14 . De ce point de vue, la lecture des<br />
Écritures est inutile tant qu’on ne corrige pas sa vie, <strong>et</strong> salutaire seulement si on la<br />
corrige –un homme qui suivrait c<strong>et</strong>te « vraie règle de vie » pouvant même se<br />
dispenser de la lecture des Écritures 15 , car tous peuvent « obéir », si très peu<br />
peuvent « comprendre ». L’essence sacrée des Écritures dépend ainsi des<br />
comportements qu’elles suscitent 16 , si bien que le caractère sacré de l’Écriture ne lui<br />
est pas intérieur, mais bel <strong>et</strong> bien extérieur. Et enfin, l’élection de la nation hébraïque<br />
est seulement extérieure aux yeux de <strong>Spinoza</strong> 17 . D’un autre côté cependant,<br />
<strong>Spinoza</strong> rencontre une difficulté à bien caractériser les Écritures comme<br />
« <strong>extérieures</strong> » ou « <strong>intérieures</strong> » 18 . Ces « paroles divines », en eff<strong>et</strong>, ne sont pas<br />
« inscrites » seulement sur du « papier » recouvert « d’encre noire », mais aussi<br />
dans le « cœur » ou « l’esprit » des hommes 19 . Mais laquelle de ces deux<br />
inscriptions fut la première, laquelle est l’original ? Au chapitre XVII du Traité<br />
« vraie règle de vie » dont parle <strong>Spinoza</strong> : que la vraie vie soit extérieure n’entraîne pas (loin de là) que<br />
toute vie extérieure soit la vraie vie. Nous discutons c<strong>et</strong>te question en détail dans la troisième partie de<br />
c<strong>et</strong>te présentation.<br />
14 TTP II : « Et assurément il ne faut pas croire que des hommes habitués aux superstitions<br />
des Égyptiens, grossiers <strong>et</strong> affaiblis par la plus misérable servitude, aient formé de Dieu des notions<br />
saines, ou que Moïse leur ait enseigné autre chose qu’une manière de vivre .Il leur<br />
enseigna à bien vivre, non certes en tant que philosophe, en s’appuyant sur la liberté de leur âme ;<br />
mais plutôt en tant que législateur, en les contraignant pas l’empire de la loi. C’est pourquoi le principe<br />
du vivre bien, ou la vraie vie, le culte <strong>et</strong> l’amour de Dieu, furent <strong>chez</strong> eux plutôt servitude que véritable<br />
liberté, grâce <strong>et</strong> don de Dieu (G III 40 35-41 7 ; LM 139 22-32).<br />
15 TTP V : « Si donc quelqu’un lit l’Écriture sainte <strong>et</strong> a foi en tous ses récits, mais sans prêter<br />
attention à la doctrine que l’Écriture vise à enseigner par leur moyen <strong>et</strong> sans amender sa vie, ce sera<br />
pour lui tout comme s’il lisait, avec l’attention coutumière au vulgaire, le Coran, ou les pièces de<br />
théâtre des poètes, ou du moins les chroniques ordinaires. À l’inverse, nous l’avons dit, celui qui les<br />
ignore totalement <strong>et</strong> qui a néanmoins des opinions salutaires <strong>et</strong> une vraie<br />
règle de vie , celui-là connaît la vraie béatitude <strong>et</strong> l’esprit du<br />
Christ est véritablement en lui. » G III 79 16-24, LM 233 22-31.<br />
16 TTP XII : « [...] L’Écriture aussi n’est sacrée <strong>et</strong> ses paroles divines qu’aussi longtemps<br />
qu’elle porte les hommes à la dévotion envers Dieu ; mais s’ils la négligent complètement, comme<br />
jadis les Juifs, alors elle n’est rien que du papier <strong>et</strong> de l’encre noire : ils la rendent complètement<br />
profane <strong>et</strong> la laissent exposée à la corruption. » G III 161 8-12, LM 435 17-22. De même, poursuit<br />
<strong>Spinoza</strong>, lorsque Moïse a brisé les tables de la loi, il n’a pas du tout brisé la parole de Dieu, mais de<br />
simples pierres, qui avaient eu un caractère sacré « parce que, sur elles, était inscrite l’alliance selon<br />
laquelle les Juifs s’étaient obligés à obéir à Dieu, mais qui n’avaient plus aucune saint<strong>et</strong>é puisqu’en<br />
adorant le veau d’or ils avaient rendu ce pacte caduc » (ibid, LM 435-437).<br />
17 TTP III : « Ainsi la nation Hébraïque fut élue par Dieu de préférence aux autres, non pas en<br />
ce qui concerne l’entendement ou la tranquillité de l’âme , mais en ce qui concerne la société, <strong>et</strong> la fortune par laquelle elle eut un État <strong>et</strong> le<br />
conserva tant d’années ». G III 47 28-48 8, LM 157 8-12.<br />
18 À partir du chapitre XII du TTP, dont le titre insiste explicitement sur c<strong>et</strong>te dimension<br />
d’écriture (tout en s’interrogeant immédiatement sur son autre nom de « parole ») : « Du véritable texte<br />
original de la loi divine, pour quelle raison on l’appelle Écriture sainte <strong>et</strong> pour quelle raison on l’appelle<br />
Parole de Dieu », <strong>et</strong>c .<br />
19 TTP XII, LM 431 23-27 : « je crains [...] qu’ils ne se m<strong>et</strong>tent à adorer des images <strong>et</strong> des<br />
simulacres, c’est-à-dire du papier <strong>et</strong> de l’encre noire, en place de la parole de Dieu » (G III 159 20-23).<br />
4
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
Théologico-Politique, <strong>Spinoza</strong> déclare que dans le Nouveau Testament, Dieu « a<br />
révélé […] par l’intermédiaire des apôtres que le pacte divin s’écrivait désormais non<br />
plus sur des tables de pierre <strong>et</strong> avec de l’encre, mais dans<br />
le cœur <strong>et</strong> avec l’Esprit de Dieu » 20 , comme si l’inscription dans le cœur avait<br />
succédé à l’inscription dans la pierre. Mais une parole de Dieu « intérieure » ne<br />
devait-elle pas être également « antérieure » à son double « extérieur » d’encre, de<br />
papier <strong>et</strong> de pierre ? L’Écriture, les écritures, la parole de Dieu en tant qu’ensemble<br />
d’inscriptions, devront donc être considérées contradictoirement comme <strong>extérieures</strong><br />
<strong>et</strong> comme <strong>intérieures</strong> à l’esprit <strong>et</strong> à l’homme, si bien que la question de savoir si, en<br />
suivant la parole divine, je me conforme à quelque chose intérieure ou extérieure à<br />
moi-même, perd ici de sa consistance 21 .<br />
On s’étonne alors moins des difficultés rencontrées pour savoir si la Loi se<br />
faisait entendre aux prophètes par des <strong>voix</strong> réellement perçues (donc <strong>extérieures</strong>) ou<br />
par des <strong>voix</strong> imaginaires (donc <strong>intérieures</strong>), l’authenticité étant –c<strong>et</strong>te fois-ci– du côté<br />
de l’extériorité 22 . Quand je me conforme à une loi, qu’elle soit physique, naturelle,<br />
civile, ou religieuse, suis-je guidé par quelque chose d’extérieur ou par quelque<br />
chose d’intérieur à moi-même ? Il est souvent difficile de répondre. Dans la politique<br />
spinoziste, par exemple, il n’y a pas d’obéissance sans consentement : si j’obéis,<br />
c’est que je « consens à », <strong>et</strong> même, à la limite, c’est que je « veux », obéir 23 . Plus<br />
généralement –je l’ai montré ailleurs <strong>et</strong> il n’est pas possible d’y revenir en détail dans<br />
le cadre de c<strong>et</strong> article– le spinozisme, pour des raisons qui tiennent à son essence<br />
immanentiste elle-même, rencontre la distinction <strong>et</strong> l’exclusion réciproques de<br />
l’intériorité <strong>et</strong> de l’extériorité comme une tâche <strong>et</strong> une difficulté également<br />
contraignantes 24 .<br />
Or <strong>Hobbes</strong>, dans le Léviathan (qui offre de si étonnantes proximités avec le<br />
Traité Théologico-Politique, que <strong>Hobbes</strong>, à qui l’on demandait ce qu’il pensait du<br />
texte de <strong>Spinoza</strong>, aurait répondu « ne jugez pas afin de ne pas être jugés » 25 ),<br />
rencontre de façon très frappante les mêmes questions exactement que celles que<br />
rencontre <strong>Spinoza</strong> à propos de la nature des « <strong>voix</strong> » par lesquelles la loi divine nous<br />
est transmise. Mon hypothèse de lecture sera donc ici que la question de l’intériorité<br />
ou de l’extériorité des <strong>voix</strong> (donc de la loi), perm<strong>et</strong> de donner une nouvelle<br />
cohérence aux principaux thèmes du Léviathan ; <strong>et</strong> que <strong>Hobbes</strong>, comme <strong>Spinoza</strong>,<br />
20 TTP XVII, LM 587 8-11 ; G III 221 22-24.<br />
21 On en dirait autant de l’inscription de la loi « dans le corps » du supplicié de la Colonie<br />
Pénitentiaire de Kafka. Le motif derridien de l’indissociabilité (ou indécidabilité) de « l’intérieur » <strong>et</strong> de<br />
« l’extérieur » trouve évidemment toute sa pertinence dès qu’il est question de ce type « d’inscription »<br />
qu’est la loi (thème constant, on le sait, de l’ouvrage de 1967 De la Grammatologie).<br />
22 TTP I, LM 83 37-85 2 : « Ces paroles <strong>et</strong> ces figures étaient dans certains cas véritables <strong>et</strong><br />
<strong>extérieures</strong> à l’imagination du prophète qui les voyait ou les entendait » (G III 17 11-13).<br />
23 Comme le montre de façon très générale <strong>et</strong> très frappante le titre du chp XIX du TTP : « On<br />
montre que le droit des affaires sacrées est entièrement entre les mains du Souverain <strong>et</strong> que le culte<br />
extérieur de la religion doit s’accorder avec la paix de la république, si nous voulons obéir à Dieu<br />
droitement ». Les notions d’obéissance, de consentement <strong>et</strong> de<br />
volonté sont ici parfaitement équivalentes.<br />
24 Je ne peux que renvoyer le lecteur aux travaux que j’ai consacrés ces dernières années à<br />
la lecture de <strong>Spinoza</strong> selon l’extériorité (voir Ramond [1995] <strong>et</strong> [2001]).<br />
25 Comme le rappelle Christian Lazzeri, en plaçant en exergue de son grand ouvrage [1998],<br />
un passage de la Vie de Thomas <strong>Hobbes</strong> par John Aubrey : « Dès que le Tractatus theologicopoliticus<br />
de <strong>Spinoza</strong> parut, M. Edmund Waller l’envoya à <strong>Hobbes</strong> en le priant de lui faire savoir ce<br />
qu’en disait M. <strong>Hobbes</strong>. M. <strong>Hobbes</strong> déclara à sa Seigneurie : Ne judicate ne judicemini », citant donc<br />
Matthieu 7-1, ou Luc 6-37.<br />
5
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
rencontre avec c<strong>et</strong>te croix des <strong>voix</strong>, ou des perceptions en général, un problème qui,<br />
dépassant largement le cadre de la politique où il est le plus visible, <strong>et</strong> traversant<br />
l’anthropologie, s’étend jusqu’à la question de la nature même de la réalité.<br />
D’abord, il est sans cesse question de « <strong>voix</strong> » dans le Léviathan. Non pas<br />
seulement sous l’aspect un peu anecdotique du fait que le « Léviathan », corps<br />
artificiel fait à l’image d’un corps naturel, possède une sorte de « <strong>voix</strong> » dans « les<br />
personnes publiques dotées par le souverain de l’autorité soit d’instruire le peuple,<br />
soit de le juger » 26 , fonctions dont <strong>Hobbes</strong> souligne d’ailleurs la très grande<br />
importance au chapitre 43 en se référant à Paul (Romains X 17) pour rappeler que<br />
« la foi vient de l’audition » (c’est-à-dire de l’enseignement) 27 . Mais surtout par le fait<br />
que la question de la « <strong>voix</strong> », <strong>et</strong> précisément sous l’aspect qui nous occupe, à<br />
savoir la question de l’extériorité ou de l’intériorité des <strong>voix</strong> que nous entendons <strong>et</strong><br />
auxquelles nous obéissons ou refusons d’obéir, c<strong>et</strong>te question de la « <strong>voix</strong> », donc,<br />
se r<strong>et</strong>rouve au cœur des thèses centrales du Léviathan.<br />
1) La génération de la République, ainsi, au chapitre 17, ne va pas sans<br />
un « quasi-discours » : « C’est comme si chacun disait à chacun [je souligne] :<br />
j’autorise c<strong>et</strong> homme ou c<strong>et</strong>te assemblée », <strong>et</strong>c 28 . Comme <strong>Hobbes</strong> l’indique<br />
clairement en recourant à l’expression « c’est comme si chacun disait à chacun » il<br />
est assez difficile de savoir quelle est la <strong>voix</strong> qui prononce de telles paroles, s’il s’agit<br />
d’un discours que chacun se tient à soi ou que chacun tient à chacun, si même ces<br />
paroles ont jamais été prononcées, ou entendues : <strong>et</strong> pourtant il faut bien qu’elles<br />
l’aient été ou qu’elles le soient, puisqu’il s’agit là de la génération même de la<br />
République. La génération de la République, ainsi, est strictement subordonnée à<br />
l’expression <strong>et</strong> à l’audition d’une certaine « <strong>voix</strong> », dont le statut est défini<br />
immédiatement comme ambigu : car c’est un « quasi-discours » (« c’est comme si<br />
chacun disait... »), <strong>et</strong> l’on ne peut pas savoir s’il est extérieur ou intérieur à chacun<br />
des contractants : s’ils l’ont clamé en chœur (comme un serment ou comme une<br />
conjuration), ou murmuré (comme un credo), ou s’ils l’ont entendu tous ensemble de<br />
la bouche de l’un d’entre eux, qui l’aurait prononcé extérieurement pour tous <strong>et</strong><br />
26 Léviathan, ch. 23 : « These public persons, with authority from the sovereign power, either<br />
to instruct, or judge the people, are such members of the commonwealth, as may fitly be compared to<br />
the organs of voice in a body natural » (G [= édition de J. C. A. Gaskin. Oxford / New York : Oxford<br />
University Press (« World’s Classics »), 1996], 162 [= p. 162], §9) : « Ces personnes publiques dotées<br />
par le souverain de l’autorité soit d’instruire le peuple, soit de le juger, sont des membres de la<br />
République qu’on pourrait comparer de manière appropriée aux organes de la <strong>voix</strong> dans un corps<br />
naturel » (T [= traduction de François Tricaud. Paris : Sirey (« Philosophie Politique »), 1971], 258 [= p.<br />
258]). Et un peu plus loin : « Quant à ceux qui sont établis pour recevoir du peuple les pétitions <strong>et</strong> les<br />
autres informations, qui sont pour ainsi dire l’oreille publique, ils sont des ministres publics »<br />
(Léviathan, ch. 23 ; T 259 : « And those that are appointed to receive the p<strong>et</strong>itions or other informations<br />
of the people, and are as it were the public ear, are public ministers » –G 162 § 12).<br />
27 Léviathan, ch. 43 : « [...] généralement le moyen de les faire croire que Dieu trouve bon de<br />
m<strong>et</strong>tre à la disposition des hommes est conforme aux voies de la nature : autrement dit, que c<strong>et</strong>te<br />
croyance leur vient de ceux qui les enseignent. C’est là la doctrine de saint Paul concernant la foi<br />
chrétienne en général : la foi vient de l’audition (Romains, X, 17), c’est-à-dire de l’audition de nos<br />
pasteurs légitimes » (T 609) : « [...] and that the means of making them believe which God is pleased<br />
to afford men ordinarly, is according to the way of nature, that is to say, form their teatchers. It is the<br />
doctrine of St Paul concerning Christian faith in general (Rom. 10. 17), faith com<strong>et</strong>h by hearing, that is<br />
to say, by hearing our lawful pastors » (G 393 §8).<br />
28 Léviathan, ch. 17 : « This is more than consent, or concord ; it is a real unity of them all, in<br />
one and the same person, made by covenant of every man with every man, in such manner, as if<br />
every man should say to every man, I authorize and give up my right of governing myself, to this man,<br />
or to this assembly of men », <strong>et</strong>c. (G 114 §13 ; T 177). Même structure en latin : « tanquam si<br />
unicuique unusquisque dicer<strong>et</strong> » (M [= éd. Molesworth. Londres : Bohn, 1841, vol. III], 131 [= p. 131]).<br />
6
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
devant tous pendant que chacun y donnait silencieusement <strong>et</strong> intérieurement son<br />
assentiment 29 ... Bref, on a là une sorte de prototype de la <strong>voix</strong> de la loi, à savoir<br />
l’installation immédiate dans un « lieu » qu’on ne peut pourtant décrire ni en termes<br />
d’intériorité ni en termes d’extériorité -phénomène fort étrange, à la réflexion 30 .<br />
2) Personne <strong>et</strong> Autorisation. Les théories proprement originales <strong>chez</strong><br />
<strong>Hobbes</strong>, que sont les théories de la « personne » <strong>et</strong> de « l’autorisation », au chapitre<br />
16 du Léviathan, enveloppent également c<strong>et</strong>te question de la « <strong>voix</strong> ». Non<br />
seulement parce qu’étymologiquement une « personne » c’est un masque destiné à<br />
proj<strong>et</strong>er une « <strong>voix</strong> », <strong>et</strong> parce que <strong>Hobbes</strong> intègre très naturellement c<strong>et</strong>te<br />
dimension de projection d’une parole dans sa définition de la personne 31 ; mais<br />
29 Yves-Charles Zarka insiste très justement ([1987], p. 332) sur l’aspect « paradoxal » de la<br />
« performance réalisée par l’énoncé » fondateur : « Le comme si change le caractère de l’énoncé, il<br />
s’agit moins d’une locution effectivement prononcée que de l’explicitation d’un acte censé avoir été<br />
reconnu <strong>et</strong> exercé, <strong>et</strong> qui soutient implicitement tout l’édifice politique. Il ne s’agit donc pas d’un acte de<br />
parole mythique, mais de l’explicitation rationnelle d’un acte symbolique que nous sommes tous<br />
censés avoir reconnu <strong>et</strong> exercé, <strong>et</strong> qui, seul, est apte à rendre compte à la fois de la fondation <strong>et</strong> de<br />
notre appartenance à l’État ». On ne saurait mieux dire : mais « dire », précisément, ou « quasi-dire »<br />
il y a bien eu, selon <strong>Hobbes</strong>, au moment de la « génération de la République » : <strong>et</strong> on ne peut pas<br />
considérer un « quasi-discours » tout à fait comme un « non-discours » -c’est du moins la piste que je<br />
cherche à suivre ici.<br />
30 C<strong>et</strong>te question est donc très légitimement placée par Benny Lévy (= BL) au centre de son<br />
ouvrage Le Meurtre du Pasteur –Critique de la vision politique du monde [2002]. BL reproche ainsi à<br />
<strong>Hobbes</strong> de ne pas tenir exactement compte des circonstances de la révélation du Sinaï : « [...] <strong>Hobbes</strong><br />
ne sait pas que lorsque Dieu a parlé à Moïse, les 600 000 Hébreux ont entendu la Voix. Il ne veut pas<br />
le savoir, en tout cas : qu’allons-nous devenir, si chacun entend des <strong>voix</strong> ? » (153 ; voir aussi 161).<br />
Même reproche à <strong>Spinoza</strong> : « L’idée qu’il puisse y avoir témoignage du prophète <strong>et</strong> témoignage des<br />
‘auditeurs’, bref témoignage à deux, paraît inconcevable à <strong>Spinoza</strong>. Le Sinaï lui pose problème. Car au<br />
Sinaï, Moïse <strong>et</strong> Israël ensemble, tous deux furent témoins de la ‘<strong>voix</strong> vraie’ » (190 ; voir aussi 196 –<br />
défense de la « doctrine maïmonidienne de la Voix créée »-, <strong>et</strong> aussi 268 sq). L’obj<strong>et</strong> principal de BL<br />
est d’opposer à la « vision politique du monde », illustrée d’abord selon lui par <strong>Hobbes</strong>, puis au plus<br />
haut point par <strong>Spinoza</strong>, <strong>et</strong> dans laquelle l’origine de la <strong>voix</strong> à laquelle on obéit devient inassignable,<br />
faute de véritable transcendance, une vision non politique, dans laquelle la nécessaire (pour BL)<br />
transcendance se manifeste d’abord par l’extériorité d’une « Voix » : « Entendre la Voix de la bouche<br />
de la Rigueur à travers l’Enseignement de Moïse est plus haut que la sagesse humaine » (212-213).<br />
On ne peut que saluer l’exactitude de la caractérisation de c<strong>et</strong>te « vision politique du monde », <strong>et</strong> la<br />
qualité de l’intuition qui la ramène à la circulation sans origine d’une <strong>voix</strong> (voir le ch. 14 : ‘le secr<strong>et</strong> de la<br />
<strong>voix</strong> claire’, <strong>et</strong> notamment les dernières lignes de l’ouvrage : « En fin de compte, voici l’alternative : ou<br />
la liberté de penser est réglée par la Voix ou elle l’est par la Souveraine Puissance. Vision prophétique<br />
ou vision politique du monde, qui impose pour finir la dictature de l’opinion. Seul le prophétisme assure<br />
la liberté. [...] Le Tractatus n’a réussi, pour notre malheur de modernes, qu’à nous faire perdre le<br />
secr<strong>et</strong> de la <strong>voix</strong> claire. » –273-274) ; inversement, on ne peut qu’être consterné par les imprécations<br />
portées de ce fait contre <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> surtout contre <strong>Spinoza</strong>, qualifié plusieurs siècles après sa mort de<br />
rien moins que d’inspirateur de l’antisémitisme moderne <strong>et</strong> des massacres bien réels accomplis en<br />
son nom (173-175, 185, 222)… Il y a <strong>chez</strong> BL une telle constance dans la détestation de soi à travers<br />
la détestation de la modernité, qu’il m’arrive de penser (laissant de côté un de mortuis nihil nisi bonum<br />
qui lui aurait sans doute paru bien fade) que le mot de <strong>Spinoza</strong> à Bl (L<strong>et</strong>tre 23, mars 1665 :<br />
« je l’affirme alors [...] : si quelque homme voit qu’il peut vivre plus commodément suspendu au gib<strong>et</strong><br />
qu’assis à sa table, il agirait en insensé en ne se pendant pas ») attendait un tel lecteur.<br />
31 Léviathan, ch. 16, début : « A person, is he, whose words or actions are considered, either<br />
as his own, or as representing the words or actions of another man, or of any other thing to whom they<br />
are attributed, wh<strong>et</strong>her truly or by fiction » (G 106 §1) : « Est une personne, celui dont les paroles ou<br />
les actions sont considérées, soit comme lui appartenant, soit comme représentant les paroles ou<br />
actions d’un autre, ou de quelque autre réalité à laquelle on les attribue par une attribution vraie ou<br />
fictive » (T 161). La définition du Léviathan latin ne mentionne pas immédiatement les « paroles » :<br />
persona est is qui suo vel alieno nomine res agit : si suo, persona propria, sive naturalis est ; si alieno,<br />
persona est ejus, cujus nomine agit, repraesentativa », <strong>et</strong>c (M 123). Cependant la référence à une<br />
« parole prononcée » ou à une « <strong>voix</strong> » est bien présente dans le texte latin, qui rapporte<br />
7
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
surtout parce que la définition même de la notion « d’auteur » introduit de fait<br />
(comme dans le cas précédent de la « génération de la République ») une<br />
superposition <strong>et</strong> une indécidabilité entre « <strong>voix</strong> extérieure » <strong>et</strong> « <strong>voix</strong> intérieure ».<br />
« Les paroles <strong>et</strong> actions de certaines personnes artificielles », écrit en eff<strong>et</strong> <strong>Hobbes</strong>,<br />
« sont reconnues pour siennes par celui qu’elles représentent. La personne est alors<br />
l’acteur ; celui qui en reconnaît pour siennes les paroles <strong>et</strong> actions est l’auteur » 32 . La<br />
conséquence bien connue de c<strong>et</strong>te théorie de l’autorisation est que je ne peux<br />
jamais me plaindre de ce que fait ou dit le Souverain, car je dois me reconnaître<br />
comme « l’auteur » de ce qu’il dit ou fait, même quand cela me nuit. Autrement dit, je<br />
n’ai pas le droit de considérer les paroles du souverain, c’est-à-dire la <strong>voix</strong> de la loi,<br />
comme une <strong>voix</strong> extérieure, mais comme une <strong>voix</strong> intérieure à moi-même, que c<strong>et</strong>te<br />
autorisation résulte d’une déclaration « expresse » ou simplement d’une<br />
« intention » 33 non exprimée verbalement. Là encore « l’autorisation », comme la<br />
« génération de la République », résulte d’un quasi discours, d’une <strong>voix</strong> flottante,<br />
dirais-je, mais qui n’en est pas moins impérieuse (tout au contraire). On trouve donc<br />
<strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> la même difficulté (ou la même solution paradoxale au problème<br />
politique) que celle que nous avons rencontrée <strong>chez</strong> <strong>Spinoza</strong> à propos de<br />
l’obéissance : pour que l’obéissance se produise effectivement, ou puisse produire<br />
ses eff<strong>et</strong>s, il faut, semble-t-il, que je ne sache jamais véritablement à qui, à quelle loi<br />
ou à quelle <strong>voix</strong>, j’obéis, jusqu’à ce que la distinction entre une obéissance<br />
involontaire (servitude ou obéissance à une loi/<strong>voix</strong> extérieure) <strong>et</strong> une obéissance<br />
volontaire (liberté ou obéissance à une loi/<strong>voix</strong> intérieure) perde pertinence. Un<br />
passage tout à fait remarquable du chapitre 21, consacré aux « lois civiles », énonce<br />
d’ailleurs explicitement <strong>et</strong> le lien de la loi à une <strong>voix</strong>, <strong>et</strong> la circularité de l’extériorité <strong>et</strong><br />
de l’intériorité propres à c<strong>et</strong>te <strong>voix</strong> : « de même que les hommes », écrit en eff<strong>et</strong><br />
<strong>Hobbes</strong>, « pour se procurer la paix <strong>et</strong> par là se préserver eux-mêmes, ont fabriqué<br />
un homme artificiel, qu’on appelle République, ils ont aussi fabriqué des chaînes<br />
artificielles, appelées lois civiles, qu’ils ont eux-mêmes, par des conventions<br />
mutuelles, attachées d’un bout aux lèvres de l’homme ou de l’assemblée à qui ils ont<br />
donné le pouvoir souverain, <strong>et</strong> de l’autre à leurs propres oreilles » 34 . La boucle est<br />
immédiatement la « personne » à l’acteur de théâtre (« adeo ut persona, tum in theatro tum in foro,<br />
idem significar<strong>et</strong> quod actor », phrase reprise dans la version anglaise).<br />
32 Léviathan, ch. 16, T 163. « Of persons artificial, some have their words and actions owned<br />
by those whom they represent. And then the person is the ‘actor’ ; and he that own<strong>et</strong>h his words and<br />
actions, is the ‘author’ : in which case the actor act<strong>et</strong>h by authority » (G 107 §4) ; « Verba <strong>et</strong> facta<br />
repraesantantium ab iis, quos repraesentant, aliquando pro suis agnoscuntur ; tunc autem<br />
repraesentans actor, repraesentatus author dicitur, ut cujus authoritate actor agit » (M 123) : ici, le latin<br />
est particulièrement homogène (dans le registre de la « représentation ») <strong>et</strong> clair : « les paroles <strong>et</strong> les<br />
actes de certains représentants sont parfois reconnus pour leurs par ceux qu’ils représentent : on<br />
appelle alors le représentant ‘acteur’, <strong>et</strong> le représenté ‘auteur’, au titre de l’autorité duquel l’acteur<br />
agit ».<br />
33 Voir par exemple Léviathan, ch. 21 : « C’est en eff<strong>et</strong> dans l’acte où nous faisons notre<br />
soumission que résident à la fois nos obligations <strong>et</strong> notre liberté ; c’est donc là qu’il convient de<br />
rechercher les arguments d’où l’on peut inférer quelles elles sont : nul ne supporte en eff<strong>et</strong> aucune<br />
obligation qui n’émane d’un acte qu’il a lui-même posé, puisque par nature tous les hommes sont<br />
également libres. Or de tels arguments devant être tirés, soit des paroles expresses : ‘j’autorise toutes<br />
ses actions’ [« from the express words, ‘I authorize all his actions » / « ab ipsis verbis, nempe,<br />
actionum omnium ejus hominis, cui summam tribuimus potestatem, authorem me facio »], soit de<br />
l’intention de celui qui se soum<strong>et</strong> à ce pouvoir [...] », <strong>et</strong>c. (T 229 ; G 144 §10 ; M 164).<br />
34 Léviathan, ch. 21, T 223-224. « But as men, for the attaining of peace, and conservation of<br />
themselves thereby, have made an artificial man, which we call a commonwealth ; so also have they<br />
made artificial chains, called civil laws, which they themelves, by mutual covenants, have fastened at<br />
one end, to the lips of that man, or assembly, to whom they have given the sovereign power ; and at<br />
8
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
alors bouclée : de même que lorsque je m’entends parler il m’est difficile, <strong>et</strong> en vérité<br />
impossible, de décider si ce que j’entends est une <strong>voix</strong> intérieure ou extérieure, de<br />
même, la <strong>voix</strong> de la loi, passant de la bouche du Léviathan à ses oreilles, y est<br />
toujours indissociablement une <strong>voix</strong> extérieure <strong>et</strong> intérieure à la fois, faisant de<br />
chacun indistinctement son propre maître <strong>et</strong> son propre esclave 35 .<br />
On ne s’étonne donc pas de voir <strong>Hobbes</strong> rencontrer les mêmes problèmes<br />
the other to their own ears [quae vincula ipsi mutuis inter se pactis ab una parte ab illius, cui summam<br />
dederunt potestatem, labra, ab altera parte ad suas ipsorum aures alligarunt] » (G 141 §5 ; M 161).<br />
35 J’ai eu le sentiment très rassurant de r<strong>et</strong>rouver ici, par le biais d’analyses portant sur la<br />
prophétie <strong>et</strong> sur la perception, l’intuition centrale de Quentin Skinner dans son ouvrage Reason and<br />
Rh<strong>et</strong>oric in the Philosophy of <strong>Hobbes</strong> [1996]. La couverture de l’ouvrage de Skinner reproduit en eff<strong>et</strong><br />
une gravure extraite de livre de Laurentius Haechtanus, Microcosmos : Parvus Mundus (Amsterdam,<br />
1579), qui représente, sous le titre Gallorum Hercules, un Hercule prince de l’éloquence, puissant,<br />
debout, à peine vêtu, déhanché, la tête penchée vers le bas, les yeux baissés, <strong>et</strong> de la bouche<br />
imperceptiblement souriante duquel sortent deux cordes qui, par des nœuds de démultiplication,<br />
viennent s’attacher aux oreilles de ceux qui l’entourent. L’image est saisissante, tout comme la<br />
métaphore <strong>Hobbes</strong>ienne. Skinner rappelle que l’orateur est généralement crédité d’une puissance<br />
magique ou surhumaine, <strong>et</strong> que la comparaison de l’orateur avec Orphée ou avec Hercule, via Lucien,<br />
était courante <strong>chez</strong> les rhétoriciens de l’époque Tudor (p. 92 <strong>et</strong> n. 191). <strong>Hobbes</strong> connaissant très bien<br />
Lucien (p. 232 <strong>et</strong> n. 135), il ne fait aucun doute aux yeux de Skinner que le passage du ch. 21 du<br />
Léviathan sur les lois qui vont des lèvres aux oreilles est une « allusion » (ibid.) à la fable de Lucien.<br />
C<strong>et</strong>te simple « allusion » constitue néanmoins, pour Skinner, un « passage remarquable » du<br />
Léviathan (p. 389 <strong>et</strong> n. 56). On a là en eff<strong>et</strong> une nouvelle image de la puissance surhumaine du<br />
Léviathan, qui vient se superposer à celle, bien connue, du grand homme composé de p<strong>et</strong>its hommes,<br />
<strong>et</strong> à celle du monstre biblique ; <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te image d’une toute puissance du Léviathan par les liens de<br />
bouche à oreille va pleinement dans le sens de l’interprétation générale de Skinner (c’est-à-dire d’une<br />
lecture de l’œuvre de <strong>Hobbes</strong> comme inscrite dans une relation de rej<strong>et</strong>, puis d’adoption, de la<br />
rhétorique au cœur de la philosophie politique) : si bien que de ce point de vue « l’allusion » du ch. 21<br />
devrait être considérée, bien plus encore qu’un « passage remarquable », comme la clé même de<br />
lecture du Léviathan. Tout en reconnaissant <strong>et</strong> en admirant la pertinence d’une telle lecture, il me<br />
semble néanmoins nécessaire de faire remarquer que « l’allusion » faite par <strong>Hobbes</strong> à la fable de<br />
Lucien en modifie assez sensiblement la leçon. Car, ce qui distingue ici Hercule <strong>et</strong> le Léviathan, c’est<br />
que dans la fable ancienne, l’origine <strong>et</strong> la source de la puissance sont clairement affirmées (en<br />
Hercule), alors que précisément, la lecture du texte de <strong>Hobbes</strong> montre que c<strong>et</strong>te origine <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te<br />
localisation y disparaissent <strong>et</strong> s’y effacent : comme dit <strong>Hobbes</strong> en eff<strong>et</strong>, « ont [...]<br />
fabriqué des chaînes artificielles, appelées lois civiles, qu’ils ont eux-mêmes, par des conventions<br />
mutuelles, attachées d’un bout aux lèvres de l’homme ou de l’assemblée à qui ils ont donné le pouvoir<br />
souverain, <strong>et</strong> de l’autre à leurs propres oreilles » [je souligne]. Il n’y a donc pas ici un héros tout<br />
puissant qui enchaîne son auditoire ; mais c’est bien l’auditoire qui a attaché lui-même les chaînes,<br />
des lèvres du héros aux oreilles de ceux qui écoutent. La source de l’enchaînement, ou de<br />
l’enchantement, qu’est l’obéissance, est donc bel <strong>et</strong> bien inassignable. Le sens de la reprise que fait<br />
<strong>Hobbes</strong> du mythe ancien au ch. 21 du Léviathan me semble être donc la mise en évidence de<br />
l’indécidabilité, plutôt que de l’origine, de l’obéissance comme de la puissance. Sur c<strong>et</strong>te image<br />
frappante, on se reportera à l’ouvrage récemment paru, extrêmement précieux <strong>et</strong> intéressant<br />
(j’exprime ici toute ma gratitude à mon collègue <strong>et</strong> ami Jean Terrel pour me l’avoir indiqué <strong>et</strong><br />
communiqué), de Horst Bredekamp Stratégies visuelles de Thomas <strong>Hobbes</strong> (Bredekamp [2003]). Voir<br />
notamment pp. 121-128. On y apprend par exemple (p. 126 n. 301) que « les rois de France devinrent<br />
chacun un alter ego d’Ogmios [‘figure Celte légendaire qui joignait à sa force herculéenne une<br />
éloquence peu commune’] <strong>et</strong> l’incarnation de l’art oratoire. Lorsque Henri II fit son entrée à Paris en<br />
1549, l’Hercule gallique, en roi de France, se tenait au-dessus de l’arc, des chaînes qui partaient de sa<br />
bouche reliant à lui les représentants des quatre états ». Bredekamp fait justement remarquer (p. 127)<br />
le gauchissement de c<strong>et</strong>te figure <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> : « L’Hercule de l’éloquence devient le Léviathan ; or les<br />
chaînes qui partent de ce dernier ne sont pas celles de l’éloquence, mais celles des lois ». « Par c<strong>et</strong>te<br />
conversion », ajoute Bredekamp (ibid.), « <strong>Hobbes</strong> discrédite l’éloquence pour la remplacer par les<br />
moyens de liaison <strong>et</strong> de conduite de la peur ». Sans doute ; mais ce qui va de la « bouche » à<br />
« l’oreille », ce sont d’abord des mots <strong>et</strong> des discours prononcés, des paroles, des <strong>voix</strong> émises <strong>et</strong><br />
entendues. Et d’autre part, les lois ne sauraient se passer de formulations, <strong>et</strong> donc de mots. On ne<br />
sépare pas si facilement « <strong>voix</strong> » <strong>et</strong> « lois ».<br />
9
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
que <strong>Spinoza</strong>, souvent dans des termes identiques, même s’il leur donne des<br />
solutions différentes. Il note par exemple, en bien des passages, la difficulté à<br />
distinguer prophétie, folie, ivresse, hallucinations, inspiration, possession,<br />
enthousiasme 36 <strong>et</strong> même tout simplement « ventriloquie », lorsqu’il fait remarquer<br />
par exemple au chapitre 37, qu’un ventriloque « peut faire croire à beaucoup que<br />
est une <strong>voix</strong> venue du ciel, quoi qu’il se plaise à leur<br />
raconter » 37 . La possession, comme l’indiquent certains passages du Nouveau<br />
Testament, se manifeste d’ailleurs parfois comme une ventriloquie 38 . Tout comme<br />
<strong>Spinoza</strong>, <strong>et</strong> pour des raisons au fond assez voisines, <strong>Hobbes</strong> est donc préoccupé<br />
par la question de la possibilité <strong>et</strong> de la nature d’une « révélation surnaturelle » 39 , ou<br />
encore par la possibilité de distinguer entre la « parole naturelle » de Dieu (à savoir<br />
la raison) <strong>et</strong> sa « parole prophétique » 40 . « Dès l’instant de la création », écrit-il ainsi<br />
au chapitre 35 du Léviathan, « Dieu non seulement régna sur tous les hommes<br />
36 Voir par exemple Léviathan, ch. 8. <strong>Hobbes</strong> y recense le flou du vocabulaire concernant la<br />
folie, la possession, <strong>et</strong>c. : ainsi, les « fous » ont été appelés « tantôt ‘démoniaques’ (c’est-à-dire,<br />
possédés d’un esprit), tantôt ‘énergumènes’ (c’est-à-dire agités, mus par des esprits) ; <strong>et</strong> de nos jours<br />
en Italie on ne les appelle pas seulement ‘pazzi’, ‘fous’, mais aussi ‘spiritati’, ‘possédés’ » (T 72 / G 50-<br />
51 §24) ; quelques lignes plus loin, <strong>Hobbes</strong> en vient aux « prophètes » : « Les juifs [...] nommaient les<br />
fous ‘prophètes’ ou ‘démoniaques’, selon qu’ils pensaient que l’esprit qui les possédait était bon ou<br />
mauvais ; certains d’entre eux appelaient ‘fous’ à la fois les prophètes <strong>et</strong> les démoniaques ; <strong>et</strong> certains<br />
appelaient le même homme à la fois ‘démoniaque’ <strong>et</strong> ‘fou’ » (T 73 / G 51 §25). Aux yeux de <strong>Hobbes</strong>, il<br />
est cependant « étrange » que les Juifs aient pu considérer les « prophètes » comme des<br />
« possédés » ; car, fait-il observer, « les prophètes de l’Ancien Testament ne se sont pas [...] prétendu<br />
envahis par Dieu <strong>et</strong> n’ont pas [...] prétendu que Dieu parlait en eux : ils disaient que Dieu leur parlait, à<br />
eux, par une <strong>voix</strong>, une vision ou un songe. Le ‘fardeau du Seigneur’ n’était pas possession, mais<br />
commandement » (T 74 / G 52 § 25). Tout le problème viendra du fait (c’est la thèse principale que je<br />
soutiens ici) qu’il est particulièrement difficile de distinguer « commandement » <strong>et</strong> « possession »,<br />
c’est-à-dire <strong>voix</strong> extérieure <strong>et</strong> <strong>voix</strong> intérieure, <strong>et</strong> que <strong>Hobbes</strong> tout particulièrement, nous le verrons (<strong>et</strong><br />
nous aurons à dire pourquoi), semble se priver comme délibérément des critères qui rendraient<br />
opérante une telle distinction, même s’il l’invoque ici.<br />
Sur les hallucinations, le ch. 12 du Léviathan décrit la fabrique des Dieux : « Et touchant la<br />
matière ou substance des agents invisibles qu’ils imaginaient de la sorte, les hommes ne purent par la<br />
réflexion naturelle rencontrer aucune autre conception que celle-ci : elle est la même que celle de<br />
l’âme humaine, <strong>et</strong> l’âme humaine est faite de la même substance que ce qui apparaît au dormeur dans<br />
ses rêves, ou dans un miroir à celui qui est éveillé, apparitions qu’ils prennent, faute de savoir qu’elles<br />
en sont que des créations de l’imagination, pour des substances <strong>extérieures</strong> réelles, <strong>et</strong> qu’en<br />
conséquence ils appellent des spectres » (T 106 / G 73 §7 ; voir également T 112-13 / G 76-77 §19).<br />
Le problème du rêve se pose, quant à la vue, de la même façon que celui de la prophétie quant à<br />
l’ouïe : la difficulté est toujours la même : comment trancher entre l’hallucination (qui n’indique pas<br />
d’extériorité) <strong>et</strong> la perception (qui indique une extériorité) ? La difficulté se redouble, bien sûr, quand, à<br />
l’exemple des prophètes, on entend des <strong>voix</strong> « en songe ».<br />
37 Léviathan, ch. 37 (« Des miracles <strong>et</strong> de leur fonction »), T 468-469 ; « A man that hath<br />
practised by drawing in of his breath (which kind of men in ancient time were called ‘ventriloqui’) and so<br />
make the weakness of his voice seem to proceed, not from the weak impulsion of the organs of<br />
speech, but from distance of place, is able to make very many men believe it is a voice from Heaven,<br />
whatsoever he please to tell them » (G 295 §12).<br />
38 L’exemple le plus connu étant sans doute celui des « démons de Gérasa » (Luc 8, 26-37).<br />
39 Léviathan, ch. 26 (« Des lois civiles »), T 306-307 : c’est la question des « lois divines<br />
positives » (« Divine positive laws », G 189 §39 ; « Lege positivae divinae », M 207)<br />
40 Léviathan, ch. 32 (« Des principes de la politique chrétienne »), première page, T 395 :<br />
« parole naturelle » / « prophétique » : « the natural / proph<strong>et</strong>ical [...] word of God (G 247 §1) /<br />
« verbum proph<strong>et</strong>icum » (M 265 [pas de référence à la « parole naturelle » de Dieu dans le latin]).<br />
Même endroit : « Néanmoins, nous n’avons pas à renoncer à nos sens <strong>et</strong> à notre expérience, <strong>et</strong> pas<br />
davantage à ce qui est indubitablement la parole de Dieu, à savoir notre raison naturelle » ;<br />
« Nevertheless, we are not to renounce our senses, and experience ; nor (that which is the undoubted<br />
word of God) our natural reason » (G 247 § 2) ; « Veruntamen sensibus, experientiae, <strong>et</strong> quod verbum<br />
Dei indubitatum est, rectae rationi [droite raison], renuntiandum non est » (M. 265).<br />
10
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
naturellement, par sa puissance ; mais il eut aussi des suj<strong>et</strong>s particuliers, auxquels il<br />
commandait par une <strong>voix</strong>, comme un homme parle à un autre » 41 ; <strong>et</strong> il mentionne<br />
alors Adam, Abraham, <strong>et</strong> Moïse comme exemples de ces « suj<strong>et</strong>s » sur lesquels<br />
Dieu régnait « par une <strong>voix</strong> ». Dans le chapitre suivant (ch. 36 : « de la parole de<br />
Dieu ; des prophètes »), <strong>Hobbes</strong> rencontre alors la même question que <strong>Spinoza</strong> :<br />
« comment Dieu parle-t-il à un prophète ? » 42 , autrement dit : comment distinguer le<br />
vrai prophète (celui auquel Dieu parle vraiment, ou qui entend une <strong>voix</strong> vraiment<br />
extérieure) du faux prophète (celui qui prend une <strong>voix</strong> seulement intérieure -une<br />
hallucination- pour la vraie <strong>voix</strong> de Dieu) ? <strong>Hobbes</strong> recense alors en vain, pour<br />
répondre à c<strong>et</strong>te question, le cortège testamentaire des apparitions, visions, anges,<br />
songes, <strong>et</strong> <strong>voix</strong> venues du ciel 43 , <strong>et</strong> se résout enfin à donner sa réponse au moyen<br />
d’un cercle logique si manifeste qu’on peut l’estimer ostentatoire : « ainsi, d’une<br />
manière générale », déclare-t-il en eff<strong>et</strong>, « les prophètes extraordinaires de l’Ancien<br />
Testament ne prenaient connaissance de la parole de Dieu que dans leurs songes <strong>et</strong><br />
leurs visions : en d’autres termes dans les images qu’ils avaient dans leur sommeil<br />
ou pendant une extase, images qui <strong>chez</strong> les vrais prophètes étaient surnaturelles<br />
mais <strong>chez</strong> les faux prophètes naturelles ou affirmées mensongèrement » 44 . Ce<br />
cercle logique, ou plutôt c<strong>et</strong>te pétition de principe manifeste (le fait que le prophète<br />
était un « vrai » prophète prouvant qu’il avait entendu une <strong>voix</strong> divine, donc<br />
extérieure, surnaturellement ; <strong>et</strong> inversement le fait qu’il avait vraiment entendu une<br />
<strong>voix</strong> surnaturelle établissant le prophète comme vrai prophète), ce cercle logique,<br />
donc, montre à l’évidence la perplexité de <strong>Hobbes</strong>, qui finit d’ailleurs par déclarer<br />
franchement, quelques paragraphes plus loin dans ce même chapitre 36, qu’il est à<br />
ses yeux impossible de « comprendre » comment Dieu pouvait bien « parler » « à<br />
ces prophètes souverains de l’Ancien Testament dont la fonction était de le<br />
consulter » 45 , ce qui n’est autre chose que de reconnaître l’impossibilité de<br />
41 Léviathan, ch. 35 (« De la signification dans l’Écriture des expressions ‘royaume de Dieu’,<br />
‘saint’, ‘sacré’ <strong>et</strong> ‘sacrement’ »), T 434 (traduction modifiée). « From the very creation, God not only<br />
reigned over all men naturally by his might ; but also had peculiar subjects, whom he commanded by a<br />
voice, as one man speak<strong>et</strong>h to another » (G 271 § 3) ; « ab ipsa creatione mundi Deus in omnes<br />
homines regnavit non modo naturaliter, sive jure omnipotentiae, sed <strong>et</strong>iam in quosdam homines<br />
quibus voce imperavit ».<br />
42 Léviathan, ch. 36, T 450 : « On peut ici poser une question : comment Dieu parle-t-il à un<br />
tel prophète ? Peut-on, diront peut-être certains, dire au sens propre que Dieu a une <strong>voix</strong> <strong>et</strong> un<br />
langage, alors qu’on ne peut dire au sens propre qu’il a une langue <strong>et</strong> d’autres organes, comme un<br />
homme ? » ; « And hereupon a question may be asked, in what manner God speak<strong>et</strong>h to such a<br />
proph<strong>et</strong>. Can it (may some say) be properly said, that God hath voice and language, when it cannot be<br />
properly said, he hath a tongue and other organs, as a man ? » (G 282-283, § 9) ; « sed quomodo,<br />
dic<strong>et</strong> aliquis, proprie dici potest loquum esse Deum, qui linguam aliaque organa loquendi non hab<strong>et</strong>,<br />
sicut homo ? » (M 303).<br />
43 Léviathan, ch. 36, T 451 / G 283-284 § 10 / M 304-305.<br />
44 Léviathan, ch. 36, T 452-453 ; « So that generally the proph<strong>et</strong>s extraordinary in the Old<br />
Testament took notice of the word of God no otherwise, than from their dreams, or visions ; that is to<br />
say, from the imaginations which they had in their sleep, or in an extasy : which imaginations in every<br />
true proph<strong>et</strong> were supernatural ; but in false proph<strong>et</strong> were either natural or feigned » (G 284 § 11) ;<br />
comme le fait remarquer Tricaud, le latin est assez différent, moins explicite <strong>et</strong> moins clair en ce que la<br />
distinction entre les « vrais prophètes » <strong>et</strong> les « faux prophètes » en est absente, tout comme la<br />
distinction (équivalente) entre les songes « surnaturels » <strong>et</strong> les songes « naturels » : « Manifestum<br />
ergo est proph<strong>et</strong>as extraordinarios V<strong>et</strong>eris Testamenti vocem Dei non aliter intellexisse, quam per<br />
somnia <strong>et</strong> visiones, id est, a phantasiis supernaturalibus » (M 306).<br />
45 Léviathan, ch. 36, T 454 (conclusion d’une série « d’hypothèses » aussi infructueuses les<br />
unes que les autres) : « On ne peut donc pas comprendre la manière dont il parlait à ces prophètes<br />
souverains de l’Ancien Testament, dont la fonction était de le consulter » ; « Therefore in what manner<br />
God spake to those sovereign proph<strong>et</strong>s of the Old Testament, whose office it was to enquire of him, is<br />
11
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
« comprendre » la distinction entre une <strong>voix</strong> « extérieure » <strong>et</strong> une <strong>voix</strong> « intérieure ».<br />
Nous rencontrerons d’ailleurs un peu plus loin, fait notable <strong>chez</strong> un philosophe<br />
rigoureux comme l’est généralement <strong>Hobbes</strong>, un second reniement de la logique au<br />
suj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te distinction entre extériorité <strong>et</strong> intériorité.<br />
3) Lire en soi. Chacun connaît le passage célèbre de l’Introduction du<br />
Léviathan, où <strong>Hobbes</strong> invite son lecteur à lire en lui-même 46 : comme s’il y avait au<br />
fond de nous, intérieurement à chacun de nous, une inscription naturelle éternelle<br />
vers laquelle il serait possible, <strong>et</strong> même nécessaire, de tourner les yeux. Mais le<br />
sens même de l’injonction de <strong>Hobbes</strong> est bien de m<strong>et</strong>tre en valeur le fait que c<strong>et</strong>te<br />
inscription naturelle, si intérieure soit-elle, n’a rien de privé ou de singulier : tout au<br />
contraire, elle est la même en chaque homme, <strong>et</strong> donc, à strictement parler, elle est<br />
extérieure à chaque homme, puisqu’elle lui parle bien plus de l’humanité que de luimême,<br />
comme l’indiquent expressément les dernières lignes du passage 47 . C’est<br />
d’ailleurs le principal de c<strong>et</strong>te Introduction –dans laquelle <strong>Hobbes</strong> mixe <strong>et</strong><br />
réinterprète, sous la forme remarquable d’un « lisez-vous les uns les autres », à la<br />
fois le « connais-toi toi-même » socratique <strong>et</strong> le christique « aimez-vous les uns les<br />
autres » en injectant l’intériorité du premier dans le second, <strong>et</strong> l’extériorité du second<br />
dans le premier–, que de faire reposer d’emblée la philosophie <strong>et</strong> la politique sur<br />
l’indécidabilité délibérée de l’intérieur <strong>et</strong> de l’extérieur, comme du naturel <strong>et</strong> de<br />
l’artificiel 48 . À partir de telles prémisses, on ne devra donc pas s’attendre à voir<br />
not intelligible » (G 286 §14 ; je donne ici le texte indiqué en note par Gaskin <strong>et</strong> traduit par Tricaud,<br />
bien que Gaskin donne un texte légèrement différent dans le corps du § 14) ; le latin est tout aussi<br />
explicite, bien que plus diplomatiquement exprimé : « Quomodo ergo Deus proph<strong>et</strong>as perp<strong>et</strong>uae<br />
vocationis alloquutus est, quando ab illis consulebatur, scriptum non invenio, nisi quod summis<br />
sacerdotibus in Sancto Sanctorum per vocem ex inter Cherubinos loquutus est ; sed vox illa, ut <strong>et</strong><br />
ca<strong>et</strong>era omnia divinae praesentiae signa, angelus dici potest, quemadmodum somnia <strong>et</strong> ca<strong>et</strong>era signa<br />
supernaturalia » (M. 307) (« Je ne trouve donc pas dans l’Écriture l’indication de la manière dont Dieu<br />
s’adressait aux prophètes de vocation perpétuelle quand ceux-ci le consultaient, si ce n’est qu’il parlait<br />
aux grands-prêtres, d’entre les Chérubins, dans le Saint des Saints, par une <strong>voix</strong>. Mais c<strong>et</strong>te <strong>voix</strong>,<br />
comme tous les autres signes de la présence divine, on peut l’appeler un ange, comme on peut le faire<br />
pour les songes <strong>et</strong> les autres signes surnaturels » -Traduction Tricaud, 454-455 n. 113) : autrement<br />
dit, il n’y a pas de réponse « compréhensible » à la question posée.<br />
46 Léviathan, Introduction, T 6 : « Mais il existe aussi un autre adage, dont l’intelligence ne<br />
date pas d’hier, qui perm<strong>et</strong>trait d’apprendre à se lire vraiment les uns les autres, s’ils<br />
voulaient s’en donner la peine ; c<strong>et</strong>te formule, c’est nosce teipsum, ‘lis-toi toi-même’ » ; « But there is<br />
another saying not of late understood, by which they might learn truly to read one another, if they would<br />
take the pains ; and that is nosce teipsum, ‘read thyself’ » (G 8 §3) ; « Extat autem praeceptum aliud<br />
antiquius, per quod intelligere possent, si vellent, homines alios rectius legere, nempe nosce teipsum »<br />
(M 2-3). L’explicitation du « connais-toi toi-même » en « lis-toi toi-même » figure seulement dans la<br />
version anglaise.<br />
47 Léviathan, Introduction : « Mais aussi parfaitement qu’un homme lise en autrui à partir des<br />
actions de celui-ci, cela ne lui sert qu’à l’égard des gens qu’il connaît personnellement, <strong>et</strong> qui sont peu<br />
nombreux. Celui qui doit gouverner toute une nation ne doit pas lire en lui-même tel ou tel individu,<br />
mais l’humanité » (T 7) ; « But l<strong>et</strong> one man read another by his actions never so perfectly, it serves him<br />
only whith his acquaintance, which are but few. He that is to govern a whole nation, must read in<br />
himself, not this, or that particular man ; but mankind » (G 8 §4) ; « Verum in cognoscendis hominibus<br />
singularibus, ut peritissimus sit quis, solos cognosc<strong>et</strong> eos quibuscum vivit familiariter, qui pauci sunt. At<br />
is, qui gentem aliquam universam recturus est, ex seipso cognosere deb<strong>et</strong> non hunc <strong>et</strong> illum hominem,<br />
sed humanam genus » (M 3-4). De ce point de vue, le fameux « Homo homini lupus » pourrait être<br />
compris comme une extension (ou une réduction) à l’animalité (traditionnelle <strong>chez</strong> les fabulistes,<br />
comme par exemple <strong>chez</strong> La Fontaine) du principe de la lecture de soi dans l’autre, franchissant les<br />
frontières entre espèces aussi bien qu’entre individus, pour atteindre à une science quasi universelle<br />
des comportements.<br />
48 Les derniers mots de l’Introduction font ainsi écho aux premiers : « La nature, c<strong>et</strong> art par<br />
12
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
« résolue » une telle question dans la suite de l’ouvrage.<br />
4) Loi de nature <strong>et</strong> loi civile. De fait, l’inscription indissociablement<br />
intérieure <strong>et</strong> extérieure de la loi naturelle explique la relation si particulière, à<br />
première vue incompréhensible voire contradictoire, instaurée par <strong>Hobbes</strong> entre « loi<br />
de nature » <strong>et</strong> « loi civile » au chapitre 26 du Léviathan, lorsqu’il déclare que « la loi<br />
de nature <strong>et</strong> la loi civile se contiennent l’une l’autre, <strong>et</strong> sont d’égale étendue » 49 . On<br />
ne doit sans doute pas s’étonner de voir Le Léviathan, monstre biblique, monstre<br />
politique (par sa composition) <strong>et</strong> monstre ontologique (artificiel <strong>et</strong> naturel), abriter le<br />
véritable monstre logique que constituent deux obj<strong>et</strong>s différents, « d’égale étendue »,<br />
<strong>et</strong> « se contenant l’un l’autre ». Ce n’est d’ailleurs pas la première entorse à la<br />
logique que nous rencontrons sur c<strong>et</strong>te question 50 . Mais si <strong>Hobbes</strong> exhibe<br />
tranquillement un tel monstre, ce n’est pas tant, me semble-t-il, pour provoquer son<br />
lecteur à la colère ou à l’interprétation, ni même pour apporter une « solution » au<br />
problème des relations entre loi naturelle <strong>et</strong> loi civile, que pour bien m<strong>et</strong>tre en<br />
évidence le statut paradoxal <strong>et</strong> indécidable de ces deux types de lois dans leur<br />
double <strong>et</strong> réciproque « ex-intériorité ». Loi naturelle <strong>et</strong> loi civile ne se distinguent<br />
d’ailleurs même pas selon le « publié » <strong>et</strong> le « non publié ». S’il est de l’essence de<br />
la loi civile, en eff<strong>et</strong>, d’être « publiée » ou « proclamée », la loi de nature de son côté<br />
n’est pas elle-même dépourvue de « <strong>voix</strong> », puisque, comme dit <strong>Hobbes</strong> dans le<br />
même chapitre, si « les lois de nature n’ont [...] aucun besoin d’être publiées ou<br />
proclamées », c’est qu’elles sont « contenues » dans l’« unique sentence » : « ne<br />
fais pas à autrui ce que tu estimes déraisonnable qu’un autre te fasse » 51 . Loi<br />
naturelle <strong>et</strong> loi civile, finalement, pouvant tenir lieu l’une de l’autre, se suppléer l’une<br />
l’autre, sans que jamais on puisse assigner laquelle serait origine ou laquelle<br />
modèle, ne diffèrent pas plus l’une de l’autre que les diverses « <strong>voix</strong> », « paroles »,<br />
ou « commandements » auxquels chacun, à la fois source <strong>et</strong> obj<strong>et</strong> de l’autorité du<br />
Léviathan, prête efficacité par ses comportements <strong>et</strong> ses conduites. Là encore,<br />
dirions-nous peut-être, « ça parle », « ça parle en nous », « ça parle en chacun de<br />
nous », « ça parle en moi », « je parle », « je lis en moi », « je lis en toi » <strong>et</strong><br />
« j’entends », deviennent autant d’énoncés indiscernables.<br />
5) La sensation. Pour autant, dira-t-on, les expériences sensitives que nous<br />
faisons lorsque nous entendons des <strong>voix</strong> ne sont pas si confuses que cela. Sans<br />
doute, il arrive que nous entendions des sons, ou des bruits, dont il est impossible à<br />
lequel Dieu a produit le monde <strong>et</strong> le gouverne, est imitée par l’art de l’homme en ceci comme en<br />
beaucoup d’autres choses, qu’un tel art peut produire un animal artificiel » (T 5) ; « Nature (the art<br />
whereby God hath made and governs the world) is by the art of man, as in many other things, so in this<br />
also imitated, that it can make an artificial animal » (G 7 § 1) ; « Naturam, id est, illam, qua mundum<br />
Deus condidit <strong>et</strong> gubernat, divinam artem, eatenus imitatur ars humana, ut possit inter alia producere<br />
artificiale animal » (M 1 ; « La nature, c'est-à-dire l’art divin avec lequel Dieu a bâti le monde <strong>et</strong> le<br />
gouverne, est imitée par l’art humain au point qu’il peut, entre autres choses, produire un animal<br />
artificiel » ; je r<strong>et</strong>raduis le latin, dans lequel l’écho entre « art divin » <strong>et</strong> « art humain » est n<strong>et</strong>tement<br />
plus perceptible que dans l’anglais).<br />
49<br />
Léviathan, ch. 26 (« Des lois civiles »), T 285 ; « The law of nature, and the civil law,<br />
contain each other, and are of equal extent » (G 177, §8) ; « [...], leges naturae <strong>et</strong> leges civiles in<br />
eadem civitate se mutuo continent » (M 198).<br />
50<br />
Voir ci-dessus les analyses sur la distinction entre « vrais » <strong>et</strong> « faux prophètes », <strong>et</strong><br />
notamment la note 45.<br />
51<br />
Léviathan, ch. 26, T 289-290 ; « The laws of nature therefore need not any publishing, nor<br />
proclamation ; as being contained in this one sentence, approved by all the world, ‘Do not that to<br />
another, which thou thinkest unreasonable to be done by another to thyself’ » (G 180 §14) ; « leges<br />
itaque naturales publicatione, proclamatione, promulgatione non indigent ; ut quae in unico praecepto<br />
continentur, ‘quodcunque vultis ut faciant vobis homines, id vos facite illis’ ».<br />
13
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
rigoureusement parler de dire s’ils proviennent de sources <strong>extérieures</strong> ou de<br />
stimulations de l’appareil auditif (c’est le cas bien connu des acouphènes). En<br />
revanche, lorsqu’il s’agit de « <strong>voix</strong> », ou de « discours », chacun a le sentiment de<br />
pouvoir distinguer, sinon la direction d’où ils proviennent (car il est dans la nature du<br />
son d’être très peu directionnel, à la différence de la vue), du moins l’existence ou<br />
non d’une source extérieure. Ces « <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> » auxquelles nous obéissons si<br />
souvent, saurions-nous par exemple décrire leur timbre ? Rien n’est moins sûr : du<br />
moins ces questions de timbre <strong>et</strong> de hauteur ne sont-elles jamais précisées (sauf<br />
erreur). Et si nous déclarons entendre la « <strong>voix</strong> de la loi », ou la « <strong>voix</strong> de la<br />
conscience », ou « des <strong>voix</strong> » divines ou non, généralement nous ne saurions pas<br />
dire, tout simplement, si ces <strong>voix</strong> sont masculines ou féminines, jeunes ou vieilles,<br />
douces ou stridentes, <strong>et</strong>c, -déterminations toujours présentes, en revanche, dans<br />
l’audition de <strong>voix</strong> réelles. Il semblerait donc qu’une solution possible au problème de<br />
l’intériorité ou de l’extériorité des <strong>voix</strong> soit à chercher d’abord dans une théorie fine <strong>et</strong><br />
attentive de la sensation. Or précisément, si <strong>Hobbes</strong> propose bien, dans les<br />
premiers chapitres du Léviathan, une telle théorie de la sensation <strong>et</strong> de l’imagination,<br />
c’est avec le résultat paradoxal, nous allons le voir, non pas de rendre possible, mais<br />
bien de rendre impossible quelque distinction objective que ce soit entre une <strong>voix</strong><br />
extérieure <strong>et</strong> une <strong>voix</strong> intérieure -comme si <strong>Hobbes</strong> avait pris soin ici de fermer toute<br />
voie de résolution de notre problème. Je terminerai donc c<strong>et</strong> exposé en analysant les<br />
raisons pour lesquelles la doctrine hobbesienne de la sensation parvient à un tel<br />
résultat, à la fois surprenant au vu de notre expérience habituelle de l’audition <strong>et</strong><br />
cependant parfaitement conforme à ses thèses déjà rencontrées sur la question des<br />
<strong>voix</strong>.<br />
Pour <strong>Hobbes</strong>, le schéma du processus de la sensation est donc le suivant :<br />
une pression subie de l’extérieur, sur le modèle de ce qui se produit lorsque nous<br />
appuyons par exemple sur nos yeux, entraîne, de l’intérieur, une résistance ou une<br />
contre pression : « c<strong>et</strong> effort », dit <strong>Hobbes</strong>, « étant dirigé vers l’extérieur, semble être<br />
quelque réalité située au dehors. Et ce semblant, ce phantasme, c’est ce qu’on<br />
appelle sensation » 52 . On voit donc que, aux yeux de <strong>Hobbes</strong>, toute sensation est en<br />
elle-même <strong>et</strong> par nature fantasmatique : du fantasme bien particulier qui consiste à<br />
imputer à un obj<strong>et</strong> extérieur la source de ce que nous sentons. Comme le dit souvent<br />
<strong>Hobbes</strong>, il faudrait par conséquent (si nous voulons éviter d’être trompés par nos<br />
sensations) nous entraîner à séparer l’obj<strong>et</strong> <strong>et</strong> la sensation qu’il produit, à l’exemple<br />
de ce que nous faisons spontanément lorsque nous voyons apparaître un obj<strong>et</strong> dans<br />
un miroir à l’endroit où il n’est pas 53 , ou lorsque par le phénomène de l’écho nous<br />
entendons une <strong>voix</strong> ailleurs que là où elle a été émise : « de même », écrit <strong>Hobbes</strong>,<br />
52 Léviathan, ch. 1, T 12 ; « which endeavour because outward, seem<strong>et</strong>h to be some matter<br />
without. And this seeming, or fancy, is that which men call ‘sense’ » (G 9 § 4) ; « [conatus cordis<br />
deliberantis se a pressione per motum tendentem extrorsum] ; qui motus propterea appar<strong>et</strong> tanquam<br />
aliquid externum. Atque apparitio haec sive phantasma est id quod vocamus ‘sensionem’ » (M 6).<br />
53 Voir, dans Bredekamp [2003], le chapitre 4, 68-90 (« Tradition de la forme <strong>et</strong> optique<br />
politique »), <strong>et</strong> notamment, p. 82 <strong>et</strong> suivantes, les références aux « verres perspectifs », très à la mode<br />
au XVII ème siècle, qui perm<strong>et</strong>taient, au moyen d’une lentille taillée spécialement, <strong>et</strong> insérée dans un<br />
tube devant un tableau également préparé, de sélectionner divers détails du tableau <strong>et</strong> de les<br />
rassembler en une figure unique, pourtant absente du tableau ; par exemple, l’illustration 49 de la p. 89<br />
montre comment on avait pu faire apparaître, en 1651, la figure de Louis XIV enfant à partir de détails<br />
prélevés sur des anges dont chacun symbolisait une vertu royale. Vu à l’œil nu, le tableau ne montrait<br />
que les anges ; vu dans la lun<strong>et</strong>te, il montrait Louis XIV. Ces « prospective glasses » apparaissent<br />
dans le chapitre XIX du Léviathan, <strong>et</strong> ne sont donc pas plus les « lun<strong>et</strong>tes d’approches » de Tricaud<br />
que les Fernrohrer des traductions allemandes (ibid, p. 83 n. 183) : il s’agit en eff<strong>et</strong> d’une illusion bien<br />
plus forte qu’un simple rapprochement, plus forte même que les anamorphoses.<br />
14
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
« que la couleur n’est pas inhérente à l’obj<strong>et</strong>, mais qu’elle est un eff<strong>et</strong> de celui-ci sur<br />
nous, causé par un mouvement dans l’obj<strong>et</strong> [...], de même le son n’est pas non plus<br />
dans la chose que nous entendons, mais il est en nous-même » 54 [je souligne]. Il<br />
s’agit pour <strong>Hobbes</strong> de défendre le point de vue strictement mécaniste selon lequel il<br />
n’existe à proprement parler, objectivement, que des mouvements de la matière, si<br />
bien que les ‘sensations’ (couleurs, sons, odeurs, <strong>et</strong>c) ne peuvent être rien d’autre<br />
que le résultat d’un processus de transmutation de l’objectif en subjectif, <strong>et</strong> du<br />
quantitatif en qualitatif, ou, comme dit <strong>Hobbes</strong>, « du mouvement en phantasme » 55 .<br />
L’aspect polémique de la thèse consiste, bien entendu, à r<strong>et</strong>irer toute qualité<br />
objective à la matière, <strong>et</strong> donc à rompre avec la doctrine des qualités : car, si les<br />
corps possédaient intrinsèquement les qualités que nos sensations leur confèrent, ils<br />
ne pourraient jamais être séparés desdites qualités, ce que réfute l’expérience de la<br />
relativité des sensations. <strong>Hobbes</strong> pose donc sans doute un obj<strong>et</strong> extérieur à la<br />
source de la sensation -ce « réalisme » expliquant sans doute son insensibilité à<br />
l’égard des arguments de la première Méditation. Mais, d’une part, l’obj<strong>et</strong> senti n’est<br />
pas nécessairement celui qu’indique la sensation (comme Descartes, <strong>Hobbes</strong> insiste<br />
sur le fait que des sensations lumineuses peuvent être provoquées par un simple<br />
contact avec l’œil, en l’absence de toute lumière ; de même, les manchots peuvent<br />
avoir des sensations dans un membre absent, <strong>et</strong>c) ; <strong>et</strong> d’autre part <strong>et</strong> surtout, que<br />
l’obj<strong>et</strong> extérieur soit ou non correctement indiqué par la sensation, c<strong>et</strong>te dernière,<br />
<strong>Hobbes</strong> y insiste, reste phantasmatique « dans tous les cas » 56 . Autrement dit, bien<br />
loin de nous garantir une voie d’accès à un obj<strong>et</strong> extérieur déterminé, la sensation<br />
n’atteste de rien d’autre que, d’une part, de l’extériorité en général, <strong>et</strong> d’autre part de<br />
l’existence en nous d’une très mystérieuse activité subjective de métamorphose ou<br />
de transmutation 57 .<br />
6) Rêve <strong>et</strong> Religion. <strong>Hobbes</strong> peut bien alors, par la suite, estimer que « les<br />
religions des païens du temps passé » tiraient leur origine de leur incapacité à<br />
« distinguer, de la vision <strong>et</strong> de la sensation, les rêves <strong>et</strong> les autres fantasmes<br />
vivaces » 58 , il se trouve néanmoins placé à son tour devant c<strong>et</strong>te même difficulté, <strong>et</strong><br />
précisément parce qu’il a lui-même défini la sensation comme un « fantasme<br />
vivace ». Toute l’analyse qu’il propose du rêve va d’ailleurs dans le même sens. Nos<br />
rêves, dit <strong>Hobbes</strong>, « sont l’inverse de nos imaginations du temps de veille : le<br />
54<br />
<strong>Hobbes</strong>, Éléments de la Loi Naturelle <strong>et</strong> Politique, I, ch. 2, § 9, début : « As colour is not<br />
inherent in the object, but an effect thereof upon us, caused by such motion in the object, [...] : so<br />
neither is sound in the thing we hear, but in ourselves ». Traduction de Dominique Weber (Paris : Le<br />
Livre de Poche, 2003, p. 89).<br />
55<br />
Ibid. Voir également ch. 6, T 49 : « j’ai dit plus haut que ce qui se trouve réellement en nous<br />
dans la sensation, c’est seulement un mouvement causé par l’action des obj<strong>et</strong>s extérieurs », <strong>et</strong>c.<br />
56<br />
Ibid. : « Et quoiqu’à une certaine distance déterminée l’obj<strong>et</strong> réel <strong>et</strong> véritable semble revêtu<br />
du phantasme qu’il engendre en nous, cependant l’obj<strong>et</strong> est une chose <strong>et</strong> l’image, le phantasme, en<br />
est une autre. Ainsi c<strong>et</strong>te sensation, dans tous les cas, n’est rien d’autre que le phantasme originaire,<br />
causé comme je l’ai dit par la pression, c'est-à-dire par le mouvement, que les choses <strong>extérieures</strong><br />
exercent sur nos yeux, nos oreilles <strong>et</strong> sur les autres organes destinés à cela » (T 12) ; « [...] So that<br />
sense in all cases, is nothing else but original fancy, caused (as I have said) by the pressure, that is, by<br />
the motion, of external things upon our eyes, [...] » (G 10 § 4) ; « [...] Sensio ergo <strong>et</strong> phantasma<br />
originale omnino idem sunt [...] » (M 6).<br />
57<br />
Comme le dit excellemment Jean Terrel ([1994], p. 71) : « Le phantasme dont part la<br />
science n’est pas une copie du réel ».<br />
58<br />
Léviathan, ch. 2, T 18 ; « From this ignorance of how to distinguish dreams, and other<br />
strong fancies, from vision and sense, did arise the greatest part of the religion of the Gentiles » (G 14<br />
§8) ; « Ab ignoratione hac distinctionis somniorum aliorumque phantasmatum vividorum a visione <strong>et</strong><br />
sensione, maxima ex parte orta est antiquorum Gentilium religio » (M 13).<br />
15
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
mouvement commence à une extrémité quand nous veillons, <strong>et</strong> à l’autre quand nous<br />
rêvons » 59 . Par exemple, si dans la veille j’enchaîne a) perception d’un ennemi, b)<br />
colère, c) chaleur dans certaines parties du corps ; dans le sommeil, je serai soumis<br />
à l’enchaînement inverse : a) chaleur dans certaines parties du corps, b) colère, c)<br />
apparition de l’image d’un ennemi. Le même renversement peut être obtenu, note<br />
<strong>Hobbes</strong> en abordant un cas encore plus probant, à partir du désir : on enchaînera<br />
donc, à l’état de veille, a) tendresse naturelle [<strong>Hobbes</strong> désigne ici très<br />
vraisemblablement une situation érotique], b) désir, c) échauffement de certaines<br />
parties du corps ; <strong>et</strong> dans le sommeil on obtiendra l’enchaînement inverse : a)<br />
échauffement « à l’excès » de certaines parties du corps, b) désir, c) apparition de<br />
« l’image de quelque manifestation de tendresse » [c'est-à-dire d’un rêve érotique].<br />
Ce dernier cas perm<strong>et</strong> de bien comprendre la thèse de <strong>Hobbes</strong> : à l’état de veille, un<br />
mouvement 1 (par exemple une caresse <strong>et</strong> la sensation qui y est liée) va provoquer,<br />
par l’intermédiaire du désir, un mouvement 2, à savoir « l’échauffement de certaines<br />
parties du corps »; inversement, dans le rêve, le mouvement 2 (échauffement) va<br />
provoquer, toujours par l’intermédiaire du désir, le mouvement 1 (rêve de caresse <strong>et</strong><br />
sensation liée).<br />
La symétrie cependant, parfaite en ce qui concerne les ‘mouvements’, est<br />
trompeuse en ce qui concerne les ‘sensations’ ou ‘phantasmes’ : car, dans le cas de<br />
la veille, ma première sensation indique une caresse réelle, donc causée par un<br />
obj<strong>et</strong> extérieur ; tandis que dans le rêve, évidemment, la sensation est liée à une<br />
caresse imaginaire, ce qui est tout différent. La même sensation, ou le même<br />
fantasme, peuvent donc accompagner des réalités tout à fait distinctes. Autrement<br />
dit, l’explication du phénomène du rêve telle que la propose <strong>Hobbes</strong> laisse<br />
entièrement pendante la question de savoir si une sensation ou une imagination<br />
correspondent bien à un obj<strong>et</strong> extérieur précis. Pour être tout à fait clair : dans les<br />
deux cas, il y a obj<strong>et</strong> « extérieur », si l’on veut, à la source de la sensation <strong>et</strong> de<br />
l’imagination (le fait que la source de la sensation, par exemple dans le rêve, se<br />
trouve « à l’intérieur » du corps ne changeant rien en cela : car, que la source d’une<br />
sensation soit « extérieure » ou « intérieure » à mon corps, c’est toujours une source<br />
« extérieure » par rapport à la sensation elle-même). Mais (pour reprendre l’exemple<br />
analysé par <strong>Hobbes</strong>) dans le premier cas, l’obj<strong>et</strong> « extérieur » est bien la caresse, <strong>et</strong><br />
dans le second, c’est un simple échauffement de certaines parties du corps, en<br />
l’absence de toute caresse. Intrinsèquement parlant, il est donc impossible<br />
d’assigner une source extérieure précise à une sensation ou à une imagination.<br />
Sans doute, <strong>Hobbes</strong> y insiste, on peut par comparaison avec la veille, <strong>et</strong> par d’autres<br />
moyens appropriés 60 , distinguer généralement veille <strong>et</strong> sommeil (encore que <strong>Hobbes</strong><br />
reconnaisse l’existence de cas troublants 61 ). Mais prises en elles-mêmes, une<br />
59 Léviathan, ch. 2, T 17 ; « In sum, our dreams are the reverse of our waking imaginations ;<br />
the motion when we are awake, beginning at one end ; and when we dream, at another » (G 13 § 6) ;<br />
« Somnia denique <strong>et</strong> vigilantium phantasma altera alterius sunt inversa ; nimirum, motu incipiente dum<br />
vigilamus ab uno termino, <strong>et</strong> ab altero dum somniamus » (M 11).<br />
60 Léviathan, ch. 2, T 17 : « Pour ma part, considérant que dans les rêves je ne pense pas<br />
souvent ni d’une façon suivie aux mêmes personnes, endroits, obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> actions que dans la veille, que<br />
je ne me rappelle pas un enchaînement de pensées cohérentes aussi long, lorsque je rêve, que dans<br />
les autres moments, <strong>et</strong> aussi parce que dans la veille je remarque souvent l’absurdité des rêves, alors<br />
que je ne rêve jamais de l’absurdité de mes pensées du temps de veille, j’estime avoir la preuve<br />
qu’étant éveillé je sais que je ne rêve pas, même si, lorsque je rêve, je me crois éveillé ».<br />
61 Léviathan, ch. 2, T 17-18 : « Le cas où il est le plus difficile à un homme de distinguer son<br />
rêve de ses pensées du temps de veille, c’est celui où l’on ne s’aperçoit pas, pour quelque raison<br />
accidentelle, que l’on a dormi [...]. C’est le cas de quelqu’un qui somnole sur sa chaise ». <strong>Hobbes</strong><br />
16
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
sensation ou une image (telles que <strong>Hobbes</strong> les définit) ne perm<strong>et</strong>tent pas de telles<br />
distinctions -tout au contraire.<br />
Conclusion. L’impression générale qui se dégage finalement du Léviathan,<br />
c’est que <strong>Hobbes</strong> semble avoir rendue impossible, par sa théorie générale des<br />
phantasmes auditifs <strong>et</strong> des phantasmes visuels, toute distinction objective entre la<br />
perception d’une <strong>voix</strong> extérieure <strong>et</strong> la perception d’une <strong>voix</strong> intérieure. C’était très<br />
probablement pour rendre d’autant plus nécessaire <strong>et</strong> plus efficace la solution qu’il<br />
propose, <strong>et</strong> qui consiste pour l’essentiel à refuser précisément d’entrer dans la<br />
recherche des critères objectifs perm<strong>et</strong>tant de distinguer entre vrais <strong>et</strong> faux<br />
prophètes. Puisqu’une solution théorique ou scientifique est impossible, la solution<br />
sera donc politique : il reviendra au souverain de décider qui est un vrai prophète <strong>et</strong><br />
qui ne l’est pas (quelle est la <strong>voix</strong> à laquelle il faut obéir), <strong>et</strong> ce en fonction de<br />
l’accord entre des prophéties données <strong>et</strong> les lois de la République. On reconnaîtra<br />
en eff<strong>et</strong> (c’est là une constante dans le Léviathan) un vrai prophète, y compris le<br />
Christ lui-même 62 , d’abord à ce qu’il n’enseigne pas une autre religion que celle qui<br />
est déjà établie 63 ! Solution bien évidemment en accord avec la doctrine générale du<br />
Léviathan, qui refuse absolument qu’une autorité autre que l’autorité politique puisse<br />
se déclarer investie de la distinction entre vrais <strong>et</strong> faux prophètes. Il me semble donc<br />
qu’en rendant le problème théoriquement insoluble, en superposant sans cesse,<br />
comme je l’ai montré, <strong>et</strong> dans toutes les parties principales de sa doctrine, l’intérieur<br />
<strong>et</strong> l’extérieur, <strong>Hobbes</strong> a voulu présenter un nœud que seul un politique, <strong>et</strong> non un<br />
théologien ou un philosophe, serait en mesure de trancher. En ce sens, c’est-à-dire<br />
en proposant de trancher par la décision plutôt que par la définition, <strong>Hobbes</strong> me<br />
semble cependant guidé par une profonde intuition philosophique, <strong>et</strong> plus<br />
précisément, ontologique. Là où <strong>Spinoza</strong> en eff<strong>et</strong>, rencontrant du fait même de sa<br />
position immanentiste de principe le difficile problème de distribuer correctement<br />
l’intériorité <strong>et</strong> l’extériorité, fait un effort philosophique général pour faire basculer<br />
l’ensemble du système vers une forme d’extériorité objective, touchant ainsi à sa<br />
façon à la critique du « mythe de l’intériorité », <strong>Hobbes</strong> choisit d’aller à l’objectivité<br />
par le détour d’une décision constitutive, nous proposant donc ce que j’ai proposé<br />
d’appeler à ma façon une « constitution de l’objectivité » 64 , en s’écartant<br />
soigneusement du nœud conceptuel qu’il a lui-même contribué à nouer. Les<br />
difficultés de nos deux philosophes <strong>et</strong> leurs vigoureuses réactions en témoignent : la<br />
revient sur ce cas au ch. 27 (T 321), en insistant particulièrement sur le danger qu’une telle confusion<br />
peut faire courir à la République (voir G 198-199 § 20). Le passage en entier est absent du latin<br />
(Tricaud ne le signale pas) : voir M 215. Ce qui se passe donc finalement lorsque nous « entendons<br />
des <strong>voix</strong> » ou lors que nous « avons des visions », selon une remarquable formule du ch. 45, c’est que<br />
nous prenons nos « fantasmes » pour des « spectres » (T 656 ; G 425, § 2 : « Not phantasms, but<br />
ghosts » ; la formule est absente du latin). Mais, à supposer qu’on évite une telle confusion, <strong>et</strong> qu’on<br />
en reste donc strictement aux « phantasmes », serions-nous pour autant sur le chemin de la réalité ?<br />
62 Voir Léviathan, ch. 41, T 512 ; G 324 § 5 ; M 353-354.<br />
63 Voir Léviathan, ch. 32, T 398 : « Si un prophète en trompe un autre, comment peut-on<br />
connaître avec certitude la volonté de Dieu par une voie autre que celle de la raison ? À c<strong>et</strong>te question,<br />
je réponds, d’après l’Écriture Sainte, qu’il y a deux marques qui, réunies, <strong>et</strong> non séparément, doivent<br />
faire reconnaître un vrai prophète. L’une est l’accomplissement de miracles ; l’autre, le fait de ne pas<br />
enseigner une autre religion que celle qui est établie » (G 249 § 7 : « One is the doing of miracles ; the<br />
other is the not teaching any other religion than that which is already established » ; voir également ch.<br />
37, T 469 (G 295 § 13), qui se réfère lui-même au ch. 36 (T 459, G 289 § 20) : dans tous ces<br />
passages, <strong>Hobbes</strong> s’appuie sur Deutéronome 13 1-5, cité dès le ch. 32 (la référence manque dans la<br />
traduction Tricaud, p. 399, ainsi que l’appel de la note 32). Sur c<strong>et</strong>te question de la légitimation des<br />
prophètes, voir les remarquables analyses de Pierre-François Moreau ([1989], pp. 68-78).<br />
64 Voir Ramond [1998].<br />
17
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
question des « <strong>voix</strong> imaginaires » <strong>et</strong> des « <strong>voix</strong> réelles » conduit bien, par les lieux<br />
imprécis de l’obéissance <strong>et</strong> de la loi, à entrevoir la structure éventuellement<br />
hallucinatoire de notre perception de la réalité, <strong>et</strong> donc finalement de la réalité ellemême.<br />
________________<br />
18
Voix <strong>extérieures</strong> <strong>et</strong> <strong>voix</strong> <strong>intérieures</strong> <strong>chez</strong> <strong>Hobbes</strong> <strong>et</strong> <strong>Spinoza</strong><br />
Textes Cités<br />
BREDEKAMP Horst [2003], Stratégies visuelles de Thomas <strong>Hobbes</strong>. –le Léviathan,<br />
archétype de l’État moderne. Illustrations des œuvres <strong>et</strong> portraits. Paris :<br />
Éditions de la maison des sciences de l’homme, 2003, 262 p. Préface de<br />
Olivier CHRISTIN, Traduction de l’allemand par Denise MODIGLIANI. Titre<br />
original : Thomas <strong>Hobbes</strong> visuelle Strategien. Der Leviathan : Urbild des<br />
modernen Staates, Werkillustrationen und Portraits. Berlin : Akademie-<br />
Verlag, 1999.<br />
DERRIDA Jacques, De la Grammatologie. Paris : Les Éditions de Minuit, 1967.<br />
HOBBES, Éléments de la Loi Naturelle <strong>et</strong> Politique. Traduction de Dominique WEBER.<br />
Paris : Le Livre de Poche, 2003.<br />
HOBBES, Léviathan. En anglais : édition de J. C. A. GASKIN. Oxford / New York :<br />
Oxford University Press (« World’s Classics »), 1996 [G]. En Latin : édition<br />
MOLESWORTH. Londres : Bohn, 1841, vol. III [M]. Traduction française de<br />
François Tricaud. Paris : Sirey (« Philosophie Politique »), 1971 [T].<br />
LAZZERI Christian [1998], Droit, pouvoir <strong>et</strong> Liberté –<strong>Spinoza</strong> critique de <strong>Hobbes</strong>.<br />
Paris : PUF, 1998.<br />
LÉVY Benny [2002], Le Meurtre du Pasteur –Critique de la vision politique du monde.<br />
Paris : Bernard Grass<strong>et</strong> / Verdier, 2002.<br />
MOREAU Pierre-François [1989], <strong>Hobbes</strong>. Philosophie, science, religion. Paris : PUF,<br />
1989.<br />
RAMOND Charles [1995], Qualité <strong>et</strong> Quantité dans la Philosophie de <strong>Spinoza</strong>. Paris :<br />
PUF, 1995.<br />
RAMOND Charles [1998], <strong>Spinoza</strong> <strong>et</strong> la Pensée Moderne -Constitutions de<br />
l’Objectivité. Paris : L’Harmattan, 1998.<br />
RAMOND Charles [2001], « Éternité, externité : sur une dimension prophétique de la<br />
philosophie de <strong>Spinoza</strong> », in Quel Avenir pour <strong>Spinoza</strong> ? –Enquête sur les<br />
spinozismes à venir, Actes du colloque tenu à l’Université Pierre Mendés<br />
France de Grenoble II les 11 <strong>et</strong> 12 mars 1999 (textes réunis <strong>et</strong> édités sous la<br />
direction de Lorenzo VINCIGUERRA). Paris : Kimé, 2001, 207-228.<br />
SPINOZA, Traité Théologico-Politique [TTP], édition <strong>et</strong> traduction par Jacqueline<br />
LAGRÉE <strong>et</strong> Pierre-François MOREAU, in <strong>Spinoza</strong>. Œuvres, III. Paris : PUF,<br />
1999 [LM]. Je donne également les références au texte latin de l’édition de<br />
GEBHARDT (<strong>Spinoza</strong> Opera. Heidelberg : Carl Winters<br />
Universita<strong>et</strong>sBuchhandlung, 1925, vol. III) [G].<br />
SKINNER Quentin [1996], Reason and Rh<strong>et</strong>oric in the Philosophy of <strong>Hobbes</strong>.<br />
Cambridge / New-York / Melbourne : Cambridge University Press, 1996.<br />
TERREL Jean [1994], <strong>Hobbes</strong>, Matérialisme <strong>et</strong> Politique. Paris : Vrin, 1994.<br />
ZARKA Yves-Charles [1987] La Décision métaphysique de <strong>Hobbes</strong>. Paris : Vrin, 1987.<br />
______________<br />
19