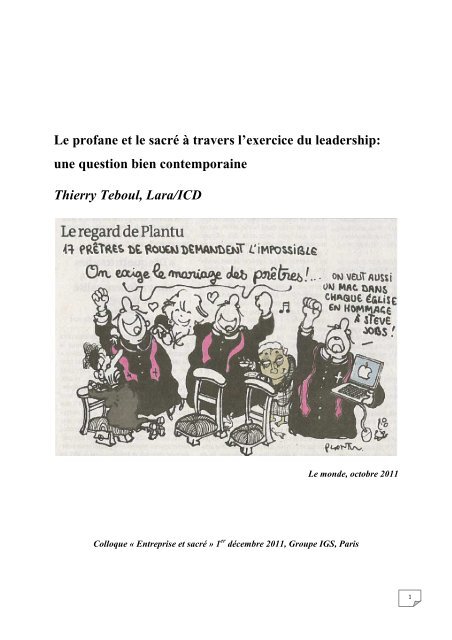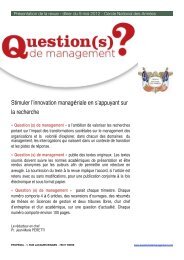Le profane et le sacré à travers l'exercice du leadership ... - propedia
Le profane et le sacré à travers l'exercice du leadership ... - propedia
Le profane et le sacré à travers l'exercice du leadership ... - propedia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La légitimation <strong>et</strong> la fabrication <strong>du</strong> <strong>le</strong>adership dans la gouvernance desclubs de football professionnelsForce est de constater que <strong>le</strong> football professionnel au cours des quinze dernières années a vuse transformer ses modes de gouvernance <strong>et</strong> se structurer ses organisations. On a affaire à unprocessus de rationalisation des règ<strong>le</strong>s de fonctionnement par la standardisation de nouvel<strong>le</strong>snormes importées pour la plupart <strong>du</strong> monde économique que l’on qualifiera de «classique ».Ces normes s’imposent au fil <strong>du</strong> temps à tous <strong>le</strong>s acteurs <strong>du</strong> champ. Tout se passe comme si laréussite sportive d’un club était désormais conditionnée par l’adhésion <strong>du</strong> plus grand nombreà ce nouvel ordre économique <strong>et</strong> social. Ces entreprises privées d’un nouveau genre sedoivent à <strong>le</strong>ur manière de satisfaire des parties prenantes qui endossent de plus en plus <strong>le</strong>shabits d’une entreprise de droit commun : <strong>le</strong>s supporters sont devenus des clients, <strong>le</strong>spropriétaires, des actionnaires, <strong>et</strong> <strong>le</strong>s dirigeants des managers.L’émergence de ce nouveau modè<strong>le</strong> ne se résume pas à sa dimension institutionnel<strong>le</strong> <strong>et</strong>organisationnel<strong>le</strong>. Il affecte <strong>le</strong>s pratiques socia<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s plus routinières comme <strong>le</strong>s postures deprésident, « <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> Aulas » en France, <strong>du</strong> nom <strong>du</strong> Président <strong>du</strong> club de Lyon, ou cel<strong>le</strong> demanager, « <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> Wenger », <strong>du</strong> nom de l’entraineur <strong>du</strong> club londonien d’Arsenal F.C. 7Ce processus d’institutionnalisation est encore inachevé si l’on s’attache aux différences deniveaux d’intégration de ces normes au sein des clubs de football français, mais surtout entre<strong>le</strong>s clubs de football des grands championnats européen (Angl<strong>et</strong>erre, Espagne, Al<strong>le</strong>magnevoire Italie) <strong>et</strong> <strong>le</strong>s clubs français. Il s’impose néanmoins comme une idéologie professionnel<strong>le</strong>de référence. Même dans <strong>le</strong>s clubs <strong>le</strong>s moins structurés, il est désormais question degouvernance <strong>et</strong> de management. <strong>Le</strong>s présidents ex-professionnels locaux « notabilisés » par lafonction font place à des dirigeants expérimentés de plus en plus issus de monde classique 8 .Et dans <strong>le</strong> même ordre d’idée, l’entraineur délaisse son habit sportif traditionnel, <strong>le</strong>survêtement, pour endosser celui <strong>du</strong> manager, avec tous <strong>le</strong>s attributs sociaux qui vont avec(l’hexis, <strong>le</strong> sty<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s modes de communication …).En France, ce modè<strong>le</strong> s’impose avec d’autant plus de force qu’il est consacré par d’autresacteurs <strong>du</strong> champ. Notamment <strong>le</strong>s médias, qui cultivent d’un côté la nostalgie d’un passéamateur dénué d’enjeux économiques, <strong>et</strong> défendent de l’autre <strong>le</strong>ur autorité <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur7 Pour une approche détaillée de ce processus historique on renverra à E. Poiraud, T. Teboul (2008).8 Dans c<strong>et</strong>te catégorie survivent encore des présidents comme ceux de Montpellier, Louis Nicollin,entrepreneur de la Région, ou d’Auxerre, Gérard Bourgoin, éga<strong>le</strong>ment entrepreneur.7
appartenance à une profession spécialisée (journaliste sportifs) qui profite à p<strong>le</strong>in de lanormalisation en cours. A ce jeu d’influence, <strong>le</strong> rapport de force tourne à l’avantage de ceuxqui promeuvent <strong>le</strong> nouveau modè<strong>le</strong>. Il présente l’avantage, notamment à partir <strong>du</strong> milieu desannées 90 de rompre avec <strong>le</strong> football aux « combines » douteuses incarnées par Bernard Tapie<strong>et</strong> Claude Bez respectivement présidents de l’Olympique de Marseil<strong>le</strong> <strong>et</strong> des Girondins deBordeaux ; C<strong>et</strong>te posture n’interdit pour autant pas la critique des dérives <strong>du</strong> système, commeon dénoncerait « <strong>le</strong>s patrons voyous » dans <strong>le</strong> monde économique « classique ».Pour mieux saisir encore la force d’imposition d’un nouveau modè<strong>le</strong>, on citera un journaliste<strong>du</strong> magazine de référence, France Football en 2006 dans un artic<strong>le</strong> consacré à Jean-MichelAulas, intitulé « JMA, la voie de la France » : « sa réussite, Lyon la doit beaucoup à l’espritd’entreprise de son président en place depuis 1987. Personne n’est obligé d’épouser tous sescombats, mais il ne serait pas honnête de ne pas reconnaître la pertinence de sa méthode.Bâtisseur acharné, agitateur d’idées <strong>et</strong> gestionnaire rigoureux, mais aussi fin manipulateur <strong>et</strong>roi de la polémique, il est <strong>le</strong> porte-drapeau de la branche libéra<strong>le</strong> <strong>du</strong> football français ». Etde conclure : « puisse d’autres dirigeants s’inspirer de la voie française dont il est <strong>le</strong>promoteur ». D’une certaine manière, la messe est dite. <strong>Le</strong> modè<strong>le</strong> Aulas, plus que <strong>le</strong> modè<strong>le</strong>lyonnais, est devenu la référence.La question qui se pose alors est de savoir si c<strong>et</strong>te institutionnalisation d’un <strong>le</strong>adership« normalisé » dans <strong>le</strong> champ <strong>du</strong> football professionnel a con<strong>du</strong>it à m<strong>et</strong>tre à distance laquestion <strong>du</strong> sacré dans un monde où, qui plus est, « <strong>le</strong>s dieux <strong>du</strong> stade » tendent à perdre<strong>le</strong>urs lauriers au gré de <strong>le</strong>ur soumission au pouvoir économique.L’intérêt d’observer un champ en construction est justement de pouvoir rendre compte desprocessus à l’œuvre. Et ce qui se donne à voir dans la normalisation que nos venonsbrièvement de décrire mais dont on peut mesurer la prégnance tous <strong>le</strong>s jours un peu plus, neplaide pas en faveur d’une mise à distance <strong>du</strong> sacré. Au contraire même, on prétendra qu’ilrelève souvent de c<strong>et</strong>te dimension si l’on s’attache aux processus de légitimation <strong>et</strong> defabrication des formes de <strong>le</strong>adership des dirigeants.Pour <strong>le</strong> montrer, on voudrait s’attacher à une figure idéa<strong>le</strong>-type, cel<strong>le</strong> d’un président de clubde football, Jean-Michel Aulas, qui a porté <strong>le</strong>s changements à l’œuvre plus haut en montrantcomment s’insinue <strong>le</strong> sacré dans la reconnaissance d’un <strong>le</strong>adership pourtant normalisé.8
Jean-Michel Aulas incarne, on l’a vu, est la figure emblématique <strong>du</strong> virage managérial <strong>du</strong>début des années 90. A priori, ni la personne, ni <strong>le</strong> professionnel ne sont prédestinés à une« carrière » de prophète en manière de gouvernance. L’histoire veut que <strong>le</strong> hasard l’aitcon<strong>du</strong>it à reprendre l’Olympique Lyonnais en 1987, alors que <strong>le</strong> club est en deuxième divisionloin de la lumière qui marquera sa domination tout au long des années 2000. Jean-MichelAulas vient <strong>du</strong> monde privé. Après une carrière fulgurante à la Cegos, il crée CEGID, unesociété de services informatiques intro<strong>du</strong>ite en Bourse seu<strong>le</strong>ment trois ans après sa création 9 .Il y a deux visions de c<strong>et</strong>te success story. Une première vision romanesque <strong>du</strong> parcours d’unchef d’entreprise qui conjugue esprit d’entreprise <strong>et</strong> rigueur de la gestion. C’est la vision laplus répan<strong>du</strong>e chez ses propres collaborateurs, au sein d’une entreprise où <strong>le</strong> culte <strong>du</strong> chef, apris une dimension légendaire.De légende, il en est justement question dans l’autre vision possib<strong>le</strong>, cel<strong>le</strong> à laquel<strong>le</strong> nousallons nous attacher. Quand on s’intéresse à la vie des légendes, à la manière dont el<strong>le</strong>s seconstruisent, à la manière dont el<strong>le</strong>s se transforment, <strong>et</strong> à la manière dont el<strong>le</strong>s touchent ausacré, on se confronte à des gril<strong>le</strong>s de <strong>le</strong>cture qui éclaire autrement <strong>le</strong> suj<strong>et</strong> (ici Aulas) <strong>et</strong> àl’obj<strong>et</strong> (ici <strong>le</strong> <strong>le</strong>adership).Parmi ces gril<strong>le</strong>s, cel<strong>le</strong> proposée par l’helléniste Pierre Grimal (1953) a r<strong>et</strong>enu toute notreattention. Cel<strong>le</strong>-ci a notamment <strong>le</strong> mérite de rappe<strong>le</strong>r que <strong>le</strong>s mythes ne sont jamais figés <strong>et</strong>qu’ils sont revisités à l’aune de trois âges : l’âge épique, l’âge tragique <strong>et</strong> l’âge philosophique.Trois âges qui sont aussi <strong>le</strong>s trois composantes d’une sacralisation tel<strong>le</strong> que nous l’avonscirconscrit : désigner l’inaccessib<strong>le</strong> <strong>et</strong> l’indisponib<strong>le</strong>. Si l’on se réfère au travail de Grimal surla vie des légendes, force est de constater que <strong>le</strong> processus de construction socia<strong>le</strong> <strong>du</strong> mythede Jean-Michel Aulas suit bien ces trois phases. De manière accélérée voire concomitante,comparativement aux mythes grecs, mais de manière toute aussi séquencée.La période épique renvoie à des mécanismes qui humanisent l’histoire <strong>du</strong> héros. A la manièred’Achil<strong>le</strong> qui va devenir une source d’inspiration à <strong>travers</strong> toute l’histoire de l’antiquité,l’histoire d’Aulas raconté par son entourage <strong>le</strong> donne à voir comme un être sensib<strong>le</strong> qui aconstruit son entreprise, Cegid, en s’appuyant sur quelques fidè<strong>le</strong>s. Ces derniers reconnaitront<strong>le</strong>ur chef au-delà des stigmates qui l’affectent une fois qu’il sera entré dans une autredimension, cel<strong>le</strong> d’un puissant dans ce monde hyper médiatique qu’est <strong>le</strong> football9 Ce résumé ne peut qu’imparfaitement refléter <strong>le</strong>s propos auprès des collaborateurs de Jean-Michel Aulas, ouauprès de Jean-Michel Aulas lui-même au cours de plusieurs rencontres.9
préoccupe peut prendre un caractère décisif. Par extension, <strong>et</strong> en s’appuyant sur ces travaux,<strong>le</strong> sacré fait ici office de « cité » à laquel<strong>le</strong> se référent <strong>le</strong>s parties prenantes de la convention.A <strong>travers</strong> l’idéal-type que constitue la figure de Jean-Michel Aulas, on voit bien que lafrontière entre <strong>le</strong> <strong>profane</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> sacré adresse encore aujourd’hui <strong>le</strong> suj<strong>et</strong> <strong>du</strong> <strong>le</strong>adership, moinsd’ail<strong>le</strong>urs dans la manifestation de sacralité dans que dans l’analyse des processus delégitimation des <strong>le</strong>aders. On aurait tort, <strong>du</strong> coup, de circonscrire l’analyse à une oppositionentre un passé empreint de sacré, <strong>et</strong> un présent <strong>profane</strong> par nature. Après tout, <strong>le</strong>scérémoniaux ayant accompagné <strong>le</strong> décès <strong>du</strong> créateur d’App<strong>le</strong> vont de pair avec la disparitiond’un homme qui a alimenté une forme de « culture pop », comme il y a eu des hommages auxhéros <strong>du</strong> Pop’art. Il en va ainsi <strong>du</strong> domaine exploré, celui <strong>du</strong> football professionnel, pourtanten prise avec une modernisation résolument inscrite dans des processus de normalisationlaissant a priori peu de place à ce que désigne <strong>le</strong> sacré, qu’il s’agisse de « l’inaccessib<strong>le</strong> » oude « l’indisponib<strong>le</strong> ». Mais on peut faire l’hypothèse que la déclinaison de ces gril<strong>le</strong>s de<strong>le</strong>cture peut s’avérer tout aussi performante sur <strong>le</strong> terrain des organisations que nous avonsqualifié de « classiques ».En distinguant au final ce qui est singulier au champ d’études choisi, <strong>et</strong> ce qui est génériquede l’exercice <strong>du</strong> <strong>le</strong>adership dans <strong>le</strong>s organisations, on contribue ainsi à éclairer <strong>le</strong> terrain <strong>du</strong>sacré <strong>et</strong> de son expression dans <strong>le</strong>s processus de management, <strong>et</strong> de changement à l’initiativede grands <strong>le</strong>aders. Tout en montrant son extrême contemporanéité.BibliographieBerger P., Luckmann T. (1986), La construction socia<strong>le</strong> de la réalité, Méridiens Klincksiek,ParisBoltanski L. Thévenot L (1991), De la justification, <strong>le</strong>s économies de la grandeur, Gallimard,ParisCallois R. (1950), L’homme <strong>et</strong> <strong>le</strong> sacré, Gallimard, ParisDupuy J.C. (2010), Lost in management, Seuil, ParisHofstede G (1977), Culture and Organisation: Software of the mind, MacGraw-Hill, NewYork11
Grimal P. (1953), La mythologie grecque, PUF, Paris<strong>Le</strong>vin K. (1975), Field Theory in Social Science, Greenwood Press, MIT, ChicagoMinzberg H. (2006), <strong>Le</strong> manager au quotidien, Editions des Organisations, références poches,2 ème ed., ParisPoiraud E., Teboul T. (2008), Amour, gloire <strong>et</strong> crampons, Pour une sociologie <strong>du</strong> foot, <strong>Le</strong>sP<strong>et</strong>its Matins, ParisWeber M. (2002), <strong>Le</strong> savant <strong>et</strong> <strong>le</strong> Politique, nouvel<strong>le</strong> tra<strong>du</strong>ction, La Découverte/poche, Paris12