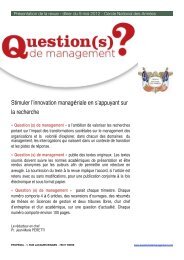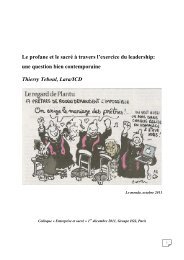Une nouvelle forme de sacralisation dans une culture ... - propedia
Une nouvelle forme de sacralisation dans une culture ... - propedia
Une nouvelle forme de sacralisation dans une culture ... - propedia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Une</strong> <strong>nouvelle</strong> <strong>forme</strong> <strong>de</strong> <strong>sacralisation</strong><strong>dans</strong> <strong>une</strong> <strong>culture</strong> organisationnelle hybri<strong>de</strong>Lorrys GherardiDocteur en SICUniversité <strong>de</strong> Nice Sophia-AntipolisLaboratoire Informations milieux medias médiations (I3M/EA 3820)98 Bd Edouard HerriotBP 320906204 NICE Ce<strong>de</strong>x 31
1. IntroductionFace à un environnement international <strong>de</strong> plus en plus ouvert et à <strong>une</strong> concurrence élargie, laprise en compte <strong>de</strong>s différences <strong>culture</strong>lles et <strong>de</strong> l’interaction entre les <strong>culture</strong>s <strong>de</strong>vient <strong>une</strong>njeu essentiel pour les organisations, tant pour satisfaire la diversité <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> que pourintégrer <strong>de</strong>s équipes <strong>de</strong> travail multi<strong>culture</strong>lles. Locale, nationale ou internationale,l’entreprise a connu par l’avènement <strong>de</strong>s techniques et technologies un rapprochement <strong>de</strong>sfrontières et donc nécessairement <strong>de</strong>s différentes <strong>culture</strong>s qui composent notre mon<strong>de</strong>. De fait,ces rapprochements doivent aussi composer avec <strong>de</strong> <strong>nouvelle</strong>s appréhensions <strong>dans</strong> toutel’acception du terme et notamment celle <strong>de</strong> « l’Autre ». En effet, l’aspect <strong>culture</strong>l pourrait seprésenter comme l’un <strong>de</strong>s plus importants d’<strong>une</strong> éventuelle stabilisation en relation avec larestructuration <strong>de</strong>s organisations, renvoyant logiquement et nécessairement à <strong>une</strong> rencontre<strong>de</strong>s <strong>culture</strong>s. Lier la question du sacré à la stratégie <strong>de</strong> développement joue un rôle majeur<strong>dans</strong> la pérennité et l’évolution <strong>de</strong>s entreprises.Le management stratégique et la communication processuelle donnent le ton <strong>de</strong> cetterecherche. Cette <strong>de</strong>rnière a pour but d’apporter un éclairage sur l’analyse <strong>de</strong> la phased’intégration post-fusion <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux entreprises lea<strong>de</strong>rs du transport aérien en se focalisant surl’un <strong>de</strong> ses outils essentiels <strong>de</strong> communication : son journal interne et les discours tenus <strong>dans</strong>ce <strong>de</strong>rnier aux salariés <strong>de</strong> la part du nouveau groupe issu <strong>de</strong> la fusion.Depuis la fin <strong>de</strong>s années 1980, les processus d’i<strong>de</strong>ntification et <strong>de</strong> <strong>sacralisation</strong>organisationnelle sont reconnus pour leur influence <strong>dans</strong> le fonctionnement organisationnel etplus particulièrement <strong>dans</strong> l’engagement <strong>de</strong>s salariés. Celui-ci est déterminant <strong>dans</strong> la réussite<strong>de</strong> la coopération et donc <strong>dans</strong> la performance d’<strong>une</strong> fusion.Notre objet <strong>de</strong> recherche sera plus le discours sacré, médiaté par le journal interne. Nousprendrons en considération sa place prépondérante <strong>dans</strong> les outils <strong>de</strong> communication, leconsidérant comme le dispositif socio-technique d’Information et <strong>de</strong> Communication(DISTIC) qui permet la diffusion du message managérial à la totalité <strong>de</strong>s salariés d’<strong>une</strong>entreprise et a fortiori <strong>de</strong>s entreprises en situation <strong>de</strong> fusion-acquisition. Ce message<strong>de</strong>viendrait vecteur d’un processus <strong>de</strong> <strong>sacralisation</strong> managériale à la bonne marche <strong>de</strong>l’entreprise alors réunifiée.2. Mise en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la part du sacré <strong>dans</strong> la <strong>culture</strong> d’entrepriseLe recueil <strong>de</strong>s informations porte sur <strong>de</strong>s domaines où les empreintes <strong>culture</strong>lles semblent lesplus naturelles. Il existe cinq catégories principales d’informations :- La fondation et le créateur représentent les premiers moments <strong>de</strong> l’entreprise, ses premierschoix et sa première expérience. En effet, l’analyse <strong>de</strong> toute situation <strong>de</strong> managementfrappe par sa « normalité », alors que <strong>de</strong>s choix ont été effectués lors <strong>de</strong> sa création parmi<strong>de</strong> nombreuses alternatives. En ce sens la fondation consacre ses premières empreintes,celles qui marquent le démarrage et la suite du fonctionnement <strong>de</strong> l’entreprise. Lesthéories <strong>de</strong> la psychodynamique ne sont pas les seules à justifier l’importance <strong>de</strong> cettecatégorie d’informations. Celles du management portent un grand intérêt à l’entrepreneur<strong>dans</strong> les sta<strong>de</strong>s initiaux d’<strong>une</strong> activité. Chacun pense à <strong>une</strong> figure emblématique <strong>de</strong>l’entreprise, ses principes, ses inventions ou sa personnalité, mais les circonstances <strong>de</strong> lafondation, c’est-à-dire la situation <strong>dans</strong> laquelle la création est opérée, sont tout aussi2
importantes. C’est souvent le contexte <strong>de</strong> la situation qui explique la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>l'empreinte <strong>de</strong> la création.- L’histoire et les petites histoires connues : L’intérêt <strong>de</strong> l’histoire est évi<strong>de</strong>nt puisqu’ildécoule <strong>de</strong> la définition même <strong>de</strong> la <strong>culture</strong>. La <strong>culture</strong> se construit selon un processusd’apprentissage, tout au long <strong>de</strong> l’histoire. La compréhension <strong>de</strong> la <strong>culture</strong> d’<strong>une</strong>entreprise passe donc par le repérage <strong>de</strong> l’histoire, <strong>de</strong> ses gran<strong>de</strong>s phases et logiquesd’évolution.- Le métier : Les informations sur le métier sont à l’intersection entre la <strong>culture</strong> et lastratégie. Ce sont <strong>de</strong>s informations fondamentales concernant les références acquises parl’entreprise <strong>dans</strong> son activité. L’étu<strong>de</strong> du métier doit indiquer ce qui constitue le cœurmême <strong>de</strong> l’entreprise puisque c’est autour <strong>de</strong> cette activité que l’organisation s’eststructurée, qu’elle s’est fixée <strong>de</strong>s objectifs et qu’elle fonctionne quotidiennement.L’entreprise est donc créatrice et utilisatrice <strong>de</strong> références.- Les valeurs : Les valeurs permettent à chacun d’évaluer ce qui est bien et mal, <strong>de</strong> porterun jugement sur les choses et d’agir. Les valeurs découlent d’expériences vécues parl’individu <strong>dans</strong> les groupes auxquels il a appartenu : « ce ne sont pas la reproduction <strong>de</strong>svaleurs collectives <strong>de</strong>s groupes mais plutôt ce qui reste <strong>de</strong> la manière dont on a vécu sesexpériences » 1 . Ainsi on peut dire qu’il y a <strong>une</strong> part d’individuel et <strong>de</strong> collectif <strong>dans</strong> lesvaleurs. Chaque collectivité crée ses propres valeurs, par référence à <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s externesexistants ou par construction ou amélioration propre. Les valeurs constituent un élémentbanal et permanent <strong>de</strong> l’action humaine, ce qui nous permet <strong>de</strong> dire qu’<strong>une</strong> décision, uncomportement, <strong>une</strong> action, se réfère <strong>de</strong> valeurs exprimant la conception <strong>de</strong> celui qui laconduit.- Les signes et symboles : Rites, langages, mo<strong>de</strong>s d’aménagement, logos, co<strong>de</strong>s <strong>de</strong>comportements et autres signes <strong>de</strong> représentations <strong>forme</strong>nt les signes et symboles pouvantparfois définir la <strong>culture</strong>. Toutefois, ces catégories donnent l’apparence d’un fourre-toutfinalement assez cohérent avec l’approche symbolique puisque tout mérite d’être étudiécomme symbole et porteur <strong>de</strong> sens.Ainsi mise en évi<strong>de</strong>nce, la <strong>culture</strong> opère comme un phénomène d’acculturationorganisationnelle sur les salariés jusqu’à <strong>de</strong>venir sacrée pour certains d’entre eux.La <strong>culture</strong>, comme tant d’autres éléments est <strong>une</strong> notion abstraite et mouvante. On peut doncse <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r comment cette <strong>de</strong>rnière, <strong>dans</strong> le cadre <strong>de</strong>s rapprochements organisationnelssubsiste-t-elle ? La question du respect mutuel <strong>de</strong>s <strong>culture</strong>s d’appartenance et en même temps<strong>de</strong> la création d’<strong>une</strong> <strong>culture</strong> comm<strong>une</strong> pose le défi <strong>de</strong> « l’inter<strong>culture</strong> d’entreprise » et ainsi,l’acceptation <strong>de</strong> la création <strong>de</strong> nouveaux symboles, d’<strong>une</strong> <strong>nouvelle</strong> <strong>sacralisation</strong>, d’<strong>une</strong><strong>nouvelle</strong> <strong>culture</strong> hybri<strong>de</strong>.Ce premier constat nous amène donc à formuler la problématique suivante : Dans latransformation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>culture</strong>s d’entreprise en <strong>une</strong> <strong>culture</strong> comm<strong>une</strong>, quelle part accor<strong>de</strong>r ausacré ? Comment à partir <strong>de</strong> cette fusion, <strong>de</strong> mêmes objets sacrés ont pu se construire et <strong>dans</strong>quelle mesure un journal interne a pu participer à cette <strong>sacralisation</strong> ?1 THEVENET M., « La <strong>culture</strong> d’entreprise », , PUF, 4 ème édition, coll. Que Sais-je ? Paris, 2003.3
3. Le changement comme ruptureLorsqu’<strong>une</strong> entreprise introduit un changement, elle le fait en général <strong>dans</strong> un ou plusieurséléments <strong>de</strong> ce que l’on nomme déterminants politiques et structurels <strong>de</strong> son i<strong>de</strong>ntité 2 .Certains changements entraînent <strong>de</strong> vraies ruptures, et plus particulièrement lors d’un rachat :tutelle, lea<strong>de</strong>rship et idéologie, stratégie, structure et système <strong>de</strong> gestion. Si ces changementssont écrits noir sur blanc, <strong>dans</strong> la réalité <strong>une</strong> majorité <strong>de</strong>s acteurs reste en place avec leurshistoires, leurs souvenirs et leurs attachements affectifs. Pour A. Chanlat et M. Dufour 3 , cesmodifications d’ordre politique et structurel, se traduisent par <strong>de</strong>s modifications <strong>de</strong>s systèmes<strong>forme</strong>ls, c'est-à-dire par <strong>de</strong>s changements du système <strong>de</strong> contraintes et d’opportunités, par <strong>de</strong>srévisions <strong>de</strong> règles <strong>de</strong> jeux, autrement dit par <strong>de</strong>s crises en termes <strong>de</strong> système d’action. Enréaction, le groupe humain peut produire <strong>de</strong>s symptômes d’absentéisme, <strong>de</strong> baisse <strong>de</strong> laproductivité ou encore d’athéisme à l’égard <strong>de</strong> l’entreprise. En somme <strong>une</strong> perte potentielle <strong>de</strong>croyance organisationnelle.Pour l’acteur individuel, c’est donc l’ensemble <strong>de</strong>s variables du système <strong>dans</strong> lequel il vit quipeut ainsi être modifié. Cet ensemble <strong>de</strong>s variables constitue l’image qu’il a <strong>de</strong> lui-même auvis-à-vis <strong>de</strong> l’entreprise, <strong>une</strong> image qu’il a construite au cours <strong>de</strong> son histoire <strong>dans</strong> le système,<strong>une</strong> image qui lui a appris à attendre <strong>de</strong> l’entreprise <strong>de</strong>s messages. Le changement remet enquestion cet équilibre psychique.Si l’acteur fournit quelque chose à l’entreprise, l’entreprise en retour procure un bénéfice àl’acteur. Quand l’entreprise change, elle doit admettre que sa responsabilité vis-à-vis <strong>de</strong>l’acteur est engagée. Le « contrat » qui unit l’entreprise à l’acteur, doit être réaménagé et c’està l’entreprise d’en prendre l’initiative, puisque c’est elle qui, <strong>dans</strong> son intérêt a introduit lechangement.4. Le rôle sacré du managerTout manager responsable d’<strong>une</strong> équipe, d’un marché ou <strong>de</strong> la négociation d’<strong>une</strong> affaire, quine tiendrait pas compte <strong>de</strong>s <strong>culture</strong>s <strong>de</strong> son personnel et du pays où il opère, risque l’échec. Larecherche que nous avons entreprise, conduit à penser qu’il faut saisir l’organisation commeun système <strong>culture</strong>l, où le symbolique et l’imaginaire occupent <strong>une</strong> place essentielle. Dès lors,les <strong>culture</strong>s propres à chaque acteur, interviennent <strong>dans</strong> le construit social <strong>de</strong> l’entreprise.Autrement dit, le mon<strong>de</strong> managérial a tout intérêt à admettre qu’<strong>une</strong> organisation est liée à unsystème <strong>de</strong> pratiques individuelles ritualisées et sacrées. Ces pratiques seront d’autant mieuxintériorisées qu’elles seront acceptées par les acteurs eux-mêmes.Il ne suffit pas <strong>de</strong> parler la même langue, ni <strong>de</strong> pratiquer le même métier pour travailler ensynergie totale entre acteurs d’<strong>une</strong> société, bien que cela facilite les rapports interpersonnels.Dans les entreprises où il y a diversité <strong>culture</strong>lle, le rôle du manager est <strong>de</strong> développer d’<strong>une</strong>part, un contrôle affectif, car tout mythe a pour fonction <strong>de</strong> provoquer chez l’autre un élanaffectif, donc <strong>de</strong> l’insérer <strong>dans</strong> un ordre et <strong>de</strong> l’inciter à <strong>de</strong>s comportements en conformitéavec les lois <strong>de</strong> l’entreprise. Et d’autre part, un contrôle intellectuel, car toute <strong>forme</strong>symbolique permet aux individus <strong>de</strong> penser l’entreprise et leur action à l’intérieur d’unsystème conceptuel. A cela s’ajoute <strong>dans</strong> la gestion <strong>de</strong>s différences un système d’automanagementimaginaire.2 LARCON J.-P. et REITTER R., « Structure <strong>de</strong> pouvoir et i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> l’entreprise », Nathan, Paris, 1979.3 CHANLAT A. et DUFOUR M., « La rupture entre l’entreprise et les hommes », Les Editions d’Organisation, Paris, 1985.4
Selon E. Enriquez 4 , la direction managériale a le choix entre <strong>de</strong>ux <strong>forme</strong>s d’imaginaire : «leurrant » et « moteur ». Dans le cadre <strong>de</strong> l’imaginaire moteur, l’entreprise encourage sesmembres à laisser aller leur imagination créatrice <strong>dans</strong> leur travail. Cela permet d’introduire ladifférence. Dans le cadre <strong>de</strong> l’imaginaire leurrant, l’organisation tente <strong>de</strong> prendre les acteursau piège <strong>de</strong> leurs convictions en les incitant à effacer leurs différences et en les orientant vers<strong>une</strong> uniformisation. Elle s’exprime comme <strong>une</strong> organisation à la fois mère <strong>de</strong> l’exil etdévoratrice. Ainsi, l’individu est occupé psychiquement en se sentant membre à part entière<strong>de</strong> l’entreprise. « Dans le cas <strong>de</strong>s dispositifs mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong> management, qui pourraient êtreassimilés à <strong>de</strong>s rituels on retrouve : […] le sacré car un rituel s’accompagne d’invocationd’éléments transcendants. » 5Ainsi, pour gérer les différences <strong>culture</strong>lles <strong>dans</strong> <strong>une</strong> organisation, le management développeun processus <strong>de</strong> socialisation <strong>de</strong>s différents acteurs par un contrôle affectif et intellectuel, etpar un imaginaire leurrant ou moteur. Cette socialisation joue un rôle important <strong>dans</strong> lerecrutement ou l’exclusion <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong> travail.On peut donc dire que la <strong>culture</strong> d’entreprise est le produit d’un mélange <strong>de</strong> sous-<strong>culture</strong>ssingulières à chaque individu <strong>dans</strong> un milieu. Gérer la différence suppose <strong>de</strong>s moyensparticuliers <strong>de</strong> décodage pour interpréter ce qui est réglementaire, optionnel et ordonné. Enfin,<strong>de</strong>ux solutions se présentent pour le management : consoli<strong>de</strong>r les différences ou les modifierpar l’outil communicationnel.5. Le journal interne : créateur <strong>de</strong> sacralitéPour la diffusion <strong>de</strong>s informations dites générales, le service communication <strong>de</strong> lacommunication interne utilise <strong>de</strong>s supports qui mettent en récit l’entreprise. « Comprendre lesorganisations à partir <strong>de</strong> leurs récits, les penser comme lieux d’<strong>une</strong> production symboliquespécifique revient à appliquer la narratologie à un univers nouveau, à première vue éloignée<strong>de</strong>s productions littéraires, artistiques ou médiatiques que cette discipline a permis <strong>de</strong>comprendre d’<strong>une</strong> <strong>nouvelle</strong> manière ». 6En entreprise plus qu’ailleurs, les informations n’étant pas données mais construites, cesoutils <strong>de</strong> communication professionnelle peuvent être considérés comme <strong>de</strong>s objets <strong>de</strong>médiation entre l’entreprise et son personnel 7 . Ils constituent <strong>une</strong> voie d’accès privilégiée àl’analyse <strong>de</strong>s organisations 8 .« Le journal interne, clef <strong>de</strong> voute <strong>de</strong> la communication interne <strong>de</strong>s entreprises est uninvestissement, et non <strong>une</strong> dépense » 9 . Cet outil permet à bien <strong>de</strong>s égards <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>sdynamiques, certes, difficilement quantifiables, mais néanmoins indispensables pour lapérennisation <strong>de</strong> l’entreprise. Dans le cadre <strong>de</strong>s rapprochements organisationnels, l’utilité dujournal interne comme dispositif <strong>de</strong> médiation semble être <strong>une</strong> évi<strong>de</strong>nce, mais le manqued’intérêt, <strong>de</strong> moyens ou d’outils comme dispositif <strong>de</strong> médiation à la restructuration <strong>de</strong>4 ENRIQUEZ E., « L’organisation en analyse », PUF, Coll. « Sociologie d’aujourd’hui », Paris, 1992.5JARDEL J.-P., LORIDON C., « Les rites <strong>dans</strong> l’entreprise : <strong>une</strong> <strong>nouvelle</strong> approche du temps », Les Editionsd’Organisation, Paris, 2000, p.202.6 d’ALMEIDA N., « Les promesses <strong>de</strong> la communication », PUF, Paris, 2001, p.937 DELEY N., « Le journal interne : un objet pour comprendre les enjeux <strong>de</strong> la communication d’entreprise » in Delcambre,P., et al, Communications organisationnelles, objets, pratiques, dispositifs, Rennes, Presses Universitaires <strong>de</strong> Rennes, 2000.8 HELLER T., « L’audiovisuel d’entreprise comme objet scientifique », in Delcambre, P., et al, Communicationsorganisationnelles, objets, pratiques, dispositifs, Rennes, Presses Universitaires <strong>de</strong> Rennes, 2000.9 LARDELLIER P., « Le journal d’entreprise – Les ficelles du métier », Editions d’Organisation, Paris, 1998.5
l’organisation est encore trop élevé au vue du nombre important <strong>de</strong>s échecs <strong>de</strong>s fusionsorganisationnelles. La raison invoquée, à tort, porte souvent sur <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong>restructuration élevés, sur l’impossibilité <strong>de</strong> « gaspiller » autant <strong>de</strong> moyens et surtout d’argent.Et pourtant, le journal interne reste un outil prépondérant si ses missions sont avérées.« Dans la perspective fonctionnaliste, la narration est conçue comme un instrument <strong>de</strong> gestionsymbolique visant l’amélioration <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong> l’organisation. Les récits sont <strong>dans</strong>cette optique reliés à <strong>une</strong> volonté d’unifier, <strong>de</strong> mobiliser le personnel. Cette piste débouche, etce n’est pas un hasard, sur <strong>une</strong> conception <strong>de</strong> la communication en termes <strong>de</strong> « propagan<strong>de</strong>corporative » ou – version française – <strong>de</strong> domination symbolique. En cela, l’approchefonctionnaliste est étroitement liée à l’approche critique qui pense la communication commeun outil <strong>de</strong> manipulation visant à légitimer un ordre social, à imposer certaines représentationset à occulter d’autres ». 10 Encore faut-il que ce <strong>de</strong>rnier soit apprécié par l’ensemble <strong>de</strong>ssalariés. Le journal interne se doit d’être la voix <strong>de</strong> la direction et <strong>de</strong>s employés et attester <strong>de</strong>l’i<strong>de</strong>ntité et <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong>s entreprises composant le groupe et du groupe lui-même.« Puisqu’on sait, <strong>de</strong>puis John L. Austin, que le langage sert à accomplir <strong>de</strong>s actes pour peuque certains énoncés soient prononcés à la <strong>forme</strong> affirmative, à la première personne duprésent <strong>de</strong> l’indicatif, il est tentant d’examiner cette hypothèse selon laquelle certains aspects« micro-strucuturels » <strong>de</strong> l’organisation pourraient être <strong>de</strong> nature performative ouillocutoire ». 11Ainsi, le journal interne <strong>de</strong>venu institutionnel par sa nature performative n’en <strong>de</strong>meure pasmoins un dispositif socio-technique d’Information et <strong>de</strong> Communication instituant un discours<strong>de</strong> <strong>sacralisation</strong> organisationnelle.6. Méthodologie :La métho<strong>de</strong> d’analyse textuelle choisie est celle issue du logiciel ALCESTE (Analyse <strong>de</strong>sLexèmes Co-occurrents <strong>dans</strong> les Enoncés Simplifiés d’un Texte). Ce logiciel d’analysetextuelle nous a permis d’analyser les discours managériaux contenus <strong>dans</strong> un journal interne,« tabloïd », édité à 72000 exemplaires, en français et en anglais, en version papier etnumérique, sous la <strong>forme</strong> d’un bi-mensuel, durant cinq années (soit 138 journaux <strong>de</strong> 2003 à2008), suivant <strong>une</strong> fusion « hybri<strong>de</strong> » <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s entreprises du secteur <strong>de</strong>s transportsaériens.ALCESTE est un acronyme signifiant Analyse <strong>de</strong>s Lexèmes Cooccurrents <strong>dans</strong> les EnoncésSimplifiés d'un Texte.« C’est <strong>une</strong> métho<strong>de</strong> qui, selon nous, peut stimuler le dialogue au sein <strong>de</strong>s disciplines dusocial quant à la nature <strong>de</strong> nos corpus textuels, nos hypothèses, traitements et interprétations,bref quant à la mesure du pouvoir symbolique du langage <strong>de</strong>s représentations » 12 . L’intérêtporté à cette métho<strong>de</strong> rési<strong>de</strong> <strong>dans</strong> le potentiel important d’acclimatation <strong>de</strong> notre recherchecontribuant à <strong>une</strong> approche herméneutique du contenu <strong>de</strong>s discours et tentant plusgénéralement <strong>de</strong> rendre intelligible la sacralité <strong>de</strong>s discours. C’est un logiciel d’analysetextuelle numérisée pour en extraire les structures signifiantes les plus fortes. Cet outil nous10 d’ALMEIDA N., « Les promesses <strong>de</strong> la communication », PUF, Paris, 2001, p.9511 GRAMACCIA G., « Les actes <strong>de</strong> langage <strong>dans</strong> les organisations », L’Harmattan, Paris, 2001, p.19912 KALAMPALIKIS N., « L’apport <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> Alceste <strong>dans</strong> l’analyse <strong>de</strong>s représentations sociales », In J.-C. ABRIC(sous la direction <strong>de</strong>), Métho<strong>de</strong>s d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s représentations sociales, Editions Erès, Ramonville Saint-Agne, 2003, pp. 147-1646
ai<strong>de</strong> à mieux comprendre notre matériel discursif et à prendre en considération l’axe dulangage <strong>dans</strong> nos étu<strong>de</strong>s.L’objectif <strong>de</strong> ce logiciel est <strong>de</strong> déterminer comment s’organisent les éléments qui constituentle corpus à analyser, réduire l’arbitraire sans la <strong>de</strong>scription du corpus et mettre en évi<strong>de</strong>ncel’information essentielle contenue <strong>dans</strong> le corpus.7. Résultats d’analyse ALCESTE :Afin d’illustrer la présence du sacré <strong>dans</strong> les récits d’entreprise comme un élément structurant<strong>de</strong> la sphère organisationnelle, nous proposons quelques extraits <strong>de</strong>s discours tenus <strong>dans</strong> lejournal institutionnel du Groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux entreprises en situation <strong>de</strong> fusion hybri<strong>de</strong>.L’analyse <strong>de</strong>s classes discursives 13 , sont constituées <strong>de</strong> <strong>forme</strong>s significatives telles que :‘<strong>de</strong>legation’, ‘equipe’, ‘participer’, ‘mariage’, ‘occasion’, ‘<strong>culture</strong>’, ‘organiser’, ‘reunir’,‘rassembler’, ‘rencontre’, ‘accueillir’.Cette classe réfère <strong>de</strong>s efforts communs <strong>de</strong> la réunion <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux entreprises. Que ce soit sous la<strong>forme</strong> d’un simple cocktail ou <strong>de</strong>s mises en lieu communs, les rencontres entre les membres<strong>de</strong> chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux compagnies sont toujours relayées <strong>dans</strong> le journal interne avec le souciconstant <strong>de</strong> fédérer les salariés autour d’un Groupe uni bien que multi<strong>culture</strong>lle et donc, <strong>une</strong><strong>nouvelle</strong> <strong>forme</strong> <strong>de</strong> <strong>sacralisation</strong> <strong>dans</strong> <strong>une</strong> <strong>culture</strong> organisationnelle hybri<strong>de</strong>.Les éléments constitutifs <strong>de</strong> ces discours révèlent aussi <strong>une</strong> <strong>sacralisation</strong> du dirigeant commecelui d’un « gui<strong>de</strong> » respecté et respectable 14 et en qui on peut avoir « la foi » car il tient sespromesses et engagements.En effet, certaines classes sont constituées <strong>de</strong> <strong>forme</strong>s significatives telles que : 'inaugurer','presi<strong>de</strong>nt', 'bureau', 'present', 'local'.Cette classe fait état <strong>de</strong>s rapprochements physiques <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux entreprises. Les bureaux etagences anciennement concurrentes <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux entreprises cohabitent dorénavant « sous lemême toit » et sous la même bannière. De plus, le Prési<strong>de</strong>nt assiste le plus souvent possible(en témoigne la présence <strong>de</strong> son titre <strong>dans</strong> les cooccurrences <strong>de</strong> termes) à ces inaugurations.<strong>Une</strong> autre classe témoigne <strong>de</strong> la présence du Prési<strong>de</strong>nt en tant que lea<strong>de</strong>r sacré vers lequeltous les salariés se tournent en cas <strong>de</strong> crise. En effet, certaines classes sont constituées <strong>de</strong><strong>forme</strong>s significatives telles que : 'presi<strong>de</strong>nt', '<strong>de</strong>veloppement_durab', 'indice', 'lea<strong>de</strong>r','economique', 'convaincu'.Ici les termes <strong>de</strong> cette classe mettent en avant les aspects économiques actuels et défis futursdu groupe qui en découlent. Cette classe laisse apparaître le discours tenu par le PDG dugroupe qui se veut à la fois rassurant (par rapport à leur position <strong>de</strong> lea<strong>de</strong>r mondial) et réaliste(par rapport à la montée du prix du pétrole).Afin <strong>de</strong> mieux nous rendre compte <strong>de</strong> ces discours instituants, nous proposons ci-aprèsquelques extraits du journal institutionnel :13 Chaque classe peut être examinée grâce à un « profil » qui contient :- la liste <strong>de</strong>s mots (ou <strong>de</strong>s <strong>forme</strong>s) les plus significatifs (mots pleins, mots outils, mots étoilés),- la liste <strong>de</strong>s unités contextuelles élémentaires les plus significatives,- les contextes caractéristiques pour chaque classe et les contextes d’apparition pour les <strong>forme</strong>s.14 HTTP://WWW.LIBERATION.FR/PORTRAIT/0101252125-JEAN-CYRIL-SPINETTA-54-ANS-PDG-D-AIR-FRANCE-S-EST-SORTI-HONORABLEMENT-DU-CONFLIT-DES-PILOTES-LE-FONCTIONNAIRE-INCOLORE-S-EST-CONVERTI-EN-PATRON-SERVITEUR-AILE7
- Le Prési<strong>de</strong>nt qualifie cette structure <strong>de</strong> « fusion originale » 15 . Selon lui, il fallait doncchoisir <strong>une</strong> structure <strong>dans</strong> laquelle « l’intérêt économique d’<strong>une</strong> <strong>nouvelle</strong> entité prime surl’intérêt <strong>de</strong> chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s parties » 16 .- <strong>Une</strong> fusion <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux entités aurait brouillé les images <strong>de</strong> marques et soulevé <strong>de</strong>s craintesi<strong>de</strong>ntitaires fortes à la disparition d’un emblème national. Dans son discours d’annonce durapprochement le 30 septembre 2003, le Prési<strong>de</strong>nt précise :« <strong>une</strong> fusion totale est impossible pour <strong>de</strong>s raisonshistoriques, psychologiques et affectives. De plus, il ne fautpas tuer <strong>de</strong>ux marques fortes ayant un rayonnementinternational ».- <strong>Une</strong> phrase du Prési<strong>de</strong>nt résume l’organisation et la logique du groupe :« Un groupe, <strong>une</strong> stratégie unique, un résultat économiqueunifié, mais avec <strong>de</strong>ux entités, <strong>de</strong>ux marques et <strong>de</strong>uxentreprises ayant chac<strong>une</strong> leurs responsabilités ».- Ces propos soulignent également le caractère exemplaire et risqué d’<strong>une</strong> opérationtotalement inédite <strong>dans</strong> le secteur du groupe :« Il ne fallait pas gérer en bon père <strong>de</strong> famille un avantagehistorique voué à disparaître, le pari est risqué mais nous nepouvions pas laisser passer l’occasion ».- Le Prési<strong>de</strong>nt ajoute <strong>de</strong>ux commentaires :« A ceux qui craignent que l’on ne mette en place un principe<strong>de</strong> dualité à l’intérieur <strong>de</strong>s entreprises, rassure-t-il, je veuxdire d’abord que je serai attentif à faire prévaloir lesprincipes d’unité du Groupe et d’unité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux entreprises.Et ensuite que, quand on s’affranchit du principe <strong>de</strong> parité,au profit d’un principe d’unité, on s’éloigne précisément <strong>de</strong>la dualité qui régnait <strong>dans</strong> le fonctionnement du SMC 17 .Notre rapprochement est un mariage volontaire entre <strong>de</strong>uxentreprises majeures. Dans un mariage, il n’est pas question<strong>de</strong> rapport dominant-dominé, mais <strong>de</strong> partenariat, <strong>de</strong>dialogue, <strong>de</strong> respect mutuel. La <strong>nouvelle</strong> organisation <strong>de</strong>vrarespecter ces exigences <strong>de</strong> bon sens. » 188. Conclusion :Nous l’avons vu, le recours au narratif permet la légitimation <strong>de</strong>s actes managériaux. « Ils’agit <strong>de</strong> mettre en perspective les actions passées, présentes et à venir, <strong>de</strong> recomposer lestrajectoires stratégiques et si possible <strong>de</strong> rendre compte <strong>de</strong> leur cohérence, d’apporter lapreuve <strong>de</strong> leur bien-fondé, <strong>de</strong> dire le vrai <strong>de</strong>s décisions prises, <strong>de</strong> rendre raison <strong>de</strong>s preuves <strong>de</strong>leur succès. Le recours au narratif s’imposerait alors comme le seul mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> légitimationsusceptible <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>ux opérations symboliques : d’<strong>une</strong> part la validation symbolique <strong>de</strong>ssavoirs acquis, leur transmutation en contenus d’<strong>une</strong> <strong>culture</strong> à l’échelle <strong>de</strong> l’entreprise, d’autrepart, la genèse d’un héros mythique, indifférencié, collectif libre <strong>de</strong> ses choix, d’autant pluslibre d’ailleurs que ses choix <strong>de</strong>vraient fournir matière à légitimation ». 19 Ainsi, « plutôt que<strong>de</strong> subir le flux <strong>de</strong>s histoires produites anarchiquement <strong>dans</strong> l’entreprise, le storytellingmanagement entend valoriser et orienter cette production en proposant <strong>de</strong>s <strong>forme</strong>s15 Extrait <strong>de</strong> la conférence <strong>de</strong> presse du 5 mai 2004.16 Extrait du discours prononcé le 30 septembre 2003 à l’annonce du rapprochement.17 Strategic Management Committee18 Extrait du journal institutionnel du Groupe • N° 211 • 12 avril 200719 GRAMACCIA G., « Les actes <strong>de</strong> langage <strong>dans</strong> les organisations », L’Harmattan, Paris, 2001, p. 2028
systématisées <strong>de</strong> communication interne et <strong>de</strong> gestion fondées sur la narration d’anecdotes(stories) » 20 . Il n’en <strong>de</strong>meure pas moins que le sacré <strong>dans</strong> sa <strong>forme</strong> narrative rassure lessalariés <strong>dans</strong> les changements organisationnels proposés, au gré <strong>de</strong>s volontés <strong>de</strong>s dirigeants ousubis, selon les fluctuations <strong>de</strong>s marchés.Dans notre cas, il semble se <strong>de</strong>ssiner <strong>une</strong> double sacralité instituée par le journalinstitutionnel :Culturelle toute d’abord, car les valeurs et les i<strong>de</strong>ntités insufflées <strong>de</strong> chac<strong>une</strong> <strong>de</strong>s entreprisesont été préservées comme le garant <strong>de</strong> la « foi » constituante et référante.Du dirigeant charismatique ensuite. En effet, le Prési<strong>de</strong>nt, lors <strong>de</strong> son arrivée à la tête <strong>de</strong>l’entreprise, avait pour mission <strong>de</strong> redresser l’entreprise qui était en perdition. Contesté <strong>dans</strong>un premier temps, puis adulé par l’ensemble <strong>de</strong>s salariés, le travail qu’il a accomplie durantces onze années auront permis <strong>de</strong> placer le nouveau groupe au premier rang mondial tout enrespectant <strong>une</strong> logique <strong>de</strong> gouvernance à la fois sociale et économique. Il a en effet conservéles i<strong>de</strong>ntités et les valeurs collectives <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux entreprises, propulsé le groupe au premier rangmondial, <strong>de</strong>vancé la crise économique etc. Ainsi représenté, le lea<strong>de</strong>r charismatique a unpouvoir d’influence lié au contexte et aux interactions avec son entourage. Son autoritélégitime repose sur sa reconnaissance et son acceptation par autrui faisant <strong>de</strong> ce dirigeantcharismatique un personnage qui s’inscrit intimement <strong>dans</strong> les attentes <strong>de</strong> sa société et <strong>de</strong> sontemps.Bibliographie :- CHANLAT A. et DUFOUR M. (1985), La rupture entre l’entreprise et les hommes, LesEditions d’Organisation, Paris.- d’ALMEIDA N. (2001), Les promesses <strong>de</strong> la communication, PUF, Paris.- DELEY N. (2000), Le journal interne : un objet pour comprendre les enjeux <strong>de</strong> lacommunication d’entreprise, in Delcambre, P., et al, Communications organisationnelles,objets, pratiques, dispositifs, Rennes, Presses Universitaires <strong>de</strong> Rennes.- ENRIQUEZ E. (1992), L’organisation en analyse, PUF, Coll. « Sociologied’aujourd’hui », Paris.- GRAMACCIA G. (2001), Les actes <strong>de</strong> langage <strong>dans</strong> les organisations, L’Harmattan,Paris, 2001.- HELLER T. (2000), L’audiovisuel d’entreprise comme objet scientifique, in Delcambre,P., et al, Communications organisationnelles, objets, pratiques, dispositifs, Rennes,Presses Universitaires <strong>de</strong> Rennes.- JARDEL J.-P., LORIDON C. (2000), Les rites <strong>dans</strong> l’entreprise : <strong>une</strong> <strong>nouvelle</strong> approchedu temps, Les Editions d’Organisation, Paris.- KALAMPALIKIS N. (2003), L’apport <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> Alceste <strong>dans</strong> l’analyse <strong>de</strong>sreprésentations sociales, In J.-C. ABRIC (sous la direction <strong>de</strong>), Métho<strong>de</strong>s d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>sreprésentations sociales, Editions Erès, Ramonville Saint-Agne.20 SALMON C., « Storytelling, la machine à fabriquer <strong>de</strong>s histoires et à formater les esprits », La Découverte/Poche, Paris,2007, p.569
- LARCON J.-P. et REITTER R. (1979), Structure <strong>de</strong> pouvoir et i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> l’entreprise,Nathan, Paris.- LARDELLIER P. (1998), Le journal d’entreprise – Les ficelles du métier, Editionsd’Organisation, Paris.- SALMON C. (2007), Storytelling, la machine à fabriquer <strong>de</strong>s histoires et à formater lesesprits, La Découverte/Poche, Paris.- THEVENET M. (2003), La <strong>culture</strong> d’entreprise, PUF, 4 ème édition, coll. Que Sais-je ?Paris10