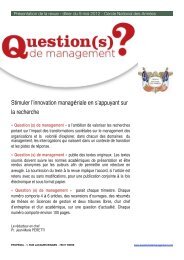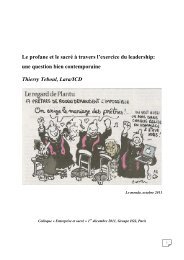Entreprise et religion : quels rapports? Quels apports? - propedia
Entreprise et religion : quels rapports? Quels apports? - propedia
Entreprise et religion : quels rapports? Quels apports? - propedia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Entreprise</strong> <strong>et</strong> <strong>religion</strong> : <strong>quels</strong> <strong>r<strong>apports</strong></strong>? <strong>Quels</strong> <strong>apports</strong>?Une étude des liens entre mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> <strong>religion</strong>Gildas BARBOTCERAG (Univ. Pierre Mendes France - Grenoble)gildas.barbot@iut-valence.frFrançoise de BRYPROPÉDIA (Groupe IGS)fdebry@orange.frJamila ALAKTIFLEM Université de Lillejamila.alaktif@hotmail.frRésuméL'actualité économique nous donne à voir en France <strong>et</strong> ailleurs une confrontation délicate entre l'entreprise<strong>et</strong> la <strong>religion</strong>. Oscillant entre le conflit ouvert <strong>et</strong> le dialogue de sourd, l'articulation entre cesdeux domaines ne va pas de soi tant ils relèvent de logiques différentes. Les chercheurs en sciencesde gestion sont interpellés par ce problème qui soulève de nombreuses questions managériales. Aussi,la conciliation entre ces deux sphères auxquelles les individus se rattachent, doit être recherchée.Compte-tenu de l'ampleur de ce suj<strong>et</strong>, nous avons choisi de focaliser notre attention sur une fonctionparticulière de l'entreprise : le mark<strong>et</strong>ing. Ainsi chercherons-nous dans ce chapitre à m<strong>et</strong>tre en évidenceles similitudes <strong>et</strong> les tensions qui apparaissent lorsqu'on explore les multiples liens entre mark<strong>et</strong>ing<strong>et</strong> <strong>religion</strong>.AbstractLiving one's faith at the workplace is som<strong>et</strong>imes difficult in France and elsewhere. Hence, researchersin business management should work on this issue so as to promote the dialogue b<strong>et</strong>ween firmsand <strong>religion</strong>. We tackle this issue with a scientific approach in order to provide managers with a conceptualframework to understand how <strong>religion</strong> and firms influence each other. As we can't study alldimensions such an issue implies, we only focus here on the impact of <strong>religion</strong> on mark<strong>et</strong>ing management.
IntroductionLes relations économiques ne se passent pas selon des lois de valeur neutre,mais sont plutôt porteuses de convictions spécifiques sur la nature de la personnehumaine, ses origines <strong>et</strong> sa destinée. Dans tout système économique, ily a une anthropologie <strong>et</strong> une théologie implicites.W. Cavanaugh, 2007, Être Consommé, p.108Contentieux autour du port de signes religieux au travail, forte croissance du marché des produits halal,débat sur le travail du dimanche, développement d'une finance islamique... Ces exemples tirés del'actualité récente illustrent à quel point les entreprises sont aujourd'hui confrontées à la question religieuse(Banon, 2005). La question de la <strong>religion</strong> ne peut rester occultée plus longtemps dans les travauxdes chercheurs en sciences de gestion.Certes, les managers <strong>et</strong> DRH commencent à aborder ouvertement la question des eff<strong>et</strong>s de l'appartenancereligieuse sur la vie professionnelle au travers du débat sur la diversité dans l'entreprise. Deleur coté, les gens de mark<strong>et</strong>ing ont rapidement compris que la prise en compte de la dimension spirituelleou religieuse dans leur offre leur perm<strong>et</strong>trait d'élargir leur clientèle (Camus, Poulain, 2008).D'une manière générale cependant, les <strong>r<strong>apports</strong></strong> entre <strong>religion</strong> <strong>et</strong> entreprise restent peu étudiés <strong>et</strong> nefont l'obj<strong>et</strong> que d’approches partielles à quelques exceptions près (notamment Robert-Demontrond,2007). Notre ambition dans c<strong>et</strong>te communication est de poser les bases d'une réflexion sur les liensentre entreprise <strong>et</strong> <strong>religion</strong>. Faute de pouvoir traiter c<strong>et</strong>te question dans tous ses aspects, nous focaliseronsnotre analyse sur la relation réciproque entre l'activité mark<strong>et</strong>ing de l'entreprise <strong>et</strong> la <strong>religion</strong>.Face à ce que certains voient comme un «r<strong>et</strong>our du religieux », nous souhaitons prendre acte d'uneconfrontation entre deux sphères de nature différente -la <strong>religion</strong> d'une part <strong>et</strong> l'entreprise d'autre partpourtirer quelques enseignements sur ce que ces deux domaines pourraient s'apporter mutuellement.Nous prenons donc le parti de ne pas considérer d'abord la <strong>religion</strong> comme un problème qui doit êtregéré, mais comme une réalité sociale qui rejaillit sur la vie des entreprises. A ce titre, elle doit êtreappréhendée comme n'importe quelle autre réalité qui conduit l'entreprise à se rem<strong>et</strong>tre en question :la mondialisation, la place grandissante des techno-sciences, les défis écologiques.Dans c<strong>et</strong>te contribution, nous chercherons à savoir <strong>quels</strong> sont les <strong>r<strong>apports</strong></strong> <strong>et</strong> <strong>apports</strong> éventuels entrela <strong>religion</strong> <strong>et</strong> l'entreprise dans le cadre de son activité mark<strong>et</strong>ing. Par exemple, le concept de fidélisationsemble éloquent : les entreprises comme les <strong>religion</strong>s partagent le souci de « fidéliser » les personnesauxquelles elles s'adressent. Sur ce point, les entreprises s'inspirent de la <strong>religion</strong> <strong>et</strong> cherchentà imposer leurs marques en créant autour de ces dernières une communauté de « fidèles ». Inversement,les <strong>religion</strong>s qui s'efforcent de transm<strong>et</strong>tre leur message spirituel recourent de plus en plus àdes techniques commerciales : adaptation du discours à la cible (jeunes, malades, non-croyants, familles),communication persuasive, opérations de relations publiques.2
Au delà d'une vision instrumentale qui se limiterait à voir en quoi <strong>religion</strong> <strong>et</strong> mark<strong>et</strong>ing peuvent êtreutiles l'un à l'autre, c<strong>et</strong>te recherche promeut l'idée d'une prise en compte globale de la personne humainequ'il soit employé, fournisseur ou client. En eff<strong>et</strong>, si les dimensions physiques, sociales, affectives<strong>et</strong> psychiques sont aujourd'hui bien intégrées dans la vision de l'homme qui sous-tend les théoriesde management, la dimension spirituelle est le plus souvent occultée. De même, parce qu'ellessont difficiles à appréhender ou taboues, les aspirations religieuses des consommateurs sont souventignorées des entreprises -alors que les recherches qui adoptent une perspective culturelle de la consommationreconnaissent que même la consommation d'obj<strong>et</strong>s communs comporte une dimensionsacrée (voir le travail fondateur de Belk, Sherry <strong>et</strong> Wallendorf en 1989).Notre réflexion sur l'entreprise <strong>et</strong> la <strong>religion</strong> articule deux concepts étrangers l'un à l'autre dont ilconvient de préciser le sens. Ces deux mots désignent des collectifs de nature différente vis à vis des<strong>quels</strong>l'individu développe des liens d'appartenance plus ou moins durables, qui jouent un rôle importantdans sa construction identitaire. Si les sciences économiques définissent l'entreprise comme« une unité économique dotée d'une autonomie juridique qui combine des facteurs de production afinde produire des biens <strong>et</strong> services destinés à être vendus sur un marché » (Beitone <strong>et</strong> al., 2001), c'estplutôt en tant qu'entité sociale que nous la considérerons ici. C'est pourquoi, nous reprenons à notrecompte la définition proposée par Bessire <strong>et</strong> Mesure (2009) qui présentent l'entreprise comme « unecommunauté de suj<strong>et</strong>s libres <strong>et</strong> responsables, parties prenantes à un proj<strong>et</strong> qui a pour finalité lacréation d'un mieux » (p.39) Par sa manière de gérer les personnes <strong>et</strong> par la vision du monde qu'ellevéhicule auprès de ses parties prenantes, l'entreprise contribue à façonner l'identité culturelle des populationsavec lesquelles elle est en contact. Notre problématique nous conduit donc à adopter unevision très incarnée de l'entreprise, loin de la conception abstraite que propose l'analyse économique.L'activité de l'entreprise est socialement située, comme l'a montré Granov<strong>et</strong>ter (1985), <strong>et</strong> la questiondu lien entre mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> <strong>religion</strong> nous amène à reconnaître l'encastrement culturel de son action, enparticulier dans son activité mark<strong>et</strong>ing qui peut être définie comme « l’effort d’adaptation des organisationsà des marchés concurrentiels, pour influencer en leur faveur le comportement des publicsdont elles dépendent, par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents» (Mercator, 2010).La <strong>religion</strong> quant à elle, est « un ensemble des croyances relatives à un ordre surnaturel ou supranaturel,des règles de vie, éventuellement des pratiques rituelles, propre à une communauté ainsi déterminée<strong>et</strong> constituant une institution sociale plus ou moins fortement organisée » (Définition duCentre national de ressources textuelles <strong>et</strong> lexicales 1 ). En dépit de l’hétérogénéité des rites <strong>et</strong> des pratiquesqui existent au sein de chaque <strong>religion</strong>, nous préférons faire référence à la <strong>religion</strong> plutôt qu'àla spiritualité, car l'appartenance religieuse implique le rattachement à une communauté de croyantstandis que la spiritualité peut être vécue hors-institutions. La spiritualité est donc moins problématiquepour l'entreprise que la <strong>religion</strong> qui renvoie à une institution ou à une communauté de croyants.Cependant, notre propos ne se limite pas aux « grandes » <strong>religion</strong>s de la tradition abrahamique <strong>et</strong>nous reconnaissons volontiers le titre de <strong>religion</strong> à tout mouvement constitué dans lequel les individuspeuvent poursuivre leur quête spirituelle (Bouddhisme, Hindouisme,...).Nous puiserons à la fois dans le corpus théorique des sciences de gestion <strong>et</strong> principalement dans lestravaux de mark<strong>et</strong>ing mais aussi dans celui des sciences sociales qui offrent un éclairage précieux surun questionnement aussi transversal. Au niveau de la <strong>religion</strong>, nous nous en tiendrons à une approchegénérale qui n'entre pas dans les débats théologiques. Nous nous intéressons en premier lieu au lienmark<strong>et</strong>ing-<strong>religion</strong> dans le contexte français, c'est pourquoi notre analyse laissera une place importanteau christianisme <strong>et</strong> au catholicisme en particulier qui reste la première <strong>religion</strong> de France. Elleévoquera en outre les défis que pose à la société française, l’affirmation de sa communauté musul-1 http://www.cnrtl.fr/definition/<strong>religion</strong>3
mane qui entend vivre sa foi au grand jour, que ce soit dans les comportements d'achat ou dans la vieprofessionnelle. Néanmoins, notre problématique dépasse largement le cadre français aussi importe-tild'inscrire notre réflexion plus largement dans la dynamique sociale actuelle, marquée par la mondialisation<strong>et</strong> le pluralisme religieux.Aborder le lien <strong>religion</strong>-entreprise est d'autant plus délicat qu'en France, la question de la <strong>religion</strong> estrelativement taboue dans l'espace public. Contrairement aux théologiens, aux philosophes au aux politologuesqui abordent assez naturellement le fait religieux dans leurs analyses, rares sont les chercheursen sciences de gestion qui s'intéressent à c<strong>et</strong>te question. Comment expliquer c<strong>et</strong>te mise àl’écart des questions religieuses? On peut penser d’une part qu’il existe une séparation dans l’espritdes chercheurs entre la gestion, qui s’intéresse aux affaires « d’ici-bas » <strong>et</strong> la <strong>religion</strong> quis’intéresserait à « l’au-delà ». Il existe d'autre part une certaine prudence à l'égard du fait religieux cartoute critique à l'encontre d'une <strong>religion</strong> peut être suspectée de racisme (antisémitisme, islamophobie...).En dépit de ces difficultés, nous proposons d'ouvrir le débat dans l'espoir de trouver une articulationstimulante entre un domaine prétendument rationnel, celui de l'entreprise <strong>et</strong> des techniquesmark<strong>et</strong>ing qu'elle emploie, <strong>et</strong> un autre qui est supposé ne pas l'être : la <strong>religion</strong> (les théories « discontinuistes» envisagent par exemple les croyances religieuses comme un continent à part de la penséehumaine). Pourtant, les travaux de H. Simon sur la rationalité limitée établissent que l'entreprise <strong>et</strong>ses acteurs sont loin d'être parfaitement rationnels. Inversement, les autorités religieuses des différentes<strong>religion</strong>s rappellent que même s'il y a une révélation, la connaissance de Dieu par les croyantsnécessite un travail de l'intelligence. Certaines prises de position manifestent clairement la volontéque s'établisse un dialogue entre foi <strong>et</strong> raison (voir par exemple le texte Fides <strong>et</strong> Ratio (1998) du Vatican2 , ou les travaux du groupe de recherche « Économie, Hommes <strong>et</strong> Société » du Collège des Bernardins3 ).En dépit de c<strong>et</strong>te convergence, l'étude des relations entreprise-<strong>religion</strong> ne va pas de soi dans le contextede laïcité « à la française » qui s'est employé à reléguer la foi au domaine privé. C<strong>et</strong>te conceptionde la laïcité a contribué à un effacement du religieux dans le domaine public, accentué par undéclin généralisé de la pratique dans toutes les sociétés occidentales (à l'exception des États-Unis).Néanmoins, la laïcité a évolué en rompant récemment avec une certaine hostilité à l'égard des <strong>religion</strong>s.Ainsi, le concept controversé de « laïcité positive » envisage d'une façon plus constructive laprésence des <strong>religion</strong>s dans la société. C<strong>et</strong>te nouvelle posture laïque nous donne l'occasion d'envisagerplus sereinement la question de la <strong>religion</strong> dans l’entreprise.Nouveaux venus dans le paysage religieux français, les musulmans ont redonné une certaine visibilitéà la <strong>religion</strong> dans l'espace public. C'est ainsi que se sont produits un certain nombre d'incidents autourde revendications religieuses, notamment au niveau des entreprises. Plutôt que de nous appesantir surces problèmes qui ont été décryptés par des spécialistes tels que Bouzar <strong>et</strong> Bouzar (2009), nous souhaitonsprendre de la hauteur pour comprendre comment peut être concilié confessionnel <strong>et</strong> professionnel(voir la proposition de Renouart (2011) aux chrétiens engagés dans la vie professionnelle).Supposer l'existence de Dieu, est un parti-pris contestable. Aussi convient-il de rappeler que l'objectifde ce travail n'est pas de m<strong>et</strong>tre à tout prix Dieu dans les entreprises, mais de constater qu'elles sontinterpellées par les croyants qui interagissent avec elle (clients, employés, fournisseurs...). Notre analysede la relation <strong>religion</strong>-entreprise a donc avant tout une visée descriptive afin de perm<strong>et</strong>tre unemeilleure compréhension de ce qui se vit dans les entreprises. D'un point de vue mark<strong>et</strong>ing, la capacitéde l'entreprise à reconnaître, lorsqu'elles existent, certaines attentes de la clientèle liées à leur foi,ne peut qu’aller dans le sens d'une meilleure compréhension du client.2 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-<strong>et</strong>-ratio_fr.html3http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/pole-de-recherche/economie-homme-soci<strong>et</strong>e.html4
Le plan que nous adoptons aborde en premier lieu la question du lien <strong>religion</strong>-entreprise d'une manièregénérale afin de dégager les enjeux de notre réflexion. Dans un deuxième temps notre analyses'intéressera au discours critique que les <strong>religion</strong>s adressent à la société de consommation. Une certaineambivalence sera mise en évidence à travers le fait que les <strong>religion</strong>s sont à la fois critiques àl'égard de l'emprise du mark<strong>et</strong>ing sur la société, <strong>et</strong> utilisatrices du mark<strong>et</strong>ing lorsqu'elles cherchent àpropager la foi. Dans une dernière partie, nous ferons ressortir les liens subtils entre entreprise <strong>et</strong> <strong>religion</strong>à travers ce qu'en révèle la communication publicitaire.1. Dieu, l'homme <strong>et</strong> l’économie1.1 Où donc est Dieu ?S'intéresser conjointement à la <strong>religion</strong> <strong>et</strong> à l'entreprise, autrement que dans le cadre d'une réflexionsur l'éthique des affaires peut sembler inhabituel voire saugrenu. En eff<strong>et</strong>, comme l'a montré Gauch<strong>et</strong>(1985), la société moderne a vécu un processus de « sortie » de la <strong>religion</strong>. Ce processus correspond àtransformation radicale de la façon de penser résultant d'une intégration des valeurs chrétiennes dansle fonctionnement social: « On peut concevoir à la limite, une société qui ne comprendrait que descroyants <strong>et</strong> qui n'en serait pas moins une société d'au-delà du religieux. Car la <strong>religion</strong>, ce futd'abord une économie générale du fait humain, structurant indissolublement la vie matérielle, la viesociale <strong>et</strong> la vie mentale. C'est aujourd'hui qu'il n'en reste plus que des expériences singulières <strong>et</strong> dessystèmes de conviction, tandis que l'action sur les choses, le lien entre les êtres <strong>et</strong> les catégories organisatricesde l'intellect fonctionnent de fait <strong>et</strong> aux antipodes de la logique de la dépendance [à la<strong>religion</strong>] qui fut leur règle constitutive depuis le commencement » (p. 133) Ce basculement, j<strong>et</strong>te unelumière nouvelle sur la notion de laïcité en n'opposant pas <strong>religion</strong> <strong>et</strong> société mais en expliquant quel'une n'est plus phagocytée par l'autre <strong>et</strong> qu'elles fonctionnent de façon autonome. Ce concept de« sortie » de la <strong>religion</strong> est précieux pour penser le rapport actuel qu'entr<strong>et</strong>iennent l'entreprise <strong>et</strong> la<strong>religion</strong>. Il perm<strong>et</strong> de comprendre que leurs logiques sont de nature différente. Néanmoins, c<strong>et</strong>te autonomiede la personne vis à vis de la <strong>religion</strong> ne signifie pas sortie de la croyance religieuse car il ya, selon Gauch<strong>et</strong>, une unité naturelle de l'esprit humain qui intègre le sentiment religieux. S’il y abien transformation des modes de pensée avec la modernité, une dimension émotionnelle imprégnéede transcendance perdure <strong>et</strong> continue de façonner nos comportements. Fort de ce postulat de départ,nous souhaitons voir en quoi la <strong>religion</strong> continue d'influencer l'agir de l'individu dans l'entreprise. La<strong>religion</strong> n'est plus un cadre rigide dans lequel s'inscrit la vie sociale <strong>et</strong> notamment professionnelle,elle apparaît plutôt aujourd’hui comme un souffle qui traverse c<strong>et</strong>te-dernière pour tenter de lui donnerdu sens.1.2 Religion <strong>et</strong> développement de l'économieTodeschini (2008) montre que dès la fin du Moyen-Age, l'ordre franciscain contribue à la mise enplace d'un cadre conceptuel perm<strong>et</strong>tant de penser l'action économique en lien avec l'éthique chrétienne.Avec Weber (1964), la question de savoir comment certaines croyances religieuses déterminentl'éthos d'une forme économique est posée. Il m<strong>et</strong> en évidence que le principe de prédestinationencourage les protestants à rechercher la richesse en la considérant comme une promesse de salut.Weber rappelle au passage que la Réforme « signifiait [une nouvelle autorité] qui pénétrait tous lesdomaines de la vie publique ou privée, imposant une réglementation de la conduite infiniment pesante<strong>et</strong> sévère ».(p. 30) témoignant ainsi de la force structurante de la <strong>religion</strong> pour tout le corps social.L'époque moderne ne perm<strong>et</strong> plus de décrypter facilement les principes religieux qui soustendentl'action économique. Cependant, on r<strong>et</strong>rouve aujourd'hui dans d'autres contextes culturels desapproches de l'entrepreneuriat qui montrent que l'éthique religieuse continue d'encourager l'initiativeéconomique. Ainsi, le mouvement MÜSIAD fondé en 1990 par des entrepreneurs d'Anatolie formule5
une éthique managériale favorable au capitalisme, qui est à l'origine d'un essor économique sans précédent,alors que la région ne jouissait pas de structures économiques ou d'un soutien politique qui laprédisposait à un tel succès (Maigre, 2005). Avec plus de discrétion, perdure en Europe occidentaleun syndicalisme chrétien (CFTC en France) <strong>et</strong> un patronat chrétien (rassemblé dans des organismestels qu' « Entrepreneurs <strong>et</strong> Dirigeants Chrétiens » ou UNIAPAC au niveau européen), preuve quemalgré la sécularisation, la <strong>religion</strong> continue d'inspirer les personnes dans leur engagement professionnel.Parce qu'elles s'intéressent à tout ce qui « fait » la vie de l'homme, les <strong>religion</strong>s ne sont pas indifférentesà la façon dont les entreprises s'organisent <strong>et</strong> fonctionnent. Cependant, les différentes <strong>religion</strong>sn'ont pas la même prétention à régenter les comportements au travail <strong>et</strong> ne portent pas leur attentionsur les mêmes points : aménagement de l'espace de travail, du temps de travail, statut de la personne<strong>et</strong> rapport au corps. Si aujourd'hui en France, la <strong>religion</strong> musulmane a des exigences sur chacun deces points, les bouddhistes ou les chrétiens protestants sont en revanche très souples.1.3 Mondialisation <strong>et</strong> Environnement : défis communsReligion <strong>et</strong> entreprises font face à un défi commun : nous verrons dans un premier temps qu'ellesdoivent relever celui de la crise écologique <strong>et</strong> dans un deuxième temps celui de la mondialisation quipose la question de la gestion de la diversité des contextes d'action (think global, act local).Comme les grandes entreprises, le christianisme s'est trouvé accusé d'être complice de la crise écologique(White, 1965). En eff<strong>et</strong>, la place prépondérante donnée à l'homme dans la création <strong>et</strong> le commandementbiblique de dominer <strong>et</strong> de soum<strong>et</strong>tre la terre (Génèse 1,28) ont été interprétés comme unencouragement à surexploiter les richesses naturelles. C<strong>et</strong>te accusation n'est pas dénuée de fondementmais repose sur une interprétation particulière des récits de la Création. Certains exégètes voient aucontraire dans ce commandement divin, l'acte par lequel le créateur confie sa création à l'homme, nonpas pour l'exploiter mais pour la préserver. Un pionnier de l'écologie comme François d'Assise auXIII e s., offre à ses compagnons l'idéal d'une vie en harmonie avec la nature <strong>et</strong> montre que la <strong>religion</strong>chrétienne favorise une sensibilité écologique <strong>et</strong> pas nécessairement des comportements prédateurs.Le discours des <strong>religion</strong>s sur les questions écologiques n'est pas sans intérêt pour les entreprises, carelles proposent une réflexion originale sur le rapport entre l'homme <strong>et</strong> la nature fondé sur leur compréhensionde la Création. L'approche que propose la doctrine sociale de l'Eglise par exemple, reposesur une métaphore présentant l'environnement comme la maison de l'homme. Aussi, la sollicitudede l'Eglise pour l'homme implique-t-elle logiquement la préservation du cadre de vie dans lequell’Homme s’épanouit. Aspects sociaux <strong>et</strong> environnementaux sont ainsi intimement liés.L'autre défi pour lequel les <strong>religion</strong>s se r<strong>et</strong>rouvent au côté des entreprises est celui de la mondialisation.L’intensification des flux migratoires, motivée par des raisons économiques, d’agrément ou desurvie, amène des croyants de différentes confessions à se rencontrer <strong>et</strong> transforme la géographie des<strong>religion</strong>s. Si la mondialisation précoce de la diaspora juive est un phénomène connu, on sait moinsqu'aujourd'hui, les quatre premiers pays musulmans n'appartiennent pas au monde arabe, que lecentre de gravité de la chrétienté n'est plus en Europe (Vall<strong>et</strong>, 2003)... La mondialisation des <strong>religion</strong>scomme celle des entreprises implique qu'elles engagent un processus d'acculturation. Face à cedéfi, les entreprises ont développé un savoir-faire en terme de management interculturel, alors que les<strong>religion</strong>s sont plus en difficultés car leur histoire reste rattachée à une terre (péninsule arabique, Palestine,Inde...). Aussi le fait de sortir de ses frontières originelles oblige les <strong>religion</strong>s à quelquesadaptations linguistiques (Le concile Vatican 2 en 1962, par exemple, a entériné la possibilité pourles catholiques de célébrer les offices religieux en langue vernaculaire) <strong>et</strong> rituelles (adaptation destenues <strong>et</strong> de l'architecture religieuse aux traditions locales). Dans certains cas, on a pu voir émergerune expression religieuse transnationale. C'est ainsi qu'un islam mondialisé résultant d'influences6
multiples est né (Roy, 2002) ou que certains courants évangélistes vont à la conquête du monde enmobilisant partout les mêmes techniques d'approches pour diffuser leur message <strong>et</strong> convertir de nouveauxadeptes.On constate sur ces deux points que l'entreprise <strong>et</strong> la <strong>religion</strong> font face à des problématiques analoguesqui peuvent être l'occasion d'un dialogue fructueux pour voir, ici <strong>et</strong> là, comment les problèmessont abordés. On découvre que toutes les deux s'adressent à un marché, ou à ce qui en tient lieu. Laproximité des démarches explique qu'un certain nombre de mots soient employés dans les deux contextes: fidélisation, conversion, rituel (religieux ou de consommation), croyances, grand messe (quece soit une célébration religieuse ou un événement fédérateur pour l’entreprise), communauté demarque ou de croyants... On comprend alors que l'entreprise <strong>et</strong> la <strong>religion</strong> actionnent des ressorts similaireslorsqu'elles s'adressent à leurs cibles. Les entreprises, dans le cadre du développement deleurs marques cherchent à susciter chez leur client les mêmes sentiments que ceux qu'éprouvent lescroyants pour leur <strong>religion</strong>. C<strong>et</strong>te ferveur religieuse se nourrit de différents éléments tels qu'une vision,un sentiment d'appartenance, un récit (storytelling), une grandeur, un éveil des sens, une ferveurcommunicative <strong>et</strong> une force symbolique (Lindstrom, 2008). Autant de dimensions que l'on a constatéespar exemple chez les fans d'Apple qui développent des réactions semblables à une émotion religieuse(Riley, 2011)Le risque d'un rapprochement sans nuances entre entreprise <strong>et</strong> <strong>religion</strong> est d'oublier leurs finalitésrespectives qui ne sont pas du même ordre. Si chacune prétend apporter un bénéfice à celles <strong>et</strong> ceux àqui elle s'adresse (bénéfice en terme de valeur <strong>et</strong> de satisfaction pour l'entreprise, bénéfice spirituel enterme de salut, de bonheur ou de paix intérieure pour la <strong>religion</strong>), la <strong>religion</strong> possède une portée existentielleà laquelle les entreprises ne sauraient prétendre, quoi qu'en disent les slogans publicitaires.2. Mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> <strong>religion</strong> : antagonismes <strong>et</strong> similitudes des logiques d'actionDans son approche du marché, l'entreprise développe un certain nombre de techniques visant la connaissancedu consommateur, l'identification de ses besoins <strong>et</strong> la promotion des produits <strong>et</strong> servicesqu'elle lui destine. Alors que l'amalgame désir-besoin est un stratagème classique des professionnelsdu mark<strong>et</strong>ing, la force critique de la <strong>religion</strong> peut perm<strong>et</strong>tre aux consommateurs d'identifier leurs« vrais » besoins, pour ne pas les confondre avec ce qui est de l'ordre du simple désir. L'éthique dontles grandes <strong>religion</strong>s sont porteuses, pourrait donc perm<strong>et</strong>tre d'ajuster les comportements de consommationgrâce à un travail de discernement.2.1 Le regard des <strong>religion</strong>s sur la consommationSur ce plan, les <strong>religion</strong>s peuvent être une instance critique à l'égard de la société de consommation.En eff<strong>et</strong>, elles sont toutes porteuses d'une anthropologie : au-delà de la simple dimension biologique,elles proposent une conception de l'homme qui explicite sa vocation.Ainsi l'anthropologie chrétienne, telle qu'elle apparaît dans le livre de la Genèse, affirme : la dignité inaliénable de la personne humaine, dont la racine <strong>et</strong> la garantie se trouvent dans ledessein créateur de Dieu la socialité constitutive de l'être humain avec pour prototype la relation originelle de l'homme<strong>et</strong> la femme, dont la société est expression première de la communion des personnes (§37 duCompendium de la doctrine sociale de l'Eglise)Le fait que l'Homme soit créé à l'image de Dieu lui confère une vocation particulière qui va donnerune coloration à sa façon d'être « dans le monde ». En eff<strong>et</strong>, le principe d'unité de la personne humaine(corpore <strong>et</strong> anima unus) ne perm<strong>et</strong> pas de séparer chez une personne ses dimensions croyante,physique, professionnelle, citoyenne... Aussi, son appartenance religieuse rejaillit sur ses comportementsde tous les jours, notamment sur sa vie professionnelle ou sa consommation. C'est vrai des ca-7
tholiques, mais ce principe d'unité qui conduit à affirmer que la vie au travail est aussi un « lieu desanctification » se r<strong>et</strong>rouve dans les autres <strong>religion</strong>s qui reconnaissent au travail une valeur constructivepour la personne humaine. De la même manière, les éthiques religieuses confèrent aux actes deconsommation une portée morale si ce n’est directement religieuse. Ainsi l'encyclique Caritas in Veritate(Benoît XVI, 2009) affirme que « la consommation <strong>et</strong> toutes les autres phases du cycle économiqueont inéluctablement des implications morales » (§37) De ce fait, on trouve dans les <strong>religion</strong>sun discours critique sur la société de consommation : « Le phénomène de la société de consommationmaintient une orientation persistante vers « l'avoir » plutôt que vers l'être. Il empêche de distinguercorrectement les formes nouvelles <strong>et</strong> les plus élevées de satisfaction des besoins humains... » (Compendiumde la doctrine sociale de l'Eglise, §360). Dans le cadre de l’islam <strong>et</strong> du judaïsme, c<strong>et</strong>te codificationde la consommation est particulièrement visible au niveau des interdits alimentaires donc lafonction est de sacraliser le monde dans lequel nous vivons en y introduisant un ordre spécifique quidistingue le licite de l'illicite (Bouard, 2005).Cavanaugh (2007) discute la notion de libre marché en adoptant la perspective de la théologie politiquechrétienne. En se référant à Friedman, il montre que la liberté du marché est une liberté négative,au sens ou elle signifie que les intervenants du marché sont protégés de toute ingérence lorsqu'ilseffectuent des transactions. Mais, le « marché libre » n'a aucun telos, c'est à dire qu'« il n'y apas de fins communes auxquelles nos désirs puissent être ordonnés. En l'absence de telles fins, toutce qui reste c'est le pur pouvoir arbitraire d'une volonté contre une autre » (p.28). Le marché estdonc libre parce que les gens consomment ce qu'ils veulent. Mais l'origine <strong>et</strong> la justifications des besoinsou des désirs importent peu. Pour les tenants du libre marché, il est vain de chercher à distinguerles besoins authentiques <strong>et</strong> les besoins artificiels. La question de la légitimité ou de l'origine dubesoin ne se pose pas. Pour l'économiste, peu importe que l'on consomme des armes à feu, des boitesde conserve ou des tapis de prière, seul compte le profit qui en résulte. Mobilisant l'analyse du désirchez Augustin d'Hippone, Cavanaugh récuse l'idée que la volonté puisse fonctionner de façon autonome,<strong>et</strong> partant, que le marché soit vraiment libre. En eff<strong>et</strong>, « la liberté ne se réduit pas à une « libertéde », mais à une « liberté pour », la capacité d'atteindre des buts valables ». La conception augustiniennede la liberté est indissociable d'un telos, qui est le r<strong>et</strong>our à Dieu. « La liberté est doncpleinement une fonction de la grâce de Dieu agissant en nous.[...] l'être n'est pas autonome. »(p. 38).Aussi, désirer un obj<strong>et</strong> coupé de ses fins est un désir de rien. En l'absence de telos, la quête du consommateurpour satisfaire ses besoin devient une quête sans fin. Désireux de tout, le consommateurn'est comblé par rien. C<strong>et</strong>te soif de consommer est bonne pour le commerce mais ne contribue pas àla construction <strong>et</strong> l'épanouissement de l'être. C<strong>et</strong>te analyse qui pose la question de la finalité de laconsommation, ne vise pas à dicter les besoins des individus comme cherchait à le faire l'économieplanifiée, mais interroge les fondements de la société de consommation. Elle fournit une clé de compréhension<strong>et</strong> une raison d'être aux mouvements prônant la simplicité volontaire ou un mode de vieplus frugal. Fort de tels fondements théologiques, ces proj<strong>et</strong>s ne sont plus vécus comme une démarchesacrificielle pour le salut de la planète, mais comme l'occasion de redonner sens à la consommation<strong>et</strong> de privilégier la croissance de l'être par rapport à l'instinct d'accumulation.2.2 Le marché comme <strong>religion</strong>Le matérialisme porté à son paroxysme <strong>et</strong> dénoncé par des sociologues critiques tels que Schor(2004) pour sa capacité à endoctriner les individus dès leur plus jeune âge, menace la vie spirituelleen entrant en concurrence avec elle ou en récupérant la <strong>religion</strong> à travers un processus de marchandisationmis en évidence par Miller (2004). L'économie <strong>et</strong> la société de consommation se présententcomme des <strong>religion</strong>s de substitution. La <strong>religion</strong> a pour fonction sociale d'indiquer à l'homme cequ'est le monde <strong>et</strong> quelle est sa place dans le monde. Or, il semble que le déclin du religieux dans sesformes institutionnelles classiques soit compensé par l'avènement d'une société de consommation8
(Baudrillard, 1970), fondée sur un certain nombre d'axiomes tels que « plus = mieux » ou « nouveau= bien ». C<strong>et</strong>te société génère « une suractivation du besoins, du besoin de besoins, de l'envie, del'envie d'envies, du désir <strong>et</strong> du désir de désirs, présentés comme la nature même du citoyen normal »(Brune, 2006). On assiste donc à une évolution de la conception de l'homme en occident : on passed'une vision chrétienne de l'homme, créé à l'image <strong>et</strong> à la ressemblance de Dieu <strong>et</strong> appelé à l'Amour àune vision marchande de l'Homme, simple machine à consommer. Ce basculement peut être interprétécomme une prise de pouvoir de la sphère marchande sur la vie sociale. Au point que la <strong>religion</strong>dominante aujourd'hui s'apparente à un culte de l'argent. C<strong>et</strong> amalgame entre Dieu <strong>et</strong> la richesse s<strong>et</strong>rouve déjà dans l'Ancien Testament, où l'on voit le peuple hébreux tenté à plusieurs reprise de rendreun culte à Mammon (mot araméen signifiant richesse). Pourtant, la sagesse biblique prévient que«celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent <strong>et</strong> celui qui aime la richesse n'en profite pas»(Ecclésiaste 5,10). C<strong>et</strong>te sentence est corroborée par la psychologie de l'argent qui a bien identifiée ladépendance potentielle des individus à l'argent <strong>et</strong> aux possessions. Certaines initiatives militantes,telles que « l'Eglise de la très sainte consommation » 4 en France ou les diatribes du révérend Billydans les hauts-lieux de la consommation nord-américains 5 stigmatisent, de façon décalée, ce passaged'un culte divin à un culte de l'argent. L’Evangile affirme à c<strong>et</strong> égard qu'on ne peut « servir deuxmaîtres, car on haïra l'un <strong>et</strong> on aimera l'autre, on s'attachera à l'un <strong>et</strong> on méprisera l'autre : vous nepouvez servir Dieu <strong>et</strong> Mammon » (Luc 16, 13). C<strong>et</strong>te mise en garde face au caractère dévorant de lasociété de consommation qui éloigne l'homme de toute transcendance se r<strong>et</strong>rouve dans toutes les confessions: le Coran dit « Ô vous qui croyez ! Ne vous interdisez pas les bonnes choses que Dieu arendues licites pour vous, en évitant cependant tout excès, car Dieu n'aime pas les outranciers » (5,87). David Loy (1996) intellectuel bouddhiste, présente pour sa part le marché comme une <strong>religion</strong> <strong>et</strong>l'économie comme sa théologie 6 . Sans réfuter l'usage des biens de ce monde, les <strong>religion</strong>s font officede garde-fou, invitant l'Homme à un usage raisonné des biens « de ce monde » <strong>et</strong> à un équilibre dansla répartition des richesses.2.3 Le mark<strong>et</strong>ing religieux tourné vers les consommateurs musulmansNotre questionnement sur les liens entre mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> <strong>religion</strong> trouve une actualité particulière avecl'évolution de la société française dans laquelle la population musulmane tend à s'affirmer : non seulementnumériquement 7 mais aussi à travers ses revendications quant à la possibilité de vivre ouvertementsa foi au quotidien, notamment à travers la consommation. Prenant à contre-pied l'analyse deGauch<strong>et</strong> sur la sortie de la <strong>religion</strong>, l'Islam imprègne largement les modes de vie <strong>et</strong> de pensée des fidèles.Aussi, la <strong>religion</strong> musulmane encadre-t-elle la vie quotidienne, tant sur le plan personnel quecollectif, par le biais de la charia. Sa mise en œuvre par les individus dépend de l'interprétation quiest faite de la loi coranique <strong>et</strong> du degré de pratique des personnes. Toujours est-il que l'on voit se développeren France des actions commerciales orientées spécifiquement vers les consommateurs musulmans.De telles opérations existent aussi en direction des consommateurs juifs mais sont quasiinexistantesà l'égard des chrétiens car leur foi n'implique pas de mode de consommation spécifique(sur le plan commercial, Noël <strong>et</strong> Pâques ont avant tout un caractère culturel, comme en témoigne laconcurrence que le Père Noël fait au « p<strong>et</strong>it Jésus »). Nous illustrerons l'émergence d'un mark<strong>et</strong>ing àcaractère religieux à travers le marché de la nourriture halal <strong>et</strong> de la finance islamique.4 http://www.consomme.org5 http://www.revbilly.com6 http://www.zen-occidental.n<strong>et</strong>/articles1/loy9.html7Selon l'étude du Pew Research Center de Washington sur « le futur de la population musulmane globale », ils représentent 7,5% de la populationfrançaise en 2010 <strong>et</strong> seront 10,3% en 20309
Le marché du halal, qui n'était jusque là qu'un marché de niche, se développe rapidement <strong>et</strong> se banalisecomme le montre la création de lignes de produits halal par les acteurs de l’agroalimentaire ou dela grande-distribution (Wassila pour Casino <strong>et</strong> Carrefour Halal pour Carrefour). Connaissant unecroissance à deux chiffres depuis des années, ce marché a représenté plus de 5 milliards € de chiffred'affaires en 2010 (soit le double du marché du bio). Si le potentiel est très prom<strong>et</strong>teur avec 6 millionsde clients potentiels, la communication autour du halal est encore délicate <strong>et</strong> pose question auxentreprises qui s'y intéressent. Le r<strong>et</strong>entissement de l'affaire Quick (qui a décidé en 2010 que 22 deses restaurants ne serviraient que de la viande halal) montre combien le suj<strong>et</strong> est sensible puisque laquestion du communautarisme n'est jamais loin <strong>et</strong> qu'une hostilité latente à l'égard des pratiques religieusespeut être constatée (la campagne de la Fondation Brigitte Bardot en janvier 2011 pour dénoncerl'abattage rituel des animaux est symptomatique de c<strong>et</strong>te hostilité). Pour les distributeurs, il s'agitd'adopter un positionnement habile entre une stratégie commerciale flattant les communautarismes <strong>et</strong>un déni des attentes religieuses des consommateurs. En même temps, les entreprises s'orientant versle marché du halal sont confrontées au choix du label de certification dont la transparence est encoreassez controversée.Développé initialement pour satisfaire les épargnants <strong>et</strong> investisseurs du monde musulman, le lancementd'une offre à destination des particuliers de services financiers conformes à la charia est actuellementà l'étude en France. Les établissements bancaires qui s'y intéressent doivent acquérir des compétencesspécifiques, établir des partenariats avec les autorités religieuses capables de garantir la conformitédes produits <strong>et</strong> enfin former la force de vente. Le potentiel est prom<strong>et</strong>teur, d'autant que lesprincipes directeurs de la finance islamique sont assez vertueux dans la mesure où ils évitent certainesdérives financières qui ont terni l'image du secteur ces dernières années. Pourtant, il n'existepas d'offre à ce jour pour satisfaire une demande latente que l'étude de AIDIMM / IFAAS 8 à estimé a1 millions de particuliers musulmans qui seraient prêts, dans les 6 mois à souscrire un ou plusieursproduits. L'adoption d'un cadre législatif favorable à la finance islamique <strong>et</strong> le succès général des filièreshalal encourage les acteurs du secteur bancaire français à se lancer. A l'heure où la banque dedétail se préoccupe de reconquérir la clientèle particulière, la finance islamique offre aux réseauxbancaires une opportunité de différenciation qui pourrait séduire un nombre conséquent de particuliers.On remarque à travers ces deux exemples que le comportement du consommateur musulman estétroitement lié à des valeurs <strong>et</strong> des normes directement liées aux prescriptions religieuses. L'approchemark<strong>et</strong>ing de la clientèle musulmane doit tenir compte d'un certain nombre de traits culturels spécifiques(rapport aux autres, à la pudeur <strong>et</strong> à la rigueur morale, besoin de normes, rapport au monde <strong>et</strong>au temps....) que Pras <strong>et</strong> Vaudour-Lagrace ont mis en évidence (2007). Ils soulignent néanmoins quecertaines nuances sont à apporter selon les pays <strong>et</strong> les époques considérées. La modernisation desclasses moyennes musulmanes favorise un « islam de marché » qui entr<strong>et</strong>ient un rapport décomplexéà la société de consommation dès lors que l'éthique musulmane est respectée.Qu'ils soient considérés par les fabricants comme des produits ordinaires, ou qu'ils fassent l'obj<strong>et</strong> d'unmark<strong>et</strong>ing spécifique, tous les produits qui sont vendus en tenant compte d'une dimension religieuse,renvoient au « mark<strong>et</strong>ing religieux » (faith based mark<strong>et</strong>ing) qui est particulièrement de mise lorsqu'onveut satisfaire une clientèle musulmane dont le mode de consommation déborde le strict respectde préceptes religieux mais doit être appréhendé plus largement en terme de style de vie, tant ilm<strong>et</strong> en jeu la construction identitaire de l'individu.8finance islamique 2011 » <strong>Quels</strong> marchés <strong>et</strong> quelles opportunités pour la banque de détail? » voir :http://www.aidimm.com/articles/finance-islamique-en-france-rapport-2011-exclusif_128.html10
3. Divine publicitéLa publicité est un phénomène intéressant à considérer car si le mark<strong>et</strong>ing était un iceberg, la publicitéen serait la partie émergée. En ce qui concerne le lien mark<strong>et</strong>ing/<strong>religion</strong>, la publicité est donc révélatricede ce que les entreprises sont prêtes à dire en matière de <strong>religion</strong>. Pour simplifier, nous distinguerons3 formes de publicité mobilisant la <strong>religion</strong>:Nature du lien entre la publicité <strong>et</strong> la <strong>religion</strong>L'utilisation de symboles religieux dans despublicités pour des produits n'ayant aucuncaractère religieuxExemples-Ben<strong>et</strong>ton dans le registre de la provocation,- Don Patillo (Panzani) dans celui de la sympathie,- Le recours au registre du péché/désir dans le parfumL'utilisation par les <strong>religion</strong>s des techniquespublicitaires<strong>et</strong> de communication pour promouvoir leur discoursou leur image.-le mark<strong>et</strong>ing social de l'Eglise (denier de l'Eglise, Service des vocations<strong>et</strong>c..., )-Aux Etats-Unis, les « mega churchs » ont poussé très loin le recoursau mark<strong>et</strong>ingL'utilisation du mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> de la publicitépour promouvoir des produits à caractèrereligieux (halal, les produits de fêtes religieuses,tourisme religieux,...)On peut distinguer des publicités pour :- des produits prescrits par la <strong>religion</strong> (nourriture halal/kasher, financeislamique,...),- des produits utiles à la pratique religieuse (obj<strong>et</strong>s de prière, pèlerinage,...)- des produits à connotation religieuse (œufs de Pâques, Mecca-cola,l'album de chansons populaires « prêtres »).C<strong>et</strong>te dernière catégorie touche un public plus large qui n'est pas uniquementconstitué de croyants.Tableau 1 : Typologie des publicités mobilisant la <strong>religion</strong>Nous reprendrons ces 3 catégories pour les expliciter en nous appuyant sur des visuels. C<strong>et</strong>te analyseprolonge un entr<strong>et</strong>ien semi-directif réalisée en mai 2011 avec Florent Sallard, professeur associé auCELSA <strong>et</strong> dirigeant d'une agence de conseil en stratégie de marque.3.1 Recours au religieux pour la promotion de produits profanes11
Image 1 : Publicité « Convaincre » d'autopromotion de l'agence BDDP & Fils en 2002C<strong>et</strong>te image fait partie d'une série de 3 visuels 9 m<strong>et</strong>tant en scène les 3 « grandes » <strong>religion</strong>s dans une situationscandaleuse : un rabbin se tartinant du pâté de porc, le pape s'ach<strong>et</strong>ant une boîte de préservatifsdans un distributeur <strong>et</strong> un moudjahidin, kalachnikov en bandoulière, se rasant la barbe.C<strong>et</strong>te série d'affiches fut créée pour promouvoir l'agence BDDP& Fils avec le slogan « des publicitésparticulièrement convaincantes ». D'après l'auteur de c<strong>et</strong>te campagne, la publicité a marqué les espritssans pour autant provoquer le scandale, car elle intervenait dans un climat social apaisé <strong>et</strong> que la signaturede la campagne indique d'emblée qu'il faut voir les visuels au second degré. Enfin, la campagnepréserve un certain équilibre, puisque les 3 <strong>religion</strong>s monothéistes sont tournées en dérision.Difficile de dire si une telle publicité serait acceptée aujourd'hui : même si le BVP donne un avispréalable, le publicitaire qui mobilise la <strong>religion</strong> dans son message doit réfléchir à la façon dont sacampagne sera reçue par le public car l'utilisation de symboles religieux peut susciter de vives réactions.Nous l'avons constaté récemment avec les protestations suscitées par la campagne « Unhate »lancée par Ben<strong>et</strong>ton en novembre 2011. C<strong>et</strong>te campagne représente des personnalités s'embrassantsur la bouche. Parmi toutes les affiches, c'est celle du pape Benoît XVI embrassant l'imam Ahmed ElTayyeb de l'université Al-Azhar, qui a été r<strong>et</strong>irée. Les affiches m<strong>et</strong>tant en scène les autres chefs d'Etatn'ont pas provoqué une polémique aussi vive, signe que les symboles religieux sont à manipuler avecprécaution.La publicité BDDP & Fils, témoigne de ce que la <strong>religion</strong> reste un réservoir de symboles forts, capablesd'être un point d'appui pour une argumentation implicite ou pour attirer l'attention. D'ailleursce sont plutôt des clichés qui ressortent : religieuses voilées <strong>et</strong> prêtres en soutane, usage du terme« Zen » pour évoquer le bien-être, <strong>et</strong>c. En fait, il s'agit plus d'une référence à un patrimoine culturelancré dans l'imaginaire collectif qu'une vraie récupération de valeurs religieuses à des fins publicitaires.En revanche, l'argumentation déployée pour vanter les produits s'appuie souvent sur des connotationspuissantes de l'univers religieux telles que la tentation, la transgression, le péché, le paradis,l'enfer... Ce registre fait réagir <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> dans certains cas de diviniser le produit. Une question reste9 http://www.bddpunlimited.com/campagnes/bddp-fils-convaincre12
en suspend à l'heure où la transmission religieuse est en crise : combien de temps encore les consommateursseront-ils capables de décrypter ces publicités?3.2 Quand les <strong>religion</strong>s croient en la publicitéLes <strong>religion</strong>s au premier rang desquelles, l'Eglise catholique ont recours aux techniques publicitairespour faire connaître leur message. Pour les média, c<strong>et</strong>te communication institutionnelle crée parfoisun malaise, au nom d'une supposée neutralité des organes de presse. Le 8 décembre 2010, le gratuit20 minutes de Lyon à refusé la diffusion d'une publicité pour la fête de la Lumière qui comportait uneprière à la Vierge Marie 10 . Ce refus paraît d'autant plus étonnant que c<strong>et</strong>te fête d'origine religieuse estcélébrée chaque année depuis des siècles à Lyon <strong>et</strong> que la municipalité prend part à ces festivités quiconstituent un temps fort de la vie culturelle lyonnaise. C<strong>et</strong> incident révèle en tout cas qu'un messagereligieux n'est pas encore perçu comme un message publicitaire classique.L'institution recourt aux campagnes publicitaires pour les questions qui concernent le grand public :grands rassemblements, financement de l'institution (campagne dite du « denier du culte ») ou pourrecruter des prêtres à l'heure où les vocations sacerdotales sont en crise.Image 2 : Campagne du Service National des Vocations en avril 2010 (Église Catholique)La publicité ci-dessus cherche à revaloriser aux yeux du grand public l'image du prêtre dont le statutsocial s'est dégradé. Elle a probablement aussi comme but secondaire de restaurer l'image de la« profession », fortement écornée par les affaires de pédophilie. Néanmoins, l'Eglise a été critiquéepour avoir utilisé dans c<strong>et</strong>te campagne des mannequins <strong>et</strong> non pas d'authentiques prêtres. Pour uneinstitution qui prône la vérité, le grand public s'attendait à ce qu'elle ne « triche » pas sur l'identité dela personne figurant sur l'affiche. D'autant plus que la mise en scène du personnel de l'entreprise dansle cadre d'une publicité institutionnelle est une pratique courante en communication. C<strong>et</strong> incidentmontre que la communication d'une institution religieuse n'est pas reçue comme n'importe quelleautre publicité.10 http://lyon.catholique.fr/?Ces-pages-que-vous-ne-lirez-pas13
A la faveur d'une intensification de la concurrence religieuse en occident <strong>et</strong> d'un processus de sécularisation,nous assistons à un regain d'intérêt des institutions religieuses pour le mark<strong>et</strong>ing, perçucomme un outil pouvant faciliter la transmission de leur message spirituel <strong>et</strong> un meilleur dialogueavec la société. L'idée d'utiliser des techniques de communication pour propager la « bonne parole »suscite quelques réticences en interne. La foi ne saurait être promue à la manière d'une lessive ou d'unnouveau forfait téléphonique... Peycelon (2009) directeur de l'Institut Pastoral d'Etudes Religieusesde Lyon montre néanmoins une volonté de dédramatiser le recours de l'Eglise à la publicité : « Quandles Eglises s'interrogent sur la capacité de propager la foi en recrutant de nouveaux fidèles […], lesouci d'efficacité introduit la question du mark<strong>et</strong>ing religieux dans le champ de la réflexion. On peutse récrier en récusant toute assimilation d'une Église à une entreprise mais ce serait oublier qu<strong>et</strong>outes les Eglises sont des organisations humaines justiciables à ce titre de la recherche en sciencessociales. Elles ne sont pas les seules organisations à but non lucratif qui proposent des biens de typesalvifique à une population (clientèle potentielle) envers laquelle elles se considèrent envoyées enmission. »L'usage de la publicité <strong>et</strong> plus largement le recours au mark<strong>et</strong>ing par l'Eglise pose néanmoins la questionde sa finalité. Est-ce l'auto-promotion de l'institution qui est visée ou la diffusion du messageévangélique? Par ailleurs, la reconnaissance d'un problème d'image stérilisant tout discours émanantde l'Eglise justifie une préoccupation pour « l'image de marque » de c<strong>et</strong>te institution. Par ailleurs, reconnaîtreque l'Eglise s'adresse à des publics distincts justifie qu'elle adapte son discours à chacun deses « publics cibles ». Pans c<strong>et</strong>te perspective, l'institution se livre clairement à une segmentation deson public. Il n'y a là rien de choquant pour Peycelon (2009) qui dresse un parallèle avec l'épisode dela Pentecôte, au cours duquel les apôtres reçoivent l'Esprit Saint. D'après l'Evangile, les auditeurs desapôtres entendent dans leur propre langue <strong>et</strong> non dans une langue universelle. Cela signifie qu'unedifférenciation du discours en fonction des publics était de mise dès l'origine.Consciemment ou non, toute <strong>religion</strong> fait du mark<strong>et</strong>ing à chaque fois qu'elle s'efforce de faire connaîtreun message à une cible. Même en l'absence de contrepartie financière, le fait qu'une réflexionsur l'efficacité du message soit menée relève d'une démarche de mark<strong>et</strong>ing. Les <strong>religion</strong>s agissentalors comme n'importe quelle organisation non marchande qui promeut une idée ou une cause. Laseule spécificité de la <strong>religion</strong> tient aux garde-fous déontologiques qu'elles s'imposent. Notammentpour ce qui touche au caractère plus ou moins offensif de la communication. Si l'Eglise catholique arenoncé au prosélytisme au nom d'un respect inconditionnel de la liberté religieuse de chacun (ce quine l'empêche pas de témoigner de sa foi), d'autres mouvements religieux comme les sectes sontmoins scrupuleux quant au recours à des techniques de communication ou de persuasion, qui peuventêtre assez intrusives voire manipulatoires.Enfin, les <strong>religion</strong>s s'avèrent très présents dans les nouveaux médias. Ceux-ci perm<strong>et</strong>tent une diffusionlarge du message selon une logique participative qui respecte l'anonymat de chacun. Intern<strong>et</strong>bouleverse les catégories traditionnelles qui perm<strong>et</strong>taient de penser la <strong>religion</strong> <strong>et</strong> rem<strong>et</strong> en questionles distinctions classiques entre privé/public, orthodoxe/hétérodoxe, religieux/séculier (Hack<strong>et</strong>t,2005)... La multiplication des portails communautaires comme www.oumma.com,www.eglise.catholique.fr ou www.protestants.org illustre le foisonnement d’initiatives communicantesde la part des courants religieux. C<strong>et</strong>te façon de communiquer est très en phase avec le polymorphismeque prend aujourd'hui l'expression religieuse, qui résulte plus d'un bricolage que d'un héritage(Hervieu-Léger, 1999). Certaines initiatives illustrent bien la manière innovante dont la <strong>religion</strong> ainvesti la toile : c'est la cas de la « R<strong>et</strong>raite dans la ville » 11 lancée par les Dominicains de France <strong>et</strong>qui propose aux internautes de vivre une r<strong>et</strong>raite de Carême en restant chez eux. C<strong>et</strong>te propositioninédite exploite tout le potentiel d'intern<strong>et</strong> (facebook, twitter, blog, musique, sites de visionnage, fo-11 http://www.r<strong>et</strong>raitedanslaville.org14
ums) pour proposer une offre non marchande de services spirituels : participation aux offices religieux,accompagnement spirituel, possibilité de faire des dons en ligne ou de déposer des intentionsde prières. En 2011, 53000 internautes se sont inscrits pour suivre la r<strong>et</strong>raite (40 jours).3.3 Promouvoir le caractère religieux des produitsL'émergence du mark<strong>et</strong>ing religieux a son corollaire : la publicité pour les biens <strong>et</strong> services portantune dimension religieuse. Cela a toujours existé mais passait par des canaux de diffusion spécialisés :presse religieuse, radios <strong>et</strong> chaînes confessionnelles. L'apparition de telles publicités dans les grandsmédias est une nouveauté dans le paysage publicitaire. Cela suppose que les annonceurs anticipent unpotentiel commercial suffisant ou voient dans la dimension religieuse une source de différenciationsuffisamment forte pour se démarquer de leurs concurrents. Ainsi, la publicité « fièrement halal » ades accents de coming out; comme si les entreprises osaient enfin parler d'un aspect jusque là tenusecr<strong>et</strong>. La publicité joue ici sur l'affirmation identitaire du consommateur qui pourra désormais assumersa foi à travers ses actes de consommation.image 3 : Campagne Isla Délice (6000 affiches) lancée en août 2010 à l'occasion du ramadanLa communication autour du halal (qui est souvent le fait de grands groupes agroalimentaires) veillecependant à ne pas enfermer le consommateur dans un « gh<strong>et</strong>to » religieux. C'est ainsi que la publicitétélévisuelle pour les plats Zakia halal m<strong>et</strong> en scène un jeune couple maghrébin au look moderne.Le slogan, quant à lui reste très basique (« Plats cuisinés Zakia halal, toujours un régal ») <strong>et</strong> n'insistepas sur le le caractère halal.Au niveau de la grande distribution, les enjeux en terme de communication se posent différemment :l'entr<strong>et</strong>ien que nous avons mené avec la directrice des études d'une enseigne de grande distribution 12souligne aussi c<strong>et</strong>te volonté de banaliser le produit <strong>et</strong> de ne pas enfermer le consommateur dans unecommunauté <strong>et</strong>hnique. Il s'agit en eff<strong>et</strong> pour c<strong>et</strong>te enseigne de ne m<strong>et</strong>tre en avant aucune communautéafin que ses magasins continuent d'accueillir une clientèle diversifiée. Si c<strong>et</strong>te enseigne propose du12 Entr<strong>et</strong>ien téléphonique mené en mai 201115
halal dans ses rayons, c'est seulement parce qu'une demande existe. Mais elle a renoncé à lancer unemarque de distributeur (MDD) halal, jugeant prioritaire <strong>et</strong> plus légitime par rapport à sa mission deservice du consommateur, de proposer une MDD de produits adaptés pour les personnes allergiques.Le groupe Casino, fidèle à sa signature « nourrir un monde de diversité » a un parti pris plus marquéen faveur des consommateurs musulmans. On peut illustrer c<strong>et</strong> engagement par le lancement d'uneMDD halal <strong>et</strong> d'un portail intern<strong>et</strong> consacré au halal (www.wassila.fr), ou l'aménagement d'un espacede 450m2 de produits halal dans son hypermarché de Roubaix 13 . On assiste donc à des stratégies decommunication plus ou moins audacieuses quant à la reconnaissance de la dimension religieuse desproduits. Par exemple l'enseigne Auchan, qui a conçu un catalogue spécial à l'occasion du ramadan2009 l'a intitulé simplement «saveurs orientales». Le site Al kanz (observatoire de la consommationmusulmane 14 ) a cru y voir la volonté de ne pas reconnaître le caractère religieux de c<strong>et</strong>te fête.Qu'il s'agisse de halal ou d'autres produits religieux (tourisme spirituel, édition religieuse,...) le discourspublicitaire s'efforce de ménager les sensibilités laïques, en considérant comme traditionnels ouculturels des produits qui sont au départ religieux. Ainsi, les opérations spéciales qui rythment la viedes supermarchés font une bonne place aux fêtes religieuses. Les magasins fêtent Pâques, Noël, lenouvel an Chinois, Ramadan... <strong>et</strong> parfois Pessah. Chez Auchan, ces fêtes religieuses qui perm<strong>et</strong>tentd'animer les grandes surfaces s'inscrivent dans le « calendrier de la vie » de l'enseigne où se succèdentaussi bien des fêtes religieuses que la rentrée des classes, la fête du printemps ou la foire auxvins. La dilution du caractère religieux des produits dans la communication des entreprises est aussiun moyen d'élargir la cible. Par ce biais, les produits de la finance islamique pourraient donc êtrevendus comme des placements socialement responsables à une clientèle non-musulmane parexemple. De la même manière, en communiquant sur son coté mythique plutôt que sur son côté mystique,le chemin de Saint Jacques de Compostelle pourra être proposé non seulement aux pèlerinsmais aussi à tout marcheur désireux de vivre une belle expérience humaine, sportive <strong>et</strong> culturelle.ConclusionC<strong>et</strong>te étude du rapport réciproque entre l'entreprise <strong>et</strong> la <strong>religion</strong> en partant d'un panorama généralpour nous focaliser ensuite sur le mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> la publicité montre combien les liens entre ces deuxdomaines sont nombreux <strong>et</strong> riches. Le fameux « r<strong>et</strong>our du religieux » toucherait donc non seulementla politique mais aussi l'entreprise <strong>et</strong> la société de consommation. Si on laisse de coté les aspects particuliersde la foi, les <strong>religion</strong>s offrent un point de vue critique stimulant pour penser l'entreprise, sonfonctionnement <strong>et</strong> sa communication. Contrairement à ce que pourrait laisser penser une vision austèredes <strong>religion</strong>s, celles-ci ne condamnent pas la consommation mais seulement ses excès quantitatifs(quand la possession devient une fin en soi) ou qualitatif (par rapport à certains interdits religieux).Les <strong>religion</strong>s peuvent avoir des propos clairs <strong>et</strong> pénétrants sur le monde professionnel ou lesgrands enjeux économiques. Ils émanent soit de certains penseurs ayant une double compétence religieuse<strong>et</strong> technique (management, finance, technologique...), soit directement de textes officiels quiexpriment la doctrine de tel ou tel courant religieux. C'est le cas par exemple de la doctrine sociale del'Eglise catholique, résumée dans un document synthétique (« le compendium de la doctrine socialede l'Eglise » 15 ). Il perm<strong>et</strong> d'accéder rapidement aux thèmes sur les<strong>quels</strong> on désire avoir un éclairagedoctrinal. Ce corpus a beau être fondé sur des principes religieux, les textes traitent de suj<strong>et</strong>s concr<strong>et</strong>s13 http://www.nordeclair.fr/Locales/Roubaix/2011/04/07/geant-le-second-souffle.shtml14 http://www.al-kanz.org15 Accessible en ligne : http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendiodott-soc_fr.html16
comme l'impact du tourisme sur le développement local, la légitimité des OGM, la toxicité de certainsproduits financiers, les délocalisations (Benoît XVI, 2009).Notre travail nous confronte inévitablement à la difficulté d'appréhender un concept tel que la <strong>religion</strong>qui n'a rien de monolithique : chaque <strong>religion</strong> présente des visages différents selon le contextehistorique <strong>et</strong> culturel dans lequel elle se trouve. En outre, les croyants d'une même <strong>religion</strong> peuventavoir des sensibilités <strong>et</strong> une manière d'exprimer leur foi très différente. Une limite de ce travail estdonc d'avoir raisonné à partir de généralités sur les <strong>religion</strong>s qui ne correspondent pas toujours exactementà ce qui se vit ici ou là dans les entreprises.Nous pensons que la question des <strong>r<strong>apports</strong></strong> entre <strong>religion</strong> <strong>et</strong> entreprise mérite d'être approfondie carces deux domaines peuvent s'apporter mutuellement. Leur dialogue mérite donc d'être poursuivi, notammentdans le but de clarifier leurs <strong>r<strong>apports</strong></strong> qui s'avèrent souvent ambigus. Du côté de la rechercheen sciences de gestion, ce dialogue suppose que des chercheurs s'intéressent aux <strong>religion</strong>s <strong>et</strong> trouventdes lieux <strong>et</strong> des occasions pour échanger avec les croyants ou les institutions religieuses (forums, associations,groupes de réflexions).C<strong>et</strong>te recherche exploratoire, focalisée sur les liens entre le mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> la <strong>religion</strong>, pourrait être approfondie<strong>et</strong> complétée. Une voie de recherche stimulante pour m<strong>et</strong>tre en lumière la façon dont lesaspirations religieuses habitent les actes de consommation consisterait à observer <strong>et</strong> analyser la consommationde services funéraires. Puisque la mort d'un proche nous renvoie à notre vison de l'audelà,les obsèques (cérémonie, soins, hommage, enterrement ou crémation) sont une occasion privilégiéed'observer comment le sentiment religieux s'exprime à travers des actes de consommation.D'autres part, c<strong>et</strong>te recherche pourrait être complétée en analysant comment les autres domaines dessciences de gestion (finance, management, comptabilité, stratégie...) appréhendent les problématiquesayant une dimension religieuse. Un tel travail perm<strong>et</strong>trait aux chercheurs de mieux cerner un certainnombre de questions qui ne sont aujourd'hui qu'imparfaitement comprises dans la mesure où la <strong>religion</strong>a été réduite à une simple variable culturelle alors qu'elle reste une dimension structurante dessociétés modernes, y compris dans celles qui ont connu un processus de sécularisation.17
BibliographieBanon P. (2005) Dieu <strong>et</strong> l'entreprise, Editions de l'organisationBaudrillard J.(1970) La société de consommation, Gallimard (ed.1996)Benoît XVI (2009) Caritas in Veritate, CerfBeitone, A., Cazorla, A., Dollo, C. & Drai, A.M. (2001) Dictionnaire des sciences économiques,Armand ColinBelk R, Wallendorf M., Sherry J.F. (1989) « The sacred and the profane in consumer bahavior :Theodicy on the Odissey », Journal of Consumer Research, 16, 1, 1-38Bessire D., Mesure H.(2009) « Penser l'entreprise comme communauté : fondements, définition <strong>et</strong>implications » Management <strong>et</strong> Avenir, 10, 30, 30-50Bouard I. (2005) « Regard anthropologique sur les interdits alimentaires », Les Cahiers Dynamiques,1, 33, 25-26Bouzar D., Bouzar L. (2009) Allah a-t-il sa place dans l'entreprise? Albin MichelBrune, F. (2005) « Pour une société de frugalité : quelques lignes de position », De l'idéologie aujourd'hui,Paris, Parangon,163-169Camus S. Poulain M. (2008) « La spiritualité : émergence d'une tendance dans la consommation »,Management <strong>et</strong> Avenir, 19, 5, 72-90Cavanaugh W. (2007) Etre consommé, Editions de l'Homme NouveauGauch<strong>et</strong> M.(1985) Le désenchantement du monde, une histoire politique de la <strong>religion</strong>, GallimardGranov<strong>et</strong>ter M.(1985) « Economic action and social structure : the problem of embeddedness »,American Journal of Sociology, 91, 481-510Hack<strong>et</strong>t R.I.J. (2005) « Religion <strong>et</strong> Intern<strong>et</strong> », Diogène, 211, 3Hervieu-Léger (2003) « La <strong>religion</strong>, mode de croire », revue du MAUSS, 22, 2, 144-158Landrevie J., Levy J. (2009) Mercator, Théorie <strong>et</strong> pratiques du mark<strong>et</strong>ing, Edition 2010, DunodLindstrom M. (2008) Buyology, truh and lies about what we buy, Broadway BusinessMaigre M.H. (2005) « L'émergence d'une « éthique musulmane » dans le monde des affaires turc :réflexion autour de l'évolution du MUSIAD », Religioscope, Etudes <strong>et</strong> Analyses, 7, 1-26Miller V.J. (2004) Consuming <strong>religion</strong> : christian faith and practice in a consumer culture, Continuum,NYRoy O. (2002) Islam mondialisé, SeuilPeycelon J. (2009) « L’Évangile au risque du Mark<strong>et</strong>ing », Spiritus Revue d'expériences <strong>et</strong> richessesmissionnaires, 193, 409-421Pras B., Vaudour-Lagrace C. (2007) « Mark<strong>et</strong>ing <strong>et</strong> Islam », Revue Francaise de Gestion, 171, 2,195-223Renouard C. (2011) « Vie en entreprise <strong>et</strong> vie spirituelle », Etudes, 6, 751-762Riley A. (2011) Secr<strong>et</strong>s of superbrands, documentaire pour la BBCRobert-Demontrond P. (2007) Anthropologie du sacré <strong>et</strong> sciences de gestion, ApogéeSchor J.B.(2004) Born to buy : the commercialized child and the new consumer culture, ScribnerTodeschini G. (2008) Richesse Franciscaine, de la pauvr<strong>et</strong>é volontaire à la société de marché, VerdierVall<strong>et</strong> O. (2003) Par les quatre horizons qui crucifient le monde, Tropique, 85, 4, 7-1118
Weber M. (1964) L’éthique protestante <strong>et</strong> l'esprit du capitalisme, Pock<strong>et</strong> (ed. 1995)19