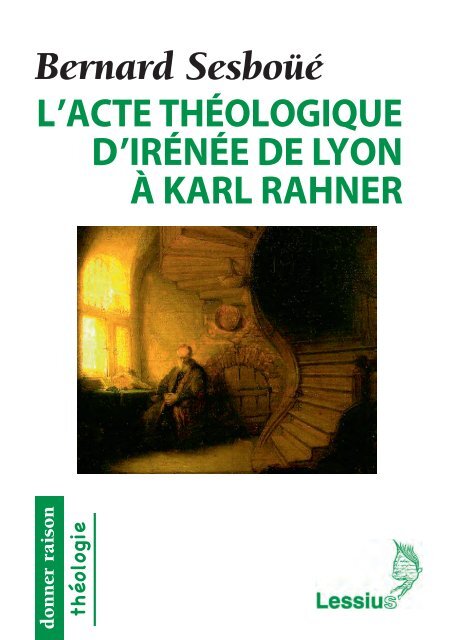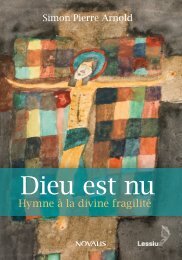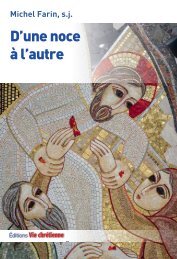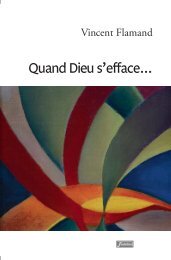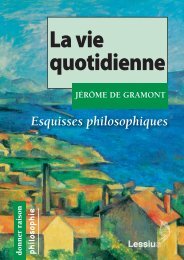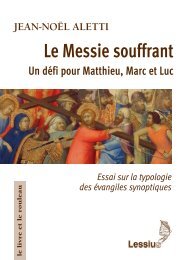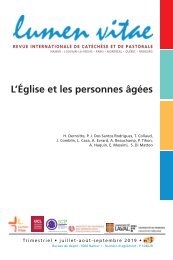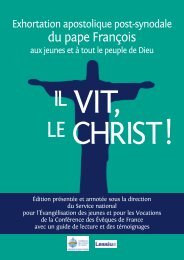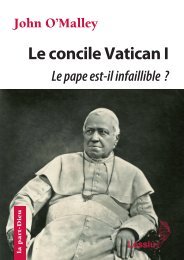L’acte théologique d’Irénée de Lyon à Karl Rahner. Les grandes créations en théologie chrétienne
Un acte théologique, comme son nom l’indique, est un faire, un agir, une création. Quelque chose advient qui n’existait pas. Un auteur, par la qualité de son travail, a fait avancer l’intelligence théologique sur un point jusque là incertain ou controversé. La découverte d’un déplacement et une problématique nouvelle chan- gent la situation antérieure et ouvrent des voies encore inconnues. Le progrès est si parlant qu’il s’impose et provoque, d’emblée ou lentement, une large unanimité. La réception par la communauté des théologiens et plus encore par l’Église est donc indispensable à la réalisation d’un acte théolo- gique. Nul ne peut prétendre qu’il a accompli un acte théologique, comme nul ne peut se prétendre prophète au nom de son propre charisme. Mais les autres, analysant telle ou telle doctrine, peuvent y voir ce qui va devenir un acte théologique. Celui-ci suppose toujours sa propre réception. L’important ici n’est pas d’abord le texte mais l’existence d’une idée créatrice. L’ouvrage est divisée en 4 sections : 1. Section patristique : Irénée, Origène, Basile de Césarée, Augustin; 2.Le Moyen Âge occidental: Boèce, Thomas d’Aquin ; 3. Les Temps modernes : Luther, le concile de Trente, Bellarmin, Petau ; 4. Du XIXe siècle à l’époque contemporaine : Möhler, Newman, le Modernisme, le concile Vatican II, Rahner. Ce livre renouvelle profondément la façon d’envisager l’histoire de la théologie, voire la théologie tout court. En outre, il ouvre de nombreuses pistes à toute personne intéressée par l’histoire des idées.
Un acte théologique, comme son nom l’indique, est un faire, un agir, une création. Quelque chose advient qui n’existait pas. Un auteur, par la qualité de son travail, a fait avancer l’intelligence théologique sur un point jusque là incertain ou controversé. La découverte d’un déplacement et une problématique nouvelle chan- gent la situation antérieure et ouvrent des voies encore inconnues. Le progrès est si parlant qu’il s’impose et provoque, d’emblée ou lentement, une large unanimité.
La réception par la communauté des théologiens et plus encore par l’Église est donc indispensable à la réalisation d’un acte théolo- gique. Nul ne peut prétendre qu’il a accompli un acte théologique, comme nul ne peut se prétendre prophète au nom de son propre charisme. Mais les autres, analysant telle ou telle doctrine, peuvent y voir ce qui va devenir un acte théologique. Celui-ci suppose toujours sa propre réception. L’important ici n’est pas d’abord le texte mais l’existence d’une idée créatrice.
L’ouvrage est divisée en 4 sections : 1. Section patristique : Irénée, Origène, Basile de Césarée, Augustin; 2.Le Moyen Âge occidental: Boèce, Thomas d’Aquin ; 3. Les Temps modernes : Luther, le concile de Trente, Bellarmin, Petau ; 4. Du XIXe siècle à l’époque contemporaine : Möhler, Newman, le Modernisme, le concile Vatican II, Rahner.
Ce livre renouvelle profondément la façon d’envisager l’histoire de la théologie, voire la théologie tout court. En outre, il ouvre de nombreuses pistes à toute personne intéressée par l’histoire des idées.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bernard Sesboüé<br />
L’ACTE THÉOLOGIQUE<br />
D’IRÉNÉE DE LYON<br />
À KARL RAHNER<br />
donner raison<br />
<strong>théologie</strong>
Bernard SESBOÜÉ, s.j.<br />
<strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong><br />
<strong>d’Irénée</strong> <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong><br />
<strong>à</strong> <strong>Karl</strong> <strong>Rahner</strong><br />
<strong>Les</strong> gran<strong>de</strong>s <strong>créations</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>théologie</strong> chréti<strong>en</strong>ne
Donner raison – <strong>théologie</strong>, 59<br />
Une collection dirigée par<br />
Hubert Jacobs s.j. et Robert Scholtus<br />
© 2017 Éditions jésuites,<br />
7, rue Blon<strong>de</strong>au, 5000 Namur (Belgique)<br />
14, rue d’Assas, 75006 Paris (France)<br />
www.editionsjesuites.com<br />
ISBN : 978-2-87299-300-0<br />
D 2017/4255/5
INTRODUCTION<br />
Tout le mon<strong>de</strong> sait ce qu’est un acte médical : l’interv<strong>en</strong>tion d’un<br />
mé<strong>de</strong>cin ou d’un ag<strong>en</strong>t <strong>de</strong> santé, ayant pour but d’améliorer l’état<br />
d’un mala<strong>de</strong> ou d’un pati<strong>en</strong>t. Un acte médical ne se réduit pas normalem<strong>en</strong>t<br />
<strong>à</strong> un échange <strong>de</strong> paroles. Il compr<strong>en</strong>d une série <strong>de</strong> gestes<br />
<strong>de</strong>stinés <strong>à</strong> changer l’état du mala<strong>de</strong>.<br />
On constate aujourd’hui l’émerg<strong>en</strong>ce du même vocabulaire <strong>à</strong><br />
propos <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong>. En 1998 j’avais donné comme sous-titre <strong>à</strong><br />
mon livre concernant Saint Basile et la Trinité la m<strong>en</strong>tion suivante :<br />
Un acte <strong>théologique</strong> au ive siècle 1 . Je voulais souligner par l<strong>à</strong> que ce<br />
Père cappadoci<strong>en</strong> avait fait avancer la recherche ecclésiale sur la<br />
Trinité <strong>de</strong> manière décisive et particulièrem<strong>en</strong>t fécon<strong>de</strong>, <strong>à</strong> partir <strong>de</strong><br />
sa réflexion sur la relation. Cette expression fait son chemin dans le<br />
langage <strong>théologique</strong> d’aujourd’hui. Est-il possible <strong>de</strong> préciser son<br />
s<strong>en</strong>s et peut-être d’analyser les raisons <strong>de</strong> son émerg<strong>en</strong>ce ?<br />
D’une certaine manière tout écrit <strong>théologique</strong> peut rev<strong>en</strong>diquer<br />
d’être un acte <strong>théologique</strong>, au même titre qu’une consultation chez<br />
le mé<strong>de</strong>cin aboutit <strong>à</strong> un acte médical. Qu’il s’agisse d’une <strong>en</strong>quête<br />
historique ou d’une réflexion spéculative, son auteur a pour but <strong>de</strong><br />
faire avancer par sa recherche la connaissance <strong>théologique</strong>. À la<br />
mesure <strong>de</strong> la fécondité <strong>de</strong> son travail, il a posé un « acte théolo-<br />
1. B. Sesboüé, Saint Basile et la Trinité. Un acte <strong>théologique</strong> au ive siècle, Desclée,<br />
Paris, 1998.
6 Introduction<br />
gique ». Mais on peut aussi considérer la chose <strong>de</strong> manière plus précise<br />
et rejoindre ainsi la raison <strong>de</strong> l’ext<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> cette expression<br />
dans le vocabulaire réc<strong>en</strong>t. Tout article ou tout livre n’est pas un<br />
acte <strong>théologique</strong> dans le s<strong>en</strong>s que l’on va essayer <strong>de</strong> décrire.<br />
Le concile <strong>de</strong> Vatican II a bi<strong>en</strong> mis <strong>en</strong> lumière que la révélation<br />
divine aux hommes <strong>en</strong> Jésus-Christ ne passe pas seulem<strong>en</strong>t par <strong>de</strong>s<br />
paroles, mais aussi par <strong>de</strong>s actes. Tout le comportem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Jésus est<br />
<strong>à</strong> la fois parole et acte, dont la fécondité s’est exercée pour le salut <strong>de</strong><br />
toute l’humanité. Par analogie bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du, ne peut-on pas dire que<br />
le discours <strong>théologique</strong> qui s’est développé tout au long <strong>de</strong>s siècles<br />
— il est évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> la parole — constitue lui aussi un<br />
acte d’interprétation du message <strong>de</strong> la foi, acte qui <strong>en</strong> est <strong>à</strong> la fois le<br />
fruit et la cause <strong>de</strong> sa compréh<strong>en</strong>sion toujours plus profon<strong>de</strong> ?<br />
1. Qu’est-ce qu’un acte <strong>théologique</strong> ?<br />
Un acte <strong>théologique</strong>, comme son nom l’indique, est un faire, un<br />
agir, une création. Quelque chose advi<strong>en</strong>t qui n’existait pas. Un<br />
auteur, par la qualité <strong>de</strong> son travail, a fait avancer l’intellig<strong>en</strong>ce <strong>théologique</strong><br />
sur un point jusque l<strong>à</strong> incertain ou controversé. La découverte<br />
d’un déplacem<strong>en</strong>t et une problématique nouvelle chang<strong>en</strong>t la<br />
situation antérieure et ouvr<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s voies <strong>en</strong>core inconnues. Le progrès<br />
est si parlant qu’il s’impose et provoque, d’emblée ou l<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t,<br />
une large unanimité.<br />
La réception par la communauté <strong>de</strong>s théologi<strong>en</strong>s et plus <strong>en</strong>core<br />
par l’Église est donc indisp<strong>en</strong>sable <strong>à</strong> la réalisation d’un acte <strong>théologique</strong>.<br />
Nul ne peut prét<strong>en</strong>dre qu’il a accompli un acte <strong>théologique</strong>,<br />
comme nul ne peut se prét<strong>en</strong>dre prophète au nom <strong>de</strong> son propre<br />
charisme. Mais les autres, analysant telle ou telle doctrine, peuv<strong>en</strong>t<br />
y voir ce qui va <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir un acte <strong>théologique</strong>. Celui-ci suppose toujours<br />
sa propre réception. L’important ici n’est pas d’abord le texte<br />
mais l’exist<strong>en</strong>ce d’une idée créatrice.<br />
<strong>Les</strong> conciles ont eu souv<strong>en</strong>t pour rôle d’accomplir <strong>de</strong>s « actes dogmatiques<br />
». Une définition récapitule dans l’ordre du langage, sous<br />
la forme d’un mot, d’une expression ou d’une proposition, le s<strong>en</strong>s<br />
orthodoxe qu’il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> donner <strong>à</strong> une expression scripturaire
Introduction<br />
7<br />
ou <strong>à</strong> ce qui constituait une loi du langage dans l’Écriture. Le poids<br />
d’obligation qui revi<strong>en</strong>t <strong>à</strong> la parole conciliaire est un point fort, qui<br />
favorise sa réception. Mais l’histoire a montré que dans certains cas<br />
ce poids n’a pas suffi et que d’autres élém<strong>en</strong>ts sont v<strong>en</strong>us interférer<br />
pour que la définition <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>ne un acquis stable, partagé et définitif.<br />
Un acte <strong>théologique</strong> peut aussi <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir la base d’un acte dogmatique,<br />
mais pas forcém<strong>en</strong>t, car la <strong>théologie</strong> se développe dans une<br />
relative autonomie. On peut dire que les actes <strong>théologique</strong>s sont <strong>à</strong><br />
la base du progrès <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> au cours <strong>de</strong> l’histoire.<br />
<strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong> a le plus souv<strong>en</strong>t un li<strong>en</strong> avec l’élaboration<br />
d’un langage nouveau. La révélation chréti<strong>en</strong>ne, par le caractère<br />
inouï <strong>de</strong> son cont<strong>en</strong>u, a contraint la réflexion humaine soit <strong>à</strong> élaborer<br />
<strong>de</strong>s concepts nouveaux, soit le plus souv<strong>en</strong>t, par un travail<br />
sémantique précis, <strong>à</strong> faire évoluer <strong>de</strong>s concepts existants pour leur<br />
donner un s<strong>en</strong>s nouveau, formant un angle plus ou moins fort avec<br />
le s<strong>en</strong>s qui leur était donné précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t.<br />
La succession <strong>de</strong>s actes <strong>théologique</strong>s au cours <strong>de</strong>s temps constitue<br />
pour une large part l’histoire même <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong>. Elle forme la<br />
dynamique continue qui a fait vivre et progresser la recherche, a<br />
composé un long discours jamais achevé, qui ne finira qu’avec l’humanité<br />
elle-même. <strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong> est au service <strong>de</strong> l’acte <strong>de</strong> foi,<br />
même si dans cette formule, le terme d’acte recouvre <strong>de</strong>s réalités<br />
profondém<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>tes.<br />
Que font <strong>en</strong> effet les théologi<strong>en</strong>s d’époque <strong>en</strong> époque ? Ils<br />
recueill<strong>en</strong>t le donné révélé <strong>à</strong> partir <strong>de</strong> la confession <strong>de</strong> foi <strong>de</strong> l’Église,<br />
elle-même fondée dans l’Écriture, la tradition et l’histoire <strong>de</strong> la foi.<br />
De ce donné ils essai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> montrer le s<strong>en</strong>s dans leur prés<strong>en</strong>t. Ils<br />
<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t <strong>en</strong> dialogue avec lui et cherch<strong>en</strong>t <strong>à</strong> le construire dans un discours<br />
cohér<strong>en</strong>t. Vivant au sein <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong>s hommes, ils<br />
particip<strong>en</strong>t au questionnem<strong>en</strong>t que la raison humaine <strong>en</strong>gage perpétuellem<strong>en</strong>t<br />
avec ce donné. Ils sont solidaires <strong>de</strong> la culture <strong>de</strong> leur<br />
temps et <strong>de</strong> sa rationalité. Ils <strong>en</strong> utilis<strong>en</strong>t la sci<strong>en</strong>ce et la philosophie.<br />
<strong>Les</strong> théologi<strong>en</strong>s sont <strong>à</strong> la croisée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux exig<strong>en</strong>ces apparemm<strong>en</strong>t<br />
contradictoires. Ils doiv<strong>en</strong>t d’une part rester fidèles au cont<strong>en</strong>u du<br />
donné dans le cadre <strong>de</strong> la communauté-Église qui recevra, ou év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t<br />
ne recevra pas, leurs propositions <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s. Ils viv<strong>en</strong>t donc<br />
une particularité, liée <strong>à</strong> une révélation située dans l’histoire et donc
8 Introduction<br />
particulière, transmise dans une tradition qui a ses limites. D’autre<br />
part, au nom <strong>de</strong> leur raison vivante ils cherch<strong>en</strong>t <strong>à</strong> montrer la valeur<br />
universelle <strong>de</strong> ce donné révélé. Ils vis<strong>en</strong>t <strong>à</strong> être <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dus <strong>à</strong> la fois<br />
<strong>de</strong>s croyants et <strong>de</strong>s incroyants, <strong>en</strong> rejoignant positivem<strong>en</strong>t le questionnem<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> tous sur le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’exist<strong>en</strong>ce. Cette discipline est<br />
donc originale et spécifique : d’un côté elle participe aux exig<strong>en</strong>ces<br />
<strong>de</strong> la raison qui habite toute sci<strong>en</strong>ce humaine, <strong>de</strong> l’autre elle se<br />
heurte <strong>à</strong> une parole qui lui est dite v<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> Dieu et sur laquelle elle<br />
n’a aucun pouvoir <strong>de</strong> jugem<strong>en</strong>t ou <strong>de</strong> choix, mais seulem<strong>en</strong>t un<br />
pouvoir <strong>de</strong> compréh<strong>en</strong>sion, d’interprétation, <strong>de</strong> traduction et d’explicitation.<br />
Elle est sans cesse appelée <strong>à</strong> <strong>de</strong>s dictions <strong>de</strong> s<strong>en</strong>s. Elle<br />
doit donc déployer la rationalité imman<strong>en</strong>te <strong>à</strong> la révélation dans<br />
une dim<strong>en</strong>sion d’universalité. La raison dont il s’agit n’est pas la<br />
raison constituée une fois pour toutes dans <strong>de</strong>s exposés <strong>à</strong> valeur<br />
perman<strong>en</strong>te. Elle est le mouvem<strong>en</strong>t vivant qui ne se satisfait jamais<br />
d’un résultat obt<strong>en</strong>u, mais cherche toujours <strong>à</strong> aller au-<strong>de</strong>l<strong>à</strong> <strong>de</strong> ce<br />
qu’elle a déj<strong>à</strong> trouvé, dans une quête insatiable qui est la conséqu<strong>en</strong>ce<br />
<strong>de</strong> l’ori<strong>en</strong>tation fondam<strong>en</strong>tale <strong>de</strong> l’homme vers Dieu. C’est<br />
la raison vivante, celle qui jaillit du pôle transc<strong>en</strong>dantal <strong>de</strong> notre<br />
esprit, selon la conception <strong>de</strong> <strong>Karl</strong> <strong>Rahner</strong>. Cette raison <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d développer<br />
une logique <strong>de</strong> la foi et justifier au regard d’elle-même les<br />
raisons <strong>de</strong> croire. Elle pousse la <strong>théologie</strong> <strong>à</strong> aller toujours <strong>de</strong> l’avant.<br />
Cette activité <strong>théologique</strong>, source d’une suite infinie d’actes<br />
<strong>théologique</strong>s, est indisp<strong>en</strong>sable <strong>à</strong> un acte <strong>de</strong> foi qui se veut vivant et<br />
n’accepte pas <strong>de</strong> tomber dans le psittacisme. Elle accompagne perpétuellem<strong>en</strong>t<br />
la vie <strong>de</strong> l’Église.<br />
2. Le discernem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s actes <strong>théologique</strong>s<br />
Ce discernem<strong>en</strong>t est inévitablem<strong>en</strong>t <strong>à</strong> la merci <strong>de</strong> chaque théologi<strong>en</strong>.<br />
Dans l’état actuel <strong>de</strong> la discipline il n’existe aucun cons<strong>en</strong>sus<br />
sur l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s actes <strong>théologique</strong>s qui se sont succédé dans l’histoire.<br />
L’important aujourd’hui est <strong>de</strong> ne ret<strong>en</strong>ir que <strong>de</strong>s actes<br />
capables d’être reconnus comme incontestables. Il ne peut être<br />
question <strong>de</strong> les ret<strong>en</strong>ir tous. Cet ouvrage cherchera <strong>à</strong> donner <strong>de</strong>s<br />
échantillons représ<strong>en</strong>tatifs liés aux grands tournants <strong>de</strong> l’histoire.
Introduction<br />
9<br />
Il essaiera <strong>de</strong> partir du comm<strong>en</strong>cem<strong>en</strong>t et d’arriver jusqu’<strong>à</strong> nos<br />
jours. Qu’il soit clair qu’il ne prét<strong>en</strong>d <strong>à</strong> aucune exhaustivité.<br />
Le point <strong>de</strong> départ sera pris dans la tradition chréti<strong>en</strong>ne chez Irénée<br />
<strong>de</strong> <strong>Lyon</strong>. Il est clair que le premier acte <strong>théologique</strong> <strong>de</strong> notre tradition<br />
fut produit par saint Paul, premier théologi<strong>en</strong> <strong>de</strong> la Nouvelle<br />
Alliance. Après Jésus, il a contribué par la vigueur <strong>de</strong> sa réflexion <strong>à</strong><br />
la fondation <strong>de</strong> l’Église et <strong>à</strong> l’élaboration <strong>de</strong> ses dogmes. Il est l’auteur<br />
<strong>de</strong>s premiers écrits du Nouveau Testam<strong>en</strong>t. Qu’a-t-il fait <strong>à</strong> partir <strong>de</strong><br />
l’événem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Jésus qui lui avait été annoncé ? Il a vécu une méditation<br />
exceptionnelle et a construit une <strong>théologie</strong> historique synthétisant<br />
le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> la suite <strong>de</strong>s initiatives <strong>de</strong> Dieu, qui ont leur<br />
aboutissem<strong>en</strong>t dans la personne du Christ. Il a dialogué avec les Juifs<br />
pour leur montrer l’accomplissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’Anci<strong>en</strong> Testam<strong>en</strong>t dans<br />
le Nouveau et il s’est adressé aux paï<strong>en</strong>s. Le passionné <strong>de</strong> la croix du<br />
Christ, le docteur <strong>de</strong> la grâce et <strong>de</strong> la justification est incontestablem<strong>en</strong>t<br />
l’auteur du premier acte <strong>théologique</strong> <strong>de</strong> l’histoire. Mais sa p<strong>en</strong>sée<br />
a été analysée par nombre <strong>de</strong> spécialistes et la dim<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> sa<br />
personnalité dépasse le cadre <strong>de</strong> cet essai. C’est dans la tradition postapostolique<br />
que nous chercherons le premier acte <strong>théologique</strong> significatif,<br />
d’ailleurs tout imprégné <strong>de</strong> la p<strong>en</strong>sée <strong>de</strong> Paul.<br />
3. <strong>Les</strong> auteurs ret<strong>en</strong>us et le plan <strong>de</strong> l’ouvrage<br />
Considérons quatre gran<strong>de</strong>s époques majeures : l’époque patristique,<br />
le Moy<strong>en</strong> Âge, les Temps mo<strong>de</strong>rnes et la Réforme, et <strong>en</strong>fin<br />
l’époque contemporaine au s<strong>en</strong>s large <strong>de</strong> ce mot c’est-<strong>à</strong>-dire les xixe<br />
et xxe siècles.<br />
1. Du temps <strong>de</strong>s Pères <strong>de</strong> l’Église nous reti<strong>en</strong>drons quatre choix<br />
paradigmatiques, Irénée <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong>, Origène, Basile <strong>de</strong> Césarée et<br />
Augustin d’Hippone. Il est difficile <strong>de</strong> refuser <strong>à</strong> ces quatre auteurs,<br />
dont les <strong>de</strong>ux grands génies et géants <strong>de</strong> la patristique, Origène et<br />
Augustin, d’avoir accompli <strong>de</strong>s actes <strong>théologique</strong>s qui ont transformé<br />
la situation <strong>de</strong> leur discipline. Ce choix n’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>d <strong>en</strong> ri<strong>en</strong><br />
déconsidérer les autres Pères dont plusieurs mériterai<strong>en</strong>t sans doute<br />
aussi <strong>de</strong> figurer <strong>à</strong> cette époque pour leurs découvertes propres.
10 Introduction<br />
2. Au Moy<strong>en</strong> Âge, la figure dominante <strong>de</strong> la scolastique est évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t<br />
saint Thomas d’Aquin. Mais on ne peut l’isoler du vaste<br />
mouvem<strong>en</strong>t dont il constitue sans doute le sommet. L’originalité<br />
<strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> se constituant comme sci<strong>en</strong>ce et se donnant la tâche<br />
d’une rationalité nouvelle <strong>de</strong> la foi s’<strong>en</strong>racine chez Boèce et connaîtra<br />
d’importants développem<strong>en</strong>ts dans la tradition franciscaine.<br />
3. Dans les Temps mo<strong>de</strong>rnes la figure <strong>de</strong> Martin Luther s’impose<br />
par le tournant qu’il a fait pr<strong>en</strong>dre <strong>à</strong> la <strong>théologie</strong>. La réponse majeure<br />
<strong>de</strong> l’Église catholique se fera, non par l’action privilégiée d’un théologi<strong>en</strong>,<br />
mais par la réunion du concile <strong>de</strong> Tr<strong>en</strong>te, dont l’œuvre, <strong>à</strong> la<br />
fois réformatrice et doctrinale, façonnera la figure <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> <strong>de</strong>s<br />
siècles <strong>à</strong> v<strong>en</strong>ir. Il faut t<strong>en</strong>ir compte aussi <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> controverse,<br />
discutable <strong>à</strong> nos yeux sans doute, mais qui a contribué pour<br />
sa part au progrès <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong>. La figure principale est ici Robert<br />
Bellarmin. On ne peut pas oublier non plus les développem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong><br />
la <strong>théologie</strong> positive, c’est-<strong>à</strong>-dire le premier retour aux Pères <strong>de</strong><br />
l’Église <strong>de</strong> nature sci<strong>en</strong>tifique. C’est plutôt une école qu’un homme<br />
qu’il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> citer ici : Mabillon, Thomassin, D<strong>en</strong>is Petau.<br />
4. De l’époque appelée ici contemporaine, ret<strong>en</strong>ons au xixe siècle<br />
l’École <strong>de</strong> Tübing<strong>en</strong> (Johann Sebastian von Drey, et Johann Adam<br />
Möhler) ainsi que John H<strong>en</strong>ry Newman.<br />
Au xxe siècle, si l’on considère la longue pério<strong>de</strong> qui s’ét<strong>en</strong>d <strong>de</strong> la<br />
crise mo<strong>de</strong>rniste <strong>à</strong> Vatican II, on constate une prise <strong>en</strong> considération<br />
nouvelle <strong>de</strong> l’histoire et <strong>de</strong> l’homme dans l’histoire. Du côté français<br />
nous trouvons tout un groupe d’hommes qui ont cherché <strong>à</strong> répondre<br />
sérieusem<strong>en</strong>t aux questions posées par le mo<strong>de</strong>rnisme et qui ont<br />
pénétré toute notre culture, <strong>en</strong> particulier Marie-Dominique Ch<strong>en</strong>u<br />
et Yves-Marie Congar, Yves <strong>de</strong> Montcheuil et H<strong>en</strong>ri <strong>de</strong> Lubac, avec<br />
beaucoup d’autres. <strong>Karl</strong> <strong>Rahner</strong> est <strong>en</strong>suite le grand témoin du tournant<br />
anthropologique (l’expéri<strong>en</strong>ce transc<strong>en</strong>dantale <strong>de</strong> l’homme).<br />
Il est trop tôt pour parler déj<strong>à</strong> du xxie siècle. C’est l’av<strong>en</strong>ir. Il ne<br />
pourra éviter la question <strong>de</strong> l’unicité du Christ dans le cadre du dialogue<br />
interreligieux 2 .<br />
2. Je remercie Laur<strong>en</strong>t Gallois <strong>de</strong>s conversations que nous avons eues sur le<br />
thème <strong>de</strong> ce livre et qui m’ont gran<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t aidé <strong>à</strong> ouvrir ma réflexion <strong>à</strong> nombre<br />
<strong>de</strong> ses implications culturelles.
Première section<br />
L’ÉPOQUE DES PÈRES DE L’ÉGLISE
INTRODUCTION<br />
Après la rédaction du Nouveau Testam<strong>en</strong>t, comportant <strong>en</strong> particulier<br />
l’acte <strong>théologique</strong> capital <strong>de</strong> saint Paul qui échappe par son<br />
statut scripturaire <strong>à</strong> notre <strong>en</strong>quête, l’histoire <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> s’inaugure<br />
par l’œuvre innombrable <strong>de</strong>s Pères <strong>de</strong> l’Église. Il ne s’agit pas<br />
ici <strong>de</strong> les mettre <strong>en</strong> compétition ni <strong>de</strong> décerner <strong>de</strong>s prix, mais <strong>de</strong><br />
faire un choix difficile pour ret<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> cette vaste littérature les personnalités<br />
qui ont fait le plus avancer la tâche <strong>théologique</strong> et ont<br />
exercé sur leurs pairs l’influ<strong>en</strong>ce la plus décisive.<br />
Nous <strong>en</strong> reti<strong>en</strong>drons ici quatre, Irénée <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong> pour l’élaboration<br />
<strong>de</strong> la première <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> l’histoire du salut ; Origène d’Alexandrie,<br />
auteur du premier traité systématique <strong>de</strong> <strong>théologie</strong> et fondateur <strong>de</strong><br />
l’exégèse chréti<strong>en</strong>ne, le Cappadoci<strong>en</strong> Basile <strong>de</strong> Césarée, qui, le premier,<br />
s’est confronté <strong>à</strong> la difficulté rationnelle posée par le mystère<br />
d’un seul Dieu <strong>en</strong> trois personnes ; et <strong>en</strong>fin Augustin d’Hippone, un<br />
homme universel, qui a prolongé l’œuvre <strong>de</strong> Basile dans son grand<br />
ouvrage sur la Trinité et est interv<strong>en</strong>u sur le mystère <strong>de</strong> l’homme,<br />
créé, pécheur et sauvé, celui qui était <strong>de</strong>stiné <strong>à</strong> rester p<strong>en</strong>dant <strong>de</strong>s<br />
siècles le grand maître <strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt. Ce choix s’imposait positivem<strong>en</strong>t,<br />
même s’il <strong>de</strong>mandait d’oublier bi<strong>en</strong> d’autres lumières <strong>de</strong> cette<br />
époque <strong>en</strong> Ori<strong>en</strong>t et <strong>en</strong> Occi<strong>de</strong>nt. On peut considérer <strong>en</strong> particulier<br />
Origène et Augustin comme faisant partie du petit groupe <strong>de</strong>s<br />
génies <strong>de</strong> l’humanité.
14 I. L’époque <strong>de</strong>s Pères <strong>de</strong> l’Église<br />
La littérature patristique trouve son unité dans une situation historique<br />
et culturelle unique. Elle fait immédiatem<strong>en</strong>t suite <strong>à</strong> l’événem<strong>en</strong>t<br />
fondateur du christianisme et elle se doit d’inv<strong>en</strong>ter, après<br />
le discours du Nouveau Testam<strong>en</strong>t, un nouveau discours, qui n’a<br />
plus la même autorité et <strong>en</strong> a parfaitem<strong>en</strong>t consci<strong>en</strong>ce, mais dont<br />
l’inv<strong>en</strong>tion s’impose aux pasteurs et aux p<strong>en</strong>seurs <strong>de</strong> ce temps, afin<br />
<strong>de</strong> faire exister un christianisme <strong>en</strong>core fragile face aux paï<strong>en</strong>s qui<br />
le combatt<strong>en</strong>t trop souv<strong>en</strong>t et aux hérétiques qui le déform<strong>en</strong>t dès<br />
le départ. La confession <strong>de</strong> foi est toujours prés<strong>en</strong>te <strong>à</strong> leur p<strong>en</strong>sée,<br />
exprimée sur le fon<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s paroles <strong>de</strong> l’Écriture. Ce premier<br />
discours met <strong>en</strong> œuvre les premières autorités <strong>de</strong> la foi. <strong>Les</strong> Pères<br />
se situ<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>de</strong>ç<strong>à</strong> <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong> distinctions qui intervi<strong>en</strong>dront par<br />
la suite. Ils vont <strong>à</strong> l’ess<strong>en</strong>tiel pour établir avec fermeté le cœur <strong>de</strong> la<br />
foi chréti<strong>en</strong>ne, c’est-<strong>à</strong>-dire le mystère trinitaire et le mystère christologique.<br />
Leur discours le plus subtil est toujours inscrit dans l’évi<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong> l’adhésion vivante au message du Christ. Cette <strong>théologie</strong><br />
est profondém<strong>en</strong>t spirituelle. Elle est un témoignage émouvant <strong>de</strong><br />
la jeunesse <strong>de</strong> la foi chréti<strong>en</strong>ne.
Chapitre premier<br />
UNE THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DU SALUT<br />
CENTRÉE SUR LE CHRIST : IRÉNÉE DE LYON<br />
Notice : Irénée (vers 130-140 – vers 202-208), évêque <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong> dans<br />
la <strong>de</strong>uxième moitié du iie siècle fut un pionnier parmi les Pères <strong>de</strong><br />
l’Église et a « parlé » <strong>à</strong> nouveau au cours du xxe siècle. Il a vécu <strong>en</strong> un<br />
temps particulièrem<strong>en</strong>t sombre <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’Église sous les règnes<br />
d’Antonin, <strong>de</strong> Marc Aurèle et <strong>de</strong> Commo<strong>de</strong>, temps où l’Église vit toujours<br />
sous la m<strong>en</strong>ace <strong>de</strong> la persécution. Ce que nous savons <strong>de</strong> sa vie<br />
se réduit <strong>à</strong> ce que nous <strong>en</strong> dit une notice d’Eusèbe <strong>de</strong> Césarée dans son<br />
Histoire ecclésiastique. Grec d’Asie mineure, né vraisemblablem<strong>en</strong>t <strong>à</strong><br />
Smyrne (Izmir), il n’est séparé <strong>de</strong> l’Église apostolique que par une génération,<br />
parce qu’il a connu dans son <strong>en</strong>fance le vieil évêque Polycarpe<br />
<strong>de</strong> Smyrne qui affirmait avoir r<strong>en</strong>contré l’apôtre saint Jean. Nous ne<br />
savons pas pourquoi sa famille est v<strong>en</strong>ue <strong>de</strong> Smyrne <strong>à</strong> <strong>Lyon</strong>, <strong>en</strong> passant<br />
par Rome, peut-être pour <strong>de</strong>s raisons économiques. Il est « presbytre »<br />
<strong>de</strong> l’Église <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong> <strong>en</strong> 177, année <strong>de</strong> la persécution qui a coûté la vie <strong>à</strong><br />
l’évêque saint Pothin. Il succè<strong>de</strong> <strong>à</strong> celui-ci et intervi<strong>en</strong>dra <strong>en</strong> 190-191<br />
auprès du pape Victor pour lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ne pas excommunier les<br />
l’Église <strong>de</strong> l’Asie, qui célébrai<strong>en</strong>t la fête <strong>de</strong> Pâques <strong>à</strong> la date juive du<br />
14 nisan, avec cette belle formule : « La différ<strong>en</strong>ce du jeûne confirme<br />
l’accord <strong>de</strong> la foi 1 . » Une tradition donne <strong>à</strong> p<strong>en</strong>ser qu’Irénée serait mort<br />
martyr lors d’une persécution <strong>de</strong> Septime Sévère (191-211).<br />
1. Eusèbe <strong>de</strong> Césarée, Histoire ecclésiastique, V, 24, 11-13 ; SC 41, p. 70.
En lecture partielle…
INDEX DES NOMS CITÉS<br />
Abélard, Pierre : 133, 135-141<br />
A<strong>de</strong>nauer, Konrad : 297<br />
Aèce : 85<br />
Adam, <strong>Karl</strong> : 233<br />
Adéodat : 98<br />
Alberigo, Giuseppe : 273, 294<br />
Albert le Grand : 140, 142, 273<br />
Alès, Adhémar d’: 289<br />
Amaladoss, Michael : 329<br />
Ambroise <strong>de</strong> Milan : 98, 100,<br />
Ammonius Saccas : 39, 43, 77<br />
Anselme <strong>de</strong> Cantorbéry : 133-<br />
136, 177<br />
Antonin : 15<br />
Apollinaire : 74<br />
Aristote : 123, 125, 126, [128],<br />
129, 131-133, [137], 142, 143,<br />
147, 150, 153, 160, [162]<br />
Arius : [41], 84, 85, [91], [107],<br />
[246-249], [251], 252, [255]<br />
Astruc, Jean : 221<br />
Athanase d’Alexandrie : 56,<br />
78, 84, 85, 91, 101, 119, 234,<br />
248, 249, 251<br />
Augustin d’Hippone : 9, 13, 40,<br />
[45], 62, 66, 84, 89, 90, 98-116,<br />
119, 125, 127, [128], 132, 134,<br />
138, 141-143, 156, 162, 173,<br />
[177], [179], 187, [191], 193,<br />
[197], 215, [220], 247, 248, 252,<br />
[253], 276, [283], 300, 306<br />
Averroès : 150<br />
Avic<strong>en</strong>ne : 150<br />
Baius : 214<br />
Balthasar, Hans Urs von : 33,<br />
37, 40, 155, 231, 232, 282, 288,<br />
296<br />
Bañez, Domingo : 337<br />
Barbieri, Dominic : 246<br />
Bardy, Gustave : 77<br />
Baronio, Cesare (voir Baronius)<br />
Baronius : 219, 221<br />
Barth, <strong>Karl</strong> : 231, 284, 288, 330<br />
Basile <strong>de</strong> Césarée : 5, 9, 13, 40,<br />
48, 65, 66, 79, 82-91, 93-97,
338 In<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s noms cités<br />
101, 105-108, 111, 119, 138,<br />
156, 190, 248, 251<br />
Basili<strong>de</strong> : 58<br />
Baudrillard, Alfred : 289<br />
Bea, Augustin : 193<br />
Beauchamp, Paul : 81<br />
Bellarmin, Robert : 10, 169, 214-<br />
219, 221-223, 225, 235, 241<br />
Bellarmino, Roberto (voir Bellar -<br />
min, Robert)<br />
B<strong>en</strong>oît, André : 16<br />
Bernard <strong>de</strong> Clairvaux : 136,<br />
137, 220<br />
Billuart, Charles-R<strong>en</strong>é : 225<br />
Birmelé, André : 199<br />
Blon<strong>de</strong>l, Maurice : 266, 282, 289,<br />
290<br />
Bochet, Isabelle : 99<br />
Boèce : 10, 100, 108, 119, 123,<br />
125-141, 143, 146, 147, 156,<br />
158, 162<br />
Boisselot, Pierre : 280<br />
Bolland, Jean : 220, 221<br />
Bollandus (voir Bolland, Jean)<br />
Bonav<strong>en</strong>ture, saint : 123, 127,<br />
133, 140, 142, 143, 159, 160,<br />
163, 215<br />
Bonuccio, Agostino : 187<br />
Bora, Catarina von : 170<br />
Borromée, Charles : 207<br />
Boson : 134<br />
Bossuet, Jacques-Bénigne : 146,<br />
247, 254<br />
Bougerol, Jacques-Guy : 159<br />
Bouillard, H<strong>en</strong>ri : 231, 232, 284,<br />
288<br />
Bourgeois, H<strong>en</strong>ri : 270<br />
Bouvier, Frédéric : 272<br />
Bouyer, Louis : 238, 246, 247<br />
Boyer, Charles : 279<br />
Bremond, H<strong>en</strong>ri : 266<br />
Breton, Stanislas : 329, 333<br />
Breton, Val<strong>en</strong>tin-M. : 159<br />
Brown, Peter : 99<br />
Buonaiuti, Ernesto : 268<br />
Cajetan : 170, 175<br />
Calvin, Jean : 180-182, 201<br />
Cano, Melchior : 212, 213<br />
Cappuyns, Maïeul : 126<br />
Carafa, Gian Pietro (voir Paul IV)<br />
Caron, Max<strong>en</strong>ce : 99<br />
Casalis, Georges : 170<br />
Celse : 40, 41, 43<br />
Cerdon : 17<br />
Cervini, Giambattista : 214<br />
Chadwick, Ow<strong>en</strong> : 254<br />
Chantraine, Georges : 284<br />
Charles Quint : 183-185<br />
Ch<strong>en</strong>u, Marie-Dominique : 10,<br />
142, 146, 147, 231, 243, 272-<br />
275, 277, 279, 280, 292<br />
Chevallier, Irénée : 99<br />
Clau<strong>de</strong>l, Paul : 44<br />
Clém<strong>en</strong>t VII : 184<br />
Clém<strong>en</strong>t d’Alexandrie : 39, 248<br />
Clém<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Rome : 16<br />
Commo<strong>de</strong> : 15<br />
Concile <strong>de</strong> Chalcédoine : 119,<br />
178, 252, 295<br />
Concile <strong>de</strong> Constantinople<br />
(IIe) : 79, 82, 95, 96, 110, 183<br />
Concile <strong>de</strong> Latran V : 184<br />
Concile <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong> : 160<br />
Concile <strong>de</strong> Nicée : 84, 92, 94,<br />
[102], 110, 119, 183, 203, 249-<br />
251, [256], 263, 291, 295<br />
Concile Vatican I : 243<br />
Concile Vatican II : 6, 10, 21,<br />
81, 169, 191, 193, 205, 231,
In<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s noms cités<br />
339<br />
238-240, 265, 272, 276, 283,<br />
288, 291, 293<br />
Congar, Yves-Marie : 10, 190,<br />
231, 234, 235, 238, 243, 274,<br />
275, 277-281, 287, 330<br />
Courcelle, Pierre : 126<br />
Courtonne, Yves : 83, 95<br />
Crouzel, H<strong>en</strong>ri : 40, 45<br />
Cypri<strong>en</strong> <strong>de</strong> Carthage : 236, 237<br />
Daniélou, Jean : 40, 231, 282-284,<br />
291-293, 330<br />
Daniélou, Ma<strong>de</strong>leine : 291<br />
Dèce : 39<br />
Delaye, Émile : 284<br />
Del Monte, Francesco (voir<br />
Jules III)<br />
Demetrius : 39<br />
D<strong>en</strong>ek<strong>en</strong>, Michel : 233-235, 238,<br />
239, 242, 243<br />
Descartes, R<strong>en</strong>é : 167, 216, 223,<br />
224, 301<br />
Dianos : 82<br />
Diocléti<strong>en</strong> : 82<br />
Diognète (Lettre <strong>à</strong>) : 16<br />
Drey, Johann Sebastian von : 10,<br />
230, 233-235, 242<br />
Drobner, Hubertus Rudolf : 37<br />
Duchesne, Louis : 268<br />
Duns Scot : 143, 160<br />
Dupront, Alphonse : 266<br />
Dupuis, Jacques : 329<br />
Durand, Alexandre : 284<br />
Duval, André : 184, 206<br />
Eck, Johannes : 170, 175<br />
Einstein, Albert : 323<br />
Emmélie : 82<br />
Épiphane <strong>de</strong> Salamine : 79<br />
Eunome : 83, 85-88<br />
Eusèbe <strong>de</strong> Césarée : 15, 39, 82<br />
Eutychès : 130, 252<br />
Euzoïos : 91<br />
Évagre le Pontique : 79<br />
Fantino, Jacques : 16<br />
Farel, Guillaume : 180<br />
Febvre, Luci<strong>en</strong> : 170<br />
Fédou, Michel : 41, 78, 79, 328,<br />
329<br />
Féret, H<strong>en</strong>ri-Marie : 279, 280<br />
Fessard, Gaston : 282, 289<br />
Fichte, Johann Gottlieb : 234<br />
Fleury, André Hercule <strong>de</strong> : 220<br />
Foscarini, Antonio : 218<br />
Fouilloux, Éti<strong>en</strong>ne : 273, 276,<br />
293<br />
François Ier : 184<br />
Frans<strong>en</strong>, Gérard : 184, 211<br />
Franzelin, Jean-Baptiste : 230<br />
Frou<strong>de</strong>, Richard H. : 245<br />
Galilée : 214, 218<br />
Gallois, Laur<strong>en</strong>t : 10<br />
Ganne, Pierre : 284<br />
Gar<strong>de</strong>il, Ambroise : 274<br />
Garrigou-Lagrange, Réginald :<br />
275, 293<br />
Gaulle, Charles <strong>de</strong> : 157<br />
Gaulle, Yvonne <strong>de</strong> : 157<br />
Gauthier, Antoine : 149<br />
Geiselmann, Joseph Rupert :<br />
190, 233, 234, 243<br />
Giet, Stanislas : 83<br />
Gillet, Martin : 279<br />
Gilson, Éti<strong>en</strong>ne : 99<br />
Grabmann, Martin : 133<br />
Grandmaison, Léonce <strong>de</strong> : 243,<br />
263, 269, 275, 281, 291
340 In<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s noms cités<br />
Grégoire le Grand : 142, 215,<br />
276<br />
Grégoire <strong>de</strong> Nazianze : 40, 65,<br />
66, 82, 83, 89, 95, 253<br />
Grégoire <strong>de</strong> Nysse : 95, 291, 292<br />
Grelot, Pierre : 194<br />
Grossi, Vittorino : 270<br />
Groupe <strong>de</strong>s Dombes : 250<br />
Guardini, Romano : 297<br />
Guerrero, Pedro : 211<br />
Guillaume d’Ockham : 143, 160<br />
Guillet, Jacques : 273, 284, 293<br />
Guitton, Jean : 247, 249<br />
Hadot, Pierre : 126<br />
Hamel, Robert : 289<br />
Hamp<strong>de</strong>n, R<strong>en</strong>n D. : 245<br />
Harl, Marguerite : 40, 45<br />
Harnack, Adolf von : 198, 266,<br />
269<br />
Hausschein, Johannes : 339<br />
Hazard, Paul : 222<br />
Hei<strong>de</strong>gger, Martin : 296, 301,<br />
[308]<br />
Héloïse : 135<br />
H<strong>en</strong>ri IV : 167, 223<br />
Héraklas : 39<br />
Her<strong>de</strong>r, Johann Gottfried von :<br />
234<br />
Hick, John : 331<br />
Hilaire <strong>de</strong> Poitiers : 100<br />
Hobbes, Thomas : 216, 222<br />
Holstein, H<strong>en</strong>ri : 190<br />
Huby, Joseph : 282<br />
Hugues <strong>de</strong> Saint-Victor : 149<br />
Hulst, Maurice d’: 268<br />
Hutin, Serge : 17<br />
Ignace d’Antioche : 16<br />
Ignace <strong>de</strong> Loyola : 171, 208,<br />
215, 298, 320, 321<br />
Irénée <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong> : 9, 13, 15-38, 41-<br />
43, 54, 75, 77, 101, 116, 117,<br />
119, 163, 236, 239, 281, 290,<br />
294<br />
Isidore <strong>de</strong> Séville : 123<br />
Jacques, saint : 187<br />
Jaschke, Hans Joch<strong>en</strong> : 37<br />
Jean, saint : 15, 23, 30, 33, 35, 46,<br />
55, 63, 66, 71-74, 89, 97, 99,<br />
190, 258, 263, 278, 333<br />
Jean Chrysostome : 248<br />
Jean <strong>de</strong> la Croix : 208<br />
Jean Damascène : 123<br />
Jean XXIII : 280, 283, 293, 297<br />
Jeannière, Abel : 323<br />
Jedin, Hubert : 184<br />
Jérôme, saint : 79, 92, 93, 187, 215<br />
Joachim <strong>de</strong> Flore : 283<br />
Jossua, Jean-Pierre : 273<br />
Jules III : 183<br />
Juli<strong>en</strong> d’Éclane : 113<br />
Jurieu, Pierre : 254<br />
Justin, saint : 16, 20, 35, 116, 330,<br />
334<br />
Justini<strong>en</strong> : 79<br />
Kant, Emmanuel : 234, 301<br />
Kasper, Walter : 233, 244, 319<br />
Keble, John : 245<br />
Kleutg<strong>en</strong>, Joseph : 230<br />
Knitter, Paul : 331<br />
Küng, Hans : 232, 288, 331<br />
La Brosse, Olivier <strong>de</strong> : 273<br />
Lacordaire, H<strong>en</strong>ri : 279<br />
Lacoste, Jean-Yves : 216<br />
Ladaria, Luis : 270
In<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s noms cités<br />
341<br />
Ladrière, Jean : 273<br />
Lagrange, Marie-Joseph : 269<br />
Lanfranc : 133<br />
La Porrée, Gilbert <strong>de</strong> : 133, 137,<br />
138<br />
Leblanc, Sylvain (voir Bremond,<br />
H<strong>en</strong>ri)<br />
Lécrivain, Philippe : 270<br />
Ledochowski, Wladimir : 282<br />
Lehmann, <strong>Karl</strong> : 298<br />
Lemaire, Marie-Gabrielle : 284<br />
Lemonnyer, Antoine : 274<br />
Le Nain <strong>de</strong> Tillemont, Louis-<br />
Sébasti<strong>en</strong> : 220, 221<br />
Léon le Grand : 252<br />
Léon X : 173, 175, 184<br />
Léon XIII : 161, 209, 246, 268<br />
Léonidas : 39<br />
Lépin, Marius : 204<br />
Loisy, Alfred : 266, 268-270, 277<br />
Lombard, Pierre : 133, 139-142,<br />
148, 152, 159, 177, 219<br />
Lortz, Joseph : 170<br />
Louis XIV : 222, 223<br />
Lubac, H<strong>en</strong>ri <strong>de</strong> : 10, 41, 70, 231,<br />
238, 243, 263, 280, 282-292,<br />
330<br />
Luc, saint : 26, 32, 33, 68, 334<br />
Luci<strong>en</strong> : 248<br />
Luther, Martin : 10, 80, 168, 170-<br />
182, [184], 185, 187-189, 191,<br />
[192], 195, 197-203, 205, 206,<br />
[208], 213, 217, 224, 225, [242],<br />
[246], 248, [269]<br />
Mabillon, Jean : 10, 169, 220, 221<br />
Macrine la Jeune : 82<br />
Ma<strong>de</strong>c, Goulv<strong>en</strong> : 99<br />
Maldonado, Juan (voir Maldonat)<br />
Maldonat : 219<br />
Malebranche : 290<br />
Mandonnet, Félix-Pierre : 100,<br />
274<br />
Marc Aurèle : 15<br />
Marcel II : 183, 214<br />
Marcion : 17, 56, 58<br />
Maréchal, Joseph : 289, 296, 301<br />
Marius Victorinus : 93, 204<br />
Marlé, R<strong>en</strong>é : 266<br />
Marrou, H<strong>en</strong>ri-Irénée : 99<br />
Marsili, Pierre : 149<br />
Massarelli, Angelo : 184, 209<br />
Maurice <strong>de</strong> Saxe : 183<br />
Melanchthon, Philippe : 176,<br />
180<br />
Mélèce : 91, 92<br />
Metz, Johann Baptist : 298, 299<br />
Möhler, Johann Adam : 10, 230,<br />
233-244, 255, 268, 274, 278,<br />
324<br />
Moingt, Joseph : 105, 117, 118,<br />
264, 318<br />
Molina, Luis <strong>de</strong> : 214<br />
Monique, sainte : 98<br />
Montcheuil, Yves <strong>de</strong> : 10, 231,<br />
233, 234, 238, 243, 278, 282,<br />
284, 289, 290<br />
Montini, Giovanni (voir Paul VI)<br />
Morone, Giovanni : 186<br />
Muller, Charles : 298<br />
Naucratius : 82<br />
Nautin, Pierre : 39, 41<br />
Nédoncelle, Maurice : 247<br />
Nestorius : 130<br />
Neufeld, <strong>Karl</strong> H. : 298<br />
Neveu, Bruno : 221<br />
Newman, John H<strong>en</strong>ry : 10, 230,<br />
238, 239, 245-259, 261-263,<br />
265, 267, 268, 278, 324
342 In<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s noms cités<br />
Newton, Isaac : 323<br />
Noët : 84<br />
Oecolampa<strong>de</strong> (voir Hausschein,<br />
Johannes)<br />
O’Leary, Joseph : 329<br />
Olivier, Daniel : 170<br />
O’Malley, John W. : 184, 188,<br />
210<br />
Origène : 9, 13, 39-58, 60-67, 69-<br />
83, 99, 104, 117, 145, 248, 283,<br />
291, 296<br />
Ouince, R<strong>en</strong>é d’ : 282<br />
Panikkar, Raymond : 331<br />
Pantène : 39<br />
Pascal, Blaise : 117, 146, 301, 305<br />
Passaglia, Carlo : 230<br />
Pasteur d’Hermas : 47<br />
Patricius : 98<br />
Paul, saint : 9, 13, 17, 20, 22-24,<br />
26, [35], [37], [47], 49, 53, 58,<br />
59, 62, 63, 68, 72, 75, 81, 86, 87,<br />
106, 114, 117, 170, 172, 173,<br />
[176], 178, [189], 192, 194-196,<br />
267, [290]<br />
Paul III : 183, 184<br />
Paul IV : 183<br />
Paul V : 209, 214<br />
Paul VI : 244, 279,<br />
Paulin : 91<br />
Pélage : 113, 193<br />
Petau, D<strong>en</strong>is : 10, 169, 214, 215,<br />
217, 219-221, 223, 225<br />
Pie IV : 183, 209, 210<br />
Pie VI : 211<br />
Pie X : 209, 270<br />
Pie XII : 81, 193, 270, 271, 287, 292<br />
Pieris, Aloysius : 331<br />
Pierre, saint : 20, 86, 87, 237, 328,<br />
335<br />
Pierre <strong>de</strong> Jean Olivi : 160<br />
Pierre <strong>de</strong> Sébaste : 82<br />
Planck, Gottlieb Jacob : 233<br />
Platon : 17, [41], [43], [47],<br />
[150], [153], 250, [291], 334<br />
Plotin : 39, 98<br />
Polycarpe <strong>de</strong> Smyrne : 15, 16<br />
Porphyre : 125<br />
Portalié, E. : 136<br />
Pothin : 15<br />
Poulat, Émile : 266<br />
Poupard, Paul : 218<br />
Praxeas : 84<br />
Proudhon, Pierre-Joseph : 283<br />
Pru<strong>de</strong>nce : 328<br />
Przywara, Erich : 232, 288<br />
Ptolémée : 19<br />
Puech, H<strong>en</strong>ri-Charles : 17<br />
Pusey, Edward B. : 245, 246<br />
Raffelt, Albert : 298<br />
<strong>Rahner</strong>, Hugo : 296<br />
<strong>Rahner</strong>, <strong>Karl</strong> : 8, 10, 113, 193,<br />
231, 232, 264, 278, 296-305,<br />
307-315, 317-323, 330<br />
Rancé, Armand : 221<br />
Ratzinger, Josef : 243<br />
Raymond <strong>de</strong> P<strong>en</strong>yafort : 149<br />
Rivière, Jean : 266<br />
Roberts, Louis : 298<br />
Rousselot, Pierre : 233, 263, 272,<br />
282, 289, 296<br />
Rufin : 40, 47, 79<br />
Sabellius : 84, 93<br />
Saint-Simon : 283<br />
Samartha, S. : 329<br />
Sartiaux, Félix : 266
In<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s noms cités<br />
343<br />
Savon, H<strong>en</strong>ri : 234<br />
Scharl, Emmeran : 25<br />
Scheeb<strong>en</strong>, Matthias : 230, 238<br />
Schelling, Friedrich von : 242,<br />
283<br />
Schleiermacher, Friedrich : 233,<br />
242<br />
Schra<strong>de</strong>r, Clem<strong>en</strong>s : 230<br />
Schwarzerd, Philippe : 180<br />
Sénécal, Bernard : 329<br />
Septime Sévère : 15, 39<br />
Seripando, Gerolamo : 172<br />
Sertillanges, Antonin-Gilbert :<br />
279<br />
Sesboüé, Bernard : 5, 16, 83, 94,<br />
135, 170, 290, 298<br />
Simon, Richard : 81, 117, 146,<br />
221, 222, 269<br />
Simon le Mage : 19<br />
Simonetti, Manlio : 40, 45<br />
Sixte V : 218<br />
Solages, Bruno <strong>de</strong> : 293<br />
Sonier <strong>de</strong> Lubac, H<strong>en</strong>ri (voir<br />
Lubac, H<strong>en</strong>ri <strong>de</strong>)<br />
Soras, Alfred <strong>de</strong> : 289<br />
Spinoza, Baruch : 167, 216, 223<br />
Strohl, H<strong>en</strong>ri : 170<br />
Suárez, Manuel : 280<br />
Symmaque : 40, 65, 127, 328, 329<br />
Thomas d’Aquin : 10, 84, 100,<br />
123, 127, 132, 133, 140, 142-<br />
153, 155-163, 168, 177, 180,<br />
181, 196, 215, 222, 272-274,<br />
284, 286, 289, 296, 297, 301<br />
Thomassin, Louis : 10, 169, 220<br />
Thüsing, Wilhelm : 297, 298, 310<br />
Tihon, Paul : 270<br />
Tisserand, Axel : 126<br />
Tixeront, Joseph : 270<br />
Torrell, Jean-Pierre : 142<br />
Tyrrel, George : 263, 268<br />
Val<strong>en</strong>sin, Auguste : 282<br />
Val<strong>en</strong>tin : 17-19, [52], 56, 58<br />
Vanneste, A. : 194<br />
Vetö, Éti<strong>en</strong>ne : 155<br />
Victor, pape : 15<br />
Vinc<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Lérins : 254, 256<br />
Vital : 91<br />
Vorgrimler, Herbert : 297, 298<br />
Walgrave, Jan H<strong>en</strong>drik : 247, 262<br />
Weger, <strong>Karl</strong>-Heinz : 298<br />
Wiseman, Nicholas : 252<br />
Wolinski, Joseph : 270<br />
Zwingli, Ulrich : 180, 201<br />
Tallon, Alain : 184<br />
Teilhard <strong>de</strong> Chardin, Pierre<br />
<strong>de</strong> : 281, 283, 288<br />
Tertulli<strong>en</strong> : 26, 163, 281, 318<br />
Tetzel, Johann : 174<br />
Theobald, Christoph : 270, 294<br />
Théodoret : 248<br />
Théophile d’Antioche : 79<br />
Thérèse d’Avila : 208
TABLE DES MATIÈRES<br />
Introduction .................................................................................................... 5<br />
1. Qu’est-ce qu’un acte <strong>théologique</strong> ? .................................................. 6<br />
2. Le discernem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s actes <strong>théologique</strong>s .......................................... 8<br />
3. <strong>Les</strong> auteurs ret<strong>en</strong>us et le plan <strong>de</strong> l’ouvrage...................................... 9<br />
Première section<br />
L’ÉPOQUE DES PÈRES DE L’ÉGLISE<br />
Introduction .................................................................................................... 13<br />
Chapitre Ier. Une <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> l’histoire du salut c<strong>en</strong>trée sur le<br />
Christ : Irénée <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong> ............................................................................ 15<br />
A. Le champ <strong>de</strong> la Gnose ...................................................................... 17<br />
B. Le <strong>de</strong>ssein <strong>d’Irénée</strong> face aux gnostiques ........................................ 18<br />
1. Entrée polémique .......................................................................... 19<br />
2. Entrée ecclésiale ............................................................................ 20<br />
3. Entrée scripturaire ........................................................................ 21<br />
4. Entrée thématique ........................................................................ 23<br />
C. <strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong> <strong>d’Irénée</strong> : les trois temps <strong>de</strong> la récapitulation.... 23<br />
1. Irénée héritier du premier acte <strong>théologique</strong> dans le Nouveau<br />
Testam<strong>en</strong>t : Paul ............................................................................ 23<br />
2. À partir <strong>de</strong>s Écritures, la première élaboration d’une <strong>théologie</strong> 24<br />
3. Le <strong>de</strong>ssein <strong>de</strong> la récapitulation dans le Christ............................ 25<br />
4. L’accomplissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>ssein par la v<strong>en</strong>ue du Christ ........ 28
346 Table <strong>de</strong>s matières<br />
5. L’achèvem<strong>en</strong>t eschatologique <strong>de</strong> la récapitulation et le retour<br />
du Christ ........................................................................................ 34<br />
6. Le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> la récapitulation .......................................................... 35<br />
D. La réception patristique et mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> <strong>d’Irénée</strong>.... 37<br />
Chapitre II. Le premier traité systématique. Une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> lecture<br />
<strong>de</strong>s Écritures : Origène ............................................................................ 39<br />
A. L’int<strong>en</strong>tion du traité (Préface).......................................................... 41<br />
B. Premier cycle <strong>de</strong>s Traités (ou Exposé général) (I, 1 — II, 3) .......... 45<br />
1. Premier traité : Sur le Père, le Fils et l’Esprit Saint (I, 1-4) ...... 45<br />
2. Deuxième Traité : <strong>Les</strong> créatures raisonnables (I, 5-8) .............. 48<br />
3. Troisième traité : Le mon<strong>de</strong> visible et les créatures qui s’y<br />
trouv<strong>en</strong>t (II, 1-3) ............................................................................ 52<br />
C. Second cycle <strong>de</strong>s traités (ou questions particulières) (II, 4 — IV, 3) .. 54<br />
1. Premier Traité : Le même Dieu pour l’Anci<strong>en</strong> et le Nouveau<br />
Testam<strong>en</strong>t (II, 4-5) ........................................................................ 54<br />
2. Deuxième Traité : De l’incarnation du Sauveur (II, 6) ............ 55<br />
3. Troisième traité : Le Saint-Esprit (II, 7) ...................................... 56<br />
4. Quatrième traité : L’âme (II, 8-9) ................................................ 57<br />
5. Cinquième traité : La résurrection, le châtim<strong>en</strong>t et les promesses<br />
(II, 10-11) .......................................................................... 58<br />
6. Sixième traité : Sur le libre arbitre (III, 1) .................................. 60<br />
7. Septième traité : Le diable et les puissances adversaires du<br />
g<strong>en</strong>re humain (III, 2-4) ................................................................ 61<br />
8. Huitième traité : Le mon<strong>de</strong> créé a comm<strong>en</strong>cé et est périssable<br />
(III, 5-6) .......................................................................................... 63<br />
D. L’interprétation <strong>de</strong>s Écritures divines. Neuvième traité (IV, 1-3) 64<br />
1. Vaincre les obstacles du texte ...................................................... 65<br />
2. L’inspiration divine <strong>de</strong>s Écritures .............................................. 67<br />
3. Le triple s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’Écriture............................................................ 67<br />
4. L’int<strong>en</strong>tion complexe <strong>de</strong> l’Esprit ................................................ 69<br />
5. Une autre grille et leurs interfér<strong>en</strong>ces ........................................ 70<br />
6. Le passage exist<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> l’Évangile corporel <strong>à</strong> l’Évangile spirituel 72<br />
7. Récapitulation (IV, 4).................................................................... 73<br />
E. Le Traité <strong>de</strong>s principes considéré comme la suite <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux actes<br />
<strong>théologique</strong>s ........................................................................................ 74<br />
1. Une première mise <strong>en</strong> forme <strong>de</strong> la « quaestio » ........................ 74<br />
2. Le résultat <strong>de</strong> cet acte <strong>théologique</strong> .............................................. 78<br />
3. Le <strong>de</strong>uxième acte <strong>théologique</strong> : la mise <strong>en</strong> forme <strong>de</strong> l’interprétation<br />
<strong>de</strong> l’Écriture ........................................................................ 79
Table <strong>de</strong>s matières<br />
347<br />
4. Le résultat <strong>de</strong> ce second acte <strong>théologique</strong> .................................. 80<br />
Chapitre III. Basile <strong>de</strong> Césarée et les relations trinitaires.................. 82<br />
A. L’élaboration rationnelle <strong>de</strong> la distinction trinitaire .................... 85<br />
1. L’hérésie d’Eunome ...................................................................... 85<br />
2. La réponse <strong>de</strong> Basile : noms propres et communs, absolus et<br />
relatifs.............................................................................................. 86<br />
3. <strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong> ........................................................................ 88<br />
B. La constitution d’une formule trinitaire reçue .............................. 90<br />
1. La situation du langage <strong>en</strong> 362 : le Syno<strong>de</strong> d’Alexandrie ........ 91<br />
2. Le combat <strong>de</strong> Basile sur <strong>de</strong>ux fronts .......................................... 94<br />
3. De l’acte <strong>théologique</strong> <strong>à</strong> l’acte dogmatique ................................ 95<br />
Chapitre IV. Augustin : <strong>de</strong> l’accomplissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la patristique <strong>à</strong><br />
la naissance <strong>de</strong> la scolastique .......................................................... 98<br />
A. À questions nouvelles besoin <strong>de</strong> réponses nouvelles .................... 100<br />
B. Augustin et l’accomplissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la rationalité patristique ........ 103<br />
C. De la foi raisonnante <strong>à</strong> la raison croyante ...................................... 106<br />
1. La recherche <strong>à</strong> partir <strong>de</strong>s catégories............................................ 106<br />
2. La recherche <strong>à</strong> partir <strong>de</strong>s images ................................................ 108<br />
D. La récapitulation <strong>de</strong> l’ouvrage.......................................................... 111<br />
E. Augustin et le péché .......................................................................... 113<br />
Bilan <strong>de</strong> la Ire section concernant l’époque patristique ...................... 116<br />
IIe section<br />
LE MOYEN ÂGE OCCIDENTAL<br />
Transition <strong>à</strong> la IIe section : la scolastique et l’usage <strong>de</strong> la raison ...... 123<br />
Chapitre V. Boèce et la naissance <strong>de</strong> la scolastique ............................ 125<br />
1. L’opuscule <strong>de</strong> Boèce sur la Trinité .............................................. 127<br />
2. D’autres opuscules <strong>théologique</strong>s <strong>de</strong> Boèce ................................ 130<br />
3. La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> la question............................................................ 131<br />
4. La nature <strong>de</strong> l’intelligibilité recherchée ...................................... 132<br />
5. Dans le sillage <strong>de</strong> Boèce la naissance <strong>de</strong> la scolastique ............ 133<br />
Chapitre VI. Saint Thomas d’Aquin et la <strong>théologie</strong> comme sci<strong>en</strong>ce .. 142<br />
1. La rationalité scolastique : la <strong>théologie</strong> comme sci<strong>en</strong>ce .......... 143<br />
2. La méthodologie <strong>de</strong> la question : la construction d’un article 146<br />
3. <strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong> : le Comm<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s S<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ces du Lombard 148<br />
4. <strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong> : La Somme contre les G<strong>en</strong>tils ...................... 149<br />
5. <strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong> : la Somme <strong>théologique</strong> ................................ 152
348 Table <strong>de</strong>s matières<br />
6. Un exemple et un chef-d’œuvre : les relations trinitaires ........ 156<br />
7. Saint Bonav<strong>en</strong>ture et l’école franciscaine .................................. 159<br />
Bilan <strong>de</strong> la IIe section sur la <strong>théologie</strong> scolastique ................................ 162<br />
IIIe section<br />
LES TEMPS MODERNES<br />
Transition <strong>à</strong> la IIIe section : les « Temps mo<strong>de</strong>rnes » .......................... 167<br />
Chapitre VII. Luther (1483-1546) et l’acte <strong>théologique</strong> <strong>de</strong> la Réforme 170<br />
1. Une nouvelle figure et un nouvel âge <strong>de</strong> la foi .......................... 171<br />
2. La « conversion » <strong>de</strong> Luther.......................................................... 172<br />
3. L’affaire <strong>de</strong>s indulg<strong>en</strong>ces, la crise et la rupture.......................... 173<br />
4. <strong>L’acte</strong> <strong>théologique</strong> <strong>de</strong> Luther : l’article qui fait t<strong>en</strong>ir ou tomber<br />
l’Église ............................................................................................ 176<br />
5. « En même temps pécheur et juste » .......................................... 176<br />
6. La <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> la croix ................................................................ 178<br />
7. Église visible et Église invisible.................................................... 179<br />
8. Le rôle <strong>de</strong> Calvin............................................................................ 180<br />
Chapitre VIII. <strong>Les</strong> actes du concile <strong>de</strong> Tr<strong>en</strong>te ...................................... 183<br />
A. L’œuvre réformatrice du concile .................................................... 186<br />
B. L’œuvre doctrinale ............................................................................ 187<br />
1. <strong>Les</strong> livres saints et les traditions (4e session).............................. 187<br />
2. Le péché originel (5e session) ...................................................... 191<br />
3. La justification par la grâce moy<strong>en</strong>nant la foi (6e session) ...... 195<br />
4. App<strong>en</strong>dice : la déclaration commune luthéro-catholique sur<br />
la justification (1999) .................................................................... 198<br />
C. Le septénaire sacram<strong>en</strong>tel (7e-24e session) .................................... 200<br />
1. Le débat avec la Réforme sur les sacrem<strong>en</strong>ts ............................ 200<br />
2. Quelques points majeurs <strong>de</strong>s affirmations <strong>de</strong> Tr<strong>en</strong>te .............. 201<br />
D. <strong>Les</strong> tournants pris et la signification du concile ............................ 207<br />
1. Comm<strong>en</strong>t juger le concile <strong>de</strong> Tr<strong>en</strong>te ? ........................................ 207<br />
2. La réception du concile et le « tri<strong>de</strong>ntinisme » .......................... 209<br />
E. Melchior Cano et les lieux <strong>théologique</strong>s. De la question <strong>à</strong> la thèse 211<br />
Chapitre IX. Robert Bellarmin et la <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> controverse.<br />
D<strong>en</strong>is Petau et la <strong>théologie</strong> positive .................................................... 214<br />
1. La <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> controverse : Robert Bellarmin.............................. 216<br />
2. D<strong>en</strong>is Petau et la naissance <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> positive ...................... 219
Table <strong>de</strong>s matières<br />
349<br />
Bilan <strong>de</strong> la IIIe section sur la naissance <strong>de</strong>s Temps mo<strong>de</strong>rnes .......... 224<br />
IVe section<br />
LES XIXe ET XXe SIÈCLES<br />
Transition <strong>à</strong> la IVe section : du xixe siècle <strong>à</strong> l’époque contemporaine 229<br />
Chapitre X. Johann Adam Möhler et l’École <strong>de</strong> Tübing<strong>en</strong> : unité<br />
et diversité dans l’Église .......................................................................... 233<br />
1. R<strong>en</strong>aissance <strong>de</strong> l’ecclésiologie...................................................... 235<br />
2. L’histoire et ses sources : la tradition et les Pères <strong>de</strong> l’Église .. 238<br />
3. La Symbolique au service <strong>de</strong> l’unité : « l’œcuménisme » <strong>de</strong><br />
Möhler ............................................................................................ 240<br />
4. La réception <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> Möhler ...................................... 243<br />
Chapitre XI. John H<strong>en</strong>ry Newman (1801-1890). De l’<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t<br />
d’un croyant pour la vérité au développem<strong>en</strong>t du dogme .......... 245<br />
1. « Je n’ai pas péché contre la lumière » ........................................ 247<br />
2. Des étu<strong>de</strong>s patristiques <strong>à</strong> la question <strong>de</strong> la véritable Église .... 248<br />
3. La question du développem<strong>en</strong>t avant Newman........................ 253<br />
4. Le développem<strong>en</strong>t du dogme comme objet c<strong>en</strong>tral <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong><br />
................................................................................................ 255<br />
5. Valeur et limites <strong>de</strong> l’Essai <strong>de</strong> Newman sur le développem<strong>en</strong>t<br />
du dogme........................................................................................ 261<br />
6. Dans le sillage <strong>de</strong> Newman : une série <strong>de</strong> théories du dévelop -<br />
pem<strong>en</strong>t du dogme.......................................................................... 263<br />
Chapitre XII. Histoire et dogme. De la crise mo<strong>de</strong>rniste au concile<br />
<strong>de</strong> Vatican II ................................................................................................ 265<br />
A. La crise mo<strong>de</strong>rniste <strong>en</strong> Europe au début du xxe siècle ................ 266<br />
B. Une nouvelle génération <strong>de</strong> théologi<strong>en</strong>s ........................................ 271<br />
1. Le P. Marie-Dominique Ch<strong>en</strong>u et l’École du Saulchoir .......... 272<br />
2. Yves Congar, l’ecclésiologie et l’œcuménisme .......................... 275<br />
3. Un travail analogue chez les jésuites : leurs aînés...................... 281<br />
4. H<strong>en</strong>ri <strong>de</strong> Lubac, l’histoire <strong>en</strong>core, et la fécondation <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong><br />
par le retour aux Pères ........................................................ 283<br />
5. Yves <strong>de</strong> Montcheuil, le précurseur, et le premier tournant<br />
christoc<strong>en</strong>trique ............................................................................ 289<br />
6. Jean Daniélou et les origines chréti<strong>en</strong>nes .................................. 291<br />
B. La convocation du concile <strong>de</strong> Vatican II et l’épanouissem<strong>en</strong>t irréversible<br />
d’une époque doctrinale nouvelle ...................................... 293
350 Table <strong>de</strong>s matières<br />
Chapitre XIII. <strong>Karl</strong> <strong>Rahner</strong> et le tournant anthropologique ............ 296<br />
1. Parv<strong>en</strong>ir <strong>à</strong> une foi intellectuellem<strong>en</strong>t honnête .......................... 300<br />
2. L’expéri<strong>en</strong>ce transc<strong>en</strong>dantale <strong>de</strong> l’homme : l’approche philo -<br />
sophique.......................................................................................... 301<br />
3. L’expéri<strong>en</strong>ce transc<strong>en</strong>dantale <strong>de</strong> l’homme : l’approche <strong>théologique</strong><br />
................................................................................................ 302<br />
4. L’homme comme événem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’auto-communication <strong>de</strong> Dieu 307<br />
5. La r<strong>en</strong>contre du Christ comme Sauveur Absolu ...................... 310<br />
6. Le christianisme comme Église .................................................. 315<br />
7. Tournant anthropologique ou anthropoc<strong>en</strong>trisme ?................ 318<br />
8. « J’ai fait l’expéri<strong>en</strong>ce immédiate <strong>de</strong> Dieu » .............................. 320<br />
Bilan <strong>de</strong> la IVe section conduisant <strong>à</strong> l’époque contemporaine ........ 323<br />
Anticipation finale.......................................................................................... 327<br />
1. Une grave objection............................................................................ 328<br />
2. Trois attitu<strong>de</strong>s fondam<strong>en</strong>tales .......................................................... 330<br />
3. Le dialogue <strong>de</strong>man<strong>de</strong> une conversion <strong>à</strong> la mo<strong>de</strong>stie...................... 332<br />
4. Deux ori<strong>en</strong>tations .............................................................................. 333<br />
In<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s noms cités ...................................................................................... 337<br />
Table <strong>de</strong>s matières .......................................................................................... 345
Du même auteur<br />
Chez <strong>Les</strong>sius :<br />
<strong>Les</strong> tr<strong>en</strong>te glorieuses <strong>de</strong> la christologie (1968-2000), <strong>Les</strong>sius, 2012.<br />
Histoire et <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> l’infaillibilité <strong>de</strong> l’Église, <strong>Les</strong>sius, 2013.<br />
Léonce <strong>de</strong> Grandmaison (1868-1927) : un intellectuel témoin du Christ et apôtre<br />
<strong>de</strong> l’Esprit (2015).<br />
Chez d’autres éditeurs :<br />
L’évangile dans l’Église : la tradition vivante <strong>de</strong> la foi, C<strong>en</strong>turion, 1975.<br />
Jésus Christ <strong>à</strong> l’image <strong>de</strong>s hommes : brève <strong>en</strong>quête sur les déformations du visage<br />
<strong>de</strong> Jésus dans l’Église et dans la société, Desclée <strong>de</strong> Brouwer/Bellarmin, 1978.<br />
Jésus dans la tradition <strong>de</strong> l’Église : pour une actualisation <strong>de</strong> la tradition <strong>de</strong><br />
Chalcédoine, Desclée, 1982.<br />
Jésus-Christ, l’unique médiateur : essai sur la ré<strong>de</strong>mption et le salut, 2 vol.,<br />
Desclée, 1988-1991.<br />
Pour une <strong>théologie</strong> œcuménique : Église et sacrem<strong>en</strong>ts, eucharistie et ministère,<br />
la Vierge Marie, Cerf, 1990.<br />
La Résurrection et la vie : petite catéchèse sur les choses <strong>de</strong> la fin, Desclée <strong>de</strong><br />
Brouwer, 1990.<br />
Pédagogie du Christ : élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> christologie fondam<strong>en</strong>tale, Cerf/Médiaspaul,<br />
1994.<br />
Histoire <strong>de</strong>s dogmes (dir.), 4 vol., Desclée, 1994-1996.<br />
« N’ayez pas peur » : regards sur l’Église et les ministères aujourd’hui, Desclée<br />
<strong>de</strong> Brouwer, 1997.<br />
Saint Basile et la Trinité : un acte <strong>théologique</strong> au ive siècle, Desclée, 1998.<br />
Tout récapituler dans le Christ : christologie et sotériologie <strong>d’Irénée</strong> <strong>de</strong> <strong>Lyon</strong>,<br />
Desclée, 2000.<br />
Croire : invitation <strong>à</strong> la foi catholique pour les femmes et les hommes du<br />
xxie siècle, Droguet & Ardant, 1999 ; Invitation <strong>à</strong> croire, Cerf, 2000.<br />
<strong>Karl</strong> <strong>Rahner</strong>, Cerf, 2001.<br />
Le magistère <strong>à</strong> l’épreuve : autorité, vérité et liberté dans l’Église, Desclée <strong>de</strong><br />
Brouwer, 2001.<br />
Le Christ, hier, aujourd’hui et <strong>de</strong>main, Desclée <strong>de</strong> Brouwer, 2003.<br />
« Hors <strong>de</strong> l’Église, pas <strong>de</strong> Salut » : histoire d’une formule et problèmes d’interprétation,<br />
Desclée <strong>de</strong> Brouwer, 2004.<br />
La pati<strong>en</strong>ce et l’utopie : jalons œcuméniques, Desclée <strong>de</strong> Brouwer, 2005.<br />
Le Da Vinci co<strong>de</strong> expliqué <strong>à</strong> ses lecteurs, Seuil, 2006.
Yves <strong>de</strong> Montcheuil : précurseur <strong>en</strong> <strong>théologie</strong>, Cerf, 2006.<br />
L’Évangile et la tradition, Bayard, 2008.<br />
L’Esprit sans visage et sans voix : brève histoire <strong>de</strong> la <strong>théologie</strong> du Saint-Esprit,<br />
Desclée <strong>de</strong> Brouwer, 2009.<br />
Sauvés par la grâce : les débats sur la justification du xvie siècle <strong>à</strong> nos jours,<br />
Éditions Facultés jésuites, 2009.<br />
Christ, Seigneur et Fils <strong>de</strong> Dieu : libre réponse <strong>à</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Frédéric L<strong>en</strong>oir,<br />
Lethielleux, 2010.<br />
De quelques aspects <strong>de</strong> l’Église : paï<strong>en</strong>s et juifs, Écriture et Église, autorité, structure<br />
ministérielle, Desclée <strong>de</strong> Brouwer, 2011.<br />
L’homme, merveille <strong>de</strong> Dieu, Salvator, 2015.<br />
Jésus : voici l’homme, Salvator, 2016.<br />
Imprimé <strong>en</strong> Belgique<br />
Février 2017<br />
Imprimerie Bietlot.
Un acte <strong>théologique</strong>, comme son nom l’indique, est un faire,<br />
un agir, une création. Quelque chose advi<strong>en</strong>t qui n’existait pas. Un<br />
auteur, par la qualité <strong>de</strong> son travail, a fait avancer l’intellig<strong>en</strong>ce<br />
<strong>théologique</strong> sur un point jusque l<strong>à</strong> incertain ou controversé. La<br />
découverte d’un déplacem<strong>en</strong>t et une problématique nouvelle chang<strong>en</strong>t<br />
la situation antérieure et ouvr<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s voies <strong>en</strong>core inconnues.<br />
Le progrès est si parlant qu’il s’impose et provoque, d’emblée ou<br />
l<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t, une large unanimité.<br />
La réception par la communauté <strong>de</strong>s théologi<strong>en</strong>s et plus <strong>en</strong>core<br />
par l’Église est donc indisp<strong>en</strong>sable <strong>à</strong> la réalisation d’un acte <strong>théologique</strong>.<br />
Nul ne peut prét<strong>en</strong>dre qu’il a accompli un acte <strong>théologique</strong>,<br />
comme nul ne peut se prét<strong>en</strong>dre prophète au nom <strong>de</strong> son propre<br />
charisme. Mais les autres, analysant telle ou telle doctrine, peuv<strong>en</strong>t<br />
y voir ce qui va <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir un acte <strong>théologique</strong>. Celui-ci suppose<br />
toujours sa propre réception. L’important ici n’est pas d’abord le<br />
texte mais l’exist<strong>en</strong>ce d’une idée créatrice.<br />
L’ouvrage est divisée <strong>en</strong> 4 sections : 1. Section patristique : Irénée,<br />
Origène, Basile <strong>de</strong> Césarée, Augustin ; 2. Le Moy<strong>en</strong> Âge occi<strong>de</strong>ntal :<br />
Boèce, Thomas d’Aquin ; 3. <strong>Les</strong> Temps mo<strong>de</strong>rnes : Luther, le concile <strong>de</strong><br />
Tr<strong>en</strong>te, Bellarmin, Petau ; 4. Du XIX e siècle <strong>à</strong> l’époque contemporaine :<br />
Möhler, Newman, le Mo<strong>de</strong>rnisme, le concile Vatican II, <strong>Rahner</strong>.<br />
Ce livre r<strong>en</strong>ouvelle profondém<strong>en</strong>t la façon d’<strong>en</strong>visager l’histoire <strong>de</strong><br />
la <strong>théologie</strong>, voire la <strong>théologie</strong> tout court. En outre, il ouvre <strong>de</strong><br />
nombreuses pistes <strong>à</strong> toute personne intéressée par l’histoire <strong>de</strong>s idées.<br />
Bernard SESBOÜÉ, sj, est professeur émérite au C<strong>en</strong>tre Sèvres (Paris).<br />
Il est l’auteur d’une imposante œuvre <strong>théologique</strong>, <strong>en</strong> patristique comme<br />
<strong>en</strong> christologie. Son <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t œcuménique et sa prés<strong>en</strong>tation actualisée<br />
<strong>de</strong> la foi et <strong>de</strong>s ministères dans l’Église l’ont r<strong>en</strong>du célèbre. Il a<br />
publié chez <strong>Les</strong>sius : <strong>Les</strong> « tr<strong>en</strong>te glorieuses » <strong>de</strong> la christologie<br />
(1968-2000) (2012), Histoire et <strong>théologie</strong> <strong>de</strong> l’infaillibilité <strong>de</strong><br />
l’Église (2013) et Léonce <strong>de</strong> Grandmaison (1868-1927) (2015).<br />
ISBN :978-2-87299-300-0<br />
9782872 993000<br />
28,00 €<br />
www.editionsjesuites.com<br />
Illustration : Rembrandt, Philosophe <strong>en</strong> méditation (détail), huile sur bois, 28 × 34 cm, Musée du Louvre (Paris).