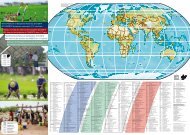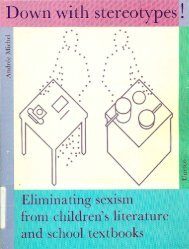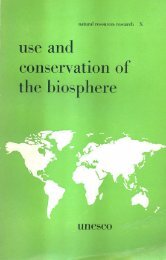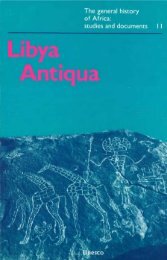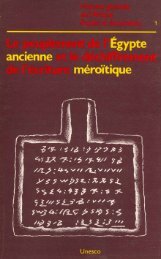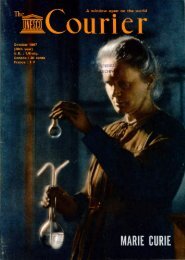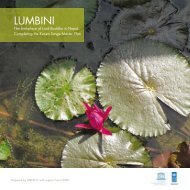Stratégie pour un développement durable du tourisme au Sahara ...
Stratégie pour un développement durable du tourisme au Sahara ...
Stratégie pour un développement durable du tourisme au Sahara ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Depuis <strong>un</strong>e cinquantaine d’années, on assiste à<br />
<strong>un</strong> changement d’attitude des exploitants agri-<br />
coles et des pasteurs des zones sahariennes.<br />
Ceux-ci, par l’effet de multiples contraintes<br />
nouvelles <strong>au</strong>tres que climatiques, se préoccupent<br />
en priorité de répondre à leurs besoins immé-<br />
diats, alimentaires particulièrement, <strong>au</strong>x dépens<br />
d u patrimoine ressource naturelle de leur<br />
exploitation.<br />
La disparition de la fonction conservation <strong>du</strong><br />
patrimoine ressource, devenue impossible <strong>du</strong> fait<br />
de l’incapacité de l’exploitant de dégager <strong>un</strong> sur-<br />
plus, est à l’origine de la dégradation des res-<br />
sources naturelles et de la rupture des équilibres<br />
écologiques. Ces derniers sont très souvent mis<br />
à l’épreuve par <strong>un</strong>e trop forte action anthropique<br />
engendrée par la pression démographique et les<br />
effets de la sécheresse. Parmi ces actions c<strong>au</strong>sant<br />
directement ou indirectement la dégradation des<br />
terres et des milieux arides, on peut citer : la m<strong>au</strong>-<br />
vaise gestion des ressources d’e<strong>au</strong>, la surexploi-<br />
tation agricole, le surpâturage et l’<strong>au</strong>gmentation<br />
des prélèvements de pro<strong>du</strong>its ligneux.<br />
2.1 La gestion des ressources en e<strong>au</strong><br />
2.1 .l Les e<strong>au</strong>x de surfaces<br />
Les ressources en e<strong>au</strong> des régions arides ou semi-<br />
arides proviennent des e<strong>au</strong>x de surface ou des<br />
e<strong>au</strong>x souterraines. Le déficit hydrique qui règne<br />
dans ces régions la majeure partie de l’année, fait<br />
que les e<strong>au</strong>x de surface y sont rares, souvent de<br />
qualité variable et très influencées par l’ampleur<br />
<strong>du</strong> ruissellement. L’écoulement de base des oueds,<br />
interconnecté <strong>au</strong>x nappes souterraines, se carac-<br />
térise par des e<strong>au</strong>x de qualité médiocre ainsi que<br />
par des apports de petites crues à e<strong>au</strong> s<strong>au</strong>mâtre.<br />
Les gueltas constituaient jadis des étapes de repos<br />
<strong>pour</strong> les caravanes.<br />
2.1.2 Les e<strong>au</strong>x souterraines sont soit<br />
renouvelables soit fossiles<br />
Les nappes souterraines à ressources renouve-<br />
lables sont celles qui reçoivent <strong>un</strong>e certaine ali-<br />
II Les enjeux de la gestion<br />
0 des ressources naturelles<br />
et de la lutte contre<br />
la désertification<br />
mentation d’e<strong>au</strong> à l’échelle saisonnière annuelle<br />
ou pluriannuelle. Elles se distinguent par <strong>un</strong>e<br />
dynamique piézométrique, résultante conjuguée<br />
de cette alimentation et de l’exploitation qui en<br />
est faite. Les nappes sont le plus souvent des aquifères<br />
à faible emmagasinement. L’essentiel des<br />
nappes à ressources renouvelables provient <strong>du</strong><br />
ruissellement suite à des pluies dépassant les<br />
20 mm, ou suite à de grandes averses. Cependant,<br />
l’e<strong>au</strong> qui s’infiltre à la suite de petites averses, est<br />
souvent piégée par le sol <strong>pour</strong> être reprise par<br />
l’évaporation. C’est ce qui entraîne la concentration<br />
des sels dissous. Ces sels sont ensuite lessivés<br />
par l’e<strong>au</strong> de pluie qui s’infiltre dans le sol et<br />
sont entraînés jusqu’à la nappe souterraine. Suite<br />
à <strong>un</strong>e surexploitation de la nappe, surtout en<br />
période de sécheresse, parallèlement à <strong>un</strong>e<br />
absence de son alimentation, on observe <strong>un</strong>e<br />
variation chimique de ses e<strong>au</strong>x qui deviennent<br />
très chargées en sel.<br />
L’exploitation de ces nappes se fait souvent à<br />
l’aide de puits de surface ou de forages. Les e<strong>au</strong>x<br />
souterraines fossiles alimentent des nappes profondes<br />
des régions arides et semi-arides. Souvent<br />
captives, elles se caractérisent par <strong>un</strong>e géométrie 3<br />
complexe d’aquifères multicouches et réagissent<br />
à l’exploitation par décompression.<br />
Ainsi, l’exploitation de ces ressources doit<br />
$<br />
m<br />
,9 Ë<br />
se faire en tenant compte <strong>du</strong> caractère non<br />
renouvelable de ces e<strong>au</strong>x et des changements de<br />
2<br />
5<br />
qualité qui peuvent résulter de leur surexploi- 2<br />
tation. L’e<strong>au</strong> des nappes fossiles est souvent 2<br />
exploitée dans les oasis où les cultures irriguées<br />
constituent la principale activité consommatrice<br />
d’e<strong>au</strong>. Un surplus d’irrigation est à l’origine de<br />
2<br />
E<br />
Ë p,<br />
la salification des terres, d’où la nécessité d’avoir $<br />
recours <strong>au</strong> drainage. Pourtant, la création de ><br />
nouvelles superficies gagnées sur les d<strong>un</strong>es et<br />
irriguées convenablement constitue <strong>un</strong>e SO~U-<br />
’<br />
2<br />
;<br />
tion contre l’avancée <strong>du</strong> désert. (L’exemple de &<br />
la nouvelle exploitation agricole de R’Jim .s<br />
Maâtoug dans l’extrême sud T<strong>un</strong>isien est à ce ‘i<br />
propos édifiant). LF<br />
15