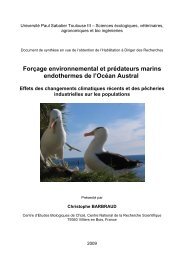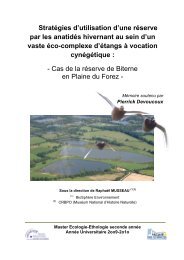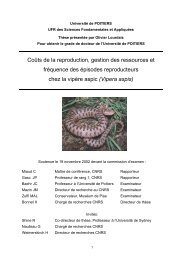DUPOUE A M2 Rapport M2 complet 5 6 11 - CEBC - CNRS
DUPOUE A M2 Rapport M2 complet 5 6 11 - CEBC - CNRS
DUPOUE A M2 Rapport M2 complet 5 6 11 - CEBC - CNRS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
écarter les effets sur les résultats de méthodes différentes du fait des données issues d’études<br />
distinctes (Al-Sadoon 1991 ; Al-Sadoon 1999). Enfin, nous avons pu montrer sur l’ensemble des<br />
espèces comparées, qu’il existe des différences significatives de pertes hydriques transcutanées<br />
selon l’origine biogéographique des espèces. Le degré des pertes hydriques semble en effet<br />
diminuer pour les espèces méditerranéennes qui font face à des conditions d’aridité supérieures. Ces<br />
résultats concordent avec ce qui a déjà été mis en évidence chez les squamates (Bentley and<br />
Schmidt-Nielsen 1966 ; Roberts and Lillywhite 1983). Cependant, cela ne semble pas vrai chez les<br />
Natricidae puisque malgré leur biogéographie différente, les deux espèces considérées ont une<br />
perméabilité cutanée similaire. On peut expliquer cette absence de différence en tenant compte d’un<br />
autre facteur qu’est l’écologie des espèces. En effet, la couleuvre vipérine, Natrix maura est un<br />
prédateur qui chasse à l’affût en milieu aquatique alors que la couleuvre à collier, Natrix natrix est<br />
un prédateur actif terrestre et aquatique (Hailey and Davies 1986). Ainsi, il est probable que le<br />
mode de vie aquatique de la couleuvre vipérine compense en quelque sorte l’aridité du milieu<br />
méditerranéen. La mise en évidence de contrastes dans les pertes hydriques valide notre troisième<br />
prédiction. La combinaison de ces résultats suggère l’existence de compromis dans les adaptations<br />
climatiques du fait de gradients de contraintes inverses. Dans un contexte thermique froid, une<br />
norme de réaction métabolique plus haute permettrait de compenser partiellement ces effets en<br />
assurant une efficacité physiologique supérieure. A l’inverse, les températures élevées<br />
favoriseraient des stratégies d’économies énergétiques et hydriques. Par ailleurs, des compromis<br />
adaptatifs semblent exister. Ainsi, pour les Viperidae, l’espèce boréale, au métabolisme élevé<br />
(avantageux en zone froide), semble particulièrement exposée aux pertes hydriques.<br />
Il devient donc intéressant d’élucider les mécanismes qui permettent de telles adaptations<br />
physiologiques. Pour commencer, nous avons mis en évidence une élévation significative du<br />
métabolisme pour les espèces de zones climatiques plus fraîches. Au niveau cellulaire, il est<br />
possible que cela soit causé par des ajustements d’ordres qualitatifs et/ou quantitatifs. En effet, une<br />
étude a pu montrer chez une espèce de scarabée subantarctique une compensation métabolique en<br />
lien avec une activité enzymatique modifiée en comparaison avec des espèces de zones climatiques<br />
plus chaudes (Haderspeck and Hoffmann 1991). Néanmoins, la mise en évidence d’ajustement du<br />
fonctionnement enzymatique, c'est-à-dire avec énergie d’activation plus basse, est assez peu<br />
documentée. A l’inverse, la densité de mitochondries est un paramètre bien plus souvent invoqué<br />
comme cause d’une compensation métabolique (Chown and Gaston 1999 ; Pörtner 2002 ; Seibel et<br />
al. 2007). La comparaison entre deux espèces de mollusques ptéropodes a fournit une preuve assez<br />
éloquente de l’augmentation en densité mitochondriale comme adaptation au froid (Rosenthal et al.<br />
2009). Afin de compenser un différentiel thermique de 10°C, l’espèce antarctique, Clione<br />
antarctica, présente en effet une abondance en mitochondries deux fois plus élevée que celle<br />
présente chez son équivalent atlantique, Clione limacina (Rosenthal et al. 2009). Pour mesurer le<br />
métabolisme, comparé à la consommation d’O2, ce paramètre est plus précis puisqu’il reflète<br />
directement l’activité mitochondriale et donc de la synthèse d’ATP (Clarke 1993). Il est difficile de<br />
conclure dans notre étude quels processus cellulaires seraient à l’origine de ces différences.<br />
17