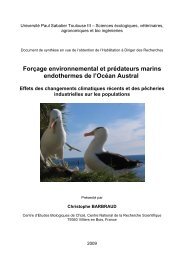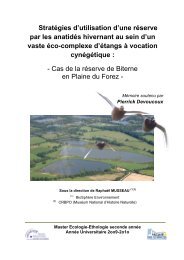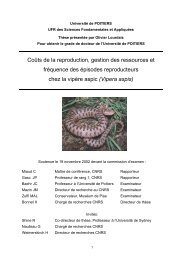DUPOUE A M2 Rapport M2 complet 5 6 11 - CEBC - CNRS
DUPOUE A M2 Rapport M2 complet 5 6 11 - CEBC - CNRS
DUPOUE A M2 Rapport M2 complet 5 6 11 - CEBC - CNRS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
thermique (Hazel and Prosser 1974)). Cette adaptation permettrait aux espèces de conserver un<br />
niveau de performance élevé malgré des températures basses, et ainsi de réussir à compléter leurs<br />
cycles vitaux plus rapidement (Chown and Gaston 1999). Bien que de nombreux doutes aient été<br />
émis quant à la réalité physiologique de cette hypothèse (Holeton 1974 ; Clarke 1980 ; Clarke<br />
1993), plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer pourquoi celle-ci n’est pas supportée<br />
chez des organismes marins (Hazel and Prosser 1970 ; Pörtner et al. 2000 ; Pörtner 2002). Chez les<br />
animaux terrestres, la plupart des études vont néanmoins dans le sens prédit par l’hypothèse comme<br />
l’illustre par exemple une méta-analyse sur 346 espèces d’insectes terrestres (Addo-Bediako et al.<br />
2002). Dans les cas où l’hypothèse n’est pas soutenue, différents auteurs soulèvent l’importance des<br />
méthodes utilisées ou des espèces comparées (Clarke 1980 ; Addo-Bediako et al. 2002 ; Seibel et al.<br />
2007). Deuxièmement, les environnements chauds sont associés à des contraintes thermiques<br />
(températures élevées) qui peuvent fortement augmenter les coûts de maintenance énergétique. Les<br />
contraintes hydriques sont également associées à des milieux chauds tels que le climat<br />
méditerranéen. Ces contraintes hydriques et énergétiques combinées peuvent favoriser une<br />
diminution du métabolisme afin de limiter les dépenses énergétiques mais aussi afin de diminuer les<br />
pertes hydriques respiratoires (Terblanche et al. 2009). L’autre avantage d’un métabolisme diminué<br />
est de réduire les dommages oxydatifs (Robert et al. 2007). Paradoxalement, ce versant des<br />
adaptations métaboliques au chaud chez les ectothermes est moins documenté. De plus, les voies de<br />
pertes hydriques ne sont pas que respiratoires mais également cutanées. Bentley and Schmidt-<br />
Nielsen (1966) et Roberts and Lillywhite (1983) ont en effet pu mettre en évidence que les pertes<br />
hydriques cutanées diminuent significativement lorsque l’aridité de l’environnement augmente. Les<br />
adaptations hydriques au niveau cutané peuvent donc être analysées indépendamment des aspects<br />
respiratoires.<br />
Des ectothermes terrestres tels que les squamates, avec une mobilité restreinte, sont<br />
particulièrement dépendants des conditions microclimatiques qui sont elles-mêmes contrôlées par le<br />
climat. Leurs performances physiologiques et comportementales étant directement affectées par la<br />
température corporelle (Huey and Slatkin 1976 ; Huey and Stevenson 1979 ; Angilletta et al. 2002),<br />
les ectothermes sont directement soumis aux variables climatiques. En Europe, au sein des<br />
différents genres, la répartition des espèces est fréquemment parapatrique. Elles sont clairement<br />
isolées les unes des autres géographiquement selon des gradients climatiques, même s’il est possible<br />
de les trouver localement en sympatrie. Par exemple, la vipère péliade, Vipera berus, et la vipère<br />
aspic, Vipera aspis, peuvent se rencontrer ensemble localement (Loire-Atlantique), bien que leur<br />
distribution dans l’ensemble soit bien distincte : celle de la vipère péliade monte notamment<br />
jusqu’au cercle polaire alors que celle de la vipère aspic s’arrête à la vallée de la Loire. Ce contraste<br />
de répartition est donc très intéressant pour en examiner des adaptations climatiques distinctes. De<br />
plus, cette distribution se rencontre chez des espèces phylogénétiquement proches, ce qui nous<br />
permet de comparer ce qui est comparable. Cela permet de s’affranchir des biais liés à l’histoire<br />
évolutive distincte des espèces (Garland and Adolph 1994) et de ne pas comparer « des pommes<br />
avec des oranges » comme le soulignent Huey and Bennett (1990). Ces aspects font donc des<br />
7