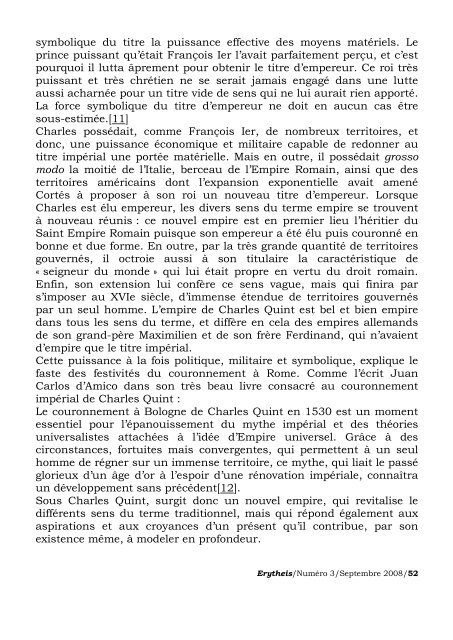L'Empire de Charles Quint : le laboratoire politique de l ... - IDT-UAB
L'Empire de Charles Quint : le laboratoire politique de l ... - IDT-UAB
L'Empire de Charles Quint : le laboratoire politique de l ... - IDT-UAB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
symbolique du titre la puissance effective <strong>de</strong>s moyens matériels. Le<br />
prince puissant qu’était François Ier l’avait parfaitement perçu, et c’est<br />
pourquoi il lutta âprement pour obtenir <strong>le</strong> titre d’empereur. Ce roi très<br />
puissant et très chrétien ne se serait jamais engagé dans une lutte<br />
aussi acharnée pour un titre vi<strong>de</strong> <strong>de</strong> sens qui ne lui aurait rien apporté.<br />
La force symbolique du titre d’empereur ne doit en aucun cas être<br />
sous-estimée.[11]<br />
<strong>Char<strong>le</strong>s</strong> possédait, comme François Ier, <strong>de</strong> nombreux territoires, et<br />
donc, une puissance économique et militaire capab<strong>le</strong> <strong>de</strong> redonner au<br />
titre impérial une portée matériel<strong>le</strong>. Mais en outre, il possédait grosso<br />
modo la moitié <strong>de</strong> l’Italie, berceau <strong>de</strong> l’Empire Romain, ainsi que <strong>de</strong>s<br />
territoires américains dont l’expansion exponentiel<strong>le</strong> avait amené<br />
Cortés à proposer à son roi un nouveau titre d’empereur. Lorsque<br />
<strong>Char<strong>le</strong>s</strong> est élu empereur, <strong>le</strong>s divers sens du terme empire se trouvent<br />
à nouveau réunis : ce nouvel empire est en premier lieu l’héritier du<br />
Saint Empire Romain puisque son empereur a été élu puis couronné en<br />
bonne et due forme. En outre, par la très gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> territoires<br />
gouvernés, il octroie aussi à son titulaire la caractéristique <strong>de</strong><br />
« seigneur du mon<strong>de</strong> » qui lui était propre en vertu du droit romain.<br />
Enfin, son extension lui confère ce sens vague, mais qui finira par<br />
s’imposer au XVIe sièc<strong>le</strong>, d’immense étendue <strong>de</strong> territoires gouvernés<br />
par un seul homme. L’empire <strong>de</strong> <strong>Char<strong>le</strong>s</strong> <strong>Quint</strong> est bel et bien empire<br />
dans tous <strong>le</strong>s sens du terme, et diffère en cela <strong>de</strong>s empires al<strong>le</strong>mands<br />
<strong>de</strong> son grand-père Maximilien et <strong>de</strong> son frère Ferdinand, qui n’avaient<br />
d’empire que <strong>le</strong> titre impérial.<br />
Cette puissance à la fois <strong>politique</strong>, militaire et symbolique, explique <strong>le</strong><br />
faste <strong>de</strong>s festivités du couronnement à Rome. Comme l’écrit Juan<br />
Carlos d’Amico dans son très beau livre consacré au couronnement<br />
impérial <strong>de</strong> <strong>Char<strong>le</strong>s</strong> <strong>Quint</strong> :<br />
Le couronnement à Bologne <strong>de</strong> <strong>Char<strong>le</strong>s</strong> <strong>Quint</strong> en 1530 est un moment<br />
essentiel pour l’épanouissement du mythe impérial et <strong>de</strong>s théories<br />
universalistes attachées à l’idée d’Empire universel. Grâce à <strong>de</strong>s<br />
circonstances, fortuites mais convergentes, qui permettent à un seul<br />
homme <strong>de</strong> régner sur un immense territoire, ce mythe, qui liait <strong>le</strong> passé<br />
glorieux d’un âge d’or à l’espoir d’une rénovation impéria<strong>le</strong>, connaîtra<br />
un développement sans précé<strong>de</strong>nt[12].<br />
Sous <strong>Char<strong>le</strong>s</strong> <strong>Quint</strong>, surgit donc un nouvel empire, qui revitalise <strong>le</strong><br />
différents sens du terme traditionnel, mais qui répond éga<strong>le</strong>ment aux<br />
aspirations et aux croyances d’un présent qu’il contribue, par son<br />
existence même, à mo<strong>de</strong><strong>le</strong>r en profon<strong>de</strong>ur.<br />
Erytheis/Numéro 3/Septembre 2008/52