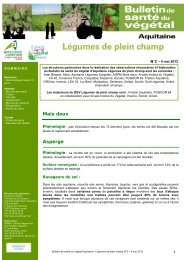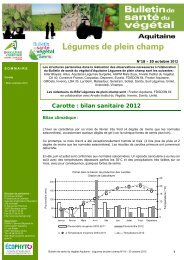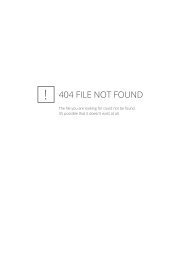Agritaine Bio n°3 - Chambre Régionale d'Agriculture Aquitaine
Agritaine Bio n°3 - Chambre Régionale d'Agriculture Aquitaine
Agritaine Bio n°3 - Chambre Régionale d'Agriculture Aquitaine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
agritaine<br />
Bulletin d’informations bio des <strong>Chambre</strong>s d’agriculture d’<strong>Aquitaine</strong><br />
NUMÉRO 3 FEVRIER 2010<br />
Sommaire<br />
RESULTAT DES ESSAIS<br />
• Comportement agronomique et qualité<br />
des blés biologiques destinés à la<br />
production de farine<br />
• Premiers résultats d’expérimentation<br />
du CREAB<br />
• Bilan des expérimentations sur des<br />
solutions alternatives en viticulture<br />
biologique 2009<br />
• Journée Prune d’Ente du CIREA<br />
JOURNEES TECHNIQUES<br />
REGIONALES<br />
• Grandes cultures : La caravane bio<br />
• Conduite du pommier en agriculture<br />
biologique au CIREA<br />
• Produire du lait de chèvre en bio<br />
• Démonstration matériel entretien<br />
du sol 2009<br />
NOUVELLES DE LA FILIERE BIO<br />
• Un programme régional d’introduction<br />
de produits bio en restauration collective<br />
• La filière lait biologique : Zoom sur<br />
l’<strong>Aquitaine</strong><br />
• La filière bovin lait bio dans les<br />
Pyrénées-Atlantiques<br />
INFOS PRATIQUES<br />
• Bilan de santé de la PAC 2010 :<br />
une redistribution des aides favorables<br />
à l’agriculture biologique<br />
• L’<strong>Aquitaine</strong> à Tech & <strong>Bio</strong><br />
• SIAD - Salon International du <strong>Bio</strong><br />
et de l’Agri-Durable à Agen<br />
• Agenda<br />
• Contacts<br />
<strong>Bio</strong><br />
Dordogne • Gironde • Landes • Lot-et-Garonne • Pyrénées-Atlantiques<br />
L’Agriculture <strong>Bio</strong>logique :<br />
une chance pour nos filières !<br />
Aujourd’hui, nous ne<br />
pouvons plus ignorer<br />
la progression régulière<br />
de la demande<br />
de produits bio, mais<br />
aussi les objectifs fixés par le Grenelle<br />
de l’Environnement, ainsi que les attentes<br />
croissantes de consommateurs en mal de<br />
réassurances.<br />
Depuis déjà plusieurs années, nos <strong>Chambre</strong>s<br />
d’Agriculture se sont engagées<br />
auprès de nos filières agricoles pour les<br />
aider à se structurer, leur permettre de<br />
s’adapter à ces nouvelles contraintes de<br />
marchés, afin de répondre aux attentes<br />
sociétales d’une population, marquée par<br />
des préoccupations environnementales<br />
de plus en plus avérées.<br />
Face aux difficultés rencontrées dans de<br />
nombreux secteurs de productions, à la<br />
concurrence violente qui désorganise<br />
de nombreux marchés et à la chute brutale<br />
des revenus agricoles, la <strong>Bio</strong> est un<br />
secteur d’activité porteur d’espérance et<br />
de développement économique, qui est<br />
régulièrement pris en considération, par<br />
nos équipes que je tiens à remercier à<br />
l’occasion de cet éditorial.<br />
Que ce soit à travers les projets d’expérimentations<br />
animés par nos équipes locales<br />
(voir le premier numéro d’<strong>Agritaine</strong><br />
<strong>Bio</strong>), mais aussi les différents projets<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
menés en collaboration avec ARBIO (journées<br />
filières, démarche de structuration<br />
de la production lait en Périgord, etc.) les<br />
<strong>Chambre</strong>s s’engagent plus que jamais<br />
auprès de leurs ressortissants, pour les<br />
aider à répondre aux attentes d’un marché<br />
en pleine expansion.<br />
Tout au long des prochains mois, notre<br />
<strong>Chambre</strong> <strong>Régionale</strong> s’engagera aussi sur<br />
plusieurs opérations de communications<br />
fortes, telles que le Salon de l’Agriculture<br />
de Bordeaux, les prochaines journées<br />
« <strong>Aquitaine</strong> Nature » et surtout le SIAD<br />
(Salon International de l’Agriculture <strong>Bio</strong>-<br />
Durable), qui se déroulera pour la première<br />
fois à Agen, en juin prochain.<br />
Toutes ces actions constituent autant de<br />
signes forts et manifestes envers l’ensemble<br />
de notre monde agricole, pour<br />
l’encourager à s’engager dans le sens<br />
d’une agriculture plus respectueuse de<br />
notre environnement. Car en intégrant<br />
les enjeux d’un développement durable,<br />
de plus en plus pris en compte par<br />
l’ensemble de nos partenaires politiques<br />
et sociaux, l’Agriculture <strong>Bio</strong>logique peut<br />
réellement devenir une chance pour l’ensemble<br />
de nos filières !<br />
Bernard Lafon,<br />
Président de la commission bio<br />
de la <strong>Chambre</strong> d’agriculture d’<strong>Aquitaine</strong>
Résultats des essais<br />
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 2<br />
<strong>Bio</strong><br />
Comportement agronomique et<br />
qualité des blés biologiques destinés<br />
à la production de farine<br />
Optimiser le rendement des variétés destinées à la production de farine,<br />
évaluer leur comportement face au développement des adventices,<br />
associer les farines issues de différentes variétés pour obtenir le profil de<br />
panification souhaité, définir un coût de production, voici un échantillon<br />
des questions que se posent les agriculteurs bio souhaitant valoriser<br />
leur production de blés biologiques à la ferme. En 2008, la <strong>Chambre</strong><br />
d’agriculture de la Gironde a souhaité répondre à quelques unes de<br />
ces questions et a donc installé un essai blé avec la collaboration d’une<br />
agricultrice bio du Médoc engagée dans une démarche de valorisation<br />
de sa production à la ferme.<br />
Dans ce suivi, nous nous sommes volontairement limités au suivi de sept<br />
variétés de blé meunier et un seigle meunier.<br />
Dans un premier temps, notre attention s’est focalisée sur la connaissance<br />
des variétés notamment par rapport à leur comportement en situation de<br />
concurrence avec les adventices.<br />
Itinéraire cultural :<br />
Rdt en<br />
Qx/ha<br />
PS H% Protéines<br />
APACHE Blé meunier 39,7 76,3 14,2 11,5<br />
ATARO Blé meunier 51,6 79,5 15,2 12,4<br />
ATLASS Blé meunier 43,0 72,0 15,4 11,5<br />
PALLADIO Blé meunier 25,5 74,7 14,9 13,3<br />
AEROBIC Blé meunier 38,7 77,9 13,4 14,5<br />
PIRENEO Blé meunier 44,0 78,6 15,1 14,5<br />
TRISO Témoin<br />
Blé meunier 45,6 77,4 14,9 11,6<br />
CAROASS Seigle meunier 34,4 73,5 14,8 10,4<br />
Moyenne 40,3 76,25 14,74<br />
Blé tendre <strong>Bio</strong> St Vivien Médoc RDT et % de Protéines<br />
Lieu St Vivien du Médoc Agriculteur Elodie AUBERT<br />
Sol<br />
Argileux limoneux profond<br />
Précédent prairie<br />
Préparation Labour, semis combiné rotative<br />
Semis Le 28 novembre 2007 Récolte 20 juillet<br />
Densité de semis 350 grains/m² Fertilisation 1 apport de 1 T de 9-12-0<br />
Désherbage Aucune intervention Protocole Témoin adjacent<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Observations :<br />
La variété Triso confirme son intérêt<br />
dans ce type de sol, notamment grâce<br />
à une bonne vigueur au départ. Elle<br />
possède une bonne capacité à couvrir<br />
le sol et sa taille lui confère un atout<br />
par rapport aux risques fusarioses.<br />
Sa teneur en protéines est par contre<br />
en deçà de nos attentes. ATARO et<br />
PIRENEO présentent quant à elles un<br />
bon compromis qualité rendement. En<br />
terme de couverture du sol, elles sont<br />
par contre moins concurrentes que<br />
Triso dans notre situation. Cependant<br />
ces données sont à relativiser compte<br />
tenu de la faible concurrence d’adventices<br />
dans notre expérimentation due<br />
en partie à un semi tardif.<br />
La réalisation des analyses de teneurs<br />
en protéines est déterminante pour<br />
un agriculteur boulanger. La teneur<br />
en protéines influe notamment sur la<br />
« résistance » de la pâte (tenacité et<br />
élasticité). Les teneurs observées dans<br />
notre essai vont être mises à profit pour<br />
réaliser des panifications séparées<br />
dans un premier temps. Ensuite nous<br />
pourrons associer ces différents profils<br />
de farine bio. L’objectif est par exemple<br />
de trouver un équilibre favorable<br />
a leur utilisation dans des machines<br />
à pain domestiques dont la vente est<br />
en plein développement actuellement.<br />
Cette expérimentation sur les farines
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 3<br />
<strong>Bio</strong><br />
se poursuivra en 2010 par des tests<br />
de panification sur des échantillons<br />
conservés.<br />
Côté coût de production, une approche<br />
des intrants , des coûts de mécanisation<br />
et des charges financières nous<br />
amènent à un montant de 326 €/T environ.<br />
Bien entendu, il s’agit d’un chiffre<br />
moyen pouvant varier dans des proportions<br />
importantes selon l’exploitation.<br />
Coût de production<br />
approché<br />
en €/ha<br />
pour<br />
3T/ha<br />
Intrants 483 161<br />
Mécanisation 375 125<br />
Charges financières et<br />
rémunération<br />
450 150<br />
Aides -330 -110<br />
TOTAL 978 326 €/T<br />
Pour terminer notre étude sur les coûts<br />
de production de la farine et donc disposer<br />
d’un coût plancher de vente de<br />
la farine à la ferme, nous ne disposons<br />
pas à l’heure actuelle des informations<br />
concernant l’étape de la meunerie. Une<br />
prochaine communication fera le point<br />
sur le calcul des charges relatives à<br />
cette étape.<br />
Philippe Mouquot<br />
Conseiller agriculture biologique<br />
(CA Gironde)<br />
Résultat BTH 2009 - Non fertilisé<br />
Le taux de protéine ;<br />
pourquoi ?<br />
La vente pour la panification<br />
est conditionnée<br />
entre autre par<br />
le taux de protéine,<br />
même si le taux de<br />
protéine n’est pas le<br />
seul critère de qualité<br />
pour un blé panifiable,<br />
il n’en reste pas<br />
moins qu’en dessous<br />
de 10 % voire 10,5 % les professionnels de la boulangerie de l’achète pas.<br />
Idéalement il le faudrait entre 11 et 12 %, d’après les résultats du CREAB, il<br />
apparaît que le choix variétal et l’apport de fertilisation est indispensable à<br />
la commercialisation en blé panifiable.<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Premiers résultats<br />
d’expérimentation<br />
du CREAB<br />
Les conditions climatiques ont été particulièrement défavorables sur<br />
la campagne avec des températures plutôt fraîches d’octobre 2008<br />
à mars 2009, suivies d’un printemps plutôt chaud en particulier en<br />
mai et juin. De plus, l’automne 2008 et l’hiver 2009 ont été marqués<br />
par de fortes précipitations. Ceci a eu des conséquences sur les<br />
cultures d’hiver, en particulier, le retard des semis (tous courant janvier<br />
2009), une faible disponibilité en azote due à la lixiviation des sols, un<br />
développement des adventices dû à la faible concurrence des blés.<br />
Essai variétal blé tendre<br />
Semis sur précédent féverole à 400 grains/m² le 8 janvier 2009.<br />
Cet essai a été conduit selon deux modalités : une première sans fertilisant,<br />
et une seconde avec un apport de 80kg/ha le 24 avril après un passage de<br />
herse étrille le 27 mars.<br />
Les composantes de rendements sont faibles avec par exemple 171 épis/m²<br />
(optimum à 400 épis /m²). Parallèlement compte-tenu de la faible disponibilité<br />
d’azote (de l’ordre de 20 kg/ha à la mi-mars), l’engrais a été très bien valorisé<br />
avec un gain de 38% de rendement (+6,5q/ha) et de 1 point de protéine.<br />
Comme le montre le graphique ci-dessous RENAN s’est bien comporté malgré<br />
son semis tardif, PIRENEO confirme son potentiel. NOGAL et PALLADIO<br />
se sont bien comportés. SATURNUS est décevant en particulier aux vues<br />
de son faible rendement :<br />
Essai variétal orge d’hiver et triticale<br />
Semis le 7 janvier 2009, sur précédent pois protéagineux. Les cultures ont<br />
reçu 40 kg d’azote/ha après un passage de herse étrille le 25 mars.<br />
Les orges plus précoces présentent une plus forte densité d’épis au m², en<br />
moyenne 331 épis/m². En revanche la carence azotée a entraîné un faible<br />
nombre de grains par épis (en moyenne 9,9 grains par épis). Le rendement<br />
moyen s’élève tout de même à 33,3 q/ha. L’analyse n’a pas permis de démontrer<br />
une différence de rendement significative entre les variétés testées.<br />
En ce qui concerne les triticales, le nombre moyen d’épis par m² est quant<br />
à lui relativement faible avec 231 épis/m², ce qui donne un rendement .../...<br />
Résultats des essais
Résultats des essais<br />
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 4<br />
<strong>Bio</strong><br />
moyen de 36,3 q/ha. Les variétés WIEL-<br />
FRIED et TREMPLIN se distinguent des<br />
autres variétés testées de par leur plus<br />
fort rendement, talonnées par DUBLET,<br />
alors que les autres décrochent, comme<br />
le montre le graphique ci-après.<br />
Résultat triticale 2009<br />
Essai variétal pois protéagineux<br />
Les conditions climatiques ont été<br />
tellement mauvaises, que les semis<br />
d’automne (fin 2008) n’ont pu être réalisés.<br />
Le semis réalisé le 5 janvier n’a<br />
pu être récolté car entièrement couché<br />
sous l’effet des précipitations et de<br />
l’antrachnose. Seul le semis du<br />
17 février a été récolté avec des rendements<br />
extrêmement faibles. Sur<br />
les variétés testées, PANACHE n’a pu<br />
être récoltée, ALEZAN et ATTIKA ont<br />
donné de meilleurs résultats que LIVIA<br />
et ENDURO pour cette année peu significative..<br />
Pour en savoir plus :<br />
Vous pouvez contacter le CREAB par<br />
téléphone au<br />
05.62.61.71.29<br />
ou par mèl :<br />
auch.creab@voila.fr<br />
L’ensemble des résultats est<br />
disponible sur le site de<br />
l’ITAB : www.itab.asso.fr<br />
Bilan des expérimentations<br />
sur des solutions<br />
alternatives en viticulture<br />
biologique 2009<br />
Ces expérimentations ont été financées par le Contrat Plan Etat<br />
Région, <strong>Chambre</strong> d’Agriculture, les sociétés Cerexagri, Ithec, Vivagro et<br />
Agronutrition.<br />
Introduction<br />
La protection phytosanitaire en viticulture biologique repose exclusivement sur l’utilisation<br />
du cuivre et du soufre dans la lutte contre le mildiou et l’oïdium permettant<br />
d’assurer une protection optimale de la production. Aujourd’hui, le cuivre est utilisable,<br />
selon la réglementation en vigueur, à des apports maximaux de 6 kg/ha/an,<br />
ces apports pouvant être raisonnés sur 5 ans avec un maximum de 30 kg/ha.<br />
Le grand débat sur le cuivre relève d’une étude réalisée par L’AFSSA (Agence Française<br />
de Sécurité Sanitaire des Aliments) concluant sur le risque sérieux pour les<br />
oiseaux, mammifères, organismes du sol et aquatiques. La proposition de l’AFSSA<br />
serait d’utiliser le cuivre à des apports ne dépassant pas 4 kg/ha/an. Aussi, la question<br />
qui se pose est de savoir si cette dose est suffisante dans toutes les situations<br />
agrobiologiques pour solutionner la problématique mildiou.<br />
Il est donc important de pouvoir anticiper et développer des expérimentations sur<br />
les doses réduites de cuivre et sur les solutions alternatives (SDN*, lutte biologique,<br />
PNPP*) .<br />
SDN* : Stimulateur des Défenses Naturelles de la plante.<br />
PNPP* : Produits Naturels Peu Préoccupants.<br />
Expérimentation<br />
Dans le cadre de programmes régionaux, la <strong>Chambre</strong> d’Agriculture de la Gironde<br />
développe des expérimentations sur des thématiques visant à réduire l’utilisation<br />
des produits phytopharmaceutiques au vignoble. Les résultats des essais menés<br />
en 2009 vous sont présentés ci-dessous.<br />
Etude d’efficacité de doses réduites de cuivre<br />
et de stratégies intégrant des produits alternatifs<br />
contre le mildiou de la vigne.<br />
Objectifs<br />
• Tester différentes préparations cupriques<br />
à des doses réduites soit 300 g Cu<br />
par traitement.<br />
• Evaluer l’efficacité de produits alternatifs<br />
en conditions agrobiologiques<br />
associés à des doses très réduites de<br />
cuivre soit 200 g Cu par traitement.<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
NB : Les produits testés ne possèdent<br />
pas d’AMM (Autorisation<br />
de Mise sur le Marché) en tant que<br />
produit phytopharmaceutique.<br />
Selon la réglementation, une utilisation<br />
contre un pathogène requiert<br />
une homologation phytosanitaire<br />
(directive CE 91/414).
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 5<br />
<strong>Bio</strong><br />
Produits testés<br />
Produit Dosage en Cu<br />
de la spécialité<br />
Quantité de<br />
produit apporté<br />
par traitement<br />
Quantité de<br />
Cu apporté<br />
par traitement<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Cu métal<br />
total<br />
Formulation<br />
Témoin non traité<br />
Héliocuivre 400 g/L 0.75 L/ha 0.3 kg/ha 3 kg/ha Hydroxyde de cuivre<br />
BB RSR® 200 g/kg 1.5 kg/ha 0.3 kg/ha 3 kg/ha Sulfate de cuivre<br />
Expe 1 400 g/kg 0.75 kg/ha 0.3 kg/ha 3 kg/ha Sulfate de cuivre<br />
Expe 2 750 g/kg 0.4 kg/ha 0.3 kg/ha 3 kg/ha Oxyde de cuivre<br />
ABE IT 56<br />
1.5 g/L de bouillie Produit alternatif<br />
BBRSR 200 g/kg 1 kg/ha 0.2 kg/ha 2 kg/ha Sulfate de cuivre<br />
Enzymes purifiées<br />
extraites de<br />
4 L/ha Produit alternatif<br />
Trichoderma<br />
BBRSR<br />
200 g/kg 1 kg/ha 0.2 kg/ha 2 kg/ha Sulfate de cuivre<br />
Prev-am<br />
1 L/ha Produit alternatif<br />
BBRSR 200 g/kg 1 kg/ha 0.2 kg/ha 2 kg/ha Sulfate de cuivre<br />
BBRSR 200 g/kg 0.2 kg/ha 2 kg/ha Sulfate de cuivre<br />
Les modalités faisant intervenir les produits alternatifs sont comparées à des témoins de vraisemblance qui reproduisent<br />
ces stratégies à l’identique mais sans l’apport des produits alternatifs. Ainsi, il est possible d’évaluer l’effet positif<br />
ou non du produit au sein de la stratégie de traitement.<br />
Les produits sont associés à une dose réduite de cuivre de 200 g/ha apportée à chaque application. Cette dose faible<br />
de cuivre a été volontairement choisie pour mettre en évidence l’efficacité du produit alternatif associé.<br />
Caractéristiques parcellaires<br />
L’essai a été mis en place sur une parcelle<br />
de Merlot d’une forte vigueur sur<br />
l’appellation Lussac-St Emilion.<br />
La parcelle de vigne est plantée à 1,80 m<br />
entre les rangs et 1 m entre les ceps soit<br />
une densité de 5555 ceps/ha<br />
Dispositif expérimental<br />
L’essai est mené en blocs de Fisher à<br />
4 répétitions. Chaque parcelle élémentaire<br />
est constituée de 10 souches sur<br />
la ligne du rang.<br />
La parcelle comprends 4 rangs d’essai<br />
et 6 rangs de garde permettant de<br />
protéger les modalités de toute dérive.<br />
Des témoins non traités adjacents sont<br />
imbriqués dans le dispositif mais exclus<br />
de l’analyse statistique.<br />
Conditions générales<br />
Pluviométrie<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Données climatiques de la<br />
station de Montagne<br />
Selon les données de l’IFV, le risque<br />
mildiou était important sur l’ensemble du<br />
vignoble Girondin à partir de début mai.<br />
Le modèle indiquait les premières contaminations<br />
épidémiques sur le week-end<br />
du 1er mai selon la pluviométrie. Ces<br />
contaminations étaient plus probables<br />
sur la semaine 19 dans le cas où la pluviométrie<br />
restait modérée sur la semaine<br />
18. Au 27 avril, le modèle n’indiquait<br />
pas un démarrage épidémique explosif<br />
comme il a pu l’être en 2008.<br />
Pluviométrie<br />
Températures moyennes<br />
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11<br />
01/04/2009<br />
05/04/2009<br />
09/04/2009<br />
13/04/2009<br />
17/04/2009<br />
21/04/2009<br />
25/04/2009<br />
29/04/2009<br />
03/05/2009<br />
07/05/2009<br />
11/05/2009<br />
15/05/2009<br />
19/05/2009<br />
23/05/2009<br />
27/05/2009<br />
31/05/2009<br />
04/06/2009<br />
08/06/2009<br />
12/06/2009<br />
16/06/2009<br />
20/06/2009<br />
24/06/2009<br />
28/06/2009<br />
02/07/2009<br />
06/07/2009<br />
10/07/2009<br />
14/07/2009<br />
18/07/2009<br />
22/07/2009<br />
26/07/2009<br />
35<br />
30<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
25<br />
T°C<br />
Au 4 mai, l’EPI diminue et le risque<br />
mildiou stagne. A ce jour, le modèle<br />
n’a pas encore enregistré de contaminations<br />
épidémiques. Les premières<br />
sont annoncées pour la semaine<br />
20. Le 11 mai, le modèle indique les<br />
premières contaminations épidémiques<br />
sur les dernières pluies et<br />
simule d’autres contaminations sur<br />
les prochains jours.<br />
Au 18 mai, l’EPI progresse pour atteindre<br />
le niveau de risque maximal.<br />
Le niveau de risque est équivalent à<br />
celui de 2008 à la même date. .../...<br />
Résultats des essais
Résultats des essais<br />
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 6<br />
<strong>Bio</strong><br />
Alors que très peu de symptômes<br />
sont observés au vignoble, le modèle<br />
indique un fort taux de contaminations<br />
en cours d’incubation de l’ordre<br />
de 50 %.<br />
Au 25 mai, le risque reste au niveau<br />
maximal mais le modèle n’indique<br />
qu’une progression modérée des<br />
contaminations pouvant atteindre<br />
un maximum simulé de l’ordre de<br />
16 à 20 %.<br />
Sur le mois de juin, le modèle indique<br />
une progression des symptômes<br />
exprimés qui devraient s’extérioriser<br />
au cours du mois de juin avec une<br />
expression plus importante sur les<br />
semaines 25 et 26. Sur la dernière<br />
semaine de juin, l’EPI est en diminution<br />
progressive et le modèle indique<br />
une progression moyenne de la FTA<br />
(Fréquence Théorique d’Attaque).<br />
Au mois de juillet, l’EPI progresse<br />
et le risque se maintient à un niveau<br />
fort. Le modèle enregistre une forte<br />
augmentation des contaminations<br />
secondaires et une forte évolution<br />
des symptômes exprimés.<br />
Les résultats<br />
Les notations :<br />
Suite à la prévision d’un risque<br />
de contamination épidémique<br />
(modélisation IFV) annoncé sur le<br />
début du mois de mai, le premier<br />
traitement a été réalisé le 30 avril<br />
en préventif de ces contaminations.<br />
Le 18 mai, les premiers symptômes<br />
sur feuilles sont observés<br />
dans les témoins non traités.<br />
Les conditions climatiques sur le<br />
secteur de Lussac n’ont pas été<br />
favorables au développement du<br />
rot gris et les témoins non traités<br />
ne présentent que de très rares<br />
dégâts sur inflorescences.<br />
Les pluies cumulées de la première<br />
quinzaine de juin ont entraîné<br />
une sortie de rot brun<br />
vers le 1er juillet. Par la suite, les<br />
observations effectuées les 6 et<br />
23 juillet montrent une évolution<br />
significative du rot brun.<br />
La pression parasitaire sur l’essai<br />
mené en conditions naturelles est<br />
d’un niveau faible sur feuillage<br />
avec 10 % d’intensité d’attaques<br />
et d’un niveau modéré sur grappes<br />
avec 44,1 % d’intensité d’attaques<br />
sur le témoin non traité.<br />
Tableau 1 : Fréquences et intensités d’attaques de mildiou sur feuilles au 23 juillet 2009<br />
(test de Newman & Keuls au seuil de 5 %)<br />
Tableau 2 : Fréquences et intensités d’attaques de mildiou sur grappes au 23 juillet 2009<br />
(test de Newman & Keuls au seuil de 5 %)<br />
Modalités<br />
Fréquence Intensité<br />
Moyennes<br />
en %<br />
Efficacités<br />
en %<br />
Moyennes<br />
en %<br />
Efficacités<br />
en %<br />
Groupes<br />
homogènes<br />
M1 : Héliocuivre (0,75 L/hA) 44.5 55.5 9.9 90.1 ns<br />
M2 : BBRSR (1,5 kg/ha) 44.0 56.0 9.1 90.9 ns<br />
M3 : Exp 1 (0,75 kg/ha) 60.5 39.5 18.2 81.8 ns<br />
M4 : Exp 2 (0,4 kg/ha) 61.5 38.5 15.3 84.7 ns<br />
M5 : ABE IT56+BBRSR à 1 kg/ha 58.0 42.0 13.4 86.6 ns<br />
M6 : Enzymes Trichoderma BBRSR à 1 kg/ha 63.0 37.0 21.3 78.7 ns<br />
M7 : Prev-Am+BBRSR à 1 kg/ha 49.3 50.7 9.8 90.2 ns<br />
M8 : BBRSR à 1 kg/ha 61.3 38.7 12.2 87.8 ns<br />
Graphique 1 : Fréquences et intensités d’attaques sur feuilles au 23 juillet 2009<br />
100.0<br />
90.0<br />
80.0<br />
70.0<br />
60.0<br />
50.0<br />
40.0<br />
30.0<br />
20.0<br />
10.0<br />
0.0<br />
100.0<br />
90.0<br />
80.0<br />
70.0<br />
60.0<br />
50.0<br />
40.0<br />
30.0<br />
20.0<br />
10.0<br />
0.0<br />
Modalités<br />
TNT Heliocuivre<br />
(0,75 L/ha)<br />
TNT Heliocuivre<br />
(0,75 L/ha)<br />
BBRSR (1,5<br />
kg/ha)<br />
BBRSR (1,5<br />
kg/ha)<br />
Moyennes<br />
en %<br />
Exp 1<br />
(Sulfate<br />
cuivre)<br />
Exp 1<br />
(Sulfate<br />
cuivre)<br />
Fréquence Intensité<br />
Exp2(Oxyde<br />
cuivre)<br />
Exp 2 (Oxyde<br />
cuivre)<br />
Efficacités<br />
en %<br />
ABEIT56 +<br />
BBRSR à 1<br />
kg/ha<br />
Fréquence Intensité<br />
ABE IT56 +<br />
BBRSR à 1<br />
kg/ha<br />
Moyennes<br />
en %<br />
Enzymes<br />
Trichoderma<br />
+BBRSRà<br />
1kg/ha<br />
Enzymes<br />
Trichoderma<br />
+ BBRSR à<br />
1kg/ha<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Efficacités<br />
en %<br />
Prev-Am +<br />
BBRSR à<br />
1kg/ha<br />
Prev-Am +<br />
BBRSR à<br />
1kg/ha<br />
BBRSR (1<br />
kg/ha)<br />
Graphique 2 : Fréquences et intensités d’attaques sur grappes au 23 juillet 2009<br />
Fréquence Intensité<br />
Groupes<br />
homogènes<br />
M1 : Héliocuivre (0,75 L/hA) 28.3 71.7 2.3 97.7 ns<br />
M2 : BBRSR (1,5 kg/ha) 29.8 70.2 2.7 97.3 ns<br />
M3 : Exp 1 (0,75 kg/ha) 38.3 61.7 3.7 96.3 ns<br />
M4 : Exp 2 (0,4 kg/ha) 38.3 61.7 4.2 95.8 ns<br />
M5 : ABE IT56+BBRSR à 1 kg/ha 40.8 59.2 5.7 94.3 ns<br />
M6 : Enzymes Trichoderma BBRSR à 1 kg/ha 36.3 63.7 3.6 96.4 ns<br />
M7 : Prev-Am+BBRSR à 1 kg/ha 42.0 58.0 5.2 94.8 ns<br />
M8 : BBRSR à 1 kg/ha 45.5 54.5 5.5 94.5 ns<br />
BBRSR (1<br />
kg/ha)
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 7<br />
<strong>Bio</strong><br />
Une analyse statistique<br />
a été réalisée uniquement<br />
entre les modalités<br />
cupriques seules qui<br />
comprennent différentes<br />
spécialités (sulfate,<br />
hydroxyde et oxyde). .<br />
Modalités<br />
Tableau 4 : Fréquences d’attaques de mildiou sur feuilles<br />
au 23 juillet 2009 (test de Newman & Keuls au seuil de 5 %)<br />
Modalités<br />
Moyennes<br />
en %<br />
Tableau 3 : Fréquences et intensités d’attaques de mildiou sur feuilles au 23 juillet 2009<br />
(test de Newman & Keuls au seuil de 5 %)<br />
Moyennes<br />
en %<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Fréquence Intensité<br />
Efficacités<br />
en %<br />
Groupes<br />
homogènes<br />
Moyennes<br />
en %<br />
Efficacités<br />
en %<br />
Groupes<br />
homogènes<br />
M8 : BBRSR à 1 kg/ha 45.5 54.5 ns 5.5 94.5 A<br />
M3 : Exp 1 (0,75 kg/ha) 38.3 61.7 ns 3.7 96.3 B<br />
M2 : BBRSR (1,5 kg/ha) 29.8 70.2 ns 2.7 97.3 B<br />
M1 : Héliocuivre (0,75 L/ha) 28.3 71.7 ns 2.3 97.7 B<br />
Fréquence<br />
Efficacités<br />
en %<br />
M8 : BBRSR à 1 kg/ha 61.3 38.7 A<br />
M3 : Exp 1 (0,75 kg/ha) 60.5 39.5 A<br />
Groupes<br />
homogènes<br />
M2 : BBRSR (1,5 kg/ha) 51.0 49.0 B<br />
M1 : Héliocuivre (0,75 L/ha) 44.5 55.5 B<br />
Les conclusions :<br />
La pression parasitaire moyenne sur la<br />
parcelle d’essai a été modérée sur les<br />
témoins non traités avec près de 45 %<br />
de destruction de récolte en moyenne.<br />
Nous avons pu constater un gradient<br />
de la maladie du haut de la parcelle<br />
vers le bas marqué par une variation de<br />
20 % sur les fréquences et intensités d’attaques<br />
dans les témoins non traités.<br />
Les résultats obtenus dans cet essai<br />
montrent que quelque soit le produit alternatif<br />
utilisé en association à une dose<br />
réduite de cuivre soit 200 g/ha, aucun<br />
gain d’efficacité significatif n’est mis en<br />
évidence. Seul le Prev-Am montrerait<br />
une tendance à améliorer l’efficacité<br />
sur la fréquence (50,7 % d’efficacité<br />
par rapport au témoin de vraisem-<br />
Tableau 5 : Intensités d’attaques de mildiou sur grappes<br />
au 23 juillet 2009 (test de Newman & Keuls au seuil de 5 %)<br />
Modalités<br />
blance présentant 38,7 % d’efficacité)<br />
et intensité d’attaques sur grappes<br />
(90,2 % d’efficacité par rapport au témoin<br />
de vraisemblance présentant 87,8 %<br />
d’efficacité).<br />
Il serait intéressant de poursuivre des<br />
études sur les produits alternatifs dans<br />
le but d’améliorer leur utilisation dans<br />
des programmes de traitements :<br />
quand et comment les positionner ?<br />
En ce qui concerne les modalités de<br />
doses réduites de cuivre (300 g/ha/<br />
traitement), les 2 spécialités les plus<br />
utilisées ( hydroxyde et sulfate) se comportent<br />
de manière identique et présentent<br />
des efficacités similaires sur feuilles<br />
et sur grappes de l’ordre de 97 % sur<br />
les intensités d’attaques sur feuilles et<br />
90 % sur grappes.<br />
Etude de stratégies intégrant des produits alternatifs<br />
contre la pourriture grise de la vigne.<br />
L’essai présenté ci-dessous concerne<br />
un des produits homologué contre le<br />
botrytis Cinerea : le Sérénade.<br />
Dispositif expérimental<br />
Le dispositif expérimental est en blocs de<br />
Fisher à 5 répétitions. Chaque parcelle<br />
élémentaire est constituée de 10 souches<br />
selon la ligne des rangs, 1 témoin non<br />
traité est inclus dans le dispositif.<br />
L’essai a été mis en place sur une parcelle<br />
de Merlot d’une forte vigueur sur<br />
l’appellation Montagne-St Emilion.<br />
Produits testés<br />
Moyennes<br />
en %<br />
Intensité<br />
Efficacités<br />
en %<br />
Groupes<br />
homogènes<br />
M3 : Exp 1 (0,75 kg/ha) 18.2 81.8 A<br />
M8 : BBRSR à 1 kg/ha 12.2 87.8 B<br />
M1 : Héliocuivre (0,75 L/ha) 9.9 90.1 B<br />
M2 : BBRSR (1,5 kg/ha) 9.1 90.9 B<br />
Dans les conditions d’une pression<br />
mildiou modérée (millésime<br />
2009), la modalité cuprique à<br />
200 g/ha/traitement présente une<br />
efficacité intéressante sur grappes.<br />
Qu’en serait-il sur une pression<br />
plus forte ? L’essai mené<br />
en 2008 sur la même parcelle a<br />
montré qu’en pression mildiou<br />
plus forte les 300 g/ha/traitement<br />
ne suffisaient pas à assurer une<br />
protection optimale.<br />
Pour 2010, des expérimentations<br />
seront reconduites sur l’utilisation<br />
de doses réduites de cuivre ainsi<br />
que sur l’utilisation de produits<br />
alternatifs.<br />
Produits Stade A Stade B Stade C Stade D<br />
Témoin non traité Effeuillage mécanique<br />
1 Teldor Effeuillage mécanique Scala<br />
2<br />
Teldor<br />
+<br />
Prev-am<br />
3 Sérénade<br />
4<br />
Sérénade<br />
+<br />
Héliosol<br />
Effeuillage mécanique<br />
Effeuillage mécanique<br />
+<br />
Sérénade<br />
Effeuillage mécanique<br />
Sérénade<br />
+<br />
Héliosol<br />
Scala<br />
+<br />
Prev-am<br />
Sérénade Sérénade<br />
Sérénade<br />
+<br />
Héliosol<br />
Sérénade<br />
+<br />
Héliosol<br />
Résultats des essais
Résultats des essais<br />
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 8<br />
<strong>Bio</strong><br />
Caractéristiques de l’année<br />
Le millésime 2009 est caractérisé par une très faible pression botrytis.<br />
Les conditions climatiques n’ont pas été favorables au développement du champignon<br />
(conditions sèches).<br />
Très peu de dégâts sont donc observés sur la parcelle d’essai avec moins de<br />
10 % d’intensité d’attaques dans les témoins non traités.<br />
Résultats<br />
Le tableau ci-dessous exprime les dégâts de botrytis observés sur les grappes en %<br />
de destruction.<br />
Modalités TNT M1 M2 M3 M4<br />
Témoin<br />
non traité<br />
Teldor A<br />
Scala C<br />
Teldor+Prev-am A<br />
Scala+Prev-am C<br />
Sérénade<br />
A,B,C et D<br />
Sérénade +<br />
Héliosol<br />
A,B,C et D<br />
Fréquence<br />
d’attaque en %<br />
75.1 46 39 68.8 71.6<br />
Groupes homogènes A B B A A<br />
Intensité<br />
d’attaques en %<br />
8.8 1.8 1.2 6.4 6.1<br />
Groupes homogènes A B B A A<br />
Le programme « référence chimique » appliqué seul ou associé au Prev-am présente<br />
les meilleures efficacités. Le Prev-am ne montre pas de gain d’efficacité significatif. La<br />
modalité intégrant les 4 applications Sérénade est significativement moins efficace<br />
que la référence et ne se distingue pas du témoin non traité.<br />
Aujourd’hui, la prophylaxie joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le botrytis<br />
cinérea et devient l’un des critères les plus importants à mettre en œuvre avant toute<br />
application d’un programme de traitements.<br />
Perspectives d’utilisation<br />
des Produits Alternatifs au vignoble<br />
Aujourd’hui, la plupart de ces produits ne sont pas<br />
homologués pour lutter contre les maladies de lavigne.<br />
Les Produits Alternatifs ne suffisent pas à assurer une<br />
protection de la récolte appliqués seuls.<br />
Selon les conditions agronomiques (millésimes),<br />
les résultats obtenus avec les Produits Alternatifs sont<br />
très variables.<br />
Le pôle viti-vinicole de Blanquefort développe des expérimentations<br />
sur l’utilisation de ces produits au vignoble<br />
en conditions agrobiologiques et conventionnelles.<br />
Ludivine Davidou<br />
Responsable Expérimentation Protection du Vignoble<br />
Service Vigne et Vin (CA 33)<br />
Tél. 05.56.35.00.00<br />
mail : l.davidou@gironde.chambagri.fr<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE
agritaine<br />
<strong>Bio</strong><br />
Stratégie de lutte contre le<br />
puceron vert<br />
Objectif de l’essai<br />
La protection contre le puceron vert est<br />
réalisée à partir d’huile blanche qui ne<br />
donne pas entière satisfaction. Aussi<br />
différentes modalités ont été étudiées en<br />
2008 afin d’en déterminer leur efficacité :<br />
huile blanche, huile de neem (sous<br />
forme d’engrais folière), argile calcinée<br />
+ lithotame.<br />
Produits utilisés<br />
OVIPHYT : 817 g/L d’huile minérale<br />
NEEMAZAL T/S : azadiractine 10 g/L<br />
SOLITHE : Lithotame de Maerl<br />
ARGICAL PROTECT : 85 % koalite calcinée<br />
Programme de traitement<br />
Stade C<br />
29/02/08<br />
NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 9<br />
Journée Prune d’Ente<br />
du CIREA<br />
Lors de la journée Prune d’Ente au CIREA, le 2 juillet dernier, un point a été réalisé sur les expérimentations<br />
menées sur le verger Prune d’Ente en agriculture biologique et les résultats obtenus en 2008.<br />
Stade C3<br />
06/03/08<br />
Témoin - -<br />
Huile blanche 15 L/ha 15 L/ha<br />
Huile de neem 2 L/ha 2 L/ha<br />
Argile Calcinée 15 kg/ha + 15 kg/ha +<br />
+ litothame<br />
15 kg/ha 15 kg/ha<br />
Après la première application, une chute<br />
de température nette dans les 24 heures<br />
suivantes a été observée. La première<br />
application n’a donc pas pu avoir l’effet<br />
escompté. En revanche, après la<br />
deuxième application les températures<br />
augmentent ce qui nous place dans une<br />
configuration optimale d’application.<br />
Comptage du nombre de foyers<br />
par arbre<br />
08/04/08 16/04/08 Stat.<br />
Témoin 0.75 27.56 ns<br />
Huile blanche 1.94 29.38 ns<br />
Huile de neem 1.94 20.94 ns<br />
Argile Calcinée<br />
+ litothame<br />
2.17 23.67 ns<br />
Conclusion<br />
Quelles que soient les modalités, aucune<br />
n’a pu limiter le développement du puceron<br />
vert.<br />
Le CIREA souhaite tester à nouveau<br />
la modalité argile calcinée + lithotame<br />
dans une stratégie plus en amont, c’est<br />
à dire en application automnale pour<br />
lutter contre le retour des fondatrices. Un<br />
nouvel essai sera conduit en 2009.<br />
Stratégie de lutte contre Monilia<br />
Laxa<br />
Objectif de l’essai<br />
Il s’agit de comparer différentes modalités<br />
de lutte à base de formulations<br />
cupriques contre le Monilia Laxa. Quatre<br />
stratégies ont été étudiées : le témoin,<br />
une stratégie mixte (cuivre, souffre et<br />
litothame), une stratégie hydroxyde +<br />
soufre et une stratégie basée sur l’utilisation<br />
du cuivrol.<br />
Produits utilisés<br />
CUIVROL : (bore 0,92 %, cuivre 18 %, molybdène<br />
0,04 %, zinc 1,15 %)<br />
KOCIDE 2000 : hydroxyde de cuivre contenant<br />
35 % de cuivre métal<br />
MICROTHIOL : 80 % de soufre micronisé<br />
SOLITHE : CaO 54 %, MgO 5 %, oligo-éléments<br />
Programme de traitement<br />
06/03/08<br />
Témoin -<br />
T1 Mixte<br />
Solithe 4 kg/ha<br />
+Cuivrol 1,2 kg/ha<br />
Microthiol 4 kg/ha<br />
T2 Cuivre hydroxyde<br />
1,2 kg de Kocide 2000<br />
+ Microthiol 5 kg/ha<br />
T3 Cuivrol Cuivrol 3 kg/ha<br />
Comptage du nombre de pousses<br />
infestées par arbre<br />
16/04/08<br />
Nb de foyer<br />
*moyenne<br />
Stat.<br />
Témoin 5,17 ns<br />
T1 Mixte 6,25 ns<br />
T2 Cuivre hydroxyde 5,42 ns<br />
T3 Cuivrol 3,92 ns<br />
Conclusion<br />
Seule la modalité T3 (Cuivrol à 3 kg/ha)<br />
a permis de limiter le développement<br />
du Monilia sur fleur. Les deux autres<br />
modalités n’ont pas permis de lutter<br />
efficacement contre ce champignon<br />
pathogène. Notons que les conditions<br />
climatiques ont été favorables au développement<br />
de la maladie.<br />
Dans la lutte contre Monilia Laxa, il<br />
semble que le cuivrol à 3kg/ha offre une<br />
piste intéressante de travail qu’il faudra<br />
encore approfondir.<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Stratégie de lutte contre Monilia<br />
Fructigena<br />
Objectif de l’essai<br />
Un essai a été mené afin de comparer<br />
différentes stratégies de lutte à base<br />
de formulations cupriques. Trois<br />
stratégies ont été étudiées en plus<br />
du témoin, une mixte (Solithol+Cui<br />
vrol+Microthiol), et les deux suivantes<br />
à base de cuivrol à deux doses<br />
d’application différentes (1 kg/ha et<br />
2 kg/ha).<br />
Programme de traitement<br />
Témoin<br />
18/07/08 rien<br />
05/08/08 rien<br />
12/08/08 rien-<br />
T1<br />
Mixte<br />
Solithe 4 kg/ha<br />
+Cuivrol 0,5 kg/ha<br />
+ Microthiol 2 kg/ha<br />
Solithe 4 kg/ha<br />
+Cuivrol 0,5 kg/ha<br />
+ Microthiol 2 kg/ha<br />
Solithe 4 kg/ha<br />
+Cuivrol 0,5 kg/ha<br />
+ Microthiol 2 kg/ha<br />
T2<br />
Cuivrol<br />
T3<br />
Cuivrol<br />
1 kg/ha 2 kg/ha<br />
1 kg/ha 2 kg/ha<br />
1 kg/ha 2 kg/ha<br />
Fruits prélevés le 18 août 2008<br />
21/08/08<br />
28/08/08<br />
%<br />
monilia<br />
%<br />
pénicillium<br />
%<br />
monilia<br />
%<br />
pénicillium<br />
Conclusion<br />
Témoin<br />
T1<br />
Mixte<br />
T2 T3l<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,83 0 1,67 0<br />
0,83 1,67 0 0,83<br />
Les résultats n’ont pas permis de déterminer<br />
qu’une des modalités se distinguait<br />
des autres. D’autant plus que<br />
les conditions météorologiques ont été<br />
très favorables et ont contribué a un bon<br />
état sanitaire des vergers. Aucun effet de<br />
phytotoxicité n’a été observé malgré les<br />
risques possibles avec le cuivrol.<br />
Le CIREA a poursuivi ses travaux de<br />
recherches en 2009. Le cahier de traitements<br />
réalisés pour la campagne<br />
2009 nous a été fourni lors de la journée<br />
technique, nous pouvons vous le<br />
transmettre à titre indicatif.<br />
Pour en savoir plus :<br />
contacter le CIREA de Frégimont<br />
Tél. 05 53 95 21 13<br />
Résultats des essais
Journées techniques régionales<br />
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 10<br />
<strong>Bio</strong><br />
Journée filière : Grandes cultures<br />
La caravane bio, initiative Lot-et-Garonnaise est organisée en partenariat avec la <strong>Chambre</strong><br />
d’Agriculture de la Dordogne. Cette journée a pour objectif de présenter la filière biologique et des techniques<br />
utilisées dans ce mode de production. Elle vise également à faire échanger ensemble producteurs bio et<br />
conventionnels.<br />
Pour cette première édition la Caravane bio était consacrée à la filière Grandes Cultures.<br />
Près de 60 exploitants en agriculture biologique et conventionnelle y ont participé le 18 juin dernier.<br />
Le matin, Magali Baine, chargée de<br />
mission à ARBIO (Association <strong>Régionale</strong><br />
des Opérateurs <strong>Bio</strong>logiques<br />
d’<strong>Aquitaine</strong>), a présenté le marché<br />
des produits biologiques en France en<br />
insistant particulièrement sur la filière<br />
Grandes Cultures (résultats de campagne<br />
de l’ONIGC). Nicolas Lecat,<br />
directeur de la coopérative AGRIBIO<br />
UNION a présenté la structuration de<br />
la filière Grandes Cultures et quelques<br />
variations de prix suivant les<br />
céréales.<br />
M. Lollivier a présenté son exploitation<br />
situé à Saint-Innocence (24) avec le<br />
matériel, ses cultures, ses rotations,<br />
ses itinéraires techniques. De nombreuses<br />
questions ont été posées.<br />
Les cultures ont été visualisées directement<br />
sur les parcelles avec des<br />
démonstrations de bineuse et herse<br />
étrille.<br />
Bineuse avant chez M. Lollivier sur tournesol<br />
Herse étrille chez M. Lollivier sur soja<br />
L’après midi les agriculteurs ont pu<br />
visiter 2 exploitations en agriculture<br />
biologique, celle de M. Marboutin<br />
à Lavergne (parcelle de blé tendre) et<br />
celle de M. De Lamarlière à Montignac<br />
de Lauzun (parcelle de soja).<br />
Parcelle de blé RENAN chez M. Marboutin<br />
Une démonstration de herse étrille et de<br />
houe rotative a également été réalisée,<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
permettant ainsi aux exploitants de visualiser<br />
concrètement le désherbage<br />
mécanique. Beaucoup d’échanges ont<br />
eu lieu entre agriculteurs sur le matériel<br />
ainsi que les choix des itinéraires<br />
techniques (choix de variétés, dates<br />
de semis, déchaumage, passage de<br />
matériels mécaniques, rotation,…).<br />
Houe rotative chez M. De Lamarlière sur<br />
soja<br />
A partir des visites des exploitations, quelques éléments concernant<br />
les itinéraires techniques :<br />
Tournesol (Alisson) Blé (Renan) Soja (Paoki)<br />
Précédent Céréale à paille Tournesol Soja<br />
Déchaumage<br />
Sitôt après récolte au déchaumeur à<br />
disques indépendants<br />
Fin juillet au déchaumeur à patte d’oie<br />
Fin août et fin sept.<br />
2 déchaumages au<br />
covercrop<br />
Sans objet<br />
Labour Tardif en nov. / dec. En octobre En nov. / dec.<br />
Reprise En février au vibroflex et herse magnum<br />
Début novembre à la herse<br />
alternative<br />
Faux semis Avril au vibroculteur Sans objet<br />
Semis Fin avril en combiné<br />
Début nov. possibilité en<br />
combiné avec la herse<br />
En février au vibroflex<br />
2 à 3 passages de vibroflex<br />
de fev. à mai<br />
Tardif après le 15 mai<br />
Amendement Aucun<br />
800 kg/ha de Fertibio<br />
(9N/12P)<br />
Aucun<br />
Antilimace Ferramol sur les tours de parcelle Aucun Aucun<br />
Lutte contre les adventices<br />
1 à 2 passages de rotario<br />
1 à 2 passages de bineuse Sans objet<br />
Herse étrille<br />
1 passage avant levée<br />
1 passage à 10 cm<br />
1 à 2 passages jusqu’à 25<br />
cm de haut<br />
Rendements moyens 25 quintaux/ha 30 quintaux/ha 25-30 quintaux/ha<br />
Nombre de passages 10 à 12 5 à 6 8 à 10<br />
Pour en savoir plus :<br />
Les fiches présentant les exploitations sont disponibles<br />
auprès de la <strong>Chambre</strong> d’Agriculture de Lot-et-Garonne<br />
et sur son site Internet : http://lot-et-garonne.chambagri.fr.
agritaine<br />
<strong>Bio</strong><br />
NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 11<br />
Journée filière : Pommes bio<br />
Conduite du pommier en agriculture biologique<br />
au CIREA. Le 1er octobre dernier, près de 60 personnes dont plus d’un tiers de producteurs<br />
majoritairement conventionnels, étaient présentes au CIREA pour assister à une réunion technique<br />
concernant la conduite du pommier en agriculture biologique. Cette journée était co-organisée par la<br />
<strong>Chambre</strong> d’Agriculture de Lot-et-Garonne et le CIREA. L’objectif de cette journée était de faire le point<br />
sur la filière bio, sur la conversion à l’agriculture biologique ainsi que sur les expérimentations menées<br />
au CIREA sur le verger de pommiers en bio depuis 1993.<br />
Ainsi, les interventions de Magali Baine, chargée de mission au sein d’ARBIO,<br />
de l’OP Sud-Ouest <strong>Bio</strong> expéditeur en frais de pommes bio, Vitamont et Danival<br />
entreprises transformatrices en<br />
jus et compotes de pommes bio<br />
ont permis d’avoir une vue globale<br />
de la filière et du marché.<br />
La présentation de l’OP Sud-<br />
Ouest <strong>Bio</strong> est en téléchargement<br />
sur notre site.<br />
Le prix payé aux producteurs est<br />
très variable suivant les variétés<br />
pouvant aller du simple au double<br />
avec une moyenne de 1,20 à<br />
1,25 €/kg sortie de station.<br />
Trois producteurs, Monsieur<br />
Guibert qui a converti son verger<br />
existant, Monsieur Jouffrain qui<br />
a planté un verger de Juliet et<br />
Monsieur Reigne qui a planté<br />
un verger de goldrush en bio<br />
ont témoigné de leur passage<br />
en bio, et de leur période de<br />
conversion.<br />
Enfin, Didier Pouzoulet, responsable<br />
du CIREA a explicité<br />
l’itinéraire technique en mode<br />
biologique du verger de pomme<br />
du CIREA en s’appuyant sur<br />
les expérimentations menées<br />
depuis 1993.<br />
Crédit photo : Michel BRU - Revue Réussir Fruits et Légumes<br />
Crédit photo : Michel BRU - Revue Réussir Fruits et Légumes<br />
Une soixantaine de personnes attentives aux<br />
différentes interventions<br />
Présentation des plateaux de variétés de<br />
pommes bio du CIREA<br />
Les fiches « Synthèse des observations variétales » , « La nutrition par la<br />
technique du double apport » et « L’entretien de la ligne de plantation » sont<br />
en téléchargement sur le site Internet de la <strong>Chambre</strong> d’Agriculture de Lot-et-<br />
Garonne, Espace Productions Végétales, rubrique Agriculture <strong>Bio</strong>logique<br />
La <strong>Chambre</strong> d’Agriculture de Lot-et-Garonne et le CIREA vont poursuivre la<br />
rédaction de ces fiches techniques qui permettront aux producteurs souhaitant<br />
se convertir à l’agriculture biologique d’avoir les bases d’un itinéraire<br />
technique de conduite du pommier en bio complet.<br />
Pour en savoir plus, contacter :<br />
Nathalie Rivière, conseillère Arboriculture - Tél. 05 53 77 83 45<br />
Séverine Chastaing, conseillère bio à la CDA 47- Tél. 05 53 77 83 12<br />
Didier Pouzoulet, du CIREA - Tél. 05 53 95 21 13<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Journées techniques régionales
Journées techniques régionales<br />
agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 12<br />
<strong>Bio</strong><br />
Journée filière :<br />
Produire du lait de chèvre en bio<br />
Ce jeudi 26 novembre 2009, à l’initiative de la<br />
Fromagerie de la Lémance et en partenariat avec ARBIO<br />
(Association <strong>Régionale</strong> des Opérateurs <strong>Bio</strong> d’<strong>Aquitaine</strong>) et ASSELDOR (Association<br />
des Eleveurs de Dordogne), les <strong>Chambre</strong>s d’agriculture de la Dordogne et de<br />
Lot-et-Garonne ont organisé une journée « Produire du lait de chèvre en bio .<br />
Cette journée a rassemblé plus de<br />
60 personnes, dont plus de la moitié<br />
d’éleveurs en conventionnel, en cours<br />
de conversion ou bio, des techniciens<br />
ainsi que des étudiants du Lycée agricole<br />
de Nérac.<br />
Au cours de la matinée, trois groupes<br />
ont été constitués pour visiter la fromagerie,<br />
avoir une information sur le marché<br />
et les filières bio et enfin connaître<br />
les principes de la réglementation et des<br />
aides à la conversion disponibles.<br />
Lors de la visite de sa Fromagerie,<br />
son directeur et créateur Monsieur<br />
Inquimbert et son personnel, nous ont<br />
fait découvrir tout le cheminement du lait<br />
pour obtenir des fromages : la concentration<br />
du lait, le caillage, l’affinage et<br />
l’emballage. La fromagerie est très présente<br />
sur le secteur bio, même si elle<br />
garde une petite part en conventionnelle<br />
(2 %). Elle a une croissance de 30 % par<br />
an depuis trois ans, essentiellement due<br />
à l’augmentation des ventes en fromages<br />
de chèvres bio. 1,2 millions de litres de<br />
lait de chèvre bio sont actuellement transformés<br />
et Monsieur Inquimbert estime<br />
qu’à horizon 2010, se sont 2 millions de<br />
litres qui seront transformés.<br />
La Fromagerie de la Lémance commercialise<br />
ses produits sous sa propre<br />
marque auprès de magasins spécialisés<br />
bio mais aussi sous marque distributeur<br />
pour le réseau des magasins spécialisés<br />
et pour la grande distribution.<br />
Aujourd’hui seule la moitié du lait de<br />
chèvre bio transformé à la fromagerie<br />
est produit localement. Monsieur<br />
Inquimbert souhaite à l’avenir augmenter<br />
ses approvisionnements bio locaux et<br />
espère que des producteurs de sud Dordogne<br />
et du Lot-et-Garonne se convertiront<br />
ou s’installeront en bio. Monsieur<br />
Inquimbert rétribue ses éleveurs à partir<br />
d’un prix de base réévalué en fonction<br />
des taux de protéines et de matières<br />
grasses, pour arriver en moyenne à<br />
20 % plus cher qu’en conventionnel.<br />
Visite d’une des salles d’affinage<br />
Magali Baine présente le marché<br />
des produits bio<br />
Jacques Tournade présente<br />
les principes de la bio<br />
Visite du bâtiment d’élevage caprin<br />
Magali Baine, chargée de mission à<br />
ARBIO a, quant à elle, présenté le marché<br />
bio en France et la place importante<br />
des produits laitiers qui sont le 2ème produit<br />
le plus consommé après les fruits et<br />
légumes bio. 56 % de ces consommateurs<br />
n’achètent leur produits laitiers que<br />
sous le label « Agriculture <strong>Bio</strong>logique ».<br />
Cette filière offre un bon potentiel de<br />
progression.<br />
Jacques Tournade et Séverine Chastaing<br />
ont présenté la réglementation bio en<br />
matière d’élevage caprin :<br />
- une alimentation 100 % bio<br />
- une ration composée à 60 % de fourrages<br />
grossiers<br />
- un mode d’alimentation basée sur les<br />
pâturages<br />
- 13,3 chèvres par ha maximum<br />
- 1,5 m² par chèvre et 0,35m² par chevreaux<br />
d’espace dans le bâtiment.<br />
Après un repas gracieusement offert par<br />
la Fromagerie de la Lémance, le groupe<br />
s’est rendu chez Monsieur Sottoriva à<br />
Saint-Beauzeil qui nous a présenté son<br />
élevage caprin de 200 têtes avec son<br />
associé Benjamin Bonifay. Cet élevage<br />
de 220 chèvres qui vient de démarrer, a<br />
basé son système fourrager sur l’utilisation<br />
du pâturage (mélange dactyle, trèfle<br />
blanc), la mise en place de luzerne (20 ha<br />
ont été mis en culture) et un concentré<br />
fermier constitué d’un mélange céréales/pois/vesce<br />
cultivé en méteil. Cette<br />
année, un complément azoté sous forme<br />
de tourteau de soja bio (720 € tonnes)<br />
a également été apporté. Ce ne devrait<br />
plus être le cas à l’avenir, avec le développement<br />
de la luzerne. La productivité<br />
par chèvre en primipare était de l’ordre<br />
de 550 litres par chèvre.<br />
Vous pouvez télécharger<br />
sur le site internet de la CDA 40 :<br />
- la fiche présentant l’exploitation de<br />
l’EARL DEMETER<br />
- la fiche de présentation de l’exploitation<br />
de Monsieur Coulbois (Thézac) qui a<br />
un élevage caprin de 50 bêtes.<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
ASSELDOR<br />
ASSociation des<br />
ELEveurs de<br />
DORdogne
agritaine<br />
<strong>Bio</strong><br />
NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 13<br />
Journées démonstration matériel<br />
entretien du sol 2009<br />
Retour sur les journées de<br />
démonstration de matériels<br />
d’entretien du sol viticole en<br />
Gironde.<br />
La <strong>Chambre</strong> d’Agriculture de la Gironde,<br />
les Associations de Développement<br />
Agricole et Rural (ADAR) et le Pôle de<br />
Compétences Phytosanitaires* ont<br />
présenté du 29 juin au 3 juillet, différents<br />
matériels : travail mécanique, contrôle<br />
par tonte ou bien encore régulation<br />
thermique.<br />
Testés dans différentes configurations<br />
de vignobles et sur des sols variés allant<br />
du sablo-graveleux à l’argilo-calcaire<br />
compacté, les matériels proposés ont<br />
été mis à rude épreuve.<br />
Les outils de travail mécanique<br />
Arrizza : récemment distribué dans<br />
notre région. L’outil présenté était une<br />
lame montée sur un porte-outils susceptible<br />
de recevoir d’autres équipements<br />
(outil rotatif à axe horizontal ou vertical,<br />
tondeuse ou déchausseur à disques).<br />
Le porte-outil dispose de nombreuses<br />
possibilités de réglage dont le dévers<br />
indépendant pour chaque côté.<br />
Belhomme : la sensibilité de son<br />
déclenchement électro-hydraulique a<br />
impressionné. Des lames de déchaussage<br />
sont proposées ainsi qu’un petit corps<br />
de chaussage qui permet de réaliser le<br />
chaussage en passant au plus près des<br />
ceps, sans altérer le passage des roues<br />
du tracteur. Il est à noter que ce constructeur<br />
travaille sur un outil qui permet en un<br />
seul passage de réaliser un déchaussage<br />
suivi d’un<br />
rechaussage,action<br />
plus<br />
agressive<br />
sur les<br />
adventicesinstallées<br />
sous<br />
le rang<br />
que celle<br />
d’une<br />
simple<br />
lame.<br />
Belhomme<br />
Boisselet : parmi la panoplie<br />
particulièrement fournie des<br />
outils adaptables sur les servomoteurs,<br />
on notera également<br />
la présence de lames. Parfois<br />
montées sur l’Acolyte (porteoutil<br />
enjambeur tracté), les<br />
lames ont aussi été remplacées<br />
par des outils rotatifs de type<br />
Pétalmatic ou Starmatic, qui<br />
ont montré une efficacité satisfaisante<br />
dans les conditions de<br />
l’essai. On peut légitimement<br />
se poser la question de l’utilisation du<br />
porte-outil Acolyte dans des parcelles<br />
qui ne bénéficient pas d’allées très<br />
larges car les temps pour tourner atteignent<br />
souvent la minute.<br />
Braun : avec ses nombreuses variantes<br />
allant du montage sur enjambeur à<br />
des adaptations à l’avant, à l’arrière ou<br />
latérales sur interlignes, la production<br />
allemande fait preuve elle aussi d’une<br />
intéressante polyvalence et permet<br />
également des vitesses d’avancement<br />
élevées, avec une bonne sensibilité de<br />
déclenchement. Les montages à l’avant<br />
ou latéraux libèrent l’arrière du tracteur<br />
pour les stratégies combinées.<br />
Clemens : le retour. Après avoir quasiment<br />
délaissé le marché girondin,<br />
Clemens revient en force avec l’aide de<br />
Monsieur Boireau (DEPAN’AGRIC Saint-<br />
Magne de Castillon) qui sur le cadre SB1<br />
de sa conception, adapte derrière des<br />
lames classiques un dispositif rotatif de<br />
bineuse à doigts qui réalise l’émottage<br />
de la bande travaillée.<br />
Egretier : présentation au cours d’une<br />
des journées de démonstration de<br />
leur porte-outil autostable, qui a<br />
démontré une capacité de travail à<br />
faible profondeur, avec une bonne<br />
régularité.<br />
Guyard : présentation lors de deux<br />
journées d’un équipement sur enjambeur<br />
constitué d’une bêche roulante<br />
Cultisamp de leur fabrication, ayant<br />
une bonne efficacité dans l’inter-rang,<br />
associée à des lames interceps de<br />
chez Actisol, dont la particularité est<br />
un retour en position sous le rang par<br />
équilibre des forces sur les 2 ailes<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Boisselet<br />
Braun<br />
de la lame. Cet outil ne demande<br />
aucun apport énergétique autre que<br />
la traction.<br />
Pellenc : le Tournesol muni de couteaux<br />
minces réalise un travail très<br />
superficiel, mais peut occasionner<br />
quelques blessures aux bourrelets<br />
proéminents.<br />
Pellenc<br />
Journées techniques régionales
Journées techniques régionales<br />
NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 14<br />
agritaine <strong>Bio</strong><br />
Souslikoff : présentation sur<br />
sa Décalex Air, outil de travail du<br />
sol à assistance pneumatique, de<br />
lames bineuses en remplacement<br />
des traditionnels corps de charrue<br />
décavaillonneuse en 8 pouces. Le<br />
dispositif de suivi de sol automatisé<br />
par jauge de contrainte équipait<br />
aussi ce matériel.<br />
Souslikoff<br />
D’une manière générale, la limite<br />
d’efficacité de ces outils de travail<br />
mécanique peut être atteinte lorsque<br />
des interventions déstructurant<br />
peu le couvert végétal sont suivies<br />
d’une période pluvieuse favorisant<br />
la reprise de végétation.<br />
Montée en puissance des lames<br />
interceps<br />
Les lames interceps (Arrizza, Belhomme,<br />
Braun, Clemens et Souslikoff)<br />
confirment leur retour en<br />
force, observé depuis quelques<br />
années. Les sols de Rauzan, certes<br />
peu envahis par les adventices mais<br />
particulièrement compactés par une<br />
forte tradition d’utilisation des herbicides<br />
chimiques, ont permis de démontrer<br />
une surprenante capacité<br />
de pénétration de ces outils. Dans<br />
ces conditions de forte compaction,<br />
les dents rigides qui précédaient<br />
la lame ont largement favorisé la<br />
pénétration de l’outil.<br />
Les lames réalisent un travail moins<br />
profond que les décavaillonneuses<br />
classiques mais respectent mieux<br />
les ceps au système racinaire installé<br />
en surface et apparaissent de<br />
ce fait plus adaptées pour un retour<br />
au travail mécanique des sols. Elles<br />
permettent en outre d’envisager des<br />
vitesses d’avancement plus élevées,<br />
de l’ordre de 5 à 6 km/h, dans de<br />
bonnes conditions.<br />
Actuellement, les constructeurs fournissent<br />
de gros efforts de recherche<br />
(conception des lames ou accessoires)<br />
afin d’optimiser cette technique<br />
et lui donner encore plus de poly-<br />
valence. De nombreuses variantes de<br />
lames sont par exemple conçues pour<br />
réaliser un pseudo décavaillonnage<br />
avec des lames équipées de déflecteurs,<br />
souvent appelés bavettes.<br />
Maîtrise des adventices par tonte<br />
Les tondeuses à lames et rotofils<br />
connaissent actuellement un joli succès.<br />
Deux marques présentaient des tondeuses<br />
à lames, VitiMeca et Védélago,<br />
alors qu’Aviff 33 proposait sa version<br />
rotofil, pouvant également recevoir<br />
des lames. La version rotofil permet<br />
une meilleure approche du cep que<br />
la version à lames. Ces outils peuvent<br />
permettre d’intervenir en « urgence »,<br />
en passant dans des vignes fortement<br />
envahies par l’herbe.<br />
Védélago<br />
Aviff 33<br />
VitiMeca présentait également, en avant<br />
première, le Rolojack, une variante de<br />
Rolofaca. Le Rolofaca, dérivé du rouleau<br />
landais, assure une régulation de<br />
la poussée des herbes par pincement<br />
des tiges, traditionnellement réalisé<br />
grâce au poids de l’outil. La particularité<br />
du Rolojack réside dans le fait que<br />
la pression sur le sol est assurée par<br />
un report de masse du tracteur sur le<br />
rouleau, par l’intermédiaire d’un vérin<br />
hydraulique. L’action de ce rouleau se<br />
fait sur une végétation déjà développée<br />
qui est pincée et couchée au sol, formant<br />
ainsi une sorte de mulch. Devant<br />
être livré à un client, ce tout nouveau<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
matériel n’a malheureusement pas pu<br />
prendre part à la démonstration.<br />
Régulation thermique<br />
Jaulent persiste dans le désherbage<br />
thermique de la vigne mais fait évoluer<br />
son matériel vers la polyvalence avec la<br />
possibilité de réaliser de l’effeuillage et<br />
de l’épamprage thermique. En option,<br />
une lance de finition manuelle superbement<br />
réalisée peut également équiper<br />
cet outil. Les conditions sèches lors de<br />
ces journées et la période d’intervention<br />
fort tardive n’ont pas permis de placer ce<br />
matériel dans des conditions normales<br />
d’utilisation. Une très bonne efficacité a<br />
cependant pu être notée sur prêle.<br />
Jaulent<br />
Quelle que soit l’alternative envisagée,<br />
le temps de travail s’avère supérieur à<br />
celui d’une stratégie chimique. C’est<br />
pourquoi l’acceptation d’un certain niveau<br />
de développement des adventices<br />
s’inscrit comme une condition indispensable.<br />
Dans cette optique, il convient<br />
de soigner les premiers passages au<br />
printemps pour ne pas être débordé<br />
par la suite, et de n’intervenir, le reste<br />
de la saison, que lorsque les adventices<br />
deviennent trop envahissantes, de<br />
manière à ne pas multiplier inutilement<br />
les passages. A noter que les stratégies<br />
de travaux combinés peuvent participer<br />
également à une nette réduction des<br />
temps de travaux, en association avec<br />
du rognage par exemple.<br />
Etienne Laveau,<br />
Conseiller Viticole <strong>Bio</strong><br />
Service Vigne et Vin de la CA 33<br />
e.laveau@gironde.chambagri.fr<br />
D’après Lettre actualités n°43 - nov. 2009<br />
Maxime Christen : CA 33, Service Vigne et Vin<br />
Alain Martinet : Pôle phyto de Blanquefort<br />
* Le Pôle de compétences Phytosanitaires réunit l’Etablissement Public<br />
Local d’Enseignement et de Formations Professionnelles Agricoles de<br />
Blanquefort, la <strong>Chambre</strong> d’Agriculture de la Gironde, la Direction <strong>Régionale</strong><br />
de l’Agriculture et de la Forêt et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
agritaine<br />
<strong>Bio</strong><br />
NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 15<br />
Un programme régional<br />
d’introduction de produits bio en<br />
restauration collective : le Conseil régional<br />
et l’Etat conventionnent avec ARBIO <strong>Aquitaine</strong><br />
Le Grenelle de l’Environnement a donné<br />
un essor important aux notions de<br />
développement durable et de respect<br />
de l’environnement. La consommation<br />
de produits issus de l’agriculture biologique<br />
suit naturellement cette évolution<br />
avec une augmentation annuelle de<br />
10 % du marché des produits bio sur<br />
le territoire national depuis 1999 et une<br />
augmentation record de consommation<br />
de produits biologiques de<br />
+ 25 % entre 2007 et 2008 (AGENCE<br />
BIO, 2009).<br />
L’Agence <strong>Bio</strong> et le CSA publient chaque<br />
année le « baromètre » de la consommation<br />
française de produits biologiques.<br />
Le 5ème baromètre CSA/Agence BIO,<br />
réalisé en octobre 2008, montre que<br />
78 % des parents d’élèves mangeant<br />
en restauration collective souhaitent<br />
que leurs enfants puissent avoir des<br />
produits biologiques dans leurs assiettes<br />
et 44 % des adultes souhaitent<br />
également avoir des repas biologiques<br />
dans leurs restaurants d’entreprises<br />
(CSA et AGENCE BIO, 2009).<br />
Cette évolution de la demande de<br />
produits biologiques en restauration<br />
collective est en phase avec les conclusions<br />
du Grenelle de l’Environnement,<br />
qui fixent comme objectifs d’atteindre<br />
15 % d’approvisionnement bio d’ici à<br />
2010 en restauration collective publique,<br />
puis 20 % en 2012. Ces objectifs<br />
ont par la suite été entérinés dans la loi<br />
du 3 août 2009 sur la mise en application<br />
des conclusions du Grenelle.<br />
Face à cette évolution structurelle de la<br />
demande de produits biologiques en<br />
France en général et dans la restauration<br />
collective en particulier, la filière<br />
biologique régionale est aujourd’hui en<br />
train de se structurer pour être en capacité<br />
à terme de répondre à cette demande.<br />
ARBIO <strong>Aquitaine</strong>, qui regroupe<br />
les opérateurs de la filière biologique<br />
en <strong>Aquitaine</strong>, a déjà coordonné en<br />
2009 en partenariat avec la <strong>Chambre</strong><br />
d’Agriculture de Lot et Garonne et le<br />
Civam Agro <strong>Bio</strong> 47, la mise en place de<br />
produits biologiques sur le Restaurant<br />
Inter Administratif (RIA) d’Agen qui sert<br />
aujourd’hui 3 menus bio par semaine<br />
et la totalité de sa gamme de fruits et<br />
de pain en bio pour ces 350 convives<br />
journaliers soit plus de 16 % de son<br />
offre. Ce projet pilote sera étendu à<br />
deux nouveaux restaurants administratifs<br />
en 2010.<br />
Pour confirmer ce premier essai,<br />
ARBIO <strong>Aquitaine</strong> a ainsi organisé le<br />
25 novembre dernier le 1er Forum<br />
Régional « Introduire des produits<br />
bio en restauration collective » au<br />
Conseil Régional afin de mettre en<br />
perspective les objectifs du Grenelle<br />
en terme de restauration collective au<br />
niveau régional. Pour organiser cette<br />
manifestation ARBIO a rassemblé ses<br />
partenaires (Conseil Régional, DRAAF,<br />
Agence <strong>Bio</strong>, Un Plus <strong>Bio</strong>, Ademe <strong>Aquitaine</strong>)<br />
avec des interventions de groupements<br />
de producteurs adhérents<br />
(Civam <strong>Bio</strong> Béarn, CABSO, SCA Pré<br />
Vert, OP Sud Ouest <strong>Bio</strong>, <strong>Bio</strong>garonne,<br />
CELPA) et des témoignages d’introduction<br />
(Restaurant Inter-administratif<br />
d’Agen et SIVU Bordeaux Mérignac).<br />
Co-présidée par Béatrice GENDREAU,<br />
vice-présidente de la Région et Patrick<br />
GRIZOU, Président d’ARBIO, la matinée<br />
a rassemblé plus de 230 participants<br />
(gestionnaires et élus).<br />
Ce succès doit à présent être suivi et accompagné.<br />
Dans ce cadre et dès 2010,<br />
le Conseil Régional d’<strong>Aquitaine</strong> et la<br />
DRAAF ont décidé de conventionner<br />
avec ARBIO pour suivre l’introduction<br />
de produits biologiques dans un groupe<br />
pilote de lycées agricoles, généraux<br />
et professionnels en 2010. L’objectif est<br />
d’expérimenter l’introduction de produits<br />
bio et de produits locaux sur un<br />
nombre réduits de restaurants collectifs<br />
en 2010 pour généraliser à un plus<br />
grand nombre d’établissements d’ici à<br />
2012 et respecter à terme les objectifs<br />
du Grenelle de l’Environnement au<br />
niveau régional.<br />
En parallèle, les adhérents d’ARBIO<br />
<strong>Aquitaine</strong> (groupements de producteurs,<br />
coopératives, transformateurs et<br />
distributeurs) et des Civams <strong>Bio</strong> sont<br />
en train de mutualiser leurs offres de<br />
produits bio afin de créer un catalogue<br />
de produits bio régionaux adaptés aux<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
besoins de la restauration collective.<br />
Cette gamme bio régionale<br />
sera prochainement disponible sur<br />
www.biosudouest.com<br />
Afin de répondre à la demande de<br />
la restauration collective et atteindre<br />
en 2012 les objectifs du Grenelle de<br />
l’Environnement, ARBIO <strong>Aquitaine</strong> a<br />
estimé les besoins de la restauration<br />
collective à plus de 900 ha supplémentaires<br />
de fruits et légumes bio,<br />
10 millions de litres de lait ou encore<br />
600 ha de céréales bio rien que<br />
pour fournir le pain nécessaire à ce<br />
marché. Cela montre les perspectives<br />
de développement ambitieuses<br />
que la filière bio a devant elle pour<br />
atteindre 20 % de produits bio en<br />
restauration collective en 2012. Il est<br />
aujourd’hui donc plus que jamais<br />
nécessaire d’accompagner et de<br />
fédérer les projets d’approvisionnement<br />
bio en restauration collective<br />
sur la région. Ce développement ne<br />
pourra se faire qu’en :<br />
- associant en amont les organismes<br />
de développement de l’agriculture<br />
biologique dans la rédaction des<br />
cahiers des charges et des appels<br />
d’offres ;<br />
- contractualisant avec les opérateurs<br />
biologiques sur des volumes<br />
pérennes et réguliers ;<br />
- se basant sur la force de rassemblement<br />
des groupements de<br />
producteurs et des entreprises biologiques<br />
régionales ;<br />
- raisonnant l’approvisionnement à<br />
l’échelle du bassin de production<br />
Sud Ouest.<br />
Le pôle régional de<br />
compétence et d’accompagnement<br />
sur l’introduction produits bio en<br />
restauration collective géré par<br />
ARBIO <strong>Aquitaine</strong> sera animé par<br />
Antoine VERGIER<br />
contact : 05 56 79 28 52<br />
arbio@wanadoo.fr<br />
Nouvelles de la filière bio
Nouvelles de la filière bio<br />
agritaine <strong>Bio</strong> NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 16<br />
La filière lait biologique<br />
Zoom sur l’<strong>Aquitaine</strong><br />
En Dordogne, la <strong>Chambre</strong> d’Agriculture a organisé une réunion le 29 0ctobre dernier,<br />
sur le thème « produire du lait bio ». Cette rencontre a permis de faire le point sur les<br />
intentions en matière de collecte des différentes laiteries ou organismes de collecte<br />
intervenant pour le lait bio sur le département, voire l’<strong>Aquitaine</strong>.<br />
Chaque opérateur suivant ses propres<br />
stratégies a des positions sur<br />
la collecte du lait bio différentes,<br />
décrites ci-après.<br />
Les laiteries artisanales locales :<br />
Péchalou (24), La Lémance (47),<br />
Le Petit Basque (33)<br />
Ces entreprises ont fait un travail prospectif<br />
sur leur besoin sous trois ans<br />
en lait bio, suite au développement<br />
de leur ligne de produit en agriculture<br />
biologique.<br />
Ce travail réalisé dans le cadre d’un<br />
dossier de structuration des filières<br />
mené avec l’interprofession (ARBIO)<br />
fait état d’un besoin de 2 millions de<br />
litres au terme des trois années à venir<br />
pour ces trois entreprises.<br />
Les producteurs étant amenés à satisfaire<br />
cette demande sont déjà identifiés<br />
: certains sont déjà producteurs<br />
de lait bio, d’autres sont en phase de<br />
conversion.<br />
La coopérative 3A<br />
Elle souhaite développer sa collecte<br />
pour son usine de Toulouse qui produit<br />
4.000 tonnes de yaourts avec du<br />
lait bio (sur 40.000 tonnes produits).<br />
Les volumes devraient doubler d’ici<br />
deux ans dans le cadre de la filiale<br />
Yéo produisant 40 % des yaourts bio<br />
vendus sous marque distributeur en<br />
France.<br />
L’objectif de cette structure est de<br />
créer une collecte à hauteur de<br />
7 millions de litres.<br />
3A est prêt à développer une collecte<br />
en Dordogne dans la mesure<br />
où il serait possible de rassembler un<br />
potentiel de 2 millions de litres dans<br />
un rayon assez proche (coût de collecte).<br />
Sa zone de collecte en conventionnel<br />
est le sud du département de<br />
la Dordogne.<br />
Il est proposé aux producteurs intéressés<br />
une contractualisation sur<br />
5 ans minimum pour un prix moyen<br />
déconnecté du prix du conventionnel<br />
à 428 €/1000 litres pour le lait bio et<br />
30 €/1000 litres de plus que le conven-<br />
tionnel pendant la phase de conversion.<br />
Contact : Jean VanDer Host<br />
La SAS <strong>Bio</strong>lait<br />
C’est un groupement de producteurs<br />
collectant 289 producteurs, essentiellement<br />
du grand ouest et du nord. En<br />
2009, elle collecte sur l’ensemble du<br />
territoire 47,5 millions de litres et prévoit<br />
de doubler ce volume sous 5 ans. Son<br />
objectif est de représenter une part significative<br />
de la collecte du lait bio.<br />
Elle développe commercialement un<br />
partenariat avec <strong>Bio</strong>coop. Le principe<br />
est la transparence totale dans les prix<br />
payés aux producteurs (les mêmes<br />
pour tous). Elle dépend de la valorisation<br />
auprès des entreprises de transformation<br />
et du coût de collecte : soit<br />
340 €/tonne en 2007, et 430 €/1000 litres<br />
en 2008 et 2009.<br />
Cette structure propose un contrat sur<br />
5 ans, avec une aide de 30 €/1000 litres<br />
pendant la phase de conversion. Elle<br />
est prête à mettre en place une collecte<br />
en Dordogne pour peu que cette collecte<br />
atteigne 2 millions de litres, dans<br />
l’idée de mettre en place une collecte<br />
durable.<br />
Contact : Jean-Marie Poilvet<br />
Le groupe SODIAAL<br />
Il a collecté 2 millions de litre en France,<br />
en particulier dans le Tarn, l’Aveyron, et<br />
la Lozère. L’entreprise veut développer<br />
ce créneau pour vendre du lait bio de<br />
consommation par le partenariat avec<br />
3A pour approvisionner son usine de<br />
St Etienne.<br />
Ce groupe est également prêt à démarrer<br />
une collecte à condition qu’elle<br />
puisse se rentabiliser.<br />
L’engagement proposé aux producteurs<br />
est de 7 ans (2 ans de conversion, plus<br />
5 ans). Le prix minimum garanti n’est<br />
pas déconnecté du conventionnel :<br />
en 2009 le prix payé devrait être de<br />
130 €/1000 litres de plus que le conventionnel<br />
avec un prix moyen proche de<br />
400 €/1000 litres en 2009.<br />
Contact : Florence Bouyssou.<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
crédit photo : Arbio<br />
Le groupe coopératif GLAC Lescure<br />
Bougon<br />
Il travaille dans le bio depuis 1990 en<br />
Charente et Haute Vienne. La transformation<br />
du produit se fait en Haute<br />
Vienne à la laiterie des Failles prés de<br />
Limoges pour du lait UHT, pasteurisé<br />
ou du fromage. La collecte s’étend en<br />
Vendée et dans les Deux Sèvres.<br />
Elle pourrait aussi s’étendre au nord de<br />
la Dordogne.<br />
En matière de prix payé au producteur,<br />
la saisonnalité s’applique avec<br />
370 €/1000 litres en mai et 480 €/1000<br />
litres en août, ce qui amène à un prix<br />
moyen de 420 à 430 €/1000 litres.<br />
Comme un certain nombre de structure,<br />
une prime de 30 €/1000 litres est<br />
versée aux producteurs en phase de<br />
conversion.<br />
Contact : Alain Poissonnier<br />
En conclusion<br />
Des possibilités de collecte se développent<br />
donc en Dordogne et peuvent<br />
intéresser des producteurs du nord<br />
Lot et Garonne. Il faut cependant qu’il<br />
y ait les producteurs en face de ces<br />
intentions de collecte, sachant qu’une<br />
conversion en vaches laitières remet<br />
en cause beaucoup de pratiques sur<br />
l’exploitation à commencer par le<br />
système fourrager.<br />
Rappelons que les produits laitiers<br />
représentent 15 % des produits bio<br />
consommés, et 70 % des consommateurs<br />
de produits bio achètent des produits<br />
laitiers bio. La collecte nationale<br />
bio a progressé de 1,7 % sur la dernière<br />
année avec 251 Millions de litres, mais<br />
reste modeste globalement avec 1,1 %<br />
de la collecte nationale.<br />
Pour en savoir plus contacter :<br />
Jacques Tournade,<br />
Conseiller d’entreprise et coordinateur bio<br />
de la <strong>Chambre</strong> d’Agriculture de Dordogne.<br />
Tel : 05 53 63 56 57
agritaine<br />
<strong>Bio</strong><br />
NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 17<br />
La filière bovins lait bio<br />
dans les Pyrénées-Atlantiques<br />
Aujourd’hui sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques,<br />
nous ne comptons que trois éleveurs bovins laitiers bio pour un total<br />
de 85 vaches laitières, faute de filière structurée en <strong>Aquitaine</strong>. Tous trois<br />
sont établis sur le Béarn, et deux d’entre eux transforment le lait à la<br />
ferme et pratiquent la vente directe (yaourts et fromages).<br />
Dans un contexte où, en revanche,<br />
la consommation de produits laitiers<br />
bio ne cesse d’augmenter en France,<br />
le groupe coopératif 3A, principal<br />
collecteur de lait conventionnel dans<br />
le Grand Sud-Ouest, s’est engagé fin<br />
2008 à travailler au développement<br />
d’une filière lait de vache bio dans les<br />
Pyrénées-Atlantiques.<br />
La coopérative 3A dispose en effet<br />
d’une unité de transformation bio à<br />
Toulouse destinée à la fabrication de<br />
yaourts bio. En 2010, ses besoins en<br />
lait bio devraient avoisiner les 7 millions<br />
de litres alors que la production actuelle<br />
se situe à 1 million de litres, correspondant<br />
à la collecte déjà en place dans le<br />
département du Tarn.<br />
L’objectif de 3A est donc de pouvoir<br />
lancer une collecte de lait bio sur les<br />
Pyrénées-Atlantiques, et plus précisément<br />
sur le Béarn pour limiter les<br />
temps de transports et donc les coûts<br />
de collecte. La taille critique à atteindre<br />
pour permettre la viabilité économique<br />
des tournées se situe autour de<br />
2 millions de litres.<br />
Si cette densité de collecte est atteinte<br />
sur le Béarn, 3A s’engage à collecter<br />
durablement le lait bio selon un contrat<br />
qui se traduit par une aide à la reconversion<br />
(+45 €/1000 litres pendant les<br />
2 ans de conversion pour les coopérateurs<br />
et +30 € pour les autres) et par<br />
un prix du lait certifié bio déconnecté<br />
du prix du lait conventionnel durant<br />
les 5 ans du contrat, fixé entre 410 et<br />
430 €/1000 litres environ.<br />
Afin de pouvoir identifier les potentialités<br />
et les freins techniques et économiques<br />
pour un passage en Agriculture <strong>Bio</strong>logique<br />
sur les exploitations intéressées du<br />
Béarn, la <strong>Chambre</strong> d’Agriculture et le<br />
CIVAM <strong>Bio</strong> Béarn travaillent en partenariat<br />
pour réaliser des audits de conversion<br />
chez les éleveurs laitiers. A ce jour,<br />
14 diagnostics ont été effectués, débouchant<br />
sur un potentiel de collecte<br />
compris entre 1,5 et 2 millions de litres.<br />
La <strong>Chambre</strong> d’Agriculture des<br />
Pyrénées-Atlantiques a établi un plan<br />
de formations de 3,5 jours répartis de<br />
mi-janvier à mi-mars dans l’objectif<br />
d’apporter aux éleveurs le maximum<br />
d’éléments afin de les aider à prendre<br />
la décision de franchir le pas et de les<br />
accompagner dans leur démarche de<br />
conversion.<br />
Contact :<br />
Marianne Delugeau,<br />
Conseillère bio à la <strong>Chambre</strong><br />
d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques.<br />
Tel : 05 59 80 70 00<br />
ou 06 11 63 20 63<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
Nouvelles de la filière bio
Infos pratiques<br />
<strong>Bio</strong> agritaine NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 18<br />
Bilan de santé de la PAC 2010 : une redistribution<br />
des aides favorables à l’agriculture biologique<br />
En 2010, le bilan de santé de la PAC organise<br />
une nouvelle distribution des aides. Elle se fait<br />
à budget constant.<br />
Elle se caractérise par un découplage (ne<br />
plus lier les aides à la production) d’un certain<br />
nombre d’aides :<br />
• 100 % des aides couplées aux cultures<br />
(céréales, oléagineux, protéagineux)<br />
• 25 % des aides PMTVA (Primes vaches<br />
allaitantes).<br />
C’est également la suppression de deux<br />
aides :<br />
• la PAB (Prime à l’abattage)<br />
• la PB (Prime à la brebis) : remplacée par<br />
l’aide à la brebis.<br />
Cette redistribution des aides va se faire sous<br />
trois formes :<br />
1. selon l’article 63 par une revalorisation des<br />
DPU, voire la création de nouveaux DPU :<br />
cette redistribution sera plus favorable pour les<br />
éleveurs mettant en œuvre des superficies en<br />
herbe ou utilisant du maïs pour l’élevage, la<br />
création de nouveaux DPU pour les cultures<br />
légumières de plein champs et pommes de<br />
terre ;<br />
2. selon l’article 68 par une ré-orientation des<br />
aides (4,55 %) avec la création de 8 nouvelles<br />
aides : ovins/caprins, veaux sous la mère ou<br />
veaux bio, maintien et conversion à l’agriculture<br />
biologique, cultures riches en protéines<br />
(protéagineux et nouvelles surfaces en légumineuses<br />
fourragères), diversité de l’assolement,<br />
assurance récolte et fonds sanitaire ;<br />
3. par la mise en place d’un taux de modulation<br />
des aides croissant (7 % en 2009<br />
pour arriver à 10 % en 2012), ré-affecté sur le<br />
développement rural.<br />
Pour les producteurs en agriculture biologique<br />
les conséquences vont interférer à plusieurs<br />
niveaux Tout d’abord, comme pour l’ensemble<br />
des producteurs, une proposition de revalorisation<br />
provisoire des DPU sera transmise à<br />
chaque producteur début 2010 (calcul fait sur<br />
les références les plus favorables entre 2005<br />
à 2008). Ces références seront à vérifier et<br />
la demande d’attribution sera à confirmer<br />
avant le 15 mai 2010.<br />
Par ailleurs, les producteurs en agriculture<br />
biologique vont pouvoir être aidés par l’aide<br />
au maintien à l’agriculture biologique.<br />
Dés 2010, cette aide au maintien se met<br />
en place :<br />
Cultures annuelles et PT 100 /ha<br />
PP et PT à longue rotation 80 /ha<br />
Maraîchage, arboriculture 590 /ha<br />
Légumes de plein champs, viticulture 150 /ha<br />
Conditions d’éligibilité :<br />
• Sur une même exploitation, cohabitation<br />
possible avec la MAE CAB (mais cumul impossible<br />
sur une même parcelle)<br />
• Il n’est pas nécessaire que l’exploitation soit<br />
entièrement engagée en agriculture biologique<br />
• Respect du règlement agriculture biologique<br />
• Notifier chaque année l’activité à l’agence bio<br />
• Obligation de faire un dossier PAC et de<br />
respecter la conditionnalité<br />
• Possibilité de couplage avec une nouvelle<br />
aide (ex. diversité de l’assolement) mais pas<br />
avec une autre MAE sur une même parcelle.<br />
Pour 2010, il sera possible de demander le<br />
crédit d’impôt sur les revenus 2009 et l’aide<br />
au maintien pour 2010. Le cumul ne sera plus<br />
possible en 2011.<br />
A partir de 2011, les aides à la conversion<br />
à l’agriculture biologique vont passer également<br />
par une aide à la surface :<br />
Cultures annuelles et PT 200 /ha<br />
PP et PT à longue rotation 100 /ha<br />
Maraîchage, arboriculture 900 /ha<br />
Légumes de plein champs, viticulture 350 /ha<br />
Conditions d’éligibilité :<br />
• Toute parcelle en conversion depuis moins<br />
de 5 ans<br />
• Non cumulable avec la MAE conversion bio<br />
et l’aide au maintien<br />
• Non cumulable avec une autre MAE et cumulable<br />
avec les nouvelles aides.<br />
La durée de cette aide serait liée à la période<br />
de conversion : 2 ou 3 ans suivant les cultures.<br />
Cette aide impliquerait la disparition de la MAE<br />
conversion <strong>Bio</strong> et éviterait les règles qui y sont<br />
liées (limite d’âge de 60 ans, plafond d’aide<br />
annuel régional de 20.000 €/an/exploitation).<br />
Ces nouvelles aides seront soumises à la<br />
modulation des aides.<br />
D’autres aides peuvent concerner également<br />
les producteurs en agriculture biologique.<br />
Il s’agit d’abord de l’aide aux cultures riches<br />
en protéines (aide prévisionnelle de 150 €/ha<br />
en 2010, puis 125 €/ha et 100 €/ha en 2012).<br />
Elle concerne les protéagineux (pois, féveroles,<br />
lupins) et elle est cumulable avec l’aide<br />
aux protéagineux de 55,57 €/ha en 2010 et<br />
2011. Elle concerne également les nouvelles<br />
superficies en légumineuses fourragères (luzerne,<br />
trèfle, sainfoin).<br />
L’aide à la diversification de l’assolement<br />
peut également correspondre à un système<br />
grandes cultures en agriculture biologique.<br />
Cette aide n’existera qu’en 2010 pour un montant<br />
de 25 €/ha sous les conditions suivantes :<br />
grandes cultures > 70 % de SAU, au moins<br />
4 cultures différentes dont la plus faible représente<br />
au minimum 5 % de la sole cultivée, la<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
culture majoritaire doit représenter moins de<br />
45 % de la sole, les 3 cultures majoritaires doivent<br />
représenter moins de 90 % de la sole.<br />
Le choix est à faire entre cette aide et l’engagement<br />
dans la MAE rotationnelle qui<br />
existera pour la dernière année en 2010. Ses<br />
engagements sont proches, mais permettent<br />
de contractualiser une aide de 32 €/ha pendant<br />
5 ans.<br />
Pour finir, les éleveurs en vaches allaitantes<br />
vont pouvoir bénéficier d’une aide au veau<br />
bio. Cette aide qui concerne également les<br />
veaux de lait labellisables, est une aide de<br />
35 €/tête, majorée à 70 €/tête pour les exploitations<br />
adhérentes à une organisation de<br />
producteur reconnu. Pour accéder à cette<br />
aide, il faut que les veaux aient été élevés<br />
selon le règlement agriculture biologique.<br />
Les veaux bio vendus en broutards seraient<br />
également concernés.<br />
Des changements en matière de conditionnalité<br />
accompagne cette redistribution<br />
des aides. Dans les modifications les plus<br />
conséquentes, on notera :<br />
• Le maintien des surfaces en herbe :<br />
prairies permanentes (maintien en surface<br />
et en emplacement), maintien des surfaces<br />
en PT5, maintien de 70 % de la référence<br />
2008 ou 2009<br />
• La mise en place de bandes tampon de<br />
5 mètres minimum (en remplacement des<br />
bandes enherbées) pour l’ensemble des<br />
producteurs le long des cours d’eau<br />
• Maintien des particularités topographiques<br />
: 1 % en 2010, jusqu’à 5 % en 2012<br />
en maintien des éléments pérennes du<br />
paysage<br />
L’agriculture biologique est donc favorisée<br />
par cette nouvelle orientation des aides,<br />
avec un financement des aides au maintien<br />
et à la conversion pérennisé et inclus dans le<br />
premier pilier de la PAC. Les producteurs ont<br />
par ailleurs des choix à opérer pour accéder<br />
à des aides qui peuvent correspondre à un<br />
système de production bio : aide aux cultures<br />
riches en protéines, aide à la diversification<br />
des assolements ou MAE rotationnelle.<br />
Mes Parcelles est un outil de gestion informatique<br />
permettant aux agriculteurs de gérer via<br />
Internet leur exploitation. Ainsi, par cet outil,<br />
l’agriculteur bio peut tenir l’équivalent d’un<br />
cahier de culture nécessaire à l’organisme<br />
certificateur lors de son audit. De plus cet<br />
outil est totalement compatible avec Télépac<br />
ce qui facilite vos enregistrements pour la<br />
PAC.<br />
Pour en savoir plus :<br />
n’hésitez pas à contacter vos<br />
référents PAC dans vos chambres<br />
départementales d’agriculture
agritaine<br />
<strong>Bio</strong><br />
NUMERO 1 FEVRIER 2010 PAGE 19<br />
Communiqué de presse : 21 septembre 2009<br />
L’<strong>Aquitaine</strong> à Tech & <strong>Bio</strong> !<br />
Le salon européen des techniques agricoles alternatives et bio, Tech&<strong>Bio</strong>, s’est tenu les 8 et 9 septembre 2009 à<br />
Loriol, dans la Drôme. L’événement, organisé par la <strong>Chambre</strong> d’agriculture de la Drôme avec le soutien de l’Assemblée<br />
Permanente des <strong>Chambre</strong>s d’Agriculture, était accueilli sur l’exploitation de M. Panissod, « <strong>Bio</strong>meille Fruits ». Il proposait<br />
également des visites d’exploitations bio en polyculture élevage. Une centaine de spécialiste ont tenu des conférences<br />
et des démonstrations de matériel, pour tous les types de production.<br />
On a pu noter un engouement pour Tech&<strong>Bio</strong><br />
depuis sa 1ère édition. En effet, le précédent<br />
salon (7 - 8 septembre 2007, Chantemerleles-blés<br />
- Drôme) avait déjà connu un grand<br />
succès avec la participation de 85 exposants<br />
et de 4.000 visiteurs venus de toute la<br />
France et aussi de l’étranger. Cette année, on<br />
comptait plus de 150 exposants et près de<br />
9.000 visiteurs !<br />
Pour cette 2ème édition, le salon Tech&<strong>Bio</strong><br />
a pris une envergure européenne. Il a offert<br />
des témoignages d’expériences de différents<br />
pays européens : Allemagne, Angleterre,<br />
Autriche, Belgique, Danemark, Italie, Serbie,<br />
Suisse... Une vingtaine d’experts européens<br />
sont intervenus à Tech&<strong>Bio</strong>. Leurs témoignages<br />
ont porté sur des techniques de<br />
production, des exemples de valorisation<br />
de produits bio, les dispositifs de la PAC<br />
en faveur de l’agriculture biologique et les<br />
innovations dans le secteur bio.<br />
Autre nouveauté cette année : la sortie officielle<br />
de la Bourse d’échanges des professionnels<br />
de l’Agriculture <strong>Bio</strong>logique en France.<br />
Conçu par les <strong>Chambre</strong>s d’Agriculture, cet<br />
outil Web vise mettre en relation acheteurs<br />
et producteurs en permettant à chacun de<br />
s’inscrire et de communiquer sur ses besoins<br />
ou disponibilité en matières premières bio.<br />
Les acteurs de la production, de la transformation<br />
et de la distribution ont pu tester cet<br />
outil directement sur le stand des <strong>Chambre</strong>s<br />
d’agriculture au salon Tech&<strong>Bio</strong> (www.techn-bio-bourse.com).<br />
Enfin, les Assises européennes de la <strong>Bio</strong>, organisées<br />
par l’Agence <strong>Bio</strong>, se sont tenues le<br />
9 septembre avec pour thème : « L’innovation :<br />
facteur et expression du développement<br />
de l’agriculture biologique ». Ces Assises<br />
avaient notamment pour objectif de faciliter<br />
les échanges de vues et les analyses sur les<br />
stratégies de développement de l’agriculture<br />
biologique et les processus de l’innovation.<br />
Elles ont rassemblé des personnalités et des<br />
experts européens de tous horizons, souhaitant<br />
partager leurs expériences et nouer des<br />
partenariats.<br />
Une délégation aquitaine d’une trentaine<br />
de personnes était présente sur le Salon :<br />
des professionnels accompagnés par des<br />
PRODUIRE BIO EN AQUITAINE<br />
agents des <strong>Chambre</strong>s d’agriculture, des<br />
entreprises, des coopératives et l’interprofession<br />
bio régionale ARBIO, ainsi que la<br />
chargée de mission agriculture biologique<br />
du Conseil régional. On rappelle que dans<br />
la région, l’agriculture biologique est un secteur<br />
dynamique, tant d’un point de vue de la<br />
production – plus de 150 conversions à l’AB<br />
en 2009 – que de la consommation.<br />
L’année prochaine, un autre événement<br />
Tech&<strong>Bio</strong> aura lieu : les 23 et 24 juin 2010,<br />
à la Ferme de Thorigné d’Anjou (Pays<br />
de la Loire), l’élevage sera à l’honneur.<br />
Les <strong>Chambre</strong>s d’agriculture d’<strong>Aquitaine</strong> et<br />
leurs partenaires répondront présents et<br />
organiseront des déplacements collectifs<br />
pour ce salon.<br />
Contact presse :<br />
Bruno Millet<br />
Tél. 05 57 85 40 03<br />
b.millet@aquitaine.chambagri.fr<br />
Catherine Gonnot<br />
Tél. 05 56 01 33 29<br />
c.gonnot@aquitaine.chambagri.f<br />
SIAD - Salon International du <strong>Bio</strong> et de l’Agri-Durable<br />
Les 3, 4 et 5 juin 2010 au Parc des expositions à Agen<br />
Le SIAD tiendra sa première édition en 2010, sous l’impulsion du Conseil Régional<br />
d’<strong>Aquitaine</strong> et à l’initiative des professionnels aquitains des secteurs de l’agriculture<br />
et de l’agro-alimentaire.Le concept de ce salon est organisé autour des 3 piliers<br />
du développement durable :l’économique, le social et l’environnement.<br />
Le SIAD se veut être une réponse<br />
du monde agricole aux enjeux<br />
futurs : nourrir la planète tout<br />
en développant une agriculture<br />
respectueuse de l’environnement.<br />
Ainsi, les agriculteurs et les<br />
entreprises agro-alimentaires<br />
sont au cœur du développement<br />
durable.<br />
Pour apporter ces réponses aux<br />
professionnels, le SIAD mettra en<br />
avant, à travers ses expositions :<br />
• La valorisation et la transformation<br />
des productions agricoles bios et<br />
durables pour le marché français<br />
et l’exportation.<br />
• Les techniques agricoles alternatives<br />
et innovantes.<br />
• Les énergies vertes et renouvelables<br />
dans le cadre agricole.<br />
• Les outils d’accompagnement pour<br />
faire de l’agri-durable : financement,<br />
formation, emploi, analyse stratégique<br />
des marchés, diagnostic entreprises.<br />
• Les échanges d’expériences, les<br />
rendez-vous d’affaires avec des professionnels<br />
nationaux et internationaux,<br />
des ateliers pratiques, des forums de<br />
rencontres, des tables rondes, des<br />
conférences.<br />
Le SIAD est divisé en plusieurs espaces<br />
dont un espace de 300m²,<br />
positionné à l’entrée, qui regroupera<br />
les acteurs de la filière bio. ARBIO<br />
<strong>Aquitaine</strong> est en charge de piloter l’espace<br />
régional du pôle bio. Ce dernier<br />
sera un lieu d’échanges entre des producteurs<br />
bio et conventionnels, des<br />
groupements de producteurs, des<br />
transformateurs ou des expéditeurs<br />
de produits bio.<br />
L’espace bio sera également un<br />
point de rendez-vous autour de la bio<br />
en restauration collective, compte<br />
tenu des demandes et des besoins<br />
des collectivités, des gérants des<br />
restaurants collectifs et des entreprises<br />
les approvisionnant.<br />
Le pôle bio proposera des conférences<br />
sur les thèmes suivants :<br />
• les alternatives de l’agriculture<br />
biologique pour une diminution des<br />
produits phytosanitaires ett des ateliers<br />
de parcours à la conversion et<br />
par filières (grandes cultures, fruits<br />
et légumes, élevage viande et lait,<br />
viticulture).<br />
• La bio en restauration collective.<br />
Contact : Orgagri<br />
Tél. 05 53 77 83 55 - www.orgagri.org<br />
Infos pratiques
Agenda<br />
Janvier<br />
• 12/01 en salle et le 8/07 sur le terrain : Faire<br />
du maraîchage en <strong>Bio</strong> - Maison de la Promotion<br />
Sociale à Artigues-Prés-Bordeaux (33)<br />
• 14 et 21/01 : Comment élaborer sa conversion<br />
en maraîchage biologique ? – Domaine<br />
de Lalande à Sainte-Livrade (47)<br />
• 18/01 : + autres dates à venir : Produire<br />
en ovin lait bio (64)<br />
•18, 19/01 et 1/02 : Maîtriser la commercialisation<br />
de ses céréales et utiliser les marchés<br />
à terme pour sécuriser son revenu - Maison<br />
de la Promotion Sociale à Artigues-Prés-<br />
Bordeaux (33)<br />
• 19/01 : L’agriculture bio, qu’est-ce que<br />
c’est en production de lait bio ? – (64)<br />
• 26/01 : Adapter son exploitation aux<br />
incidences de la PAC 2010 – Mairie à Port<br />
Sainte-Marie (47)<br />
• 26/01 : Découverte de l’agriculture biologique<br />
à Ribérac (24)<br />
• 27 et 28/01 : Initiation aux techniques bio<br />
en prunier d’Ente – CIREA à Frégimont (47)<br />
• 28/01 : Mettre en place une ration d’hiver<br />
adaptée en élevage laitier bovin en agriculture<br />
biologique à Monbazillac (24)<br />
Contacts<br />
• Dordogne<br />
Jacques Tournade<br />
Tél : 05.53.63.56.50<br />
Fax : 05 53 63 56 55<br />
jacques.tournade@dordogne.chambagri.fr<br />
• Gironde<br />
Philippe Mouquot<br />
Etienne Laveau<br />
Tél : 05 56 79 64 13<br />
Fax : 05 56 79 64 24<br />
p.mouquot@gironde.chambagri.fr<br />
e.laveau@gironde.chambagri.fr<br />
Février<br />
<strong>Chambre</strong> régionale d’agriculture d’<strong>Aquitaine</strong><br />
Cité mondiale - 6, parvis des Chartrons 33075 Bordeaux cedex<br />
Tél. : 05 56 01 33 33 • Fax : 05 57 85 40 40<br />
E-mail : accueil@aquitaine.chambagri.fr • Site : www.aquitainagri.org<br />
• 4/02 : Obtenir le label AB (64)<br />
• 4/02 : Envisager une conversion en agrobiologie<br />
(40)<br />
• 9/02 : Initiation aux techniques bio en<br />
Viticulture – Domaine de Lalande à Sainte-<br />
Livrade (47)<br />
• 9 et 16/02 : Convertir son vignoble à l’agriculture<br />
biologique à Monbazillac (24)<br />
• 9/02 et une journée fin mars à fixer :<br />
Produire des Grandes cultures en <strong>Bio</strong> - Maison<br />
de la Promotion Sociale à Artigues-Prés-<br />
Bordeaux (33)<br />
• 10 et 18/02 : Convertir et Conduire son<br />
vignoble en Agriculture biologique - Maison<br />
de la Promotion Sociale à Artigues-Prés-<br />
Bordeaux (33)<br />
• 12/02 : Savoir innover dans son système<br />
de Grandes Cultures - Maison de la Promotion<br />
Sociale à Artigues-Prés-Bordeaux (33)<br />
• 16/02 : Initiation aux techniques bio en<br />
arboriculture : Zoom sur le pommier bio<br />
- CIREA à Frégimont (47)<br />
• 16 et 17/02 : Conversion de sa noyeraie en<br />
agriculture biologique à Montignac (24)<br />
• 18/02 : Initiation aux techniques bio en<br />
grandes cultures - Domaine de Lalande à<br />
Sainte-Livrade (47)<br />
• 19/02 : Résultats technico-économiques<br />
lait <strong>Bio</strong> – (64)<br />
Correspondants bio<br />
des <strong>Chambre</strong>s d’agriculture <strong>Aquitaine</strong><br />
agritaine<br />
<strong>Bio</strong><br />
• Landes<br />
Florence Garez<br />
Pierre Jouglain<br />
Tél : 05 58 85 45 40<br />
Fax : 05 58 85 45 21<br />
florence.garez@landes.chambagri.<br />
pierre.jouglain@landes.chambagri.fr<br />
• Lot-et-Garonne<br />
Séverine Chastaing<br />
Tél : 05 53 77 83 12<br />
Fax : 05 53 68 04 70<br />
severine.chastaing@lot-et-garonne.cham<br />
bagri.fr<br />
Directeur de la publication : Dominique Graciet<br />
• Coordination et rédaction : Séverine Chastaing,<br />
Catherine Gonnot et Philippe Lansade<br />
• Conception PAO : Patricia Mouret, <strong>Chambre</strong><br />
régionale d’agriculture d’<strong>Aquitaine</strong><br />
Imprimé selon les recommandations ADEME<br />
Dépôt légal Février 2010 - N°ISSN 1966-5172<br />
Mars<br />
Cofinancé par l’Union Europènne<br />
sur le FEADER<br />
• 3 et 4/03 : Défense des cultures : Utiliser les<br />
préparations à base de plantes – <strong>Chambre</strong><br />
d’Agriculture à Agen (47)<br />
• 9, 10 et 16/03 : Conversion à l’Agriculture<br />
<strong>Bio</strong>logique - Domaine de Lalande à Sainte-<br />
Livrade (47)<br />
• 12 et 19/03 : Réfléchir à la production de<br />
lait de vaches « BIO » – Domaine de Lalande<br />
à Sainte-Livrade (47)<br />
• 15/03 : Conduite des cultures en agriculture<br />
bio – (64)<br />
• 25/03 : Produire du porc biologique – (64)<br />
• Fin mars (date à préciser) : Journée portes<br />
ouvertes couverts végétaux en grandes<br />
cultures à Coudures (40)<br />
Juillet<br />
• Date à fixer en juillet : Séchage en grange<br />
et Gestion des pâtures pour limiter le parasitisme<br />
(64)<br />
pour en savoir plus,<br />
contacter les correspondants bio<br />
des chambres départementales<br />
(cades ci-dessous)<br />
• Pyrénées-Atlantiques<br />
Ludivine Mignot<br />
Mariane Delugeau<br />
Tél/Fax : 05 59 37 20 62<br />
l.mignot@pa.chambagri.fr<br />
m.delugeau@pa.chambagri.fr<br />
• <strong>Aquitaine</strong><br />
Philippe Lansade<br />
Catherine Gonnot<br />
Tél : 05 56 01 33 39 / 33 29<br />
Fax : 05 57 85 40 40<br />
p.lansade@aquitaine.chambagri.fr<br />
c.gonnot@aquitaine.chambagri.fr<br />
• ARBIO<br />
Jérôme Cinel<br />
Tél : 05 56 79 28 52<br />
Fax : 05 56 79 33 18<br />
arbio@wanadoo.fr<br />
CHAMBRE<br />
D'AGRICULTURE<br />
AQUITAINE