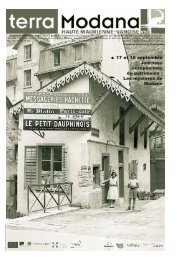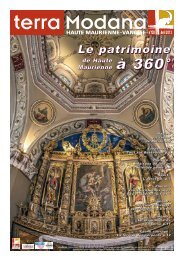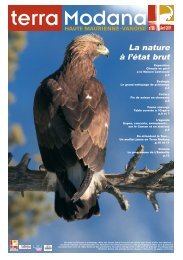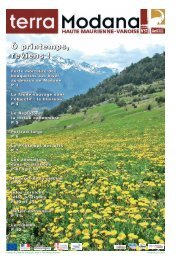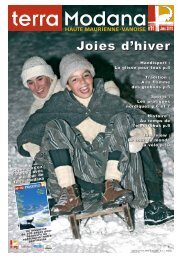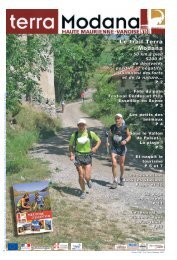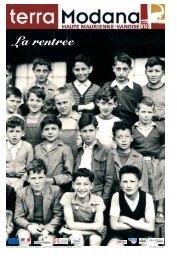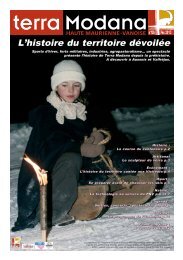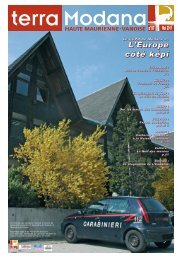TerraModana n°89
TerraModana n°89
TerraModana n°89
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pour vivre heureux,<br />
vivons cachés<br />
Chouettes et hiboux étant principalement<br />
actifs la nuit, il est difficile de les observer.<br />
De plus, ce sont des spécialistes du camouflage<br />
et de la discrétion. Le moyen-duc, par<br />
exemple, se tient bien droit contre le tronc<br />
des arbres en journée. Grâce à son plumage<br />
brun jaunâtre, il se confond avec l’écorce<br />
et se fait invisible. Le petit-duc emploie<br />
la même technique. Le camouflage et l’évitement<br />
sont souvent la première réaction<br />
de ces rapaces face à un intrus. Mais ils<br />
savent aussi se faire menaçants s’ils se<br />
sentent en danger. Yeux exorbités, claquements<br />
de bec, écartement des ailes et gonflement<br />
du plumage sont utilisés pour faire<br />
peur à l’ennemi. Les petits peuvent se coucher<br />
sur le dos pour donner des coups de<br />
griffes aux prédateurs qui sont principalement<br />
la martre, la fouine ou le renard.<br />
Enfin, quand ils sont trop dérangés, les<br />
rapaces nocturnes déménagent. C’est ainsi<br />
que le couple de grands-ducs est allé nicher<br />
ailleurs lorsque la via ferrata du diable a<br />
été installée dans les gorges de l’Arc.<br />
Chouette hulotte (strix aluco). Surnommée “chat-huant” , la hulotte est le plus connu des rapaces nocturnes. Son “ hou-ou”<br />
sonore s’entend près des maisons, comme ici dans le quartier de Loutraz à Modane. ©Parc national de la Vanoise-Mollard Maurice<br />
Oiseaux de proie, chouettes et<br />
hiboux sont équipés d’un bec crochu<br />
et acéré et de serres puissantes<br />
composées de 4 doigts. Leurs ailes<br />
ont une bordure “frangée” qui permet<br />
un vol parfaitement silencieux.<br />
Un atout pour ces prédateurs<br />
hypermétropes qui disposent d’une<br />
vision nocturne exceptionnelle et<br />
d’une capacité à observer tout<br />
autour d’eux, par une rotation<br />
quasi totale de la tête. Le sens<br />
essentiel de ces rapaces est cependant<br />
l’ouïe : ils sont capables de<br />
capturer leur proie sans se servir<br />
de leurs yeux ! Les trous auditifs<br />
sont cachés derrière les disques<br />
faciaux, presque au niveau des<br />
yeux, l’oreille droite étant généralement<br />
plus large et placée plus<br />
haut que la gauche.<br />
Les espèces forestières (Tengmalm<br />
et chevêchette) chassent plutôt à<br />
l’ouïe ou à l’affût alors que les<br />
espèces appréciant les espaces<br />
ouverts survolent les terrains à la<br />
recherche de proies ou effectuent<br />
du surplace au-dessus des galeries<br />
de petits mammifères en attendant<br />
leur sortie.<br />
Quant au régime alimentaire, il est<br />
Prédateurs nocturnes<br />
varié : gros insectes pour le petitduc,<br />
petits mammifères et petits<br />
oiseaux pour la Tengmalm… La<br />
toute petite chevêchette n’hésite<br />
pas à s’attaquer à des proies plus<br />
grosses qu’elle, comme le pic<br />
épeiche. Quant au grand-duc, c’est<br />
un super prédateur dont le menu se<br />
compose aussi bien de mammifères<br />
(campagnols, rats, souris, renards,<br />
lièvres, écureuils...) que d’oiseaux.<br />
Il s’offre même d’autres rapaces.<br />
Le plus souvent, chouettes et<br />
hiboux avalent leurs proies<br />
entières. Si elles sont trop grosses,<br />
ils les dépècent. Dans l'estomac, les<br />
sucs digestifs attaquent les chairs<br />
et laissent poils, plumes et os<br />
intactes. Ces restes sont rejetés par<br />
le bec après la digestion sous<br />
formes de boulettes : ce sont les<br />
pelotes de réjection. Ces pelotes<br />
sont d’ailleurs le meilleur moyen de<br />
repérer la présence d’un rapace<br />
nocturne dans le secteur. Par<br />
exemple, à Termignon, les grandsducs<br />
qui s’étaient installés dans les<br />
gorges de l’Arc n’ont jamais été<br />
observés, ni même entendus.<br />
Seules ces pelotes prouvaient leur<br />
présence.<br />
Le hibou petit-duc scops (optus scops) consomme beaucoup d’orthoptères (criquets, sauterelles...).<br />
Ce migrateur passe l’hiver en Afrique mais à la bonne saison on peut le rencontrer dans les villages.<br />
Solitaires<br />
Chouettes et hiboux ne sont pas grégaires.<br />
Ils tolèrent uniquement leur<br />
compagnon et leurs jeunes. Les territoires<br />
sont défendus bec et serres, la<br />
chouette hulotte peut même mener des<br />
combats mortels avec une rivale qui<br />
s'aventurerait dans son espace. Seuls<br />
les moyens-ducs (et le hibou des<br />
marais, non présent en Haute<br />
Maurienne) se regroupent en hiver pour<br />
partager un même dortoir qui peut<br />
accueillir plusieurs dizaines d’individus.<br />
Hulottes et grands-ducs forment des<br />
couples durables sur des années, les<br />
autres espèces ne s’accouplent généralement<br />
que pour la période de reproduction.<br />
Les parades aériennes nuptiales<br />
ont lieu à la fin de l’hiver, le moment<br />
idéal pour observer ces rapaces qui sont<br />
alors très bruyants. 2 à 7 œufs sont pondus<br />
et couvés par la femelle pendant<br />
près d’un mois. Les petits apprennent à<br />
chasser pendant l’été et se séparent de<br />
leurs parents à l’automne, période critique<br />
que seul un oiseau sur deux parviendra<br />
à surmonter.<br />
Grand duc d’Europe (bubo bubo), un super prédateur dont le menu se compose aussi bien de<br />
mammifères que d’oiseaux, dont la chouette hulotte. ©Parc national de la Vanoise-Bouche Michel<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pages 6 et 7<br />
©photothèque Parc national des Ecrins : Robert Chevalier