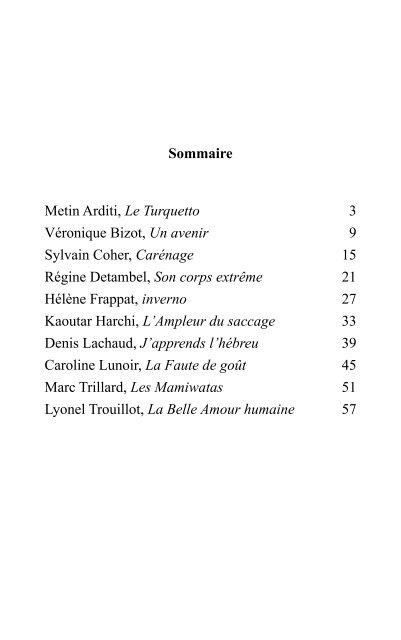Sommaire Metin Arditi, Le Turquetto 3 Véronique Bizot, Un ... - Index of
Sommaire Metin Arditi, Le Turquetto 3 Véronique Bizot, Un ... - Index of
Sommaire Metin Arditi, Le Turquetto 3 Véronique Bizot, Un ... - Index of
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Sommaire</strong><br />
<strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong>, <strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong> 3<br />
<strong>Véronique</strong> <strong>Bizot</strong>, <strong>Un</strong> avenir 9<br />
Sylvain Coher, Carénage 15<br />
Régine Detambel, Son corps extrême 21<br />
Hélène Frappat, inverno 27<br />
Kaoutar Harchi, L’Ampleur du saccage 33<br />
Denis Lachaud, J’apprends l’hébreu 39<br />
Caroline Lunoir, La Faute de goût 45<br />
Marc Trillard, <strong>Le</strong>s Mamiwatas 51<br />
Lyonel Trouillot, La Belle Amour humaine 57
<strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong><br />
<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong><br />
Roman<br />
Se pourrait-il qu’un tableau célèbre – dont la signature présente<br />
une discrète anomalie – soit l’unique œuvre qui nous reste d’un<br />
des plus grands peintres de la Renaissance vénitienne ? <strong>Un</strong> égal de<br />
Titien ou de Véronèse ?<br />
Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émigré très jeune<br />
à Venise, masqué son identité, troqué son nom pour celui d’Elias<br />
Troyanos, fréquenté les ateliers du Titien, et fait une carrière exceptionnelle<br />
sous le nom de <strong>Turquetto</strong> : le “Petit Turc”, comme<br />
l’a surnommé <strong>Le</strong> Titien lui-même.<br />
<strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong> retrace le destin mouvementé de cet artiste, né juif<br />
en terre musulmane, nourri de foi chrétienne, qui fut traîné en<br />
justice pour hérésie…<br />
Né en 1945 à Ankara, <strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong> vit à Genève. Il préside l’Orchestre de la<br />
Suisse romande et la fondation <strong>Le</strong>s Instruments de la Paix-Genève. Son œuvre est<br />
publiée chez Actes Sud : Dernière lettre à Th éo (2005), La Pension Marguerite<br />
(2006 ; Babel n° 823, prix Lipp Suisse 2006), L’Imprévisible (2006, prix de la<br />
Radio suisse romande 2007 ; Babel n° 910), Victoria-Hall (Babel n° 726), La<br />
Fille des Louganis (2007 ; Babel n° 967) et Loin des bras (2009).<br />
• A noter : la parution simultanée de Loin des bras dans la collection de poche<br />
Babel (Babel n° 1068).<br />
Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 288 pages / isbn 978-2-7427-9919-0<br />
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)<br />
3
DR<br />
<strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong>
<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong><br />
Ce livre est l’histoire d’une passion. Celle d’Elie Soriano dit<br />
<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong>, enfant de Constantinople, juif né en terre<br />
musulmane, et qui ne pouvait concevoir de vivre sans dessiner.<br />
A la mine de plomb ou au pinceau, il devait saisir l’autre. Pénétrer<br />
son âme, la comprendre et la révéler, dans toute sa vérité.<br />
Mais les lois sacrées des Juifs et des Musulmans interdisaient la<br />
représentation. Alors, pour assouvir sa passion, Elie Soriano a<br />
menti, trahi, triché, tourné le dos à son père, renié ses origines. Il<br />
a fui. Et s’est fondu dans autant de personnages que cela s’avérait<br />
nécessaire.<br />
Au fi l d’une vie mouvementée, il a chaque fois tout saisi du<br />
monde qui l’entourait, les passions, le fond et la forme. Il s’est<br />
senti aussi juif que musulman, grec orthodoxe ou catholique romain…<br />
Il a vécu ces identités multiples avec fureur et sincérité,<br />
au risque de sa vie. Il s’est imbibé des histoires de la Bible, de<br />
calligraphie ottomane et d’art sacré byzantin. Il a embelli ses tableaux<br />
de tout ce que les hommes – tous les hommes – avaient<br />
jusque-là produit de plus pr<strong>of</strong>ond et de plus raffi né. La calligraphie<br />
lui a permis d’atteindre la précision du disegno, que seuls maîtrisaient<br />
les peintres de Florence. Il lui a ajouté la science du colorito<br />
des Vénitiens, dont la sensualité l’avait bouleversé. Il a éclairé ses<br />
tableaux de la spiritualité byzantine, comme personne depuis<br />
Giotto n’avait réussi à le faire. Et l’alliage inspiré de ces infl uences<br />
pr<strong>of</strong>ondes et contradictoires a fait de lui le plus grand, le plus<br />
consolant des peintres, de la même façon que celui qui fonderait<br />
dans son cœur toutes les croyances serait le meilleur des hommes.<br />
M. A.<br />
5
Selon son habitude, Elie remonta la rue des Marchands-d’or aussi<br />
lentement que possible. Il l’appelait la rue des Visages-Immobiles,<br />
tant ses commerçants ressemblaient à des oiseaux de proie. A l’aff ût,<br />
impénétrables, maîtrisés… Attentifs à la moindre émotion qui pourrait<br />
apparaître sur le visage de leur client.<br />
— Prezzo pazzo ! Prezzo pazzo ! 1<br />
C’était un marin dont Elie avait fait le portrait deux jours plus tôt,<br />
à la taverne. L’homme était en conversation animée devant une boutique.<br />
<strong>Le</strong> commerçant approuvait en souriant tout ce que disait le<br />
marin, et Elie se dit que le marché serait conclu dans les trois minutes,<br />
tant le vendeur semblait sûr de son fait.<br />
<strong>Le</strong> marin lui avait dit qu’il était de Zena 2 . A la taverne, la plupart<br />
des marins venaient d’une ville qui avait pour nom Venetsia. Ceux-là,<br />
lorsqu’il leur remettait leur portrait, se lançaient tous dans des commentaires<br />
animés où revenaient sans cesse deux mots : bravissimo et<br />
bottega.<br />
Elie avait fi ni par comprendre que, à Venetsia, des enfants de son<br />
âge travaillaient dans des ateliers appelés boutiques, et qu’ils y apprenaient<br />
tout ce qui touchait au métier de peintre.<br />
Pourquoi n’était-il pas né à Venetsia ?<br />
Perdu dans ses pensées, il remonta la Divan Djaddesi sans prêter<br />
attention au tintamarre des eskidji, des soudjou ou des iskemledji 3 qui<br />
criaient le nom de leur métier pour annoncer leur passage.<br />
A la taverne, la table de cuisine était couverte des tepsis 4 qu’avait<br />
1. “Prix fou !”<br />
2. Gênes (en dialecte génois).<br />
3. Vendeurs de vieilleries ; d’eau ; de chaises.<br />
4. Grands plats en étain ou en cuivre.<br />
6<br />
<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong> (extrait)
<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong> (extrait)<br />
préparés S<strong>of</strong>i a, surtout des choux farcis à la viande et des feuilles de<br />
vigne farcies au riz et aux pignons. Elie n’y prêta pas attention et se<br />
dirigea vers le garde-manger d’où il retira une mine de plomb ainsi<br />
qu’une mince liasse de feuillets beiges.<br />
Il s’assit à la longue table, poussa avec précaution les plateaux de<br />
mets cuisinés, plaça la petite liasse devant lui et ferma les yeux.<br />
La scène du matin lui revint en mémoire avec précision. Lorsque<br />
Roza s’était retrouvée seins nus, ses traits s’étaient relâchés d’un coup.<br />
Elle avait croisé les bras sur la poitrine, et, les yeux baissés, elle demeurait<br />
fi gée dans une expression de douleur.<br />
Il resta quelques instants dans son souvenir, puis ouvrit les yeux et<br />
traça l’ovale de la tête, d’une main très sûre et d’un seul trait, comme<br />
s’il calligraphiait une volute. Il donna aux joues leur arrondi exact,<br />
rendit l’amertume de Roza en marquant le relâchement de la lèvre<br />
inférieure, et appr<strong>of</strong>ondit le noir du regard par un hachuré de plomb<br />
sur les paupières.<br />
Il dessina ainsi durant un quart d’heure, très vite, observa le résultat<br />
et eut un sentiment de dépit. Avec de la couleur, le portrait aurait<br />
eu une tout autre allure.<br />
Arsinée l’accueillit avec un “D’où viens-tu ?” qui en disait long.<br />
Sans attendre de réponse, elle se lança dans une succession de menaces<br />
: Ses encres et son crayon, elle allait les jeter à la mer ! Quant<br />
à son Djelal Baba, ce baba de rien du tout, elle allait lui dire deux<br />
mots, par saint Grégoire ! Et son église Saint-Sauveur, il pouvait<br />
l’oublier, et même oublier jusqu’à son existence !<br />
— Je suis arménienne, S<strong>of</strong>i a est orthodoxe et Djelal Bey est musulman.<br />
Chacun reste chez soi ! Il n’y a que toi pour vouloir te mélanger<br />
aux autres ! Tu devrais avoir honte !<br />
Elle secoua la tête avec dédain :<br />
— Ton père est au lit ! Il souff re ! Et toi, pendant ce temps, tu vas<br />
traîner… Allez, il t’attend !<br />
Il n’en pouvait plus, d’Arsinée. <strong>Un</strong>e grosse vieille qui changeait<br />
d’avis sans cesse, voilà ce qu’elle était. Et méchante, en plus ! Ou alors<br />
elle était gentille, puis d’un coup elle devenait méchante, et, à la fi n,<br />
c’était comme si elle n’avait jamais été gentille. Certains jours, elle<br />
7
lui lançait : “Tu as encore été dessiner à la taverne ! Tu n’as pas honte !”<br />
Mais, d’autres jours, c’était : “Allez, montre ! Mais montre vite !” et<br />
une fois le dessin en main, elle secouait la tête de gauche à droite,<br />
comme une cloche :<br />
“Mashallah 5 ! C’est ma-gni-fi que ! Vraiment magnifi que !”<br />
Lorsqu’il lui demandait de lui parler de sa mère, c’était aussi selon<br />
son humeur. Certaines fois, elle le rabrouait :<br />
— Ta mère était la plus belle femme au monde ! Voilà ! Et maintenant,<br />
fi che-moi la paix !<br />
D’autres fois, elle se perdait dans des descriptions sans fi n :<br />
— Que veux-tu que je te dise, mon Elie ? Des yeux verts… immenses !<br />
Vallahi billahi immenses… <strong>Un</strong> nez long, mais si fi n, si délicat… <strong>Un</strong><br />
nez de reine ! Et sa bouche… <strong>Un</strong> fruit rouge, mon Elie ! <strong>Un</strong> fruit du<br />
paradis ! Et ses cheveux ! De l’or fi n, mon Elie, de l’or fi n ! Et toujours<br />
gracieuse ! Toujours toujours toujours… Quoi qu’elle mît sur elle, la<br />
pauvre ! Et comme elle marchait… <strong>Un</strong>e reine, je te dis !<br />
Elle faisait alors un geste du plat de la main, plusieurs fois, comme<br />
pour dire : “Tu ne peux pas t’imaginer !”<br />
Deux jours plus tôt, alors qu’ils marchaient vers le Han, il lui avait<br />
demandé :<br />
— Comment était ton visage, lorsque tu étais jeune ?<br />
— Mon visage, tu dis ? Mon visage ? Tu sais combien j’étais jolie ?<br />
Elle s’était alors lancée dans une description volubile d’elle-même,<br />
en joignant pour chaque trait le geste à la parole :<br />
— Mes joues étaient comme ça… (Elle les avait étirées.) Et mon<br />
cou, Elie… <strong>Un</strong> cou de cygne ! Et mes yeux… Deux amandes vertes,<br />
je te dis !<br />
Au retour, il avait fait d’elle un portrait en jeune fi lle. <strong>Le</strong> soir même,<br />
elle l’avait découvert, les yeux ébahis. Durant plusieurs secondes, elle<br />
était restée silencieuse. Puis elle avait éclaté en sanglots.<br />
5. “Par la grâce de Dieu.”<br />
<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong> (extrait)
<strong>Véronique</strong> <strong>Bizot</strong><br />
<strong>Un</strong> avenir<br />
Roman<br />
Paul reçoit une lettre de son frère Odd qui lui annonce qu’il<br />
“disparaît pour un temps indéterminé” et lui demande en postscriptum<br />
s’il peut passer chez lui pour vérifi er que le robinet d’un<br />
lavabo du deuxième étage de la maison familiale a bien été purgé.<br />
Malgré “un rhume colossal”, Paul, ni une ni deux, prend sa voiture<br />
et parcourt les trois cents kilomètres qui le séparent dudit<br />
robinet. <strong>Un</strong> avenir est une histoire de famille.<br />
Après Mon couronnement, on retrouve le style irrésistible de <strong>Véronique</strong><br />
<strong>Bizot</strong>, où la noirceur est délicieuse parce que toujours<br />
saturée d’incongruité drolatique, de lucidité étonnée et de métaphysique<br />
légèrement récalcitrante.<br />
Auteur de deux recueils de nouvelles (<strong>Le</strong>s Sangliers, Stock, 2005, prix Renaissance<br />
de la nouvelle 2006, et <strong>Le</strong>s Jardiniers, Actes Sud, 2008) et d’un roman<br />
(Mon couronnement, Actes Sud, 2010, Grand Prix du roman 2010 de la<br />
sgdl, prix Lilas 2010), <strong>Véronique</strong> <strong>Bizot</strong> est, de son propre aveu, une “gentille<br />
personne affl igée de la conscience du pire”.<br />
• A noter : la parution simultanée de Mon couronnement dans la collection<br />
de poche Babel (Babel n° 1070).<br />
Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 112 pages / isbn 978-2-7427-9951-0<br />
relations presse : Aurélie Serfaty-Berc<strong>of</strong>f (01 55 42 14 45)<br />
9
© Gaspar de Grandy<br />
<strong>Véronique</strong> <strong>Bizot</strong>
<strong>Un</strong> avenir<br />
A u départ, c’est-à-dire et comme chaque fois en l’absence de<br />
projet particulier, j’avais à l’esprit un téléphérique avec, dans<br />
un village de montagne, un homme, un Ecossais, qui en aurait<br />
commandité la construction à des fi ns personnelles, je voyais assez<br />
bien la chute de ce téléphérique, je commencerais d’ailleurs par la<br />
chute. J’avais aussi la vague idée d’un autre homme assez âgé qui,<br />
le jour de la mort de sa femme, se serait presque machinalement<br />
rendu dans un garage où il aurait acheté une voiture avec quoi il<br />
aurait aussitôt pris la route sans repasser par chez lui. Je tournais<br />
encore autour d’une ambiance entre deux frères, ou entre des frères<br />
et des sœurs, adultes mais avec en toile de fond le désastre de<br />
l’enfance qui peut unir ou bien diviser, la ruine de cette famille.<br />
Je pensais également à une vieille actrice autrefois célèbre. Tous<br />
ces personnages sont fi nalement dans le livre, sollicités par la pensée<br />
d’un narrateur qui attend, bloqué dans une maison, que la<br />
neige cesse de tomber. Ils ont tous quelque chose en commun, une<br />
façon de disparaître, un isolement, choisi, subi (ou les deux),<br />
quelques insomnies et, alors que tout semble achevé, probablement<br />
encore quelque chose à vivre.<br />
V. B.<br />
11
<strong>Le</strong> mercredi notre frère m’écrivit qu’il disparaissait pour un temps indéterminé,<br />
un bref courrier posté d’une gare que j’ai reçu le jeudi, dont<br />
j’ai aussitôt transmis copie aux autres, qu’ils n’aillent pas se lancer dans<br />
d’inutiles recherches, et j’ai ensuite parcouru sous la neige, le cerveau<br />
embrouillé par un rhume colossal, les trois cents kilomètres qui séparent<br />
mon domicile du sien afi n de vérifi er, comme il me le demandait en<br />
post-scriptum, que le robinet d’un lavabo du second étage, à propos<br />
duquel il conservait un doute, avait bien été purgé par lui avant son<br />
départ. <strong>Un</strong>e fois sur place et trouvant une maison glaciale, j’ai poussé<br />
la conscience jusqu’à contrôler la totalité des robinets, après quoi j’ai<br />
allumé un feu dans la cheminée de la bibliothèque et passé là deux ou<br />
trois heures, assis avec une boîte de Kleenex dans le canapé, face au<br />
fauteuil de vieux velours jaune qui avait gardé l’empreinte du corps de<br />
notre frère et dans lequel il avait probablement médité son projet de<br />
disparition, à moins qu’il n’ait été pris d’une subite impulsion, comme<br />
autrefois notre père, que nous avons connu assis en pyjama dans ce<br />
même fauteuil jusqu’à ce qu’un matin on ne l’y voie plus, ni là ni nulle<br />
part, et qu’il nous ait fallu recevoir, cinq ans plus tard, un avis de décès<br />
en provenance d’un gouvernement de Malaisie pour cesser de l’attendre.<br />
Cet avis de décès avait à l’époque révolté nos sœurs, qui les a fait toutes<br />
les trois se ruer sur un atlas afi n de localiser l’endroit précis et, soupçonnaient-elles,<br />
paradisiaque pour lequel notre père non seulement<br />
nous avait tous les six abandonnés après avoir vidé ses comptes bancaires,<br />
mais où, comme elles l’ont dit en martelant la péninsule malaise de<br />
leurs index, il n’avait vraisemblablement fait que couler cinq idylliques<br />
et indignes années, après quoi, refermant défi nitivement l’atlas, elles<br />
ont déclaré qu’il était hors de question de faire rapatrier son corps. Et<br />
si notre frère Odd, que je n’avais pas vu depuis longtemps, laissait<br />
maintenant entendre dans son courrier qu’il n’était pas certain de revenir<br />
un jour, je n’en ai pas pour autant conclu qu’il s’installait là-bas<br />
12<br />
<strong>Un</strong> avenir (extrait)
<strong>Un</strong> avenir (extrait)<br />
en Malaisie, bien que l’idée m’ait naturellement effl euré. Ce que j’en<br />
ai conclu, c’est qu’il nous incombait désormais d’assurer les frais d’entretien<br />
de la maison, lesquels, comme je venais de le constater en<br />
parcourant les étages, avaient à ce stade occasionné la vente d’un assez<br />
grand nombre de meubles et de tableaux. Assis face à la cheminée et<br />
voyant par les fenêtres la neige qui continuait de tomber, compromettant<br />
mon retour, je me faisais la réfl exion qu’il aurait mieux valu vendre<br />
la maison au lieu d’y laisser notre frère, qui avait mené là une existence<br />
certainement eff arante, bien qu’il fût le seul d’entre nous, après le<br />
mariage de deux de nos sœurs et l’internement de la troisième, à avoir<br />
déclaré vouloir y vivre. Nous savions cependant tous qu’il n’avait, à ce<br />
stade de sa vie, d’autre solution que de rester dans cette maison, laquelle<br />
ne pourrait maintenant être légalement vendue sans son accord, nous<br />
l’avions sur les bras avec ses quelque vingt pièces et le double de fenêtres,<br />
ses murs lézardés, sa toiture instable et son parc qui ne ressemblait plus<br />
qu’à un vague pâturage cerné par les orties. Sans doute notre frère<br />
n’avait-il fi nalement pas supporté l’idée d’un hiver supplémentaire dans<br />
cet endroit, bien qu’il eût à l’époque prétendu avoir à son égard quantité<br />
de projets, tous appuyés par les banques locales, comme il nous<br />
l’avait affi rmé avec un enthousiasme suspect. L’un de nos deux récents<br />
beaux-frères, un Suisse qui faisait commerce international de l’acier,<br />
s’était alors posément enquis de savoir à quel type de projet songeait<br />
notre frère, qui avait répondu songer notamment à un genre de maison<br />
d’hôtes, ainsi qu’à la réunion de deux salons du rez-de-chaussée, laquelle<br />
formerait une salle pour séminaires ou banquets, et nous avions tous<br />
vigoureusement hoché la tête, à l’exception de notre beau-frère qui<br />
n’avait fait que produire l’un de ses opaques sourires suisses. Malgré<br />
notre conscience que celui qui resterait vivre là était à plus ou moins<br />
brève échéance condamné au dépérissement, nous avons feint de croire<br />
que notre frère saurait s’en tirer avec cette salle de séminaires et de<br />
banquets et, après lui avoir concédé le droit d’occuper le lieu comme<br />
s’il s’agissait d’une faveur, nous l’avons laissé livré à lui-même. Et alors<br />
que le feu s’éteignait dans la cheminée et qu’étant allé rebrancher le<br />
compteur électrique j’allumais quelques lampes (et tu n’as même pas<br />
remplacé les ampoules grillées), j’en venais peu à peu à envisager qu’il<br />
soit en réalité parti se tuer quelque part. Si bien que sortant de mon<br />
portefeuille sa lettre, je l’ai relue sans y voir soudain autre chose que<br />
13
<strong>Un</strong> avenir (extrait)<br />
l’indication de son imminent suicide, en dépit de son post-scriptum<br />
prétendument préoccupé de ce robinet pour lequel il m’avait fait faire<br />
un trajet de trois cents kilomètres. Repliant la lettre, j’ai tout à coup<br />
ressenti l’aberration qu’il y avait eu à faire ce trajet au cours duquel je<br />
n’avais pratiquement pensé qu’à ce robinet du second étage qui, s’il se<br />
mettait à geler et si notre frère ne l’avait pas purgé, pouvait à tout<br />
moment provoquer une rupture des canalisations, comme il me l’avait<br />
écrit. Mais j’avais tout trouvé en ordre, et j’étais maintenant sur le point<br />
de penser que cette histoire de robinet n’avait été qu’un stratagème de<br />
notre frère pour me faire venir et, une fois là, appréhender l’accablement<br />
mental et physique qui avait été le sien dans ce décor.
Sylvain Coher<br />
Carénage<br />
Roman<br />
Rien de plus important pour Anton qu’une virée à 220 kilomètres-heure<br />
aux petites heures, arqué sur l’Elégante, sa Triumph<br />
nerveuse comme une hirondelle. En dépit de l’amour et des possibles,<br />
c’est bien là que se joue son existence, dans ces instants de<br />
liberté absolue. Sur l’obsession et les rendez-vous fatidiques, sur<br />
les fantômes des bords de route, un roman envoûtant porté par<br />
une langue sonore, précise et onirique.<br />
Né en 1971, Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes, selon le vent et l’état de la<br />
mer. Après des études de lettres modernes, il a successivement été moniteur de<br />
voile, surveillant d’internat, libraire, éditeur, maçon et chômeur. Depuis 2001,<br />
il intervient lors de rencontres ou de lectures publiques et anime régulièrement<br />
des ateliers d’écriture. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006.<br />
Romancier – Hors saison (Joca Seria, 2002), La Recette de Stein (Joca Seria,<br />
2004), Facing (Joca Seria, 2005), Fidéicommis (Naïve, 2006), <strong>Le</strong>s Eff acés<br />
(Argol, 2008) –, il écrit également pour le théâtre et l’opéra.<br />
• A noter : la parution simultanée de Hors saison dans la collection de poche<br />
Babel (Babel n° 1071).<br />
Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 160 pages / isbn 978-2-7427-9953-4<br />
relations presse : Aurélie Serfaty-Berc<strong>of</strong>f (01 55 42 14 45)<br />
15
DR<br />
Sylvain Coher
Carénage<br />
J e ne suis pas motard mais de mes vingt ans je garde un parfum<br />
d’essence et d’ennui, le bruit des moteurs et le silence des aprèsmidi<br />
vides. Des années où l’amour et la mécanique vinrent ensemble<br />
occuper les jours et bousculer les nuits.<br />
<strong>Un</strong> séjour de quelques mois dans l’Est de la France aura suffi<br />
pour raviver le souvenir de ces années perdues à rouler vite pour<br />
aller nulle part. Presque chaque soir j’y ai entendu comme autrefois<br />
les hurlements des moteurs déchirer la petite ville en deux,<br />
dans l’axe de sa route nationale. Et quoi faire d’autre quand on a<br />
vingt ans, pour jouer à ne pas devenir vieux ?<br />
<strong>Le</strong>s motards ressemblent bien souvent à leurs motos. Il y a ceux<br />
qui se déplacent pour travailler en semaine, ceux qui se promènent<br />
le week-end et ceux qui vont chercher la nuit les sensations qu’ils<br />
n’auront jamais le jour.<br />
Anton compte parmi ces derniers.<br />
Anton est cette silhouette couchée sur sa machine, telle qu’on<br />
en aperçoit parfois dans un éclair depuis la vitre arrière des voitures<br />
familiales. <strong>Un</strong> garçon dont la vie est un pari sur elle-même. <strong>Un</strong><br />
oiseau de nuit à la recherche du danger, d’un ultime défi mécanique.<br />
L’imaginer n’était pas diffi cile, tant son visage me semblait familier.<br />
Et puis il y a <strong>Le</strong>en, dont l’amour peine à supplanter sa rivale et<br />
à modifi er l’inéluctable trajectoire de ce motard suspendu entre le<br />
pont et l’eau. Car c’est une histoire d’amour à trois : un garçon,<br />
une fi lle, une moto. Et comme souvent dans ces cas-là les rivalités<br />
s’accumulent et s’entrechoquent.<br />
<strong>Le</strong> carénage ne protège que du vent.<br />
Et la Ligne bleue des Vosges est, de l’avis de beaucoup, la plus<br />
belle route du monde.<br />
S. C.<br />
17
18<br />
Carénage (extrait)<br />
C’est toujours la même image, vue d’une visière pr<strong>of</strong>i lée surteinte<br />
contre laquelle toute la lumière imaginable serait venue s’éteindre.<br />
Et l’intérieur noir comme vide, les yeux tout au fond du creux. Vifs<br />
mais pas assez pour recomposer autre chose que cet incorrigible fl ou<br />
dans un paysage irréel. C’est le plus beau rêve d’Anton, celui qu’il<br />
fait presque toutes les nuits depuis son enfance. <strong>Un</strong> véritable cauchemar<br />
pour à peu près n’importe qui. Et la vitesse pure, fl oue, contrariée.<br />
La vitesse comme un gouff re, une brèche temporelle entre le<br />
pont et l’eau.<br />
<strong>Un</strong>e immédiate éternité.<br />
Dans ce rêve, Anton ferme les yeux. Il prend appui sur le rebord<br />
d’un toboggan huilé comme il faut par de petites mains invisibles.<br />
D’un seul coup de feu quelque part on vient de lancer le départ ; on<br />
vient d’ouvrir une vanne et le débit est puissant, la sueur immédiate.<br />
Pas de paroi sur les côtés, rien où planter les griff es d’un chat. C’est<br />
une chute sans fi n, on tombe dans le sommeil comme une bille en<br />
fer lâchée depuis le fond du ciel : la tension diminue, les pulsations<br />
cardiaques ralentissent et on tressaille parce qu’un muscle se relâche<br />
plus rapidement qu’un autre.<br />
Quelque part un moteur s’arrête lorsqu’un autre redémarre.<br />
A cent vingt déjà il n’entend plus que le vent dans le casque. <strong>Le</strong><br />
frou-frou d’un tissu invisible entre par la visière, chatouille le nez<br />
mieux qu’une plume et fait monter des larmes aussitôt chassées sur<br />
les tempes pour rejoindre les cheveux plaqués sous la mousse des<br />
garnitures. Dehors le bruit et dedans les vibrations. Il roule, roule.<br />
Du côté gauche de la cornée, Anton suit le défi lement continuel et<br />
largement hypnotique d’une glissière-guillotine dont l’ondulation<br />
reste de faible amplitude. <strong>Le</strong>s zébras font stroboscopes et Anton reconstruit<br />
la belle continuité d’une ligne blanche principalement<br />
composée de petits segments rectangulaires.
Carénage (extrait)<br />
<strong>Un</strong>e chute peut être mortelle à n’importe quelle vitesse.<br />
La probabilité d’une chute mortelle reste néanmoins liée à la vitesse.<br />
<strong>Un</strong>e main invisible le repousse en arrière tandis qu’une autre plus<br />
large et plus ferme appuie dans son dos et lui donne l’élan que donne<br />
la main d’un père la première fois qu’il vous apprend à faire du vélo.<br />
Alors Anton empoigne sa couette comme s’il s’agissait de poignées<br />
en caoutchouc. Ses doigts se crispent, le pouce cherche les commodos<br />
et il essore malgré lui plein gaz à en décoller le matelas du canapé de<br />
son minuscule studio.<br />
A cent quarante, Anton perd la sensation physique du sol sur lequel<br />
les deux rubans de caoutchouc des pneus Supercorsa gonfl és à bloc<br />
le maintenaient jusqu’alors. Il doit se reprendre pour ne pas se redresser<br />
brusquement en criant à pleine gorge les bras grands ouverts<br />
le slogan du constructeur anglais : Go Your Own Way ! Au lieu de cela<br />
Anton relâche les épaules et derrière la visière dans les refl ets irisés on<br />
peut le voir sourire avec cette incroyable légèreté qui fait de lui l’hirondelle<br />
des jours de pluie. L’âme vagabonde, un trait noir évanescent<br />
qui dessine hâtivement le contour des champs et la périphérie enrubannée<br />
de la ville. <strong>Un</strong>e hirondelle voltant et piquant d’une abatée sur<br />
l’aile ou sur la queue. Spirale, vrille, boucle et retournement.<br />
La vitesse vous manque.<br />
La vitesse vous fait perdre du poids. <strong>Le</strong> corps libéré de toute entrave<br />
et l’euphorie de l’oxygène bu sans mesure à grandes lampées au goulot<br />
d’une bouteille gigantesque. Anton roule vite. Il roule, roule. La<br />
moto qui l’entraîne n’a rien d’un cheval de Troie, rien d’une Oural<br />
aux pneus de 4x4 ; ce n’est pas la Poderosa du Che dans la poussière<br />
des pistes chiliennes ni l’une de ces Royal Enfi eld dont le sillage est<br />
formé par la fumée d’un millier de bâtonnets d’encens. La moto qui<br />
l’entraîne n’a rien des chromes d’une Norton 500 ni les crampons ni<br />
la boue d’un trail haut perché pour les buttes sablonneuses du Sinaï.<br />
L’Elégante est un oiseau de proie dont le puissant siffl ement rappelle<br />
simultanément celui du serpent furieux, du chat échaudé et de la<br />
chouette eff raie.<br />
<strong>Un</strong> corps noir qui absorbe tout et ne rend rien.<br />
Si le sol vous brûle les pneus c’est que vous ne roulez pas assez vite.<br />
Vous sentez bientôt les remontées de chaleur du trois cylindres le long<br />
de vos jambes dont les muscles se tendent à mesure que vous vous<br />
19
Carénage (extrait)<br />
élevez dans les tours. <strong>Le</strong> beau bruit court le long de la partition, il y<br />
a des routes dont on ne voudrait pas voir la fi n.<br />
Anton est partout à la fois. Sur les lacets du Snake de Mulholland<br />
Drive, sur la Rainbow Ride africaine et sur le Wangan périphérique<br />
de Tokyo. Mother Road et Garden Road. Anton dévale le terrifi ant<br />
Russian Highway from Hell et la Great Ocean Road australienne. Il<br />
va vers <strong>Le</strong>h, vers Frisco, et l’entrelacs des virages forme une frise interminable.<br />
Il ne semble vivre que par le haut du corps, à partir des hanches.<br />
Quelques mouvements des pieds mis à part – sur le levier du frein<br />
d’un côté et sur le sélecteur de l’autre –, les genoux restent bien plaqués<br />
de part et d’autre contre les fl ancs de la machine. Anton pleure<br />
sur la Passo Gardena des Dolomites, sur la Dixie et l’Enfer vert du<br />
Nürburgring Nordschleife desquels il revient bientôt pour refaire le<br />
tracé idéal, entre les courtes portions de voie express, les nationales<br />
et le ballon d’Alsace. Jusqu’à la route des Crêtes chargée des senteurs<br />
boisées d’un automne vosgien qui le rapproche kilomètre après kilomètre<br />
d’un lit puant l’essence, le caoutchouc brûlé et le goudron frais.<br />
Lorsqu’il entre dans la zone rouge à près de quatorze mille tours<br />
par minute la surface se dérobe sans eff ort. Il est devenu cet objet<br />
propulsé dans le vide pénétrant l’air par l’eff raction continue d’un<br />
empilement de murs et de fenêtres qui se referme avec fracas loin<br />
derrière lui.<br />
Anton roule. Il roule. <strong>Un</strong> simple mouvement dans l’espace, la trajectoire<br />
d’une balle privée de cible. <strong>Le</strong> monde n’a pas bougé d’un<br />
cheveu et pourtant il s’en trouve diff érent. Ici chaque seconde est un<br />
univers et rien dans la conduite ne peut être renouvelé à l’identique.<br />
Anton vient de rendre à l’air son immobilité et un vieux vers scolaire<br />
lui revient en mémoire : Ce ne peut être que la fi n du monde, en avançant.
Régine Detambel<br />
Son corps extrême<br />
Roman<br />
Ebranlée dans sa chair par un accident de voiture, Alice vit heure<br />
par heure les mutations de son corps à travers l’expérience de<br />
la cicatrisation, de la consolidation, de la musculation. Prélude<br />
à une renaissance dans un corps diff érent, rejoué, renégocié, ce<br />
voyage dans le chantier organique et le monde clos qu’est l’hôpital<br />
est aussi un roman puissamment initiatique sur les séductions<br />
exercées par la mort et la maladie à certaines étapes de l’existence,<br />
quand s’instaure un rapport inédit à la vérité, voire à une forme<br />
de spiritualité.<br />
Née en 1963, Régine Detambel, kinésithérapeute de formation, vit aujourd’hui<br />
dans la région de Montpellier et est l’auteur depuis 1990 d’une œuvre littéraire<br />
de tout premier plan, publiée pour l’essentiel chez Julliard, au Seuil et chez<br />
Gallimard. Chevalier des Arts et des <strong>Le</strong>ttres, Régine Detambel a également été<br />
lauréate du prix Anna de Noailles de l’Académie française. Chez Actes Sud, elle<br />
est l’auteur du Syndrome de Diogène (essai, 2008). Dernières publications :<br />
50 histoires fraîches (Gallimard, 2010 ; sélection prix Goncourt de la Nouvelle),<br />
Sur l’aile (Mercure de France, 2010).<br />
Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 160 pages / isbn 978-2-7427-9921-3<br />
relations presse : Régine <strong>Le</strong> Meur (05 62 66 94 63)<br />
21
DR<br />
Régine Detambel
Son corps extrême<br />
J’ ai longtemps fréquenté les hôpitaux comme auxiliaire<br />
médicale. J’y suis souvent retournée par l’écriture. <strong>Un</strong> hôpital<br />
est une grosse machine cliquetant comme un Tinguely, une entreprise<br />
pleine de mouvements et de bruits, de circuits électriques,<br />
de pompes, de lumières, de matériaux radioactifs, avec du plâtre,<br />
et des clous, des vis… L’hôpital est aussi vivant et bruyant qu’un<br />
chantier d’autoroute.<br />
Aux yeux d’Alice – que j’ai choisi de nommer ainsi pour <strong>Le</strong>wis<br />
Carroll et les folles modifi cations du corps de son héroïne au cours<br />
de ses aventures –, l’hôpital est surtout un chantier organique. <strong>Le</strong><br />
corps comme acteur et comme œuvre ne devrait pas être exclusivement<br />
réservé aux plasticiens et aux performeurs. La patiente, se<br />
remodelant, s’exhibe en pleine performance, dans un authentique<br />
art du corps.<br />
Il m’a également semblé essentiel de montrer quelle peut être la<br />
résonance politique des soins hospitaliers, depuis le service de<br />
réanimation, sans doute le plus haut lieu de surveillance technocratique,<br />
jusqu’au centre de rééducation, où se côtoient, démocratiquement,<br />
des bancroches et des manchots de milieux divers, avec<br />
des philosophies et des approches de la vie extrêmement variées.<br />
L’hôpital, comme le monastère ou la prison, est par excellence<br />
le lieu de la métamorphose physique et morale, de la crise, de la<br />
prise de conscience : telle est la mission de l’alitement forcé, faire<br />
qu’on s’arrête et qu’on regarde mieux en soi-même. Pour l’écrivain<br />
comme pour son personnage, il arrive qu’un tel séjour apparaisse<br />
soudain comme une nécessité inévitable, absolument pas au sens<br />
médical mais dans un sens existentiel.<br />
R. D.<br />
23
<strong>Le</strong>s œuvres électroacoustiques du moniteur cardiaque. <strong>Un</strong> beau jour<br />
on coupe les machines. Aussitôt qu’on débranche les moniteurs, le<br />
bruit intérieur cesse et Alice ne s’entend plus vivre. Elle n’entend plus<br />
le ré majeur pointu du cœur qui était le sien propre. Eff roi de n’être<br />
pas. Dans ce cri horrifi é, retour de la voix d’Alice. Sa voix lui paraît<br />
étrange, sinistre, elle la sent comme quelque chose qu’elle aurait avalé,<br />
de trop gros pour elle. Puis clarté : le choc minime d’un bouton de<br />
blouse contre le pied métallique du lit. <strong>Un</strong> petit coup de xylophone<br />
qui requinque. Alice comprend alors qu’elle respire seule, elle vit<br />
seule. Adieu, fantasmes rétrogrades, ce bonheur aux yeux clos ne<br />
pouvait pas durer.<br />
Elle était si bien depuis des semaines, elle était un vase de céramique<br />
avec çà et là de grossières empreintes de pouce. Elle sonnait délicieusement<br />
le creux, elle était modelée par des doigts de latex, elle était<br />
un contenant incontinent, et soudain les lettres reviennent, la ronde<br />
des voyelles et les actes de magie dont elles sont capables. Qui cassent<br />
la baraque. <strong>Le</strong>s lettres maintenant lui dansent dans la bouche et le<br />
golem en elle ressuscite, l’homoncule au teint brouillé reprend vie,<br />
désormais en état de balbutier des choses particulièrement utiles,<br />
comme je m’appelle Alice et je ne me souviens pas du tout de ce qui<br />
s’est passé. Or la mémoire fonctionne aux vibrations. Ce sont les<br />
vibrations de la voix qui entraînent ses courroies. Aux premiers mots<br />
d’Alice, l’usine rouvre ses portes. Sirènes de l’usine qui rappelle ses<br />
acteurs. Ça cogne et tonne en elle, c’est le grondement du temps qui<br />
se remet en route. Retour en fanfare du souvenir.<br />
On ne s’éveille pas vierge d’un coma. Même si on a l’impression,<br />
un temps, que tout est blanc, il y a eu les cauchemars. <strong>Le</strong>s démons<br />
hantent le silence et s’en nourrissent, ils sont la face vénéneuse des<br />
choses dont on avait si peur dans la chambre d’enfant, ils sont l’ombre<br />
24<br />
Son corps extrême (extrait)
Son corps extrême (extrait)<br />
de l’armoire, ils sont la tache de moisi sur la toile de Jouy qui, dans<br />
la presque obscurité, avait l’air d’une tête de mort, ils sont des âmes<br />
en peine et des spectres condamnés à une course désordonnée et<br />
éternelle.<br />
On ne s’éveillera plus jamais vierge. <strong>Le</strong>s plis sont marqués partout.<br />
La preuve, c’est qu’on n’a pas toute la vie à retraverser quand on rouvre<br />
les yeux, un beau matin, dans un lit surélevé et muni de manivelles<br />
commodes. On n’a pas grand-chose à passer en revue, excepté ses<br />
abattis peut-être. Mais le fait d’être femme, le fait d’être mère, le fait<br />
de se demander si on est folle ou saine, tout revient aussitôt, le fardeau,<br />
le fagot, le paquet de souvenirs mouillés comme du linge lourd lui<br />
reviennent en pleine poire. Alice sait déjà tout, les scandales sont<br />
restés des scandales, les bonheurs sont toujours lumineux. Rien de<br />
changé. Rouvrir les yeux sur un matelas à eau de quarante centimètres<br />
d’épaisseur n’a créé aucun court-circuit déroutant. Et bien que son<br />
existence ait été largement éventrée et retournée par l’événement,<br />
Alice appartient toujours au même règne, à l’embranchement souhaité,<br />
pointe dans la classe idoine, évolue dans l’ordre, la famille, le<br />
genre et l’espèce ad hoc. Elle n’a pas eu droit à du neuf. Elle a remis<br />
sa vieille vie, d’occase, et replantera ses pieds dans les mêmes ornières.<br />
Rien n’a fait surgir de son être psychique des combinaisons fantastiques<br />
ou subtiles, elle se retrouve comme devant, déjà bouleversée, déjà<br />
infi niment angoissée, avec la peur et la rage au ventre, qui déploient<br />
leurs fastes et hissent leurs drapeaux.<br />
Elle s’éveille donc seule, David a disparu. Pour les diff érends, du<br />
moins, ils se sont toujours bien entendus et Alice ne perd rien à<br />
émerger dans cette réalité-là, avec pour seul nuage une poche de<br />
glucose au-dessus de sa tête et pour tout roulement de tonnerre le<br />
rire bête et bienfaisant de la famille banale qui visite sa voisine de<br />
chambre. Elle a la tête eff royablement lourde, gourde, elle est toujours<br />
en retard d’une réplique et son intelligence traîne derrière elle, égarée<br />
quelque part dans l’épave de la voiture ou sous le lit ou dans le tiroir<br />
de la table de chevet avec les protège-slips, un miroir inutile et des<br />
sucrettes. Elle somnole dans ce monde complet, ouaté et glougloutant.<br />
Ses pensées forment une matière légère, alvéolée. Et le vide apparent<br />
dans son crâne tient à l’allongement inouï des temps de pose entre<br />
deux réfl exions, si bien que chacune de ses journées se love dans une<br />
25
Son corps extrême (extrait)<br />
seule image qui suffi t à la condenser. <strong>Le</strong>s heures se remplissent d’ellesmêmes<br />
d’une sorte de matière sans valeur, de billes de polystyrène,<br />
de bulles de plastique qui n’ont ni goût ni couleur. L’extrême de<br />
l’allègement. Alice jouit du bonheur de se fondre dans la masse, de<br />
n’avoir plus à décider du bien et du mal. Aubaine que d’être dépouillée<br />
de la pénible tâche de penser, libre du carcan des conventions et des<br />
manières, ne répondant rien quand on lui parle, n’ouvrant pas la<br />
bouche quand on lui donne à manger. <strong>Le</strong> vide est un baume aux<br />
tourments de soi. <strong>Un</strong>e terrible et merveilleuse dispense d’humanité.<br />
Portée par la morphine, Alice goûte une paix royale. Il faut atteindre<br />
parfois la très grande vieillesse pour la trouver enfi n. Des femmes de<br />
quatre-vingt-seize ans ne se souviennent pas de leurs enfants, même<br />
pas d’en avoir eu, elles disent : C’est si loin maintenant, et elles sont<br />
vraiment tout à fait tranquilles.<br />
Des idées qu’elle a hébergées jusque-là sans raison la quittent tandis<br />
que d’autres, à l’apparence neuve, viennent s’installer dans cette<br />
carcasse paisible qui paresse toute la journée. La fi èvre travaille à<br />
l’engourdir, Alice souhaiterait que ça dure jusqu’à la mort, mais elle<br />
sent déjà que viendra la douloureuse guérison, qui gratte, qui pique,<br />
qui démange, qui lance, qui recolle, qui retape. Cette espèce de grosse<br />
paysanne inusable qu’est la vie, bouffi e de forces, gaie et quasiment<br />
aveugle, est en train de la sarcler au plus pr<strong>of</strong>ond.
Hélène Frappat<br />
INVERNO<br />
Roman<br />
Dans l’enfance, Emmanuelle a été la meilleure amie de L. Vingt<br />
ans plus tard, elle resurgit dans sa vie, l’invitant à lui rendre visite<br />
quelque part en Bretagne. Dans le train qui, machine à remonter<br />
le temps, emmène L. et son fi ls vers les brumes du passé, les souvenirs<br />
et les destins prennent corps.<br />
Avec une délicatesse et une justesse rares, Hélène Frappat explore<br />
la position du témoin qui surprend chacun à la lisière de soi, au<br />
bord des autres. Cinégénique et musical, inverno eff euille les mystères<br />
de la mémoire et fredonne la dissonance des émotions, sur<br />
l’air d’une fugue où la nostalgie n’est jamais dénuée de violence.<br />
Hélène Frappat est née en 1969 à Paris. Traductrice de l’anglais et de l’italien,<br />
elle est l’auteur de trois romans : Sous réserve (Allia, 2004), L’Agent de<br />
liaison (Allia, 2007) et Par eff raction (Allia, 2009 ; mention spéciale du jury,<br />
prix Wepler 2009).<br />
Août 2011 / 10 x 19 / 144 pages / ISBN 978-2-7427-9909-1<br />
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)<br />
27
© Philippe Matsas / Opale / Actes Sud<br />
Hélène Frappat
INVERNO<br />
J’ ai voulu écrire un roman comme un train qui fi lerait dans la<br />
nuit. <strong>Le</strong> train avance, mais peu à peu le lecteur qui s’y embarque<br />
regarde défi ler, sur l’écran des vitres transformées par l’obscurité en<br />
miroir, sa propre vie, et des souvenirs : les siens, et ceux des compagnons<br />
d’une vie – amis, amants, parents, disparus, fantômes bienveillants<br />
ou menaçants.<br />
Mon train est une machine à remonter le temps. Il part de la<br />
gare Montparnasse et se dirige vers la Bretagne. A bord, une mère<br />
et son fi ls. L. part retrouver son amie d’enfance Emmanuelle qu’elle<br />
n’a pas revue depuis vingt ans.<br />
Durant cette parenthèse suspendue entre deux gares, dans cet<br />
espace-temps parallèle qui semble ne se dérouler nulle part, d’autres<br />
voyages en train refont surface.<br />
<strong>Un</strong>e femme quitte son pays pour retrouver son amant. Elle<br />
s’installe aux abords d’une gare romaine. Plus tard, elle fera le<br />
trajet en sens inverse. <strong>Un</strong>e autre femme s’<strong>of</strong>f re à des inconnus de<br />
passage dans le compartiment d’un train de banlieue. A la fi n des<br />
années 1960, dans une brasserie proche de la gare Saint-Lazare,<br />
un homme se découvre jaloux.<br />
De l’incertitude et des pièges de la mémoire émergent par instants<br />
des indices glaçants. Dans le noir des tunnels, les lambeaux d’une<br />
enfance engloutie, d’un amour défunt, resurgissent par fl ashes. La<br />
saveur ambiguë et douceâtre de la nostalgie empoisonne peu à peu<br />
le lecteur.<br />
Sur l’écran des vitres du tunnel, les nuages et les saisons défi lent,<br />
aussi changeants que dans un ciel de Bretagne : printemps versatile,<br />
été caniculaire, ombres roses automnales des bruyères, et l’hiver,<br />
inverno, qui commande les saisons du souvenir.<br />
H. F.<br />
29
A l’âge de sept ans, à son arrivée au mois d’octobre dans sa nouvelle<br />
école primaire (un bâtiment en brique identique aux résidences hlm<br />
de cette rue paisible de Saint-Ouen), L. avait été adoptée par une<br />
petite fi lle au troisième rang qui avait désigné la place vide à côté<br />
d’elle. Sans paraître remarquer la gêne de la nouvelle (que tous ses<br />
camarades de classe prirent pour de la hauteur), Emmanuelle lui<br />
adressa un sourire qui fendit son visage triangulaire d’une ligne immense<br />
parallèle à la fente hilare de ses yeux. Depuis, les petites fi lles<br />
étaient inséparables, dormant chez la mère de l’une ou les parents de<br />
l’autre, passant les longs mercredis pluvieux d’automne ensemble.<br />
Emmanuelle habitait au neuvième étage d’une tour résidentielle.<br />
<strong>Un</strong> tapis en fourrure blanche, un canapé et une table basse en plastique<br />
remplissaient à peine l’espace symétrique du salon. Contre les baies<br />
vitrées envahies de ciel (s’il fait beau, on aperçoit le Sacré-Cœur), la<br />
silhouette de Bérangère passe comme une ombre. <strong>Un</strong> matin, à travers<br />
la salle de bains ouverte, L. a aperçu son corps nu gracile incliné vers<br />
la baignoire.<br />
Tout change à l’arrivée du père. Mère et fi lle répriment leurs fous<br />
rires complices ; le tapis blanc du salon étouff e les sons ; l’horizon,<br />
par-delà les baies vitrées, prend une teinte grise. Bientôt, si elle ne<br />
s’enfuit pas à temps, L. devra s’asseoir autour de la table ronde et<br />
observer discrètement le rituel du dîner en famille, pour ne pas commettre<br />
d’impair.<br />
Dans sa mémoire, la silhouette massive du père d’Emmanuelle se<br />
détache sur fond d’un ciel incolore où les traits du visage de l’homme<br />
en contre-jour paraissent fi gés, tandis que le défi lé des nuages sales<br />
de l’Ile-de-France tourbillonne.<br />
Certains dimanches, L. accompagne Emmanuelle à l’aéroport du<br />
Bourget où son père – détendu soudain, heureux presque, au milieu<br />
d’une troupe bruyante d’hommes – saute en parachute. Elle s’ennuie<br />
30<br />
inverno (extrait)
inverno (extrait)<br />
pendant que le petit visage d’Emmanuelle, le menton pointé avec<br />
intensité vers le ciel, scrute l’horizon à la recherche de la tache minuscule<br />
du parachute de son père. Lorsqu’il tombe à terre avec un<br />
bruit sourd et se dégage en riant de l’écheveau de cordes et de toiles,<br />
L. s’éloigne en direction des baraquements pour ne pas assister aux<br />
retrouvailles de la fi lle et du père.<br />
<strong>Un</strong> été, peut-être au mois de juillet (durant ces vacances dans la<br />
presqu’île de Crozon ?), le père d’Emmanuelle est venu chercher les<br />
petites fi lles en voiture. (Ses souvenirs émergent du passé, vacillants.<br />
L. est incapable d’identifi er l’époque du divorce des parents d’Emmanuelle,<br />
tant le mari et sa jeune femme ont toujours formé dans<br />
son esprit deux entités distinctes.)<br />
Ils parcoururent des kilomètres dans la Mercedes silencieuse qui<br />
lui donnait mal au cœur. Derrière les vitres, le ciel bas sentait l’hiver,<br />
comme si, à proximité du père d’Emmanuelle, il régnait une autre<br />
saison, plus venteuse, plus froide. Sur le siège arrière, à côté d’Emmanuelle<br />
qui faisait semblant de dormir, elle avait écouté l’homme<br />
se livrer à de violentes diatribes contre les étrangers, ses ennemis. Il<br />
n’avait même pas réagi – L. devinait son regard dans le miroir rectangulaire<br />
du rétroviseur – lorsque l’amie de sa fi lle l’avait interrompu<br />
avec insolence. (L’homme semblait enfermé dans un lieu où<br />
aucune parole, même brutale, ne pouvait l’atteindre.)<br />
A l’issue du voyage, les portes de la voiture s’étaient ouvertes sur<br />
la pointe du Raz. <strong>Le</strong>s deux petites fi lles s’étaient tenues par la main<br />
pour résister à la menace du vent. On entendait au loin, dans la baie<br />
des Trépassés, le hurlement des galets qu’entrechoquent les rouleaux<br />
de l’Océan.
Kaoutar Harchi<br />
L’Ampleur du saccage<br />
Roman<br />
Héritiers maudits d’une féroce répression sexuelle qui s’est exercée<br />
trente ans plus tôt et a marqué leurs destins respectifs du sceau de la<br />
désespérance, quatre hommes liés par la fatalité du sang traversent<br />
la Méditerranée où s’écrit, sous le ciel algérien, l’ultime épisode de<br />
leur inconsolable désastre.<br />
Née à Strasbourg en 1987, de parents marocains, Kaoutar Harchi, titulaire<br />
d’une licence de lettres modernes, d’un master de socio-anthropologie et d’un<br />
master de socio-critique est, depuis 2010, doctorante-monitrice à la Sorbonne,<br />
où elle assure des enseignements en littérature et sociologie. Elle vit aujourd’hui<br />
dans la région parisienne. Zone cinglée, son premier roman, a été publié en<br />
2009 aux éditions Sarbacane.<br />
Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 128 pages / isbn 978-2-7427-9952-7<br />
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)<br />
33
© Tanguy de Montesson<br />
Kaoutar Harchi
L’Ampleur du saccage<br />
L ’Ampleur du saccage est un texte que j’ai écrit en résonance<br />
aux nombreux romans d’auteurs algériens que j’ai découverts<br />
à l’âge de vingt ans. Je pense à Nedjma de Kateb Yacine, à La<br />
Répudiation de Rachid Boudjedra, à L’Amour, la fantasia d’Assia<br />
Djebar et à bien d’autres encore. Ces œuvres qui me hantent ont<br />
contribué à confi gurer l’espace de ma propre création littéraire.<br />
La misère aff ective et sexuelle, le fantasme de fusion avec la fi gure<br />
maternelle entretenu par les jeunes garçons, le spectre de l’inceste,<br />
le tabou qui pèse sur le désir féminin, les rapports familiaux dominés<br />
par la rivalité intergénérationnelle, sont autant de thèmes<br />
qui constituent le cœur battant de mon roman et ont nourri ma<br />
volonté d’aborder, dans sa radicalité la plus totale, la problématique<br />
de la fi liation.<br />
Est-il possible d’entretenir avec ses parents – et tout particulièrement<br />
avec sa mère – une relation délivrée du “pathologique” ?<br />
Non, semblent répondre les hommes de mon récit, incapables de<br />
se déprendre de la douloureuse ambiguïté qui les lie à Nour, fi gure<br />
maternelle autour de laquelle tous, fatalement, gravitent.<br />
Ils forment le carré d’une malédiction au centre duquel se trouve<br />
cette femme-mère vers qui l’amour et le désir convergent continuellement<br />
alors même que l’omniprésence de la parole masculine<br />
l’écrase, la réduit au cri puis au silence. Il m’importait que cette<br />
confi guration, ce cernement, puissent faire écho à la réalité de<br />
certaines sociétés arabo-musulmanes qui, parce qu’elles maintiennent<br />
les femmes dans une certaine dimension symbolique, nient<br />
ce qu’elles ont de chair et de sang. De réalité.<br />
K. H.<br />
35
Avec la fi n de mes hallucinations viennent les bruits de la ville, les aboiements<br />
des chiens et sa voix qui m’appelle. Homme menteur, routier à<br />
tout faire, Si Larbi, mon étrange tuteur, s’absente des semaines et des mois<br />
mais revient toujours à la maison. Il est ce corps boomerang qui provoque<br />
ma colère tant il retient de secrets.<br />
Attablé comme s’il allait s’endormir, sa mâchoire dessine dans l’air des<br />
cercles immenses ponctués par le claquement bestial des dents. Si Larbi,<br />
la cinquantaine grise, ingurgite et recrache. Noyaux et osselets. Il préfère<br />
la graisse à la chair. Apprécie peu le poisson et ignore le rythme des repas.<br />
Son dos ploie sous le poids. De sa carcasse hagarde, seuls ses yeux sont<br />
demeurés vifs. Si Larbi, continuellement aff alé, rêve d’un ailleurs folklorique<br />
béni d’insouciance, bordé par une mer bleue tranquille. Il est<br />
pourtant assis là-bas, dans le salon, débordant de sa chaise, malodorant,<br />
prisonnier d’un univers étroit : son grand camion retapé à neuf, ses cartes<br />
routières, sa besace en cuir, son briquet, ses mouchoirs en papier. Ma<br />
cohabitation avec lui est une lutte sans violence où la présence de l’un<br />
provoque l’absence de l’autre. Au fi l des jours, j’invente une danse miraculeuse<br />
qui <strong>of</strong>f re à chacun de ses gestes son exact contraire. Mes mouvements<br />
forment un ballet fait d’évitements, de déviations ultimes,<br />
d’arrangements et de volte-face. Croiser Si Larbi, c’est me risquer à lui<br />
poser mille questions et cela ne servirait à rien. L’homme est symbole de<br />
silence. Alors, je guette. <strong>Le</strong>s pas dans le couloir, les fenêtres que l’on referme,<br />
les tiroirs que l’on ouvre. Je me retiens d’aller aux toilettes, je patiente<br />
contre le chambranle de la porte, je rebrousse chemin, je sors, je rentre.<br />
Ces bruits esquissent dans mon esprit la géographie incertaine de lieux<br />
momentanément infréquentables.<br />
Mon amour vacille au fi l des départs. Lorsque Si Larbi s’en va vers de<br />
nouvelles destinations, je crains qu’il ne revienne plus jamais. <strong>Un</strong> accident<br />
de la route, une bagarre… J’y pense des heures durant et ma gorge se<br />
36<br />
L’Ampleur du saccage (extrait)
L’Ampleur du saccage (extrait)<br />
noue. Je me demande alors qui me dira, qui me racontera, qui acceptera<br />
d’aiguiller la quête d’un môme sans passé. Je n’appartiens à aucune terre,<br />
je ne descends d’aucune lignée, je suis là, simplement. Cause abandonnée<br />
au bon vouloir des mystères mutiques, je dérive le long des impostures,<br />
épuisé, car tous les ports d’accueil ont disparu : j’ignore d’où je viens.<br />
Je pense peu à mon géniteur, seule ma génitrice m’obsède. Je suis en<br />
quête perpétuelle du ventre qui m’a porté et nourri, d’où j’ai froidement<br />
été expulsé. Jeté au monde. Depuis, j’erre sans avoir personne vers qui<br />
me retourner. Mais à qui me plaindre ? Mon sang est orphelin. Mon<br />
corps, sans autre corps. Il me faut connaître cette préhistoire de ma vie,<br />
essentielle à sa poursuite. J’ai dans la tête des voix muettes, des yeux fermés,<br />
le portrait d’une femme qui me tourne éternellement le dos. Mais je<br />
n’abandonne pas. Je fonde ma propre légende, récit de mon enfance,<br />
conte du présent, où les éléments imaginés se mêlent à ceux vécus. J’avance<br />
ainsi, traquant photos et cartes postales, lettres et billets de train. Je collectionne<br />
tout ce qui pourrait m’aider à comprendre. J’accumule des<br />
indices insignifi ants, miettes d’informations, débris incohérents chipés<br />
des cartons, soustraits à la poussière des vieux classeurs, pistes de misère<br />
à travers lesquelles je recherche un fi l conducteur. Logique interne de ma<br />
vie. Je voudrais savoir quel est mon peuple, quelle est ma lutte, moi qui<br />
suis issu d’un trou douloureux, aussitôt ouvert aussitôt refermé.<br />
*<br />
Mon nom est Arezki et d’ordinaire, on ne m’appelle pas. J’ai trente ans<br />
et vis au sommet d’une tour claire noyée dans le ciel. J’ai cessé de fréquenter<br />
les cages d’escaliers aux odeurs d’urine tenaces, désormais je reste posté<br />
à la fenêtre de ma chambre mais partout mon air est irrespirable, je suffoque.<br />
La tête penchée dans le vide, les yeux fermés, je tente de comprendre<br />
le pourquoi d’une existence dénuée de sens, sans plaisir, menée à huis-clos<br />
comme si le monde autour de moi avait disparu. Ma mère la première.<br />
Figure inconnue qui me hante, je l’imagine et me demande ce qui en moi<br />
vient d’elle ; je demeure sans réponse, abruti par la cruauté des énigmes<br />
et l’entêtement de Si Larbi à se taire. Avec le temps, j’ai fi ni par accepter<br />
son comportement. Ne disposant d’aucune ressource, je dépends entièrement<br />
de lui. Mon quotidien est fait d’ennui, de trafi cs, de questions.<br />
C’est le désœuvrement mêlé à ce sentiment de n’être rien.<br />
37
L’Ampleur du saccage (extrait)<br />
A Paris, le travail n’existe plus. Nostalgique, je continue de fréquenter les<br />
usines et traîne sur les grands boulevards. Je squatte les dépotoirs pour<br />
observer, à travers les carreaux grossissants, les couples violents qui se<br />
déchirent et se recollent. Voyeur depuis mes quinze ans, je me nourris de<br />
l’aff ection des autres et rêve d’être séquestré par des bras amoureux m’assurant<br />
l’asile une nuit sur deux.<br />
<strong>Le</strong>s femmes me sont inconnues. D’elles, je ne sais que les formes animales<br />
et pornographiques. <strong>Le</strong> manque de confi ance m’a toujours empêché de<br />
partir à leur rencontre et mes doigts ne font que parcourir les pages glacées<br />
des magazines. Durant de longues heures, la main glissée dans mon<br />
pantalon, je malmène et torture des corps qui ne m’ont rien fait. Auxquels<br />
je n’aurai peut-être jamais droit. <strong>Le</strong>s fi lles sont chères aujourd’hui. Pénétrer<br />
c’est payer. Je ne suis plus un homme mais un sexe nomade en quête d’un<br />
refuge humide. <strong>Un</strong> sexe obsédé par lui-même, malade sous la pression<br />
du manque, prêt à se casser, un sexe courbaturé, pris de vomissements<br />
mais qui ne peut vomir. Pourtant, je sais que je ne suis pas seul. Alignés<br />
le long des trottoirs, réunis à l’entrée des immeubles, les autres puceaux<br />
surveillent les fi lles comme des vigiles amoureux. Ils parient sur celles qui<br />
se retourneront jusqu’à ce que l’un d’entre eux reconnaisse sa sœur, passante<br />
inconnue devenue cible des railleries. Il faut le dire : les mères peinent à<br />
tenir leurs fi lles qui, apportant le linge sale à la laverie, se donnent en<br />
spectacle. Actrices méditerranéennes prises au jeu des regards, inconscientes<br />
des risques encourus à l’idée de provoquer des mâles aussi beaux que<br />
dangereux. Dans les rues, on siffl e et on crache.<br />
Chaque semaine, les habitants de la ville se trouvent une nouvelle fi gure<br />
expiatoire. Ils vivent des vengeances plein la tête, rejouent des guerres<br />
ancestrales autour d’une partie de cartes. Tous cultivent une haine innée<br />
si bien que les fi ls deviennent les héritiers forcés des grandes violences.<br />
Ces fi ls se connaissent entre eux. Ils ont mordu le même sein, partagé la<br />
même couche et dans la nuit éprouvé les mêmes plaisirs. <strong>Le</strong>s secrets<br />
n’existent pas dans ce genre de clan. <strong>Le</strong>s hommes sont des transparences<br />
en blouson de cuir qui se laissent pénétrer par la curiosité familiale. <strong>Le</strong><br />
partage est une règle proche de l’inceste.
Denis Lachaud<br />
J’apprends l’hébreu<br />
Roman<br />
Frédéric, dix-sept ans, suit ses parents à travers l’Europe, d’un déracinement<br />
à l’autre, pr<strong>of</strong>ondément menacé dans son équilibre.<br />
Mais après Paris, Oslo et Berlin, la famille débarque à Tel-Aviv<br />
et le jeune homme découvre la singularité d’Israël – un pays et<br />
une langue qu’il pourrait peut-être enfi n faire siens, parce que si<br />
proches de lui dans leurs rapports complexes à l’identité, au territoire<br />
et à l’appartenance.<br />
Après J’apprends l’allemand (1998 ; Babel n° 406), La Forme pr<strong>of</strong>onde<br />
(2000 ; Babel n° 568), Comme personne (2003 ; Babel n° 641), <strong>Le</strong> vrai<br />
est au c<strong>of</strong>f re (2005 ; Babel n° 934) et Prenez l’avion (2009), J’apprends<br />
l’hébreu est le sixième roman de Denis Lachaud publié aux éditions Actes Sud.<br />
Acteur, auteur, metteur en scène, il travaille pour le théâtre. Ses pièces sont<br />
publiées chez Actes Sud-Papiers.<br />
Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 240 pages / isbn 978-2-7427-9943-5<br />
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)<br />
39
DR<br />
Denis Lachaud
J’apprends l’hébreu<br />
J e vais en Israël. De nombreuses fois. Quelques semaines. Je<br />
m’y sens chez moi, parmi ceux que j’aime. Je décide d’y séjourner<br />
plusieurs mois pour écrire.<br />
Commencer un nouveau roman, c’est apprendre une nouvelle<br />
langue. <strong>Le</strong> premier jour, les premiers mots apparaissent et derrière<br />
eux, l’édifi ce lentement se dessine. Tout obéit à certaines règles,<br />
un peu mystérieuses, qu’il s’agit d’identifi er et de suivre pour<br />
avancer, grammaire de la nouvelle langue, architecture de la fi ction.<br />
Je m’installe à Tel-Aviv. J’apprends l’hébreu et j’écris J’apprends<br />
l’hébreu. Car j’ai envie d’écrire sur ce que je vois, entends et ressens ;<br />
sur tout ce que j’ignorais avant de venir. J’entre dans la langue et me<br />
vient l’histoire qui va traduire en mots ce qui se rassemble en moi.<br />
J’écris sur Tel-Aviv : c’est de là que je pars. Et Frédéric apparaît.<br />
Il quitte Berlin pour Tel-Aviv, avec sa famille. Apprendre l’hébreu,<br />
c’est pour lui tenter d’échapper à l’eff ondrement, à la folie.<br />
<strong>Un</strong> homme s’assied à côté de moi. Il voit que j’écris. Il me questionne<br />
sur le sujet.<br />
– Tel-Aviv, c’est Israël, dit-il. Quand je sors de Tel-Aviv, je prends<br />
l’avion et je quitte le pays.<br />
Je pars. J’explore. Haïfa, Saint-Jean-d’Acre, Tibériade. <strong>Le</strong> Néguev.<br />
Jérusalem. Puis Bethléem et Ramallah.<br />
A chaque fois, je pars de Tel-Aviv et je porte en moi Frédéric qui<br />
tente de se sauver, avec toute l’énergie du désespoir.<br />
J’apprends l’hébreu est un roman israélien.<br />
D. L.<br />
41
Mon père trouve que les Israéliens sont mal élevés, même en matière<br />
de business, dit-il, tu tends le pied, ils marchent dessus. Mon père<br />
est trop suisse pour Tel-Aviv. Genève fait obstacle. Genève n’est pas<br />
un avantage ici, Genève est un avantage quand on évolue au sein de<br />
la civilisation suisse et de ses trottoirs impeccables, mais pas ici, oh<br />
non, pas ici. Par chance pour le couple parental, ma mère est française.<br />
Elle sait marcher sur le pied, elle aussi.<br />
Pour aller dans le sens de mon père, il est vrai qu’ici les voitures s’arrêtent<br />
constamment sur les passages cloutés, au mépris des piétons.<br />
Moi je pense que c’est la langue qui change les données.<br />
En hébreu, il n’y a ni conditionnel ni subjonctif qui poussent à la<br />
politesse et à la retenue.<br />
En hébreu, tout est à l’indicatif.<br />
On ne voudrait pas, on veut.<br />
You wouldn’t like to, you want to.<br />
Oui, dit Mme <strong>Le</strong>v qui parle l’hébreu, l’allemand et comprend l’anglais,<br />
je suis d’accord avec toi. On manque de temps.<br />
C’est l’Orient ici, dit M. Masri qui parle l’hébreu, l’arabe, le français<br />
et comprend l’anglais. N’écoute pas Mme <strong>Le</strong>v, elle se croit encore en<br />
Europe. L’Orient fonctionne diff éremment. <strong>Le</strong>s nuances sont ailleurs.<br />
Observe, écoute et ne juge pas trop vite.<br />
Pour ne rien arranger, les autorités ont placé le feu tricolore de l’autre<br />
côté de la rue traversante. Alors évidemment, les automobilistes, qui<br />
sont des loups aff amés tout autour de la planète, veulent s’approcher<br />
le plus près possible de l’ampoule pour l’avaler au moment où elle va<br />
passer au vert.<br />
L’automobile a été inventée pour accélérer le déplacement.<br />
Chaque arrêt forcé insulte le conducteur.<br />
42<br />
J’apprends l’hébreu (extrait)
J’apprends l’hébreu (extrait)<br />
<strong>Le</strong> conducteur n’accepte de s’arrêter au rouge que par crainte du chaos<br />
généralisé.<br />
Mais son pare-chocs grignote le passage piétons.<br />
Je suis debout devant le passage piétons du carrefour Gordon-<br />
Dizeng<strong>of</strong>f et je veux traverser pour rentrer chez moi. <strong>Le</strong> conducteur<br />
de la grosse Mercedes me barre la route. Il y a tout simplement confl it<br />
d’intérêts.<br />
<strong>Le</strong> feu tricolore est une limite.<br />
Je pense que c’est idiot de ne pas le placer là où se trouve en réalité<br />
la limite.<br />
Je dis que ça complique tout de créer un décalage entre la limite et<br />
l’image de la limite.<br />
Peut-être les automobilistes israéliens ne veulent-ils pas sentir qu’ils<br />
s’arrêtent au carrefour pour la bonne et simple raison qu’ils veulent<br />
ignorer la limite. Mais je n’ai pas encore trouvé dans la langue hébraïque<br />
quelle est l’explication de ce dépassement.<br />
Or, il y a une limite à tout.<br />
Je me le répète souvent.<br />
Mme <strong>Le</strong>v, je voudrais vous demander, vous êtes, je voudrais vous demander<br />
quelque chose.<br />
Mais oui mon garçon, demande-moi.<br />
Vous êtes arrivée quand en Israël ? Si vous voulez bien me répondre.<br />
Je suis arrivée en 1945, je ne te l’ai pas déjà dit ?<br />
Vous ne m’avez pas dit quand, non, 1945, oui, ah.<br />
Ce n’était pas encore Israël. <strong>Le</strong>s Anglais étaient encore là.<br />
Vous habitiez déjà ici ?<br />
J’ai habité tout de suite à Tel-Aviv, mais pas ici.<br />
Pas ici, mais alors où ?<br />
Plus au sud, route de Jaffa.<br />
Ah oui, je vois où. Route de Jaffa, derrière la rue Florentine. Et vous<br />
aviez acheté un appartement ?<br />
Olà non, je n’avais rien.<br />
Vous habitiez chez une connaissance, quelqu’un que vous connaissiez ?<br />
43
J’apprends l’hébreu (extrait)<br />
Non, je louais une pièce à un Arabe.<br />
Ah oui, à un Arabe.<br />
Oui. Mon propriétaire était un Arabe de Jaffa. Il venait me voir tous les<br />
mois pour collecter le loyer. Quand je n’avais pas d’argent, il attendait.<br />
Ce n’était pas un mauvais bougre.<br />
Vous êtes restée longtemps dans la pièce de l’Arabe ?<br />
Plusieurs années. Il a disparu en 1948. Du jour au lendemain. Je ne sais<br />
pas s’il est parti, s’il a été chassé ou tué. Plus personne n’est venu collecter<br />
le loyer. Je ne savais pas à qui payer. J’ai rencontré mon mari en<br />
1950 et j’ai déménagé.<br />
Vous avez quitté la pièce de l’Arabe.<br />
Oui.<br />
Mais cette pièce, l’Arabe a disparu, vous avez déménagé, il n’y avait<br />
plus personne ?<br />
Toute la maison lui appartenait. Elle a été récupérée. Il y a eu une loi sur<br />
ce qu’on a appelé les “biens abandonnés”. Ce n’est pas très glorieux,<br />
cette époque, mon petit Frédéric.<br />
Comme en Amérique, quand les colons européens ont volé leurs terres<br />
aux Indiens, c’est ce que je comprends.<br />
Voilà, quelque chose comme ça. Ils n’en sont pas très fi ers non plus.<br />
Même aujourd’hui. <strong>Le</strong>s Américains n’aiment pas parler des Indiens. <strong>Le</strong>s<br />
Canadiens non plus. Si tu veux les énerver, parle-leur des Indiens. Ach,<br />
tu sais, faire naître un pays nouveau, ça n’a rien du conte de fées. Ça<br />
n’est jamais très propre.<br />
(Au soleil couchant, en allemand, sur le banc dans la rue Gordon.)<br />
Tout n’a rien du conte de fées.<br />
Chaque jour de la vie de chaque enfant qui a grandi se charge de le<br />
lui rappeler.<br />
Au cas où il tenterait de l’oublier.
Caroline Lunoir<br />
La Faute de goût<br />
Roman<br />
Fresque miniature d’un 15 août dans une demeure familiale de la<br />
bourgeoisie traditionnelle, où transparaît – d’extérieurs en intérieurs,<br />
de plein jour en contre-jour – le portrait d’une génération<br />
qu’aucun feu ne soutient, qu’aucune révolte ne consume et qui<br />
pose sur le monde un regard lucide et désabusé.<br />
Caroline Lunoir est née en 1981. Elle a grandi à Castres puis à Toulouse. La<br />
Faute de goût est son premier roman, écrit à Boston en 2009. Avocate pénaliste,<br />
elle vit et travaille à Paris.<br />
Août 2011 / 10 x 19 / 128 pages / isbn 978-2-7427-9950-3<br />
relations presse : Aurélie Serfaty-Berc<strong>of</strong>f (01 55 42 14 45)<br />
45
DR<br />
Caroline Lunoir
La Faute de goût<br />
C’ est l’été, le rendez-vous immanquable des vacances, les<br />
vraies, les buissonnières, celles qui donnent un sens à une<br />
année de travail. C’est l’été et le temps de l’éternel dilemme, l’escapade<br />
ou le retour aux sources. Cette année, le choix est fait, la<br />
valise entrouverte sur les tomettes de la maison de famille, et les<br />
souvenirs entassés pêle-mêle, déballés.<br />
C’est l’été et ces quelques jours entre soi scellent le sceau d’un<br />
certifi cat d’origine. Chacun retrouve son rang, ses sujétions, ses<br />
alliances et ses neutralités. Revenir est décidément régressif.<br />
L’enfance est écrite sur les érafl ures des murs, les branches basses<br />
des arbres du jardin, les photographies désuètes et dans les yeux<br />
des aînés. <strong>Le</strong>s repas de retrouvailles sont animés par l’exégèse des<br />
anecdotes communes qui forgent l’historiographie familiale et<br />
atténuent ce que l’on est devenu.<br />
Dans la chaleur du mois d’août, poser sa serviette de bain au<br />
milieu de celles de ses tantes, c’est laisser bruisser le chœur des<br />
ragots et entamer la nouvelle saison de la saga familiale ; partager<br />
l’apéritif avec ses grands-oncles, c’est prendre le pouls du vieux<br />
corps électoral ; regarder ses cousins, c’est comparer les choix que<br />
l’on a faits. Entre deux plongeons dans la piscine, un barbecue et<br />
une promenade digestive, les conversations alanguies s’aventurent<br />
jusqu’à la ligne des non-dits. L’équilibre tient à la bonhomie des<br />
convives qui, d’une plaisanterie ou d’un silence, fuient les éclats<br />
et préservent les prochains étés à passer ensemble.<br />
Mais derrière cette galerie de portraits et les esquisses de scènes de<br />
vie sourdent la dilution du modèle transmis, la lutte feutrée pour le<br />
haut de la pyramide et l’attentisme oisif de la nouvelle génération.<br />
Allongé sur un transat, ou dans les éclaboussures de brasses<br />
coulées énergiques, chacun sait diluer dans l’eau chlorée de la<br />
piscine de la copropriété l’angoisse du retour aux conventions<br />
familiales, la grâce des fous rires partagés, le contrôle social des<br />
proches, avec pour socle, l’impératif de solidarité.<br />
La Faute de goût est le chant du cygne d’un clan qui passe et un<br />
hommage aux bouts de terre qui nous ont façonnés.<br />
C. L.<br />
47
<strong>Le</strong> soleil est timide mais c’est l’heure précieuse où la maison dort<br />
encore. Seule ma grand-mère laisse fumer son thé dans la cuisine et<br />
enchante les couloirs de l’odeur des tartines. L’hiver, quand je me lève<br />
au petit matin, les champs sont enrhumés de brume. Hier, j’ai enterré<br />
ma soirée dans un policier truculent, une poire et une tisane.<br />
Dès mon arrivée, mon grand-père m’en avait vanté les mérites.<br />
S’embusquer dans un fauteuil pour se plonger dans un polar est une<br />
sauvagerie tout à fait acceptée. La piscine m’attend, après elle sera<br />
trop mondaine.<br />
Tiens, le grincement de la porte du potager ne m’a pas érafl é l’oreille.<br />
António a dû huiler les gonds. Je le vois très bien, à la fraîche, un soir<br />
à dix-sept heures, penché sur les montants, dans le halo de sa cigarette,<br />
et la grâce de ses mains écornées. Avant, seuls les enfants poussaient<br />
cette porte et en sautaient le pas. Elle leur promettait une orgie autorisée<br />
de framboises puis de groseilles et de cassis dans un bourdonnement<br />
terrible d’abeilles. Il fallait singer la délicatesse pour serrer<br />
une poignée de baies et non une bouillie sanguine. Belle réhabilitation<br />
pour ces planches élimées que d’être le sésame de la piscine. <strong>Un</strong> eldorado,<br />
en cet été caniculaire. Caniculaire, c’est ce mot rabâché qui<br />
a dû décider mon grand-père. De nos jours, la chaleur tue sournoisement<br />
nos têtes blanches qui ont cru trouver dans le Sud un refuge<br />
clément. La canicule, l’ennui et le besoin d’entreprendre. Voilà trois<br />
raisons pour construire une piscine. Mon grand-père tenait à réfl échir,<br />
mesurer, calculer. Il s’est aff airé tout le printemps. Il s’est lancé dans<br />
l’audition des pisciniers du coin pour choisir le gars qui partagerait<br />
son souci de la technique et comprendrait les contraintes du sol. Il a<br />
envoyé ma grand-mère en mission de renseignement chez leurs<br />
connaissances déjà pourvues. Il a creusé le potager pour y enfouir le<br />
vide de sa retraite, créer et diriger. Il a noyé dans le chlore le sentiment<br />
que personne n’attend plus rien d’autre de lui qu’une gestion soignée<br />
48<br />
La Faute de goût (extrait)
La Faute de goût (extrait)<br />
de son patrimoine, en bon père de famille. Mais parce que j’aime à<br />
croire que l’amusement de ses yeux se fend d’ironie, je vois dans cette<br />
piscine l’un de ces défi s dérisoires qu’il aff ectionne. A la regarder, rien<br />
ne le laisserait penser. Elle coule, bleue, limpide, des jours heureux.<br />
Tranquillement laide avec sa margelle en pierres reconstituées et son<br />
liner bleu turquoise.<br />
Mais peu importe, planter une piscine dans une indivision reste<br />
hardi. Pharaonique. <strong>Un</strong>e mainmise sur les aff aires de la copropriété.<br />
J’imagine ce qui se dit, hors les murs. Paul a une insatiable soif de<br />
contrôle, de puissance. Et ce plaisir à étaler son fric ! Peut-être un<br />
résidu de ses origines modestes. Il a fait un beau mariage, avec<br />
Madeleine. Il vient d’une famille d’horlogers. La générosité de mon<br />
grand-père est pourtant irrésistible. Je ne sais pas comment il a dit<br />
aux sœurs de sa femme qu’il leur <strong>of</strong>f rait la piscine. <strong>Un</strong> mystère plane<br />
sur la répartition des frais d’entretien. C’est une pudeur inhabituelle.<br />
Et moi, à peine arrivée ici, penchée sur l’eau claire, je ne puis m’empêcher<br />
d’y réfl échir. Je suis déjà acteur des confl its de cet été.<br />
La chaleur a emporté les réticences. <strong>Le</strong> sérieux de la charge de grandsparents<br />
aussi. Et la peur que cette année peut-être, les parents et les<br />
enfants passeraient leurs vacances ailleurs. Ils ont pensé aux cris de<br />
joie des enfants, aux premiers bains des plus petits, à l’approbation<br />
lascive des adolescentes sur les pierres chaudes, au crawl énergique des<br />
parents. <strong>Le</strong>s puces de canard ont fait le reste. Avant, nous partions en<br />
tribu nous égayer sur les plages privées de la rivière. Nous sautions du<br />
ponton dans la vase, débusquions les écrevisses cachées sous les cailloux.<br />
Grandir signifi ait parvenir à traverser sans bouée jusqu’à l’autre rive.<br />
Depuis deux ans, nous avions déserté ces berges, découragés par les<br />
démangeaisons dues à ces parasites. Mon grand-père a gagné.<br />
<strong>Le</strong> grand parasol crème <strong>of</strong>f re une ombre distinguée. <strong>Un</strong> crocodile<br />
lubrique est tapi dans l’eau. <strong>Le</strong>s transats admirent la vue de la vallée,<br />
splendide. Je jette mon tee-shirt, dénoue ma serviette et plonge dans<br />
l’eau bleue. Désormais, sur les cartes postales vendues au village, la<br />
vue aérienne du château sera sertie d’un saphir, gage incontestable<br />
du bonheur opulent de la famille.
Marc Trillard<br />
<strong>Le</strong>s Mamiwatas<br />
Roman<br />
Alors qu’un climat d’insurrection s’étend sur le Cameroun, le<br />
directeur de l’Alliance française de Buea, cloîtré chez lui, face à<br />
la mer et ses créatures délétères (les mamiwatas), boit la coupe<br />
de deux ans de désenchantements : sa scabreuse addiction de<br />
quinquagénaire aux charmes d’une trop jolie menteuse locale ;<br />
l’illusion d’échapper au passif des amours / haines coloniales ; et<br />
l’agonie (programmée en haut lieu) de l’Alliance française qu’il dirige<br />
– fruit pourrissant de siècles de présence française en Afrique.<br />
Marc Trillard est né en 1955. Il est l’auteur d’une douzaine de romans ou<br />
récits de voyages, dont Eldorado 51 (Phébus, 1994 ; prix Interallié 1994),<br />
Coup de lame (Phébus, 1998 ; prix Louis-Guilloux) et <strong>Le</strong> Maître et la Mort<br />
(Gallimard, 2003).<br />
Août 2011 / 14,5 x 24 / 256 pages / isbn 978-2-7427-9918-3<br />
Relations presse : Régine <strong>Le</strong> Meur (05 62 66 94 63)<br />
51
© Louise Trillard<br />
Marc Trillard
<strong>Le</strong>s Mamiwatas<br />
C onfiné dans sa villa par les émeutes de la faim qui secouent<br />
le pays, ce “Cameroun déréglé”où il travaille pour la coopération<br />
française, le personnage principal de cette histoire fait le<br />
bilan des dix-huit mois qu’il vient d’y passer. Bien que largement<br />
quinquagénaire, il lui faut reconnaître qu’il vient, durant cette<br />
année et demie, d’en apprendre sur l’homme plus qu’il ne l’a fait<br />
durant toute sa vie, ceci au prix de pas mal de coups et blessures<br />
infl igés à son ego, sinon à son âme.<br />
<strong>Le</strong>s Mamiwatas peut être lu comme un roman d’apprentissage,<br />
celui de l’Occidental confronté à l’autre, à son système de pensée, à<br />
ses priorités imprescriptibles, et voyant, à ce contact, ses propres<br />
certitudes voler en éclats. Ou, plus que de certitudes, lorsqu’on<br />
s’attache aux pas de mister Mike dans la rouerie de la ville ou la<br />
brutalité de la brousse, devrait-on parler de naïveté. Cette candeur<br />
telle qu’il la retrouve chez la plupart de ses compatriotes – et jusque<br />
chez l’ambassadeur –, et qui est source de tous les malentendus entre<br />
les deux sociétés. Car il y a loin entre ce que l’on sait ou croit savoir<br />
d’un pays et de ses mœurs et la réalité du quotidien, comme il y a<br />
infi niment loin entre une décision dans un bureau présidentiel à<br />
Paris (ici, la dévaluation du franc CFA) et ses répercussions en Afrique.<br />
J’ai voulu dans ce livre parler de la violence en temps de paix sur le<br />
continent africain, celle qui, au Cameroun comme ailleurs, régit les<br />
rapports humains de tous les jours. Celle que mister Mike expérimente<br />
dans ses relations avec les femmes (personne ne lui a demandé d’y<br />
aller, comme dirait son conseiller culturel), avec les membres du comité<br />
de gestion de son Alliance, avec les envoyés du monarque local.<br />
Celle qui sous-tend le pouvoir des autorités, qu’elles soient<br />
traditionnelles, civiles ou militaires. Celle que l’on retrouve jusque<br />
dans l’emprise et l’expression de la superstition, chez les âmes<br />
frustes comme les “esprits constitués”.<br />
M. T.<br />
53
Il y avait eu aussi les expéditions purement ludiques, toute “pédagogie”<br />
abandonnée à une autre fois. Seules l’insouciance et la gaieté (y<br />
avait-il jamais eu de l’insouciance et de la gaieté, avec Gloria ?). La<br />
pirogue qu’il avait louée ce dimanche matin éclatant de lumière. Ça<br />
ne pourrait que lui plaire, la visite d’une île. C’était nouveau, non ?<br />
Avait-elle jamais posé le pied sur une île ? Elle raconterait ça à ses<br />
copines avec ses mots à elle et ses poses quand elle ne trouverait pas<br />
les mots. Mondoni Island, qu’il passerait des heures à méditer depuis<br />
la terrasse de la villa. Ils avaient foulé les galets noirs de la grève et<br />
jeté des regards empreints de circonspection vers le centre de l’île<br />
inhabitée, la sombre forêt qui la recouvrait entièrement et sur laquelle<br />
tournoyaient loin au-dessus de criards oiseaux marins. Mais avant ça,<br />
avant d’accoster l’île en naufragés pour de rire, il avait voulu lui<br />
montrer ce qu’il valait encore à cinquante ans. La question de son<br />
âge ne s’était jamais présentée, n’avait jamais été évoquée en aucune<br />
occasion, ni de près, ni de loin, mais il imaginait qu’il était bien ce<br />
qu’il était. Ce quinquagénaire. Ce quinquagénaire encore solidement<br />
charpenté mais ce quinquagénaire quand même. Alors il avait montré<br />
qu’il n’y avait pas seulement la charpente mais aussi l’audace et<br />
l’énergie. L’homme en lui-même, intemporellement. A mi-chemin<br />
de la côte et du rivage de l’île, il avait plongé sans crier gare dans les<br />
eaux de la baie. On se retrouve là-bas ! avait-il lancé à Gloria, enjoignant<br />
avec force gestes au pilote de poursuivre sa route. Il s’était vite<br />
rendu compte qu’il ne serait pas au rendez-vous. Qu’il n’avait pas les<br />
bras pour le faire. Qu’il ne les avait plus. La distance qui le séparait<br />
de l’île lui paraissait à présent bien plus importante qu’il ne l’avait<br />
cru depuis le banc de la pirogue. Et il y avait cet insoupçonnable<br />
courant par le travers contre lequel ses frénétiques battements de<br />
jambes restaient vains. Il s’épuisait trop vite. Il buvait trop des courtes<br />
vagues que l’aimable houle venait briser sur son nez. Il se noyait, par<br />
54<br />
<strong>Le</strong>s Mamiwatas (extrait)
<strong>Le</strong>s Mamiwatas (extrait)<br />
ce beau dimanche sans nuage. Là-bas, debout dans la pirogue, Gloria<br />
s’était aperçue de la détresse de son nageur. Ils étaient revenus le<br />
chercher et il avait dû accepter l’aide de leurs bras pour le hisser à<br />
bord. <strong>Le</strong> courant, avait-il souffl é. <strong>Le</strong> courant, oui, avait confi rmé le<br />
pilote. C’était bien trop loin, de toute façon, avait ajouté Gloria. Il<br />
avait essayé de lire dans son regard. Tout allait bien. Il n’avait pas<br />
ruiné son image et elle ne lui en voulait pas de l’avoir ridiculisée<br />
devant le pilote, son Blanc buvant la tasse, son Blanc à l’agonie dans<br />
la vague. Il s’était recomposé une fi gure, plus vite qu’il ne l’espérait.<br />
Sur l’île, il avait retrouvé tous ses moyens, sa décision. “Nous allons<br />
rentrer par un autre chemin. Au lieu de tout droit, un petit détour<br />
par ce croissant de côte.” Ils avaient longé un rivage de rochers aux<br />
arêtes meurtrières entre lesquels il lui avait montré, comme s’il en<br />
était l’observateur coutumier, les carcasses déchiquetées de thoniers<br />
naufragés là depuis des années et des décennies. Plus tard, il avait<br />
plaisanté le pilote sur la croyance locale, les redoutées mamiwatas.<br />
Ce n’était pas au pilote qu’il s’adressait, mais à Gloria, lui faisant<br />
savoir par la bande sa familiarité des superstitions natives ainsi que<br />
le condescendant dédain qu’elles lui inspiraient. Alors ils sont où, ces<br />
esprits tracassiers ? Ici, avait répondu leur navigateur. Ici où ça, je ne<br />
vois rien. Là même, en dessous. Ah ah, mais vous les avez déjà vus<br />
alors ? ! Oh, monsieur, plusieurs fois. Et à quoi ressemblent-ils ?<br />
Monsieur, ce n’est pas le moment, pas ici. Ça ne l’était pas, non. Ce<br />
n’était pas le bon sujet. La conversation déplaisait à Gloria. Son visage<br />
s’était fermé, s’était éloigné, si un visage pouvait s’éloigner. La superstition.<br />
La superstition touchait tous les esprits et en priorité les esprits<br />
que la connaissance n’avait pas préparés à rejeter l’irrationnel. Celui<br />
de leur pêcheur à sa barre. Celui de Gloria, sœur du pêcheur dans<br />
son inculture.<br />
C’était durant la demi-heure du trajet de retour que l’événement<br />
s’était produit. Evénement invisible aux yeux de Gloria, et plus encore<br />
à ceux du pilote. Il la contemplait assise devant lui, immobile et silencieuse,<br />
le regard capturé par le mouvement des vagues, lorsque<br />
l’idée, non, l’envie, le pr<strong>of</strong>ond désir, la résolution, l’avait traversé.<br />
L’avait saisi, l’avait happé. Il pourrait rester avec elle. Il pourrait rester<br />
avec elle plus longtemps que les quelques jours ou semaines qu’il avait<br />
pensé que durerait leur liaison. Construire avec elle quelque chose<br />
55
<strong>Le</strong>s Mamiwatas (extrait)<br />
de plus solide et de plus légitime, comme il avait modestement commencé<br />
à le faire. Emmener la relation de leur couple fortuit vers une<br />
union au plein sens du terme, sanctionnée ou non, mais vraie, et<br />
constante. Il la sortirait de ce qu’elle était, la tirerait progressivement<br />
des pr<strong>of</strong>ondeurs de son inculture, l’éloignerait de la toxique société<br />
de ses copines de fi esta. Consacrerait de son temps, consacrerait de<br />
sa personne, pour en faire la personne qu’elle aurait pu être si elle<br />
n’était pas née dans ce village frontalier de l’ignorance absolue ; si elle<br />
n’avait pas, ensuite, périclité sous la loi du Nord musulman paternel ;<br />
si elle n’était pas en train de se débattre dans un programme scolaire<br />
où l’incurie des pr<strong>of</strong>esseurs décourageait les plus volontaires de leurs<br />
élèves. Il était en mesure de l’aider. Il pouvait faire œuvre utile et il<br />
en avait le désir. Et ce n’était plus une idée mais une décision.
Lyonel Trouillot<br />
La Belle Amour humaine<br />
Roman<br />
Dans un petit village côtier d’une île des Caraïbes, une jeune<br />
Occidentale est venue, sur les traces de son père, éclaircir<br />
l’énigme aux allures de règlement de comptes qui fonde son<br />
roman familial. Au fi l de récits qu’elle recueille et qui, chacun<br />
à leur manière, posent une question essentielle – “Quel usage<br />
faut-il faire de sa présence au monde ?” –, se déploie, de la<br />
confrontation au partage, une cartographie de la fraternité nécessaire<br />
des vivants face aux appétits féroces de ceux qui tiennent<br />
pour acquis que le monde leur appartient.<br />
Romancier et poète, intellectuel engagé, acteur passionné de la scène francophone<br />
mondiale, Lyonel Trouillot est né en 1956 dans la capitale haïtienne,<br />
Port-au-Prince, où il vit toujours aujourd’hui. Son œuvre est publiée chez Actes<br />
Sud : Rue des Pas-Perdus (1998 ; Babel n° 517), Th érèse en mille morceaux<br />
(2000), <strong>Le</strong>s Enfants des héros (2002 ; Babel n° 824), Bicentenaire (2004 ;<br />
Babel n° 731), L’Amour avant que j’oublie (2007 ; Babel n° 969) et Yanvalou<br />
pour Charlie (2009 ; prix Wepler 2009).<br />
• A noter : la parution simultanée de Yanvalou pour Charlie dans la collection<br />
de poche Babel (Babel n° 1069).<br />
Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 176 pages / isbn 978-2-7427-9920-6<br />
relations presse : Aurélie Serfaty-Berc<strong>of</strong>f (01 55 42 14 45)<br />
57
© Marc Melki<br />
Lyonel Trouillot
La Belle Amour humaine<br />
J’ emprunte l’expression “la belle amour humaine” au romancier<br />
haïtien Jacques Stephen Alexis, théoricien du “réalisme merveilleux”.<br />
L’idée étant de dire à la fois le factuel et le perçu, le réel<br />
qu’on se fait débordant toujours la réalité, en pour ou en contre.<br />
Dans le hasard des destinées qui nous font naître ici ou ailleurs,<br />
dans l’inégale distribution sociogéographique de la richesse et de<br />
la pauvreté, avec quel autre construire son vivre ensemble ? Avec<br />
qui, quoi, et comment habiter la sublime et dérisoire promesse<br />
d’une “belle amour humaine” qui lierait les habitants d’un village<br />
haïtien ? Entre une jeune Occidentale partie à la recherche du père<br />
qu’elle n’a pas connu et qui est peut-être lui-même coupable d’un<br />
parricide, un homme qui fait métier de guide pour touristes et un<br />
peintre ayant renoncé au portrait pour privilégier le paysage, se<br />
tisse une histoire placée sous le signe de cette seule question : “Quel<br />
usage faut-il faire de sa présence au monde ?”<br />
J’ai voulu succomber à la tentation de croire que le langage de<br />
l’Autre (tous les langages : la peinture, le mot, le chant, la danse…)<br />
détient le pouvoir de nous révéler à nous-mêmes, qu’il existait en<br />
toute personne humaine qui ne se serait pas encore convertie en<br />
monstre une dimension de “bienfaisance” susceptible de rendre<br />
cette personne, d’où qu’elle vienne, indispensable.<br />
A l’opposé de ceux qui passent leur vie à voler aux autres leur<br />
part de fête, il y a celles et ceux qui invitent chacun à amener sa<br />
part de chant. C’est à leur geste et à leur rêve (pour fou qu’il puisse<br />
être) que j’ai voulu rendre hommage.<br />
L. T.<br />
59
L’autre chose qu’il faut que tu saches : il y a sept heures de route<br />
entre le bruit et le silence. Entre ici et Anse-à-Fôleur. J’imagine que<br />
chez toi aussi les villes se suivent et ne se ressemblent pas. Il est des<br />
villes qui aboient et d’autres qui chuchotent. Il est des villes qui<br />
sourient et d’autres qui font la gueule. Des qui se peinturlurent comme<br />
une fi lle condamnée à faire le trottoir se déguise chaque soir pour<br />
partir au combat. Et d’autres qui ne montrent rien, ne vendent rien,<br />
ne font pas dans le show <strong>of</strong>f ni dans la devanture, mais sourient sans<br />
forcer quand passe un visiteur. Ma ville sur mer, elle est comme ça.<br />
Ma vraie ville, c’est ici. J’y suis né et je connais ses bruits par cœur.<br />
Ses recoins. Ses désastres. Mais là-bas, c’est ma ville aussi. Enfi n, mon<br />
village. J’y ai planté mes rêves. Et la terre qui t’appartient, c’est celle<br />
où tu plantes tes rêves. Celle que tu aimerais léguer à tes enfants.<br />
Lorsque nous arriverons là-bas tu pourras faire la diff érence. Ici, il y<br />
a ici et là-bas. Ici, c’est ville ouverte, scandale à pr<strong>of</strong>usion. Chaque<br />
jour il arrive par la route assez de familles nombreuses pour peupler<br />
une autre ville. Là-bas, dans le lieudit d’Anse-à-Fôleur où tu souhaites<br />
que je te conduise, c’est peu de monde, quelques copains, une poignée<br />
de vivants qui s’appellent par leurs prénoms et ne cultivent pas le<br />
vacarme. <strong>Le</strong>s enfants y ramassent encore des coquillages, les portent<br />
à leurs oreilles, et la mer leur y chante quelque chanson secrète, sans<br />
déranger les autres. <strong>Le</strong>s adultes n’élèvent pas la voix pour un oui pour<br />
un non. Ils se fâchent rarement, et quand ça leur arrive, les enfants<br />
sourient dans leur dos, sachant que c’est un jeu de rôle, un faux orage,<br />
qui passera vite. Même les bêtes ne crient que chacune à son tour,<br />
quand besoin est, d’herbe ou de soin. Là-bas, les gens, ils braient pas<br />
comme ici. Quand ils optent pour le silence, même le rire leur passe<br />
par les yeux. Et lorsqu’ils parlent, y a encore du silence caché derrière<br />
leurs mots. Quand tu arriveras avec tes questions, ils te feront en guise<br />
de réponse des phrases enroulées comme des vagues dont le sens<br />
60<br />
La Belle Amour humaine (extrait)
La Belle Amour humaine (extrait)<br />
t’échappera si tu fais ta paresseuse ou ta fi lle de la raison pure et les<br />
interprètes à la lettre. S’ils te sortent des lapalissades comme quoi les<br />
dés ont six faces et la nuit est parfois plus longue que le jour, ne va<br />
pas croire qu’ils sont débiles et te parlent pour ne rien dire, c’est un<br />
conseil d’ami qui t’invite à voir en toute chose l’avers et le revers. S’ils<br />
te demandent à quoi cela sert de découvrir l’astuce par laquelle le lait<br />
qui n’a pas de jambes s’arrange pour grimper jusqu’au cœur de la noix<br />
de coco, c’est qu’ils souhaitent que tu comprennes que peu de choses<br />
méritent qu’on en saisisse les origines, les pourquoi et les conséquences.<br />
Qu’il est des faits sans importance qui ne valent pas le bavardage, et<br />
d’autres dont les causes sont d’une telle pr<strong>of</strong>ondeur qu’elles échappent<br />
à toute analyse, et qu’il convient pour être heureux de les laisser à<br />
leur mystère. “Laissez les choses à leur mystère.” Voilà ce qu’ils te<br />
répondront. C’est ce que mon oncle a dit à l’enquêteur venu de la<br />
capitale “s’informer des origines de l’incendie ayant détruit les maisons<br />
sœurs de l’homme d’aff aires Robert Montès et du colonel à la retraite<br />
Pierre André Pierre et causé la mort des deux illustres citoyens à une<br />
heure indéterminée entre le soir et l’aube dans le lieudit d’Anse-à-<br />
Fôleur”. Mon oncle, lui-même, comme les gens du village, appartient<br />
au mystère. Pourtant il n’est pas né là-bas. Pendant longtemps, il a<br />
vécu ici, enfermé dans son atelier, en plein cœur du vacarme, et gagné<br />
son pain à peindre des visages sur commande, se construisant au fi l<br />
des ans une belle réputation de portraitiste. Ministres, dames du<br />
monde, notables, militaires, vieux mariés, jeunes mariés… il a mis<br />
sur ses toiles tous les visages solvables, indépendamment de la pr<strong>of</strong>ession,<br />
de l’âge, du sexe, de la couleur. <strong>Le</strong> visage humain est, dit-il,<br />
la plus petite unité de la beauté et de la laideur des espèces vivantes,<br />
le plus petit territoire sur lequel s’aff rontent la bonté et la cruauté, la<br />
bêtise et l’intelligence. Lorsque les médecins lui ont annoncé que nul<br />
traitement ne pouvait le guérir de la cécité annoncée, il a gardé le<br />
secret sur sa maladie et décidé de se retirer dans une petite ville, de<br />
préférence au bord de la mer. Etrangement, du temps où il voyait, la<br />
mer ne l’attirait pas. Mais depuis qu’il habite l’ombre, sa maison sur<br />
la côte, c’est un peu comme sa barque. Il prétend qu’il suffi t de<br />
quelques pas, de quelques brasses, d’un geste, pour lier sa vie à celle<br />
de l’eau. Que, surtout quand on n’y est pas né, on a l’impression<br />
qu’un village côtier, c’est une porte, que ce qu’il y a derrière, les terres<br />
61
La Belle Amour humaine (extrait)<br />
intérieures, est moins grand, moins présent que ce qu’il y a devant :<br />
toute la largeur de l’océan. Chaque matin il se lève de son lit avec<br />
l’aide de Solène, elle lui ouvre la fenêtre et il s’installe dans son fauteuil<br />
pour regarder la mer. C’est là, devant sa fenêtre, aveugle et voyant,<br />
qu’il a reçu il y a vingt ans l’enquêteur venu de la capitale qui le<br />
dévisageait sans comprendre. “Laissez les choses à leur mystère.<br />
Maintenant que je ne vois plus, je ne trouve pas meilleur usage de<br />
ma présence au monde que de regarder par la fenêtre. Oui, deux<br />
hommes sont morts, deux maisons ont brûlé. Mais est-ce là le plus<br />
important ! <strong>Un</strong> jour, vous aussi vous mourrez. Quand viendra l’heure,<br />
posez-vous la question qui compte : «Ai-je fait un bel usage de ma<br />
présence au monde ?» Si la réponse est non, ce sera trop tard, pour<br />
vous plaindre comme pour changer. Alors, n’attendez pas. <strong>Le</strong>s circonstances<br />
de la mort n’<strong>of</strong>f rent pas de clé pour comprendre. La mort<br />
demeure pour le vivant la plus banale des occurrences, la seule qui<br />
soit inévitable. La mort ne nous appartient pas, puisqu’elle nous<br />
précède. Mais la vie…”
Actes Sud - Service de la communication<br />
18, rue Séguier - 75006 Paris<br />
tél. : 01 55 42 63 00 / communication@actes-sud.fr<br />
Directrice de la communication<br />
Estelle <strong>Le</strong>maître<br />
tél. : 01 55 42 63 00 / e.lemaitre@actes-sud.fr<br />
Attachées de presse<br />
Nathalie Giquel<br />
tél. : 01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr<br />
Nelly Mladenov<br />
tél. : 01 55 42 63 06 / n.mladenov@actes-sud.fr<br />
Aurélie Serfaty-Berc<strong>of</strong>f<br />
tél. : 01 55 42 14 45 / a.berc<strong>of</strong>f @actes-sud.fr<br />
Nathalie Baravian<br />
tél. : 01 55 42 63 08 / n.baravian@actes-sud.fr<br />
Régine <strong>Le</strong> Meur<br />
tél. : 05 62 66 94 63 / r.lemeur@actes-sud.fr<br />
Droits étrangers<br />
Claire Teeuwissen<br />
tél. : 04 88 65 90 09 / c.teeuwissen@actes-sud.fr<br />
Rencontres en librairie<br />
Nicolas Vasseur<br />
tél. : 06 66 57 97 37 / n.vasseur@actes-sud.fr<br />
Siège social<br />
<strong>Le</strong> Méjan, BP 900 38 - 13633 Arles cedex<br />
www.actes-sud.fr
Achevé d’imprimer en mai 2011<br />
par l’imprimerie Collet à Mayenne<br />
pour le compte des éditions Actes Sud, <strong>Le</strong> Méjan, place Nina-Berberova, 13200 Arles<br />
Imprimé en France