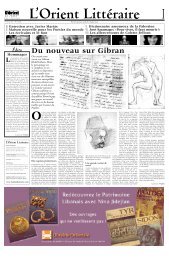La littérature ibéro-américaine entre le « boom ... - L'Orient-Le Jour
La littérature ibéro-américaine entre le « boom ... - L'Orient-Le Jour
La littérature ibéro-américaine entre le « boom ... - L'Orient-Le Jour
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VI Essais<br />
Attila,<br />
mythe<br />
et<br />
réalité<br />
attIla, la vIO<strong>le</strong>nce nOmade de Michel Rouche,<br />
Fayard, 2009, 510 p.<br />
Nous ne <strong>le</strong> connaissons<br />
que par des écrivains<br />
romains, observateurs<br />
impuissants de l’effondrement<br />
de l’empire<br />
d’Occident ; présenté sous la forme<br />
d’un être bestial et cornu à l’instar<br />
d’un bouc, <strong>«</strong> Attila est <strong>le</strong> type même<br />
du repoussoir manichéen ». Mais cette<br />
vision des vaincus n’est-el<strong>le</strong> pas une ultime<br />
vengeance destinée à occulter <strong>le</strong><br />
visage de l’un des plus grands conquérants<br />
du monde ? Michel Rouche mène<br />
l’enquête et nous conduit, au-delà du<br />
mythe, à la réalité.<br />
Roi des Huns vers 434, Attila ne régna<br />
seul qu’à partir de 445 après s’être débarrassé<br />
par un meurtre de son frère<br />
Bléda avec qui il partageait <strong>le</strong> pouvoir.<br />
Il rassembla sous son autorité toutes<br />
<strong>le</strong>s tribus des Huns en 446 avec l’aide<br />
du roi des Ostrogoths. Il allait pouvoir<br />
assouvir ses ambitions de conquêtes…<br />
Après avoir envahi à deux reprises<br />
(441/443, 447/449) l’empire d’Orient<br />
auquel il imposa, à chaque paix, des<br />
tributs considérab<strong>le</strong>s, il se lança à la<br />
conquête de l’empire d’Occident. Ses<br />
dernières expéditions qui lui valurent<br />
<strong>le</strong> surnom de <strong>«</strong> fléau de Dieu » sont <strong>le</strong>s<br />
plus connues, mais aussi <strong>le</strong>s plus diffici<strong>le</strong>s<br />
à expliquer. Ses conquêtes s’opèrent<br />
alors en effet dans un <strong>«</strong> climat de faci<strong>le</strong><br />
réussite ». Rouche nous éclaire sur ce<br />
point. De fait, la situation de l’empire<br />
avant l’arrivée des Huns est cel<strong>le</strong> d’un<br />
<strong>«</strong> organisme en p<strong>le</strong>ine mutation » par<br />
suite des réformes non terminées des<br />
empereurs illyriens qui ont sacralisé <strong>le</strong><br />
pouvoir.<br />
Historien consacré de cette période,<br />
Rouche analyse <strong>le</strong>s causes de la supériorité<br />
des Huns dans <strong>le</strong> domaine de<br />
l’armement. Supériorité d’autant plus<br />
avantageuse que Rome rencontre des<br />
difficultés pour mobiliser, au sens stric-<br />
archIves secrètes du cInéma françaIs de<br />
1945 à 1975 de <strong>La</strong>urent Garreau, PUF, 2009, 352 p.<br />
En 1945, suite à la Seconde Guerre<br />
mondia<strong>le</strong>, <strong>le</strong> gouvernement<br />
français décide d’instaurer une<br />
commission de contrô<strong>le</strong> des films régie<br />
par <strong>le</strong> ministère de l’Information afin<br />
de garder l’œil sur un art relativement<br />
nouveau et potentiel<strong>le</strong>ment dangereux.<br />
À l’heure où <strong>le</strong>s autres arts sont affranchis<br />
de toute tutel<strong>le</strong>, la France ressent<br />
combien <strong>le</strong> cinéma peut atteindre <strong>le</strong>s<br />
fou<strong>le</strong>s. <strong>Le</strong>s interventions de la commission<br />
de contrô<strong>le</strong> serviront donc à protéger<br />
<strong>le</strong>s mœurs françaises et à renvoyer<br />
une bonne image du pays à l’étranger.<br />
<strong>Le</strong> livre de <strong>La</strong>urent Garreau, riche en<br />
décrets juridiques, lois et exemp<strong>le</strong>s de<br />
films censurés, tente d’expliquer comment<br />
s’est instauré juridiquement<br />
<strong>le</strong> dispositif de la censure,<br />
quels en étaient <strong>le</strong>s thèmes<br />
et sujets délicats et de quel<strong>le</strong>s<br />
manières la censure intervenait.<br />
Il retrace <strong>le</strong>s tournants<br />
majeurs de son évolution, un<br />
parcours qui ne s’arrête pas<br />
en 1975, comme <strong>le</strong> laisse supposer<br />
<strong>le</strong> titre, mais continue<br />
jusqu’à nos jours, <strong>le</strong>s derniers<br />
changements datant de 2007.<br />
S’interroger sur la censure qui régit <strong>le</strong><br />
cinéma français revient à interroger <strong>le</strong><br />
cinéma lui-même en tant que porteur<br />
d’idéologie. On a souvent dit que <strong>le</strong><br />
cinéma est <strong>le</strong> fruit de son époque. On<br />
réalise grâce à ce livre que <strong>le</strong>s interdits,<br />
<strong>le</strong>s coupures, <strong>le</strong>s non-dits sont encore<br />
plus révélateurs que ce qu’on dévoi<strong>le</strong>.<br />
Ils montrent surtout que la France fut<br />
généra<strong>le</strong>ment tolérante lorsqu’il s’agissait<br />
de vio<strong>le</strong>nce ou de liberté de mœurs.<br />
Des films aux titres aguichants comme<br />
Mam’zel<strong>le</strong> Nitouche, <strong>Le</strong>s hommes<br />
ne pensent qu’à ça, Papa, maman, la<br />
bonne et moi et Paris coquin… n’in-<br />
D.R.<br />
Génie méconnu, brigand bien-aimé, fléau de Dieu, stratège impitoyab<strong>le</strong>,<br />
barbare purificateur, monstre diabolique, tombeur de rome, destructeur<br />
ou père fondateur, terrib<strong>le</strong> ou généreux, qui fut donc Attila ?<br />
tement militaire du terme, toutes ses<br />
forces simultanément sur trois fronts<br />
différents, ceux du Rhin, du Danube<br />
et de l’Euphrate. Rouche souligne <strong>le</strong><br />
manque d’unité de l’empire d’Occident<br />
et insiste sur l’opposition de deux<br />
formes d’organisation : cel<strong>le</strong> d’hommes<br />
groupés en tribus guerrières et cel<strong>le</strong> de<br />
citoyens déléguant <strong>le</strong>ur défense à des<br />
armées permanentes et à un État tenu<br />
par des fonctionnaires. Il en ressort une<br />
<strong>«</strong> société à la vio<strong>le</strong>nce disciplinée, instab<strong>le</strong><br />
dès qu’el<strong>le</strong> perd son maître ». En<br />
revanche, la vio<strong>le</strong>nce barbare d’Attila<br />
fit sa force comme el<strong>le</strong> fit ensuite cel<strong>le</strong><br />
de ses successeurs, Avars et Magyars.<br />
Deux ans après la défaite des champs<br />
catalauniques, Attila mourut en 453,<br />
à la suite d’une nuit d’ivresse, d’une<br />
bana<strong>le</strong> épistaxis (saignement de nez).<br />
Bruta<strong>le</strong>, sa mort demeura mystérieuse :<br />
<strong>«</strong> Jusqu’au bout, Attila fut un homme<br />
craint et controversé… entouré de farouches<br />
fidélités et de haines hagardes.<br />
» En huit ans de règne personnel,<br />
<strong>«</strong> il est parvenu à faire venir à ses pieds<br />
simultanément <strong>le</strong>s ambassadeurs des<br />
deux empires romains d’Occident et<br />
d’Orient ».<br />
Si son empire ne lui a pas survécu en<br />
raison de la peste et des conflits <strong>entre</strong><br />
ses fils, sa légende, el<strong>le</strong>… <strong>«</strong> Triomphateur<br />
dans la mort, <strong>le</strong> sang et l’or », Attila<br />
continue à jouer un rô<strong>le</strong> historique<br />
grâce au mythe qu’il a inspiré. Il existe<br />
bien des re<strong>le</strong>ctures de ce mythe parmi<br />
<strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s cel<strong>le</strong> des Lumières, mais aussi<br />
cel<strong>le</strong> de Wagner qui rassemb<strong>le</strong> toutes<br />
<strong>le</strong>s légendes en un néopaganisme séduisant<br />
de beauté et de grandeur sauvage<br />
; au point de susciter un discip<strong>le</strong>,<br />
Adolf Hit<strong>le</strong>r, qui a littéra<strong>le</strong>ment vécu et<br />
interprété Attila mythique. <strong>«</strong> Trempezvous<br />
toujours dans <strong>le</strong> sang des impurs !<br />
Vous vous purifiez et vous garantissez<br />
<strong>le</strong> rétablissement de l’équilibre racial<br />
indispensab<strong>le</strong> à celui du monde… »<br />
s’écriait Himm<strong>le</strong>r en bon discip<strong>le</strong> du<br />
Führer. Ainsi s’explique, par ce biais de<br />
l’histoire des mentalités, la plus grande<br />
quiétèrent pas vraiment la censure et<br />
décrochèrent faci<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s visas d’exploitation<br />
et d’exportation. En revanche,<br />
la France fut beaucoup plus chatouil<strong>le</strong>use<br />
vis-à-vis de ses fail<strong>le</strong>s socia<strong>le</strong>s<br />
et de ce qui pouvait nuire à sa politique<br />
étrangère. Aussi, évoquer <strong>le</strong>s fêlures internes<br />
du système comme la corruption<br />
de la police, des juges, <strong>le</strong>s trafics de drogue,<br />
la prostitution… est vu d’un très<br />
mauvais œil. Toutefois, la censure rend<br />
bizarrement hommage au cinéma. Sa<br />
présence rappel<strong>le</strong> la puissance de cet art<br />
et sa comp<strong>le</strong>xité, un art qui déborde son<br />
cadre portant un message politique et<br />
dénonçant <strong>le</strong>s fléaux de la société. En<br />
même temps, il ne cesse jamais d’être<br />
<strong>le</strong> produit d’une industrie qui cherche<br />
à maximiser son profit en offrant du<br />
<strong>«</strong> rêve » et de la <strong>«</strong> réalité » aux spectateurs.<br />
L’exemp<strong>le</strong> de <strong>La</strong> Religieuse de<br />
Jacques Rivette montre comment<br />
un film peut se transformer<br />
en phénomène de<br />
société. Produit en 1962, il<br />
sou<strong>le</strong>va un tel tollé de la part<br />
des institutions catholiques<br />
que Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> en<br />
personne dut l’interdire pour<br />
calmer l’animosité publique.<br />
Ce n’est qu’en 1967 que <strong>le</strong><br />
film obtint son visa d’exploitation<br />
grâce aux efforts infatigab<strong>le</strong>s de<br />
son producteur, aux pétitions et surtout<br />
à Georges Gorse, président de la commission<br />
qui se chargea patiemment de<br />
faire changer d’avis <strong>le</strong> général.<br />
L’ouvrage va au-delà de l’analyse objective<br />
des faits et contourne <strong>le</strong> sensationnalisme<br />
attaché habituel<strong>le</strong>ment au mot<br />
<strong>«</strong> censure ». Alors qu’on semblait promis<br />
à une série de révélations dénonçant <strong>le</strong>s<br />
actes de barbarie commis au nom d’une<br />
mora<strong>le</strong> absurde sur <strong>le</strong> monde hautement<br />
spirituel de l’art, d’agréab<strong>le</strong>s surprises<br />
nous sont réservées. <strong>La</strong> première étant<br />
que <strong>le</strong> livre tord <strong>le</strong> cou aux préjugés et<br />
nous présente une censure démystifiée,<br />
catastrophe de l’histoire européenne.<br />
S’appuyant sur <strong>le</strong>s résultats des dernières<br />
fouil<strong>le</strong>s archéologiques devenues de<br />
plus en plus scientifiques, et ce depuis<br />
<strong>le</strong>s frontières de la Chine jusqu’à la péninsu<strong>le</strong><br />
européenne, Rouche distingue<br />
<strong>le</strong>s forces et <strong>le</strong>s faib<strong>le</strong>sses du <strong>«</strong> civilisé »<br />
par rapport au <strong>«</strong> barbare » ; et nous<br />
révè<strong>le</strong> l’étrange caractère des Huns en<br />
particulier et des nomades en général.<br />
Ce faisant, il s’intéresse au mystère des<br />
Amazones, tribu parmi d’autres, et <strong>entre</strong>prend<br />
de faire la part des choses <strong>entre</strong><br />
la légende fantasmée et <strong>le</strong>s faits historiques<br />
établis. Il se demande d’ail<strong>le</strong>urs si,<br />
au sein même de la tribu des Huns, derrière<br />
la façade officiel<strong>le</strong>ment proclamée<br />
de la vio<strong>le</strong>nce masculine, il n’y aurait<br />
pas eu en réalité un exercice si<strong>le</strong>ncieux<br />
du pouvoir féminin, <strong>entre</strong> autres en<br />
vertu de la notion de <strong>«</strong> v<strong>entre</strong> de souveraineté<br />
». Rouche s’intéresse à l’évolution<br />
du christianisme qui, introduit<br />
par Constantin en 313 puis proclamé<br />
religion d’État en 392, devient à partir<br />
de l’an mil un facteur de sédentarisation<br />
des nomades. À grand renfort de détails<br />
et de cartes géographiques indispensab<strong>le</strong>s<br />
à la compréhension des stratégies<br />
militaires et des enjeux politiques d’une<br />
époque si lointaine, Rouche plante soigneusement<br />
<strong>le</strong> décor d’un contexte a<br />
priori assez obscur et réussit <strong>le</strong> tour de<br />
force de nous <strong>le</strong> rendre familier.<br />
Coutumiers des sacrifices humains et<br />
buveurs de sang, <strong>le</strong>s Huns ont inspiré<br />
une indicib<strong>le</strong> terreur. Il n’en existe pas<br />
moins une véritab<strong>le</strong> démesure <strong>entre</strong><br />
cette terreur et la réalité des destructions<br />
et des massacres commis. <strong>Le</strong>s<br />
images des nomades ont créé un choc,<br />
quel<strong>le</strong>s que soient <strong>le</strong>urs têtes : cel<strong>le</strong> du<br />
Hun à la Frankenstein, cel<strong>le</strong> de l’Avar<br />
porteur de nattes ou cel<strong>le</strong> du Magyar<br />
au crâne rasé. <strong>«</strong> <strong>Le</strong>s mythes ont beau<br />
sommeil<strong>le</strong>r au niveau des récits folkloriques,<br />
ils n’en ont pas moins la vie<br />
dure. ».<br />
Dame Anastasie nue et habillée<br />
lAmiA el-SAAd<br />
ni bonne ni mauvaise, mais qui s’interroge<br />
perpétuel<strong>le</strong>ment sur el<strong>le</strong>-même, sur<br />
sa raison d’être et sa façon de procéder.<br />
Certes, ses justificatifs sont souvent<br />
condamnab<strong>le</strong>s lorsqu’il s’agit d’une censure<br />
politique où <strong>le</strong>s autorités françaises<br />
tentent d’esquiver des sujets graves et<br />
de cacher certaines vérités concernant<br />
la Collaboration, <strong>le</strong>s colonies, la guerre<br />
d’Algérie… Mais <strong>le</strong>s décisions prises<br />
par la commission de contrô<strong>le</strong> sont<br />
parfois compréhensib<strong>le</strong>s voire louab<strong>le</strong>s,<br />
surtout quand il s’agit de protéger <strong>le</strong>s<br />
mineurs d’images trop vio<strong>le</strong>ntes ou sadiques.<br />
Garreau conclut ainsi avec des<br />
propos qui rendent justice à une activité<br />
trop souvent condamnée : <strong>«</strong> <strong>La</strong> censure<br />
n’a pas pour première vocation d’empêcher<br />
la transmission des œuvres aux<br />
générations futures. El<strong>le</strong> s’appuie sur<br />
l’idée qu’el<strong>le</strong> se fait de l’état des mœurs<br />
ou de la conjoncture politique et socia<strong>le</strong><br />
pour prononcer l’avis qu’el<strong>le</strong> estime <strong>le</strong><br />
plus conforme à l’intérêt public. »<br />
Même l’image reçue habituel<strong>le</strong>ment du<br />
censeur est remise en question. L’auteur<br />
met en va<strong>le</strong>ur <strong>le</strong> mérite des présidents<br />
successifs de la commission de contrô<strong>le</strong><br />
qui ont guidé <strong>le</strong> cinéma vers la liberté<br />
et l’affranchissement. Grâce à eux, des<br />
changements ont été effectués et des<br />
films à sujets sensib<strong>le</strong>s tels <strong>Le</strong>s Parents<br />
terrib<strong>le</strong>s de Cocteau, <strong>Le</strong> Corbeau de<br />
Clouzot, <strong>Le</strong>s Tricheurs de Carné… ont<br />
pu être projetés. On retiendra surtout<br />
<strong>le</strong> nom de Georges Huisman, à la tête<br />
de la censure de 1945 à 1950, grand<br />
amoureux du cinéma et de son métier<br />
de censeur qui lui donnait <strong>«</strong> l’agréab<strong>le</strong><br />
obligation de voir tous <strong>le</strong>s films ». À lui<br />
revient l’affirmation ferme que la censure<br />
doit traiter <strong>«</strong> <strong>le</strong> film comme une<br />
création spirituel<strong>le</strong> qui mérite <strong>le</strong> respect<br />
et qui exige d’être conservée dans son<br />
intégralité ». Il a redéfini ainsi <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s<br />
d’un jeu qu’on pensait manichéen.<br />
myriAm SASSine<br />
Riad el-Solh, fils<br />
de l'Empire et<br />
père du Liban<br />
D.R.<br />
la lutte pOur l’Indépendance arabe, rIad<br />
el-sOlh et la naIssance du mOyen-OrIent<br />
arabe mOderne de Patrick Sea<strong>le</strong>, Fayard, 572p.<br />
Depuis près d’un demisièc<strong>le</strong>,<br />
Patrick Sea<strong>le</strong> a la<br />
réputation d’être un des<br />
journalistes <strong>le</strong>s mieux informés<br />
du Moyen-Orient. Plusieurs de<br />
ses livres sont devenus des classiques<br />
de référence. Cette fois, délaissant l’actualité<br />
récente, il s’est intéressé à la<br />
biographie d’un des hommes essentiels<br />
de l’histoire du Proche-Orient dans la<br />
première moitié du XX e sièc<strong>le</strong>.<br />
<strong>La</strong> vie de Riad el-Solh l’a fasciné depuis<br />
longtemps, et il s’est lancé dans<br />
l’écriture de sa biographie à la demande<br />
de descendants de l’homme d’État.<br />
Cela lui a permis de disposer de très<br />
riches informations familia<strong>le</strong>s complétant<br />
ce que l’on pouvait trouver dans<br />
<strong>le</strong>s archives et la presse. L’auteur s’est<br />
fait aider de <strong>«</strong> documentalistes » dans<br />
<strong>le</strong> dépouil<strong>le</strong>ment des sources arabes,<br />
ottomanes, françaises et anglaises. On<br />
peut considérer qu’il a disposé de tout<br />
ce qui est accessib<strong>le</strong> actuel<strong>le</strong>ment sur<br />
ce sujet.<br />
<strong>La</strong> biographie commence par l’ascension<br />
socia<strong>le</strong> de la famil<strong>le</strong> Solh au XIX e<br />
sièc<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> cadre de l’Empire ottoman.<br />
Son père, Rida al-Solh, a fait<br />
carrière dans l’administration ottomane.<br />
Il a exercé à plusieurs reprises<br />
<strong>le</strong>s fonctions de qa’im maqam (souspréfet)<br />
puis de mutassarif (préfet ou<br />
gouverneur) dans différentes parties de<br />
l’empire, en particulier dans <strong>le</strong>s Balkans.<br />
Riad el-Solh est né<br />
en 1894. Il a été é<strong>le</strong>vé au<br />
sein de sa famil<strong>le</strong> avec<br />
des précepteurs puis a<br />
fréquenté <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s missionnaires<br />
chrétiennes et<br />
l’éco<strong>le</strong> ottomane d’État.<br />
Son père a pris sa retraite<br />
en 1907 pour être élu en<br />
1908 député de Beyrouth<br />
au Par<strong>le</strong>ment ottoman.<br />
Avec justesse, l’auteur insiste<br />
sur l’importance de<br />
ces années de formation à<br />
Istanbul dans <strong>le</strong> contexte<br />
de la vie politique tumultueuse<br />
de la période Jeune-Turque<br />
(1908-1913).<br />
Selon <strong>le</strong> paradoxe bien connu pour ce<br />
milieu de notab<strong>le</strong>s arabes sunnites, <strong>le</strong><br />
jeune homme va être profondément<br />
marqué par la culture politique ottomane<br />
tout en s’engageant dès 1913<br />
dans <strong>le</strong> milieu des sociétés secrètes<br />
arabistes. Durant la guerre, <strong>le</strong> père et<br />
<strong>le</strong> fils sont considérés comme suspects<br />
par <strong>le</strong> pouvoir jeune-turc, et c’est probab<strong>le</strong>ment<br />
grâce à <strong>le</strong>urs réseaux d’amis<br />
politiques au plus haut niveau de l’État<br />
qu’ils sont seu<strong>le</strong>ment exilés à Smyrne<br />
durant ces années terrib<strong>le</strong>s. Dès la<br />
fin des combats, <strong>le</strong> jeune Riad rejoint<br />
l’émir Faysal à Damas. À 25 ans, il devient<br />
l’éphémère gouverneur de Saïda,<br />
vil<strong>le</strong> d’où sa famil<strong>le</strong> est originaire et où<br />
el<strong>le</strong> conserve des biens importants, des<br />
parents et des amis. Il en est chassé par<br />
<strong>le</strong>s Français. Alors que son père est ministre<br />
de l’Intérieur du royaume arabe,<br />
Riad fait partie des radicaux qui n’acceptent<br />
pas la séparation du Liban de<br />
la Syrie et <strong>le</strong>s compromis que Faysal<br />
passe avec <strong>le</strong>s Français. Après l’occupation<br />
de Damas par <strong>le</strong>s Français en<br />
août 1920, il est condamné à mort et<br />
doit s’évader du Liban dans des circonstances<br />
romanesques.<br />
Exilé, il séjourne en Égypte et en Europe<br />
et achève son initiation politique.<br />
Il peut r<strong>entre</strong>r au Liban en 1924 où il<br />
devient journaliste. Durant <strong>le</strong>s années<br />
de la grande révolution syrienne, il se<br />
fait <strong>le</strong> propagandiste de la cause arabe<br />
en Europe dont il est maintenant une<br />
personnalité de premier rang. Comme<br />
durant <strong>le</strong> reste de sa vie, il sacrifie une<br />
grande partie de la fortune familia<strong>le</strong><br />
aux besoins de la cause. Rentré au <strong>Le</strong>vant<br />
en 1928, il devient l’un des ani-<br />
Défenseur<br />
de l’unité<br />
arabe, il<br />
s’oppose<br />
aux projets<br />
d’union<br />
avancés par<br />
la Jordanie<br />
et l’Irak<br />
mateurs du Bloc national syrien décidé<br />
à trouver une solution politique avec la<br />
France. Son action s’exerce dans l’ensemb<strong>le</strong><br />
du Proche-Orient. En liaison<br />
avec Hajj Amin al-Husseini, il <strong>entre</strong> en<br />
contact avec <strong>le</strong>s sionistes dans <strong>le</strong> but de<br />
mieux comprendre <strong>le</strong>urs ambitions. Il<br />
en ressort encore plus inquiet.<br />
Au milieu des années 1930, il prend<br />
conscience que <strong>le</strong> Grand Liban est<br />
devenu un fait accompli et qu’il doit<br />
inscrire son action politique dans ce<br />
cadre. <strong>Le</strong> moment décisif est la conclusion<br />
des traités franco-syrien et franco-libanais<br />
de 1936. L’échec de cette<br />
politique lui porte un coup très dur.<br />
Durant la Seconde Guerre mondia<strong>le</strong>,<br />
il se refuse à tout engagement en faveur<br />
de l’Al<strong>le</strong>magne, mais soutient la<br />
révolte irakienne de 1941. <strong>La</strong> grande<br />
heure de Riad el-Solh commence avec<br />
la conquête des États du <strong>Le</strong>vant par<br />
<strong>le</strong>s Anglo-Gaullistes. Il est maintenant<br />
la personnalité politique la plus importante<br />
des sunnites du Liban. Avec<br />
une grande intelligence politique, il va<br />
nouer une doub<strong>le</strong> alliance, l’une avec <strong>le</strong><br />
général Spears, <strong>le</strong> représentant britannique,<br />
l’autre avec Béchara el-Khoury,<br />
qui va conduire au pacte national et à<br />
l’indépendance du Liban.<br />
Après 1945, plusieurs fois Premier ministre,<br />
il doit affronter <strong>le</strong>s problèmes<br />
de la constitution d’un État organisé<br />
alors que la lutte pour l’indépendance<br />
ne l’a pas préparé à cette tâche. S’il est<br />
reconnu comme une grande personnalité<br />
sur <strong>le</strong> plan arabe et s’il est un partisan<br />
de liens forts avec la Syrie, il doit<br />
faire face à une désunion croissante<br />
<strong>entre</strong> <strong>le</strong>s deux pays due<br />
à l’antagonisme des pro-<br />
jets économiques. Tout<br />
en étant un défenseur<br />
de l’unité arabe, il s’oppose<br />
aux projets d’union<br />
avancés par la Jordanie<br />
et l’Irak. Il est impuissant<br />
devant la catastrophe<br />
pa<strong>le</strong>stinienne de 1948<br />
due à l’impréparation<br />
de tous <strong>le</strong>s pays arabes.<br />
L’exercice du pouvoir<br />
est un temps bien décevant<br />
alors que la défaite<br />
de Pa<strong>le</strong>stine suscite la<br />
montée des mouvements<br />
politiques radicaux. L’affaire<br />
du PPS et de la mort<br />
d’Antoun Saadé est expliquée avec détails<br />
et mesure. Il en est de même pour<br />
<strong>le</strong>s circonstances encore extrêmement<br />
troub<strong>le</strong>s de l’assassinat à Amman de<br />
Riad el-Solh, <strong>le</strong> 16 juil<strong>le</strong>t 1951.<br />
Cette biographie est riche en détails,<br />
portraits et analyse psychologique.<br />
On y retrouve toute la politique arabe<br />
d’un demi-sièc<strong>le</strong> expliquée de la façon<br />
la plus claire possib<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s noninitiés.<br />
<strong>Le</strong> ton n’est pas tendre pour<br />
la politique française, ce qui pour<br />
<strong>le</strong> moins correspond à la perception<br />
qu’en avaient <strong>le</strong>s milieux nationalistes<br />
arabes. On perçoit aussi l’ombre écrasante<br />
de la présence britannique dans<br />
la région. Comme d’autres personnalités<br />
panarabes de l’époque, Riad s’est<br />
senti enfermé dans <strong>le</strong> cadre étatique<br />
nouveau en train de se former. Son héritage<br />
ottoman ne l’avait pas formé à<br />
cette perspective.<br />
Riad el-Solh a été l’architecte de l’indépendance<br />
du Liban, un fervent partisan<br />
de l’unité arabe souvent déçu par<br />
<strong>le</strong>s rivalités mesquines des dirigeants<br />
arabes, un démocrate attaché au par<strong>le</strong>mentarisme<br />
et à l’entente islamochrétienne,<br />
préférant la citoyenneté au<br />
confessionnalisme. Il a cherché un modus<br />
vivendi acceptab<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s relations<br />
<strong>entre</strong> la Syrie et <strong>le</strong> Liban. Comme<br />
beaucoup d’hommes politiques de sa<br />
génération et de son milieu, il a sacrifié<br />
une grande partie de la fortune familia<strong>le</strong><br />
aux exigences de la lutte politique.<br />
Son prestige de son vivant comme<br />
après sa mort a été grand.<br />
Henry lAUrenS<br />
Jeudi 4 marS 2010<br />
à lire<br />
Saint Jean-Paul II<br />
C’est ce 4 mars que paraît chez Plon<br />
<strong>le</strong> livre d’Alain Virconde<strong>le</strong>t, intitulé<br />
(avant l’heure !) Saint Jean-Paul II.<br />
L’occasion de revenir sur <strong>le</strong> parcours<br />
exceptionnel d’un saint homme qui<br />
aima <strong>le</strong> Liban.<br />
Poissons d’avril<br />
Après <strong>le</strong> succès de <strong>La</strong> valse <strong>le</strong>nte des<br />
tortues et des Yeux jaunes de crocodi<strong>le</strong>,<br />
Katherine Pancol publie <strong>le</strong> 1er avril<br />
chez Albin Michel un nouveau roman<br />
bizarrement intitulé <strong>Le</strong>s écureuils de<br />
Central Park sont tristes <strong>le</strong> lundi. C’est<br />
éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> 1er avril que sortira, aux<br />
éditions XO, <strong>le</strong> dernier Guillaume<br />
Musso.<br />
San-Antonio chez Bouquins<br />
<strong>La</strong> prestigieuse col<strong>le</strong>ction Bouquins<br />
chez Robert <strong>La</strong>ffont annonce la sortie<br />
prochaine des 175 romans de San-Antonio<br />
à l’occasion du dixième anniversaire<br />
de la mort de son créateur,<br />
Frédéric Dard. Réunis en 17 tomes,<br />
dont 6 paraissent cette année, ces romans<br />
écrits <strong>entre</strong> 1949 et 1999 feront<br />
<strong>le</strong> bonheur des inconditionnels du<br />
fameux commissaire.<br />
Nouveautés chez Actes Sud<br />
Parmi <strong>le</strong>s parutions prévues chez Actes<br />
Sud : Déluge de Henry Bauchau, <strong>Le</strong><br />
si<strong>le</strong>nce des esprits de Wilfried N’Sondé<br />
(lauréat du Prix des 5 continents de la<br />
Francophonie), <strong>Le</strong> lanceur de dés de<br />
Mahmoud Darwich illustré de photos<br />
d’Ernest Pignon Ernest, Invisib<strong>le</strong> de<br />
Paul Auster, Orphelins de l’Eldorado<br />
de Milton Hatoum, <strong>Le</strong> musicien et <strong>le</strong><br />
calife de Bagdad de Rachid el-Daïf, <strong>La</strong><br />
question de Pa<strong>le</strong>stine d’Edward Saïd ,<br />
Dictionnaire des hiéroglyphes de Yves<br />
Bonnamy et Ashraf Sadek et Vers un<br />
renouveau de la pensée musulmane,<br />
par Ziad Hafez, chercheur libanais à<br />
l’Université de Washington.<br />
Grass et Modiano <strong>le</strong> retour<br />
C’est <strong>le</strong> 25 mars que <strong>le</strong>s éditions du<br />
Seuil sortent la traduction en français<br />
du dernier roman du Prix Nobel<br />
de <strong>littérature</strong> 1999, Günter Grass,<br />
intitulé L’Agfa Box, où il fait par<strong>le</strong>r<br />
ses enfants d’eux et de lui. <strong>Le</strong> dernier<br />
Modiano, intitulé L’Horizon,sort ce 4<br />
mars chez Gallimard.<br />
Douaihy et Najjar en librairie<br />
Notre collaborateur Jabbour Douaihy<br />
publie ces jours-ci un roman en<br />
arabe, intitulé al-Maout beyna el-ahli<br />
nouaass (Dar an-Nahar) et voit son<br />
roman Pluies de juin traduit chez Actes<br />
Sud (sortie <strong>le</strong> 7 avril). <strong>Le</strong>s éditions<br />
Dar an-Nahar publient éga<strong>le</strong>ment la<br />
traduction en arabe de Saint Jean-Baptiste<br />
d’A<strong>le</strong>xandre Najjar dont <strong>le</strong> récit<br />
<strong>Le</strong> Si<strong>le</strong>nce du ténor vient de paraître<br />
en italien (Il Si<strong>le</strong>nzio del oratore) et en<br />
anglais (The Si<strong>le</strong>nce of my father). Najjar<br />
vient enfin de publier une plaquette<br />
intitulée Haïti, suivi de : Al<strong>le</strong>r simp<strong>le</strong><br />
pour la mort (éditions Dergham).<br />
à voir<br />
Des livres aux Oscars<br />
Parmi <strong>le</strong>s films nominés aux Oscars,<br />
trois au moins sont inspirés de livres :<br />
Precious, inspiré de Push de Sapphire ;<br />
Une éducation, tiré des Mémoires<br />
de Lynn Barber, et In the air, adapté<br />
du livre de Walter Kirn. Verdict <strong>le</strong> 7<br />
mars !<br />
Adè<strong>le</strong> Blanc-Sec en sal<strong>le</strong><br />
Luc Besson s’attaque à Adè<strong>le</strong> Blanc-<br />
Sec, la BD de Tardi, C’est l’actrice<br />
Louise Bourgoin qui a interprété <strong>le</strong><br />
rô<strong>le</strong> principal du film qui sort en sal<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong> 14 avril.<br />
<strong>Le</strong> dernier Dan Brown bientôt<br />
au cinéma<br />
<strong>Le</strong> symbo<strong>le</strong> perdu, <strong>le</strong> dernier best-sel<strong>le</strong>r<br />
de Dan Brown, sera bientôt adapté<br />
au cinéma par Steven Knight. Tom<br />
Hanks, qui a déjà joué dans Da Vinci<br />
code et Anges et démons, serait partant<br />
pour camper de nouveau <strong>le</strong> rô<strong>le</strong><br />
du professeur <strong>La</strong>ngdon.<br />
D.R.