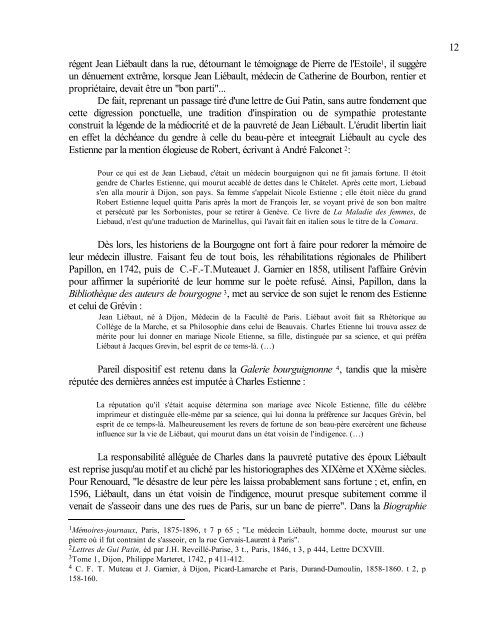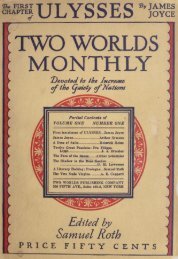1 “Les Misères de Nicole Estienne ou les peines et tourments qu'elle ...
1 “Les Misères de Nicole Estienne ou les peines et tourments qu'elle ...
1 “Les Misères de Nicole Estienne ou les peines et tourments qu'elle ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
égent Jean Liébault dans la rue, dét<strong>ou</strong>rnant le témoignage <strong>de</strong> Pierre <strong>de</strong> l'Estoile 1, il suggère<br />
un dénuement extrême, lorsque Jean Liébault, mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> Catherine <strong>de</strong> B<strong>ou</strong>rbon, rentier <strong>et</strong><br />
propriétaire, <strong>de</strong>vait être un "bon parti"...<br />
De fait, reprenant un passage tiré d'une l<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> Gui Patin, sans autre fon<strong>de</strong>ment que<br />
c<strong>et</strong>te digression ponctuelle, une tradition d'inspiration <strong>ou</strong> <strong>de</strong> sympathie protestante<br />
construit la légen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la médiocrité <strong>et</strong> <strong>de</strong> la pauvr<strong>et</strong>é <strong>de</strong> Jean Liébault. L'érudit libertin liait<br />
en eff<strong>et</strong> la déchéance du gendre à celle du beau-père <strong>et</strong> inteegrait Liébault au cycle <strong>de</strong>s<br />
<strong>Estienne</strong> par la mention élogieuse <strong>de</strong> Robert, écrivant à André Falcon<strong>et</strong> 2:<br />
P<strong>ou</strong>r ce qui est <strong>de</strong> Jean Liebaud, c'était un mé<strong>de</strong>cin b<strong>ou</strong>rguignon qui ne fit jamais fortune. Il étoit<br />
gendre <strong>de</strong> Char<strong>les</strong> <strong>Estienne</strong>, qui m<strong>ou</strong>rut accablé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ttes dans le Châtel<strong>et</strong>. Après c<strong>et</strong>te mort, Liebaud<br />
s'en alla m<strong>ou</strong>rir à Dijon, son pays. Sa femme s'appelait <strong>Nicole</strong> <strong>Estienne</strong> ; elle étoit nièce du grand<br />
Robert <strong>Estienne</strong> lequel quitta Paris après la mort <strong>de</strong> François Ier, se voyant privé <strong>de</strong> son bon maître<br />
<strong>et</strong> persécuté par <strong>les</strong> Sorbonistes, p<strong>ou</strong>r se r<strong>et</strong>irer à Genève. Ce livre <strong>de</strong> La Maladie <strong>de</strong>s femmes, <strong>de</strong><br />
Liebaud, n'est qu'une traduction <strong>de</strong> Marinellus, qui l'avait fait en italien s<strong>ou</strong>s le titre <strong>de</strong> la Comara.<br />
Dès lors, <strong>les</strong> historiens <strong>de</strong> la B<strong>ou</strong>rgogne ont fort à faire p<strong>ou</strong>r redorer la mémoire <strong>de</strong><br />
leur mé<strong>de</strong>cin illustre. Faisant feu <strong>de</strong> t<strong>ou</strong>t bois, <strong>les</strong> réhabilitations régiona<strong>les</strong> <strong>de</strong> Philibert<br />
Papillon, en 1742, puis <strong>de</strong> C.-F.-T.Muteau<strong>et</strong> J. Garnier en 1858, utilisent l'affaire Grévin<br />
p<strong>ou</strong>r affirmer la supériorité <strong>de</strong> leur homme sur le poète refusé. Ainsi, Papillon, dans la<br />
Bibliothèque <strong>de</strong>s auteurs <strong>de</strong> b<strong>ou</strong>rgogne 3, m<strong>et</strong> au service <strong>de</strong> son suj<strong>et</strong> le renom <strong>de</strong>s <strong>Estienne</strong><br />
<strong>et</strong> celui <strong>de</strong> Grévin :<br />
Jean Liébaut, né à Dijon, Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> la Faculté <strong>de</strong> Paris. Liébaut avoit fait sa Rhétorique au<br />
Collège <strong>de</strong> la Marche, <strong>et</strong> sa Philosophie dans celui <strong>de</strong> Beauvais. Char<strong>les</strong> Etienne lui tr<strong>ou</strong>va assez <strong>de</strong><br />
mérite p<strong>ou</strong>r lui donner en mariage <strong>Nicole</strong> Etienne, sa fille, distinguée par sa science, <strong>et</strong> qui préféra<br />
Liébaut à Jacques Grevin, bel esprit <strong>de</strong> ce tems-là. (…)<br />
Pareil dispositif est r<strong>et</strong>enu dans la Galerie b<strong>ou</strong>rguignonne 4, tandis que la misère<br />
réputée <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années est imputée à Char<strong>les</strong> <strong>Estienne</strong> :<br />
La réputation qu'il s'était acquise détermina son mariage avec <strong>Nicole</strong> <strong>Estienne</strong>, fille du célèbre<br />
imprimeur <strong>et</strong> distinguée elle-même par sa science, qui lui donna la préférence sur Jacques Grévin, bel<br />
esprit <strong>de</strong> ce temps-là. Malheureusement <strong>les</strong> revers <strong>de</strong> fortune <strong>de</strong> son beau-père exercèrent une fâcheuse<br />
influence sur la vie <strong>de</strong> Liébaut, qui m<strong>ou</strong>rut dans un état voisin <strong>de</strong> l'indigence. (…)<br />
La responsabilité alléguée <strong>de</strong> Char<strong>les</strong> dans la pauvr<strong>et</strong>é putative <strong>de</strong>s ép<strong>ou</strong>x Liébault<br />
est reprise jusqu'au motif <strong>et</strong> au cliché par <strong>les</strong> historiographes <strong>de</strong>s XIXème <strong>et</strong> XXème sièc<strong>les</strong>.<br />
P<strong>ou</strong>r Ren<strong>ou</strong>ard, "le désastre <strong>de</strong> leur père <strong>les</strong> laissa probablement sans fortune ; <strong>et</strong>, enfin, en<br />
1596, Liébault, dans un état voisin <strong>de</strong> l'indigence, m<strong>ou</strong>rut presque subitement comme il<br />
venait <strong>de</strong> s'asseoir dans une <strong>de</strong>s rues <strong>de</strong> Paris, sur un banc <strong>de</strong> pierre". Dans la Biographie<br />
1 Mémoires-j<strong>ou</strong>rnaux, Paris, 1875-1896, t 7 p 65 ; "Le mé<strong>de</strong>cin Liébault, homme docte, m<strong>ou</strong>rust sur une<br />
pierre où il fut contraint <strong>de</strong> s'asseoir, en la rue Gervais-Laurent à Paris".<br />
2 L<strong>et</strong>tres <strong>de</strong> Gui Patin, éd par J.H. Reveillé-Parise, 3 t., Paris, 1846, t 3, p 444, L<strong>et</strong>tre DCXVIII.<br />
3 Tome 1, Dijon, Philippe Marter<strong>et</strong>, 1742, p 411-412.<br />
4 C. F. T. Muteau <strong>et</strong> J. Garnier, à Dijon, Picard-Lamarche <strong>et</strong> Paris, Durand-Dum<strong>ou</strong>lin, 1858-1860. t 2, p<br />
158-160.<br />
12