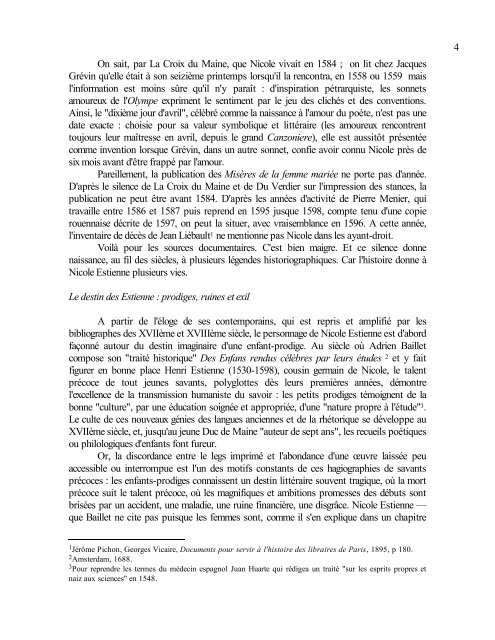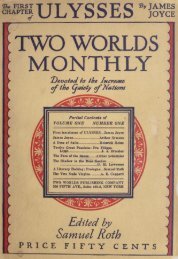1 “Les Misères de Nicole Estienne ou les peines et tourments qu'elle ...
1 “Les Misères de Nicole Estienne ou les peines et tourments qu'elle ...
1 “Les Misères de Nicole Estienne ou les peines et tourments qu'elle ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
On sait, par La Croix du Maine, que <strong>Nicole</strong> vivait en 1584 ; on lit chez Jacques<br />
Grévin <strong>qu'elle</strong> était à son seizième printemps lorsqu'il la rencontra, en 1558 <strong>ou</strong> 1559 mais<br />
l'information est moins sûre qu'il n'y paraît : d'inspiration pétrarquiste, <strong>les</strong> sonn<strong>et</strong>s<br />
am<strong>ou</strong>reux <strong>de</strong> l'Olympe expriment le sentiment par le jeu <strong>de</strong>s clichés <strong>et</strong> <strong>de</strong>s conventions.<br />
Ainsi, le "dixième j<strong>ou</strong>r d'avril", célébré comme la naissance à l'am<strong>ou</strong>r du poète, n'est pas une<br />
date exacte : choisie p<strong>ou</strong>r sa valeur symbolique <strong>et</strong> littéraire (<strong>les</strong> am<strong>ou</strong>reux rencontrent<br />
t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs leur maîtresse en avril, <strong>de</strong>puis le grand Canzoniere), elle est aussitôt présentée<br />
comme invention lorsque Grévin, dans un autre sonn<strong>et</strong>, confie avoir connu <strong>Nicole</strong> près <strong>de</strong><br />
six mois avant d'être frappé par l'am<strong>ou</strong>r.<br />
Pareillement, la publication <strong>de</strong>s <strong>Misères</strong> <strong>de</strong> la femme mariée ne porte pas d'année.<br />
D'après le silence <strong>de</strong> La Croix du Maine <strong>et</strong> <strong>de</strong> Du Verdier sur l'impression <strong>de</strong>s stances, la<br />
publication ne peut être avant 1584. D'après <strong>les</strong> années d'activité <strong>de</strong> Pierre Menier, qui<br />
travaille entre 1586 <strong>et</strong> 1587 puis reprend en 1595 jusque 1598, compte tenu d'une copie<br />
r<strong>ou</strong>ennaise décrite <strong>de</strong> 1597, on peut la situer, avec vraisemblance en 1596. A c<strong>et</strong>te année,<br />
l'inventaire <strong>de</strong> décès <strong>de</strong> Jean Liébault 1 ne mentionne pas <strong>Nicole</strong> dans <strong>les</strong> ayant-droit.<br />
Voilà p<strong>ou</strong>r <strong>les</strong> s<strong>ou</strong>rces documentaires. C'est bien maigre. Et ce silence donne<br />
naissance, au fil <strong>de</strong>s sièc<strong>les</strong>, à plusieurs légen<strong>de</strong>s historiographiques. Car l'histoire donne à<br />
<strong>Nicole</strong> <strong>Estienne</strong> plusieurs vies.<br />
Le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong>s <strong>Estienne</strong> : prodiges, ruines <strong>et</strong> exil<br />
A partir <strong>de</strong> l'éloge <strong>de</strong> ses contemporains, qui est repris <strong>et</strong> amplifié par <strong>les</strong><br />
bibliographes <strong>de</strong>s XVIIème <strong>et</strong> XVIIIème siècle, le personnage <strong>de</strong> <strong>Nicole</strong> <strong>Estienne</strong> est d'abord<br />
façonné aut<strong>ou</strong>r du <strong>de</strong>stin imaginaire d'une enfant-prodige. Au siècle où Adrien Baill<strong>et</strong><br />
compose son "traité historique" Des Enfans rendus célèbres par leurs étu<strong>de</strong>s 2 <strong>et</strong> y fait<br />
figurer en bonne place Henri <strong>Estienne</strong> (1530-1598), c<strong>ou</strong>sin germain <strong>de</strong> <strong>Nicole</strong>, le talent<br />
précoce <strong>de</strong> t<strong>ou</strong>t jeunes savants, polyglottes dès leurs premières années, démontre<br />
l'excellence <strong>de</strong> la transmission humaniste du savoir : <strong>les</strong> p<strong>et</strong>its prodiges témoignent <strong>de</strong> la<br />
bonne "culture", par une éducation soignée <strong>et</strong> appropriée, d'une "nature propre à l'étu<strong>de</strong>" 3.<br />
Le culte <strong>de</strong> ces n<strong>ou</strong>veaux génies <strong>de</strong>s langues anciennes <strong>et</strong> <strong>de</strong> la rhétorique se développe au<br />
XVIIème siècle, <strong>et</strong>, jusqu'au jeune Duc <strong>de</strong> Maine "auteur <strong>de</strong> sept ans", <strong>les</strong> recueils poétiques<br />
<strong>ou</strong> philologiques d'enfants font fureur.<br />
Or, la discordance entre le legs imprimé <strong>et</strong> l'abondance d'une œuvre laissée peu<br />
accessible <strong>ou</strong> interrompue est l'un <strong>de</strong>s motifs constants <strong>de</strong> ces hagiographies <strong>de</strong> savants<br />
précoces : <strong>les</strong> enfants-prodiges connaissent un <strong>de</strong>stin littéraire s<strong>ou</strong>vent tragique, où la mort<br />
précoce suit le talent précoce, où <strong>les</strong> magnifiques <strong>et</strong> ambitions promesses <strong>de</strong>s débuts sont<br />
brisées par un acci<strong>de</strong>nt, une maladie, une ruine financière, une disgrâce. <strong>Nicole</strong> <strong>Estienne</strong> —<br />
que Baill<strong>et</strong> ne cite pas puisque <strong>les</strong> femmes sont, comme il s'en explique dans un chapitre<br />
1Jérôme Pichon, Georges Vicaire, Documents p<strong>ou</strong>r servir à l'histoire <strong>de</strong>s libraires <strong>de</strong> Paris, 1895, p 180.<br />
2Amsterdam, 1688.<br />
3P<strong>ou</strong>r reprendre <strong>les</strong> termes du mé<strong>de</strong>cin espagnol Juan Huarte qui rédigea un traité "sur <strong>les</strong> esprits propres <strong>et</strong><br />
naiz aux sciences" en 1548.<br />
4