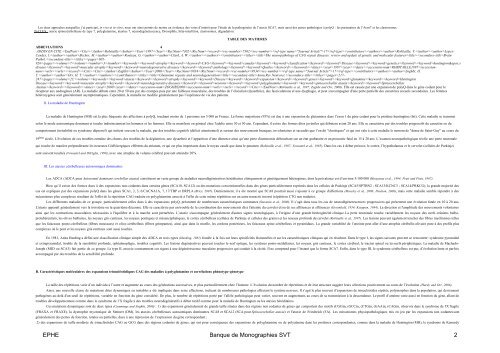Elodie Martin - EPHE
Elodie Martin - EPHE
Elodie Martin - EPHE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Les deux approches auxquelles j’ai participé, in vivo et in vitro, nous ont ainsi permis de mettre en évidence des voies d’intérêt pour l’étude de la pathogénèse de l’ataxie SCA7, mais aussi des autres pathologies à polyQ : les partenaires de l’Atxn7 et les clastosomes.<br />
TS-CLES : ataxie spinocérébelleuse de type 7, polyglutamine, ataxine 7, neurodégénérescence, Drosophile, béta-interféron, clastosomes, dégradation.<br />
TABLE DES MATIERES<br />
ABREVIATIONS 4<br />
ADDIN EN.CITE Robitaille19977302730217Robitaille, Y.Lopes-<br />
Cendes, I.Becher, M.Rouleau, G.Clark, A. W.The neuropathology of CAG repeat diseases: review and update of genetic and molecular featuresBrain<br />
Pathol.901-<br />
92673atrophyCAGcanadaclassificationDiseasegeneticshuntington's<br />
diseasemuscular atrophyneurodegenerative diseasespathologyQuebec1997ROBITAILLE1997Zoghbi20009934993417Zoghbi, H.<br />
Y.Orr, H. T.Glutamine repeats and neurodegenerationAnnu.Rev.Neurosci.217-<br />
24723:ataxiaatrophyDiseaseexpansiongenesglutamineHuntington<br />
Diseasemuscular atrophyneurodegenerative diseasesneuronspolyglutaminespinocerebellar ataxiaSpinocerebellar<br />
Ataxias2000ZOGHBI2000(Robitaille et al., 1997; Zoghbi and Orr, 2000). Elle est causée par une expansion de polyQ dans le gène codant pour le<br />
récepteur aux androgènes (AR). La maladie débute entre 20 et 50 ans par des crampes puis par une faiblesse musculaire, des troubles de l’élocution (dysarthrie), des fasciculations et une dysphagie, et peut s'accompagner d'une perte partielle des caractères sexuels secondaires. Les femmes<br />
hétérozygotes sont généralement asymptomatiques. Cependant, la maladie ne modifie généralement pas l’espérance de vie des patients.<br />
II. La maladie de Huntington<br />
La maladie de Huntington (MH) est la plus fréquente des affections à polyQ, touchant moins de 1 personne sur 5 000 en France. La forme majoritaire (95%) est due à une expansion de glutamines dans l’exon 1 du gène codant pour la protéine huntingtine (htt). Cette maladie se transmet<br />
selon le mode autosomique dominant et touche indistinctement les hommes et les femmes. Elle se manifeste en général chez l'adulte entre 30 et 50 ans. Cependant, il existe des formes dites juvéniles qui débutent avant 20 ans. Elle se caractérise par des troubles progressifs du caractère ou du<br />
comportement (irritabilité ou syndrome dépressif) qui initient souvent la maladie, par des troubles cognitifs (déficit attentionnel) et surtout des mouvements brusques, involontaires et saccadés que l’on dit "choréiques" et qui ont valu à cette maladie le surnom de "danse de Saint-Guy" au cours du<br />
19ème siècle. L'évolution de ces troubles entraîne des chutes, des troubles de la déglutition, une dysarthrie et l’apparition d’une démence ainsi qu’une perte d'autonomie débouchant sur un état grabataire et un pronostic fatal en 15 à 20 ans. L’examen neuropathologique révèle une perte neuronale<br />
qui touche de manière prépondérante les neurones GABAergiques efférents du striatum, et qui est plus importante dans le noyau caudé que dans le putamen (Robitaille et al., 1997; Vonsattel et al., 1985). Dans les cas à début précoce, le cortex, l’hypothalamus et le cervelet (cellules de Purkinje)<br />
sont souvent touchés (Vonsattel and DiFiglia, 1998), avec une atrophie du volume cérébral pouvant atteindre 20%.<br />
III. Les ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes<br />
Les ADCA (ADCA pour Autosomal dominant cerebellar ataxia) constituent un vaste groupe de maladies neurodégénératives héréditaires cliniquement et génétiquement hétérogènes, dont la prévalence est d’environ 5/100 000 (Hirayama et al., 1994; Pratt and Pratt, 1967).<br />
Bien qu’il existe des formes dues à des expansions non-codantes dans certains gènes (SCA10, SCA12) ou des mutations conventionnelles dans des gènes particulièrement exprimés dans les cellules de Purkinje (SCA5/SPTBN2 ; SCA13/KCNC3 ; SCA14/PRKCG), la grande majorité des<br />
cas est expliquée par des expansions polyQ dans les gènes SCA1, 2, 3, 6/CACNA1A, 7, 17/TBP et DRPLA (Brice, 2007). Dernièrement, il a été montré que SCA8 pourrait aussi s’ajouter à ce groupe d'affections (Moseley et al., 2006; Paulson, 2006), mais cette maladie semble répondre à des<br />
mécanismes plus complexes résultant de l'effet de la répétition CAG traduite en polyglutamine associé à l'effet de cette même répétition sur un autre transcrit inversé (répétition CTG non traduite).<br />
Les différentes maladies de ce groupe, particulièrement celles dues à des expansions polyQ, présentent de nombreuses caractéristiques communes (Stevanin et al., 2000). Il s’agit dans tous les cas de neurodégénerescences progressives qui présentent une évolution fatale en 10 à 20 ans.<br />
L'ataxie apparaît généralement vers la troisième ou la quatrième décennie. Elle se caractérise par un trouble de la coordination des mouvements dû à l'atteinte du cervelet et/ou de ses afférences et efférences (Greenfield, 1954; Koeppen, 1984). La direction et l'amplitude des mouvements volontaires<br />
ainsi que les contractions musculaires nécessaires à l'équilibre et à la marche sont perturbées. L’ataxie s'accompagne généralement d'autres signes neurologiques, à l'origine d’une grande hétérogénéité clinique. La perte neuronale touche variablement les noyaux des nerfs crâniens bulboprotubérentiels,<br />
les olives bulbaires, les noyaux gris centraux, les noyaux pontiques et mésencéphaliques, le cortex cérébelleux (cellules de Purkinje et cellules des grains) et les noyaux profonds du cervelet (Robitaille et al., 1997). Les lésions peuvent également toucher des fibres myélinisées telles<br />
que les faisceaux ponto-cérébelleux (fibres moussues) et olivo-cérébelleux (fibres grimpantes), ainsi que dans la moelle, les cordons postérieurs, les faisceaux spino-cérébelleux et pyramidaux. La grande variabilité de l’atteinte peut aller d’une atrophie cérébello-olivaire pure à des profils plus<br />
complexes où le pont et les noyaux gris centraux sont aussi touchés.<br />
En 1981, Anita Harding a défini une classification clinique simple des ADCA en trois types (Harding, 1981) fondée à la fois sur leurs spécificités lésionnelles et sur les caractéristiques cliniques qui en résultent. Dans le type I, les signes suivants peuvent se rencontrer: syndrome pyramidal<br />
et extrapyramidal, trouble de la sensibilité profonde, ophtalmoplégie, troubles cognitifs. Les lésions dégénératives peuvent toucher le nerf optique, les systèmes ponto-médullaires, les noyaux gris centraux, le cortex cérébral, le tractus spinal ou les nerfs périphériques. La maladie de Machado-<br />
Joseph (MJD ou SCA3) fait partie de ce groupe. Le type II, associe constamment ces signes à une dégénérescence maculaire progressive qui conduit à la cécité. Il ne comprend pour l’instant que la forme SCA7. Enfin, dans le type III, le syndrome cérébelleux est pur, d’évolution lente et parfois<br />
accompagné par des troubles de la sensibilité profonde.<br />
B. Caractéristiques moléculaires des expansions trinucléotidiques CAG des maladies à polyglutamine et corrélations phénotype-génotype<br />
La taille des répétitions varie d’un individu à l’autre et augmente au cours des générations successives, et plus particulièrement chez l’homme. L’évolution du nombre de répétitions et de leur structure suggère leurs sélections positivement au cours de l’évolution (Hardy and Orr, 2006).<br />
Ainsi, une nouvelle classe de mutations dites dynamiques ou instables a été impliquée dans seize affections, incluant de nombreuses pathologies affectant le système nerveux. Il s’agit le plus souvent d’expansions de trinucléotides répétés, polymorphes dans la population, qui deviennent<br />
pathogènes au-delà d'un seuil de répétitions, variable en fonction du gène considéré. De plus, le nombre de répétitions porté par l’allèle pathologique peut varier, souvent en augmentant, au cours de sa transmission à la descendance. Le profil d’atteinte varie aussi en fonction du gène, allant de<br />
troubles développementaux comme dans le syndrome de l’X fragile à des troubles neurodégénératifs à début tardif comme pour la maladie de Huntington ou les ataxies héréditaires.<br />
Ces mutations dynamiques sont de deux types (Cummings and Zoghbi, 2000) : 1) des expansions généralement de grande taille situées dans des régions non codantes de gènes qui comportent des motifs (CGG)n, (GCC)n, (CTG)n, (GAA)n, (CAG)n, observés dans le syndrome de l'X fragile<br />
(FRAXA et FRAXE), la dystrophie myotonique de Steinert (DM), les ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes SCA8 et SCA12 (SCA pour Spinocerebellar ataxia) et l'ataxie de Friedreich (FA). Les mécanismes physiopathologiques mis en jeu par les expansions non codantes sont<br />
généralement des pertes de fonction, totales ou partielles, dues à une répression de l’expression du gène correspondant ;<br />
2) des expansions de taille modérée de trinucléotides CAG ou GCG dans des régions codantes de gènes, qui ont pour conséquence des expansions de polyglutamine ou de polyalanine dans les protéines correspondantes, comme dans la maladie de Huntington (MH), le syndrome de Kennedy<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 2