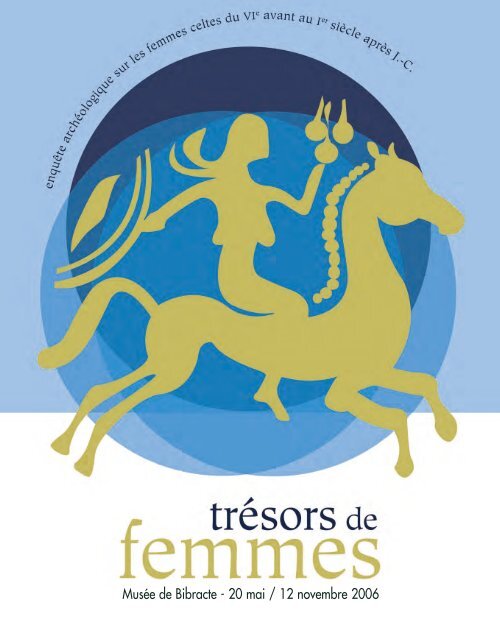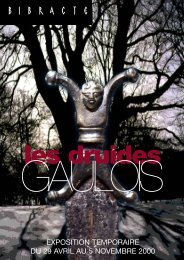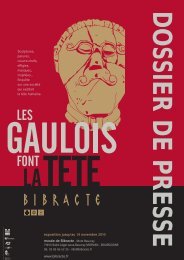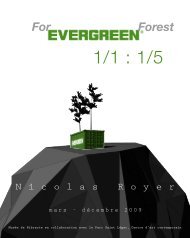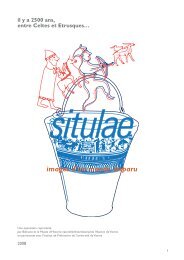Télécharger le catalogue (PDF 7,6 Mo) - Bibracte
Télécharger le catalogue (PDF 7,6 Mo) - Bibracte
Télécharger le catalogue (PDF 7,6 Mo) - Bibracte
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TAP BIBRACTEFEMMES COUV Ok 16/05/06 17:54 Page 1<br />
Musée de <strong>Bibracte</strong> - 20 mai / 12 novembre 2006
TAP BIBRACTEFEMMES 2deCOUV Ok 16/05/06 17:56 Page 1<br />
Les objets présentés proviennent des musées et col<strong>le</strong>ctions suivantes :<br />
Al<strong>le</strong>magne (D) : Rheinisches Landesmuseum, Bonn - Landesdenkmalamt, Staatliche Altertümersammlung, Saarbruck -<br />
Rheinisches Landesmuseum, Trèves<br />
Autriche (A) : Bundesdenkmalamt, Vienne<br />
France (F) : Musée d'Alésia, Alise-Sainte-Reine - Musée d'art et d'histoire, Auxerre -<br />
Musée du Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine - Musée P. Dubois-A. Boucher, Nogent-sur-Seine -<br />
Musée Rolin, Autun - Musée municipal, Soissons -<br />
Musée des Ursulines, Mâcon - Service régional de l'archéologie Rhône-Alpes, Lyon<br />
Hongrie (H) : Hermann Ottó Múzeum, Miskolc<br />
,<br />
,<br />
République tchèque (CZ) : Jihoceské muzeum – Musée de la Bohême<br />
méridiona<strong>le</strong>, Ceské Budejovice - Muzeum vychodních Cech - Musée de la<br />
Bohême orienta<strong>le</strong>, Hradec Králové - Oblastní muzeum – Musée régional,<br />
Chomutov - Ceské muzeum stríbra – - Musée tchèque de l’Argent,<br />
Kutná Hora - Regionální muzeum – Musée régional, Kolí - Oblastní<br />
muzeum – Musée régional, Louny - Regionální muzeum – Musée<br />
régional, Melník - Mestské muzem – Musée municipal, Novy<br />
Bydzov - Národní muzeum – Musée national, Praha -<br />
Muzeum Dr. B. Horáka – Musée Horák, Rokycany -<br />
Stredoceské muzeum – Musée de la Bohême centra<strong>le</strong>, Roztoky<br />
u Prahy - Vlastivedné muzeum – Musée du Pays,<br />
Slany- Muzeum stredního Pootaví – Musée de la région<br />
d’Otava, Strakonice - Regionální muzeum – Musée régional,<br />
Teplice - Mestské muzeum a ga<strong>le</strong>rie – Musée municipal<br />
et Ga<strong>le</strong>rie, Vodnany - Regionální muzeum K. A. Polánka –<br />
Musée régional, Zatec.<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
Slovaquie (SK) : Slovenské národné muzeum - Musée national<br />
slovaque, Bratislava - Muzeum mad'arskej kultury a Podunajska<br />
– Musée de la Culture hongroise et de la Région danubienne,<br />
Komárno - Zemplinské muzeum – Musée de Zemplin, Michalovce<br />
- Archeologick_ ustav Slovenskej akadémie vied – Institut<br />
d’archéologie de l’Académie slovaque des Sciences, Nitra<br />
Suisse (CH) : Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne -<br />
Musée historique, Berne.<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,<br />
,
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 3<br />
Trésors<br />
de femmes,<br />
à la découverte des femmes celtes<br />
VIe sièc<strong>le</strong> avant J.-C. – Ier VI sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />
Musée de <strong>Bibracte</strong> – 20 mai / 12 novembre 2006<br />
e sièc<strong>le</strong> avant J.-C. – Ier sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />
Musée de <strong>Bibracte</strong> – 20 mai / 12 novembre 2006<br />
xé aff. trésors de femmes 11/04/06 10:21 Page 1<br />
enquête archéologique sur <strong>le</strong>s femmes celtes du VIe avant au Ier sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />
graphisme : <strong>le</strong>s Pisto<strong>le</strong>ros 03 80 65 18 50<br />
trésors de<br />
femmes<br />
Exposition jusqu’au 12 novembre 2006<br />
Musée de <strong>Bibracte</strong> - <strong>Mo</strong>nt Beuvray<br />
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray<br />
MORVAN - BOURGOGNE<br />
Tél. 03 85 86 52 35 - www.bibracte.fr / info@bibracte.fr<br />
Textes : <strong>Bibracte</strong> / Photos : DR<br />
Trois musées européens se sont associés pour concevoir cette exposition<br />
sur la femme celte : <strong>le</strong> Musée national tchèque, à Prague, <strong>le</strong> parc archéologique<br />
de Wederath-Belginum, situé près de Trèves, et <strong>le</strong> musée de <strong>Bibracte</strong>. Les objets<br />
présentés proviennent d’Al<strong>le</strong>magne, d’Autriche, de France, de Hongrie, de la République<br />
tchèque, de Slovaquie et de Suisse, soit une bonne partie du territoire anciennement<br />
occupé par des populations de culture celtique. Le cadre chronologique retenu<br />
s’étend du VIe Trois musées européens se sont associés pour concevoir cette exposition<br />
sur la femme celte : <strong>le</strong> Musée national tchèque, à Prague, <strong>le</strong> parc archéologique<br />
de Wederath-Belginum, situé près de Trèves, et <strong>le</strong> musée de <strong>Bibracte</strong>. Les objets<br />
présentés proviennent d’Al<strong>le</strong>magne, d’Autriche, de France, de Hongrie, de la République<br />
tchèque, de Slovaquie et de Suisse, soit une bonne partie du territoire anciennement<br />
occupé par des populations de culture celtique. Le cadre chronologique retenu<br />
s’étend du VI sièc<strong>le</strong> avant J.-C. jusqu’au passage à l’ère chrétienne, époque couvrant<br />
la fin du premier âge du Fer (Hallstatt) et <strong>le</strong> second âge du Fer (période de La Tène).<br />
e sièc<strong>le</strong> avant J.-C. jusqu’au passage à l’ère chrétienne, époque couvrant<br />
la fin du premier âge du Fer (Hallstatt) et <strong>le</strong> second âge du Fer (période de La Tène).<br />
EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 3
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 4<br />
Trésors de femmes,<br />
À la découverte<br />
des femmes celtes<br />
4 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />
1<br />
Une impossib<strong>le</strong> enquête ?<br />
La place de la femme dans <strong>le</strong>s sociétés grecque et romaine est bien connue grâce à des textes<br />
anciens. Soumise en droit à son mari qui a droit de vie sur el<strong>le</strong> comme sur ses enfants, el<strong>le</strong> peut<br />
néanmoins connaître <strong>le</strong> prestige et <strong>le</strong> pouvoir… du moins quand el<strong>le</strong> est issue de l’aristocratie.<br />
La réalité quotidienne était certainement moins brillante.<br />
Qu’en est-il dans la société celte, contemporaine de la Rome républicaine et des royaumes hellénistiques<br />
? C’est cette question que tente de poser l’exposition. Autant <strong>le</strong> dire d’emblée : la tâche<br />
est ardue. Les textes sont pratiquement muets sur <strong>le</strong> sujet.<br />
A première vue, l’archéologie n’apporte guère plus de renseignements. Ainsi, parmi <strong>le</strong>s centaines<br />
de milliers d’objets récoltés sur l’oppidum de <strong>Bibracte</strong>, deux douzaines seu<strong>le</strong>ment peuvent être<br />
sans ambiguïté associés à la femme : noms inscrits sur des poteries, images féminines sur<br />
des monnaies, restes osseux. Il faut aussi reconnaître que, pour <strong>le</strong>s archéologues, <strong>le</strong> genre neutre<br />
se transforme bien vite en genre masculin.<br />
Essayons donc de surmonter l’apparente indigence des sources pour retrouver ce qu’étaient<br />
la condition féminine et, plus largement, la place du féminin chez <strong>le</strong>s Celtes.<br />
1 - La femme celte dans l’imagerie romantique : La druidesse Velléda, peinture d’Arnaud La Roche, XIX e sièc<strong>le</strong>.<br />
Velléda est connue par l’historien romain Tacite, qui la décrit comme une prophétesse qui vivait en Germanie au I er sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />
L’image confuse de la femme celte<br />
Le sources écrites et iconographiques de l’Antiquité nous livrent bien peu<br />
d’éléments concrets sur la femme celte. Ainsi, <strong>le</strong>s textes nous livrent <strong>le</strong> nom<br />
de seu<strong>le</strong>ment trois femmes celtes historiques, <strong>le</strong>s reines bretonnes Boudicca<br />
et Catimandua, et la Galate Chiomara – qui toutes, d’ail<strong>le</strong>urs, avaient pris<br />
<strong>le</strong> pouvoir dans des circonstances inhabituel<strong>le</strong>s. C’est l’exception qui<br />
confirme la règ<strong>le</strong>.<br />
Dans <strong>le</strong>s Commentaires sur la Guerre des Gau<strong>le</strong>s de Ju<strong>le</strong>s César,<br />
notre meil<strong>le</strong>ure source d’information, à peine vingt passages mentionnent<br />
des femmes. Et encore, il s’agit presque toujours de phrases toutes faites à<br />
propos de massacres qui ont touché «<strong>le</strong>s femmes, <strong>le</strong>s enfants et <strong>le</strong>s vieillards».<br />
Cette indigence des sources laisse libre cours aux représentations modernes<br />
fantaisistes, qu’el<strong>le</strong>s soient romantiques, ésotériques ou mystificatrices.<br />
2 - Coup<strong>le</strong> de Galates se donnant la mort.<br />
Sculpture romaine d’après un original du III e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.,<br />
qui faisait partie d’un monument é<strong>le</strong>vé par <strong>le</strong> roi Atta<strong>le</strong> I er à Pergame (Asie mineure).<br />
2
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 5<br />
3<br />
3 - Inscriptions après cuisson sur un vase en terre cuite, I er sièc<strong>le</strong> avant J.C.<br />
On lit, en caractères grecs, <strong>le</strong> nom féminin MATERIAS.<br />
Oppidum de <strong>Bibracte</strong>.<br />
Des femmes à sortir de l’anonymat<br />
De la langue que parlaient <strong>le</strong>s Celtes, seu<strong>le</strong>s des bribes nous sont parvenues.<br />
On connaît néanmoins plusieurs centaines de noms propres : noms de divinités<br />
sur des inscriptions d’époque romaine, noms de lieux transmis<br />
par la toponymie et noms de personnes inscrits sur des monnaies<br />
ou d’autres objets de la vie quotidienne. Heureusement pour nous,<br />
ces noms sont souvent porteurs de sens – Vercingétorix est « <strong>le</strong> roi<br />
des guerriers », Belisama, « la très puissante », Sénobéna, « la vieil<strong>le</strong><br />
femme »… De cette façon, on peut restituer, avec plus ou moins<br />
de sûreté, une liste de mots en rapport avec la femme et <strong>le</strong> féminin.<br />
4 - Inscription avant cuisson, début du I er sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />
L’écriture était suffisamment familière aux habitants de <strong>Bibracte</strong> pour que chacun<br />
soit capab<strong>le</strong> d’écrire son nom, en caractères grecs ou latins (la langue gauloise ne disposant<br />
pas de son propre alphabet). Comme on peut s’y attendre, <strong>le</strong>s propriétaires de ces modestes<br />
ustensi<strong>le</strong>s de cuisine sont souvent des femmes.<br />
Le nom inscrit, DRVENTIA, est celui que <strong>le</strong>s Gaulois donnaient à la rivière Durance. Faut-il<br />
établir un rapport avec <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> vase inscrit a été trouvé dans une conduite qui drainait<br />
une source ?<br />
Oppidum de <strong>Bibracte</strong>, aqueduc de la maison PC1.<br />
Glossaire<br />
aua : petite-fil<strong>le</strong> ?<br />
bena : femme<br />
brunnio- : sein<br />
derti : concubine ?<br />
dona : femme ?<br />
druna : vigoureuse, rapide<br />
duxtir : fil<strong>le</strong><br />
exuertina : infidè<strong>le</strong>, déloya<strong>le</strong><br />
geneta : jeune fil<strong>le</strong><br />
genos : lignée, famil<strong>le</strong><br />
gnata : fil<strong>le</strong><br />
iouinca : jeune<br />
isara : impétueuse<br />
litaui : la Terre<br />
lubita : aimée<br />
magus, mapat- : enfant, va<strong>le</strong>t<br />
matir : mère<br />
matronae : déesses-mères<br />
matta : fil<strong>le</strong>, gamine ?<br />
rigana : reine<br />
sena : vieil<strong>le</strong><br />
sentice : compagne, épouse<br />
suior- : sœur<br />
su<strong>le</strong>via : conductrice<br />
teuta / touta : tribu, peup<strong>le</strong><br />
tuto- : sexe féminin<br />
(opposé de moto- : membre viril)<br />
ueni- : clan, famil<strong>le</strong>, lignée<br />
uidla : voyante, sorcière<br />
uimpa : jolie<br />
unna : l’eau<br />
(Liste établie d’après X. Delamarre,<br />
Dictionnaire de la langue gauloise,Paris 2001.)<br />
Des fusaïo<strong>le</strong>s inscrites<br />
Le filage de la laine est une activité réservée aux femmes. Le sol de la<br />
vil<strong>le</strong> d’Autun a livré une exceptionnel<strong>le</strong> série de fusaïo<strong>le</strong>s (qui servaient<br />
de volant d’inertie au fuseau), fabriquées dans une pierre tendre loca<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong> lignite, et pourvues d’inscriptions. En p<strong>le</strong>ine époque romaine, la langue<br />
de ces inscriptions est généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> gaulois, qui est longtemps resté<br />
la langue de la vie quotidienne après la conquête de César. Pas toujours<br />
très faci<strong>le</strong>s à traduire, ces inscriptions ont toutes<br />
une connotation féminine, voire érotique.<br />
geneta imi daga uimpi :<br />
«je suis une jeune fil<strong>le</strong><br />
bonne et bel<strong>le</strong>»<br />
mattadagomota balineenata :<br />
«bonne à baiser»<br />
marcosior :<br />
«que je sois chevauchée»<br />
5 - Trois fusaïo<strong>le</strong>s en lignite,<br />
I er / II e sièc<strong>le</strong>s après J.-C.<br />
D. 2,5 cm. Autun (France), musée Rolin.<br />
EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 5<br />
4<br />
5
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 6<br />
7<br />
6 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />
Les sources<br />
archéologiques<br />
La femme celte la plus célèbre que l’archéologie a révélée est la «princesse» de Vix, ensevelie à la fin du VI e sièc<strong>le</strong><br />
avant J.-C. avec de très riches offrandes au nord de la Bourgogne.<br />
Après plus de 150 ans de recherche, l’archéologie et l’anthropologie présentent aujourd’hui une nouvel<strong>le</strong> image,<br />
plus réaliste, de la femme celte. Combinées, ces deux disciplines permettent de reconstituer l’apparence physique<br />
et <strong>le</strong> mode de vie de nos ancêtres à partir des matériaux que <strong>le</strong> sol fournit : images figurées, objets témoignant de la vie<br />
quotidienne, et sépultures.<br />
La sépulture permet de s’intéresser à un individu particulier, dont on peut restituer, au terme d’une enquête ostéo-archéologique,<br />
<strong>le</strong> sexe et l’âge au moment du décès. Dans <strong>le</strong>s cas favorab<strong>le</strong>s, on apprécie aussi l’état sanitaire de la population<br />
dont on étudie <strong>le</strong> cimetière, ainsi que <strong>le</strong> statut social de ses habitants : a-t-on affaire à une élite ou à une population modeste ?<br />
6<br />
6- Plaque de joug en bronze de Waldalgesheim (Rhénanie-<br />
Palatinat, Al<strong>le</strong>magne), vers 350-300 avant J.-C.<br />
Cette applique décorative provient d’une très riche tombe<br />
à char féminine, dont <strong>le</strong>s objets présentent un sty<strong>le</strong><br />
décoratif homogène dit « sty<strong>le</strong> de Waldalgesheim »<br />
ou « sty<strong>le</strong> végétal continu ». Ce buste paré d’un torque<br />
et d’une longue coiffure symétrique nous semb<strong>le</strong> être une<br />
femme, mais l’ambiguïté subsiste.<br />
H. 9,5 cm. Bonn (Al<strong>le</strong>magne), Rheinisches Landesmuseum.<br />
7- Anneau de chevil<strong>le</strong> en bronze, IIIe sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />
Les têtes humaines sont ici à peine esquissées.<br />
D. 87 mm. Vodnany (République tchèque), Musée municipal<br />
et Ga<strong>le</strong>rie.<br />
Des représentations figurées rares et ambiguës<br />
Les Celtes nous ont laissé très peu de représentations figurées. La raison en est bien<br />
connue : <strong>le</strong>ur religion <strong>le</strong>ur interdisait de donner une physionomie humaine à <strong>le</strong>urs<br />
dieux. Les rares figures humaines produites par l’art celtique apparaissent sur<br />
des bijoux et sur des armes. El<strong>le</strong>s sont toujours ambiguës, souvent masquées dans<br />
un décor exubérant. Cel<strong>le</strong>s qui sont identifiées comme franchement masculines<br />
ou féminines sont l’exception.<br />
Ce n’est qu’au contact de la civilisation gréco-romaine que <strong>le</strong>s divinités gauloises<br />
prendront parfois figure humaine, mais sous une apparence <strong>le</strong> plus souvent empruntée<br />
au répertoire iconographique classique.<br />
8- Fibu<strong>le</strong> en bronze de Slovenské Pravno (Slovaquie), vers 400 avant J.-C.<br />
Cette parure exceptionnel<strong>le</strong> –sans doute féminine– comporte trois masques humains<br />
traités dans un sty<strong>le</strong> typique du début du second âge du Fer.<br />
L. 7 cm. Nitra (Slovaquie), Institut archéologique.<br />
^<br />
8
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 7<br />
Les sources funéraires<br />
L'analyse des nécropo<strong>le</strong>s est essentiel<strong>le</strong><br />
parce que, dans bien des régions,<br />
la période celtique n’est documentée<br />
qu’à partir de sépultures. Grâce aux<br />
objets bien conservés qu’el<strong>le</strong>s contiennent<br />
souvent, <strong>le</strong>s tombes ont plus retenu<br />
l’attention que <strong>le</strong>s sites d’habitat,<br />
aux vestiges souvent très discrets.<br />
De plus, une sépulture permet d’appréhender<br />
un individu en particulier,<br />
avec son histoire personnel<strong>le</strong>.<br />
L’analyse comprend l’étude des effets<br />
personnels et autres objets (récipients<br />
ayant contenu des offrandes, par<br />
exemp<strong>le</strong>) qui accompagnent <strong>le</strong> mort.<br />
A cela s’ajoute l’analyse de l’architecture<br />
de la tombe et l'analyse anthropologique.<br />
Chez <strong>le</strong>s Celtes, <strong>le</strong>s morts sont, selon<br />
l’époque et la région, incinérés ou inhumés.<br />
Les tombes féminines, du moins<br />
<strong>le</strong>s plus riches, se distinguent bien des<br />
tombes masculines. Les morts sont<br />
en effet ensevelis ou brûlés sur <strong>le</strong><br />
bûcher tout habillés et équipés des<br />
objets qui indiquent <strong>le</strong>ur statut et <strong>le</strong>ur<br />
rang : panoplie militaire plus ou moins<br />
complète pour <strong>le</strong>s hommes, objets de<br />
parure pour <strong>le</strong>s femmes.<br />
Deux tombes du III e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />
Ces deux tombes ont été fouillées en 2005<br />
sur la nécropo<strong>le</strong> de Sajópetri, dans <strong>le</strong> Nord-<br />
Est de la Hongrie. El<strong>le</strong>s présentent<br />
des assemblages funéraires typiques.<br />
Miskolc (Hongrie), Hermann Ottó Múzeum,<br />
fouil<strong>le</strong> M. Szabó, université de Budapest.<br />
Les données anthropologiques<br />
Le matériau source de l’anthropologie préhistorique est constitué<br />
des vestiges osseux, qu’ils soient calcinés (dans <strong>le</strong> cas de sépultures<br />
à incinération), ou non. Sur <strong>le</strong> terrain, l’anthropologue prend<br />
soin de noter la disposition des os, ce qui lui permettra de préciser<br />
<strong>le</strong> rituel funéraire (présence d’un cercueil, dérou<strong>le</strong>ment<br />
de la crémation…).<br />
Au laboratoire, <strong>le</strong>s questions qu’il se pose sont <strong>le</strong>s suivantes :<br />
– s’agit-il de restes humains ou animaux (car ces derniers<br />
sont fréquents dans <strong>le</strong>s tombes, au moins comme restes<br />
d’offrandes alimentaires) ?<br />
– quel est <strong>le</strong>ur sexe et quel est <strong>le</strong>ur âge ?<br />
– quel est <strong>le</strong> nombre des morts (en particulier dans <strong>le</strong> cas des incinérations) ?<br />
– quel<strong>le</strong>s étaient <strong>le</strong>ur tail<strong>le</strong> et <strong>le</strong>ur apparence ?<br />
– quel<strong>le</strong>s étaient <strong>le</strong>s maladies dont ils souffraient, ainsi que <strong>le</strong>urs particularités anatomiques<br />
et génétiques ?<br />
Des examens paléo-pathologiques plus approfondis peuvent être tentés par radiographie<br />
et tomodensitométrie, microscopie optique et à balayage é<strong>le</strong>ctronique, endoscopie…<br />
Les analyses isotopiques renseignent sur l’alimentation et la mobilité, <strong>le</strong>s analyses des oligoéléments<br />
sur la contamination en métaux lourds. Les procédés de biologie moléculaire<br />
analysent <strong>le</strong> matériau héréditaire (ADN) et renseignent sur <strong>le</strong> sexe, <strong>le</strong>s liens de parenté<br />
et <strong>le</strong>s maladies.<br />
9<br />
10<br />
9- Tombe masculine à incinération (9/55),<br />
vers 280 avant J.-C.<br />
– épée en fer dans son fourreau, avec<br />
sa chaîne de suspension ;<br />
– pièces métalliques d’un bouclier ;<br />
– fibu<strong>le</strong> en fer ;<br />
– couteau en fer.<br />
10- Tombe féminine à inhumation (81/155),<br />
vers 250 avant J.-C.<br />
– brace<strong>le</strong>ts en bronze et en sapropélite ;<br />
– fibu<strong>le</strong>s en bronze ;<br />
– bague en bronze ;<br />
– per<strong>le</strong> en verre ;<br />
– anneaux de chevil<strong>le</strong> en bronze ;<br />
– couteau en fer.<br />
11 - Brace<strong>le</strong>t en bronze de la tombe (9/55) de Sajópetri.<br />
Le décor imite la technique du filigrane propre à l’orfèvrerie.<br />
EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 7<br />
11
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 8<br />
La détermination du sexe<br />
Les os du bassin sont déterminants pour<br />
définir <strong>le</strong> sexe (fiabilité de 95%). Le bassin<br />
d’une femme qui a subi une grossesse<br />
est en effet déformé de façon caractéristique.<br />
Les autres os du sque<strong>le</strong>tte présentent<br />
des caractéristiques sexuel<strong>le</strong>s plus ou<br />
moins marquées. Grâce à l’observation de<br />
trente indices, l’étude du crâne permet<br />
aussi une détermination sexuel<strong>le</strong> à 90 %.<br />
Dans la mesure où <strong>le</strong> patrimoine génétique<br />
(ADN) est conservé, <strong>le</strong> sexe peut éga<strong>le</strong>ment<br />
être défini par la biologie moléculaire.<br />
Les mensurations des os montrent la tail<strong>le</strong><br />
moyenne des femmes celtes était d’environ<br />
156 à 160 cm, contre 170 cm pour <strong>le</strong>s hommes.<br />
La détermination de traces en lien avec<br />
une activité professionnel<strong>le</strong><br />
Les maladies professionnel<strong>le</strong>s existaient à l’âge<br />
du Fer. En lien avec une charge continuel<strong>le</strong> et<br />
excessive, des lésions osseuses que l’on appel<strong>le</strong><br />
enthésopathies peuvent se former aux points<br />
d’attache des tendons, des ligaments ou bien aux<br />
capsu<strong>le</strong>s articulaires. L’aplatissement de la diaphyse<br />
de certains os résulte éga<strong>le</strong>ment de la sollicitation<br />
excessive de certains musc<strong>le</strong>s. L’exercice fréquent<br />
de certaines activités physiques, comme<br />
la station assise ou accroupie, se traduit éga<strong>le</strong>ment<br />
par l’apparition de facettes articulaires caractéristiques.<br />
On explique <strong>le</strong>s surfaces articulaires<br />
supplémentaires à l’intersection entre <strong>le</strong>s reins et<br />
la hanche par la charge croissante des vertèbres<br />
lombaires. La maternité et l’habitude de porter<br />
<strong>le</strong>s enfants sur <strong>le</strong> dos ont <strong>le</strong> même effet sur l’articulation<br />
entre <strong>le</strong> sacrum et l’os iliaque, en bas du dos.<br />
La détermination des liens de parenté<br />
Dans une nécropo<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s regroupements de tombes<br />
sont souvent interprétés comme d’origine familia<strong>le</strong>.<br />
L’anthropologie peut, avec essentiel<strong>le</strong>ment deux<br />
méthodes, étayer ou contredire une tel<strong>le</strong> hypothèse.<br />
Les caractéristiques épigénétiques sont des divergences<br />
anatomiques minimes par rapport à la norme,<br />
dont l’origine héréditaire a une probabilité é<strong>le</strong>vée.<br />
Depuis peu d’années, <strong>le</strong>s méthodes de biologie<br />
moléculaire sont aussi utilisées. El<strong>le</strong>s se basent sur<br />
<strong>le</strong>s sections de l’ADN, dénommées short tandem<br />
repeats (STRs). El<strong>le</strong>s varient d’un individu à l’autre<br />
et sont transmissib<strong>le</strong>s par hérédité. Une seu<strong>le</strong> application<br />
archéologique peut être mentionnée pour<br />
notre période. El<strong>le</strong> concerne une tombe du site<br />
du Dürnberg (Autriche) contenant trois individus<br />
dont on a ainsi pu prouver la parenté.<br />
8 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />
La détermination de l'âge<br />
Avec <strong>le</strong>s méthodes utilisées à ce jour, l'âge peut être déterminé à dix ans près chez l’adulte.<br />
Pour des raisons évidentes, l'âge des enfants et des ado<strong>le</strong>scents peut être évalué avec bien<br />
plus de précision lorsqu’on dispose d’un sque<strong>le</strong>tte bien conservé.<br />
12<br />
12- Crâne présentant<br />
une trépanation.<br />
Site de Tisice, Prague<br />
(République tchèque),<br />
Musée national.<br />
La détermination des pathologies<br />
L’ostéo-archéologie n’identifie que <strong>le</strong>s maladies qui ont laissé des traces sur <strong>le</strong>s os. Les plus<br />
fréquentes sont <strong>le</strong>s altérations dégénératives qui affectent <strong>le</strong>s articulations. L’arthrose,<br />
qui touche la hanche, <strong>le</strong> genou, l’épau<strong>le</strong> et <strong>le</strong> coude, est aussi répandue qu’aujourd’hui.<br />
Pour la colonne vertébra<strong>le</strong>, on par<strong>le</strong> de spondylarthrite déformante qui peut conduire à la soudure<br />
des vertèbres entre el<strong>le</strong>s.<br />
Les maladies inflammatoires (ostéomyélite chronique, méningite, inflammation des sinus)<br />
sont plutôt rares, de même que <strong>le</strong>s tumeurs (compte tenu de la durée de vie relativement<br />
courte des individus de cette époque).<br />
Lésions poreuses, arrêts de croissance des os longs et dégradations de la dentition sont<br />
la conséquence de maladies et de carences dont <strong>le</strong>s sources sont variées : carence alimentaire,<br />
pertes chroniques de sang, sans oublier <strong>le</strong>s infections par des parasites (poux, vers…), un mal<br />
dont on souffrait beaucoup à l’âge du Fer.<br />
Il y a peu de traces de traitements médicaux. L’intervention chirurgica<strong>le</strong> la plus frappante est<br />
la trépanation, qui consiste à perforer complètement la calotte crânienne. Cette opération était<br />
réalisée pour des raisons médica<strong>le</strong>s (hémorragies, traumatismes…) et peut-être pour des<br />
motifs rituels. Le traitement des fractures par atè<strong>le</strong>s est moins spectaculaire.<br />
Des anneaux d’argi<strong>le</strong> ou de bronze trouvés dans la région du bassin, dans des tombes<br />
de femmes en âge de procréer, sont interprétés comme des diaphragmes, encore utilisés de<br />
nos jours dans plusieurs traitements gynécologiques.<br />
^
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 9<br />
Autopsie<br />
d’une sépulture de <strong>Bibracte</strong><br />
14 - La tombe de 2004<br />
en cours de fouil<strong>le</strong>.<br />
15 - Vue rapprochée<br />
sur l’urne de la tombe de 2004.<br />
14<br />
13<br />
Comment se dérou<strong>le</strong> l’étude d’une sépulture, de la fouil<strong>le</strong> aux analyses de laboratoire ? Suivons <strong>le</strong> cas d’une<br />
tombe « privilégiée » découverte de façon inattendue sur <strong>le</strong> site de <strong>Bibracte</strong> et qui s’est avérée contenir<br />
<strong>le</strong>s restes d’une femme adulte.<br />
En 2004, une esplanade parfaitement carrée de 8 m de côté délimitée par un étroit fossé, profond d’environ<br />
1 m, a été découverte en faisant des sondages pour comprendre <strong>le</strong> système de fortification, près de la Porte<br />
du Rebout. A chaque ang<strong>le</strong> de cet enclos, une petite excavation signa<strong>le</strong> l’emplacement d’un poteau disparu.<br />
Presqu’au centre, une autre fosse exiguë contenait l’urne funéraire, accompagnée d’un gobe<strong>le</strong>t à boire intact.<br />
Il s’agit d’une tombe à incinération comme <strong>le</strong>s quelques dizaines d’autres découvertes<br />
entre 1992 et 1994, à quelques centaines de mètres de là. La nouvel<strong>le</strong><br />
tombe a comme point commun avec ces dernières son enclos fossoyé, qui signa<strong>le</strong><br />
un «jardin funéraire» autrefois délimité par une palissade.<br />
El<strong>le</strong> s’en distingue par sa localisation inhabituel<strong>le</strong> à proximité immédiate<br />
d’une porte de la vil<strong>le</strong>, bien en vue à proximité d’une voie, par la tail<strong>le</strong> inhabituel<strong>le</strong><br />
de son enclos, par la présence d’une urne et par l’assemblage insolite des objets<br />
qui ont été retrouvés associés aux ossements de la défunte.<br />
La poursuite des sondages en 2005 a révélé que cette tombe n’était pas isolée :<br />
la terrasse artificiel<strong>le</strong> comporte au moins un autre enclos, dont l’exploration<br />
est prévue en 2006.<br />
13 - La nécropo<strong>le</strong> du col du Rebout, à proximité de l’oppidum de <strong>Bibracte</strong>.<br />
Fouil<strong>le</strong> de 1993.<br />
Le mobilier d’accompagnement<br />
Malgré un volume de sédiments réduit à une dizaine de litres, <strong>le</strong> contenu de l’urne et du gobe<strong>le</strong>t a livré<br />
des objets d’une étonnante diversité. Tout d’abord, des milliers d’esquil<strong>le</strong>s osseuses blanchies par<br />
<strong>le</strong>ur passage sur <strong>le</strong> bûcher dont la plus grande partie appartiennent au sque<strong>le</strong>tte de la défunte. Une soixantaine<br />
portent un élégant décor sculpté de feuillages, de personnages et d’animaux, de sty<strong>le</strong> gréco-romain.<br />
On identifie ces tab<strong>le</strong>ttes d’os décoré au placage d’une banquette, sur laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s riches Romains avaient<br />
l’habitude de s’allonger lors des repas.<br />
A part l’urne et un tesson de céramique peinte de fabrication loca<strong>le</strong>,<br />
la fosse a livré <strong>le</strong>s restes de plusieurs récipients en céramique d’origine<br />
méditerranéenne : un gobe<strong>le</strong>t à boire, un fragment d’amphore<br />
à vin, et <strong>le</strong>s restes très dégradés par <strong>le</strong> feu de cinq petites fio<strong>le</strong>s<br />
à onguents. Parmi <strong>le</strong>s nombreux restes organiques carbonisés,<br />
on note des noyaux de dattes, des pépins de figues, des coquil<strong>le</strong>s<br />
de noix et de noisettes. Ces vestiges d’offrandes comprennent<br />
donc des denrées exotiques et certainement coûteuses, car seu<strong>le</strong>s<br />
<strong>le</strong>s noisettes ont une origine loca<strong>le</strong>. On retrouve aussi du hêtre et<br />
de l’aulne qui appartiennent sans doute au combustib<strong>le</strong> du bûcher.<br />
On note encore de menus objets métalliques, notamment des clous.<br />
Les objets de parure en bronze ont pu, comme souvent, avoir fondu<br />
sur <strong>le</strong> bûcher. Aucun de ces objets ne permet de donner pour cette<br />
tombe une date plus précise que <strong>le</strong> Ier 15<br />
sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />
EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 9
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 10<br />
Les données anthropologiques<br />
L’urne fouillée en laboratoire a livré environ 1 200 g d’ossements<br />
humains, dont l’état montre qu’ils ont été exposés pour la plupart à une<br />
température d’au moins 800 °C. Quelques-uns, un peu moins brûlés,<br />
ont été retrouvés au fond de l’urne. Il s’agit sans doute de ceux qui ont été<br />
ramassés en premier en périphérie du bûcher. Les restes d’os décorés<br />
ont été trouvés dans toutes <strong>le</strong>s couches de l’urne ; ce qui contribue à<br />
<strong>le</strong>s identifier aux restes d’une banquette sur laquel<strong>le</strong> était déposé <strong>le</strong> corps.<br />
La col<strong>le</strong>cte des os a été assez soigneuse, puisque la crémation complète<br />
d’un corps humain adulte fournit environ 1700/1800 g d’os. Bien que<br />
la crémation déforme <strong>le</strong>s os, on peut affirmer qu’il s’agit d’un individu<br />
de grande tail<strong>le</strong> (environ 1,70 m), âgé entre 20 et 39 ans.<br />
Les caractéristiques du crâne désignent morphologiquement un individu<br />
de sexe féminin, mais la robustesse de la tête du fémur et du radius<br />
contredit ce résultat. Les insertions musculaires faib<strong>le</strong>ment imprimées<br />
désignent éga<strong>le</strong>ment une femme. Plusieurs indices pathologiques ont été<br />
mis en évidence : une perte de dents intra vitam, des parodontopathies<br />
et une sinusite maxillaire.<br />
Quelques fragments d’os crâniens appartiennent à deux autres adultes,<br />
plus âgés. Ce sont probab<strong>le</strong>ment des restes récoltés par inadvertance,<br />
ce qui est courant quand <strong>le</strong>s bûchers funéraires sont toujours installés<br />
au même emplacement. Plus ambiguë est la présence de quelques fragments,<br />
éga<strong>le</strong>ment exposés au feu, d’un fœtus ou d’un nouveau-né.<br />
L’interprétation des données<br />
Les informations provenant du terrain et des études de laboratoire,<br />
laissent imaginer une histoire plausib<strong>le</strong>, à défaut d’être certaine. Il s’agirait<br />
d’une femme de haut rang, vues la dimension inhabituel<strong>le</strong> de son enclos<br />
funéraire, la localisation de celui-ci bien en vue à une porte de la vil<strong>le</strong>,<br />
isolée des tombes plus modestes de la nécropo<strong>le</strong> du col du Rebout, ainsi<br />
que la qualité de son mobilier funéraire.<br />
Bien que de statut privilégié, cette femme a souffert de carences (perte<br />
de dents), et il est possib<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> soit décédée lors d’un accouchement,<br />
ce qui expliquerait la présence d’un nouveau-né à ses côtés.<br />
La présence d’une urne funéraire et l’exposition du corps sur<br />
une banquette, sont inhabituel<strong>le</strong>s dans ce contexte gaulois,<br />
alors que ce sont des caractéristiques bien connues<br />
pour <strong>le</strong>s tombes d’Italie centra<strong>le</strong> de la même époque.<br />
Ne pourrait-on donc pas imaginer que notre défunte<br />
ait été une bel<strong>le</strong> Romaine qui se serait mariée avec<br />
un nob<strong>le</strong> éduen ? Impossib<strong>le</strong> de l’affirmer, mais<br />
<strong>le</strong>s exemp<strong>le</strong>s sont nombreux à cette époque de<br />
femmes qui ont fondé un foyer à des centaines de kilomètres<br />
de <strong>le</strong>ur lieu de naissance.<br />
10 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />
17<br />
18<br />
16<br />
16- <strong>Bibracte</strong>, tombe de 2004.<br />
Fiche d’enregistrement des restes humains (W.R. Teegen).<br />
17- Le jardin funéraire de la tombe de 2004.<br />
18- Restitution d’un bûcher avec une banquette<br />
comparab<strong>le</strong> à cel<strong>le</strong> retrouvée dans la tombe<br />
de <strong>Bibracte</strong> servant de lit funéraire.<br />
D’après Witteyer, 2000
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 11<br />
Les âges de la vie<br />
A l’âge du Fer, la vie est dure pour tous, que l’on fasse partie de l’élite ou que l’on soit simp<strong>le</strong><br />
paysan. L’espérance de vie en témoigne : el<strong>le</strong> est d’à peine plus de 20 ans, alors qu’el<strong>le</strong><br />
est aujourd’hui d’environ 80 ans en Europe et de 35 ans dans <strong>le</strong> pire des cas<br />
(dans certains pays africains). L’espérance de vie des populations rura<strong>le</strong>s de<br />
l’Europe médiéva<strong>le</strong> n’était toutefois pas meil<strong>le</strong>ure qu’à l’âge du Fer.<br />
Dans une société où la répartition sexuel<strong>le</strong> des tâches de la vie quotidienne<br />
est très marquée, la femme a un rythme de vie très différent de celui de son mari,<br />
avec la responsabilité de la famil<strong>le</strong> et de la plupart des tâches domestiques. Cette dure<br />
existence explique que <strong>le</strong>s femmes mourraient plus jeunes que <strong>le</strong>s hommes, à l’inverse<br />
d’aujourd’hui : une femme ayant atteint l’âge adulte meurt en moyenne à 31 ans,<br />
contre 38 ans pour un homme. On note en effet une forte surmortalité entre 20 et 35 ans,<br />
liée aux accidents de grossesse et de l’accouchement.<br />
19 - Brace<strong>le</strong>t en fer avec amu<strong>le</strong>ttes,<br />
vers 180-150 avant J.-C.<br />
Nécropo<strong>le</strong> de Wederath (Rhénanie-Palatinat),<br />
tombe 1493 (F, 20-60 ans).<br />
Trèves (Al<strong>le</strong>magne), Rheinisches Landesmuseum.<br />
20 - Figurine d'oiseau et grelots en terre cuite,<br />
II e s. avant J.-C. / I er s. après J.-C.<br />
Nécropo<strong>le</strong>s d’Hoppstädten et Wederath (Rhénanie-<br />
Palatinat), tombe 3/1937.<br />
Trèves (Al<strong>le</strong>magne), Rheinisches Landesmuseum.<br />
21 - Amu<strong>le</strong>ttes en bronze, vers 150-120 avant J.C.<br />
Nécropo<strong>le</strong> de Wederath (Rhénanie-Palatinat)<br />
Tombe 1205.<br />
Trèves (Al<strong>le</strong>magne), Rheinisches Landesmuseum.<br />
21<br />
20<br />
La petite enfance et l’enfance<br />
La mortalité infanti<strong>le</strong> est très é<strong>le</strong>vée. Les très jeunes enfants ont donc un statut social<br />
spécifique. Ils ont rarement droit à une sépulture norma<strong>le</strong>. Souvent, <strong>le</strong>s restes des enfants<br />
morts-nés sont enfouis dans <strong>le</strong> sol même des habitations, ou relégués dans des poubel<strong>le</strong>s,<br />
quand ils ne sont pas enfouis avec <strong>le</strong> corps de <strong>le</strong>ur mère morte en couches. Les mêmes<br />
pratiques se retrouvent dans bien des sociétés traditionnel<strong>le</strong>s. A Rome par exemp<strong>le</strong>, selon une<br />
très vieil<strong>le</strong> loi, on n’incinère pas <strong>le</strong>s enfants morts s’ils n’ont pas eu <strong>le</strong>urs premières dents.<br />
Tout au long de l’enfance, l’individu reste très vulnérab<strong>le</strong> aux maladies et aux carences<br />
alimentaires, comme en témoignent <strong>le</strong>s ossements. Aussi, <strong>le</strong>s amu<strong>le</strong>ttes sont plus souvent<br />
retrouvées dans <strong>le</strong>s tombes d’enfants que dans cel<strong>le</strong>s d’adultes.<br />
Les grelots et <strong>le</strong>s figurines d’animaux en céramique sont <strong>le</strong>s seuls jouets bien attestés.<br />
La présence de vases miniatures dans <strong>le</strong>s tombes d’enfant est plus ambiguë, car on<br />
<strong>le</strong>s retrouve aussi dans des contextes religieux.<br />
Dans <strong>le</strong>s nécropo<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s tombes d’enfants sont souvent situées à l’écart des tombes<br />
d’adultes. Cependant, de nombreuses tombes d’enfants sont dotées d’un riche mobilier<br />
qui témoigne de <strong>le</strong>ur appartenance à des famil<strong>le</strong>s socia<strong>le</strong>ment é<strong>le</strong>vées.<br />
L’ado<strong>le</strong>scence<br />
L’ado<strong>le</strong>scence, en tant qu’âge de la maturité sexuel<strong>le</strong>, est une phase de transition.<br />
La puberté était sans doute plus tardive qu’à notre époque. Au XIX e sièc<strong>le</strong>, el<strong>le</strong> se situe<br />
encore à 16-17 ans en Europe, ce qui implique que <strong>le</strong>s jeunes femmes étaient rarement<br />
ferti<strong>le</strong>s avant 18 ans.<br />
Ce passage de l’enfance à l’âge adulte a aussi de multip<strong>le</strong>s significations dans une perspective<br />
socioculturel<strong>le</strong> : c’est un véritab<strong>le</strong> âge de passage. La fréquence des amu<strong>le</strong>ttes<br />
dans <strong>le</strong>s tombes d’ado<strong>le</strong>scentes renvoie au monde de l’enfance. La tenue vestimentaire,<br />
en revanche, est souvent cel<strong>le</strong> de femmes adultes, avec une panoplie complète de parures,<br />
comportant fibu<strong>le</strong>s, torques et brace<strong>le</strong>ts.<br />
Selon César, <strong>le</strong>s Gaulois admettent « en public <strong>le</strong>urs fils près d’eux seu<strong>le</strong>ment quand<br />
ils ont grandi, et qu’ils sont devenus par là-même capab<strong>le</strong>s de se battre ; il est vraiment<br />
considéré comme une honte qu’un fils non encore adulte se montre, même une fois,<br />
publiquement à côté de son père ». De la même manière, on peut supposer que <strong>le</strong>s très<br />
jeunes fil<strong>le</strong>s ne se montraient pas en public avec <strong>le</strong>ur mère.<br />
EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 11<br />
19
TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 12<br />
23<br />
22- Coiffures féminines<br />
D’après des décors de vaissel<strong>le</strong> métallique<br />
du sud-est des Alpes.<br />
V e sièc<strong>le</strong> avant J.-C. (d’après O.H. Frey).<br />
23- Reconstitution de parures féminines<br />
des régions rhénanes avec anneaux de tempes.<br />
Propres aux régions du Rhin moyen,<br />
ces anneaux circulaires semb<strong>le</strong>nt réservés<br />
aux femmes mariées.<br />
V e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />
(d’après R. Cordie-Hackenberg 1992).<br />
24 / 25- Reconstitution de la tombe 14 de Goeblingen-Nospelt.<br />
(Luxembourg) (dessin B. Claris).<br />
26- Une tombe féminine.<br />
Cette sépulture de femme adulte était inhumée allongée sur <strong>le</strong> dos, avec des restes d’offrandes alimentaires sur son côté droit (ossements<br />
animaux, un vase, deux grandes écuel<strong>le</strong>s, un gobe<strong>le</strong>t, un couteau en fer). De sa tenue vestimentaire, sont conservés un torque à décor torsadé,<br />
une paire de brace<strong>le</strong>ts, deux petits tubes et quatre anneaux de ceinture en bronze. Sa tail<strong>le</strong> est estimée à 165 cm. La présence d’un torque<br />
signa<strong>le</strong> une femme de rang é<strong>le</strong>vé.<br />
Vers 400 - 350 avant J.-C. Bucy-<strong>le</strong>-Long, «La Héronnière» (Picardie), tombe BLH 330. Soissons (France), Musée municipal.<br />
12 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />
L’âge du mariage<br />
A Rome, <strong>le</strong>s garçons peuvent se marier à partir de 14 ans et <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s à partir de 12 ans, soit bien avant<br />
de pouvoir procréer. On ignore ce qu’il en est dans <strong>le</strong> monde celtique. Si l’on se fie à César, chez <strong>le</strong>s Germains,<br />
«c’est une des hontes <strong>le</strong>s plus grandes parmi eux que de connaître la femme avant l’âge de vingt ans».<br />
Il dit aussi que <strong>le</strong>ur roi Arioviste a deux femmes. Une tel<strong>le</strong> polygamie n’est pas attestée en Gau<strong>le</strong>.<br />
César précise <strong>le</strong>s droits et devoirs des époux gaulois: «Les maris mettent en communauté, avec la somme<br />
d’argent qu’ils reçoivent en dot de <strong>le</strong>urs femmes, une part de <strong>le</strong>urs biens éga<strong>le</strong> à cette dot. On fait de<br />
ce capital un compte joint, et l’on en réserve <strong>le</strong>s intérêts ; celui des deux époux qui survit à l’autre reçoit<br />
la part des deux avec <strong>le</strong>s intérêts accumulés. Les maris ont droit de vie et de mort sur <strong>le</strong>urs femmes comme<br />
sur <strong>le</strong>urs enfants. Lorsqu’un père d’illustre naissance vient à mourir, ses proches s’assemb<strong>le</strong>nt et, si cette<br />
mort fait naître quelque soupçon, <strong>le</strong>s femmes sont mises à la question comme des esclaves ; si <strong>le</strong> crime<br />
est prouvé, el<strong>le</strong>s sont livrées au feu et aux plus cruels tourments et supplices.»<br />
Il semb<strong>le</strong> donc que, si la femme est soumise à son mari, el<strong>le</strong> a des droits identiques à lui en ce qui concerne<br />
<strong>le</strong> patrimoine de la famil<strong>le</strong>. De tels droits tomberont en désuétude pour ne resurgir qu’au XIX e sièc<strong>le</strong>.<br />
24 25<br />
La veil<strong>le</strong>sse et la mort<br />
Une femme qui a passé <strong>le</strong> cap des 40 ans, a toutes <strong>le</strong>s chances de vivre plus âgée que son mari.<br />
On ne sait pas si <strong>le</strong>s femmes âgées et <strong>le</strong>s veuves étaient dotées d’un statut spécial. Les restes<br />
de <strong>le</strong>ur tenue vestimentaire ne montrent pas de différence nette avec ceux des femmes plus jeunes.<br />
Au cours de l’âge du Fer, <strong>le</strong>s rites de l’inhumation et de l’incinération varient suivant <strong>le</strong>s périodes<br />
et <strong>le</strong>s régions. Aux VI e et V e sièc<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s tombes sont souvent disposées autour d’une tombe privilégiée<br />
signalée par une architecture monumenta<strong>le</strong> ou la richesse de son mobilier (Bucy-<strong>le</strong>-Long).<br />
Exceptionnel<strong>le</strong>ment, des zones particulières sont destinées aux enfants, aux femmes et aux<br />
hommes (Andelfingen). Parfois, <strong>le</strong>s regroupements paraissent familiaux (Nebringen), chaque<br />
groupe pouvant être isolé dans un enclos. Enfin, certaines nécropo<strong>le</strong>s ont une organisation spatia<strong>le</strong><br />
qui ne s’explique que par <strong>le</strong>ur développement au cours des années (Münsingen).<br />
Le culte des morts se manifeste par l’entretetien des sépultures. La tombe à tumulus 14 de la nécropo<strong>le</strong><br />
de Gœblingen-Nospelt est unique. Datée vers 20 avant J.-C., el<strong>le</strong> contenait <strong>le</strong>s restes<br />
d’une femme de 30 à 35 ans, et de riches présents. Des vestiges de libations et de sacrifices d’animaux,<br />
et des pièces de monnaie, retrouvés sur <strong>le</strong> sommet du tumulus, prouvent sa fréquentation pendant<br />
environ 150 ans. Une autre forme de culte des morts, bien différente, est attestée par <strong>le</strong>s amu<strong>le</strong>ttes<br />
taillées dans un fragment de calotte crânienne.<br />
22<br />
26
TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 13<br />
La femme dans tous ses états<br />
La femme celte apparaît sous des jours différents selon l'activité dans laquel<strong>le</strong> on la saisit : ménagère occupée du <strong>le</strong>ver au coucher du so<strong>le</strong>il par<br />
ses tâches quotidiennes ou femme de haut rang qui doit contribuer au prestige de son mari ou de sa famil<strong>le</strong>, par sa prestance et la qualité de sa tenue<br />
vestimentaire, lors des événements de la vie publique.<br />
Les tâches de la vie quotidienne qui nous paraissent anodines aujourd'hui (préparer <strong>le</strong> repas, col<strong>le</strong>cter son bois de chauffage…) l'occupent à p<strong>le</strong>in<br />
temps. Les quelques heures qu'el<strong>le</strong> épargne sur ces activités domestiques sont mises à profit pour d'autres travaux, notamment <strong>le</strong> filage et <strong>le</strong> tissage,<br />
une activité artisana<strong>le</strong> qui lui permet, plus que tout autre, d'exercer sa créativité et ses ta<strong>le</strong>nts artistiques.<br />
Seul <strong>le</strong> mariage donne à la femme sa place dans la société. Il permet des alliances familia<strong>le</strong>s et politiques dont el<strong>le</strong> est l'enjeu, notamment pour <strong>le</strong>s<br />
famil<strong>le</strong>s nob<strong>le</strong>s. Comme dans toutes <strong>le</strong>s sociétés rura<strong>le</strong>s traditionnel<strong>le</strong>s, la femme celte révè<strong>le</strong> son statut et celui de sa famil<strong>le</strong> par ses atours : coiffure,<br />
maquillage et tatouages (?), vêtements, parures.<br />
Les textes et inscriptions n'ont gardé la mémoire d'aucun rô<strong>le</strong> public réservé aux femmes. En revanche, <strong>le</strong>s cultes proprement féminins et <strong>le</strong>s divinités<br />
féminines ont longtemps perduré, permettant d'apprécier <strong>le</strong>ur importance dans la société celtique.<br />
La femme au foyer<br />
Le travail à la maison et à la cuisine est considérab<strong>le</strong> du point de vue du temps passé et<br />
de l'énergie déployée. L’environnement quotidien de la femme celte est donc la pièce (généra<strong>le</strong>ment<br />
unique) de sa maison où trône en position centra<strong>le</strong> <strong>le</strong> foyer sur <strong>le</strong>quel est suspendu<br />
un chaudron de cuivre. Sans tab<strong>le</strong> haute ni chaise à portée de main, la ménagère travail<strong>le</strong><br />
en général en position accroupie, comme <strong>le</strong> prouve l'étude des restes osseux.<br />
La mouture des céréa<strong>le</strong>s, à el<strong>le</strong> seu<strong>le</strong>, l’occupe plusieurs heures par jour, tout comme<br />
la col<strong>le</strong>cte de bois pour <strong>le</strong> feu, <strong>le</strong> tout en ayant constamment l’œil sur ses plus jeunes<br />
rejetons. Ces tâches sont partagées avec <strong>le</strong>s grands-parents et <strong>le</strong>s enfants, puisqu'un toit<br />
abrite trois générations.<br />
La nourriture est surtout constituée de<br />
bouillies de céréa<strong>le</strong>s et de légumineuses<br />
riches en protéines comme <strong>le</strong>s fèves,<br />
<strong>le</strong>s petits pois et <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ntil<strong>le</strong>s. Le pain n’est<br />
pas si fréquent et <strong>le</strong>s édulcorants (miel)<br />
réservés aux grandes occasions. La pâtisserie<br />
est connue par des offrandes funéraires.<br />
Aucune espèce fruitière n'est encore<br />
cultivée à l’âge du Fer. A ceux col<strong>le</strong>ctés<br />
dans la nature, s’ajoutent tardivement des<br />
fruits exotiques. On sait très peu de choses<br />
sur <strong>le</strong>s légumes. En tout cas, la rareté des<br />
cas de scorbut prouve un apport suffisant<br />
en vitamine C.<br />
Les pertes de dents, plus fréquentes chez <strong>le</strong>s<br />
hommes à Wederath, suggèrent une nourriture<br />
particulièrement cariogène, c'est-à-dire<br />
riche en hydrates de carbone.<br />
La proportion des différents isotopes stab<strong>le</strong>s du<br />
carbone ( 13 C/ 12 C) et de l'azote ( 15 N/ 14 N) dans <strong>le</strong><br />
collagène osseux renseigne aussi sur l'alimentation.<br />
Une teneur accrue en 15 N, qui indique une<br />
forte consommation de viande, est ainsi notée<br />
dans <strong>le</strong>s os des sque<strong>le</strong>ttes masculins des tombes<br />
privilégiées avec armes des nécropo<strong>le</strong>s tchèques<br />
de Kutná Hora-Karlov et Radovesice.<br />
La viande est presque exclusivement fournie<br />
par <strong>le</strong>s animaux domestiques : bœuf,<br />
porc et mouton surtout, cheval et chien<br />
plus rarement. Le lait est aussi important<br />
dans l'alimentation. L'hydromel et la bière<br />
sont <strong>le</strong>s deux boissons alcoolisées fabriquées<br />
sur place. S’y ajoute <strong>le</strong> vin, importé<br />
en grande quantité du monde méditerranéen,<br />
mais réservé aux grandes occasions<br />
et à l’élite.<br />
EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 13
TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 14<br />
La femme au travail<br />
La division sexuel<strong>le</strong> du travail<br />
est attestée par l'archéologie<br />
funéraire. Le peu d’outillage<br />
retrouvé dans <strong>le</strong>s tombes féminines<br />
se limite au travail des texti<strong>le</strong>s<br />
et du cuir. De fait, <strong>le</strong> filage de<br />
la laine, <strong>le</strong> tissage et la confection<br />
des vêtements se font dans <strong>le</strong> cadre<br />
domestique, car ces activités demandent peu de place et se<br />
concilient faci<strong>le</strong>ment avec <strong>le</strong>s tâches ménagères. Sur <strong>le</strong>s sque<strong>le</strong>ttes<br />
féminins, l’arthrose des articulations de la main peut être<br />
associée au tissage. A l'instar de la Grecque Pénélope, cette<br />
activité concerne éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s femmes de rang é<strong>le</strong>vé, comme<br />
<strong>le</strong> montrent quelques scènes figurées.<br />
La femme est aussi très sollicitée par <strong>le</strong>s travaux du jardin et<br />
des champs. Tant pour <strong>le</strong>s femmes que pour <strong>le</strong>s hommes, <strong>le</strong>s<br />
articulations des hanches et des épau<strong>le</strong>s présentent des symptômes<br />
typiques des populations à orientation agraire.<br />
Dans <strong>le</strong> contexte particulier des mines de sel de Hallstatt,<br />
<strong>le</strong>s études anthropologiques montrent une nette différenciation<br />
sexuel<strong>le</strong> du travail. Les hommes assurent l'extraction du sel, <strong>le</strong>s<br />
femmes <strong>le</strong> transportent jusqu'à la surface. Ces corvées sont<br />
somme toute peu différentes de cel<strong>le</strong>s que<br />
toute femme celte effectue quotidiennement<br />
: approvisionner <strong>le</strong> foyer en eau et<br />
en combustib<strong>le</strong>, porter <strong>le</strong>s jeunes enfants.<br />
La façon de porter une charge se manifeste<br />
par des marques caractéristiques sur<br />
<strong>le</strong>s vertèbres lombaires (pour <strong>le</strong> port à<br />
bras <strong>le</strong> corps) et cervica<strong>le</strong>s (pour <strong>le</strong> port<br />
sur la tête).<br />
28<br />
La femme en société<br />
La société celtique est essentiel<strong>le</strong>ment<br />
agraire, même lorsque se développent<br />
des bourgades de marché et des vil<strong>le</strong>s<br />
fortifiées (oppida), à partir du III e sièc<strong>le</strong><br />
avant J.-C. Dans ce contexte, l'unité<br />
familia<strong>le</strong> est marquée par <strong>le</strong> patriarcat.<br />
Chaque membre de la famil<strong>le</strong> occupe une<br />
position particulière, réglée par de nombreuses<br />
conventions. La tenue vestimentaire<br />
manifeste la position de chacun<br />
et de chacune.<br />
14 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />
Les restes de la tenue vestimentaire, très<br />
variab<strong>le</strong>s pour ce qui concerne <strong>le</strong>s sépultures<br />
féminines, donnent donc des indications<br />
précieuses sur <strong>le</strong> statut social. Tout en<br />
haut de l'échel<strong>le</strong>, on trouve des sépultures<br />
véritab<strong>le</strong>ment princières, comme cel<strong>le</strong>s<br />
de Vix, de Rheinheim ou de Waldalgesheim.<br />
A un niveau moindre, la nécropo<strong>le</strong> de<br />
Münsingen montre bien la diversité des<br />
statuts. Sur 219 tombes, on peut bâtir<br />
<strong>le</strong> schéma suivant :<br />
26<br />
29<br />
26- Aiguil<strong>le</strong>s à coudre en bronze, II e / I er s. avant J.-C.<br />
Oppidum de Stradonice, Prague (République tchèque), Musée national.<br />
L. 46-106 mm.<br />
27- Pesons de métier à tisser de <strong>Mo</strong>d<strong>le</strong>sovice, III e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />
Strakonice (République tchèque), Musée de la région d’Otava.<br />
27<br />
28 et 29- Fragment d’étoffe brodé de fils de laine, III e s. avant J.-C<br />
et restitution.<br />
Des fils rouge neufs ont été replacés à l'emplacement des anciens,<br />
généra<strong>le</strong>ment disparus. On a restitué en fac-similé l'aspect d'origine de<br />
l'étoffe. Ces fragments de vêtements de très bonne facture ont été<br />
miracu<strong>le</strong>usement conservés par <strong>le</strong>ur utilisation comme renforts dans des<br />
brace<strong>le</strong>ts creux en tô<strong>le</strong> de bronze. A une époque où <strong>le</strong>s autres artisanats<br />
sont déjà fortement organisés et installés dans des espaces<br />
qui <strong>le</strong>ur sont réservés, hors du cadre domestique, ces rares témoignages<br />
d'étoffes finement tissées et brodées sont <strong>le</strong> seul exemp<strong>le</strong> vraiment<br />
probant de la qualité du travail féminin à l'âge du Fer.<br />
Nové Zàmky, longueur 30 cm. Nitra, Slovaquie, Institut d’archéologie.<br />
- 3 % de tombes richement dotées ;<br />
- 20 % de tombes moyennement dotées ;<br />
- 42 % de tombes pauvrement dotées ;<br />
- 35 % de tombes non dotées.<br />
Se dessine ainsi une pyramide socia<strong>le</strong>.<br />
En haut se trouve l'élite. A l'échel<strong>le</strong> intermédiaire<br />
se trouvent <strong>le</strong>s hommes portant<br />
<strong>le</strong>s armes et <strong>le</strong>urs épouses. Enfin, l’échelon<br />
inférieur regroupe près de 80 % de<br />
la population.
TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 15<br />
Les vêtements et la coiffure<br />
Les écrivains grecs évoquent <strong>le</strong> goût des Gaulois pour <strong>le</strong>s étoffes colorées.<br />
Les pièces de monnaie et <strong>le</strong> décor de certains vases à boisson présentent des<br />
personnages dotés d'une coiffure comp<strong>le</strong>xe, en chignon ou en tresses, parfois<br />
maintenue par une résil<strong>le</strong>.<br />
De tout cela, il reste très peu de témoignages matériels. Les éping<strong>le</strong>s à<br />
cheveux sont très rares. Les fibu<strong>le</strong>s de petite tail<strong>le</strong>, portées en paire sur<br />
<strong>le</strong>s épau<strong>le</strong>s, tiennent un vêtement en étoffe légère. Les fibu<strong>le</strong>s retrouvées<br />
sur <strong>le</strong> thorax sont souvent plus grosses et maintiennent une<br />
sorte de manteau à capuchon, porté par <strong>le</strong>s femmes et <strong>le</strong>s hommes.<br />
Des nécessaires de toi<strong>le</strong>tte<br />
témoignent aussi des soins corporels, qu’il<br />
s'agisse des pinces à épi<strong>le</strong>r et des rasoirs<br />
pour <strong>le</strong>s hommes et des miroirs pour <strong>le</strong>s<br />
femmes.<br />
Les texti<strong>le</strong>s, conservés à l’état de menus<br />
fragments, montrent une grande variété<br />
d’étoffes et de décors, obtenus par <strong>le</strong> tissage,<br />
la teinture et la broderie. Bien qu'issus de<br />
zones géographiques situés en marge du<br />
domaine celtique, <strong>le</strong>s corps sacrifiés de l'âge<br />
du Fer retrouvés dans <strong>le</strong>s tourbières de l’Eu-<br />
31 rope du Nord (Grande-Bretagne et Danemark)<br />
donnent un aperçu de ce que pouvait être <strong>le</strong>ur apparence physique.<br />
Aux coiffures comp<strong>le</strong>xes et aux tatouages, s'ajoutent des chaussures de cuir et<br />
différentes pièces de vêtement dont <strong>le</strong>s réparations nombreuses rappel<strong>le</strong>nt<br />
<strong>le</strong> prix de ces tissus portés à vie ou du moins jusqu'à <strong>le</strong>ur usure<br />
tota<strong>le</strong>.<br />
31- Fac-similés de vêtements de l’âge du Fer d’après des découvertes de tourbières : jupe<br />
longue, tunique, cape et ceinture.<br />
Tissages de M.-P. Puybaret, 2006.<br />
33- Per<strong>le</strong>s en verre.<br />
Oppidum de Stradonice,<br />
I er sièc<strong>le</strong> avant J.-C.,<br />
Prague(République tchèque),<br />
Musée national.<br />
34 - Brace<strong>le</strong>t en bronze à décor<br />
de corail, vers 300 avant J.-C.<br />
Sie de Chotin, tombe 19.<br />
Komarno (République tchèque),<br />
Musée de la culture hongroise.<br />
,<br />
,<br />
33<br />
34<br />
30<br />
30- Ensemb<strong>le</strong> funéraire de la fin du III e s. avant J.-C. comprenant<br />
<strong>le</strong>s restes d’une ceinture et de trois fibu<strong>le</strong>s.<br />
Wederath (Rhénanie, Palatinat), tombe 1416, Trèves (Al<strong>le</strong>magne),<br />
Rheinissches Landmuseum.<br />
32- Eping<strong>le</strong> à cheveux et autres parures, vers 300 avant J.-C.<br />
Cet ensemb<strong>le</strong> provient de deux sépultures féminines contiguës<br />
et associées au sein d'un même enclos funéraire. Il comprend<br />
un rare exemp<strong>le</strong> d'éping<strong>le</strong> à cheveux, ornée d'un motif dérivé<br />
du sty<strong>le</strong> végétal continu, ainsi qu'une fibu<strong>le</strong> de facture identique.<br />
La Saulsotte (Aube) « Ferme de Frécul », Nogent-sur-Seine (France),<br />
Musée P. Dubois - A. Boucher<br />
La parure dans tous ses états<br />
Du VI e au I er sièc<strong>le</strong> avant J.-C., <strong>le</strong>s parures ont connu une grande variété de<br />
forme, de matériau et de décor. El<strong>le</strong>s témoignent de la virtuosité des artisans.<br />
D’après des textes et représentations figurées grecs et romains,<br />
la parure n’est pas réservée qu’aux femmes.<br />
La découverte de métaux précieux, or et argent, est peu fréquente.<br />
Le cuivre et ses alliages, comme <strong>le</strong> bronze coulé ou martelé, ou <strong>le</strong> laiton plus<br />
faci<strong>le</strong> à forger, imitent la cou<strong>le</strong>ur du métal nob<strong>le</strong>, avec parfois des incrustations<br />
rouge de corail ou d'émail. Les anneaux à oves creux et autres parures<br />
de sty<strong>le</strong> «plastique» du III e sièc<strong>le</strong> représentent<br />
des sommets de l'orfèvrerie celte. Le fer,<br />
matériau considéré comme vulgaire<br />
aujourd'hui, fait l'objet d'un travail<br />
très fin qui montre qu'on <strong>le</strong> tient alors<br />
en haute estime.<br />
Au III e sièc<strong>le</strong>, l'emploi du verre,<br />
jusqu'alors réservé à de petites per<strong>le</strong>s<br />
de colliers, se généralise. Importé<br />
du monde méditerranéen, il est fondu par<br />
EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 15<br />
32
TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 16<br />
<strong>le</strong>s artisans celtes et mélangé à différents<br />
oxydes métalliques pour fabriquer des brace<strong>le</strong>ts<br />
et per<strong>le</strong>s aux cou<strong>le</strong>urs chatoyantes<br />
et au décor comp<strong>le</strong>xe.<br />
Les matières organiques fossi<strong>le</strong>s (ambre,<br />
lignite, sapropélite, jais) sont aussi utilisées<br />
pour <strong>le</strong>s per<strong>le</strong>s et brace<strong>le</strong>ts. Ces parures<br />
portées par <strong>le</strong>s deux sexes peuvent disposer<br />
d'un sens symbolique ou de vertus apotropaïques,<br />
comme c'est encore <strong>le</strong> cas aujourd'hui<br />
pour l'ambre et <strong>le</strong> corail, par exemp<strong>le</strong>.<br />
35 - Brace<strong>le</strong>ts en verre<br />
de la nécropo<strong>le</strong> de Münsingen,<br />
III e-II e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />
Berne (Suisse), Musée historique.<br />
Femme et pouvoir<br />
Comment mesurer <strong>le</strong> pouvoir dont a disposé<br />
une femme dont la tombe est aussi prestigieuse<br />
que cel<strong>le</strong> de la princesse de Vix ?<br />
A-t-el<strong>le</strong> régné ou s’est-el<strong>le</strong> contentée d’afficher,<br />
par son train de vie et son apparence<br />
fastueuse, <strong>le</strong> prestige de sa famil<strong>le</strong> ou de son<br />
époux ? Quoi qu'il en soit, des femmes ont<br />
disposé de conditions de vie privilégiées que<br />
signa<strong>le</strong>nt différents indices anthropologiques,<br />
comme la grande tail<strong>le</strong> du sque<strong>le</strong>tte<br />
ou une plus longue durée de vie.<br />
Les textes antiques mentionnent peu de<br />
femmes celtes qui ont exercé <strong>le</strong> pouvoir et,<br />
quand c'est <strong>le</strong> cas, toujours dans des circonstances<br />
exceptionnel<strong>le</strong>s. César explique en<br />
revanche que la femme est un enjeu diplomatique.<br />
Ainsi, <strong>le</strong> chef éduen Dumnorix<br />
s’est marié avec la fil<strong>le</strong> de l’Helvète Orgétorix<br />
et a remarié sa mère à un nob<strong>le</strong> biturige.<br />
La femme peut être un otage de luxe, selon<br />
un usage que l'on retrouve parmi <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s<br />
régnantes de l'Europe moderne.<br />
Il y a diverses façons d'identifier ces pratiques<br />
d'exogamie. Quand une femme fonde<br />
un foyer loin de son lieu de naissance,<br />
35<br />
16 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />
36 - Collier de pâte de verre, Ve s. avant J.-C., site de Lipa<br />
Hradec Kralove (République tchèque),<br />
Musée de la Bohême orienta<strong>le</strong>.<br />
36<br />
, ,<br />
el<strong>le</strong><br />
garde,<br />
au moins en<br />
partie, la tenue vesti- 38<br />
mentaire de sa région. Un<br />
torque, une agrafe de ceinture<br />
ou une fibu<strong>le</strong> retrouvés dans une<br />
tombe loin de <strong>le</strong>ur zone habituel<strong>le</strong><br />
de distribution peuvent signa<strong>le</strong>r une<br />
femme de lointaine origine.<br />
On vient de proposer <strong>le</strong> dosage du strontium<br />
fixé par l'émail dentaire. Le rapport<br />
87 Sr/ 86 Sr varie fortement dans l'eau potab<strong>le</strong><br />
selon la nature du sous-sol. Appliquée à la<br />
nécropo<strong>le</strong> de Dornach (D), située dans une<br />
région calcaire, cette méthode d'analyse<br />
montre que deux guerriers et une jeune<br />
femme sont venus au tournant du IV e -<br />
III e s. avant J.-C. de régions granitiques,<br />
peut-être de Bohême.<br />
,<br />
37- Torque en bronze de Champagne, vers 300 avant J.-C.<br />
Autun (France), Musée Rolin.<br />
38 -Fibu<strong>le</strong>, vers 300/250 avant J.-C.<br />
Ega<strong>le</strong>ment retrouvée en Bohême,<br />
cette fibu<strong>le</strong> est caractéristique<br />
des régions alpines.<br />
Kutná Hora – Karlov, tombe 26<br />
Kutná Hora (CZ), Musée tchèque de l’Argent.<br />
^<br />
^<br />
39 - Torque à pastil<strong>le</strong>s d'émail rouge, vers 300 avant J.-C.<br />
Retrouvé en Bohême, ce torque appartient<br />
à un type que l’on trouve très rarement en dehors<br />
de Suisse occidenta<strong>le</strong>.<br />
Prague - Zizkov<br />
Prague (CZ), Musée national.<br />
39<br />
37
TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 17<br />
La femme protectrice<br />
La place de la femme dans la religion est un des domaines <strong>le</strong>s plus délicats à aborder. Les auteurs de l’Antiquité signa<strong>le</strong>nt<br />
l’existence de prêtresses, de prophétesses et de femmes douées d’un pouvoir de divination, dans des régions périphériques<br />
du monde celtique. Ainsi, selon César, dans ces régions, <strong>le</strong>s femmes consultent <strong>le</strong> sort pour savoir si <strong>le</strong> moment de<br />
combattre est venu. Pour Tacite, Velléda est une prophétesse douée d’un grand prestige. La reine bretonne Boudicca<br />
consulte <strong>le</strong>s orac<strong>le</strong>s en observant la course d’un lièvre.<br />
Ces témoignages, assez vagues, ne permettent pas d’affirmer qu’il a existé un c<strong>le</strong>rgé féminin aussi important que celui<br />
des druides, dont <strong>le</strong>s membres ne sont recrutés que parmi <strong>le</strong>s hommes, au terme d’une longue initiation.<br />
L’archéologie suggère qu’il a existé des rites spécifiquement féminins et l’importance des déesses dans <strong>le</strong> panthéon<br />
gallo-romain laisse supposer qu’il en est de même à la fin de l’âge du Fer.<br />
Des cultes au féminin ?<br />
L’archéologie religieuse des Celtes a fait un bond en avant considérab<strong>le</strong> avec l’identification<br />
et la fouil<strong>le</strong> de nombreux sanctuaires, depuis trente ans. Sous la forme d’un enclos quadrangulaire<br />
renfermant une ou plusieurs chapel<strong>le</strong>s, il s’agit <strong>le</strong> plus souvent de sanctuaires à la<br />
vocation guerrière bien affirmée par la présence d’armes, voire de dépouil<strong>le</strong>s de guerriers.<br />
La découverte de Duchcov, en Bohême, est un exemp<strong>le</strong> non controversé de la participation<br />
des femmes à la vie religieuse, sous la forme d’activités rituel<strong>le</strong>s. Des milliers de fibu<strong>le</strong>s,<br />
de brace<strong>le</strong>ts et de bagues, typiques de la tenue féminine, ont été déposés dans un chaudron de<br />
bronze et conservés à quelques mètres de profondeur dans une source therma<strong>le</strong>.<br />
Cette découverte unique doit être mise en parallè<strong>le</strong> avec cel<strong>le</strong>s, plus fréquentes, de traces d’un<br />
culte gallo-romain près des sources. Les sources de la Seine – où était vénérée la déesse éponyme<br />
Séquana – ont livré des centaines de statues grossières de pierre et de bois et des représentations<br />
anatomiques qui témoignent d’un culte populaire à cette déesse aquatique dont on<br />
espérait qu’el<strong>le</strong> apporterait la guérison.<br />
41<br />
40- Personnage féminin (?) vêtu<br />
d’un manteau à capuchon, bois<br />
(copie), I er sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />
Sources de la Seine.<br />
Dijon (France),<br />
Musée archéologique<br />
H. 86 cm.<br />
Des déesses<br />
De la même façon que <strong>le</strong>s Romains ont identifié <strong>le</strong>urs dieux ancestraux<br />
à ceux des Grecs, la Gau<strong>le</strong> romaine s’est enrichie des croyances<br />
et des cultes locaux. Cette fusion partiel<strong>le</strong> permet d’identifier, grâce aux<br />
inscriptions et aux statues d’époque romaine, un certain nombre de divinités<br />
d’origine gauloise.<br />
Alors que César ne mentionne qu’une déesse gauloise, qu’il assimi<strong>le</strong> à Minerve,<br />
patronne des arts et des techniques, il existe un grand nombre de divinités galloromaines<br />
féminines. El<strong>le</strong>s peuvent être réparties en plusieurs groupes :<br />
◗ <strong>le</strong>s divinités guerrières (rares), comme Bodua (« la Victorieuse »)<br />
chez <strong>le</strong>s Eduens, Segeta (« Puissance »), Cathubodua (« Corneil<strong>le</strong> du combat »),<br />
Vercanae (déesses Colère);<br />
◗ <strong>le</strong>s déesses appartenant à un coup<strong>le</strong> : Rosmerta (« la Grande Pourvoyeuse »),<br />
déesse de prospérité associée à Mercure, Sirona avec Apollon Grannus, Nemetona<br />
avec Mars Loucetius, Damona avec Borvo, Bergusia avec Ucuetis…<br />
41 - Déesse-mère, appuyée sur un buste de dieu masculin portant un torque, calcaire, début du I er sièc<strong>le</strong> après J.-C. (?).<br />
Auxerre (France), faubourg Saint-Martin, Musée d'Art et d’Histoire. H. 36 cm.<br />
EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 17<br />
40
TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 18<br />
44<br />
Des déesses (suite)<br />
◗ <strong>le</strong>s déesses reines : Riganae, qui trônent et sont dépourvues d’attributs maternels :<br />
Anextlomara (« la Grande Protectrice »), <strong>Mo</strong>gontia (« la Grande ») et surtout Epona<br />
(« la Cavalière »), très populaire à l’époque gallo-romaine ;<br />
◗ <strong>le</strong>s déesses mères : Matres, Matronae, divinités protectrices souvent associées à<br />
un lieu, comme <strong>le</strong>s Matres Treverae (« <strong>le</strong>s Mères de Trèves »), et qui peuvent prendre<br />
la forme de Vénus, de la Fortune ou de l’Abondance ;<br />
◗ <strong>le</strong>s déités topiques ou tutélaires, bien plus nombreuses que <strong>le</strong>s déités topiques masculines,<br />
qui sont associées aux cours d’eau (Sequana, la Seine, Souconna, la Saône,<br />
Icauna, l’Yonne), aux sources (Sequana), aux montagnes, aux vil<strong>le</strong>s (<strong>Bibracte</strong>, Aventia).<br />
18 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />
43<br />
Ces statuettes trouvaient <strong>le</strong>ur place<br />
sur <strong>le</strong>s autels domestiques<br />
des famil<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s plus modestes.<br />
Le culte rendu dans <strong>le</strong> cadre familial<br />
privilégiait <strong>le</strong>s divinités nourricières<br />
et protectrices, ce qui explique<br />
la sur-représentation écrasante<br />
(20 contre 1) des divinités féminines.<br />
42 - Statue de déesse-mère, calcaire oolithique, I er-III e s. après J.-C. Oppidum d'Alésia, Alise-Sainte-Reine,<br />
Musée Alésia. H. 49 cm.<br />
43 - Triade de déesses-mères, calcaire oolithique, I er-III e s. après J.-C.<br />
Oppidum de Vertault. Châtillon-sur-Seine (France), Musée du Châtillonnais. H. 39 cm.<br />
Une image plus précise<br />
de la femme celte ?<br />
En conclusion, nous constatons que c’est seu<strong>le</strong>ment en unissant archéologie et<br />
anthropologie, avec <strong>le</strong>s autres sciences naturel<strong>le</strong>s, que l'on peut dessiner une image<br />
plus réaliste de la femme celte.<br />
Bien que de nombreuses découvertes aient été apportées dans <strong>le</strong> cadre de cette<br />
exposition, nous savons encore peu de choses sur ces femmes. Il est nécessaire de<br />
poursuivre <strong>le</strong>s recherches. Le souhait de la présente exposition est d’y inciter.<br />
44 - Statère des Riedones.<br />
Les représentations clairement féminines apparaissent très rarement sur <strong>le</strong>s monnaies celtiques. Le meil<strong>le</strong>ur exemp<strong>le</strong> est<br />
constitué par plusieurs séries de monnaies d'or frappées dans l'ouest de la France à date haute (fin du III e sièc<strong>le</strong> / début<br />
du II e sièc<strong>le</strong> ?). el<strong>le</strong> représentent une cavalière nue, brandissant un poignard et un bouclier. Cette représentation, qui respecte<br />
la nudité « héroïque » des guerriers celtes, est l'unique témoignage d'une divinité guerrière, inconnue des textes antiques et des<br />
représentations figurées gallo-romaines.<br />
42
TAP BIBRACTEFEMMES 3deCOUV Ok 16/05/06 18:05 Page 1<br />
L’EXPOSITION EST LE RÉSULTAT D’UNE CO-PRODUCTION ENTRE :<br />
<strong>Bibracte</strong> / Musée de la Civilisation Celtique, Glux-en-G<strong>le</strong>nne / Saint-Léger-sous-Beuvray (F) ;<br />
Archäologiepark Belginum, <strong>Mo</strong>rbach-Wederath (D) ;<br />
Národní muzeum, Praha - Musée national, Prague (CZ).<br />
Coordination scientifique : Rosemarie Cordie, Vincent Guichard, Pavel Sankot, Wolf-Rüdiger Teegen.<br />
Coordination muséographique : Françoise Paquelot (<strong>Bibracte</strong>).<br />
Coordination technique : Jacky Gorlier (<strong>Bibracte</strong>).<br />
Textes : Rosemarie Cordie, Miluse Dobisíková, Vincent Guichard, Françoise Paquelot, Pavel Sankot, Milan Stloukal,<br />
^<br />
,<br />
Wolf-Rüdiger Teegen, Petr Ve<strong>le</strong>mínsky, Julian Wiethold.<br />
Régie des objets exposés : Dominique Lacoste (<strong>Bibracte</strong>), Patricia Lepaul (<strong>Bibracte</strong>).<br />
Scénographie : Patrick Bidot (Beaune).<br />
Création graphique : Les Pisto<strong>le</strong>ros (Dijon).<br />
Fabrication graphique : En Apparence.<br />
Aménagement de l'espace : Gérard Blanchot, Bruno Caré, Bernard Duquy-Nicoud,<br />
Bernard Pautet, Claude Sainjon (<strong>Bibracte</strong>).<br />
Photographies : Antoine Maillier (<strong>Bibracte</strong>), sauf mention contraire.<br />
Livret de l'exposition : FTM Presse / Bourgogne Magazine.<br />
Soutiens financiers : Ministère de la Culture et de la Communication,<br />
Direction régiona<strong>le</strong> des Affaires culturel<strong>le</strong>s de Bourgogne, Dijon.<br />
Conseil régional de Bourgogne, Dijon.<br />
Conseil général de la Nièvre, Nevers.<br />
Conseil général de la Saône-et-Loire, Mâcon.<br />
Museumsverband Rheinland-Pfalz, Mayence.<br />
Stiftung für Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, Mayence.<br />
Förderverein Archäologiepark Belginum e.V., <strong>Mo</strong>rbach-Wederath.<br />
Les organisateurs de l’exposition remercient tout particulièrement <strong>le</strong>s<br />
personnes suivantes pour <strong>le</strong>ur soutien et <strong>le</strong>ur coopération : Sabine Bolliger<br />
Schreyer, conservatrice au Musée historique de Berne, Jean-Louis Coudrot,<br />
conservateur du Musée de Châtillon-sur-Seine, Micheline Durand, conservateur<br />
du Musée d'art et d'histoire d'Auxerre, Christa Farka, directrice du<br />
Bundesdenkmalamt de Vienne, Karin Goethert, directrice du Rheinisches Landesmuseum<br />
de Trèves, Claude Grapin, conservateur départemental du patrimoine<br />
chargé du musée d'Alésia, Peter Jud, Gilbert Kaenel, conservateur du<br />
Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne, Marie Lapalus,<br />
conservateur du Musée des Ursulines de Mâcon, Anne Le Bot-Helly, conserva-<br />
trice régiona<strong>le</strong> de l'archéologie de Rhône-Alpes, Michal Lukes, directeur géné-<br />
ral du Musée national de Prague, Brigitte Maurice-Chabard, conservatrice du<br />
Musée Rolin d'Autun, Karol Pieta, chercheur à l'Institut archéologique de<br />
Nitra, Felix Mül<strong>le</strong>r, conservateur au Musée historique de Berne, Jacques Piette,<br />
conservateur du musée P. Dubois-A. Boucher de Nogent-sur-Seine, Walter<br />
Reinhard, conservateur du Landesdenkmalamt, Staatliche Altertümersammlung<br />
de Saarbrücken, Dominique Roussel, conservateur du Musée de Soissons,<br />
A<strong>le</strong>xander Ruttkay, directeur de l'Institut archéologique de Nitra, Michael<br />
Schmauder, conservateur du Rheinisches Landesmuseum de Bonn, Miklós Szabó,<br />
professeur à l'université Lórand Eötvös de Budapest, László Veres, directeur du<br />
musée Ottó Hermann de Miskolc, Christian Vernou, conservateur du Musée archéologique<br />
de Dijon.<br />
Et tout particulièrement : Rosemarie Cordie, directrice du parc archéologique<br />
de Wederath-Belginum, Pavel Sankot, conservateur au Musée national Prague /<br />
Musée historique, Wolf-Rüdiger Teegen, chercheur à l'université de Leipzig.<br />
INFORMATIONS PRATIQUES BIBRACTE :<br />
Musée de la Civilisation celtique,<br />
<strong>Mo</strong>nt Beuvray, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray<br />
Tél. : 03.85.86.52.35. - Courriel : info@bibracte.fr - site : www.bibracte.fr<br />
Expositions permanente et temporaire sur la civilisation celtique et <strong>le</strong>s recherches archéologiques<br />
menées sur <strong>le</strong> mont Beuvray, où se trouvait la vil<strong>le</strong> gauloise de <strong>Bibracte</strong>, capita<strong>le</strong> des Eduens, l'un<br />
des peup<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s plus puissants de la Gau<strong>le</strong> à l'époque de Vercingétorix et de Ju<strong>le</strong>s César.<br />
Tous <strong>le</strong>s jours de 10 à 18 heures (jusqu'à 19 heures en juil<strong>le</strong>t et août). Durée de visite conseillée : une demi-journée à une journée complète. Passeport <strong>Bibracte</strong> : visite guidée du site<br />
archéologique et entrée au musée : 9,50 € (p<strong>le</strong>in tarif) et 7,25 € (tarif réduit).<br />
Visite libre du musée : 5,75 € (p<strong>le</strong>in tarif) et 4,25 € (tarif réduit). Boutique cadeaux et livres. Salon de thé et paniers pique-nique.<br />
^
TAP BIBRACTEFEMME 4deCOUV Ok 16/05/06 18:08 Page 1<br />
Musée de la Civilisation celtique<br />
<strong>Mo</strong>nt Beuvray<br />
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray<br />
Tél. : 03.85.86.52.35.<br />
Courriel : info@bibracte.fr<br />
site : www.bibracte.fr<br />
n° ISBN : 2-909668-51-7<br />
Prix public : 3,50 €<br />
En partenariat avec Bourgogne Magazine