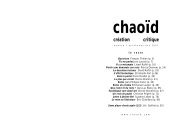Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
10 chaoïd numéro 2 - hiver 2000<br />
félix utopie 10<br />
et jamais dans le même temps la réflexion n’a eu une telle valeur esthétique.<br />
Ceux qui fustigeaient Guattari le jargonnant ont raté Félix le poète.<br />
Voilà s’il en était besoin la leçon de <strong>Ritournelle</strong>(s).<br />
Les concepts sont là mais rendus bancals, sans ce corset que la<br />
réflexion leur donne. Ils jaillissent, dansent, sortent du texte sans que les<br />
points d’ancrage du discours réflexif ne les oriente souvent de force.<br />
L’énonciation s’est délivrée de ses piliers. Alors, les morceaux de concepts<br />
se touchent et peuvent interagir sans la barrière des adverbes de liaison ou<br />
des connecteurs ; sans les moules de la progression didactique. Ils sont en<br />
lambeaux, réduits à leur essentielle brutalité. La parturition est violente et<br />
éclatante. Cette volonté d’assèchement du discours est parfaitement perceptible<br />
dans la multiplication des phrases nominales presque exclamatives<br />
qui donnent une teneur impérative au texte. Réduire les moyens<br />
pour que les images surgissent. L’homme de pensée a détruit ses habitudes<br />
pour ne laisser qu’un squelette dont les segments créent l’image. Il montre<br />
ainsi combien ses ouvrages théoriques ont toujours été tendus par un soubassement<br />
esthétique qui ne rend que plus impérieuse lorsqu’elle fut<br />
exprimée la parole philosophique. Le rejet si fréquent de la copulation verbale<br />
a du reste une portée qu’il convient d’observer. Le verbe conjugué a<br />
une tâche de personnalisation qui aboutit à une inévitable réduction au<br />
petit secret personnel : “Il s’était juré, le con, que plus jamais il n’utiliserait<br />
la troisième personne du singulier, comme on dit à l’école “. La nominalisation<br />
des phrases évoque une inévitable collectivisation anonyme de<br />
la parole, le refus de l’intime, l’ouverture à la multiplicité. Notons néanmoins<br />
que certains verbes demeurent ; mais de manière significative, ils<br />
sont majoritairement à l’infinitif et au présent de l’indicatif. Celui-ci<br />
impose sa ductilité, à la fois plein et vide de sémantisme temporel et actanciel.<br />
Il permet ainsi de conserver un potentiel important de relations et<br />
d’échanges entre sujets. Celui-là “exprime le temps de l’événement pur ou<br />
du devenir” (Mille plateaux, p. 322). Il ne s’agit cependant pas de coquetterie<br />
stylistique mais de porter un événement dans la langue : créer un cosmos,<br />
une explosion sémantiques. A cette fin, les phrases nominales s’accompagnent<br />
d’un usage inhabituel de l’accumulation et de la juxtaposition.<br />
<strong>Ritournelle</strong>(s) ou la juxtaposition triomphante. Outre son caractère<br />
jaillissant qui s’accorde fort bien à la danse des concepts relevée plus haut,<br />
la juxtaposition s’oppose fondamentalement à la subordination et l’interprétation<br />
politique de cette donnée ne pouvait que plaire à Guattari. La<br />
juxtaposition, c’est la promotion d’une organisation horizontale sans rapport<br />
hiérarchique contre une organisation verticale d’intégration de prédications<br />
secondes par une prédication première. Toujours conscient<br />
qu’écrire revient à créer une société de mots, Guattari ne pouvait être que<br />
favorable aux procédés égalitaristes. La juxtaposition nivelle les diverses<br />
fonctions syntaxiques et l’auteur en joue lorsqu’il relie des éléments qui ne<br />
le peuvent pas, se plaçant souvent en deçà de la correction syntaxique. (Il<br />
faudrait du reste faire un sort à ces niveaux intermédiaires qui ne sont pas<br />
sans évoquer le dernier Beckett : “A moins que jamais plus”(59) ; “Plus je<br />
malingre mémoire” (60)). Elle permet par ailleurs de connecter divers éléments<br />
sans diriger les échanges qui vont avoir lieu par une quelconque<br />
copulation syntaxique. Il entraîne <strong>Ritournelle</strong>(s) dans l’hétérogenèse sur<br />
laquelle Guattari a tant écrit (pas étonnant dès lors que soient évoqués les<br />
hérauts de l’hétérogène : l’archéoptéryx et l’ornithorynque). Son texte<br />
devient un cosmos sémantique acentré, sans hiérarchie.<br />
Cette tendance qui vise à éviter de recréer dans le corps même de<br />
l’ouvrage les marques de pouvoir est tout à fait perceptible dans la récurrence<br />
d’une forme inhabituelle : les phrases dont on ne lit que la proposition<br />
subordonnée ou que les compléments ciconstanciels, c’est-à-dire le<br />
périphérique et non l’essentiel, le dirigé et non le dirigeant : “Quand il<br />
s’est vu dans la glace. “. Le but profond est d’éliminer la proposition principale<br />
et de redonner une dignité au subordonné. Le texte est alors composé<br />
d’un grand nombre de phrases suspendues (“Qu’elle ait de petits<br />
seins si bien formés.” (29)) qui attendent d’être complétées et ne le seront<br />
pas. Il semble que Guattari interrompe le mouvement de la langue lorsqu’il<br />
va devoir réintroduire un marqueur de pouvoir. Ne doit-on pas y voir<br />
sans romantisme exagéré la parfaite écriture de tous ses engagements politiques<br />
? la mise en valeur des opprimés, des mineurs ?<br />
Cette juxtaposition triomphante se lit au niveau même des paragraphes<br />
qui tous occasionnent une rupture avec le précédent. Guattari ne<br />
souhaite pas introduire de hiérarchie d’un niveau à l’autre. C’est pourquoi<br />
on lit une véritable recherche de l’auto-similarité, tentative égalitariste