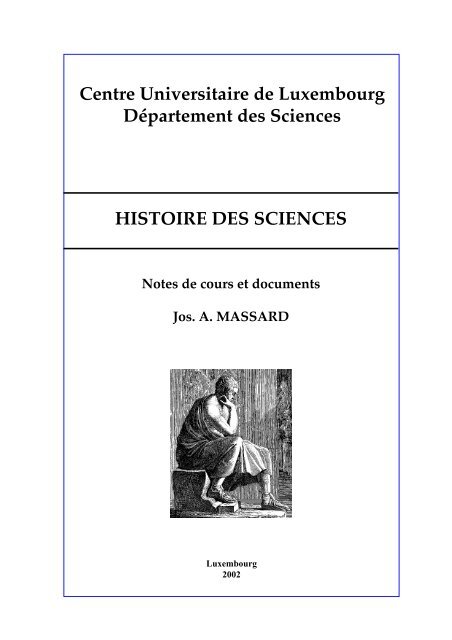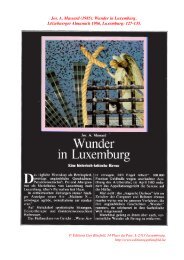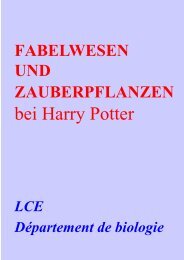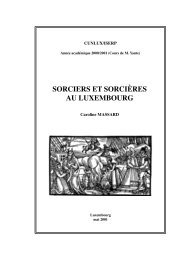HISTOIRE DES SCIENCES Centre Universitaire de ... - Jos A. Massard
HISTOIRE DES SCIENCES Centre Universitaire de ... - Jos A. Massard
HISTOIRE DES SCIENCES Centre Universitaire de ... - Jos A. Massard
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 1<br />
<strong>Centre</strong> <strong>Universitaire</strong> <strong>de</strong> Luxembourg<br />
Département <strong>de</strong>s Sciences<br />
<strong>HISTOIRE</strong> <strong>DES</strong> <strong>SCIENCES</strong><br />
Notes <strong>de</strong> cours et documents<br />
<strong>Jos</strong>. A. MASSARD<br />
Luxembourg<br />
2002
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 2<br />
<strong>Jos</strong>. A. <strong>Massard</strong> (jmassard@pt.lu)<br />
L’auteur a enseigné l’histoire <strong>de</strong>s sciences et <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine au Département <strong>de</strong>s Sciences du <strong>Centre</strong><br />
universitaire <strong>de</strong> Luxembourg <strong>de</strong> 1995 à 2002. La première partie <strong>de</strong> ces notes <strong>de</strong> cours s’est très largement<br />
inspirée chez Jean Théodoridès (1995): Histoire <strong>de</strong> la biologie. 6e édition. - Paris, Presses <strong>Universitaire</strong>s<br />
<strong>de</strong> France, 127 p. (= Que sais-je?, No 1) et Jean-Charles Sournia (1992): Histoire <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine.<br />
- Paris, Editions <strong>de</strong> la Découverte, 358 p. (Coll. Histoire <strong>de</strong>s sciences).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 3<br />
<strong>Centre</strong> <strong>Universitaire</strong> <strong>de</strong> Luxembourg<br />
Département <strong>de</strong>s Sciences<br />
Année académique 2001-2002<br />
<strong>HISTOIRE</strong> <strong>DES</strong> <strong>SCIENCES</strong><br />
par <strong>Jos</strong>. A. MASSARD<br />
1. LA PRÉ<strong>HISTOIRE</strong><br />
1.1. L’HOMME PRÉHISTORIQUE ET LE MONDE VIVANT<br />
Reproduit d’après: Théodoridès, Histoire <strong>de</strong> la biologie. 1995.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 4<br />
Reproduit d’après: Théodoridès, Histoire <strong>de</strong> la biologie. 1995.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 5<br />
1.2 PALÉOPATHOLOGIE ET ETHNOMÉDECINE<br />
1.2.1. PALÉOPATHOLOGIE<br />
La paléopathologie étudie les maladies <strong>de</strong> l’Homme en se basant sur les restes humains trouvés<br />
dans certains sites préhistoriques ou archéologiques qu’elle analyse à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s<br />
scientifiques mo<strong>de</strong>rnes.<br />
Traumatismes et maladies<br />
La paléopathologie se base essentiellement sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s squelettes et <strong>de</strong>s os. Leur<br />
examen permet d’i<strong>de</strong>ntifier certaines affections qui frappaient nos ancêtres ou les<br />
traumatismes qu’ils avaient subis.<br />
◆ Traumatismes:<br />
Les traumatismes sont dus aux conditions <strong>de</strong> vie très dures qui ont favorisé <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts:<br />
climat, chasse au gros gibier tel que mammouths ou rhinocéros, défense contre les<br />
animaux carnivores concurrents qui tuent les herbivores servant <strong>de</strong> nourriture à<br />
l’Homme, luttes entre clans pour la conquête <strong>de</strong> nouveaux territoires, etc.<br />
Les paléopathologistes trouvent ainsi <strong>de</strong> nombreuses traces <strong>de</strong> traumatismes: fractures<br />
<strong>de</strong>s os longs, fractures <strong>de</strong> la colonne vertébrale, fractures du bassin, pointes <strong>de</strong><br />
flèche ou <strong>de</strong> harpon fichées dans les os, etc.<br />
◆ Affections <strong>de</strong>s os:<br />
Le tissu osseux, grâce à sa résistance à la décomposition, représente l’essentiel du<br />
matériel dont on dispose pour l’étu<strong>de</strong> la paléopathologie.<br />
Les os peuvent présenter:<br />
• <strong>de</strong>s séquelles <strong>de</strong> rhumatismes déformant ou soudant les articulations;<br />
• <strong>de</strong>s altérations évoquant la tuberculose osseuse (mais, il faut être réservé: la<br />
mé<strong>de</strong>cine contemporaine, en effet, apprend que le tissu osseux réagit <strong>de</strong> façon<br />
très voisine à <strong>de</strong>s agressions différentes comme la tuberculose, certaines parasitoses,<br />
l’atteinte par <strong>de</strong>s germes ressemblant aux tréponèmes <strong>de</strong> la syphilis);<br />
• un cancer <strong>de</strong>s os;<br />
• <strong>de</strong>s déformations ou malformations du squelette;<br />
• une mauvaise <strong>de</strong>nture. Certains restes <strong>de</strong> mâchoires comportent <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts qui<br />
manquent ou sont déchaussées, signe d’infections fréquentes et graves <strong>de</strong>s gencives.<br />
On trouve également <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts atteintes <strong>de</strong> carie.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 6<br />
◆ Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s tissus :<br />
Parfois <strong>de</strong>s tissus mous sont trouvés (momies, hommes <strong>de</strong>s tourbières, cadavres <strong>de</strong><br />
l’âge <strong>de</strong> la pierre conservés dans un glacier: “Oetzi”). Ils peuvent être réhydratés,<br />
radiographiés, soumis à la datation au carbone 14, isotope radioactif du carbone, et<br />
étudiés au microscope électronique. Les viscères peuvent être examinés, ainsi que<br />
les protéines qui les constituent; on peut même fixer ainsi le groupe sanguin ou tissulaire<br />
<strong>de</strong> personnes mortes <strong>de</strong>puis plusieurs milliers d’années.<br />
L'ADN peut être préservé dans <strong>de</strong>s tissus mous (restes momifiés ou congelés) et <strong>de</strong>s<br />
tissus durs (os et <strong>de</strong>nts).<br />
◆ L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> représentations artistiques <strong>de</strong> l’Homme préhistorique :<br />
Citons les statuettes féminines telle la Vénus <strong>de</strong> Willendorf ou les peintures rupestres<br />
représentant l’Homme préhistorique.<br />
◆ L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’habitat préhistorique:<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’habitat préhistorique éclaire en partie les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> nutrition grâce à:<br />
• la palynologie ou étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pollens qui met en évi<strong>de</strong>nce les éventuelles plantes<br />
alimentaires;<br />
• l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s déjections humaines minéralisées (coprolithes) qui fournit <strong>de</strong>s indications<br />
supplémentaires sur la composition <strong>de</strong> l’alimentation (présence <strong>de</strong> graines<br />
ou <strong>de</strong> noyaux <strong>de</strong> plantes alimentaires, d’osselets ou <strong>de</strong> fragments d’os provenant<br />
<strong>de</strong>s animaux ingérés);<br />
• l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ossements ou <strong>de</strong>s coquillages d’animaux éparpillés autour <strong>de</strong>s âtres<br />
ou accumulés dans les “dépotoirs” préhistoriques.<br />
LA PALÉOMÉDECINE<br />
En l’absence <strong>de</strong> textes, la paléopathologie ne dispose pas <strong>de</strong> documents qui permettent<br />
<strong>de</strong> savoir comment se soignait l’Homme préhistorique.<br />
◆ Réduction <strong>de</strong> fractures:<br />
On peut affirmer, d’après les squelettes exhumés que l’Homme préhistorique sait<br />
réduire les fractures, en immobilisant les os cassés et en conservant leur axe; mais comme<br />
<strong>de</strong>s chevauchements <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux fragments subsistent, on peut conclure qu’il ne sait<br />
pas exercer une traction sur les <strong>de</strong>ux extrémités brisées qui aurait rétabli un parfait<br />
alignement.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 7<br />
◆ Trépanations du crâne:<br />
On hésite encore davantage à se prononcer sur les trépanations du crâne, partiellement<br />
cicatrisées dans le cours <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong> l’individu. Traumatismes acci<strong>de</strong>ntels ou<br />
blessures délibérées?<br />
Avaient-elles une signification religieuse, un but magique ou plutôt un but thérapeutique<br />
mécanique remédiant à un enfoncement <strong>de</strong> l’os, à une maladie nerveuse<br />
comme l’épilepsie ou une paralysie? Dans ce cas, on pourrait supposer que l’Homme<br />
préhistorique attribuait déjà au cerveau l’origine <strong>de</strong> la paralysie. Visaient-elles à amen<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>s troubles mentaux, ce qui permettrait <strong>de</strong> conclure que l’on mettait dans le<br />
crâne l’origine <strong>de</strong>s comportements anormaux? La question restera probablement sans<br />
réponse.<br />
Mais on exhume <strong>de</strong>s crânes trépanés dans le mon<strong>de</strong> entier et jusqu’à l’époque récente<br />
<strong>de</strong>s Celtes. De nombreux musées en conservent <strong>de</strong>s exemplaires. Les scientifiques<br />
émettent un certain nombre d’hypothèses pour expliquer ces trépanations qui<br />
se pratiquent encore dans diverses ethnies d’Afrique noire.<br />
Crâne néolithique trépané.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 8<br />
1.2.2. L’ETHNOMÉDECINE<br />
L’ethnomé<strong>de</strong>cine étudie les conceptions médicales <strong>de</strong>s peuples primitifs (Naturvölker)<br />
et notamment leurs métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traitement médical.<br />
Il est généralement admis que la mé<strong>de</strong>cine a été d’abord magique, puis religieuse.<br />
Les causes <strong>de</strong>s maladies<br />
Dans l’esprit <strong>de</strong>s peuples primitifs la maladie est le plus souvent provoquée par un<br />
mauvais génie, un démon ou une déité. Cette conception est très répandue. 1 Dans<br />
<strong>de</strong>s cas particuliers, la maladie peut être une punition divine.<br />
D’autres causes peuvent être:<br />
• l’esprit ou l’âme d’un défunt,<br />
• le non respect d’un tabou,<br />
• <strong>de</strong>s personnes ayant un pouvoir démoniaque (magiciens, sorcières …),<br />
• <strong>de</strong>s animaux ayant pénétré dans le corps (p. ex. sous forme d’un ver) ou l’esprit<br />
d’animaux,<br />
• <strong>de</strong>s substances étrangères ayant pénétré dans le corps, dont <strong>de</strong>s projectiles<br />
magiques (nous parlons encore <strong>de</strong> nos jours <strong>de</strong> “Hexenschuß” pour désigner<br />
un lumbago!),<br />
• un ensorcellement, le mauvais oeil, etc.<br />
Le sorcier (Medizinmann, medicine man)<br />
Face à ces causes surnaturelles l’homme éprouve le besoin d’un intermédiaire entre le<br />
visible et l’invisible qui lui échappe.<br />
Cet “agent <strong>de</strong> communication” possè<strong>de</strong> le savoir ou un don, il jouit d’une autorité<br />
sur le clan ou la tribu par sa fortune ou par l’hérédité. Il <strong>de</strong>vient le “parlementaire”<br />
désigné ou élu et jouera le rôle <strong>de</strong> prêtre ou <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin, parfois <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux.<br />
On retrouve cet intercesseur aujourd’hui encore dans certaines populations africaines.<br />
Les Dogons 2 , par exemple, ont choisi le forgeron comme mé<strong>de</strong>cin du village.<br />
Maître <strong>de</strong>s formes puisqu’il redresse les instruments tordus ou faussés, il répare les<br />
membres fracturés, enlève les tumeurs ou fabrique le couteau qui incise l’abcès douloureux.<br />
Et le clan lui reconnaît un pouvoir magique.<br />
1 Martin Luther (1483-1546) ne doutait pas que la maladie est l’oeuvre d’un démon malfaisant bien<br />
connu, le diable <strong>de</strong>s chrétiens. Ainsi il écrit: “Ueber das ist khein Zweyfel, dass Pestilentz und Fiber und<br />
an<strong>de</strong>r schwer Krankheyten nichts an<strong>de</strong>rs sein, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>s Teufel werkhe.”<br />
2 Dogons = peupla<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’ouest, dans la région frontalière du Burkina Faso et du Mali.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 9<br />
Le sorcier guérisseur <strong>de</strong> la grotte <strong>de</strong>s Trois-Frères (Ariège)<br />
(16.000 - 10.000 ans av. J.-C.)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 10<br />
Sorcier indien exorcisant le démon <strong>de</strong> la maladie.<br />
(Amérique du Nord, 19e s.)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 11<br />
2. SCIENCE ET MÉDECINE DE LA MÉSOPOTAMIE<br />
La Mésopotamie a été la patrie <strong>de</strong>s cultures sumérienne, babylonienne et assyrienne.<br />
Les sources<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sciences et <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine mésopotamienne peut se baser sur <strong>de</strong>s documents<br />
écrits.<br />
Les textes dont nous disposons datent d’environ 3000 à 400 ans av. J.-C. Ils se présentent<br />
sous forme <strong>de</strong>:<br />
• collections <strong>de</strong> tablettes soigneusement numérotées au moment <strong>de</strong> leur rédaction,<br />
• stèles, dont celle portant le célèbre Co<strong>de</strong> d’Hammourabi,<br />
• statues,<br />
• sceaux.<br />
Ecriture cunéiforme
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 12<br />
La divination<br />
Les dieux sont bienveillants; mais, à l’image <strong>de</strong>s forces <strong>de</strong> la nature qu’ils personnifient<br />
se comportent en <strong>de</strong>spotes capricieux aux colères imprévisibles. Ils exigent un<br />
culte minutieux. Sans leur consentement rien ne doit être entrepris car rien ne saurait<br />
réussir. Les particuliers, les rois plus encore, sont à l’affût <strong>de</strong> toutes les manifestations<br />
<strong>de</strong> leurs volontés. Or, dans ce mon<strong>de</strong> où le ciel et la terre sont intimement<br />
liés, tout peut avoir une signification: une rencontre fortuite, un songe, une éclipse...<br />
Des prêtres spécialisés, les <strong>de</strong>vins, interprètent ces signes envoyés par les dieux; ils<br />
les cherchent dans le vol <strong>de</strong>s oiseaux, les entrailles — le foie surtout <strong>de</strong>s animaux<br />
sacrifiés (hépatoscopie); ils s’efforcent enfin, longuement, patiemment, <strong>de</strong> les lire<br />
sur la voûte céleste où, dans le mouvement <strong>de</strong>s astres et l’aspect <strong>de</strong>s constellations,<br />
est inscrit le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong>s hommes. Les astrologues mésopotamiens pourtant n’en vinrent<br />
qu’assez tard à prédire l’avenir d’un individu d’après la position <strong>de</strong>s astres au<br />
moment <strong>de</strong> sa naissance: le plus ancien horoscope connu ne remonte qu’au -Ve siècle.<br />
La magie<br />
En dépit <strong>de</strong> ces précautions, l’homme n’est jamais à l’abri <strong>de</strong> la colère <strong>de</strong>s dieux. Aux<br />
désobéissances à la loi — dictées par les dieux, toutes les lois sont sacrées — viennent<br />
s’ajouter les fautes, innombrables, que les mieux intentionnés peuvent toujours<br />
commettre à leur insu: rite négligé, divinité inconnue offensée; et les dieux courroucés<br />
ont <strong>de</strong> terribles châtiments. Ils frappent les coupables dans leurs biens, leur famille,<br />
leur personne, directement ou en déchaînant contre eux la hor<strong>de</strong> <strong>de</strong>s démons.<br />
Le fidèle enfin est à la merci <strong>de</strong>s sorciers, capables eux aussi <strong>de</strong> lâcher les démons.<br />
Pécheur ou non, il est toujours menacé par les forces mauvaises qui rô<strong>de</strong>nt. Les bons<br />
génies sont impuissants à les écarter complètement. Reste alors la magie: <strong>de</strong>s prêtres,<br />
les exorcistes, ont pour fonction <strong>de</strong> mettre en fuite les démons, au nom d’Ea et<br />
<strong>de</strong> Mardouk.<br />
Quelqu’un tombe-t-il mala<strong>de</strong> ? On le tient pour possédé. On appelle à son chevet un<br />
prêtre qui cherche d’abord à établir la faute qu’il a commise et le nom du démon qui<br />
l’habite. Puis, ayant administré au patient un remè<strong>de</strong> assez nauséeux pour enlever à<br />
son hôte l’envie <strong>de</strong> rester, l’exorciste par <strong>de</strong>s incantations, débusque le démon, l’oblige<br />
à fuir ou le contraint à s’installer dans une figurine qu’il jette ensuite aux flammes.<br />
La magie mésopotamienne était essentiellement exorcisme.<br />
LES <strong>SCIENCES</strong><br />
Mais les pratiques <strong>de</strong> cette religion acheminèrent obscurément les Mésopotamiens<br />
vers la Science.<br />
Astronomie<br />
A force d’examiner le ciel dans l’illusion d’y déceler la volonté <strong>de</strong>s dieux (astrologie),<br />
les prêtres accumulèrent <strong>de</strong>s observations d’où se dégagea peu à peu une connaissance<br />
exacte <strong>de</strong>s phénomènes célestes (astronomie). Ils apprirent à prévoir les
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 13<br />
éclipses, à distinguer le mouvement apparent <strong>de</strong>s étoiles et <strong>de</strong>s planètes.... Ils divisèrent<br />
l’année en 12 mois lunaires et ceux-ci en semaines <strong>de</strong> 7 jours. Ils fractionnèrent<br />
le jour en 12 parties — égales chacune à <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> nos heures —, la double-heure en 60<br />
doubles minutes et la double-minute en 60 doubles-secon<strong>de</strong>s.<br />
Mathématiques<br />
Cette astronomie supposait <strong>de</strong>s connaissances mathématiques, qu’exigeait également<br />
la vie économique. Les Mésopotamiens furent en effet <strong>de</strong> remarquables calculateurs;<br />
on peut même les tenir pour les inventeurs <strong>de</strong> l’algèbre.<br />
Sciences biologiques et mé<strong>de</strong>cine<br />
Les Sumériens pratiquaient la zootechnie (distinction <strong>de</strong> diverses races <strong>de</strong> chevaux,<br />
croisements entre cheval et âne, etc.). Les Babyloniens avaient certaines connaissances<br />
biologiques: <strong>de</strong>s modèles en terre cuite <strong>de</strong> divers viscères (notamment du foie)<br />
prouvent qu’ils pratiquaient la dissection animale. Pour eux, le coeur était le siège <strong>de</strong><br />
l’intelligence et le foie celui du mouvement du sang. Ils distinguaient le «sang clair»<br />
(artériel, formé le jour, et le «sang sombre» (veineux), formé la nuit. On trouve par<br />
ailleurs dans les tablettes cunéiformes <strong>de</strong>s listes <strong>de</strong> noms d’animaux et <strong>de</strong> plantes<br />
avec un rudiment <strong>de</strong> classification.<br />
Mé<strong>de</strong>cine<br />
Le traitement <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s ne relevait pas uniquement <strong>de</strong> la magie. Des exorcistes<br />
avaient fini par amasser assez d’expérience pour reconnaître et soigner quelques<br />
maladies simples.<br />
Certains <strong>de</strong>s textes dont nous disposons se répètent <strong>de</strong> siècle en siècle et témoignent<br />
d’un savoir transmis <strong>de</strong> génération en génération par <strong>de</strong>s maîtres professant dans les villes<br />
les plus considérables. Il existe déjà un véritable corps <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins.<br />
Le Co<strong>de</strong> d’Hammourabi (Co<strong>de</strong>x Hammurabi), un recueil <strong>de</strong> lois rédigé au 18e s. av.<br />
J.-C., contient entre autres <strong>de</strong>s prescriptions s’appliquant aux mé<strong>de</strong>cins, définissant<br />
leurs honoraires et les sanctions en cas d’échec :<br />
“Si un mé<strong>de</strong>cin soigne un seigneur, lui ouvre un abcès et sauve son oeil, il recevra dix sicles<br />
(“Schekel”) d’argent. Si le patient est un esclave, son maître <strong>de</strong>vra payer pour lui dix sicles d’argent.”<br />
“Si le mé<strong>de</strong>cin ouvre un abcès avec un couteau <strong>de</strong> bronze et provoque la mort du patient, ou lui<br />
fait perdre un oeil, il aura les mains tranchées.”<br />
Beaucoup plus tard, l’historien grec Hérodote (490/84-430/25), a fourni une version<br />
très différente <strong>de</strong> la pratique médicale <strong>de</strong>s Babyloniens:<br />
“Ils apportent leurs mala<strong>de</strong>s sur la place publique, car ils n’ont point <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins. Les gens<br />
s’approchent du mala<strong>de</strong> et ceux qui ont souffert d’un mal semblable, ou vu quelqu’un en souffrir,<br />
proposent leurs conseils; ils s’approchent, donnent <strong>de</strong>s avis et recomman<strong>de</strong>nt les remè<strong>de</strong>s<br />
qui les ont guéris d’un mal semblable ou qu’ils ont vu guérir quelqu’un. Il est interdit <strong>de</strong> passer<br />
près d’un mala<strong>de</strong> sans lui parler et <strong>de</strong> continuer sa route avant <strong>de</strong> lui avoir <strong>de</strong>mandé quel est<br />
son mal.”
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 14<br />
Hépatoscopie en Mésopotamie.<br />
Modèle <strong>de</strong> foie <strong>de</strong> mouton en argile utilisé à <strong>de</strong>s fins divinatoires.<br />
Epoque assyrienne-babylonienne<br />
(1900-1800 av. J.-C.).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 15<br />
Mais comme nous l’avons vu la mé<strong>de</strong>cine reste dominée par la religion et les dieux.<br />
Le dieu <strong>de</strong> Babylone, Mardouk, s’est imposé au cours <strong>de</strong>s siècles. Autour <strong>de</strong> lui<br />
gravitent <strong>de</strong> nombreux génies et démons, responsables <strong>de</strong>s maladies dont souffrent<br />
les hommes. Compagnons <strong>de</strong>s dieux, les génies sont les gardiens <strong>de</strong> la maison comme<br />
du corps humain, et toute infraction aux règles édictées déclenche leur colère.<br />
La maladie est donc vécue comme un châtiment ou un péché.<br />
On comprend qu’avec cette étiologie diagnostic et pronostic se situent sur <strong>de</strong>ux plans:<br />
l’un hypothétique, l’autre réellement médical. Par exemple, l’observation clinique du<br />
sujet permet <strong>de</strong> faire le diagnostic <strong>de</strong>s accès <strong>de</strong> paludisme, <strong>de</strong> la jaunisse, <strong>de</strong> l’occlusion<br />
intestinale, <strong>de</strong> la crise d’épilepsie, <strong>de</strong> l’ictus cérébral ␣<br />
. Pour chacune <strong>de</strong> ces maladies,<br />
on précise les formes cliniques comportant un diagnostic favorable ou fatal.<br />
Mais, parallèlement à cette sémiologie 3 rigoureuse, on recherche minutieusement<br />
les antécé<strong>de</strong>nts du mala<strong>de</strong> afin <strong>de</strong> découvrir le péché récemment commis et d’i<strong>de</strong>ntifier<br />
le génie responsable <strong>de</strong> la maladie.<br />
Aux fautes morales, s’ajoutent les causes d’impureté physiques: mettre les pieds dans<br />
l’eau sale, toucher un homme ou une femme dont les mains ne sont pas lavées, toucher<br />
un corps sale, etc.<br />
On utilise plusieurs types <strong>de</strong> diagnostics <strong>de</strong> nature divinatoire: songes, vols d’oiseaux,<br />
date d’une crue, couleur et direction d’une fumée sur un foyer, forme d’une tache<br />
d’huile, etc.<br />
On pratique l’hépatoscopie, une technique <strong>de</strong> divination au moyen <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> du<br />
foie d’un animal: son poids, sa couleur, sa structure anatomique. La profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s<br />
sillons du foie, la configuration <strong>de</strong>s lobes pouvaient ainsi servir à établir le pronostic<br />
<strong>de</strong> la maladie.<br />
L’hépatoscopie a été très populaire. On a retrouvé <strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> maquettes <strong>de</strong> foies<br />
en terre cuite, bois ou bronze. Elle a même persisté dans le temps et dans l’espace<br />
puisque cette mantique 4 viscérale se pratiquera plus tard, couramment, chez les<br />
Étrusques et les Hittites.<br />
3 sémiologie = partie <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine qui étudie les signes (symptômes) <strong>de</strong>s maladies.<br />
4 mantique = divination.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 16<br />
3. LA MÉDECINE ÉGYPTIENNE<br />
Les sources<br />
L’écriture hiéroglyphique suit une évolution continue et l’historien détient <strong>de</strong>s documents<br />
pour chacune <strong>de</strong> ses étapes. Outre la sculpture et les sceaux, matériel commun<br />
à elle et à Sumer, l’Égypte a légué <strong>de</strong>s manuscrits sur papyrus et sur cuir ainsi<br />
que <strong>de</strong>s peintures sur les murs <strong>de</strong>s tombeaux et sur les objets.<br />
Une quinzaine <strong>de</strong> papyrus médicaux — établis à différentes dates — sont à notre<br />
disposition, dont:<br />
• le papyrus Edwin Smith, écrit vers 1600 av. J.-C., conservé à l’Académie <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> New York;<br />
• le papyrus Ebers, écrit vers 1550 av. J.-C., conservé à l’Université <strong>de</strong> Leipzig, le<br />
plus connu <strong>de</strong>s papyrus parce que traduit le premier.<br />
Organisation <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine<br />
La pratique médicale semble s’être transmise non <strong>de</strong> maître à élève, mais <strong>de</strong> père en<br />
fils, sinon dans la même famille, en tout cas dans la même caste. Les mé<strong>de</strong>cins font<br />
partie <strong>de</strong> l’élite <strong>de</strong> la société. Apparemment, ils ne <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt pas d’honoraires, mais<br />
perçoivent, en tant que fonctionnaires, une rémunération<br />
fixe, le plus souvent sous forme <strong>de</strong> nourriture ou <strong>de</strong> vêtements.<br />
Hérodote raconte que les mé<strong>de</strong>cins étaient tous spécialisés,<br />
l’un s’occupant <strong>de</strong>s yeux, l’autre du ventre, le troisième<br />
<strong>de</strong> gynécologie. En fait, comme pour la plupart<br />
<strong>de</strong>s témoignages contemporains, il faut nuancer cette<br />
affirmation. Au 5 e siècle av. J.-C., si l’on peut considérer<br />
les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> la capitale comme spécialisés, il n’en va<br />
pas <strong>de</strong> même dans les provinces.<br />
Imhotep — un mé<strong>de</strong>cin divinisé<br />
Nous connaissons les noms et, partiellement, les biographies<br />
<strong>de</strong> plusieurs centaines <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins égyptiens. Mais<br />
aucun d’entre eux n’est aussi célèbre qu’Imhotep qui<br />
vécut vers 2600 av. J.-C.<br />
IMHOTEP (vers 2600 av. J.-C.)<br />
mé<strong>de</strong>cin, architecte, écrivain, déifié plus tard.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 17<br />
Conseiller et architecte du pharaon Djéser (Djoser) <strong>de</strong> la troisième dynastie memphite<br />
(<strong>de</strong> Memphis) (Ancien Empire), il fit élever pour son maître le premier monument<br />
colossal <strong>de</strong> l’architecture égyptienne: la pyrami<strong>de</strong> à <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> Saqqara et le vaste<br />
mausolée funéraire qui l’entoure, un <strong>de</strong>s premiers monuments architecturaux en<br />
pierre <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’humanité.<br />
Imhotep légua en guise <strong>de</strong> testament <strong>de</strong>s instructions morales, <strong>de</strong>s traités d’astronomie<br />
et <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, repris pendant <strong>de</strong>s siècles par les copistes. Dès le Nouvel Empire␣ , il<br />
fut considéré comme un <strong>de</strong>scendant du dieu Ptah (le dieu <strong>de</strong> Memphis). Plus tard, à<br />
la Basse Époque, il a été vénéré comme un dieu guérisseur. On éleva <strong>de</strong>s temples à sa<br />
mémoire, où les mala<strong>de</strong>s-fidèles pratiquaient l’incubation nocturne dans le but, peutêtre,<br />
d’analyser les songes provoqués artificiellement, comme on le fera bientôt dans<br />
les asklépiéions grecs.<br />
Pathologie et thérapeutique<br />
Selon toute vraisemblance, la pathologie égyptienne diffère peu <strong>de</strong> la mésopotamienne.<br />
Nous l’appréhendons cependant mieux dans le détail grâce à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
momies. Ces cadavres <strong>de</strong>sséchés ont été disséqués, analysés, radiographiés <strong>de</strong>s centaines<br />
<strong>de</strong> fois. Nous connaissons les caries <strong>de</strong>ntaires dont souffrait tel pharaon. Des<br />
mé<strong>de</strong>cins ont établi les diagnostics <strong>de</strong>s rhumatismes infectieux secondaires à l’infection<br />
<strong>de</strong>s gencives. Ils ont noté <strong>de</strong>s cals vicieux, <strong>de</strong>s ostéomyélites, <strong>de</strong>s gibbosités<br />
pottiques. La bilharziose ou l’ankylostomiase␣ étaient répandues dans ce pays où<br />
l’eau apporte à la fois la vie et la mort. Aucune autre civilisation ancienne ne nous<br />
offre un matériel aussi <strong>de</strong>nse sur la pathologie humaine.<br />
Le papyrus Edwin Smith donne une idée <strong>de</strong> la mentalité médicale égyptienne. Il<br />
représente sans doute la copie d’un document du début <strong>de</strong> l’Ancien Empire; certains<br />
auteurs pensent même que le texte <strong>de</strong> ce document aurait été inspiré par Imhotep. Le<br />
papyrus Smith traite surtout <strong>de</strong> cas appartenant à la pathologie externe (traitement<br />
<strong>de</strong>s blessures, y compris le traitement chirurgical). Les observations se succè<strong>de</strong>nt<br />
selon un ordre anatomique qui va <strong>de</strong> la tête aux pieds (a capite ad calcem).<br />
Chaque chapitre décrit un cas clinique présenté selon le même schéma. La <strong>de</strong>scription<br />
porte sur les éléments suivants:<br />
• l’examen du mala<strong>de</strong> par le mé<strong>de</strong>cin (chirurgien); cet examen comporte le<br />
questionnaire, l’exploration <strong>de</strong> la lésion par <strong>de</strong>s moyens simples comme la palpation,<br />
le sondage <strong>de</strong> la plaie, la mobilisation du segment <strong>de</strong> membre, la palpation<br />
du pouls artériel,<br />
• la déclaration du diagnostic au patient,<br />
• le commentaire sur le pronostic, c’est-à-dire les chances <strong>de</strong> guérison,<br />
• l’exposé <strong>de</strong> la thérapeutique qui consiste le plus fréquemment en <strong>de</strong>s prescriptions<br />
simples, ou en prières et incantations dans les cas jugés inguérissables.<br />
Les Égyptiens connaissent dans le détail l’anatomie <strong>de</strong>s animaux, mais, ils ignorent
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 18<br />
l’anatomie <strong>de</strong> l’Homme, peut-être en raison du respect <strong>de</strong> l’apparence humaine qu’ils<br />
espèrent conserver pour l’éternité grâce aux embaumements. Ainsi , on vi<strong>de</strong> la boîte<br />
crânienne du défunt par la voie nasale et on éviscère l’abdomen par une courte incision<br />
dans la fosse iliaque gauche. Des voies aussi exiguës ne permettent pas le développement<br />
<strong>de</strong>s observations en anatomie.<br />
Parallèlement, dans certains cas <strong>de</strong> chirurgie, on conseille <strong>de</strong> prononcer à haute voix<br />
<strong>de</strong>s formules incantatoires et traditionnelles au dieu concerné: on peut s’adresser<br />
ainsi à Amon-Rê, le dieu suprême, ou à Isis, la déesse-mère protectrice, ou à Touèris,<br />
déesse à tête d’hippopotame, qui prési<strong>de</strong> aux accouchements. À l’instar <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine<br />
sumérienne, la mé<strong>de</strong>cine égyptienne associe logique et magie.<br />
«D'abord, à l'ai<strong>de</strong> d'un fer recourbé, ils extraient le<br />
cerveau par les narines…»<br />
Hérodote, 490-425 av. J.-C.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 19<br />
LE PAPYRUS SMITH,<br />
découvert par l'Anglais Edwin Smith (1822-1906). Texte chirurgical. En bas, transcription<br />
en hiéroglyphes.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 20<br />
PAPYRUS EBERS (vers 1550 av. J.-C.)<br />
acheté à Louqsor<br />
par l'égytologue allemand Georg Ebers (1837-1898).<br />
Facsimilé édité en 1875.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 21<br />
DOCUMENTS : LES PAPYRI ÉGYPTIENS<br />
Champollion n’eut jamais l’occasion <strong>de</strong> voir un<br />
papyrus médical égyptien. Il faut attendre<br />
Heinrich Brugsch - l’étu<strong>de</strong> scientifique <strong>de</strong><br />
l’Egypte ancienne en est encore à ses débuts -<br />
pour que soit mis à jour et publié un document<br />
<strong>de</strong> ce genre. Il s’agissait du papyrus Berlin 3038,<br />
dit “papyrus médical <strong>de</strong> Berlin”, qui fut incorporé<br />
dans le célèbre Recueil <strong>de</strong> monuments égyptiens<br />
publié par le savant allemand à Leipzig<br />
en 1863. Le papyrus est daté <strong>de</strong> la XIXe dynastie.<br />
Le début est perdu mais la fin est conservée.<br />
L’analyse du contenu montre à l’évi<strong>de</strong>nce<br />
que ce document recopie surtout <strong>de</strong>s textes<br />
médicaux traditionnels. On y trouve ainsi le<br />
même traité sur les oukhedou donné par le papyrus<br />
Ebers, plus ancien. Les remè<strong>de</strong>s <strong>de</strong>stinés à<br />
combattre l’action <strong>de</strong>s différents démons ( fumigations<br />
et onguents à visée apotropaïque 5 )<br />
y sont particulièrement représentés, et proportionnellement<br />
plus nombreux que dans les traités<br />
médicaux antérieurs (Ebers, Smith, Kahun,<br />
Hearst). Ce papyrus ressemble tout à fait à un<br />
compendium privé <strong>de</strong> praticien, pour reprendre<br />
une expression <strong>de</strong> François Daumas. À l’époque<br />
<strong>de</strong> la publication <strong>de</strong> Brugsch, le papyrus<br />
<strong>de</strong> Berlin ne permettait pas <strong>de</strong> se faire une idée<br />
exacte <strong>de</strong>s connaissances médicales <strong>de</strong>s anciens<br />
Égyptiens.<br />
La découverte <strong>de</strong>s célèbres papyrus Ebers et<br />
Smith permit enfin d’avoir une masse <strong>de</strong> textes<br />
assez significative pour étudier les connaissances<br />
médicales <strong>de</strong> l’Egypte ancienne. Que ces<br />
<strong>de</strong>ux papyrus fassent partie d’une seule trouvaille<br />
est à peu près certain. Cette trouvaille<br />
clan<strong>de</strong>stine, et donc sur laquelle nous serons<br />
toujours très mal renseignés, fut probablement<br />
importante. Il s’agissait peut-être d’une petite<br />
bibliothèque, d’un coffre qui aurait encore contenu<br />
le papyrus mathématique Rhind. Les <strong>de</strong>ux<br />
papyrus médicaux furent acquis par l’Américain<br />
Edwin Smith, grand amateur d’antiquités<br />
qui vivait à l’époque à Louxor. Il semble les<br />
avoir eus entre les mains dès 1862. Le lot proviendrait<br />
peut-être <strong>de</strong>s magasins du<br />
Ramesséum, le temple funéraire <strong>de</strong> Ramsès II.<br />
Edwin Smith garda pour lui le papyrus qui<br />
porte maintenant son nom et qui est le célèbre<br />
traité chirurgical publié par Breasted en 1930.<br />
C’est Georg Ebers qui acheta à Smith le plus<br />
grand <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux papyrus médicaux et qui l’appela<br />
tout simplement, sinon mo<strong>de</strong>stement,<br />
“papyrus Ebers”. La publication qu’il en fit en<br />
1875 est magnifique et digne <strong>de</strong> l’importance<br />
du papyrus. Ce document est écrit dans un hiératique<br />
d’une qualité graphique exceptionnelle,<br />
et il est complet. On date le manuscrit <strong>de</strong> 1550<br />
environ av. J.-C., ce qui est aussi la date qu’il<br />
faut assigner au papyrus Smith, Apparemment,<br />
le papyrus Ebers veut faire le tour <strong>de</strong> la pathologie<br />
rencontrée par un mé<strong>de</strong>cin dans son exercice<br />
quotidien et lui servir <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>. Il <strong>de</strong>meure<br />
toujours le plus important <strong>de</strong>s livres médicaux<br />
<strong>de</strong> l’Égypte ancienne. Nulle part ailleurs on<br />
trouvera autant <strong>de</strong> renseignements permettant<br />
<strong>de</strong> définir la pensée médicale <strong>de</strong> l’époque. Bien<br />
entendu, par rapport au papyrus Ebers, le traité<br />
chirurgical du papyrus Smith est d’un abord<br />
plus direct, mais, sans lui, on pourrait encore<br />
parvenir à une vision cohérente <strong>de</strong>s connaissances<br />
médicales égyptiennes. L’inverse n’est pas<br />
vrai.<br />
Les fouilles <strong>de</strong> la ville d’Illahoun (Kahun) livrèrent<br />
à la fin du siècle <strong>de</strong>rnier, et parmi d’autres<br />
textes, un traité médical <strong>de</strong>s plus anciens, écrit<br />
vers 1850 av. J.-C., pendant le Moyen Empire<br />
égyptien. On a toutefois remarqué que ce texte<br />
utilise quelques formes grammaticales récentes,<br />
plus récentes en tout cas que celles utilisées habituellement<br />
par le papyrus Ebers, qui lui est<br />
pourtant postérieur . C’est que les dates <strong>de</strong>s supports,<br />
<strong>de</strong>s papyrus conservés, ne sauraient servir<br />
à dater la conception <strong>de</strong>s textes eux-mêmes.<br />
Le papyrus Ebers semble puiser plus ou moins<br />
directement la majorité <strong>de</strong> ses textes dans <strong>de</strong>s<br />
recueils datant <strong>de</strong> l’Ancien Empire, donc antérieurs<br />
aux papyrus <strong>de</strong> Kahun. Il est toutefois<br />
probable que le papyrus gynécologique <strong>de</strong><br />
Kahun soit lui aussi tributaire <strong>de</strong> très anciens<br />
écrits <strong>de</strong> cette époque, mais qu’il y ait eu une<br />
mise à jour grammaticale lors <strong>de</strong> la rédaction<br />
du texte qui nous est parvenu. Les papyrus<br />
Ebers et <strong>de</strong> Berlin avaient déjà transmis <strong>de</strong>s remè<strong>de</strong>s<br />
pour les maladies <strong>de</strong>s femmes, <strong>de</strong>s pronostics<br />
pour le déroulement <strong>de</strong> la grossesse,<br />
mais dans aucun <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux papyrus la matière<br />
n’est traitée aussi systématiquement que<br />
dans Kahun, qui doit être considéré pour l’instant<br />
comme le seul vrai papyrus gynécologique<br />
<strong>de</strong> l’Égypte ancienne.<br />
(Extrait <strong>de</strong>: T. Bardinet: Les papyrus médicaux <strong>de</strong> l’Egypte<br />
pharaonique. Fayard, Paris 1995.)<br />
5 Destiné à écarter le mauvais sort, <strong>de</strong>signe une représentation ou un objet <strong>de</strong>stiné à éloigner le mal.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 22<br />
4. L’ANTIQUITÉ GRECQUE ET ROMAINE<br />
4.1. LES CONCEPTIONS THÉORIQUES SUR LA NATURE DE LA MATIÈRE<br />
4.1.1. Les théories <strong>de</strong>s éléments<br />
Thalès, philosophe grec <strong>de</strong> Milet en Ionie (Asie Mineure),<br />
fut l’un <strong>de</strong>s premiers, au VIIe siècle av. J.-C., à<br />
penser que l’homme peut comprendre l’univers à<br />
l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa seule raison, sans personnaliser les forces<br />
<strong>de</strong> la nature par <strong>de</strong>s divinités. Il supposa que l’eau est<br />
le principe du mon<strong>de</strong>, le matériau <strong>de</strong> base. Le caractère<br />
amorphe <strong>de</strong> ce liqui<strong>de</strong> laissait croire qu’il pouvait<br />
donner lieu à toutes les qualités et toutes les propriétés<br />
<strong>de</strong>s choses <strong>de</strong> la nature. C’était un premier “ élément”.<br />
Thalès <strong>de</strong> Milet (VIIe s.)<br />
Anaximandre (env. 610-545 av. J.-C.) met en jeu un principe<br />
indéfini, indéterminé, amorphe sur tous les plans:<br />
l’apeiron (terme signifiant “ sans limite ”).<br />
Anaximène (maturité vers 545 av. J.-C.) choisit l’air<br />
comme élément <strong>de</strong> base.<br />
Héraclite d’Ephèse (né vers 540 av. J.-C.), sensible surtout<br />
à la mobilité et à l’écoulement du <strong>de</strong>venir, voit dans<br />
le feu l’élément primordial. La flamme peut prendre<br />
toutes les formes. Elle est à l’image <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong> la<br />
nature.<br />
La matière chez Parméni<strong>de</strong> (540-450 av. J.-C.) <strong>de</strong>vient<br />
plus abstraite: l’unicité qui sous-tend le divers apparent<br />
du mon<strong>de</strong> est seule réalité. L’univers étant Un, il<br />
est l’Etre. Sa seule caractéristique étant d’être, il est<br />
au-<strong>de</strong>là du changement. Tout en lui est donc i<strong>de</strong>ntique.<br />
Il est ainsi continu, homogène, immobile et <strong>de</strong><br />
symétrie sphérique. Nos sens sont imparfaits et nous<br />
donnent une image fausse <strong>de</strong> la réalité. La matière <strong>de</strong>-<br />
Héraclite d’Ephèse (né vers 540 av. J.-C.),
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 23<br />
venant abstraite et totalement définie dans le cadre <strong>de</strong> l’Un, le problème <strong>de</strong> sa structure<br />
est sans objet.<br />
Empédocle (env. 485-425 av. J.-C.) admet la<br />
pluralité dans le principe <strong>de</strong> l’Etre. Le feu,<br />
l’air, l’eau et la terre seront associés en proportions<br />
variables sous l’influence d’une<br />
force d’attraction, l’amour, et d’une force répulsive,<br />
la haine. Lorsque l’amour domine,<br />
tous les éléments sont unis et le mon<strong>de</strong> prend<br />
une symétrie sphérique analogue à celle <strong>de</strong><br />
l’univers <strong>de</strong> Parméni<strong>de</strong>. Lorsque la haine<br />
domine, il y a dissociation.<br />
Dans cette voie un pluralisme plus radical<br />
encore sera professé par Anaxagore (480-428<br />
av. J.-C.) qui admet un nombre presque infini<br />
<strong>de</strong> corps <strong>de</strong> base.<br />
Les 4 éléments d’Empédocle<br />
Les théories <strong>de</strong>s éléments présentèrent leurs formes les plus élaborées dans les œuvres<br />
<strong>de</strong> Platon et d’Aristote.<br />
L’inspiration <strong>de</strong> Platon (427-347 av. J.-C.) se place pour partie dans la filiation <strong>de</strong><br />
l’Ecole pythagoricienne. Les choses <strong>de</strong> notre mon<strong>de</strong> sont en quelque sorte <strong>de</strong>s ombres,<br />
le reflet d’un mon<strong>de</strong> parfait où les Idées sont <strong>de</strong>s êtres métaphysiques qui constituent<br />
le réel. Les quatre éléments: feu, air, eau, terre, bien que générateurs <strong>de</strong> la<br />
matière, ne constituent pas les principes premiers <strong>de</strong>s corps. Ce sont les nombres qui<br />
représentent la clef <strong>de</strong>s transformations. Ils sont non seulement le modèle <strong>de</strong> la matière,<br />
réglant et ordonnant tout, mais aussi ils sont eux-mêmes matière physique.<br />
Platon concevra la matière comme une forme géométrique, un volume.<br />
Les éléments seront donc nécessairement <strong>de</strong>s volumes, c’est-à-dire <strong>de</strong>s étendues<br />
spatiales limitées par <strong>de</strong>s surfaces. Or toute surface peut se ramener à <strong>de</strong>s triangles<br />
<strong>de</strong> base. Platon, parce que ceux-ci lui paraissent obéir à une esthétique mathématique,<br />
choisit <strong>de</strong>ux triangles:<br />
• le triangle rectangle isocèle, avec lequel il forme un cube<br />
• le triangle équilatéral, lequel Platon forme trois polyèdres réguliers: tétraèdre,<br />
octaèdre, icosaèdre qui contiennent respectivement 4, 8 et 20 triangles <strong>de</strong> base.<br />
Le feu est le plus léger, le plus mobile <strong>de</strong>s éléments. Il correspond donc au tétraèdre<br />
qui, n’ayant que quatre triangles constitutifs, est le plus petit <strong>de</strong>s polyèdres, donc le<br />
plus léger. Si le feu détruit tout, c’est à cause <strong>de</strong>s arêtes aiguës <strong>de</strong> sa figure.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 24<br />
Platon pense que le cube est le polyèdre le plus stable. Cette figure représente donc<br />
la terre et sa massivité. Selon <strong>de</strong>s critères semblables l’octaèdre correspondra à l’air,<br />
l’icosaèdre à l’eau.<br />
tétraèdre = feu<br />
icosaèdre = eau<br />
Les éléments peuvent subir une dissociation en leurs triangles <strong>de</strong> base. Ces <strong>de</strong>rniers<br />
se recombinent alors éventuellement selon une autre figure. Par exemple:<br />
1 Air 2 Feu<br />
octaèdre = air<br />
cube = terre<br />
(8 triangles équilatéraux) (2 x 4 triangles équilatéraux)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 25<br />
Aristote (384-424 av. J.-C.) envisage un univers plus tangible que celui <strong>de</strong> Platon<br />
dont la matière est irréelle. Il se livre à <strong>de</strong> multiples et minutieuses observations,<br />
surtout dans le domaine <strong>de</strong>s sciences naturelles.<br />
Pour que les modifications <strong>de</strong> la matière, la réalisation <strong>de</strong>s potentialités <strong>de</strong>s êtres<br />
physiques, s’effectuent, il faut qu’existe comme fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> ces êtres un même<br />
substrat. Ce substrat doit pouvoir s’adapter à toutes les diversités. C’est donc une<br />
matière première amorphe dans toutes les extensions du terme et qui peut donc<br />
prendre toutes les “ formes ” possibles. Le substrat <strong>de</strong>vient matière sensible parce<br />
que s’y ajoutent <strong>de</strong>s propriétés, <strong>de</strong>s qualités, qui seront sa “ forme ”. Ces qualités<br />
sont au nombre <strong>de</strong> quatre: chaud, froid, sec, humi<strong>de</strong>, et vont par couples <strong>de</strong> contraires:<br />
chaud-sec, chaud-humi<strong>de</strong>, froid-humi<strong>de</strong>, froid-sec. Le premier <strong>de</strong> ces couples<br />
correspond à l’élément feu, le <strong>de</strong>uxième à l’air, le troisième à l’eau et le quatrième à<br />
la terre.<br />
Aristote pense, comme Platon, que les éléments peuvent se transformer les uns dans<br />
les autres. Pour cela il faut, dans le cadre <strong>de</strong> sa théorie, changer l’une <strong>de</strong>s qualités du<br />
couple en son contraire. Les <strong>de</strong>ux qualités peuvent aussi changer en même temps<br />
mais le processus est alors plus difficile.<br />
Aristote considère qu’à chaque élément correspond un lieu vers lequel il tend naturellement.<br />
Le feu se porte à la “ limite ”, c’est-à-dire qu’il monte. L’élément terre se<br />
porte vers le “ centre ”: il <strong>de</strong>scend. C’est là une tentative pour interpréter le lourd et<br />
le léger par une référence, par une propriété interne, à la matière. La “pensanteur”,<br />
l’“ attraction universelle” ne seront découvertes et étudiées que bien plus tard au<br />
XVIIe siècle par Newton.<br />
Le changement et le mouvement s’observent dans la nature car il existe un Moteur<br />
primordial parfait. Etant parfait il est ce vers quoi tout tente <strong>de</strong> se rapprocher. C’est<br />
cette profon<strong>de</strong> aspiration <strong>de</strong>s choses vers lui qui les anime et les fait évoluer, les fait<br />
changer <strong>de</strong> “forme ”.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 26<br />
Les théories <strong>de</strong>s éléments dans leurs conceptions les plus élaborées, telles que les ont<br />
conçues Platon et Aristote, avec <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> transmutation d’un élément en<br />
un autre, soulèveront <strong>de</strong> grands espoirs chez les penseurs du Moyen Age en qui la<br />
fièvre d’expérimentation sera vive. On peut dire qu’Aristote surtout est partiellement<br />
à l’origine <strong>de</strong>s efforts ultérieurs <strong>de</strong>s alchimistes. Les notions élémentales rencontreront<br />
un terrain si favorable que l’atomisme, dont nous allons examiner la théorie,<br />
sera complètement délaissé à l’époque médiévale.<br />
4.1.2. La théorie atomique<br />
Pour Leucippe, né vers 480 av. J.-C., définir la matière, l’existence, c’est-à-dire l’Etre,<br />
implique aussi la définition du non-Etre, <strong>de</strong> ce qui n’est rien: le vi<strong>de</strong> complet. La<br />
matière et le vi<strong>de</strong> doivent donc intervenir tous <strong>de</strong>ux au niveau même <strong>de</strong> la constitution<br />
du mon<strong>de</strong>. Il s’ensuit que la matière n’est pas uniformément pleine. Ni homogène,<br />
ni continue, celle-ci peut être divisée en ses pleins et en son vi<strong>de</strong>. Ces parties<br />
<strong>de</strong> plein, les Grecs les appelleront “ atomes ”: ce que l’on ne peut couper. Chaque<br />
atome est ainsi un univers clos, complet, qui ressemble à l’univers global <strong>de</strong> Parméni<strong>de</strong>.<br />
Ces idées furent développées surtout par Démocrite (460-360 av. J.-C.), élève <strong>de</strong> Leucippe.<br />
Démocrite pense que rien ne permet d’attribuer une forme déterminée aux<br />
atomes. L’immense diversité <strong>de</strong>s géométries que cela implique, alliée aux multiples<br />
façons dont les atomes peuvent s’assembler mécaniquement par leurs aspérités,<br />
permet d’expliquer la formation <strong>de</strong> tout ce qui existe.<br />
C’est cependant au poète romain Lucrèce (98-55 av. J.-C.) que l’on doit l’exposé le<br />
plus complet sur l’atomisme <strong>de</strong> l’Antiquité. Dans son œuvre De la nature, il décrit les<br />
conceptions du philosophe grec Epicure (341-270 av. J.-C.). Dans l’univers, il existerait<br />
un “ haut ” et un “ bas ” absolus. Les atomes emportés par leur propre “ poids ”<br />
tombent dans le vi<strong>de</strong> immense, comme <strong>de</strong>s gouttes <strong>de</strong> pluie. Une déclinaison imperceptible,<br />
due au hasard, leur permet <strong>de</strong> se rencontrer, <strong>de</strong> s’emmêler grâce à leurs<br />
aspérités, leurs crochets, <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s agrégats, c’est-à-dire <strong>de</strong> la matière.<br />
Les corps durs doivent leur cohésion à <strong>de</strong>s atomes très crochus intimement entrelacés.<br />
Les liqui<strong>de</strong>s sont formés <strong>de</strong> corpuscules lisses et ronds qui ne peuvent se maintenir<br />
réunis et roulent aisément. L’huile passe plus difficilement que le vin à travers<br />
les pores d’un filtre car ses atomes sont <strong>de</strong> plus gran<strong>de</strong> taille. Lucrèce pourra ainsi<br />
interpréter <strong>de</strong> façon mécanique par l’atomisme tous les phénomènes <strong>de</strong> la nature:<br />
goût, couleur, vision, rêves et même centaures ou fantômes !<br />
4.1.3. Devenir <strong>de</strong>s théories grecques sur la matière<br />
Epicure ne propose pas sa théorie atomique dans le but essentiel <strong>de</strong> produire un<br />
système explicatif <strong>de</strong> l’univers. Il cherche à libérer l’homme <strong>de</strong> ses angoisses. En<br />
effet l’homme a peur <strong>de</strong> la mort, <strong>de</strong> l’au-<strong>de</strong>là, du châtiment <strong>de</strong>s dieux. Or son âme,<br />
composée d’atomes très subtils, se dissocie, comme son corps, lorsqu’il meurt. Rien<br />
ne reste d’un individu puisqu’il n’est que matière. Il ne faut donc pas avoir peur<br />
d’un châtiment, d’autant que les dieux, cantonnés dans <strong>de</strong>s intermon<strong>de</strong>s, ne s’occupent<br />
pas <strong>de</strong>s affaires <strong>de</strong>s hommes.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 27<br />
Le matérialisme qui est à la base <strong>de</strong> l’atomisme oppose cette théorie à celles <strong>de</strong>s<br />
éléments. Une telle opposition est plus profon<strong>de</strong> que l’opposition mise en jeu au<br />
niveau du caractère continu ou discontinu <strong>de</strong> la matière. En effet les théories <strong>de</strong>s<br />
éléments n’aboutissent pas totalement dans leur effort <strong>de</strong> positivité et <strong>de</strong> rationalisation<br />
<strong>de</strong> la nature. Elles conservent le souvenir du temps où le feu, l’air, l’eau et la<br />
terre étaient les puissances divines dont la mythologie raconte le rôle et les aventures<br />
dans l’univers. Les éléments participent encore à quelque <strong>de</strong>gré du grand souffle<br />
divin. Aristote a besoin d’un Moteur immobile, image <strong>de</strong> la divinité pour mouvoir le<br />
mon<strong>de</strong>. L’idée <strong>de</strong> Dieu imprègne toute l’œuvre <strong>de</strong> P1aton. C’est le Dieu qui a harmonisé<br />
mathématiquement les éléments. On conçoit alors que, dans l’Antiquité et<br />
au Moyen Age, époques où l’homme avait son esprit très préoccupé <strong>de</strong> salut, <strong>de</strong><br />
divinité, la théorie atomique, du fait <strong>de</strong> son caractère matérialiste, ait eu peu ou pas<br />
du tout <strong>de</strong> succès. Les théories <strong>de</strong>s éléments correspondaient mieux à la mentalité<br />
<strong>de</strong>s individus.<br />
Il faudra attendre la Renaissance et le XVIIe siècle pour que l’homme, se tournant<br />
vers lui-même avec le courant humaniste, commence à introduire dans la chimie les<br />
conceptions atomiques. La chimie apparaîtra ainsi par la suite d’autant plus scientifique<br />
qu’elle se séparera <strong>de</strong>s notions élémentales pour intégrer en elle comme système<br />
explicatif l’atomisme. Tout le développement <strong>de</strong> la pensée chimique jusqu’à<br />
nos jours dépendra donc <strong>de</strong>s influences respectives <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux systèmes théoriques<br />
conçus par les philosophes grecs. Chacun d’entre eux sera tour à tour repris, délaissé,<br />
enrichi, ou même allié à l’autre dans un essai <strong>de</strong> synthèse.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 28<br />
4.2. LA MÉDECINE EN GRÈCE ANTIQUE<br />
La mé<strong>de</strong>cine grecque apparaît comme un art déjà ancien dans l’Ilia<strong>de</strong> et l’Odyssée,<br />
oeuvres traditionnellement attribuées à Homère, un poète qui aurait vécu au 8e siècle<br />
av. J.-C. Dans l’Ilia<strong>de</strong> plus d’une centaine <strong>de</strong> types <strong>de</strong> blessures sont décrits. La<br />
chirurgie grecque est déjà bien développée à cette époque.<br />
4.2.1. <strong>DES</strong> DIEUX GUÉRISSEURS<br />
À côté <strong>de</strong> ce savoir rationnel et pratique, se maintiennent <strong>de</strong>s conceptions plus transcendantales.<br />
Les anciens Grecs connaissent en effet <strong>de</strong> nombreux dieux et <strong>de</strong>mi-dieux<br />
guérisseurs. Ces divinités peuvent provoquer <strong>de</strong>s maladies par courroux, par vengeance<br />
ou par punition à la suite d’un sacrilège. Elles peuvent également guérir les<br />
maladies. Contrairement à celles <strong>de</strong>s Mésopotamiens et <strong>de</strong>s Égyptiens, ces divinités<br />
ont le plus souvent une forme humaine.<br />
• Apollon est le dieu-guérisseur le plus puissant.<br />
• L’immortel centaure Chiron enseigne la mé<strong>de</strong>cine et pratique la chirurgie.<br />
• Asklépios — en latin Esculape —, fils d’Apollon et <strong>de</strong> la nymphe Coronis, a été<br />
l’élève <strong>de</strong> Chiron qui lui a appris à soigner les mala<strong>de</strong>s “par la parole, les simples 6 et<br />
le couteau”.<br />
Au départ, Asklépios apparaît encore comme un roi grec en même temps grand mé<strong>de</strong>cin. Ses<br />
guérisons miraculeuses — il sait même faire ressusciter <strong>de</strong>s morts — provoquent la colère <strong>de</strong> Pluton,<br />
dieu <strong>de</strong> l’enfer, qui se plaint à Zeus. Craignant qu’Asklépios ne change l’ordre du mon<strong>de</strong>,<br />
Zeus le foudroie, mais le place dans l’Olympe au rang <strong>de</strong>s autres dieux.<br />
• Parmi les <strong>de</strong>scendants d’Asklépios, se trouvent <strong>de</strong>ux filles dont les noms ont donné<br />
naissance à <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine:<br />
◊ Hygie (Hygieia), déesse <strong>de</strong> la santé, qui enseigne les manières les plus saines <strong>de</strong><br />
mener notre vie. Son nom est à l’origine du mot “hygiène”, science qui traite <strong>de</strong><br />
la santé humaine, <strong>de</strong>s règles et <strong>de</strong>s conditions d’existence nécessaires pour la<br />
conserver.<br />
◊ Panacée (Panakeia), déesse <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine. Son nom se retrouve dans le mot<br />
“panacée” , remè<strong>de</strong> prétendu universel (allem.: Allheilmittel).<br />
6 un simple, n. m. = un médicament qui n’a subi aucune préparation pharmaceutique, ou qui ne<br />
contient qu’une seule substance.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 29<br />
Achille pansant son ami Patrocle blessé lors <strong>de</strong> la lutte pour Troie.<br />
Coupe grecque du Ve siècle av. J.-C.<br />
Le dieu guérisseur Asklépios (Esculape)<br />
avec un bâton autour duquel s'est enroulé un serpent. Le coq représente une offran<strong>de</strong>.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 30<br />
La mé<strong>de</strong>cine théurgique␣ 7 et le culte d’Asklépios<br />
À partir du 7e siècle av. J.-C., le culte d’Asklépios s’étend en Grèce. Des sanctuaires<br />
dédiés à Asklépios — les asklépiéions — surgissent un peu partout, dans la péninsule<br />
et les îles, tout aussi bien qu’en Asie Mineure. L’un <strong>de</strong>s plus prestigieux a été<br />
celui d’Épidaure; l’un <strong>de</strong>s mieux conservés est celui <strong>de</strong> Cos.<br />
Les prêtres attachés à ces temples — les asclépia<strong>de</strong>s 8 — y soignent les mala<strong>de</strong>s. Le<br />
traitement comprend l’établissement <strong>de</strong> l’anamnèse 9 , <strong>de</strong>s bains, <strong>de</strong>s prières et <strong>de</strong>s<br />
offran<strong>de</strong>s à Asklépios et à ses enfants. Il se caractérise surtout par la pratique <strong>de</strong><br />
l’incubation: le mala<strong>de</strong> passe la nuit dans le temple. Le dieu ou ses enfants le guérissent<br />
pendant son sommeil et lui donnent <strong>de</strong>s conseils sous forme <strong>de</strong> rêve. Au réveil,<br />
les prêtres-mé<strong>de</strong>cins interprètent ce rêve et en dérivent leur thérapeutique.<br />
Dans les temples étaient élevés <strong>de</strong>s serpents inoffensifs (Couleuvre d’Esculape,<br />
Äskulapnatter, taille ad 2 m) qui étaient censés intervenir eux aussi dans le traitement<br />
nocturne. Il arrivait même qu’ils vinssent lécher les yeux <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s — les<br />
ophtalmies étaient fréquentes à l’époque — et les blessures ouvertes.<br />
Le traitement était payant. En signe <strong>de</strong> reconnaissance, le mala<strong>de</strong> guéri offrait souvent<br />
au dieu un ex-voto représentant l’organe ou le membre mala<strong>de</strong>. Les prêtres gravaient<br />
sur <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s stèles ou <strong>de</strong>s plaques en pierre le compte rendu <strong>de</strong>s guérisons<br />
particulièrement miraculeuses.<br />
Le culte d’Asklépios n’est pas sans rappeler celui d’Imhotep. Asklépios est en fait la<br />
version grecque d’Imhotep!<br />
Le bâton d’Asklépios et le caducée<br />
Asklépios se faisait accompagner par un serpent, symbole <strong>de</strong> la pru<strong>de</strong>nce et <strong>de</strong>s forces<br />
souterraines, du renouveau et <strong>de</strong> la régénération (mue du serpent!). Dès le 6 e s.<br />
av. J.-C., Asklépios est représenté ayant en main un bâton sur lequel s’enroule un<br />
serpent. Nous retrouvons aujourd’hui ce bâton et ce serpent dans l’emblème <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins, le caducée (Äskulapstab).<br />
Le serpent apparaît <strong>de</strong> même dans l’emblême <strong>de</strong>s pharmaciens. Là il s’enroule autour<br />
d’un vase (la coupe d’Hygie). Par analogie avec les mé<strong>de</strong>cins cet emblème est le<br />
“caducée” <strong>de</strong>s pharmaciens.<br />
7 théurgie, n. f. (gr. : theos = dieu, ergon = ouvrage, travail) = sorte <strong>de</strong> magie par laquelle on prétendait<br />
se mettre en rapport avec les divinités bienfaisantes. Théurgique = qui a rapport à la théurgie. Théurge,<br />
n.m. = quelqu’un qui adhère aux doctrines théurgistes ou qui les pratique.<br />
8 Le terme d’asclépia<strong>de</strong>s est également utilisé pour désigner <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins qui prétendaient <strong>de</strong>scendre<br />
d’Asklépios. Voir le chapitre sur Hippocrate.<br />
9 anamnèse, n.f. = renseignements fournis par le sujet interrogé sur son passé et sur l’histoire <strong>de</strong> sa<br />
maladie (en allem.: Anamnese = Vorgeschichte einer Krankheit).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 31<br />
L'asclépiéion <strong>de</strong> Cos<br />
asclépiéion = sanctuaire d'Asklépios (Asclépios) où les mala<strong>de</strong>s venaient chercher <strong>de</strong>s secours. Le plus<br />
grand a été celui d'Épidaure, d'autres se sont trouvés à Athènes, Cni<strong>de</strong>, Pergame, Smyrne.<br />
caducée <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
Äskulapstab<br />
staff of Asclepius<br />
caducée <strong>de</strong>s pharmaciens<br />
coupe d’Hygie et serpent
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 32<br />
4.2.2. HIPPOCRATE, LE “PÈRE DE LA MÉDECINE”<br />
Avec Hippocrate la mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>vient rationnelle et se détache <strong>de</strong> ses racines religieuses.<br />
Hippocrate est né vers 460 dans l’île <strong>de</strong> Cos (Kos), proche <strong>de</strong>s côtes d’Asie Mineure<br />
et où existait un asklépiéion. 10<br />
Sa biographie est assez imprécise, souvent influencée par la légen<strong>de</strong>. Hippocrate<br />
apprend la mé<strong>de</strong>cine auprès <strong>de</strong> son père Héracli<strong>de</strong> qui est mé<strong>de</strong>cin et prétend comme<br />
tant d’autres <strong>de</strong>scendre d’Asklépios. Le jeune Hippocrate complète son instruction<br />
sans doute aussi en étudiant les cas <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s traités dans l’asclépéion <strong>de</strong> son île<br />
natale. À l’âge <strong>de</strong> vingt ans, Hippocrate quitte l’île <strong>de</strong> Cos et parcourt la Grèce comme<br />
“pério<strong>de</strong>ute”, mé<strong>de</strong>cin voyageur. Il séjourne peut-être en Égypte et en Scythie 11 , certainement<br />
en Asie Mineure. Puis, il retourne dans l’île <strong>de</strong> Cos où il enseigne la mé<strong>de</strong>cine<br />
— sous un platane, selon la légen<strong>de</strong> — et il y écrit <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Plus tard, il reprend ses voyages. Il est mort vers 370 à Larissa, en Thessalie.<br />
Toutes ces données biographiques sont incertaines. Parmi les légen<strong>de</strong>s qui se sont<br />
tissées autour <strong>de</strong> la vie d’Hippocrate, citons celle selon laquelle il aurait refusé <strong>de</strong><br />
soigner le roi <strong>de</strong>s Perses Artaxerxès 12 , en dépit<br />
<strong>de</strong>s présents magnifiques qui lui auraient été offerts.<br />
Par ailleurs, il aurait sauvé Athènes assiégée<br />
par les Spartiates et envahie par la “peste” (vers<br />
430 av. J.-C.) en conseillant aux Athéniens d’allumer<br />
dans tous les carrefours <strong>de</strong> grands feux d’herbes<br />
aromatiques pour purifier l’air et chasser ainsi<br />
le fléau. Il est cependant établi qu’à l’époque Hippocrate<br />
n’était pas à Athènes.<br />
Hippocrate (vers 460 - 370)<br />
10 Hippocrate serait né dans l’antique capitale <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> Cos, la ville d’Astypalaia, située dans l’extrémité<br />
ouest <strong>de</strong> l’île, à proximité <strong>de</strong> l’actuel village <strong>de</strong> Kefalos. On y a découvert les restes d’un asklépiéion<br />
mineur. Astypalaia a été détruite par un séisme en 413-412 av. J.-C. Les habitants ont fini par l’abandonner<br />
et beaucoup se sont regroupés dans l’extrémité est <strong>de</strong> l’île pour y fon<strong>de</strong>r l’actuelle ville <strong>de</strong><br />
Cos, qui est <strong>de</strong>venue la nouvelle capitale <strong>de</strong> l’île. Selon certains auteurs la construction du fameux<br />
asklépiéion <strong>de</strong> Cos, situé à quelques kilomètres du centre <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Cos, date <strong>de</strong> cette époque<br />
(vers 366 av. J.-C.) (A. Krug: Heilkunst und Heilkult. C.H. Beck, 1985). Si cette chronologie est exacte,<br />
Hippocrate n’aurait donc pas connu ce nouvel asklépiéion, mais tout au plus celui d’Astypalaia, et il<br />
serait évi<strong>de</strong>nt qu’il n’aurait jamais enseigné sous un platane à Cos, comme le racontent les gui<strong>de</strong>s<br />
touristiques.<br />
11 ancienne région au nord <strong>de</strong> la mer Noire et à l’est <strong>de</strong> la mer Caspienne.<br />
12 Artaxerxès I er (465-425 av. J.-C.), roi <strong>de</strong> Perse; vaincu par les Grecs, il fut obligé <strong>de</strong> renoncer, par la<br />
paix <strong>de</strong> Cimon (449 av. J.-C.), à la domination <strong>de</strong>s cités grecques d’Asie.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 33<br />
Le Corpus hippocratique (Corpus hippocraticum)<br />
Hippocrate a été longtemps considéré comme l’auteur <strong>de</strong> nombreux ouvrages médicaux<br />
qui ont été regroupés sous le titre <strong>de</strong> Corpus hippocraticum. En fait, quelquesuns<br />
seulement <strong>de</strong> ces ouvrages sont dus à Hippocrate. La rédaction <strong>de</strong>s autres est<br />
due à divers auteurs et s’est étendue sur une longue pério<strong>de</strong> allant <strong>de</strong> 400 av. J.-C. à<br />
100 après J.-C. Ces écrits hippocratiques reflètent la doctrine <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
Cos inspirée par Hippocrate.<br />
Une édition complète <strong>de</strong>s textes<br />
éparpillés dans les bibliothèques du<br />
mon<strong>de</strong> a été réalisée au 19 e s. par<br />
Littré 13 . Elle comprend une soixantaine<br />
d’écrits, dont:<br />
• Des airs, <strong>de</strong>s eaux et <strong>de</strong>s lieux. [une<br />
sorte <strong>de</strong> traité antique d’écologie<br />
humaine]<br />
• De la maladie sacrée. [= épilepsie]<br />
• De l’art.<br />
• Des fractures.<br />
• Des articulations.<br />
«Corpus Hippocraticum»<br />
page <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong> la première édition<br />
en latin (Rome, 1525).<br />
Les principes <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine hippocratique<br />
La mé<strong>de</strong>cine hippocratique comprend quatre éléments fondamentaux <strong>de</strong> l’action du<br />
mé<strong>de</strong>cin:<br />
• Elle remplace la tradition orale par <strong>de</strong>s textes écrits.<br />
• Elle prône l’établissement d’un diagnostic par l’interrogatoire et l’examen du mala<strong>de</strong>:<br />
le mé<strong>de</strong>cin procè<strong>de</strong> à un entretien avec le mala<strong>de</strong>; il le regar<strong>de</strong>, le touche,<br />
13 Ces Oeuvres complètes d’Hippocrate en 10 volumes sont parues <strong>de</strong> 1839-1861. Émile Littré (1801-<br />
1881), lexicographe et philosophe français, célèbre surtout par son Dictionnaire <strong>de</strong> la langue française, 4<br />
vol, 1863-1872.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 34<br />
palpe le corps souffrant. Il tient compte <strong>de</strong> l’anamnèse, <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> vie du<br />
mala<strong>de</strong> et <strong>de</strong>s conditions climatiques du lieu d’habitation.<br />
• Elle formule un pronostic.<br />
• Elle propose un traitement adéquat. La thérapeutique peut être diététique, médicamenteuse<br />
ou chirurgicale.<br />
La nature <strong>de</strong> la maladie et la doctrine <strong>de</strong>s quatre humeurs<br />
La mé<strong>de</strong>cine hippocratique relie le microcosme (corps humain) au macrocosme (univers).<br />
Selon le philosophe Empédocle d’Agrigente (504-433 av. J.-C.) le macrocosme<br />
comprend 4 éléments fondamentaux: le feu, la terre, l’eau et l’air. Sur ces 4 éléments se<br />
plaquent les caractères suivants: le chaud, le sec, le froid et l’humi<strong>de</strong>.<br />
Pour les mé<strong>de</strong>cins hippocratiques le corps humain comprend <strong>de</strong>s parties soli<strong>de</strong>s et<br />
quatre humeurs (analogie avec les quatre éléments):<br />
• le sang, originaire du coeur;<br />
• la pituite 14 ou phlegme, originaire du cerveau;<br />
• la bile jaune, originaire du foie;<br />
• la bile noire ou atrabile, originaire <strong>de</strong> la rate.<br />
La santé est le résultat <strong>de</strong> l’équilibre et du mélange harmonieux (eucrasie) <strong>de</strong> ces<br />
quatre humeurs. La maladie résulte d’un déséquilibre (dyscrasie) <strong>de</strong> ces quatre humeurs<br />
du corps. 15<br />
La cause primordiale <strong>de</strong> la maladie est une substance nuisible (matière ou humeur<br />
pectante, materia peccans); elle peut se former dans le corps lui-même ou être introduite<br />
<strong>de</strong> l’extérieur. C’est elle qui provoque la dyscrasie. Le corps réagit contre cette<br />
matière nuisible par <strong>de</strong>s réactions s’accompagnant d’une production accrue <strong>de</strong> chaleur<br />
(pepsis = coction). La fièvre est le résultat <strong>de</strong> cette coction. La guérison se fait par<br />
la <strong>de</strong>struction ou l’élimination <strong>de</strong> la matière pectante, et le rétablissement <strong>de</strong> l’eucrasie.<br />
Si un reste <strong>de</strong> matière nuisible non «digérée» subsiste dans le corps, le mal <strong>de</strong>vient<br />
chronique. Si le corps succombe complètement aux influences nuisibles, la dyscrasie<br />
va en augmentant, et le mala<strong>de</strong> meurt.<br />
14 lat. pituita = humeur, mucus. Le dictionnaire mo<strong>de</strong>rne désigne sous le terme “pituite” la mucosité<br />
<strong>de</strong>s fosses nasales ou le liqui<strong>de</strong> filant, aqueux, que les alcooliques ou les sujets atteints <strong>de</strong> gastrite<br />
ren<strong>de</strong>nt le matin à jeun.<br />
15 en grec: eu = bien, dys = mauvais, krasis = mélange.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 35<br />
La théorie <strong>de</strong>s 4 éléments<br />
HIPPOCRATE (400) ARISTOTE (340)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 36<br />
(Coeur)<br />
SANG<br />
(Sanguin)<br />
AIR<br />
LES QUATRE HUMEURS,<br />
LES QUATRE ÉLÉMENTS<br />
ET LES QUATRE TEMPÉRAMENTS<br />
Chaud<br />
Humi<strong>de</strong><br />
(Foie)<br />
BILE JAUNE<br />
(Cholérique)<br />
FEU<br />
Sec<br />
Froid<br />
(Cerveau)<br />
PHLEGME OU PITUITE<br />
(Phlegmatique)<br />
EAU<br />
(Rate)<br />
BILE NOIRE<br />
(Mélancholique)<br />
TERRE
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 37<br />
(d’après P. Schneck, Geschichte <strong>de</strong>r Medizin systematisch)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 38<br />
La théorie <strong>de</strong>s 4 humeurs sera développée davantage par Aristote (384-322 av. J.-C.)<br />
et Galien (130-200) et <strong>de</strong>viendra la théorie dominante du Moyen Âge et <strong>de</strong>s siècles<br />
suivants. Elle a fourni la base <strong>de</strong>s techniques d’évacuations: saignée (A<strong>de</strong>rlaß), application<br />
<strong>de</strong> ventouses avec ou sans scarification, purgation, vomissements, sudation,<br />
éternuements, etc.<br />
Plus tard, probablement à partir du Moyen Âge seulement, un tempérament particulier<br />
a été associé à l’abondance relative <strong>de</strong> chaque humeur, reliant ainsi la physiologie<br />
à la psychologie:<br />
• le sanguin (Sanguiniker), dominance du sang;<br />
• le cholérique (Choleriker), dominance <strong>de</strong> la bile jaune:<br />
• le mélancolique ou atrabilaire (Melancholiker), dominance <strong>de</strong> la bile noire;<br />
• le phlegmatique (Phlegmatiker), dominance du phlegme.<br />
Le sanguin<br />
Le cholérique<br />
(colérique)<br />
LES 4 TEMPÉRAMENTS<br />
(d'après Versehung <strong>de</strong>s Leibs, Augsburg, 1491)<br />
Le mélancolique<br />
Le phlegmatique<br />
(flegmatique)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 39<br />
Le serment d’Hippocrate<br />
Le célèbre serment d’Hippocrate qui figure également dans le Corpus hippocraticum<br />
n’est pas dû à la plume d’Hippocrate. Il s’agit vraisemblablement d’un serment véritable<br />
prononcé non pas par tous les nouveaux mé<strong>de</strong>cins, mais par ceux d’un certain<br />
groupe, peut-être celui <strong>de</strong>s pythagoriciens 16 . On a cru voir leur marque dans les<br />
clauses favorables à la conservation <strong>de</strong> la vie à tout prix (hostilité à l’égard <strong>de</strong> l’avortement,<br />
interdiction du poison), l’horreur du sang versé (refus <strong>de</strong> l’opération <strong>de</strong> la<br />
taille d’un calcul urinaire).<br />
Je jure par Apollon mé<strong>de</strong>cin, par Esculape, par<br />
Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les<br />
déesses, les prenant à témoin que je remplirai,<br />
suivant mes forces et ma capacité, le serment et<br />
l’engagement suivants:<br />
Je mettrai mon maître <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine au même<br />
rang que les auteurs <strong>de</strong> mes jours, je partagerai<br />
avec lui mon savoir, et, le cas échéant, je pourvoirai<br />
à ses besoins; je tiendrai ses enfants pour<br />
<strong>de</strong>s frères, et, s’ils désirent apprendre la mé<strong>de</strong>cine,<br />
je la leur enseignerai sans salaire ni engagement.<br />
Je ferai part <strong>de</strong>s préceptes, <strong>de</strong>s leçons<br />
morales et du reste <strong>de</strong> l’enseignement à mes fils,<br />
à ceux <strong>de</strong> mon maître, et aux disciples liés par<br />
un engagement et un serment suivant la loi médicale,<br />
mais à nul autre.<br />
Je dirigerai le régime <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s à leur avantage,<br />
suivant mes forces et mon jugement, et je<br />
m’abstiendrai <strong>de</strong> tout mal et <strong>de</strong> toute injustice.<br />
Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>, ni ne prendrai l’initiative d’une pa-<br />
Le serment d’Hippocrate<br />
Quelques aphorismes d’Hippocrate<br />
reille suggestion; semblablement, je ne remettrai<br />
à aucune femme un pessaire abortif.<br />
Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans<br />
l’innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas<br />
l’opération <strong>de</strong> la taille, je la laisserai aux gens<br />
qui s’en occupent. Dans quelque maison que<br />
j’entre, j’y entrerai pour l’utilité <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s, me<br />
préservant <strong>de</strong> tout méfait volontaire et corrupteur,<br />
et surtout <strong>de</strong> la séduction <strong>de</strong>s femmes et<br />
<strong>de</strong>s garçons, libres ou esclaves. Quoi que je voie<br />
ou enten<strong>de</strong> dans la société pendant l’exercice ou<br />
même hors <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong> ma profession, je<br />
tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué,<br />
regardant la discrétion comme un <strong>de</strong>voir en<br />
pareil cas.<br />
Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il<br />
me soit donné <strong>de</strong> jouir heureusement <strong>de</strong> la vie<br />
et <strong>de</strong> ma profession, honoré à jamais parmi les<br />
hommes; si je le viole et que je me parjure,<br />
puissé-je avoir un sort contraire!<br />
(Traduction <strong>de</strong> Littré)<br />
De nombreux aphorismes écrits en grec ancien n’ont plus <strong>de</strong> sens dans le vocabulaire<br />
actuel. D’autres ont toute leur valeur et témoignent d’une bonne observation.<br />
• La vie est courte, l’art est long (vita brevis, ars longa), l’occasion fugitive, l’expérience<br />
trompeuse, le jugement difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui<br />
convient, mais encore faire que le mala<strong>de</strong>, les assistants et les choses extérieures y<br />
concourent.<br />
• Restaurer avec lenteur les corps amaigris lentement, et rapi<strong>de</strong>ment les corps amaigris<br />
en peu <strong>de</strong> temps.<br />
16 École s’inspirant <strong>de</strong>s concepts philosophiques du mathématicien Pythagore (vers 570-497/96) (“le<br />
mon<strong>de</strong> entier n’est qu’harmonie et arithmétique”). D’après cette école, la santé résulte <strong>de</strong> l’harmonie<br />
<strong>de</strong>s composants du corps, la maladie est le fait <strong>de</strong> la dysharmonie <strong>de</strong> ces composants.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 40<br />
• Les maladies qui proviennent <strong>de</strong> plénitu<strong>de</strong> sont guéries par évacuation, celles<br />
qui proviennent <strong>de</strong> vacuité par réplétion, et en général les contraires par les<br />
contraires (Contraria contrariis curantur) 17 .<br />
• Les personnes qui ont naturellement beaucoup d’embonpoint sont plus exposées<br />
que les maigres à une mort subite.<br />
• Ceux qui sont pris <strong>de</strong> tétanos meurent en quatre jours; s’ils dépassent ce terme,<br />
ils guérissent.<br />
• L’épilepsie qui survient avant la puberté est susceptible <strong>de</strong> guérison; mais celle<br />
qui survient à vingt-cinq ans ne finit ordinairement qu’avec la vie.<br />
• Ceux qui <strong>de</strong>viennent bossus à la suite d’asthme ou <strong>de</strong> toux avant la puberté,<br />
périssent. [tuberculose vertébrale et pulmonaire ?]<br />
(Le corps humain est constitué par quatre<br />
humeurs, dont le juste tempérament<br />
est la condition <strong>de</strong> la santé.)<br />
Le corps <strong>de</strong> l’homme a en lui sang, pituite, bile<br />
jaune et noire; c’est là ce qui en constitue la nature<br />
et ce qui y crée la maladie et la santé. Il y a<br />
essentiellement santé quand ces principes sont<br />
dans un juste rapport <strong>de</strong> crase, <strong>de</strong> force et <strong>de</strong><br />
quantité, et que le mélange en est parfait; il y a<br />
maladie quand un <strong>de</strong> ces principes est soit en<br />
défaut soit en excès, ou, s’isolant dans le corps,<br />
n’est pas combiné avec tout le reste. Nécessairement,<br />
en effet, quand un <strong>de</strong> ces principes<br />
s’isole et cesse <strong>de</strong> se subordonner, non-seulement<br />
le lieu qu’il a quitté s’affecte, mais celui<br />
où il s’épanche s’engorge et cause douleur et<br />
travail. Si quelque humeur flue hors du corps<br />
plus que ne le veut la surabondance, cette éva-<br />
Extraits du traité<br />
DE LA NATURE DE L’HOMME<br />
L’auteur <strong>de</strong> ce traité est Polybe, disciple et gendre d’Hippocrate. Sa rédaction se situe<br />
vers l’extrême fin du 5 e s. av. J.-C. Il développe une théorie <strong>de</strong> la nature humaine physique<br />
en commençant par s’attaquer aux monistes qui estiment que celle-ci est réductible à un<br />
élément unique, pour les uns c’est l’air, pour les autres le feu, pour d’autres encore l’eau<br />
ou la terre, selon le cas. Pour l’école hippocratique ce sont ces quatre humeurs toutes<br />
ensembles qui constituent le corps humain.<br />
cuation engendre la souffrance. Si, au contraire,<br />
c’est en <strong>de</strong>dans que se font l’évacuation, la métastase,<br />
la séparation d’avec les autres humeurs,<br />
on a fort à craindre, suivant ce qui a été dit, une<br />
double souffrance, à savoir au lieu quitté et au<br />
lieu engorgé.<br />
(Les quatre humeurs sont manifestement<br />
distinctes l’une <strong>de</strong> l’autre.)<br />
J’ai promis <strong>de</strong> démontrer que les principes qui<br />
constituent l’homme suivant moi, sont toujours<br />
les mêmes, et dans le langage reçu, et dans la<br />
nature; or, je dis que ce sont le sang, la pituite,<br />
et la bile jaune et noire. Et d’abord, remarquonsle,<br />
dans l’usage ces humeurs ont <strong>de</strong>s noms distincts<br />
qui ne se confon<strong>de</strong>nt pas; ensuite, dans<br />
la nature, les apparences n’en sont pas moins<br />
diverses, et ni la pituite ne ressemble au sang,<br />
17 principe fondamental <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine allopathique, opposé à l’axiome fondamental <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine<br />
homéopathique: Similia similibus curantur (les semblables se soignent par les semblables). La mé<strong>de</strong>cine<br />
hippocratique a eu recours aux <strong>de</strong>ux principes, selon le cas.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 41<br />
ni le sang à la bile, ni la bile à la pituite. En effet,<br />
quelle similitu<strong>de</strong> y aurait-il entre <strong>de</strong>s substances<br />
qui ne présentent ni la même couleur à la<br />
vue, ni la même sensation au toucher, n’étant ni<br />
chau<strong>de</strong>s, ni froi<strong>de</strong>s, ni sèches, ni humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
même manière? Il faut donc, avec une telle dissemblance<br />
d’apparence et <strong>de</strong> propriétés, qu’elles<br />
ne soient pas i<strong>de</strong>ntiques, s’il est vrai que le<br />
feu et l’eau ne sont pas une seule et même substance.<br />
On peut se convaincre qu’elles ne sont<br />
pas en effet i<strong>de</strong>ntiques, mais que chacune a une<br />
vertu et une nature particulière: donnez à un<br />
homme un médicament phlegmagogue, il vomit<br />
<strong>de</strong> la pituite; un médicament cholagogue, il<br />
vomit <strong>de</strong> la bile; <strong>de</strong> même <strong>de</strong> la bile noire est<br />
évacuée si vous administrez un médicament qui<br />
agisse sur la bile noire; enfin, blessez quelque<br />
point du corps <strong>de</strong> manière à faire une plaie, du<br />
sang s’écoulera. Et cela se produira <strong>de</strong>vant vous<br />
chaque jour et chaque nuit, l’hiver comme l’été,<br />
tant que l’homme pourra attirer en lui le souffle<br />
et le renvoyer; il le pourra jusqu’à ce qu’il<br />
soit privé <strong>de</strong> quelqu’une <strong>de</strong>s choses congénitales.<br />
Or, ces principes que j’ai dénommés sont<br />
congénitaux. Comment, en effet, ne le seraientils<br />
pas ? D’abord, l’homme les a évi<strong>de</strong>mment<br />
en lui sans interruption tant qu’il vit; puis il est<br />
né d’un être humain les ayant tous, et il a été<br />
nourri dans un être humain les ayant tous aussi,<br />
à savoir ces principes qu’ici je nomme et démontre.<br />
(Description confuse <strong>de</strong>s veines.)<br />
Les plus grosses veines sont ainsi disposées: il<br />
y en a quatre paires dans le corps. L’une <strong>de</strong> ces<br />
paires, partant <strong>de</strong> <strong>de</strong>rrière la tête, passe par le<br />
cou, parcourt en arrière le rachis et arrive à<br />
droite et à gauche aux hanches et aux membres<br />
inférieurs, puis gagne par les jambes les malléoles<br />
externes et les pieds. Il faut donc faire à<br />
la partie externe <strong>de</strong>s jarrets et <strong>de</strong>s malléoles les<br />
saignées que l’on pratique pour les douleurs du<br />
dos et <strong>de</strong>s hanches. Les veines <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong><br />
paire, nommées jugulaires, viennent <strong>de</strong> la tête<br />
près <strong>de</strong>s oreilles, passent par le cou, longent le<br />
rachis en avant <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux cotés, et arrivent le long<br />
<strong>de</strong>s lombes aux testicules et aux cuisses, puis<br />
par la partie interne <strong>de</strong>s jarrets et par les jambes<br />
aux malléoles internes et aux pieds. Il faut donc<br />
dans les douleurs <strong>de</strong>s lombes et <strong>de</strong>s testicules<br />
faire <strong>de</strong>s saignées au côté interne <strong>de</strong>s jarrets et<br />
aux malléoles internes. La troisième paire <strong>de</strong><br />
veines se rend <strong>de</strong>s tempes par le col aux omoplates,<br />
puis se porte au poumon et arrive, celle<br />
du côté droit à gauche, celle du côté gauche à<br />
droite, celle <strong>de</strong> droite allant du poumon dans la<br />
mamelle, à la rate et au rein, celle <strong>de</strong> gauche allant<br />
du poumon à droite dans la mamelle, au<br />
foie et au rein, toutes <strong>de</strong>ux finissant à l’anus. La<br />
quatrième paire va du <strong>de</strong>vant <strong>de</strong> la tête et <strong>de</strong>s<br />
yeux sous le cou et les clavicules, puis d’en haut<br />
par les bras au pli du cou<strong>de</strong>, puis par les avantbras<br />
aux carpes et aux doigts, puis <strong>de</strong>s doigts<br />
elle remonte par les paumes <strong>de</strong>s mains et les<br />
avant-bras au pli du cou<strong>de</strong>, par la partie inférieure<br />
<strong>de</strong>s bras aux aisselles, et d’en haut, par<br />
les côtes, l’une se rend à la rate, l’autre au foie,<br />
toute <strong>de</strong>ux allant se terminer par le ventre aux<br />
parties génitales. Telle est la distribution <strong>de</strong>s<br />
grosses veines. Il est aussi <strong>de</strong>s veines venant du<br />
ventre qui sont distribuées dans le corps en<br />
grand nombre et <strong>de</strong> toute façon, et par lesquelles<br />
la nourriture arrive aux parties. D’autre part<br />
les grosses veines en fournissent qui se ren<strong>de</strong>nt<br />
tant du <strong>de</strong>dans que du <strong>de</strong>hors au ventre et au<br />
reste du corps, et qui communiquent entre elles<br />
les unes <strong>de</strong> <strong>de</strong>dans en <strong>de</strong>hors et les autres <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>hors en <strong>de</strong>dans. C’est donc d’après ces considérations<br />
qu’il faut pratiquer les saignées; mais<br />
il faut avoir soin qu’elles soient aussi loin que<br />
possible du lieu où les douleurs se font sentir<br />
d’habitu<strong>de</strong> et où le sang se rassemble. De cette<br />
façon, en effet, il ne se fera pas soudainement<br />
un grand changement, et en rompant l’habitu<strong>de</strong><br />
vous empêcherez le sang <strong>de</strong> continuer à se rassembler<br />
dans le même lieu.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 42<br />
L’anatomo-physiologie hippocratique<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la forme et <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong>s parties du corps sont intimement liées chez<br />
Hippocrate.<br />
Les parties du corps<br />
Les mé<strong>de</strong>cins hippocratiques distinguent les formations qui se trouvent à l’intérieur<br />
du corps et dont les noms appartiennent au langage commun, mais ils ne les conçoivent<br />
pas comme <strong>de</strong>s parties structurées qui servent d’instruments pour accomplir<br />
<strong>de</strong>s fonctions précises.<br />
La notion abstraite d’organe manque encore et, par conséquent, celle aussi d’organisme<br />
en tant qu’unité qui dispose d’un ensemble d’organes. Le mot “organe” se<br />
trouve dans les traductions mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong>s textes hippocratiques, mais il désigne ce<br />
qui dans la version originale n’est que la “partie” du corps. La notion d’organe ne<br />
sera bien définie qu’au temps d’Aristote.<br />
Si certains textes <strong>de</strong> la Collection hippocratique (p.ex. le traité Du cœur et le livre VI<br />
<strong>de</strong>s Epidémies) l’utilisent et font preuve <strong>de</strong> connaissances anatomiques étonnamment<br />
précises, c’est qu’ils n’appartiennent à l’enseignement d’Hippocrate ni par leur date<br />
ni par leur lieu d’origine.<br />
Les cavités du corps<br />
Nous avons vu que selon Hippocrate, le corps humain se compose <strong>de</strong> parties soli<strong>de</strong>s<br />
(chairs) et d’humeurs (liqui<strong>de</strong>s). Les chairs <strong>de</strong> l’ensemble du corps forment une sorte<br />
d’éponge qui entoure quelques cavités. Le tronc possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cavités, l’inférieure et<br />
la supérieure, séparées par le diaphragme, membrane médiane dont un prolongement<br />
(le péricar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’anatomie mo<strong>de</strong>rne) enveloppe le coeur.<br />
La physiologie du mouvement<br />
La disposition <strong>de</strong>s os et le fonctionnement mécanique <strong>de</strong>s articulations sont parfaitement<br />
compris, par contre, le mouvement <strong>de</strong>s membres est attribué non pas à la<br />
contraction <strong>de</strong>s muscles mais au tiraillement <strong>de</strong>s «cordons » (traduction du pluriel<br />
neura, qui désigne dans les écrits hippocratiques aussi bien les nerfs que les tendons<br />
et les ligaments).<br />
L’anatomo-physiologie vasculaire<br />
Dans l’anatomo-physiologie vasculaire, le mot phlebs s’applique indistinctement aux<br />
veines et aux artères, les <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> vaisseaux sont donc confondus. Les <strong>de</strong>scriptions<br />
du parcours <strong>de</strong>s vaisseaux sanguins n’ont qu’un rapport assez vague avec la<br />
réalité. Cela n’a pas <strong>de</strong> conséquence pratique pour le système anatomo-physiologique<br />
d’Hippocrate, car les canaux sont seulement <strong>de</strong>s voies préférentielles, non exclusives.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 43<br />
Le mouvement <strong>de</strong>s liqui<strong>de</strong>s<br />
Aucun centre anatomique ne fait mouvoir et ne coordonne les déplacements <strong>de</strong>s<br />
liqui<strong>de</strong>s dans le corps.<br />
Le phlegme coule constamment du creux <strong>de</strong> la tête « vers le bas ». Les traces <strong>de</strong> cette<br />
opinion sont conservées dans certaines expressions mo<strong>de</strong>rnes, telles que:<br />
• le « rhume <strong>de</strong> cerveau » (« écoulement » par le nez du phlegme provenant du<br />
cerveau et suintant à travers les parois <strong>de</strong>s sinus crâniens),<br />
• le « rhumatisme » (« écoulement » du phlegme qui se fixe sur les articulations).<br />
Les conformations <strong>de</strong>s parties, leurs schêmata, déterminent <strong>de</strong> manière assez grossière<br />
les processus physiologiques et pathologiques. Les parties creuses et larges<br />
attirent les liqui<strong>de</strong>s et en sont toujours pleines (ce sont notamment la tête, l’utérus et<br />
la vessie); les creuses et déployées reçoivent passivement les liqui<strong>de</strong>s; les soli<strong>de</strong>s et<br />
arrondies n’attirent ni ne reçoivent; les spongieuses et flasques, telles que la rate, les<br />
poumons et les mamelles, absorbent les liqui<strong>de</strong>s qui arrivent à leur proximité.<br />
Les substances qui se meuvent librement dans un corps sain sont le sang et l’air. Les<br />
textes hippocratiques mentionnent la bile et le phlegme surtout dans <strong>de</strong>s contextes<br />
pathologiques. Ces <strong>de</strong>ux humeurs existent dans le corps sain mais ne sont pas perceptibles.<br />
Le renouvellement du corps<br />
Le corps humain a besoin d’être constamment renouvelé. L’apport <strong>de</strong> trois sortes <strong>de</strong><br />
substances est nécessaire pour lui donner la force et pour assurer d’abord sa croissance<br />
puis le maintien <strong>de</strong> son embonpoint:<br />
• la nourriture,<br />
• les boissons,<br />
• l’air.<br />
Les aliments sont digérés, puis assimilés. Cela se fait par une série <strong>de</strong> cuissons ou<br />
«coctions», transformations <strong>de</strong> la matière sous l’influence <strong>de</strong> la chaleur. L’air nourrit<br />
cette chaleur.<br />
Cardiocentrisme et encéphalocentrisme<br />
Certains traités du Corpus considèrent le coeur comme le siège <strong>de</strong>s sentiments et le<br />
centre <strong>de</strong> l’activité intellectuelle, alors que la majorité <strong>de</strong>s textes hippocratiques attribuent<br />
ce rôle au cerveau.<br />
Le conflit entre le cardiocentrisme et l’encéphalocentrisme n’est donc pas encore<br />
résolu <strong>de</strong> manière univoque.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 44<br />
Conclusion<br />
Les faiblesses <strong>de</strong> l’anatomo-physiologie hippocratique sautent immédiatement aux<br />
yeux:<br />
• méconnaissance du rôle <strong>de</strong> la structure dans la détermination <strong>de</strong>s processus<br />
vitaux,<br />
• approche essentiellement qualitative,<br />
• refus <strong>de</strong> la dissection ou plus exactement mépris pour ce procédé d’investigation,<br />
Résultat <strong>de</strong> ces défauts méthodologiques:<br />
• au niveau <strong>de</strong> l’anatomie:<br />
- une mauvaise connaissance <strong>de</strong>s viscères (organes internes)<br />
• au niveau <strong>de</strong> la physiologie:<br />
- <strong>de</strong>s explications fantaisistes <strong>de</strong> la plupart <strong>de</strong>s fonctions physiologiques.<br />
(d’après D. Gourevitch in Hippocrate, De l’art médical. Livre <strong>de</strong> Poche: 44s)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 45<br />
4.3. ARISTOTE, LE «PÈRE» DE LA BIOLOGIE<br />
Aristote est né à Stagire (nom mo<strong>de</strong>rne: Stavro) en Macédoine en 384 av. J.-C. et mort<br />
à Chalcis, chef-lieu <strong>de</strong> l’île d’Eubée, en 322 av. J.-C. Il est le véritable fondateur <strong>de</strong> la<br />
biologie en tant que discipline scientifique, bien qu’il ait été aussi un philosophe formé à<br />
l’Ecole <strong>de</strong> Platon. Son progrès décisif sur ce <strong>de</strong>rnier est d’avoir établi l’induction<br />
comme base <strong>de</strong> la connaissance scientifique.<br />
Aristote (384 -322 av. J.-C.)<br />
Ses principaux écrits biologiques sont:<br />
• Histoire <strong>de</strong>s animaux,<br />
• Des parties <strong>de</strong>s animaux,<br />
• De la génération <strong>de</strong>s animaux,<br />
• De l’âme.<br />
Il écrivit également un ouvrage d’anatomie<br />
et un traité <strong>de</strong> botanique qui se sont perdus<br />
ainsi que les illustrations <strong>de</strong> ses ouvrages<br />
zoologiques.<br />
Il a tenté <strong>de</strong> classer les quelque 400 espèces<br />
animales qu’il connaissait et dont il avait disséqué<br />
une cinquantaine, les divisant en <strong>de</strong>ux<br />
grands groupes:<br />
• les enaima, pourvus <strong>de</strong> sang rouge<br />
(= Vertébrés),<br />
• et les anaima, dépourvus <strong>de</strong> sang rouge<br />
(= Invertébrés).<br />
Sa conception <strong>de</strong> l’espèce (eidos) est encore actuelle, tandis que son “genre” (genos)<br />
va du sous-genre au phylum actuels.<br />
Comme morphologiste, il a établi, le premier, le principe d’homologie structurale<br />
s’opposant à la simple analogie fonctionnelle.<br />
Ses observations anatomiques ou éthologiques sur <strong>de</strong>s animaux terrestres ou aquatiques<br />
(Mollusques, Poissons) sont remarquables et certaines n’ont été confirmées<br />
qu’au siècle <strong>de</strong>rnier (ainsi les moeurs du Siluridé Parasilurus aristotelis mâle surveillant<br />
ses œufs, la pseudo-placentation du squale Mustela laevis, la locomotion <strong>de</strong> l’argonaute,<br />
ses observations sur les Cétacés et les chauves-souris qu’il est le premier à<br />
avoir placées correctement dans les Mammifères, etc.).<br />
Aristote est aussi un précurseur <strong>de</strong> l’écologie (étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s organismes en fonction du<br />
milieu) et <strong>de</strong> la biogéographie, tandis que sa physiologie est supérieure à celle <strong>de</strong>s<br />
écrits hippocratiques.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 46<br />
Hist. anim. Vl, xiv: « Les œufs les plus lents à se développer sont ceux <strong>de</strong>s silures; aussi le mâle<br />
monte-t-il la gar<strong>de</strong> jusqu’à quarante ou cinquante jours pour empêcher les petits poissons qui<br />
passent <strong>de</strong> dévorer sa progéniture »<br />
C’est la surveillance <strong>de</strong> la ponte par les poissons. Personne n‘a voulu le croire. Cuvier<br />
et Valenciennes, dans leur Histoire naturelle <strong>de</strong>s poissons (1839), ont réfuté avec mesure<br />
ce qu’Aristote avait relaté, disant que «cela revêtait un aspect un peu miraculeux». Agassiz,<br />
zoologiste à Harvard (U.S.A.) a reçu vers les années 1850, en provenance du fleuve<br />
Achéloüs en Epire, <strong>de</strong>s poissons qui sont toujours appelés localement glanos (nom<br />
qu’Aristote avait alors employé), et il a constaté que ces silures importés avaient un<br />
comportement <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong>s oeufs qui rappelait celui <strong>de</strong> quelques silures américains.<br />
Il a donc décrit en 1857, comme «nouvelle» espèce grecque <strong>de</strong> silure, le Parasilurus<br />
aristotelis et il a admis sans la moindre hésitation la relation d’Aristote dont le bien-fondé<br />
a été authentifié par <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s ultérieures. Cet exemple illustre parfaitement bien la<br />
qualité <strong>de</strong>s observations d’Aristote.<br />
Les successeurs d’Aristote<br />
Mustelus laevis (Sélaciens):<br />
coupe longitudinale d’un utérus renfermant<br />
<strong>de</strong>s foetus à divers sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
développement<br />
Argonaute:<br />
A. femelle nageant,<br />
B. mâle<br />
Théophraste (vers 370-285 av. J.-C.) succéda à Aristote qu’il connut<br />
bien, à la direction du Lycée; ce polygraphe écrivit <strong>de</strong>ux traités<br />
<strong>de</strong> botanique qui font <strong>de</strong> lui un <strong>de</strong>s fondateurs <strong>de</strong> cette discipline<br />
(avec Dioscori<strong>de</strong>, voir plus loin).<br />
Les autres savants grecs ayant contribué à l’avancement <strong>de</strong> la biologie<br />
furent tous mé<strong>de</strong>cins, dont Hérophile et Erasistrate; le premier<br />
fut surtout anatomiste, reconnaissant le cerveau comme centre<br />
du système nerveux et comme siège <strong>de</strong> l’intelligence, tandis<br />
que le second fut un physiologiste qui avait distingué les nerfs<br />
moteurs <strong>de</strong>s nerfs sensitifs. Il fut également le premier théoricien<br />
<strong>de</strong> la conception mécaniste <strong>de</strong> l’organisme humain.<br />
Théophraste
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 47<br />
La finalité chez Aristote : A chaque chose, sa fin<br />
Pour Aristote, un grand principe unissait<br />
le ciel du haut et la terre du bas: l’idée que<br />
chaque chose a une fonction dans un tout,<br />
et que, au cours du temps, la fin <strong>de</strong> chaque<br />
changement ou mouvement explique<br />
le début et toutes les étapes intermédiaires.<br />
Nous <strong>de</strong>vons apprécier la connaissance<br />
<strong>de</strong>s étoiles, si merveilleuses et éloignées,<br />
mais nous pouvons découvrir beaucoup<br />
plus facilement ce que sont les objets<br />
sur Terre, tels que les “ plantes et les<br />
animaux périssables qui croissent à côté<br />
<strong>de</strong> nous ”. Ici, encore, “ ceux qui nous en<br />
apprendront les causes pourront nous procurer<br />
d’immenses plaisirs ”. Parmi ces causes,<br />
se trouve la “ nécessité ” que la pomme<br />
tombe. Mais cela ne suffit pas. Pour Aristote,<br />
l’explication <strong>de</strong> la véritable nature <strong>de</strong><br />
toute chose passe nécessairement par l’explication<br />
<strong>de</strong> la vertu en raison <strong>de</strong> laquelle<br />
l’événement se produit ou l’objet est tel<br />
qu’il est. De telles questions ren<strong>de</strong>nt fascinantes<br />
les créatures les plus humbles.<br />
Ainsi, tous les sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> croissance d’un<br />
gland, du tout jeune plant au jeune arbre,<br />
peuvent s’expliquer par leur <strong>de</strong>stinée finale:<br />
<strong>de</strong>venir un chêne. Cette forme finale<br />
doit aussi expliquer l’existence <strong>de</strong>s feuilles,<br />
leur forme, l’écorce, les racines et toutes<br />
les autres parties. Les queues <strong>de</strong>s homards<br />
“ne sont d’aucune utilité aux crabes qui<br />
vivent près <strong>de</strong>s côtes; pour les crabes qui<br />
quittent le rivage pour la mer, les pattes<br />
sont moins adaptées pour se déplacer, et<br />
ils marchent peu. Des crabes minuscules<br />
ont leurs pattes arrière aplaties comme <strong>de</strong>s<br />
nageoires ou <strong>de</strong>s rames, <strong>de</strong> façon à les<br />
ai<strong>de</strong>r à nager. Les crevettes ont <strong>de</strong>s queues<br />
mais pas <strong>de</strong> pinces, en raison <strong>de</strong> leur grand<br />
nombre <strong>de</strong> pattes sur lesquelles s’est<br />
épuisé le matériau pour la croissance <strong>de</strong>s<br />
pinces. Mais leurs nombreuses pattes leur<br />
permettent d’assurer leur mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> progression<br />
en nageant”.<br />
Le même principe peut servir également<br />
à corréler les différences entre organes, en<br />
montrant comment ils coopèrent pour<br />
maintenir un organisme comme un tout.<br />
Ainsi, les rapaces ont <strong>de</strong>s becs crochus et<br />
<strong>de</strong>s serres aiguisées et courbées pour “ leur<br />
assurer la maîtrise sur leur proie, ceci convenant<br />
mieux à <strong>de</strong>s actes violents qu’à<br />
toute autre forme ”.<br />
Si toutes les parties contribuent à former<br />
un tout, aucune partie ne peut jamais changer,<br />
parce que tout <strong>de</strong>vrait changer immédiatement.<br />
Cet état d’équilibre dure <strong>de</strong><br />
toute éternité, parce que, pour Aristote, “le<br />
temps est infini et l’univers perpétuel” —<br />
il n’est pas apparu à un instant particulier.<br />
Peut-être y a-t-il eu un jour <strong>de</strong>s créatures<br />
mal adaptées, mais elles ont été rapi<strong>de</strong>ment<br />
décimées, exactement comme <strong>de</strong>s animaux<br />
très déformés naissent <strong>de</strong> temps en temps,<br />
mais périssent rapi<strong>de</strong>ment. Aristote se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:<br />
“Pourquoi la nature doit-elle toujours<br />
agir avec une fin, parce que cela est<br />
mieux ainsi ? Zeus n’envoie pas la pluie<br />
afin <strong>de</strong> faire pousser le blé; cela vient par<br />
nécessité. Ce qui a été aspiré vers le haut<br />
doit se rafraîchir, se transformer en eau et<br />
tomber; et il se trouve que cela fait pousser<br />
le blé. Si la récolte d’un paysan s’abîme, la<br />
pluie ne tombe pas dans le but <strong>de</strong> gâcher<br />
le blé.” Ce point <strong>de</strong> vue contraste avec la<br />
croyance traditionnelle que la récolte a été<br />
perdue parce qu’un dieu voulait punir le<br />
paysan <strong>de</strong> quelque péché. Au siècle précé<strong>de</strong>nt,<br />
le dramaturge athénien Aristophane<br />
s’était moqué <strong>de</strong> Socrate pour avoir enseigné<br />
cette même leçon, à savoir que les nuages<br />
produisent <strong>de</strong> la pluie — ou n’en produisent<br />
pas — pour <strong>de</strong>s raisons naturelles.<br />
Ainsi, si quelques connexions sont fortuites,<br />
peut-être que, si nos “<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>de</strong>vant<br />
poussent pointues pour mordre, les <strong>de</strong>nts<br />
du fond larges pour mâcher, ce n’est que<br />
pure coïnci<strong>de</strong>nce”. Et si quelque animal ne<br />
profite pas <strong>de</strong> cet heureux concours <strong>de</strong> circonstances,<br />
il meurt. Mais Aristote affirme<br />
que le hasard ne s’applique qu’à <strong>de</strong>s événements<br />
occasionnels. Lorsqu’une série
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 48<br />
d’événements se produit dans une séquence<br />
régulière avec une fin spécifique,<br />
“toutes les étapes précé<strong>de</strong>ntes sont orien-<br />
La téléologie, l’explication <strong>de</strong> l’univers par<br />
<strong>de</strong>s buts prédéterminés, survécut jusqu’à<br />
Charles Darwin. La métho<strong>de</strong> fut utilisée<br />
pour démontrer l’intervention d’un Créateur.<br />
Il ne semble pas que telle ait été l’intention<br />
d’Aristote, qui voyait en chaque<br />
organisme un système clos qui <strong>de</strong>vait grandir<br />
comme il le faisait. Dans ses <strong>de</strong>scriptions,<br />
il introduisit une distinction entre<br />
ceux qui basent leurs récits sur <strong>de</strong>s histoires<br />
où interviennent les dieux, et ceux qui<br />
s’intéressent à la “sagesse humaine”; il<br />
oppose les métaphores <strong>de</strong> la poésie avec<br />
les analogies précises <strong>de</strong> la science. En ce<br />
sens, il était religieux; mais il soutenait que<br />
le divin dans l’univers est pur intellect, <strong>de</strong><br />
sorte que l’activité humaine la plus élevée<br />
est l’activité intellectuelle. Il s’agit <strong>de</strong> trouver<br />
la cause naturelle <strong>de</strong>s choses. Le caractère<br />
impersonnel, objectif <strong>de</strong> la science —<br />
“quelque chose a été observé”, plutôt que<br />
“j’ai observé quelque chose”— est dans le<br />
style d’Aristote.<br />
L’induction est l’acte par lequel l’esprit passe <strong>de</strong> la<br />
connaissance <strong>de</strong>s faits à celle <strong>de</strong>s lois qui les régissent.<br />
L’héritage d’Aristote<br />
L’expression «sciences inductives» est synonyme<br />
<strong>de</strong> celle <strong>de</strong> «sciences expérimentales». On<br />
a longtemps opposé le « raisonnement inductif␣<br />
» au «raisonnement déductif» en disant que<br />
le premier va du particulier au général, alors<br />
que le second progresse du général au particulier.<br />
L’induction pose un très important problème<br />
philosophique : les faits observés ou expérimentés<br />
sont toujours particuliers: ils se produisent<br />
en un lieu et à une époque déterminés;<br />
comment dès lors avons nous le droit, en nous<br />
appuyant sur ces faits, d’énoncer une loi absolument<br />
générale, valable pour tous les lieux et<br />
pour toutes les époques ?<br />
L’induction<br />
tées vers cette fin”, et aucun événement <strong>de</strong><br />
la séquence ne peut être fortuit.<br />
Il y a là un certain isolement, voire <strong>de</strong><br />
l’aridité. Il se peut qu’Aristote l’ait ressenti,<br />
et qu’il ait commencé à croire que Platon<br />
avait eu raison d’exprimer ses pensées profon<strong>de</strong>s<br />
par <strong>de</strong>s images, plutôt que, à sa propre<br />
manière, par <strong>de</strong>s chaînes infinies <strong>de</strong><br />
définitions et <strong>de</strong> raisonnements abstraits.<br />
“Plus je suis isolé et solitaire, écrivait-il,<br />
plus j’en viens à aimer les mythes.”<br />
On montra souvent qu’Aristote avait finalement<br />
tort. Il se peut qu’avec l’âge son<br />
désir farouche <strong>de</strong> tout expliquer se soit<br />
transformé en une course contre la montre,<br />
et son sentiment d’isolement vient<br />
peut-être <strong>de</strong> ce que personne, excepté<br />
peut-être Théophraste, ne pourrait jamais<br />
partager cette immense tâche. Pour toutes<br />
ces raisons, et malgré ses erreurs, Aristote<br />
a fondé la métho<strong>de</strong> et la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la<br />
nature que l’on appelle la science, et c’est<br />
son point <strong>de</strong> vue qui a dominé pendant<br />
près <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mille ans.<br />
L’induction repose sur l’expérience, mais elle la<br />
dépasse infiniment en concluant <strong>de</strong> «quelques<br />
cas» à «tous les cas». C’est spontanément que<br />
l’esprit humain pense d’une manière générale<br />
et universelle le fait constaté: le savant est en<br />
droit <strong>de</strong> formuler une loi générale après une expérience<br />
unique, s’il est bien certain d’avoir isolé<br />
l’influence qu’il étudie, car la même expérience<br />
répétée n’ajoute rien à moins qu’on n’en varie<br />
les conditions.<br />
L’induction trouve son fon<strong>de</strong>ment dans les lois<br />
<strong>de</strong> la logique formelle d’une part et d’autre part<br />
dans la croyance à un ordre universel <strong>de</strong> la nature,<br />
à une harmonie qui règne dans le mon<strong>de</strong> et que<br />
nous pouvons saisir avec notre intelligence: «la<br />
nature suit un cours uniforme», «les mêmes causes<br />
produisent les mêmes effets», telles sont les<br />
formules que l’on utilise souvent pour exprimer<br />
cette croyance.<br />
(M. Gex: Eléments <strong>de</strong> philosophie <strong>de</strong>s sciences)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 49<br />
4.4. LA MÉDECINE À ALEXANDRIE : LES PREMIÈRES DISSECTIONS<br />
À la suite <strong>de</strong>s conquêtes d’Alexandre le Grand (356 - 323 av. J.-C.), Athènes et l’Ionie 18<br />
déclinent. Un grand centre culturel naît à Alexandrie où une immense bibliothèque<br />
est créée. Elle réunira plus <strong>de</strong> 900.000 manuscrits.<br />
Hérophile<br />
Vers 300 av. J.-C. une renommée école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine y<br />
est établie. Parmi les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’école d’Alexandrie,<br />
il faut citer Hérophile et Érasistrate, <strong>de</strong>ux anatomistes<br />
à qui le pharaon Ptolémée Soter 19 a accordé le privilège<br />
<strong>de</strong> disséquer <strong>de</strong>s cadavres humains. Il paraît qu’ils<br />
ont également pratiqué <strong>de</strong>s vivisections sur <strong>de</strong>s animaux<br />
et sur <strong>de</strong>s humains — <strong>de</strong>s condamnés à mort,<br />
par exemple!<br />
• Hérophile (né vers 330 av. J.-C.) a étudié, entre autres,<br />
le système nerveux et les méninges. Il a découvert les<br />
nerfs et le 4e ventricule cérébral. Pour lui, le siège <strong>de</strong><br />
la pensée et <strong>de</strong>s sentiments est situé dans le cerveau,<br />
contrairement à Aristote qui l’a placé dans le coeur.<br />
Pour Hérophile, le coeur sert uniquement à entretenir<br />
la chaleur du corps. Il a reconnu la relation entre l’activité<br />
cardiaque et le pouls. Il a établi la distinction entre<br />
veines et artères. Il a découvert les ovaires et les<br />
oviductes, ainsi que l’épididyme.<br />
• Érasistrate (vers 300 - 250 à 240 av. J.-C.) étudie l’anatomie du système vasculaire.<br />
Il affirme que le sang circule <strong>de</strong>s artères dans les veines par d’invisibles conduits. Il<br />
rectifie la <strong>de</strong>scription erronée du coeur donnée par Aristote qui lui avait attribué<br />
trois chambres au lieu <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux. Convaincu du rôle primordial du sang, Érasistrate<br />
s’oppose à la saignée en raison <strong>de</strong>s pertes qui en résultent.<br />
Érasistrate fait <strong>de</strong>s expériences physiologiques. Étudiant<br />
le fonctionnement <strong>de</strong>s nerfs périphériques, il arrive à distinguer<br />
les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs. Il considère<br />
cependant les nerfs comme <strong>de</strong>s tubes creux contenant<br />
un liqui<strong>de</strong>. De même, il accepte l’idée que l’air entre<br />
dans les poumons et le coeur et qu’il est transporté à<br />
travers le corps par les artères!<br />
Hérophile et Érasistrate.<br />
18 Ionie = nom <strong>de</strong> la côte <strong>de</strong> l’Asie Mineure sur la mer Égée.<br />
19 Ptolémée I er Soter (360-283 av. J.-C.), l’un <strong>de</strong>s généraux d’Alexandre le Grand, nommé satrape<br />
d’Égypte, fondateur <strong>de</strong> la bibliothèque, <strong>de</strong> l’école et du musée d’Alexandrie, constructeur du phare<br />
dans l’île <strong>de</strong> Pharos. Il a eu son surnom Soter (sauveur) en secourant les Rhodiens.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 50<br />
Lecture:<br />
PREMIÈRES DISSECTIONS À ALEXANDRIE<br />
Les mé<strong>de</strong>cins n’étaient pas seuls alors à s’intéresser<br />
à la mé<strong>de</strong>cine. Deux <strong>de</strong>s plus grands philosophes <strong>de</strong><br />
l’Antiquité ont exercé une influence prépondérante<br />
sur les théories médicales. Le premier, un peu plus<br />
jeune qu’Hippocrate et son grand admirateur, fut Platon<br />
(428-347 av. J.-C.); l’autre Aristote (384-322 av.<br />
J.-C.) élève <strong>de</strong> Platon, fils <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin et mé<strong>de</strong>cin<br />
lui-même, représente l’une <strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s figures<br />
<strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s sciences. Tous les êtres vivants, hommes,<br />
animaux, plantes, étaient pour lui l’objet <strong>de</strong> recherches<br />
si bien que certains ont voulu voir en lui le<br />
fondateur <strong>de</strong> la biologie. Il se livra à <strong>de</strong>s dissections<br />
sur les animaux, et, comparant les espèces entre elles,<br />
en établit même une sorte <strong>de</strong> classification.<br />
Le roi Philippe <strong>de</strong> Macédoine avait alors un fils <strong>de</strong><br />
treize ans Alexandre. Ayant entendu vanter le génie<br />
d’Aristote, il lui confia l’éducation du prince. Celui<br />
qui <strong>de</strong>vait être Alexandre le Grand écouta les leçons<br />
du plus grand philosophe <strong>de</strong> l’Antiquité ! Quand<br />
Alexandre, âgé <strong>de</strong> vingt ans, succéda à son père, Aristote<br />
retourna à Athènes où il donna son enseignement<br />
au Lycée, tout en se promenant. Alexandre commençait<br />
le cours <strong>de</strong> son règne triomphant pendant<br />
lequel il ne cessa <strong>de</strong> prodiguer à son maître les marques<br />
les plus vives <strong>de</strong> sa reconnaissance.<br />
Plutarque rapporte une anecdote montrant qu’il n’était<br />
pas alors aisé d’être mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>s grands <strong>de</strong> ce mon<strong>de</strong>,<br />
ainsi que les mé<strong>de</strong>cins égyptiens en avaient fait l’expérience<br />
auprès <strong>de</strong> Darius.<br />
Le roi était tombé mala<strong>de</strong> et, tout secoué <strong>de</strong> fièvre,<br />
gisait dans son lit. Son premier mé<strong>de</strong>cin, Philippe<br />
d’Acarnanie, s’affairait à lui préparer une potion<br />
quand on vint porter à Alexandre une lettre l’avisant<br />
<strong>de</strong> se méfier <strong>de</strong> son mé<strong>de</strong>cin qui cherchait à l’empoisonner.<br />
A ce moment-là, Philippe entra dans la chambre du<br />
roi, suivi <strong>de</strong> ses confrères et portant la coupe contenant<br />
le remè<strong>de</strong>.<br />
Alors, écrit Plutarque, “ Alexandre lui donna d’une<br />
main la lettre, et prenant <strong>de</strong> l’autre la coupe, il avala<br />
la mé<strong>de</strong>cine tout d’un trait, sans laisser paraître le<br />
moindre soupçon. ”<br />
Le trait est certes admirable et témoigne du caractère<br />
d’Alexandre. L’accusation était, bien entendu, fausse<br />
et quelques jours après le prince fut guéri. Mais on<br />
se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ce qui serait advenu si par hasard il avait<br />
eu quelques douleurs ou s’était senti plus mal, comme<br />
il arrive dans mainte maladie ?<br />
Quelques années plus tard, à Babylone, une autre fièvre<br />
<strong>de</strong>vait emporter Alexandre, à l’âge <strong>de</strong> trente-<strong>de</strong>ux<br />
ans (323 av. J.-C.). L’empire ne survécut pas à ce<br />
héros prestigieux qui avait conquis l’Egypte et<br />
l’Orient jusqu’aux portes <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>. Ses généraux se<br />
partagèrent bientôt ses dépouilles. L’Egypte échut à<br />
Ptolémée, dit Ptolémée Soter (Sauveur), fils <strong>de</strong><br />
Lagus, qui fonda ainsi la monarchie grecque <strong>de</strong><br />
l’Egypte et fut le chef <strong>de</strong> la dynastie <strong>de</strong>s Lagi<strong>de</strong>s.<br />
Alexandrie, créée par Alexandre dont elle portait le<br />
nom, n’était qu’une toute jeune capitale, mais grâce<br />
à Ptolémée elle <strong>de</strong>vait détrôner Athènes et pendant<br />
trois siècles, <strong>de</strong>venir le centre du mon<strong>de</strong> grec. Ptolémée<br />
Soter attira autour <strong>de</strong> lui tous les lettrés, tous les<br />
artistes <strong>de</strong> Grèce et d’Asie Mineure; il fit construire<br />
à leur intention un immense Musée et fonda sa fameuse<br />
Bibliothèque qui compta, dit-on, jusqu’à sept<br />
cent mille volumes.<br />
Ptolémée Soter se signala en rendant à la mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong>s services inoubliables. Nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins<br />
étaient aussi arrivés à Alexandrie où ils trouvaient<br />
<strong>de</strong> vastes locaux <strong>de</strong>stinés à leur usage et un Jardin<br />
botanique où étaient réunies toutes les plantes médicinales.<br />
L’un <strong>de</strong> ces mé<strong>de</strong>cins était Hérophile, originaire<br />
<strong>de</strong> Chalcédoine en Bithynie, l’autre Erasistrate,<br />
né dans l’île <strong>de</strong> Céos. Celui-ci s’était rendu célèbre<br />
en guérissant Antiochus, fils du roi <strong>de</strong> Syrie et <strong>de</strong><br />
Babylonie, qui se mourait d’un mal mystérieux.<br />
Erasistrate ayant soupçonné que ce mal était le mal<br />
d’amour, avait fait défiler dans la chambre du mala<strong>de</strong><br />
toutes les femmes du palais. Lorsque Stratonice,<br />
secon<strong>de</strong> épouse du roi, parut, le jeune prince se trahit,<br />
il pâlit, son cœur se mit à battre. Le mé<strong>de</strong>cin<br />
arriva à persua<strong>de</strong>r le roi <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r pour épouse Stratonice<br />
à son fils qui recouvra aussitôt la santé. Si<br />
nous rappelons cette anecdote, parce qu’elle a souvent<br />
inspiré les peintres, particulièrement Ingres, la<br />
mé<strong>de</strong>cine retiendra que c’est à Hérophile et à<br />
Erasistrate, à ces <strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins et à eux seulement,<br />
que Ptolémée Soter accorda le privilège inouï <strong>de</strong> disséquer<br />
<strong>de</strong>s cadavres humains. Grâce à ces dissections,<br />
Hérophile donna pour la première fois <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions<br />
exactes du corps qui allaient permettre<br />
d’édifier la mé<strong>de</strong>cine sur <strong>de</strong>s bases nouvelles et faire<br />
<strong>de</strong> lui le plus grand anatomiste <strong>de</strong> l’Antiquité tandis<br />
qu’Erasistrate créait véritablement la physiologie<br />
mo<strong>de</strong>rne.<br />
Mais hélas ! Après Ptolémée Soter, l’horreur <strong>de</strong>s peuples<br />
méditerranéens pour l’ouverture <strong>de</strong>s cadavres<br />
fut la plus forte et la dissection fut <strong>de</strong> nouveau interdite.<br />
Il fallut attendre environ quinze cents ans pour<br />
qu’elle re<strong>de</strong>vînt — presque furtivement — autorisée,<br />
quinze siècles pendant lesquels la mé<strong>de</strong>cine ne<br />
put avancer qu’à tâtons, semblable à un homme qui<br />
chercherait son chemin dans les ténèbres.<br />
(Extrait <strong>de</strong>: P. Dumaître: Mé<strong>de</strong>cine et mé<strong>de</strong>cins.<br />
Magnard, Paris, 1977)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 51<br />
4.5. LA PATHOLOGIE SOLIDISTE<br />
Érasistrate est a<strong>de</strong>pte <strong>de</strong> la philosophie atomistique <strong>de</strong> Démocrite (env. 460 -390 av.<br />
J.-C.) d’après laquelle <strong>de</strong>s particules élémentaires indivisibles appelés atomes constituent<br />
la matière, donc également le corps humain. Dans le concept pathologique<br />
d’Érasistrate ces constituants soli<strong>de</strong>s du corps prévalent sur les constituants liqui<strong>de</strong>s<br />
(humeurs).<br />
Érasistrate <strong>de</strong>vient ainsi le précurseur, sinon le fondateur <strong>de</strong> la pathologie solidiste<br />
(Solidarpathologie), l’autre grand concept <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine antique.<br />
Empédocle<br />
Aristote<br />
4 éléments<br />
Hippocrate<br />
4 humeurs<br />
(orientation chimique-biologique)<br />
PATHOLOGIE HUMORALE<br />
CONCEPTS DE LA MÉDECINE ANTIQUE<br />
philosophie naturelle grecque<br />
«mé<strong>de</strong>cine mo<strong>de</strong>rne»<br />
Démocrite<br />
Epicure<br />
atomes<br />
Érasistrate<br />
constituants soli<strong>de</strong>s<br />
(orientation physique)<br />
PATHOLOGIE SOLIDISTE
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 52<br />
5. MÉDECINE ET <strong>SCIENCES</strong> NATURELLES<br />
À L’ÉPOQUE DE L’EMPIRE ROMAIN<br />
Au début, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins au sens strict n’existent pas encore dans la Rome antique.<br />
C’est le père <strong>de</strong> famille (pater familias), maître absolu du foyer, qui veille sur la santé<br />
<strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> sa famille, <strong>de</strong>s esclaves et du bétail. L’exercice concret <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine<br />
et <strong>de</strong> la chirurgie est considéré comme une basse besogne convenant uniquement<br />
aux esclaves ou aux femmes.<br />
Peu à peu cependant <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins grecs commencent à s’installer à Rome. Caton<br />
l’Ancien (234-149 av. J.-C.), défenseur farouche <strong>de</strong>s vieilles traditions romaines, les<br />
voit d’un mauvais oeil. Il dénonce les mé<strong>de</strong>cins grecs comme les pires ennemis <strong>de</strong><br />
Rome et les accuse d’empoisonner et d’assassiner leurs clients. Pour Caton aucun<br />
remè<strong>de</strong> ne vaut le chou, véritable panacée se prêtant à toutes sortes d’usages thérapeutiques!<br />
5.1. MÉDECINE ET PHARMACOLOGIE ROMAINES<br />
AU 1 ER SIÈCLE APRÈS J.-C.<br />
Dans le domaine <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> la pharmacologie <strong>de</strong>ux personnages dont la<br />
biographie n’est que peu connue doivent être mentionnés pour le 1er siècle après J.-<br />
C.: Celse (Celsus) et Dioscori<strong>de</strong>.<br />
Celse (Aulus Cornelius Celsus), De medicina.<br />
Celse (25 av. J.-C. - env. 50 apr. J.-C.) — qui n’a peut-être pas été mé<strong>de</strong>cin — est<br />
l’auteur d’une vaste encyclopédie comprenant <strong>de</strong>s ouvrages sur l’agriculture, <strong>de</strong>s<br />
traités militaires, <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> philosophie, <strong>de</strong> rhétorique et <strong>de</strong> droit. Aucun <strong>de</strong><br />
ces ouvrages n’a été transmis à nous.<br />
Par contre, il subsiste huit livres sur la mé<strong>de</strong>cine<br />
(De medicina), tous écrits en latin (le seul ouvrage<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’époque classique en latin!). Dans<br />
l’introduction, Celse retrace l’histoire <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine<br />
jusqu’à son temps. Il <strong>de</strong>vient ainsi le premier<br />
historien <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine. La partie la plus importante<br />
<strong>de</strong> son ouvrage est représentée par les <strong>de</strong>ux<br />
livres qu’il a consacrés à la chirurgie. Il y décrit les<br />
techniques chirurgicales utilisées à son époque (ligatures,<br />
amputation, incisions, excisions, etc.).<br />
Cornelius Celsus (1er siècle?)<br />
Celse aurait vécu <strong>de</strong> 25 av. J.-C. à<br />
environ 50 apr. J.-C.; mais d’autres dates<br />
se rencontrent dans la littérature).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 53<br />
Éclipsé par Galien (voir plus loin), Celse est tombé dans l’oubli. Son oeuvre a été<br />
redécouverte pendant la Renaissance. “De medicina” a été l’un <strong>de</strong>s premiers ouvrages<br />
médicaux à être imprimé (en 1478).<br />
Dioscori<strong>de</strong> (Pedanios Dioskuri<strong>de</strong>s), De materia medica.<br />
Le mé<strong>de</strong>cin (militaire) grec Dioscori<strong>de</strong> (env. 40 - 80 apr. J.-C.) a écrit vers 60 ou 70 apr.<br />
J.-C. un vaste ouvrage pharmacologique écrit en grec (Peri hylês iatrikês) et dont le<br />
titre en traduction latine est: De materia medica (Sur la matière médicale). Dioscori<strong>de</strong><br />
y traite les épices, les onguents et les huiles, les animaux et leurs produits, les plantes<br />
(dont les céréales et les légumes), les vins et les minéraux.<br />
Les <strong>de</strong>scriptions que Dioscori<strong>de</strong> donne <strong>de</strong>s plantes (plus <strong>de</strong> 500) sont brèves et ne<br />
permettent pas toujours leur i<strong>de</strong>ntification. Son ouvrage est néanmoins d’une gran<strong>de</strong><br />
importance pour la botanique, un domaine où il est resté — tout comme en pharmacologie<br />
— une autorité vénérée durant plus <strong>de</strong> 15 siècles. C’est dans son oeuvre que<br />
le terme botaniké (= botanique) est rencontré pour la première fois.<br />
De l’ouvrage <strong>de</strong> Dioscori<strong>de</strong> il subsiste une copie manuscrite aux enluminures splendi<strong>de</strong>s<br />
datant <strong>de</strong> 512.<br />
Dioscori<strong>de</strong> (env. 40 - 80 apr. J.-C.)<br />
avec <strong>de</strong>s plantes médicinales, dont la<br />
mandragore.<br />
Un élève <strong>de</strong> Dioscori<strong>de</strong> est en train <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssiner<br />
la racine <strong>de</strong> mandragore. Dioscori<strong>de</strong> est en<br />
train d’écrire.<br />
LA MANDRAGORE (die Alraune)<br />
La mandragore est une solanacée (Nachtschattengewächs).<br />
L’Antiquité et le Moyen Age ont attribué un pouvoir magique à<br />
la racine (à cause <strong>de</strong> sa forme vaguement anthropomorphe !).<br />
Les fruits jouissaient <strong>de</strong> la renommée <strong>de</strong> possé<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s propriétés<br />
aphrodisiaques, d’où leur nom allemand «Liebesäpfelchen».<br />
Des décoctions <strong>de</strong> fruits ont été utilisées par les mé<strong>de</strong>cins<br />
antiques comme somnifère ou narcotique. La plante contient en<br />
fait les alcaloï<strong>de</strong>s scopolamine et hyoscyamine (cette <strong>de</strong>rnière<br />
se transformant en atropine après la récolte ).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 54<br />
LECTURE:<br />
EXTRAITS COMMENTÉS DE L’OUVRAGE DE MEDICINA DE CELSE<br />
(d’après H.C.D. <strong>de</strong> Wit, 1992: 94-95)<br />
De Medic., Prooem. 38-39: “Les suppositions<br />
sur <strong>de</strong>s choses cachées n’ont aucun sens car<br />
il est important <strong>de</strong> savoir, non pas ce qui<br />
cause la maladie, mais ce qui la guérit. Il<br />
n’est pas, non plus, important <strong>de</strong> savoir la<br />
manière dont la digestion se déroule, mais<br />
il importe que les choses mangées soient<br />
bonnes... On ne réfléchit pas sur la manière<br />
dont on respire, mais on veut savoir comment<br />
améliorer une respiration difficile et<br />
réduite. On ne réfléchit pas non plus sur ce<br />
qui fait bouger les veines mais on veut savoir<br />
ce que ces mouvements signifient.”<br />
•<br />
Ces théories sont conformes à celles <strong>de</strong> l’école<br />
alexandrine <strong>de</strong>s “empiriques” fondée par<br />
Philinos <strong>de</strong> Cos et Sérapion d’Alexandrie. Celsus<br />
pensait qu’il n’y avait rien à attendre <strong>de</strong>s concepts<br />
théorétiques <strong>de</strong>s “dogmaticiens”.<br />
De Medic., Prooem. 29-30: “Les philosophes<br />
seraient <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins sans égaux si leur raisonnement<br />
logique avait le pouvoir <strong>de</strong> guérir,<br />
mais ils sont noyés dans leurs mots et<br />
n’ont aucune notion <strong>de</strong> pratique médicale.”<br />
•<br />
On a souvent affirmé, mais aussi réfuté, que la<br />
vivisection humaine était pratiquée sous le règne<br />
<strong>de</strong>s Empereurs. Il me paraît que les observations<br />
<strong>de</strong> Celsus ne laissent aucun doute à ce<br />
sujet. Il a relaté dans la citation qui suit que la<br />
vivisection était bien pratiquée par les anatomistes<br />
alexandrins (II,2 et V,4) sur <strong>de</strong>s scélérats<br />
emprisonnés mis à leur disposition par le souverain.<br />
De Medic., Prooem. 40-44: “Une <strong>de</strong>rnière pratique<br />
est absolument cruelle: elle consiste à<br />
couper dans le ventre et la poitrine d’hommes<br />
vivants et c’est à mettre au passif <strong>de</strong><br />
l’art <strong>de</strong> guérir qui cherche à obtenir le bien<br />
être <strong>de</strong>s hommes en détruisant un individu<br />
et, qui plus est, d’une façon extrêmement<br />
cruelle. Premièrement, parce qu’il n’est pas<br />
possible <strong>de</strong> parvenir au but recherché d’une<br />
manière aussi violente quand celui-ci peut<br />
être atteint par une autre voie et sans commettre<br />
un crime. Car, après avoir ouvert le<br />
corps, la couleur, la rugosité, la douceur, la<br />
fermeté et tous caractères <strong>de</strong> cette nature<br />
ne sont plus pareils à ce qu’ils étaient lorsque<br />
le corps était encore intact. Les corps,<br />
par exemple, même lorsqu’ils sont intacts,<br />
changent déjà d’aspect extérieur sous l’empire<br />
<strong>de</strong> la peur, <strong>de</strong> la douleur, par manque<br />
<strong>de</strong> nourriture, indigestion, fatigue et affections<br />
bénignes <strong>de</strong> diverses sortes. Il est encore<br />
bien plus vraisemblable que les organes<br />
internes, qui sont beaucoup plus mous<br />
et pour lesquels la lumière représente déjà<br />
quelque chose <strong>de</strong> nouveau, se modifieront<br />
sous l’impact <strong>de</strong> lésions très graves et subiront<br />
effectivement <strong>de</strong>s déformations. Rien<br />
n’est plus sot, dit-on, que <strong>de</strong> penser que les<br />
parties du corps d’un homme vivant ne sont<br />
pas, quelque soit leur état habituel, quelque<br />
chose <strong>de</strong> différent chez un moribond<br />
ou, mieux encore, chez un cadavre. Parce<br />
que l’on peut ouvrir le ventre d’un homme<br />
qui respire encore, car le ventre est d’une<br />
importance secondaire, mais dès que le couteau<br />
pénètre effectivement dans la cavité <strong>de</strong><br />
la poitrine et que le transept — une sorte<br />
<strong>de</strong> membrane située entre la partie supérieure<br />
et la partie inférieure du corps (les<br />
Grecs l’appellent diaphragme) — est sectionné,<br />
l’homme meurt immédiatement.<br />
Par conséquent, le mé<strong>de</strong>cin meurtrier aura<br />
vu le contenu <strong>de</strong> la poitrine et les entrailles<br />
d’un cadavre, comme ils le sont dans un<br />
cadavre et non comme ils le sont chez un<br />
être vivant. Et alors, ce chirurgien qui cruellement<br />
découpe un homme ne sera pas informé<br />
<strong>de</strong> ce que sont nos entrailles pendant<br />
la vie. S’il existe néanmoins une possibilité<br />
d’observer quelque chose tant que l’homme<br />
respire encore, ce sont ceux qui le soignent<br />
qui peuvent, par hasard, l’observer. Par
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 55<br />
exemple, un gladiateur dans l’arène, un soldat<br />
dans une bataille ou un voyageur attaqué<br />
par <strong>de</strong>s brigands, peut être blessé à un<br />
point tel qu’une partie ou une autre <strong>de</strong> l’intérieur<br />
<strong>de</strong> son corps soit visible, une fois<br />
ceci, une autre fois quelque chose <strong>de</strong> différent.<br />
De cette façon, un mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> bon<br />
jugement peut apprendre à connaître l’emplacement,<br />
la disposition, la forme et tous<br />
les caractères visibles <strong>de</strong>s organes, non pas<br />
en pratiquant la boucherie, mais en essayant<br />
<strong>de</strong> guérir. Sa compassion envers autrui lui<br />
permet <strong>de</strong> découvrir ce que d’autres veulent<br />
apprendre au moyen d’une cruauté<br />
horrible.<br />
Et même la dissection <strong>de</strong>s cadavres est superflue<br />
pour cette raison (même si elle n’est<br />
pas cruelle, c’est une occupation extrêmement<br />
dégoûtante) que la plupart <strong>de</strong>s<br />
organes ont changé quand ils sont morts.<br />
Les soins apportés aux patients montreront<br />
tout ce qui est possible d’apprendre <strong>de</strong>s<br />
hommes vivants.”<br />
•<br />
Il ne faut donc pas attendre <strong>de</strong> tentative <strong>de</strong> recherche<br />
anatomique <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> Celsus et <strong>de</strong><br />
ses contemporains. Pourtant, son oeuvre renferme<br />
<strong>de</strong>s centaines <strong>de</strong> conseils et <strong>de</strong> remè<strong>de</strong>s à<br />
l’usage du mé<strong>de</strong>cin traitant avec, çà et là, <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>scriptions dignes d’intérêt. Par exemple cette<br />
brève explication sur la structure <strong>de</strong> l’oeil humain:<br />
De Medic. V11.7.13-c: “Le globe oculaire<br />
possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux enveloppes extérieures. La<br />
plus externe est appelée “kératoi<strong>de</strong>s” par les<br />
Grecs. Cette enveloppe est assez épaisse<br />
dans la partie <strong>de</strong> l’oeil qui est blanche. Elle<br />
est mince au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la pupille. Une enveloppe<br />
intérieure l’accompagne dont la<br />
pupille est le centre où se trouve un petit<br />
orifice. L’enveloppe environnante est mince<br />
mais s’épaissit à quelque distance et les<br />
Grecs appellent cette enveloppe<br />
“chorioi<strong>de</strong>s”. Ces <strong>de</strong>ux enveloppes qui entourent<br />
le contenu du globe oculaire fusionnent<br />
dans leur partie postérieure et, après<br />
s’être amincies, passent par une ouverture<br />
entre les os. Elles gagnent la membrane du<br />
cerveau à l’intérieur duquel elles pénètrent.<br />
À l’intérieur <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux enveloppes, là où se<br />
trouve la pupille, existe un vi<strong>de</strong>. Encore à<br />
l’intérieur <strong>de</strong> cela se trouve une enveloppe<br />
extrêmement fine qui fut appelée<br />
“arachnoi<strong>de</strong>s” par Herophilos. La moitié arrière<br />
<strong>de</strong> l’arachnoi<strong>de</strong>s a la forme d’une coupe<br />
et dans cette cavité se trouve ce que les<br />
Grecs nomment “hyaloi<strong>de</strong>s” car cela ressemble<br />
beaucoup à du verre. Ce n’est pas un<br />
liqui<strong>de</strong> ni une substance soli<strong>de</strong>, mais, par<br />
manière <strong>de</strong> dire, un liqui<strong>de</strong> solidifié et <strong>de</strong><br />
sa couleur dépend celle <strong>de</strong> la pupille, noire<br />
ou bleu métallique, tandis que l’enveloppe<br />
extérieure est complètement blanche. Mais<br />
ce liqui<strong>de</strong> solidifié est recouvert d’une<br />
membrane venant <strong>de</strong> l’intérieur <strong>de</strong> l’oeil.<br />
Au-<strong>de</strong>ssus on trouve une goutte d’un liqui<strong>de</strong><br />
qui ressemble au blanc d’oeuf et cela<br />
donne la possibilité <strong>de</strong> voir; les Grecs l’appellent<br />
le “cristalloi<strong>de</strong>s”.<br />
La lentille <strong>de</strong> l’oeil est à l’origine <strong>de</strong> la vision.<br />
Celsus doit sa connaissance <strong>de</strong> l’existence du<br />
cristallin principalement aux Grecs mais il faut<br />
reconnaître que sa <strong>de</strong>scription, brève et claire<br />
avec les quelques insuffisances que l’on peut<br />
facilement comprendre, était la meilleure proposée<br />
à ce jour. Il n’est pas certain qu’il ait voulu<br />
conférer au cristallin la fonction <strong>de</strong> permettre<br />
une vision tantôt nette ou tantôt floue ou peutêtre<br />
même simplement la fonction <strong>de</strong> voir. Il est<br />
certain que l’on n’avait pas alors le moindre<br />
soupçon <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong> la rétine.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 56<br />
5.2. LA MÉDECINE ET ANATOMIE-PHYSIOLOGIE ROMAINES<br />
AU 2 E SIÈCLE APRÈS J.-C.<br />
CLAUDE GALIEN DE PERGAME (CLAUDIUS GALENUS)<br />
(129 ENV. - ENV. 200)<br />
Clau<strong>de</strong> Galien (Claudius Galenus) est l’un <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins les plus importants <strong>de</strong> l’antiquité.<br />
Né à Pergame en 129 apr. J.-C. Il est d’abord éduqué par son père, un architecte<br />
et mathématicien. Puis il abor<strong>de</strong> <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s philosophiques pour s’orienter<br />
ensuite vers la mé<strong>de</strong>cine (selon la légen<strong>de</strong> à la suite d’un rêve inspiré à son père par<br />
Asklépios). Il commence ses étu<strong>de</strong>s médicales à Pergame pour les poursuivre à<br />
Smyrne, Corinthe et Alexandrie. À l’âge <strong>de</strong> 28 ans, il retourne dans sa patrie et <strong>de</strong>vient<br />
mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>s gladiateurs à Pergame. En 161-162, il fait un séjour à Rome et y<br />
exerce la mé<strong>de</strong>cine. Il quitte Rome assez vite (problèmes avec les mé<strong>de</strong>cins en place<br />
qu’il ne ménage pas ou fuite <strong>de</strong>vant l’épidémie <strong>de</strong> peste qui commence à ravager la<br />
ville?).<br />
Il retourne à Pergame et y reste quelque temps. Puis, il se rend comme chirurgien<br />
militaire à Aquilée (province d’Udine), d’où les empereurs Marc Aurèle et Lucius<br />
Verus préparent une campagne contre les Germains. Quelques années plus tard,<br />
Galien est renvoyé à Rome pour être le mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> Commo<strong>de</strong>, le fils <strong>de</strong> Marc Aurèle.<br />
Il exerce à Rome tout en restant mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> la Cour.<br />
En 192, après la mort <strong>de</strong> Commo<strong>de</strong> et un gigantesque incendie qui a ravagé le centre<br />
<strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Rome (ainsi qu’une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s manuscrits <strong>de</strong> Galien), il retourne<br />
à Pergame ou il mourra vers l’an 200.<br />
Galien a laissé une vaste oeuvre médicale comportant plus <strong>de</strong> 100 traités écrits en<br />
grec. La majorité <strong>de</strong> ces ouvrages s’appuient sur l’oeuvre d’Hippocrate dont les écrits<br />
sont reproduits, commentés et complétés; ils portent sur l’anatomie, la physiologie<br />
et la mé<strong>de</strong>cine.<br />
Galien <strong>de</strong> Pergame<br />
(129 env. - env. 200 apr. J.-C.)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 57<br />
Une édition <strong>de</strong>s oeuvres <strong>de</strong> Galien datant <strong>de</strong> 1562.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 58<br />
La mé<strong>de</strong>cine galénique<br />
Galien reprend les principes <strong>de</strong> la théorie <strong>de</strong>s humeurs et <strong>de</strong>s qualités d’Hippocrate.<br />
Mais, il ne retient pas l’idée <strong>de</strong> la natura medicatrix d’Hippocrate et prend aussi en<br />
considération <strong>de</strong>s lésions organiques localisées.<br />
Galien avance ainsi une double explication <strong>de</strong>s maladies:<br />
• déséquilibre <strong>de</strong>s humeurs (explication hippocratique) (voir),<br />
• dysfonctionnement <strong>de</strong> tel ou tel organe, par suite d’une lésion ou d’une altération<br />
(explication anatomopathologique).<br />
Ces <strong>de</strong>ux types d’explications sont liés: tel déséquilibre <strong>de</strong>s humeurs entraîne telle<br />
ou telle altération <strong>de</strong> tel ou tel organe; telle altération <strong>de</strong> tel organe entraîne tel déséquilibre<br />
<strong>de</strong>s humeurs.<br />
L’explication anatomopathologique n’est qu’esquissée, l’humorisme hérité d’Hippocrate<br />
reste prédominant.<br />
Diagnostic<br />
Pour établir le diagnostic il faut reconnaître le type <strong>de</strong> dérangement du mélange <strong>de</strong>s<br />
humeurs (dyscrasie).<br />
Les moyens en sont:<br />
• l’examen <strong>de</strong> l’urine (Harnbefund) (dont la forme exagérée <strong>de</strong>viendra<br />
l’uroscopie en vogue au Moyen Âge),<br />
• la palpation du pouls.<br />
Consultation médicale: palpation du pouls et examen <strong>de</strong> l'urine.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 59<br />
Thérapeutique<br />
Le traitement découle <strong>de</strong>s principes mêmes <strong>de</strong> l’humorisme:<br />
• Le régime reste un élément fondamental <strong>de</strong> la thérapeutique.<br />
• L’eau est souvent utilisée dans le traitement (bains, aspersion, etc.).<br />
• Il faut évacuer les humeurs en excès: saignées, ventouses, ponctions, diurétiques,<br />
vomitifs, purges.<br />
• La médicamentation se fait par <strong>de</strong>s drogues diverses administrées sous forme<br />
<strong>de</strong> pilules, potions, suppositoires, cataplasmes, etc.<br />
Relief romain avec <strong>de</strong>s<br />
ventouses (Schröpfköpfe) et<br />
une trousse d'instruments<br />
(pour la scarification <strong>de</strong> la<br />
peau ou l'incision <strong>de</strong>s<br />
veines?) Époque <strong>de</strong> l'empire<br />
romain.<br />
La mé<strong>de</strong>cine galénique ou galénisme avec son concept schématisé universellement<br />
applicable a survécu jusqu’au 17e siècle. C’est elle qui a été parodiée<br />
par Rabelais et Molière.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 60<br />
GALIEN ET L’ANATOMIE<br />
Une partie <strong>de</strong>s connaissances sur l’anatomie humaine <strong>de</strong> Galien est certainement<br />
due à son activité comme mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>s gladiateurs à Pergame, notamment ses connaissances<br />
sur la musculature et les articulations <strong>de</strong>s extrémités.<br />
Par contre ses écrits <strong>de</strong>viennent plus incertains quand il s’agit <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong> l’intérieur<br />
du corps humain. En fait, Galien a fait <strong>de</strong> nombreuses dissections, mais <strong>de</strong>s<br />
dissections d’animaux (!), surtout <strong>de</strong> singes, <strong>de</strong> porcs et <strong>de</strong> chiens.<br />
Recourant à un raisonnement par analogie, il a transposé à l’Homme les connaissances<br />
acquises sur <strong>de</strong>s animaux (ex. réseau admirable <strong>de</strong> l’encéphale)! En plus, il y a<br />
mêlé <strong>de</strong>s hypothèses fictives découlant <strong>de</strong> sa physiologie (ex. les pores du septum<br />
cardiaque)!<br />
GALIEN ET LA PHYSIOLOGIE<br />
La physiologie occupe une place <strong>de</strong> choix dans l’oeuvre <strong>de</strong> Galien.<br />
Expériences physiologiques<br />
Galien a fait <strong>de</strong> nombreuses expériences physiologiques chez l’animal:<br />
• En coupant le nerf laryngé récurrent (nervus laryngeus recurrens, nerf laryngé inférieur),<br />
qui innerve les muscles du larynx, Galien provoque la disparition <strong>de</strong> la<br />
voix, montrant ainsi le rôle <strong>de</strong> ce nerf.<br />
• Il provoque l’arrêt respiratoire en coupant la moelle allongée (medulla oblongata),<br />
et la paraplégie par la section <strong>de</strong> la moelle épinière.<br />
• Il ligature les uretères et démontre que l’urine est produite par les reins — et<br />
non par la vessie comme on le croyait auparavant.<br />
En dépit <strong>de</strong> tout cela, Galien n’est pas un scientifique au sens mo<strong>de</strong>rne. Il ne se limite<br />
pas aux conclusions qu’il peut tirer <strong>de</strong> ses expériences, mais construit tout un système<br />
<strong>de</strong> la physiologie basé sur la spéculation.<br />
Les grands appareils et leurs fonctions<br />
La physiologie <strong>de</strong> Galien peut être décomposée en trois grands appareils auxquels<br />
sont associées trois fonctions:<br />
1) le foie, les veines et la nutrition,<br />
2) le coeur, les poumons, les artères et la respiration,<br />
3) l’encéphale, les nerfs, les muscles et le domaine sensori-moteur.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 61<br />
◆ Le premier grand appareil galénique est constitué par le foie et les veines.<br />
Il assure la nutrition <strong>de</strong>s différentes parties du corps par l’intermédiaire du sang.<br />
Ce sang est élaboré au niveau du foie à partir <strong>de</strong>s aliments, ceci grâce à une faculté<br />
naturelle sanguinifique. Le sang formé s’écoule dans les veines qui le distribuent<br />
à tous les organes et aux membres. Il sert à la nutrition <strong>de</strong> ces organes. On<br />
attribue souvent à Galien l’idée <strong>de</strong> l’intervention au niveau du foie d’un pneuma<br />
naturel ou pneuma physique (souffle naturel, spiritus naturalis); elle semble être bien<br />
postérieure à Galien, mais fait partie du modèle galénique tel qu’il a été compris<br />
à partir du Moyen Âge.<br />
◆ Le <strong>de</strong>uxième grand appareil galénique est constitué du coeur, <strong>de</strong>s artères et <strong>de</strong>s<br />
poumons.<br />
C’est une sorte d’appareil respiratoire dont le rôle est:<br />
• la production <strong>de</strong> la chaleur vitale (dans le coeur),<br />
• la modération <strong>de</strong> cette chaleur par l’air pulmonaire qui sert donc à refroidir le<br />
coeur,<br />
• l’élaboration par le coeur, grâce à sa chaleur propre et à l’air apporté par la<br />
respiration, d’un pneuma vital ou souffle vital (spiritus vitalis),<br />
• la distribution au reste du corps <strong>de</strong> ce pneuma vital, mêlé au sang, par l’intermédiaire<br />
<strong>de</strong>s artères.<br />
Le pneuma vital “vitalise” les organes.<br />
◆ Le troisième grand appareil galénique est constitué <strong>de</strong> l’encéphale, <strong>de</strong>s nerfs, <strong>de</strong>s<br />
muscles et prési<strong>de</strong> aux sensations et aux mouvements.<br />
L’encéphale est le lieu <strong>de</strong> la pensée, <strong>de</strong> la sensibilité et du mouvement volontaire. La<br />
sensibilité et le mouvement volontaire s’effectuent par l’intermédiaire <strong>de</strong>s nerfs qui<br />
relient l’encéphale aux différentes parties du corps. Galien distingue les nerfs sensibles<br />
et les nerfs moteurs.<br />
Le fonctionnement <strong>de</strong> ce troisième appareil est lié au pneuma animal ou souffle animal␣<br />
(spiritus animalis) émané du cerveau et distribué par les nerfs.<br />
Points importants<br />
Galien a retiré au coeur la fonction sanguinifique qu’Aristote lui avait attribuée.<br />
Mais, il lui conserve sa fonction respiratoire, bien qu’il sache par sa propre expérience<br />
que les artères véhiculent du sang et non pas <strong>de</strong> l’air comme il a été affirmé<br />
auparavant.<br />
Galien enlève <strong>de</strong> même au cerveau son rôle d’organe <strong>de</strong>stiné au refroidissement du<br />
sang. Pour Galien, l’encéphale est le lieu <strong>de</strong> la pensée, <strong>de</strong> la sensibilité et du mouve-
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 62<br />
ment volontaire. La sensibilité et le mouvement volontaire s’exercent par l’intermédiaire<br />
<strong>de</strong>s nerfs, sensitifs et moteurs.<br />
Pour Galien, tout comme pour Hérophile, l’âme est une âme pensante, encéphalique,<br />
qui a charge <strong>de</strong> la pensée, <strong>de</strong> la sensibilité et <strong>de</strong> la motricité volontaire. (Chez<br />
Aristote le siège <strong>de</strong> l’âme est le coeur).<br />
Anatomie et physiologie <strong>de</strong> l'Homme selon Galien<br />
trachée-artère<br />
artère veineuse<br />
= veine pulmonaire<br />
veine artérielle<br />
(veine artérieuse)<br />
= artère pulmonaire<br />
POUMON<br />
veine cave<br />
FOIE<br />
spiritus naturalis<br />
(formation du sang)<br />
REIN<br />
veine porte<br />
CERVEAU<br />
spiritus animalis<br />
hypophyse<br />
(phlegme)<br />
réseau admirable<br />
(rete mirabile)<br />
aorte<br />
ventricule gauche (coction)<br />
spiritus vitalis<br />
COEUR<br />
septum (+ pores)<br />
ventricule droit<br />
ESTOMAC<br />
ET INTESTIN<br />
vésicule biliaire<br />
(bile jaune)<br />
RATE<br />
(bile noire)<br />
Remarquons que Galien admet l’existence <strong>de</strong> fins pores dans la cloison interventriculaire<br />
permettant le passage du sang du ventricule droit vers le ventricule gauche.<br />
Réseau admirable = rete mirabile : un réseau admirable d'origine carotidienne est présent chez certains<br />
Mammifères, dont le Porc et les Ongulés. Ce réseau n'existe pas chez l'Homme, contrairement à l'idée <strong>de</strong> Galien!<br />
La flèche, qui dans «l’artère veineuse» va du coeur vers le poumon, indique l’élimination <strong>de</strong> la «matière<br />
fuligineuse» produite par «la coction» au niveau du ventricule gauche.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 63<br />
5.3. ROME ET L’<strong>HISTOIRE</strong> NATURELLE<br />
L’apport <strong>de</strong>s Latins aux sciences naturelles a été beaucoup moins important que<br />
celui <strong>de</strong>s Grecs.<br />
Lucrèce (Titus Lucretius Carus)<br />
(98-55 av. J.-C.)<br />
Lucrèce est né à Rome vers 98 av. J.-C.. Il est mort en 55 av. J.-C. On sait très peu <strong>de</strong><br />
choses <strong>de</strong> sa vie. Il est connu comme l’auteur d’un poème en six chants, De rerum<br />
natura ␣ (Sur la nature␣ ), inspiré par la physique atomistique d’Épicure. Cet ouvrage<br />
nous livre également certaines réflexions «biologiques».<br />
Pline l’Ancien<br />
(23-79 apr. J.-C.)<br />
Pline l’Ancien (23-79) est l’auteur d’une Historia Naturalis (Histoire naturelle), vaste<br />
encyclopédie en 37 livres, dont plusieurs traitent <strong>de</strong>s êtres vivants (plantes, animaux,<br />
homme). Il s’agit d’une compilation sans esprit critique qui eut cependant le mérite<br />
d’être pendant quinze siècles le principal ouvrage <strong>de</strong> référence en histoire naturelle.<br />
Pline l’Ancien<br />
(23-79 AD)<br />
On trouve également <strong>de</strong>s passages biologiques<br />
intéressants dans les ouvrages <strong>de</strong>s<br />
agronomes latins (Caton, Varron, Columelle,<br />
etc.).<br />
Caton l’Ancien (né vers 231 BC, mort vers 147 BC),<br />
homme politique romain, célèbre pour l’austérité <strong>de</strong> ses<br />
moeurs. Auteur d’un traité sur l’agriculture: De re rustica.<br />
Varron (116-26 BC), né à Rome, avocat, polygraphe latin,<br />
nombreux ouvrages dont un traité d’agriculture: De<br />
re rustica.<br />
Columelle (1er s. AD), né à Cadix, écrivain latin, auteur<br />
d’un ouvrage en 12 livres sur l’agriculture: De re rustica.<br />
Après le second siècle <strong>de</strong> notre ère, la biologie comme les autres sciences <strong>de</strong>vait entrer<br />
dans une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> déca<strong>de</strong>nce particulièrement nette en Occi<strong>de</strong>nt et ce ne sera qu’au<br />
XVIe siècle qu’elle prendra un nouvel essor. Cependant au Moyen Age, certains esprits<br />
positifs firent œuvre <strong>de</strong> biologistes.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 64<br />
6. LE MOYEN AGE<br />
En 395, Théodose (379-395) partage avant <strong>de</strong> mourir l’Empire romain entre ses <strong>de</strong>ux<br />
fils. L’aîné (Arcadius) régnera sur l’Orient avec Constantinople (Byzance) comme<br />
capitale. Le ca<strong>de</strong>t (Honorius) régnera sur l’Occi<strong>de</strong>nt.<br />
L’Empire d’Occi<strong>de</strong>nt s’effondra bientôt sous les coups <strong>de</strong>s invasions barbares du V e<br />
siècle (Wisigoths, Vandales, Huns, etc.); il disparaîtra en l’an 476 où le <strong>de</strong>rnier empereur<br />
— établi à Ravenne — sera déposé. L’empire d’Orient durera jusqu’en 1453,<br />
année <strong>de</strong> la prise <strong>de</strong> Constantinople par les Turcs.<br />
Le Moyen Age est grosso modo la pério<strong>de</strong> comprise entre la prise <strong>de</strong> Rome par les<br />
Barbares (Ve siècle) et celle <strong>de</strong> Constantinople par les Turcs (1453).<br />
6.1. LA SCIENCE DE L’ORIENT<br />
6.1.1. BYZANCE<br />
L’Empire byzantin maintient la tradition hellénique, mais l’apport original <strong>de</strong> cette<br />
civilisation à la science est assez faible.<br />
La science byzantine a eu le mérite <strong>de</strong> préserver les œuvres d’Hippocrate, d’Aristote<br />
et <strong>de</strong> Galien. Elle a laissé parvenir jusqu’à nous <strong>de</strong>s manuscrits richement illustrés<br />
comme le célèbre Co<strong>de</strong>x Julianae Aniciae <strong>de</strong> la Bibliothèque <strong>de</strong> Vienne (VIe siècle) où<br />
sont figurées la plupart <strong>de</strong>s plantes citées dans la «Matière médicale» <strong>de</strong> Dioscori<strong>de</strong>.<br />
Parmi les scientifiques byzantins, relevons:<br />
• Oribase <strong>de</strong> Pergame (env. 325-400), mé<strong>de</strong>cin grec qui, après la chute <strong>de</strong> l’Empire,<br />
a fui Rome pour se réfugier à Constantinople. Il est l’auteur d’une monumentale<br />
encyclopédie médicale qui par son envergure a dépassé le Corpus<br />
hippocratique et les traités <strong>de</strong> Galien.<br />
• Paul d’Égine (env. 600-650), auteur d’un Abrégé <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en sept livres,<br />
oeuvre intéressante surtout par sa partie chirurgicale. L’auteur y décrit <strong>de</strong>s<br />
techniques précises comme la trachéotomie, l’ablation <strong>de</strong>s ganglions, l’ablation<br />
<strong>de</strong> tumeurs superficielles, etc.<br />
Tout en poursuivant la compilation, la mé<strong>de</strong>cine byzantine commence à y inclure<br />
ses propres connaissances cliniques et à s’ouvrir au savoir médical arabe, perse et<br />
indien.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 65<br />
6.1.2. L’ISLAM<br />
Mahomet (vers 570-632), fon<strong>de</strong> l’islamisme. Ses successeurs commencent à conquérir<br />
les pays <strong>de</strong> l’Orient (Jérusalem, Mésopotamie, Égypte). Alexandrie est prise en<br />
642; la bibliothèque est brûlée. Les Arabes vont conquérir ensuite l’Afrique du Nord<br />
et l’Espagne.<br />
Au 8 e siècle, le calife Haroun-al-Raschid fon<strong>de</strong> Bagdad, sur le Tigre, et en fait la capitale<br />
<strong>de</strong> son empire. Il y construit <strong>de</strong>s hôpitaux, <strong>de</strong>s écoles et une gran<strong>de</strong> bibliothèque.<br />
Le calife fait rassembler dans cette bibliothèque tous les manuscrits grecs qu’on<br />
peut trouver. Il charge les Juifs <strong>de</strong> les traduire en arabe. L’oeuvre d’Hippocrate et <strong>de</strong><br />
Galien a ainsi survécu. Galien est particulièrement apprécié par les Arabes. Par l’intermédiaire<br />
<strong>de</strong> traductions d’arabe en latin son oeuvre gagnera peu à peu, du XII e au<br />
XV e siècle, l’Europe occi<strong>de</strong>ntale.<br />
Parmi les mé<strong>de</strong>cins arabes, il faut surtout relever<br />
Ibn Sina ou Avicenne (980-1037), un Perse, auteur<br />
d’un grand traité, le Canon <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine (Canon<br />
medicinae), en cinq volumes.<br />
IBN SINA ou AVICENNE<br />
(980-1037)<br />
Les dissections humaines étaient interdites et les anatomistes islamiques restèrent<br />
fidèles aux métho<strong>de</strong>s galéniques. Pour eux, l’anatomie était une partie <strong>de</strong> la théologie<br />
et <strong>de</strong> la cosmologie et l’aspect téléologique d’une structure était plus important<br />
que la structure elle-même.<br />
Cependant, certains mé<strong>de</strong>cins estimèrent l’observation directe supérieure à la lecture<br />
ou au commentaire <strong>de</strong> Galien. C’est ainsi que l’Islam a à son crédit:<br />
1) la réalisation <strong>de</strong>s plus anciens schémas anatomiques <strong>de</strong> l’œil (Hunain 809-873);<br />
2) la découverte <strong>de</strong> la « petite circulation « (pulmonaire) par Ibn-al-Nafis (1210-1288)<br />
(voir plus loin);<br />
3) d’importantes innovations en pharmacologie végétale.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 66<br />
L’oeil avec les muscles et les nerfs y rattachés,<br />
selon le traité ophtalmologique <strong>de</strong><br />
Hunayn ibn Ishaq (809-873),<br />
mé<strong>de</strong>cin et scientifique arabe<br />
important connu pour avoir<br />
traduit <strong>de</strong>s ouvrages<br />
grecs en arabe.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 67<br />
6.1. 3. LES JUIFS<br />
On trouve dans le Talmud 20 <strong>de</strong>s données biologiques. En outre, les traducteurs et<br />
lexicographes juifs du Moyen Age qui résidaient dans la région méditerranéenne<br />
ont donné d’intéressants renseignements sur les noms <strong>de</strong>s plantes ou d’animaux<br />
ayant cours alors dans les diverses langues européennes et orientales.<br />
Il faut citer enfin l’œuvre du mé<strong>de</strong>cin et philosophe Moïse Maïmoni<strong>de</strong> (1135-1204)<br />
qui écrivit un Traité <strong>de</strong>s Poisons où sont cités <strong>de</strong>s plantes vénéneuses et <strong>de</strong>s animaux<br />
venimeux avec les remè<strong>de</strong>s à utiliser pour s’en préserver.<br />
Moïse Maïmoni<strong>de</strong> (1135-1204)<br />
20 Talmud = livre contenant les doctrines et les préceptes enseignés par les anciens rabbins.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 68<br />
6.2. LA SCIENCE DE L’OCCIDENT : UN ÉVÊQUE, UN EMPEREUR<br />
Les rares auteurs ayant contribué à la biologie sont ceux qui, échappant à la scolastique<br />
et notamment à la dictature d’Aristote, firent <strong>de</strong>s observations originales dans la<br />
nature. Nous ne citerons ici que les <strong>de</strong>ux principaux: un évêque, Albert le Grand<br />
(1193-1280) et un empereur: Frédéric II <strong>de</strong> Hohenstaufen (1194-1250).<br />
Albert le Grand (Albertus Magnus)<br />
(vers 1200 - 1280)<br />
Albert le Grand (Albertus Magnus), originaire d’Allemagne,<br />
a écrit en 1270 un traité d’inspiration aristotélicienne<br />
et galénique sur les animaux (De<br />
animalibus) en 26 livres dont 21 sont consacrés à<br />
l’anatomie comparée <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong>s animaux.<br />
Il a donné une classification <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers qui sur<br />
certains points perfectionne celle d’Aristote, a fait<br />
quelques observations originales sur <strong>de</strong>s Invertébrés<br />
terrestres et marins et sur divers Vertébrés (Cétacés,<br />
Castor, races géographiques <strong>de</strong> l’Ecureuil,<br />
etc.).<br />
Ses idées en embryologie sont inspirées d’Aristote<br />
et sa physiologie est encore hippocratique. Pour lui,<br />
le cœur est le siège <strong>de</strong> la chaleur vitale. Son oeuvre<br />
biologique rompt un long silence et marque une<br />
transition entre l’Antiquité et la Renaissance.<br />
Frédéric II <strong>de</strong> Hohenstaufen<br />
(1194-1250)<br />
Frédéric II <strong>de</strong> Hohenstaufen, roi <strong>de</strong> Sicile puis empereur<br />
d’Allemagne, a écrit un remarquable traité<br />
<strong>de</strong> fauconnerie (De Arte venandi cum avibus). C’est<br />
une véritable encyclopédie ornithologique, où il y<br />
est question <strong>de</strong> la morphologie et <strong>de</strong>s mœurs <strong>de</strong> divers<br />
Oiseaux.<br />
Il a étudié notamment chez eux l’adaptation du bec,<br />
la mécanique du vol (il aurait découvert la<br />
pneumaticité <strong>de</strong> leurs os). Les miniatures illustrant<br />
ce traité sont au nombre <strong>de</strong> 900; certaines d’entre<br />
elles, très fidèles, ont peut-être été exécutées par<br />
l’empereur lui-même.<br />
Frédéric II <strong>de</strong> Hohenstaufen
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 69<br />
Passionné pour la recherche scientifique, Frédéric II a promulgué en 1241 un édit<br />
autorisant la dissection <strong>de</strong>s cadavres humains, qui fut malheureusement rapporté<br />
par l’Eglise après sa mort. Cette interdiction <strong>de</strong> disséquer les corps humains explique<br />
qu’à la célèbre Ecole <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Salerne, l’anatomie était enseignée dès le<br />
XIe siècle d’après celle du porc et d’autres Vertébrés. A partir du XIVe siècle, cet<br />
interdit sera levé et permettra à l’Italien Mondino <strong>de</strong>i Luzzi (vers 1275-1326) <strong>de</strong> perfectionner<br />
sur certains points les notions d’anatomie humaine <strong>de</strong> l’Antiquité (voir<br />
plus loin).<br />
•<br />
Ces quelques indications montrent qu’en Occi<strong>de</strong>nt comme en Orient, la biologie<br />
médiévale était caractérisée par un goût très vif pour la scolastique et que seuls les<br />
esprits plus libres observant directement les êtres vivants (mé<strong>de</strong>cins, chasseurs, agriculteurs,<br />
etc.) apportèrent du nouveau en ce domaine.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 70<br />
7. MÉDECINE ET <strong>SCIENCES</strong> NATURELLES<br />
À L’ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE<br />
La Renaissance est marquée par la reviviscence<br />
<strong>de</strong> l’Antiquité dans les arts et les sciences, avec<br />
un retour aux sources grecques et latines et le<br />
développement <strong>de</strong> l’humanisme 21 . C’est l’époque<br />
<strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s découvertes géographiques:<br />
Christophe Colomb découvre l’Amérique<br />
(1492), Vasco da Gama atteint les In<strong>de</strong>s par la<br />
voie maritime (1498). L’imprimerie est inventée<br />
vers le milieu du 15e s. 22 La conquête <strong>de</strong> Constantinople<br />
par les Turcs en 1453 fait émigrer <strong>de</strong><br />
nombreux savants grecs vers les pays <strong>de</strong> l’Europe.<br />
L’astronome polonais Nicolas Copernic<br />
(1473-1543) remplace le système géocentrique<br />
<strong>de</strong> Ptolémée (vers 100 - vers 160) (les planètes<br />
tournent autour <strong>de</strong> la Terre, centre <strong>de</strong> l’univers)<br />
par le système héliocentrique (les planètes et la<br />
Terre tournent autour du Soleil, centre <strong>de</strong> l’univers).<br />
À côté <strong>de</strong>s sciences au sens strict, <strong>de</strong>s sciences<br />
occultes se développent:<br />
L’astrologie connaît un regain <strong>de</strong> ferveur.<br />
L’alchimie prend son essor. Les alchimistes sont<br />
convaincus que tout peut se transformer en tout.<br />
Ils cherchent à accomplir le «grand oeuvre» qui<br />
fournira la pierre philosophale (Stein <strong>de</strong>r Weisen)<br />
permettant <strong>de</strong> transmuer le plomb en or, source<br />
<strong>de</strong> richesse et symbole <strong>de</strong> la pureté avant le péché<br />
originel. Le grand oeuvre permettra d’acquérir<br />
les biens <strong>de</strong> ce mon<strong>de</strong>, mais surtout <strong>de</strong><br />
régénérer l’homme et la nature. L’alchimie est<br />
donc une <strong>de</strong>s voies du salut.<br />
Des alchimistes au travail.<br />
Nicolas COPERNIC (1473-1543), auteur <strong>de</strong><br />
l’ouvrage «De revolutionibus orbium coelestium»<br />
(Traité sur les révolutions du mon<strong>de</strong> céleste.)<br />
21 A l’origine, un humaniste était un érudit qui s’adonnait aux «lettres humaines», c’est-à-dire à l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s connaissances ne concernant pas directement la théologie. Ce savoir profane, on le recherchait<br />
presque exclusivement dans les textes <strong>de</strong> l’Antiquité classique.<br />
22 Les livres imprimés avant 1500 sont appelés «incunables» (<strong>de</strong> incunabulum = berceau)<br />
(Wiegendrucke).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 71<br />
• La croyance à la sorcellerie, héritage du Moyen Âge, mènera à la chasse aux sorcières,<br />
l’un <strong>de</strong>s chapitres les moins glorieux <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’Europe et <strong>de</strong> l’Église<br />
qui a duré jusqu’au 17e s. Des traités comme le Malleus maleficarum ou Hexenhammer<br />
(Marteau <strong>de</strong>s Sorcières) édité en 1487 par les moines dominicains Jacob Sprenger<br />
et Heinrich Institoris servent <strong>de</strong> gui<strong>de</strong> aux inquisiteurs. Beaucoup <strong>de</strong> sages-femmes<br />
sont d’ailleurs accusées <strong>de</strong> sorcellerie. 23 Il faut attendre l’année 1631 pour voir la<br />
publication d’un premier ouvrage s’insurgeant contre les procès <strong>de</strong> sorcellerie. Il<br />
s’agit <strong>de</strong> «Cautio criminalis o<strong>de</strong>r Rechtliches Be<strong>de</strong>nken wegen <strong>de</strong>r Hexenprozesse» écrit<br />
par le Jésuite Friedrich von Spee (1591-1635), qui est mort et enterré à Trèves.<br />
«Cautio criminalis», 1ère édition en 1631, 2e édition<br />
en 1632 (Cautio criminalis o<strong>de</strong>r Rechtliches<br />
Be<strong>de</strong>nken wegen <strong>de</strong>r Hexenprozesse).<br />
7.1. L’essor <strong>de</strong> la botanique et <strong>de</strong> la zoologie<br />
Sous l’influence <strong>de</strong> l’humanisme la botanique, tout en restant étroitement liée à la<br />
mé<strong>de</strong>cine, s’est développée en une science indépendante. De nombreux ouvrages<br />
<strong>de</strong> botanique (Kräuterbücher, herbiers) sont publiés. Grâce à l’imprimerie leur diffusion<br />
est largement facilitée.<br />
Citons:<br />
- Herbarum vivae eicones (1530), par Otto Brunfels (1488-1534), ancien moine chartreux<br />
converti au luthéranisme et <strong>de</strong>venu mé<strong>de</strong>cin. C’est le premier à avoir publié<br />
<strong>de</strong>s reproductions <strong>de</strong> plantes absolument conformes à la nature.<br />
• New Kreutterbuch (1539), par Jérôme Bock 24 (1498-1554).<br />
Friedrich von SPEE<br />
(1591-1635)<br />
• De historia stirpium commentarii (1542), par Leonhardt Fuchs (1501-1556).<br />
23 Au Luxembourg, 700 procès <strong>de</strong> sorcellerie sont documentés pour la pério<strong>de</strong> 1560-1700. Le nombre<br />
réel <strong>de</strong>s procès est probablement <strong>de</strong>ux à trois fois supérieur.<br />
24 Hieronymus Tragus en latin.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 72<br />
Herbarium Apulei (1481)<br />
Le premier herbier imprimé.<br />
Otto BRUNFELS (1488-1534)<br />
Auteur <strong>de</strong> Herbarum vivae icones<br />
(1530)<br />
Leonhardt FUCHS,<br />
De Stirpium historia (1542).<br />
L’un <strong>de</strong>s plus grands naturalistes <strong>de</strong> l’époque a été<br />
le mé<strong>de</strong>cin zurichois Conrad Gesner (1516-1565) qui<br />
a publié une monumentale «Historia animalium»<br />
(Histoire naturelle <strong>de</strong>s animaux). Emporté par la<br />
peste en 1565, il n’a pas pu terminer le pendant<br />
botanique, une «Histoire naturelle <strong>de</strong>s plantes»,<br />
pour laquelle il avait déjà confectionné <strong>de</strong>s centaines<br />
<strong>de</strong> figures; elle n’a été éditée qu’au 18e s. sous<br />
le titre «Opera botanica Conradi Gesneri», 1751-1771<br />
(Oeuvres botaniques <strong>de</strong> Conrad Gesner). Gesner a<br />
réintroduit en thérapeutique la belladone<br />
(Tollkirsche) déjà connue <strong>de</strong> Dioscori<strong>de</strong>.<br />
Otto BRUNFELS:<br />
Le Fraisier sauvage (Fragaria vesca).<br />
Conrad GESNER (1516-1565)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 73<br />
7.2. André Vésale et l’anatomie<br />
Au début <strong>de</strong> la Renaissance, l’anatomie du corps humain n’est guère connue. Plus<br />
<strong>de</strong> 1500 ans se sont écoulés <strong>de</strong>puis les dissections humaines faites à Alexandrie par<br />
Hérophile et Erasistrate. Galien n’avait disséqué que <strong>de</strong>s animaux, notamment <strong>de</strong>s<br />
singes.<br />
Quelques rares dissections avaient été faites pendant le Moyen Âge. Ainsi, en Italie<br />
Mondino <strong>de</strong>’ Luzzi (Mundinus) (?1275-1326) avait disséqué <strong>de</strong>ux corps <strong>de</strong> femmes<br />
en 1315, ce qui ne l’empêche pas <strong>de</strong> répéter dans son «Anothomia» (1316) l’affirmation<br />
erronée selon laquelle l’utérus <strong>de</strong> la femme serait divisé en sept compartiments,<br />
<strong>de</strong> même qu’il accepte l’idée que l’utérus humain serait pourvu <strong>de</strong> cornes utérines.<br />
Quelques rares anatomistes italiens avaient imité l’exemple <strong>de</strong> Mondino <strong>de</strong>’ Luzzi,<br />
mais ils risquaient d’être poursuivis par l’Inquisition.<br />
Au début du 16e s., les dissections <strong>de</strong>venaient plus fréquentes. Elles n’étaient pas<br />
effectuées par les professeurs, mais par <strong>de</strong>s assistants. Cela suffisait néanmoins pour<br />
constater que la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> Galien ne concordait pas avec les observations. Mais<br />
plutôt que <strong>de</strong> conclure à une erreur <strong>de</strong> Galien, l’on préférait dire que c’était la nature<br />
qui avait changé!<br />
Léonard <strong>de</strong> Vinci disséqua (1452-1519) plus <strong>de</strong> dix corps humains. Ses <strong>de</strong>ssins, très<br />
précis pour l’époque, ne furent pas publiés, <strong>de</strong> sorte que son l’influence n’a pas été à<br />
la mesure <strong>de</strong> ses recherches.<br />
Planche anatomique publiée en 1493 dans<br />
le Fasciculo di medicina et qui illustre<br />
l’Anothomia <strong>de</strong> Mondino <strong>de</strong>’ Luzzi y incluse.<br />
Cette image <strong>de</strong> femme éventrée est la<br />
première figuration d’une structure organique<br />
ouverte.<br />
Léonard <strong>de</strong> VINCI<br />
(1452-1519)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 74<br />
L’anatomie humaine a été révolutionnée par le Belge André Vésale (1514-1564) avec<br />
la publication <strong>de</strong> l’ouvrage De humani corporis fabrica libri septem (Les sept livres sur<br />
la structure du corps humain) paru en 1543 à Bâle. Le livre comprend plus <strong>de</strong> 300<br />
gravures sur bois. Vésale y décrit ce qu’il a vu <strong>de</strong> ses propres yeux. Il montre que<br />
Galien s’est trompé sur <strong>de</strong> nombreux points ce qui ne manquera pas <strong>de</strong> soulever<br />
l’opposition <strong>de</strong>s partisans inconditionnels <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier.<br />
Les aïeux <strong>de</strong> Vésale sont originaires <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Wesel 25 , d’où le nom <strong>de</strong> famille «van Wesele» qui<br />
a été latinisé en Vesalius. Il est né le 31 décembre 1514 à Bruxelles, il est mort le 5 octobre 1564 sur l’île<br />
<strong>de</strong> Zante (mer Ionienne) au retour d’un pèlerinage à Jérusalem.<br />
André Vésale (1514-1564)<br />
Gravure sur bois due à Calcar.<br />
Planches anatomiques <strong>de</strong> Vésale<br />
25 Nord-Rhénanie-Westphalie, à l’embouchure <strong>de</strong> la Lippe dans le Rhin inférieur.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 75<br />
Frontispice <strong>de</strong> l’ouvrage “De humani corporis fabrica libri septem”,<br />
Bâle, 1543
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 76<br />
André Vésale fut un jeune homme précoce.<br />
Après avoir étudié à Louvain, il était venu à<br />
Paris où il suivit les cours du célèbre professeur<br />
Sylvius. À l’âge où l’on songe plutôt à rire<br />
et à s’amuser, Vésale n’avait qu’une passion:<br />
l’anatomie. Le soir au lieu d’aller boire dans<br />
les cabarets avec <strong>de</strong> gais compagnons, il se dirigeait<br />
vers les cimetières, il rôdait près du gibet<br />
<strong>de</strong> Montfaucon où pendait la dépouille <strong>de</strong><br />
quelque supplicié. Par ruse ou en payant le gardien<br />
<strong>de</strong> beaux <strong>de</strong>niers, il s’emparait <strong>de</strong> ces corps<br />
et les emportait comme un voleur dans sa <strong>de</strong>meure<br />
où il procédait à la dissection. Les cadavres<br />
étaient encore si rares que quelques années<br />
plus tard, en 1556, Guillaume Ron<strong>de</strong>let,<br />
chancelier <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Montpellier,<br />
inaugurait le théâtre d’anatomie <strong>de</strong> cette<br />
ville en disséquant le corps <strong>de</strong> son propre fils.<br />
Mais Vésale était las d’entendre toujours citer<br />
Galien. Il quitta bientôt Paris pour Padoue où<br />
il fut nommé à vingt-trois ans professeur d’anatomie.<br />
De tous les pays les étudiants accouraient<br />
pour l’entendre tant sa réputation était<br />
déjà gran<strong>de</strong>: c’était alors un homme <strong>de</strong> petite<br />
taille, aux yeux vifs et noirs aux cheveux et à la<br />
barbiche noirs, difficile <strong>de</strong> caractère qui disait<br />
ce qu’il pensait sans craindre <strong>de</strong> se faire <strong>de</strong>s<br />
ennemis. Cinq ans après son arrivée à Padoue,<br />
à l’âge <strong>de</strong> vingt-huit ans seulement, en 1543, il<br />
publiait son chef-d’oeuvre intitulé De Humani<br />
corporis fabrica (La structure du corps humain),<br />
énorme in-folio sorti à Bâle <strong>de</strong>s presses <strong>de</strong> Jean<br />
Oporinus, un <strong>de</strong>s plus grands imprimeurs du<br />
siècle, et écrit bien entendu en latin comme<br />
presque tous les livres médicaux <strong>de</strong> ce temps-là.<br />
Ce livre déchaîna les passions <strong>de</strong> tous les anatomistes<br />
<strong>de</strong> l’époque. Vésale y signalait, pour<br />
la première fois, la plupart <strong>de</strong>s erreurs contenues<br />
dans l’oeuvre <strong>de</strong> Galien et décrivait ce<br />
qu’il avait vu <strong>de</strong> ses propres yeux. D’ailleurs, à<br />
l’encontre <strong>de</strong>s autres professeurs qui se contentaient<br />
<strong>de</strong> prési<strong>de</strong>r du haut <strong>de</strong> leur chaire, il disséquait<br />
lui-même avec une adresse extraordinaire,<br />
tel qu’on le voit sur le fameux frontispice<br />
<strong>de</strong> la Fabrica où il est représenté, scalpel<br />
en main, faisant une leçon sur un cadavre, au<br />
milieu d’une foule nombreuse d’étudiants et<br />
<strong>de</strong> curieux dans le théâtre anatomique <strong>de</strong> Padoue,<br />
un <strong>de</strong> ces théâtres que les dissections fréquentes<br />
vont obliger à construire un peu partout.<br />
LECTURE: ANDRÉ VÉSALE<br />
La Fabrica est encore célèbre à d’autres titres:<br />
Vésale avait voulu pour son livre les plus magnifiques<br />
illustrations. On a dit qu’il s’était<br />
adressé au Titien lui-même, d’autres disent à<br />
son élève Calcar. Quoi qu’il en soit, ces squelettes,<br />
ces écorchés sont figurés en <strong>de</strong>s attitu<strong>de</strong>s<br />
harmonieuses sur un fond <strong>de</strong> paysage italien.<br />
Ils vont, viennent, se meuvent, laissant<br />
étaler leurs chairs, claquer leurs os; ces êtres<br />
dépouillés semblent encore vivants. Les impressionnantes<br />
gravures <strong>de</strong> la Fabrica <strong>de</strong>meurent<br />
les plus belles images <strong>de</strong> l’anatomie.<br />
Vésale, <strong>de</strong>vant la tempête <strong>de</strong> protestations élevées<br />
par tous ceux qui pensaient que Galien<br />
n’avait pu se tromper, quitta Padoue pour aller<br />
remplir auprès <strong>de</strong> l’empereur Charles Quint à<br />
qui il avait dédié son livre, les fonctions <strong>de</strong> premier<br />
mé<strong>de</strong>cin. Après la retraite <strong>de</strong> l’empereur,<br />
il fut mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> son fils Philippe II. Sa fin est<br />
restée un peu mystérieuse. On a raconté qu’il<br />
avait été accusé — à tort bien sur — d’avoir<br />
disséqué un gentilhomme encore vivant et que<br />
l’empereur pour le protéger, lui avait ordonné<br />
d’aller faire un pèlerinage en Terre Sainte. Au<br />
retour il aurait péri dans un naufrage, mais il<br />
mourut tout simplement à l’île <strong>de</strong> Zante, sur la<br />
côte adriatique, l’année 1564.<br />
Extrait <strong>de</strong>: Paule Dumaître, Mé<strong>de</strong>cine et mé<strong>de</strong>cins. Paris,<br />
Magnard, 1977.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 77<br />
Gabriele Fallope (1523-1562) a été l’élève <strong>de</strong> Vésale à Padoue. Il est connu pour ses<br />
travaux sur la reproduction humaine et le développement du foetus dont il a étudié<br />
la formation <strong>de</strong>s os et celle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts. Il a (re-)découvert les oviductes déjà décrits<br />
par Hérophile, dont la découverte était passée dans l’oubli. C’est en son honneur<br />
que les oviductes s’appellent toujours « les trompes <strong>de</strong> Fallope».<br />
Son contemporain Bartolomeo Eustachi (vers 1500-1574) était un fervent a<strong>de</strong>pte <strong>de</strong><br />
Galien et un adversaire déclaré <strong>de</strong> Vésale. Cela ne l’a pas empêché <strong>de</strong> produire <strong>de</strong><br />
sérieux ouvrages anatomiques. Il est connu pour sa découverte <strong>de</strong> la trompe qui fait<br />
communiquer l’oreille moyenne et la partie supérieure du pharynx, la «trompe d’Eustache»<br />
(Eustachische Röhre, Ohrtrompete). En fait, là encore il s’agit plutôt <strong>de</strong> la redécouverte<br />
d’une structure déjà décrite par Alcméon <strong>de</strong> Croton, philosophe grec qui a<br />
vécu vers 500 av. J.-C.<br />
Gabriele Fallope (1523-1562)<br />
Bartolomeo Eustachi<br />
(vers 1500-1574)<br />
Oreille et trompe d’Eustache
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 78<br />
7.3. Ambroise Paré et la chirurgie<br />
Le chirurgien-barbier Ambroise Paré (1510-1590), <strong>de</strong>venu chirurgien militaire par<br />
après, a profondément changé la chirurgie <strong>de</strong> son temps qui a dû d’ailleurs affronter<br />
un nouveau type <strong>de</strong> blessures, celles faites par les armes à feu—un domaine où les<br />
écrits d’Hippocrate et <strong>de</strong> Galien ne pouvaient évi<strong>de</strong>mment plus servir.<br />
Depuis les travaux <strong>de</strong> l’Italien Jean <strong>de</strong> Vigo (Giovanni da Vigo) (1450?-1525? ou<br />
1460?-1525? ) on admettait que les blessures par armes à feu sont envenimées par la<br />
poudre. C’est pourquoi il fallait les traiter par le feu, seul capable d’après Vigo <strong>de</strong><br />
détruire le poison. Le traitement consistait dans la cautérisation <strong>de</strong>s plaies par le fer<br />
porté au rouge ou par l’huile bouillante.<br />
Un jour, manquant d’huile bouillante, Paré l’a remplacée par un baume à base d’oeufs,<br />
d’huile rosate 26 et <strong>de</strong> térébenthine qu’il a appliqué sans le chauffer. Il n’y a pas eu<br />
d’empoisonnement, au contraire, le résultat a été nettement mieux que dans le cas<br />
<strong>de</strong>s plaies cautérisées. Paré a décidé d’abandonner la cautérisation <strong>de</strong>s plaies et <strong>de</strong> la<br />
remplacer par le pansement <strong>de</strong> son invention.<br />
La cautérisation au fer rouge était également d’usage lors <strong>de</strong>s amputations. Paré a<br />
remplacé ce procédé extrêmement douloureux et peu favorable à la guérison par la<br />
ligature <strong>de</strong>s vaisseaux sanguins, revenant ainsi à une métho<strong>de</strong> déjà en usage dans<br />
l’Antiquité dans la mé<strong>de</strong>cine alexandrine, mais tombée dans l’oubli.<br />
Ambroise PARÉ (1510-1590)<br />
(gravure sur cuivre 1682)<br />
Application du cautère (Brenneisen).<br />
La cautérisation a été introduite par la mé<strong>de</strong>cine<br />
arabe.<br />
26 rosat, adj. = se dit d’une préparation dans laquelle on fait entrer <strong>de</strong>s roses.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 79<br />
En plus, Paré a inventé <strong>de</strong>s prothèses pour remplacer les membres amputés.<br />
Dans le domaine <strong>de</strong>s remè<strong>de</strong>s, Paré s’est élevé contre l’utilisation <strong>de</strong> la pierre <strong>de</strong><br />
bézoard ( persan: bedzhar = contrepoison), <strong>de</strong> la corne <strong>de</strong> licorne ou <strong>de</strong> la momie.<br />
Il a publié plus <strong>de</strong> vingt ouvrages dont le plus important porte le titre «Dix livres<br />
<strong>de</strong> la Chirurgie» (Paris, 1564).<br />
Main artificielle. Prothèse imaginée et réalisée<br />
par Ambroise Paré.<br />
Amputation <strong>de</strong> la jambe. Gravure sur bois <strong>de</strong> 1517.<br />
Licornes (g.)<br />
et animal fournissant le<br />
bézoard (dr.).<br />
“Der aufrichtige Materialist<br />
und Specerey-Händler”<br />
(1717).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 80<br />
A Angers, le Vendredi Saint <strong>de</strong> l’année 1525, un<br />
jeune garçon <strong>de</strong> quinze ans observait un mendiant<br />
à la porte d’une église qui suppliait bien<br />
haut qu’on lui donnât l’aumône; pour apitoyer<br />
le peuple il montrait un bras pourri qui sortait<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssous son pourpoint. Tout à coup,<br />
l’homme ayant fait trop <strong>de</strong> mouvements, le bras<br />
pourri se détacha et tomba à terre. On comprit<br />
alors la supercherie.<br />
—Ah ! ah ! le coquin a coupé le bras d’un pendu<br />
qu’il a attaché à son vêtement en cachant le sien<br />
propre afin <strong>de</strong> faire pitié et <strong>de</strong> récolter <strong>de</strong> l’argent<br />
sans travailler.<br />
Le jeune garçon qui observait le mendiant et<br />
qui nous a raconté plaisamment cette histoire<br />
se nommait Ambroise Paré.<br />
Né en 1510 au Bourg-Hersent, aux portes <strong>de</strong> Laval,<br />
où son père était, croit-on, attaché à la maison<br />
du comte <strong>de</strong> Laval en qualité <strong>de</strong> valet <strong>de</strong><br />
chambre barbier, le jeune Ambroise avait tout<br />
naturellement suivi la profession paternelle.<br />
Etait-il en apprentissage chez un barbier d’Angers<br />
? On ne sait, mais après un séjour à Vitré<br />
où son frère était établi maître chirurgien-barbier,<br />
Ambroise partit pour Paris où il travailla<br />
pendant trois ans à l’Hôtel-Dieu, pratiquant <strong>de</strong><br />
nombreuses dissections et soignant les mala<strong>de</strong>s.<br />
Il aurait pu <strong>de</strong>venir un bon chirurgien-barbier<br />
comme tant d’autres mais son <strong>de</strong>stin n’était pas<br />
là. La Guerre l’attendait, et alors commença son<br />
extraordinaire carrière.<br />
Mr. <strong>de</strong> Montejan, colonel général <strong>de</strong>s gens à<br />
pied, envoyé par François Ier pour occuper le<br />
Milanais, cherchait à s’attacher un chirurgien<br />
pour accompagner l’armée. Ambroise Paré qui<br />
avait dû, par manque d’argent, renoncer à ses<br />
étu<strong>de</strong>s, décida <strong>de</strong> le suivre. À la fin d’octobre<br />
1537 il assistait au combat du Pas <strong>de</strong> Suse ␣ 27 et là<br />
fit sa première découverte qui <strong>de</strong>vait présenter<br />
pour les batailles à venir la plus gran<strong>de</strong> importance.<br />
On croyait alors que les blessures faites par les<br />
armes à feu — les arquebuses — s’envenimaient<br />
à cause <strong>de</strong> la poudre et qu’il fallait les arroser<br />
d’huile bouillante pour faire sortir le poison. Ce<br />
traitement barbare faisait pousser <strong>de</strong>s cris affreux<br />
aux pauvres blessés. Notre jeune chirur-<br />
LECTURE: AMBROISE PARÉ<br />
gien se conformait donc à l’usage, mais il y avait<br />
ce jour là afflux <strong>de</strong> blessés.<br />
—Je n’ai plus d’huile, s’exclama Paré que vais-je<br />
faire ?<br />
Il eut alors l’idée d’appliquer sur les plaies d’arquebuses<br />
un «digestif» fait <strong>de</strong> jaune d’oeuf,<br />
d’huile <strong>de</strong> rosat et <strong>de</strong> térébenthine. La nuit, il ne<br />
put dormir, certain que le len<strong>de</strong>main il allait<br />
trouver les mala<strong>de</strong>s qui n’avaient pas eu d’huile,<br />
morts empoisonnés.<br />
Ce fut le contraire qui se produisit: le len<strong>de</strong>main<br />
matin ces blessés-là avaient reposé toute la nuit,<br />
sans gran<strong>de</strong>s douleurs, et les autres n’avaient<br />
cessé <strong>de</strong> crier, et brûlaient <strong>de</strong> fièvre. Ainsi Paré<br />
avait découvert que la poudre n’empoisonnait<br />
pas les blessures faites par les armes à feu et<br />
trouvé en même temps un nouveau traitement.<br />
Ambroise Paré <strong>de</strong>vint si populaire à l’armée, sa<br />
technique opératoire fut si justement vantée que<br />
les princes et les grands seigneurs voulaient tous<br />
être soignés par lui. Au siège <strong>de</strong> Boulogne en<br />
1545, il fut appelé près du duc François <strong>de</strong> Guise.<br />
— Le duc a reçu au visage un coup <strong>de</strong> lance si<br />
violent que le fer est <strong>de</strong>meuré dans la plaie. Il<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> Maître Ambroise.<br />
Paré prit alors <strong>de</strong>s tenailles <strong>de</strong> maréchal-ferrant,<br />
appliqua son pied contre le visage du patient et<br />
retira le fer. Désormais on appela le duc <strong>de</strong><br />
Guise: le Balafré.<br />
La plus gran<strong>de</strong> découverte <strong>de</strong> Paré fut celle <strong>de</strong><br />
la ligature <strong>de</strong>s artères au cours <strong>de</strong>s opérations.<br />
Jusque-là on usait, pour arrêter les hémorragies,<br />
<strong>de</strong> cautère au fer rouge, ce qui entraînait d’atroces<br />
souffrances. Il suffit <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r les gravures<br />
<strong>de</strong>s anciens livres pour se représenter ce<br />
qu’était alors une amputation. Sur l’une d’elles<br />
le patient est assis sur une chaise, un voile lui<br />
couvrant le visage, sans doute pour lui épargner<br />
l’horrible spectacle, bien qu’il soit probablement<br />
sous l’effet d’une plante narcotique<br />
dont on lui a fait respirer le suc. Le chirurgien<br />
sectionne l’os tandis qu’un ai<strong>de</strong> à genoux, tient<br />
la partie qu’on ampute d’où s’échappe le sang<br />
qui coule dans un baquet. Il va ensuite cautériser<br />
les vaisseaux au fer rouge. Ce fut encore la<br />
27 Pas <strong>de</strong> Suse = défilé situé près <strong>de</strong> Suse, village <strong>de</strong>s Alpes italiennes (province <strong>de</strong> Turin).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 81<br />
guerre qui fournit à Paré l’occasion d’expérimenter<br />
un procédé moins hasar<strong>de</strong>ux et moins barbare.<br />
Au retour d’une expédition en Allemagne,<br />
l’année 1552, on vint l’appeler en toute hâte:<br />
— Un gentilhomme a eu la jambe traversée par<br />
un coup <strong>de</strong> couleuvrine.<br />
Il fallut amputer. Notre chirurgien eut alors<br />
l’idée, au lieu <strong>de</strong> cautériser avec le fer, <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r<br />
à la ligature <strong>de</strong>s vaisseaux au moyen d’une<br />
aiguille. Cette métho<strong>de</strong> permettait d’amputer<br />
très rapi<strong>de</strong>ment, dans la chair saine, et préservait<br />
les blessés <strong>de</strong>s hémorragies et <strong>de</strong> la gangrène.<br />
Le gentilhomme supporta si bien l’opération<br />
qu’il retourna à Paris, tout gaillard, avec<br />
une jambe <strong>de</strong> bois. « Je le pansai et Dieu le guérit «<br />
écrit alors Paré. Cette formule, nous la retrouvons<br />
maintes fois sous sa plume, elle est tout à<br />
l’honneur <strong>de</strong> cet homme grand autant que mo<strong>de</strong>ste.<br />
On n’en finirait pas <strong>de</strong> raconter toutes les aventures<br />
<strong>de</strong> Paré. Une <strong>de</strong>s plus célèbres est la part<br />
qu’il prit en 1552 au siège <strong>de</strong> Metz. 28 La ville,<br />
défendue par le duc <strong>de</strong> Guise, était entourée <strong>de</strong><br />
tous côtés par les troupes <strong>de</strong> Charles Quint. Paré<br />
parvint à s’introduire dans la place en franchis-<br />
7.4. Paracelse et la mé<strong>de</strong>cine interne<br />
sant, la nuit, les lignes ennemies. Il a raconté<br />
lui-même toutes ses campagnes — il fut chirurgien<br />
militaire durant près <strong>de</strong> vingt-cinq ans —<br />
dans une langue savoureuse qu’on prend plaisir<br />
à lire encore aujourd’hui. N’oublions pas que<br />
Paré, qui n’était que chirurgien-barbier, ne savait<br />
pas le latin et écrivait en français. On lui<br />
doit aussi beaucoup d’autres ouvrages ornés <strong>de</strong><br />
jolies gravures où on le voit réduisant <strong>de</strong>s fractures,<br />
procédant à diverses opérations, avec le<br />
pourpoint, la barbiche courte et le toquet du<br />
temps <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers Valois.<br />
Il en avait fait du chemin, le petit apprenti d’Angers:<br />
le roi Henri II l’avait nommé son premier<br />
chirurgien. Malheureusement il ne put pas le<br />
guérir <strong>de</strong> la terrible blessure reçue dans le tournoi<br />
<strong>de</strong>s Tournelles en juillet 1559. Le roi avait<br />
oublié <strong>de</strong> baisser la visière <strong>de</strong> son casque, la<br />
lance <strong>de</strong> son adversaire, Montgomery, lui transperça<br />
le crâne. Après la mort du roi, Paré remplit<br />
les mêmes fonctions auprès <strong>de</strong> ses fils, François<br />
II, Charles IX et Henri III. Chirurgien <strong>de</strong><br />
quatre rois <strong>de</strong> France !<br />
Extrait <strong>de</strong>: Paule Dumaître, Mé<strong>de</strong>cine et mé<strong>de</strong>cins. Paris,<br />
Magnard, 1977.<br />
La mé<strong>de</strong>cine interne du 16e s. est toujours a<strong>de</strong>pte <strong>de</strong> la pathologie humorale. Cette<br />
conception est cependant mise en question par un mé<strong>de</strong>cin surnommé Paracelse, 29<br />
<strong>de</strong> son vrai nom Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, né en<br />
Suisse près d’Einsie<strong>de</strong>ln vers 1493, mort à Salzbourg en 1541.<br />
PARACELSE (1493-1541)<br />
Paracelse ne croit guère aux théories enseignées dans<br />
les universités et s’insurge contre les autorités <strong>de</strong> la<br />
mé<strong>de</strong>cine galénique, notamment Galien lui-même et Avicenne.<br />
A son avis, les livres traditionnels font obstacle<br />
aux progrès <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine. Il faut les mettre <strong>de</strong> côté,<br />
revenir au «livre <strong>de</strong> la nature» et baser la mé<strong>de</strong>cine sur<br />
l’expérience empirique, même celle <strong>de</strong> simples barbiers<br />
ou <strong>de</strong> «sorcières».<br />
Il abandonne la pharmacologie hippocratico-galénique<br />
basée surtout sur <strong>de</strong>s médicaments d’origine végétale<br />
(ou animale). Paracelse, qui est alchimiste, introduit dans<br />
la mé<strong>de</strong>cine interne <strong>de</strong>s médicaments chimiques et mi-<br />
28 D’après Sournia (1992), Paré a également été au Luxembourg. Il faut entendre par là l’ancien<br />
duché <strong>de</strong> Luxembourg. Paré a participé au siège <strong>de</strong> Damvillers, ville luxembourgeoise à l’époque.<br />
29 C’est-à-dire: celui qui est à côté <strong>de</strong> Celse (voir ce chapitre).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 82<br />
néraux tels le mercure, le chlorure d’antimoine, le vitriol (sulfate <strong>de</strong> cuivre), <strong>de</strong>s<br />
composés d’arsenic, <strong>de</strong>s composés <strong>de</strong> bismuth, le chlorure aurique et <strong>de</strong>s préparations<br />
plombiques. 30 Il apparaît <strong>de</strong> cette manière comme un précurseur <strong>de</strong> l’iatrochimie<br />
ou chimiatrie (17e et 18e s.) qui admet l’existence <strong>de</strong> transformations chimiques dans<br />
l’organisme humain (métabolisme) et s’oppose ainsi clairement à la pathologie humorale.<br />
Il faut néanmoins préciser que la théorie alchimique du fonctionnement <strong>de</strong> l’organisme<br />
développée par Paracelse est tout aussi hermétique et obscure que la théorie<br />
galénique ou hippocratique. Paracelse fon<strong>de</strong> sa théorie iatrochimique sur trois principes<br />
(tria prima) présents dans toutes les choses naturelles, plantes, animaux, minéraux,<br />
métaux, corps humain:<br />
• le soufre (sulphur), qui correspond à tout ce qui brûle;<br />
• le sel (sal), qui représente ce qui est soli<strong>de</strong>, ce qui reste sous forme <strong>de</strong> cendres<br />
après incinération ou distillation, qui résiste donc au feu;<br />
• le vif-argent ou mercure (mercurius), qui correspond à ce qui est volatile, s’évapore,<br />
s’élève dans la fumée et se sublime, ce qui ne brûle pas et ne forme pas<br />
<strong>de</strong> dépôt.<br />
Ces principes ne correspon<strong>de</strong>nt pas aux substances <strong>de</strong> même nom. Leur mélange<br />
défavorable mène à la maladie.<br />
Paracelse est également a<strong>de</strong>pte <strong>de</strong> la doctrine <strong>de</strong>s signatures (Signaturenlehre) d’après<br />
laquelle la nature fait reconnaître ses forces curatives par <strong>de</strong>s signes extérieurs. Ainsi,<br />
une plante à fleur ressemblant à <strong>de</strong>s yeux peut servir à guérir <strong>de</strong>s maladies <strong>de</strong>s yeux<br />
(cas <strong>de</strong> l’Euphraise, Euphrasia, Augentrost); la carotte étant jaune, son suc peut guérir<br />
la jaunisse.<br />
Par ailleurs Paracelse croît fermement à l’influence <strong>de</strong>s astres sur la santé et que la<br />
thérapie doit varier en fonction <strong>de</strong> la constellation <strong>de</strong>s astres. Il croît aussi à la magie.<br />
Tout comme Celse dans son temps, Paracelse écrit ses principaux<br />
ouvrages dans la langue courante, dans son cas<br />
donc l’allemand, alors que les autres savants s’expriment<br />
en latin. Parmi ces ouvrages, citons sa «Große Wundartzney»<br />
(1536/ 1537).<br />
Théorie <strong>de</strong>s signatures: fruit du Grenadier (grena<strong>de</strong>, Granatapfel) à graines<br />
ressemblant à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts d’où son utilisation comme remè<strong>de</strong> contre le<br />
mal <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts.<br />
30 Toutes ses préparations n’étaient pas chimiques, p. ex. son «laudanum», utilisé comme somnifère<br />
et anti-douleur, correspondait à <strong>de</strong> l’opium dans du vin
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 83<br />
«Große Wundtartzney», 1er livre (1536)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 84<br />
7.5. La syphilis<br />
Vers la fin du 15e s. la syphilis, une maladie jusque-là inconnue, commence à se<br />
répandre en Europe <strong>de</strong> manière épidémique. Cette maladie débute par une sorte<br />
d’abcès douloureux (chancre) sur les organes génitaux, puis par <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts cutanés,<br />
une sorte <strong>de</strong> gale sur tout le corps.<br />
Son apparition coïnci<strong>de</strong> avec <strong>de</strong>ux événements marquants:<br />
• le retour du Nouveau Mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> Christophe Colomb et <strong>de</strong> son équipage qui débarquent<br />
en Espagne (1493/94);<br />
• le siège et la prise <strong>de</strong> Naples (1494/95) par le roi Charles VIII <strong>de</strong> France, avec, du<br />
côté <strong>de</strong>s Italiens, <strong>de</strong>s troupes espagnoles envoyées en secours par le roi d’Espagne.<br />
La syphilis gagne les troupes françaises qui après leur retrait <strong>de</strong> Naples ramènent la<br />
maladie dans leur pays. Français et Napolitains se rejettent la responsabilité <strong>de</strong> leur<br />
malheur: les uns l’appellent «le mal <strong>de</strong> Naples», les autres «le mal français». C’est sous<br />
ce <strong>de</strong>rnier nom qu’elle sera connue peu après en Allemagne (Franzosenkrankheit) et<br />
en Angleterre (French disease); d’Allemagne elle passe en Pologne où elle <strong>de</strong>viendra<br />
la «maladie alleman<strong>de</strong>», alors qu’en Russie elle portera le nom <strong>de</strong> «maladie polonaise».<br />
Les remè<strong>de</strong>s utilisés contre la syphilis ont été le traitement au mercure ou, pour les<br />
plus riches, une infusion <strong>de</strong> bois râpé provenant d’un arbre <strong>de</strong> l’Amérique tropicale,<br />
le gaïac. 31<br />
Traitement médical d’un couple atteint <strong>de</strong> syphilis.<br />
Le corps <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s est recouvert <strong>de</strong>s éruptions cutanées<br />
typiques qui apparaissent la 3e semaine après l’infection.<br />
L’un <strong>de</strong>s docteurs mire l’urine <strong>de</strong> la femme, l’autre se sert<br />
d’une spatule pour appliquer un onguent (à base <strong>de</strong> mercure?)<br />
sur la jambe du mari.<br />
(Gravure sur bois du 15e s.)<br />
31 Guajacum officinale (Zygophyllacées). Le bois très dur est utilisé <strong>de</strong> nos jours en ébénisterie. Il fournit<br />
une résine dont on extrait le gaïacol.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 85<br />
La syphilis a encore été appelée la «grosse vérole». 32 Le nom <strong>de</strong> syphilis est dû au<br />
mé<strong>de</strong>cin et poète italien Jérôme Fracastor (Girolamo Fracastoro) qui dans son ouvrage<br />
«Syphilis ou le mal vénérien» (Syphilis sive morbus gallicus) paru en 1530 invente un<br />
berger du nom <strong>de</strong> Syphilus qui aurait été le premier à souffrir <strong>de</strong> cette maladie. Il<br />
aurait en effet offensé le Soleil, qui l’aurait puni en lui envoyant <strong>de</strong>s rayons causant<br />
la maladie mortelle.<br />
Jérôme Fracastor (1478-1553) a publié en 1546 le livre «De contagione et contagiosis<br />
morbis» (De la contagion et <strong>de</strong>s maladies contagieuses) dans lequel il a avancé l’opinion<br />
les maladies épidémiques sont dues à la contagion. Cette contagion peut être<br />
directe, d’individu à individu, ou indirecte, par <strong>de</strong>s germes (seminaria morbi) transportés<br />
par l’air, les vêtements, les objets usuels, etc. Il initie <strong>de</strong> cette manière le débat<br />
qui jusqu’à la fin du 19e s. opposera contagionnistes et anticontagionnistes (a<strong>de</strong>ptes <strong>de</strong><br />
la théorie <strong>de</strong>s miasmes).<br />
L’agent <strong>de</strong> la syphilis, le spirochète Spirochaete pallida, aujourd’hui appelé Treponema<br />
pallidum, a été découvert en 1905 par Fritz Schaudinn (1871-1906) et Paul Erich Hoffmann<br />
(1868-1959). En 1906, August von Wassermann (1866-1925) a trouvé un test<br />
sérologique (réaction <strong>de</strong> Wassermann) facilitant le diagnostic <strong>de</strong> la syphilis.<br />
Préparation et application du bois <strong>de</strong> gaïac comme remè<strong>de</strong> contre la syphilis.<br />
Utilisation précoce <strong>de</strong> drogues américaines dans la pharmacologie européenne.<br />
Gravure sur cuivre, vers 1570.<br />
32 du lat. varius = tacheté. Petite vérole = variole (allem.: Pocken).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 86<br />
Jerome Fracastor (Girolamo Fracastoro) was<br />
born in Verona in 1483. He was a fellow<br />
stu<strong>de</strong>nt of Copernicus at Padua University,<br />
where he studied both philosophy and<br />
medicine; he later became doctor to the Fathers<br />
of the Council of Trent. He wrote numerous<br />
works, and died, respected and famous, in 1553<br />
in his country resi<strong>de</strong>nce near Verona. It was one<br />
work in particular which ma<strong>de</strong> him famous.<br />
Syphilis sive morbus gallicus …, which appeared<br />
in 1530 and enjoyed an immense success, going<br />
through a hundred or so different editions in<br />
the sixteenth century. This long poem in Latin,<br />
which is of un<strong>de</strong>niable literary merit, and<br />
which some have compared to Virgil’s Georgics,<br />
tells the story of the shepherd Syphilus, who<br />
offen<strong>de</strong>d the Sun by overturning his altars and<br />
replacing them with altars to King Alcithoüs,<br />
whose flocks he ten<strong>de</strong>d. To punish him, the Sun<br />
God sent him the venereal disease which the<br />
inhabitants of the surrounding countrysi<strong>de</strong><br />
named syphilis in memory of the first person<br />
to suffer from it. Thus the name syphilis was<br />
born, though it was practically abandoned until<br />
Jérôme FRACASTOR<br />
(1478-1553)<br />
Fracastor, the father of ‘syphilis’<br />
the end of the eighteenth century, doctors and<br />
public alike preferring to use the word ‘pox’.<br />
Fracastor’s poetic imagination and elegance in<br />
no way <strong>de</strong>tract from his precision as a doctor.<br />
As for the i<strong>de</strong>as expressed in Syphilis, there is<br />
nothing new. Fracastor mentions the theory that<br />
the disease originates in the Americas without<br />
sanctioning it, for he attributes it to a harmful<br />
conjunction of the stars. The treatment he<br />
recommends is that of his pre<strong>de</strong>cessors, such<br />
as the therapy with mercury and gaiac.<br />
On the other hand, the treatise on contagious<br />
diseases which he published fifteen years later<br />
contains newer i<strong>de</strong>as. He points out modifications<br />
in the disease; most importantly, though,<br />
he has an inspired intuition about the agent of<br />
the contagion, picturing the disease as being<br />
caused by the multiplication and spread within<br />
the body of ‘tiny invisible living things’<br />
(‘particulas vero minimas et insensibiles’).<br />
(extrait <strong>de</strong>:<br />
Clau<strong>de</strong> Quétel, History of syphilis, 1990, p. 52-53)<br />
Gaïac, Guaiacum officinale (Zygophyllacées)<br />
petit arbre, Amérique tropicale (Venezuela,<br />
Colombie, Haïti, Bahamas)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 87<br />
8. MÉDECINE ET PHYSIOLOGIE<br />
EXPÉRIMENTALE AU 17e SIÈCLE<br />
8.1. WILLIAM HARVEY (1578-1657)<br />
ET LA DÉCOUVERTE DE LA CIRCULATION SANGUINE<br />
Si le 16e s. a été caractérisé par le développement <strong>de</strong> l’anatomie, le 17e s. le sera par<br />
le développement <strong>de</strong> la physiologie expérimentale. La découverte la plus importante<br />
dans ce domaine a été celle <strong>de</strong> la circulation du sang par Harvey qui a ainsi mis<br />
en brèche la mé<strong>de</strong>cine galénique. Cette découverte se situe cependant dans un contexte<br />
historique qui l’a préparée.<br />
8.1.1. Rappel préliminaire: les idées anciennes<br />
Pour mieux comprendre ce contexte, rappelons les idées galéniques en rapport avec<br />
le mouvement du sang et la respiration.<br />
«L’audace et l’importance historique <strong>de</strong> la nouvelle physiologie circulatoire <strong>de</strong> Harvey ne<br />
s’apprécient à leur juste valeur que si l’on met en évi<strong>de</strong>nce la cohérence et l’extraordinaire<br />
puissance explicative du système galéniste.<br />
Selon la doctrine médicale élaborée à partir <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> Galien, le sang existe sous<br />
<strong>de</strong>ux formes [sang veineux et sang artériel], distribuées à l’ensemble <strong>de</strong> notre corps à partir<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux centres (le foie et le coeur) et par l’intermédiaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux réseaux vasculaires (veines<br />
et artères). Le premier <strong>de</strong> ces réseaux distribue la nourriture, le second la chaleur vitale. Le<br />
sang veineux provient <strong>de</strong>s aliments et est constamment renouvelé. La partie utile <strong>de</strong>s aliments<br />
digérés dans l’estomac et dans les intestins est transportée au foie où elle subit la<br />
coction, sorte particulière <strong>de</strong> cuisson qui la transforme en sang veineux. Les excréments soli<strong>de</strong>s<br />
sont le résidu <strong>de</strong> la digestion gastro-intestinale, et les urines, le résidu <strong>de</strong> la formation<br />
hépatique du sang. Dès qu’il est produit par le foie, ce sang sombre et épais s’écoule dans les<br />
veines et est distribué par elles à tous les organes et à tous les membres. Une partie <strong>de</strong> ce sang<br />
passe par la veine cave dans la moitié droite du coeur et, <strong>de</strong> là, une fraction continue le<br />
cheminement et parvient par la « veine artérieuse» (c’est-à-dire l’artère pulmonaire) aux<br />
poumons où elle est consommée.<br />
Une autre partie suinte à travers les pores <strong>de</strong> la paroi interventriculaire dans la moitié gauche<br />
du coeur. Le ventricule gauche est le siège <strong>de</strong> la chaleur innée. Une nouvelle coction du sang<br />
s’y opère. Celui-ci <strong>de</strong>vient plus rouge, écumeux. Il est mélangé avec <strong>de</strong> l’air qui vient <strong>de</strong>s<br />
poumons par l’«artère veineuse» (c’est-à-dire la veine pulmonaire). Par ce même vaisseau<br />
sont éliminées les matières fuligineuses, résidus <strong>de</strong> la formation cardiaque du sang clair et<br />
chaud. La valvule mitrale possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux valves seulement et n’obture donc pas complètement<br />
l’entrée du ventricule gauche, c’est-à-dire permet le double trajet dans la veine pulmonaire.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 88<br />
Par l’intermédiaire <strong>de</strong> l’aorte et <strong>de</strong>s artères, le sang clair et chaud, dit précisément artériel, est<br />
distribué à l’ensemble du corps.<br />
Pour les Anciens, ce qui définit un vaisseau c’est la qualité du sang qu’il contient; pour les<br />
Mo<strong>de</strong>rnes, c’est la direction dans laquelle le sang se meut. Cela explique pourquoi il a fallu,<br />
après la découverte d’Harvey, inverser la dénomination <strong>de</strong>s vaisseaux qui relient le coeur et<br />
les poumons. Arrivés à la périphérie, c’est-à-dire à la «chair» <strong>de</strong>s organes et <strong>de</strong>s membres, les<br />
<strong>de</strong>ux sangs sont consommés. Le sang veineux est assimilé, carnifié. Le résidu <strong>de</strong> ce processus<br />
est la transpiration.<br />
Selon le système galéniste, les <strong>de</strong>ux sangs, veineux et artériel, coulent dans <strong>de</strong>s directions<br />
parallèles, essentiellement centrifugales, la première par rapport au foie, la secon<strong>de</strong> par rapport<br />
au coeur. Il peut y avoir <strong>de</strong>s fluctuations locales mais il n’y a pas <strong>de</strong> retour. Les sangs<br />
sont moins poussés par une force motrice qu’attirés par les parties du corps qui en ressentent<br />
le besoin. Pour les galénistes, le modèle principal <strong>de</strong> la source du mouvement est l’aimant et<br />
non la pompe.<br />
(extrait <strong>de</strong> M.D. Grmek:<br />
La première révolution biologique. Paris 1990, Payot.)<br />
Le mouvement du sang d’après la conception galénique du Moyen Âge<br />
veine artérieuse =<br />
artère pulmonaire<br />
artère veineuse =<br />
veine pulmonaire<br />
(côté droit) (côté gauche)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 89<br />
8.1.2. La découverte <strong>de</strong> la circulation pulmonaire ou petite circulation<br />
8.1.2.1. Ibn AN-NAFIS (1211-1288 ou 1296)<br />
Dans son Commentaire anatomique du canon d’Avicenne le mé<strong>de</strong>cin égyptien Ibn an-<br />
Nafis décrit pour la première fois la circulation pulmonaire. Il conteste l’existence<br />
<strong>de</strong>s pores entre les <strong>de</strong>ux ventricule du coeur, telle qu’elle a été affirmée par Galien.<br />
Pour Ibn an-Nafis, le sang passe du ventricule droit, où il a été «raffiné», dans la<br />
«veine artérieuse» (artère pulmonaire) pour aller jusqu’au poumon. Dans le poumon,<br />
le sang se mélange avec l’air pour être «purifié», puis, il passe dans «l’artère<br />
veineuse» (veine pulmonaire) et va dans le ventricule gauche du coeur.<br />
En résumé, pour Ibn an-Nafis «le passage du sang dans le ventricule gauche se fait<br />
par les poumons après que ce sang a été chauffé et remonté du ventricule droit».<br />
Curieux mélange <strong>de</strong> notions galéniques et <strong>de</strong> réflexions nouvelles.<br />
Ce passage (pulmonaire) explique mieux que la théorie galéniste comment l’air se mélange<br />
au sang, rend compte <strong>de</strong> la présence du sang dans la veine pulmonaire et supprime l’hypothèse<br />
gênante d’un trajet dans les <strong>de</strong>ux sens par ce vaisseau (arrivée <strong>de</strong> l’air dans le coeur<br />
et expulsion <strong>de</strong>s matières fuligineuses).<br />
Le modèle développé par Ibn an-Nafis n’a malheureusement pas connu la diffusion<br />
qu’il méritait et n’a pas atteint l’Occi<strong>de</strong>nt. Ainsi, même Vésale qui pourtant avait<br />
bien étudié l’anatomie du coeur sans trouver <strong>de</strong> pores ne niait pas (ou n’osait pas<br />
nier) le passage du sang à travers la cloison interventriculaire. Il s’étonnait tout au<br />
plus «du travail du Créateur qui fait exsu<strong>de</strong>r le sang du ventricule droit vers le gauche<br />
par <strong>de</strong>s passages qui échappent à la vue». Vésale respectait le dogme galénique en<br />
écrivant dans sa Fabrica: «Le coeur attire l’air et aspire une gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> sang<br />
du ventricule droit dans le ventricule gauche. Le coeur utilise l’air pour faire l’esprit<br />
vital. Le coeur dilaté prend l’air du poumon dans le ventricule gauche, mais en se<br />
contractant il propulse l’esprit vital dans la gran<strong>de</strong> artère avec le flux impétueux du<br />
sang.»<br />
8.1.2.2. Michel SERVET (1511?-1553)<br />
Michel Servet (1511?-1553), mé<strong>de</strong>cin et théologien espagnol, a été l’un <strong>de</strong>s premiers<br />
à contester ouvertement Galien. Il a fourni une interprétation parfaitement correcte<br />
<strong>de</strong> la circulation pulmonaire: «Le courant sanguin ne passe pas à travers la cloison<br />
cardiaque — comme on le suppose généralement — mais le sang suit une longue<br />
route par les poumons, poussé d’une façon particulière et admirable. Le sang qui<br />
contient le spiritus naturalis entre en contact avec l’air dans les poumons et leurs<br />
vaisseaux sanguins et reçoit une provision <strong>de</strong> spiritus vitalis, prenant alors une teinte<br />
rouge brique.<br />
Le sang s’écoule <strong>de</strong> la moitié droite du coeur vers les poumons par le vaisseau sanguin<br />
artériel (= veine artérieuse). Le sang effectue son retour par le vaisseau sanguin<br />
veineux (= artère veineuse) et arrive dans la moitié gauche du coeur.»
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 90<br />
Michael Servetus (1511-1553), the first European<br />
to <strong>de</strong>scribe the pulmonary circulation, was a<br />
man who spent his whole life struggling against<br />
the dogmatism and intolerance that permeated<br />
the Renaissance world. If any man died twice<br />
for his beliefs it was Servetus. His attacks on<br />
orthodoxy were so broad and blatant that he<br />
was burned in effigy by the Catholics and in<br />
the flesh by the Protestants. While challenging<br />
religious dogma, Servetus proved that<br />
contemporary anatomical information was<br />
sufficient to allow a heretic to elucidate the<br />
pathway taken by the blood in the minor, or<br />
pulmonary circulation.<br />
Servetus left his native Spain to study law, but<br />
like Paracelsus he soon joined the ranks of the<br />
wan<strong>de</strong>ring geniuses and mavericks <strong>de</strong>stined to<br />
spend their lives disturbing the universe. After<br />
his first major treatise, On the Errors of the Trinity<br />
(1531), was published, both Catholic and Protestant<br />
theologians agreed that the author was<br />
a heretic of the worst sort. Finding it necessary<br />
to go un<strong>de</strong>rground, Servetus established a new<br />
i<strong>de</strong>ntity as «Michael Villanovanus.» Un<strong>de</strong>r this<br />
name, he atten<strong>de</strong>d the University of Paris before<br />
moving to Lyons where he published a new<br />
edition of the Geographia of the second century<br />
astronomer and geographer Ptolemy of<br />
Alexandria. Even when editing a classic of such<br />
antiquity Servetus could not resist the<br />
opportunity to express dangerous opinions.<br />
While <strong>de</strong>scribing France, Servetus referred to<br />
the ceremony of the Royal Touch in which the<br />
king miraculously cured victims of scrofula. «I<br />
myself have seen the king touch many attacked by<br />
Servet a inclus ces réflexions dans son livre<br />
Christianismi restitutio (Restitution du Christianisme),<br />
un ouvrage théologique paru en 1553. Servet s’attaquait<br />
au pape et à l’Église catholique, à la Sainte Trinité,<br />
au protestantisme et à Calvin. Arrêté à Vienne<br />
(en Isère) par l’Inquisition et condamné à mort à<br />
Lyon, il réussit à s’enfuir et se réfugia à Genève. Il y<br />
fut condamné pour hérésie après avoir été affreusement<br />
torturé et brûlé vif, avec ses livres, sur l’instigation<br />
<strong>de</strong> Calvin.<br />
Michel Servet (1511?-1553)<br />
Lecture: Michael Servetus (1511-1553)<br />
this ailment,» Servetus wrote, «but I have never<br />
seen any cured.»<br />
Returning to the University of Paris to study<br />
medicine, Servetus supported himself by<br />
lecturing on mathematics, geography, and<br />
astronomy. When he stepped over the line that<br />
Christian doctrine had drawn between acceptable<br />
areas of astrology and the forbid<strong>de</strong>n zone<br />
of judicial astrology (essentially fortune-telling),<br />
he was threatened with excommunication.<br />
Attacks on judicial astrology can be traced back<br />
to the time of St. Augustine (354-430), but the<br />
theological opposition and philosophical<br />
skepticism seem to have intensified by the end<br />
of the fifteenth century. Although his first impulse<br />
was to <strong>de</strong>fend his actions, his case was<br />
hopeless and Servetus returned to his un<strong>de</strong>rground<br />
life. The separation between medicine<br />
and astrology among learned circles in France<br />
has been attributed to the attack of the medical<br />
faculty of Paris on an astrologer named<br />
Villanovanus in 1537.<br />
As if looking for more trouble, Servetus entered<br />
into a correspon<strong>de</strong>nce with John Calvin<br />
(1509-1564), the French Protestant reformer who<br />
foun<strong>de</strong>d a relgious system based on the doctrines<br />
of pre<strong>de</strong>stination and salvation solely by<br />
God’s grace. In addition to criticizing Calvin’s<br />
Institutiones, Servetus sent him an advance copy<br />
of his radical treatise, On the Restitution of<br />
Christianity (1553). Calvin respon<strong>de</strong>d by sending<br />
pages torn from the Restitution to the Catholic<br />
Inquisition with the information that Servetus<br />
had printed a book full of scandalous
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 91<br />
blasphemies. Servetus was arrested and<br />
imprisoned, but managed to escape before he<br />
was tried, convicted, and burned in effigy. Four<br />
months later, Servetus surfaced in Calvin’s<br />
Geneva, where he was arrested and con<strong>de</strong>mned<br />
to burn «without mercy.» Attempts to mitigate<br />
the sentence to burning «with mercy» (strangulation<br />
before immolation) were unsuccessful.<br />
Almost all the newly printed copies of The Restitution<br />
were ad<strong>de</strong>d to the fire. In 1903 the<br />
Calvinist congregation of Geneva expressed regrets<br />
and erected a monument to the martyred<br />
heretic. Moreover, a review of his case revealed<br />
that the <strong>de</strong>ath sentence had been illegal, because<br />
the proper penalty should have been<br />
banishment.<br />
Given the fact that Servetus’ account of the<br />
pulmonary circulation is buried within the<br />
700-page Restitution, it is clear that his inspiration<br />
and motives were primarily religious, not<br />
medical or scientific. According to Servetus, to<br />
un<strong>de</strong>rstand the relationship between God and<br />
humanity, and to know the Holy Spirit, one must<br />
un<strong>de</strong>rstand the spirit within human beings<br />
through knowledge of the human body,<br />
especially the blood, for as stated in Leviticus<br />
«the life of the flesh is in the blood. « Prevailing<br />
knowledge of what we might call the plumbing<br />
arrangements of the cardiovascular system<br />
could be traced to Galen, but Servetus argued<br />
that the fact that more blood was sent to the<br />
lungs than was necessary for their own<br />
nourishment indicated that passage of blood<br />
through pores in the septum was not the major<br />
path by which blood entered the left si<strong>de</strong> of the<br />
heart. Servetus conten<strong>de</strong>d that the change in the<br />
8.1.2.3. Realdo COLOMBO (1510-1559)<br />
Realdo Colombo<br />
(1510-1559)<br />
color of the blood indicated that aeration took<br />
place in the lungs rather than in the left<br />
ventricle. Then, charged with the vital spirit<br />
formed by the mixing of air and blood in the<br />
lungs, bright red blood was sent to the left<br />
ventricle. Servetus did not go on to consi<strong>de</strong>r<br />
the possibility of a systemic blood circulation;<br />
he was satisfied that he had reconciled<br />
physiology with his theological convictions<br />
concerning the unity of the spirit.<br />
What effect did Servetus have on<br />
sixteenth-century science? In retrospect,<br />
Servetus seems a heroic figure, but if his<br />
contemporaries knew of his work they were<br />
unlikely to admit to being in sympathy with<br />
the ill-fated heretic. Moreover, only three copies<br />
of the The Restitution are known to have<br />
survived the flames. It is unlikely that Servetus<br />
influenced anatomists any more than Ibn<br />
an-Nafis, who had <strong>de</strong>scribed the pulmonary<br />
transit in the thirteenth century. However, there<br />
is always uncertainty about the actual diffusion<br />
of i<strong>de</strong>as and information — especially that<br />
which might be consi<strong>de</strong>red heretical,<br />
dangerous, and subversive — as opposed to the<br />
survival of documentary evi<strong>de</strong>nce. Whatever<br />
influence Servetus did or did not have on<br />
progress in physiology, his career remains a<br />
fascinating revelation of the dark un<strong>de</strong>rsi<strong>de</strong> of<br />
the Renaissance and religious intolerance. His<br />
Restitution proves that in the sixteenth century<br />
a man with rather limited training in medicine<br />
and anatomy could un<strong>de</strong>rstand the pulmonary<br />
circulation.<br />
(Magner: A history of medicine, 1992, p. 191ss)<br />
Quelques années après la mort <strong>de</strong> Servet, l’anatomiste<br />
italien Realdo Colombo (1510-1559) fait dans<br />
son livre De re anatomica (1559) une <strong>de</strong>scription<br />
parfaite et complète <strong>de</strong> la petite circulation. Beaucoup<br />
d’historiens admettent que c’est à Colombo,<br />
qu’il connaissait, que Servet <strong>de</strong>vait l’idée <strong>de</strong> la circulation<br />
pulmonaire.<br />
Colombo base son hypothèse sur <strong>de</strong>s faits<br />
anatomophysiologiques et sur un raisonnement
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 92<br />
d’ordre quantitatif:<br />
• l’absence <strong>de</strong> pores dans la cloison interventriculaire;<br />
• la présence <strong>de</strong> sang (et non pas d’air) dans la veine pulmonaire;<br />
• le calibre <strong>de</strong> l’artère pulmonaire (trop important pour uniquement servir à nourrir<br />
le poumon);<br />
• le fonctionnement parfait <strong>de</strong> la valvule mitrale (dans le système galé-niste la<br />
valvule mitrale freinait le passage du sang dans un sens mais ne l’empêchait<br />
pas, d’où selon Galien la présence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux lames seulement pour la valvule<br />
mitrale au lieu <strong>de</strong>s trois <strong>de</strong> la valvule tricuspi<strong>de</strong> qui assure une fermeture complète).<br />
Pourtant Colombo n’arrive pas à convaincre tout le mon<strong>de</strong>. À Paris, Ambroise Paré<br />
reste sceptique. L’Église n’entend pas abandonner la théorie <strong>de</strong> Galien.<br />
(côté gauche)<br />
Coupe transversale du coeur<br />
montrant les valvules.<br />
(côté droit)<br />
Realdo Colombo (1510-1559)<br />
Frontispice <strong>de</strong> l'ouvrage De re anatomica (1559)<br />
qui décrit la petite circulation.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 93<br />
8.1.3. Les travaux <strong>de</strong> William Harvey:<br />
circulation pulmonaire et circulation générale<br />
En 1628, l’Anglais William Harvey publie à Francfort l’ouvrage Exercitatio anatomica<br />
<strong>de</strong> motu cordis et sanguinis in animalibus (Traité anatomique sur les mouvements du<br />
coeur et du sang chez les animaux) dans lequel il fait la synthèse <strong>de</strong>s observations<br />
antérieures et <strong>de</strong> ses propres recherches pour établir un schéma général <strong>de</strong> la circulation<br />
du sang dans le corps:<br />
• le coeur est le moteur du mouvement du sang;<br />
• les artères conduisent le sang vers les organes (courant sanguin centrifuge);<br />
• les veines ramènent le sang au coeur (courant sanguin centripète).<br />
Ce modèle est le résultat d’un raisonnement basé sur plusieurs catégories d’arguments,<br />
anatomiques, physiologiques et quantitatifs.<br />
William HARVEY (1578-1657)<br />
8.1.3.1. Arguments anatomiques et physiologiques<br />
Ils résultent <strong>de</strong> la dissection et <strong>de</strong> la vivisection d’animaux faites par Harvey ou se<br />
basent sur les observations antérieures qui lui étaient connues:<br />
• Existence et structure <strong>de</strong>s valvules du coeur (Galien p.p.).<br />
• Absence <strong>de</strong> pores dans le septum interventriculaire (Colombo).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 94<br />
• Existence <strong>de</strong>s valvules veineuses (d’Acquapen<strong>de</strong>nte), 33<br />
Représentation <strong>de</strong>s valvules veineuses subcutanées <strong>de</strong> l'avant-bras, tirée <strong>de</strong> l'ouvrage <strong>de</strong><br />
J. Fabricius d'Acquapen<strong>de</strong>nte, De venarum ostiolis, Padoue 1603.<br />
• L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mouvements du coeur après vivisection notamment sur <strong>de</strong>s animaux<br />
poïkilothermes (crapauds, grenouilles, serpents, poissons, etc.), lui a montré<br />
que le coeur se vi<strong>de</strong> par contraction au moment <strong>de</strong> la systole et se remplit<br />
(passivement) au moment <strong>de</strong> la diastole. La systole représente donc la phase<br />
active, et non pas la diastole comme c’était admis jusque-là. (On pensait que<br />
lors <strong>de</strong> la diastole le coeur aspirait activement le sang.)<br />
• Harvey montre que le mouvement du coeur commence par la contraction <strong>de</strong><br />
l’oreillette qui chasse le sang dans le ventricule. Dès que le ventricule est rempli,<br />
il se contracte; c’est la pulsation. Par cette pulsation, le ventricule droit pousse le<br />
sang apporté par l’oreillette vers les poumons par l’intermédiaire d’un vaisseau<br />
appelé «veine artérieuse» par les anatomistes. Harvey reconnaît que <strong>de</strong> par sa<br />
structure et sa fonction cette «veine» correspond plutôt à une artère (artère pulmonaire).<br />
• L’étu<strong>de</strong> du mouvement <strong>de</strong>s artères après dissection lui fait réfuter l’idée que la<br />
dilatation <strong>de</strong>s artères serait due à un phénomène actif propre aux artères. Les<br />
artères se remplissent comme un tuyau et non comme un soufflet. La pulsation<br />
<strong>de</strong> l’artère pulmonaire est due à la contraction du ventricule droit. La pulsation<br />
<strong>de</strong>s artères du reste du corps est due à la contraction du ventricule gauche qui<br />
explique donc également le pouls que le mé<strong>de</strong>cin peut palper.<br />
• En s’appuyant sur l’étu<strong>de</strong> du trajet du sang dans le coeur et les gros vaisseaux<br />
avoisinants chez <strong>de</strong>s animaux sans poumons et sur <strong>de</strong>s fétus et <strong>de</strong>s adultes d’animaux<br />
avec <strong>de</strong>s poumons, Harvey fournit une <strong>de</strong>scription exacte et correcte <strong>de</strong><br />
la petite circulation (circulation pulmonaire).<br />
33 Découverte <strong>de</strong>s valvules dans les veines sus-hépatiques par Charles Estienne (1505-1564), dans la<br />
gran<strong>de</strong> veine azygos (qui relie les veines du thorax à la veine cave) par Amatus Lusitanus (1511-<br />
1568) et Giovanni Battista Canano, dans les veines périphériques par Salomon Alberti (1540-1600)<br />
et Fabricio d’Acquapen<strong>de</strong>nte (1533-1619). La découverte <strong>de</strong>s valvules veineuses aurait déjà dû<br />
faire vaciller l’édifice galénique. En effet, la disposition <strong>de</strong> ces valvules est telle qu’elle s’oppose à<br />
l’écoulement du sang vers la périphérie, alors que le modèle galénique postule que le sang <strong>de</strong>s<br />
artères et <strong>de</strong>s veines s’écoule justement vers les organes périphériques. Mais, d’Acquapen<strong>de</strong>nte<br />
préfère penser que les valvules qu’il vient <strong>de</strong> découvrir ont une fonction régulatrice et ne s’opposent<br />
pas à la circulation vers la périphérie.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 95<br />
L’existence d’une gran<strong>de</strong> circulation (circulation générale) que Harvey esquisse rapi<strong>de</strong>ment<br />
est finalement la conséquence logique <strong>de</strong> la petite circulation. Le sang chassé<br />
par le ventricule gauche dans l’aorte doit forcément revenir au ventricule droit pour<br />
être poussé vers les poumons.<br />
8.1.3.2. Arguments quantitatifs (mathématiques)<br />
À l’appui <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> la circulation Harvey a fait le raisonnement quantitatif<br />
suivant:<br />
«Ainsi, chez l’homme, nous supposons qu’à chaque contraction du cœur, il passe une<br />
once, ou trois drachmes, ou une drachme <strong>de</strong> sang dans l’aorte. Ce sang ne peut revenir<br />
dans le cœur à cause <strong>de</strong> l’obstacle que lui opposent les valvules.<br />
Or, le cœur en une <strong>de</strong>mi-heure a plus <strong>de</strong> mille contractions; chez quelques personnes<br />
même, il en a <strong>de</strong>ux mille, trois mille et même quatre mille. En multipliant par drachmes,<br />
on voit qu’en une <strong>de</strong>mi-heure il passe par le coeur dans les artères trois mille drachmes,<br />
ou <strong>de</strong>ux mille drachmes, ou cinq cents onces; enfin une quantité <strong>de</strong> sang beaucoup plus<br />
considérable que celle qu’on pourrait trouver dans tout le corps. De même chez le mouton<br />
ou chez le chien, supposons qu’il passe un scrupule à chaque contraction du cœur, en<br />
une <strong>de</strong>mi-heure, on aura mille scrupules, soit trois livres et <strong>de</strong>mie <strong>de</strong> sang. Or, dans tout<br />
le corps il n’y en a pas plus <strong>de</strong> quatre livres, comme je m’en suis assuré chez le mouton. 34<br />
Ainsi en supputant la quantité <strong>de</strong> sang que le cœur envoie à chaque contraction et en<br />
comptant ces contractions, on voit que toute la masse du sang passe <strong>de</strong>s veines dans les<br />
artères par le cœur et aussi par les poumons.<br />
D’ailleurs ne prenons ni une <strong>de</strong>mi-heure, ni une heure, mais un jour: il est clair que le<br />
coeur par sa systole transmet plus <strong>de</strong> sang aux artères que les aliments ne pourraient en<br />
donner, plus que les veines n’en pourraient contenir.»<br />
D’où une pareille quantité <strong>de</strong> sang peut-elle donc venir? Où peut-elle aller? Harvey pose la<br />
question catégoriquement et cela même constitue une nouveauté dans l’histoire <strong>de</strong> la biologie...<br />
Arrivé à ce point Harvey formule sa gran<strong>de</strong> découverte: «Je me suis alors <strong>de</strong>mandé si tout<br />
ne s’expliquerait pas par un mouvement circulaire du sang. Le sang chassé par le ventricule gauche<br />
dans les artères traverse les tissus <strong>de</strong> l’ensemble du corps. Celui qui est chassé par le ventricule droit<br />
dans l’artère pulmonaire traverse les poumons… »<br />
8.1.3.3. Etu<strong>de</strong> expérimentale du trajet du sang<br />
Harvey a étudié expérimentalement le chemin du sang dans les vaisseaux. Chez<br />
l’animal, il interrompt le courant sanguin <strong>de</strong> la veine cave en la comprimant avec<br />
une agrafe, le pouce ou l’in<strong>de</strong>x; il constate que le tronçon <strong>de</strong> la veine situé entre<br />
l’obstacle et le coeur se vi<strong>de</strong>, <strong>de</strong> même que le coeur. Par contre la ligature <strong>de</strong> l’aorte<br />
fait dilater le coeur au point qu’il risque d’éclater. Le sang veineux s’écoule donc en<br />
direction du coeur et le sang artériel en part.<br />
34 1 livre = 12 onces; 1 once = 8 drachmes; 1 drachme = 3 scrupules ; 1 scrupule = 24 grains ; 1 livre =<br />
367,126 g ; 1 once = 30,594 g; 1 drachme = 3,824 g ; 1 scrupule = 1,274 g ; 1 grain = 0,053 g.<br />
500 onces = 15,3 kg, quantité largement sous-estimée (!).<br />
Au repos, le coeur charrie par heure 360 l, soit 8.600 l par jour (9 t) et 3.100.000 litres par an.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 96<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
Démonstration du reflux veineux par Harvey (1628)<br />
Étu<strong>de</strong> expérimentale par compression <strong>de</strong>s veines<br />
Fig. 1: Si on met un garrot au-<strong>de</strong>ssus du cou<strong>de</strong> (AA), <strong>de</strong>s noeuds apparaissent sur les veines<br />
situées au-<strong>de</strong>là du garrot aux endroits où se trouvent <strong>de</strong>s valvules.<br />
Fig. 2: Le sang est chassé par compression entre H et O. Si le doigt comprime la veine en H,<br />
elle reste vi<strong>de</strong> entre H et O.<br />
Fig. 3: Un doigt comprime la veine en H; <strong>de</strong> l’autre main, on comprime la veine en K au-<strong>de</strong>ssus<br />
<strong>de</strong> la valvule O. Plus on appuiera fortement, plus la veine sera gonflée et distendue du<br />
côté <strong>de</strong> la valvule ou <strong>de</strong> la nodosité (O), mais elle restera vi<strong>de</strong> au-<strong>de</strong>ssous (H. O).<br />
Fig. 4: Si, à quelque distance au-<strong>de</strong>ssous d’une nodosité ou d’une valvule, on met le doigt en L,<br />
par exemple, et si on met un autre doigt (M) un peu plus haut, qui comprime le sang en N<br />
jusqu’au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> la valvule, on verra que cette partie (L. N) reste vi<strong>de</strong>, et que le sang<br />
ne peut pas revenir au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> la valvule, absolument comme entre H et O dans la<br />
figure 2. Mais si on ôte le doigt en H (fig. 2), aussitôt le sang revient <strong>de</strong>s veines inférieures<br />
et remplit l’espace H. O.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 97<br />
Il met un garrot au bras d’une personne et il constate que dans l’artère la pulsation<br />
<strong>de</strong>vient plus forte au-<strong>de</strong>ssus du garrot (du côté proximal) et plus faible au-<strong>de</strong>ssous<br />
(du côté distal). Puis il relâche le garrot jusqu’à ce que le pouls <strong>de</strong>vienne sensible<br />
dans la partie distale. La main enfle alors et les veines situées au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> la ligature<br />
sont dilatées par le sang qui s’y accumule. La pression maintenant exercée par<br />
le garrot permet donc au sang artériel <strong>de</strong> passer, mais est toujours suffisante pour<br />
comprimer les veines et y interrompre le retour du sang.<br />
Harvey conclut <strong>de</strong> ces observations que le sang s’écoule <strong>de</strong>s artères vers les veines et<br />
qu’il doit y avoir <strong>de</strong>s «anastomoses» — peut-être <strong>de</strong>s sortes porosités intra-tissulaires<br />
— entre ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> vaisseaux. Le rôle <strong>de</strong>s valvules veineuses est i<strong>de</strong>ntique<br />
à celui <strong>de</strong>s valvules sigmoï<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’aorte et <strong>de</strong> l’artère pulmonaire: empêcher le reflux<br />
du sang.<br />
•<br />
Désormais le modèle galénique est définitivement mis en brèche. Le sang ne se forme<br />
pas dans le foie, et il n’est pas remplacé en continu à partir <strong>de</strong> la nourriture, mais<br />
c’est toujours le même liqui<strong>de</strong> qui circule dans un circuit fermé. Tout l’édifice physiologique<br />
et thérapeutique d’inspiration galénique menace <strong>de</strong> s’écrouler.<br />
Il est évi<strong>de</strong>nt qu’Harvey rencontre une farouche opposition chez <strong>de</strong> nombreux mé<strong>de</strong>cin<br />
<strong>de</strong> son époque. Une âpre bataille opposera les «circulateurs» et<br />
«anticirculateurs».<br />
En effet, la théorie d’Harvey présente encore certains aspects qu’il n’arrive pas à<br />
expliquer. En niant à juste titre la fonction aspiratrice du coeur telle qu’elle a été<br />
présentée par Galien, il n’arrive pas à expliquer non plus le retour du sang veineux;<br />
il se contente d’affirmer que le sang revient spontanément vers le coeur qui est son<br />
«lieu naturel». Il n’arrive pas à expliquer non plus pourquoi le sang a une couleur<br />
différente dans les artères et les veines, alors que d’après lui c’est le même sang y qui<br />
circule. Enfin, il n’a pas pu éluci<strong>de</strong>r le passage du sang entre les artères et les veines.<br />
•<br />
Sur ce <strong>de</strong>rnier point l’oeuvre d’Harvey a été complétée en 1661 par la <strong>de</strong>scription<br />
<strong>de</strong>s capillaires sanguins dans les poumons par Marcello Malpighi (1628-1694). Ces<br />
capillaires font en effet la jonction entre artères et veines.<br />
Cette découverte a été rendue possible par l’essor <strong>de</strong> la<br />
microscopie. Elle est complétée par la mise en évi<strong>de</strong>nce,<br />
en 1669, <strong>de</strong> l’hématose pulmonaire par Richard Lower<br />
(1631-1691).<br />
Marcello MALPIGHI (1628-1694).<br />
Professeur <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à Bologne, Pise et Messine. Fondateur <strong>de</strong> l'anatomie<br />
microscopique (histologique). Décrit dans son traité «De pulmonibus<br />
observationes anatomicae» les alvéoles et les capillaires pulmonaires (1661).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 98<br />
8.1.4. Conséquences <strong>de</strong> la théorie circulatoire<br />
De la théorie d’Harvey découlaient <strong>de</strong>ux conséquences logiques:<br />
1° la possibilité <strong>de</strong> l’injection intraveineuse <strong>de</strong> médicaments,<br />
2° la possibilité <strong>de</strong> la transfusion sanguine.<br />
Les premières injections intraveineuses ont été pratiquées chez l’homme par les<br />
Anglais John Wilkins (1614-1672) et Christopher Wren (1632-1723).<br />
Une transfusion sanguine d’animal à animal (<strong>de</strong>ux chiens) a été essayée en 1665 par<br />
Richard Lower (1631-1691). Une transfusion d’un animal à l’homme a été faite en<br />
1667 par Jean-Baptiste Denis (1625-1704), professeur à Montpellier et mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong><br />
Louis XIV.<br />
Tranfusion d'un chien à l'homme.<br />
Joh. Scultetus, Appendix … ad armamentarium chirurgicum,<br />
Amsterdam 1671.<br />
Ces essais d’injection ou <strong>de</strong><br />
transfusion ont été extrêmement<br />
dangereux, avec risque <strong>de</strong><br />
thrombose, d’embolie 35 ou <strong>de</strong><br />
choc, et il y a eu bientôt <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts<br />
mortels, <strong>de</strong> sorte que ces<br />
métho<strong>de</strong>s ont été abandonnées<br />
pour n’être reprises qu’au 19e s.<br />
— <strong>de</strong> nouveau avec <strong>de</strong> très<br />
grands risques. Ce n’est qu’au<br />
20e s. qu’elles sont <strong>de</strong>venues <strong>de</strong>s<br />
métho<strong>de</strong>s thérapeutiques sans<br />
danger.<br />
La pratique ancienne <strong>de</strong> la saignée<br />
n’a pas disparu avec la dé-<br />
couverte <strong>de</strong> la circulation. Au contraire, elle a été particulièrement prisée au 17 e et<br />
surtout au 18 e s., avec <strong>de</strong>s abus conduisant souvent à <strong>de</strong>s anémies mortelles d’origine<br />
iatrogène.<br />
Après la circulation sanguine, ce sera le tour <strong>de</strong> la découverte <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> la lymphe.<br />
Bartolomeo Eustachio (1520-1574) avait déjà décrit le canal thoracique. Gaspard Aselli<br />
(1581-1626) avait i<strong>de</strong>ntifié en 1622 les vaisseaux lymphatiques du mésentère pendant la<br />
digestion («vaisseaux lactés»).<br />
Jean Pecquet (1622-1674) a montré que les vaisseaux lactés se déversent dans la citerne<br />
abdominale à laquelle on a donné son nom (citerne <strong>de</strong> Pecquet), et que <strong>de</strong> là la lymphe<br />
rejoint la circulation veineuse au niveau <strong>de</strong> la veine sous-clavière.<br />
35 embolie, n.f. = oblitération d’un vaisseau par un corps étranger (embolus) charrié par le sang;<br />
thrombose, n.f. = oblitération d’un vaisseau par un caillot formé sur place.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 99<br />
Schéma général <strong>de</strong> la circulation
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 100<br />
Une expérience <strong>de</strong> vivisection<br />
En 1622, le mé<strong>de</strong>cin italien Gaspare Aselli (1581-1626), professeur d’anatomie et <strong>de</strong> chirurgie à<br />
Padoue (Pavia), a fait la vivisection d’un chien qu’il a rapportée en ces termes:<br />
“ J’ouvris un chien gros et qui avait mangé <strong>de</strong>puis peu... Pour voir les mouvements du diaphragme,<br />
j’ouvris le ventre et je repoussai le ventricule [= estomac] et les intestins vers le bassin, lorsque<br />
j’aperçus <strong>de</strong>s petits filets blancs très nombreux sur la surface du mésentère et celle <strong>de</strong>s intestins...<br />
Je présumai d’abord que c’étaient <strong>de</strong>s nerfs, mais je connus bientôt mon erreur... J’ouvris<br />
un <strong>de</strong> ces grands cordons blancs, mais à peine l’incision avait été faite, que je vis sortir une<br />
liqueur blanchâtre <strong>de</strong> la nature du lait ou <strong>de</strong> la crème. ”<br />
Aselli nomme ces cordons “ veines lactées ” et montre qu’elles ne sont visibles que si l’animal a<br />
mangé <strong>de</strong>s aliments riches en lipi<strong>de</strong>s.<br />
Une anse intestinale isolée. Les circonvolutions intestinales sont reliées entre elles par le mésentère,<br />
tissu très fin où circulent les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, aussi<br />
appelés «chylifères».
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 101<br />
Première mesure <strong>de</strong> la pression sanguine<br />
Au cours <strong>de</strong> la 1ère moitié du 18e s., Stephen Hales introduisit d’abord dans la veine jugulaire<br />
d’une jument un tube dans lequel le sang s’éleva <strong>de</strong> 15 pouces. Plus tard, il refit la même<br />
expérience pour une artère d’un membre postérieur : «le sang jaillit dans le tube à 8 pieds et 3<br />
pouces au-<strong>de</strong>ssus du coeur».<br />
❒ Interprétez ces expériences et calculez les valeurs mesurées<br />
(1 pied = 32,48 cm, 1 pouce = 2,77 cm).<br />
Stephen HALES (1677-1761)<br />
Physiologiste, chimiste et inventeur anglais. Après <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s au<br />
collège Corpus Christi à Cambridge, Stephen Hales <strong>de</strong>vient pasteur<br />
et, en 1709, il obtient la charge perpétuelle <strong>de</strong> la cure <strong>de</strong><br />
Teddington, dans le Middlesex.<br />
Hales est connu pour ses Statical Essays. Le premier volume,<br />
Vegetable Staticks (1727), décrit <strong>de</strong>s expériences sur la physiologie<br />
végétale. Le second volume, intitulé Haemastaticks (1733),<br />
est une contribution importante en physiologie animale; à cette occasion,<br />
il met au point <strong>de</strong>s instruments pour mesurer la pression<br />
sanguine dans les vaisseaux.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 102<br />
La perte <strong>de</strong> sang<br />
«La perte d’un <strong>de</strong>mi-litre <strong>de</strong> sang n’entraîne aucune<br />
conséquence (donneurs <strong>de</strong> sang). Une hémorragie<br />
rapi<strong>de</strong> et massive entraîne la mort en quelques minutes,<br />
alors même que l’organisme conserve les <strong>de</strong>ux<br />
tiers <strong>de</strong> son volume sanguin».<br />
Larousse <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine.<br />
La saignée<br />
La saignée (die Armbeuge)<br />
Les veines superficielles ou sous-cutanées saillent<br />
sous la peau et sont très apparentes chez certains<br />
sujets; c’est à leur niveau que l’on pratique les injections<br />
intraveineuses, en particulier au pli du cou<strong>de</strong> (à<br />
la «saignée» <strong>de</strong>s auteurs anciens); ces veines superficielles<br />
forment un réseau aux mailles serrées au<br />
niveau <strong>de</strong> la main.<br />
Une saignée (A<strong>de</strong>rlass) au début du 19e siècle.<br />
Universalis<br />
A<strong>de</strong>rlaß: Blutabnehmen heilt<br />
Zu <strong>de</strong>n rabiaten medizinischen Behandlungsmetho<strong>de</strong>n<br />
vergangener Jahrhun<strong>de</strong>rte gehörte <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>rlaß,<br />
mittels <strong>de</strong>ssen Kranken (wie man vermutete: vergiftetes)<br />
Blut abgenommen wur<strong>de</strong>.<br />
Noch Anfang dieses Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> die Technik<br />
<strong>de</strong>s A<strong>de</strong>rlasses im Lexikon ausführlich geschil<strong>de</strong>rt,<br />
und es hieß: “ Für die Heilung akuter Entzündungen,<br />
beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>s Gehirns sowie für lebensgefährliche<br />
Blutstauungen (bei Lungenentzündung,<br />
Herzfehler) blieb <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>rlaß auch bis in die neuere<br />
Zeit eine sehr beliebte Ableitung. Der Gebrauch <strong>de</strong>s<br />
A<strong>de</strong>rlasses ist aber gegen früher eingeschränkt wor<strong>de</strong>n,<br />
insofern man nur Kranke, aber nicht mehr Gesun<strong>de</strong><br />
zur A<strong>de</strong>r läßt. ”<br />
Heute weiß man, daß einige Rezepte die Entnahme<br />
von mehr Blut aus <strong>de</strong>n A<strong>de</strong>rn verlangten, als <strong>de</strong>r<br />
Körper überhaupt hat. Wur<strong>de</strong> die Behandlung korrekt<br />
(was, Gott sei Dank, nicht immer <strong>de</strong>r Fall war)<br />
durchgeführt, so verblutete <strong>de</strong>r Patient schlicht und<br />
einfach.<br />
K. Waller 1999 Lexikon <strong>de</strong>r klassischen Irrtümer. Eichborn.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2001 103<br />
La découverte <strong>de</strong>s groupes sanguins par Landsteiner (1901)<br />
Karl LANDSTEINER (1868-1943)<br />
prix Nobel <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1930<br />
Pendant les années 1897 à 1908, Landsteiner travaille à l’Institut<br />
d’anatomie pathologique <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Vienne. Après la<br />
guerre, il s’expatrie à cause <strong>de</strong>s mauvaises conditions <strong>de</strong> travail<br />
et s’installe à La Haye, puis, en 1922, à New York, où il<br />
<strong>de</strong>vient membre <strong>de</strong> l’Institut Rockefeller, et où il reste jusqu’à sa<br />
mort. C’est à l’Institut Rockefeller qu’il découvre avec ses collaborateurs<br />
le facteur Rh (découverte publiée en 1940).<br />
C’est dans un article consacré aux substances bactérici<strong>de</strong>s<br />
du sérum humain, publié à Vienne en 1900,<br />
que Landsteiner signale, en quelques lignes, la faculté<br />
qu’ont certains sérums humains d’agglutiner<br />
les hématies d’autres sangs humains.<br />
Effectuant une série <strong>de</strong> tests sur le sang <strong>de</strong> ses collaborateurs,<br />
Landsteiner aboutit en 1901 aux conclusions<br />
suivantes:<br />
1) La surface du globule rouge peut être porteuse<br />
d’un antigène ou facteur qu’il nomme A, ou d’un autre<br />
antigène qu’il nomme B, ou encore ne rien porter du<br />
tout, ce qui donne lieu à trois types sanguins: A, B et<br />
O (ce <strong>de</strong>rnier n’ayant ni A ni B). Un quatrième groupe,<br />
plus rare, formé <strong>de</strong> sujets qui possè<strong>de</strong>nt simultanément<br />
les <strong>de</strong>ux antigènes (groupe AB), sera mis en<br />
évi<strong>de</strong>nce par <strong>de</strong>ux collaborateurs <strong>de</strong> Landsteiner en<br />
1902. Le groupe O est le plus commun dans presque<br />
toutes les populations.<br />
2) Tout être humain présente dans son sérum le ou<br />
les anticorps qui ne correspon<strong>de</strong>nt pas aux antigènes<br />
ABO portés par ses hématies. C’est la présence<br />
universelle <strong>de</strong> ces anticorps (ou agglutinines), dits<br />
“ réguliers ” ou “ naturels”, qui permit <strong>de</strong> découvrir<br />
les variétés immunologiques du sang humain et <strong>de</strong><br />
définir les quatre groupes sanguins <strong>de</strong> base. Cette<br />
non-concordance chez un même sujet <strong>de</strong>s antigènes<br />
présents sur ses cellules et <strong>de</strong>s anticorps présents<br />
dans son sérum constitue une règle essentielle,<br />
dite “ règle <strong>de</strong> Landsteiner ”. Elle est impérative:<br />
s’il en allait autrement, l’individu s’autodétruirait<br />
(c’est d’ailleurs ce qui arrive au cours <strong>de</strong>s maladies<br />
auto-immunes, autrement dit lorsque le mala<strong>de</strong> fabrique<br />
<strong>de</strong>s anticorps contre ses propres tissus).<br />
Quand la Première Guerre mondiale éclata, la transfusion<br />
sanguine en était encore à ses balbutiements.<br />
Faute <strong>de</strong> disposer d’un anticoagulant efficace et non<br />
toxique, on pratiquait uniquement la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> bras<br />
à bras, en injectant directement le sang du donneur<br />
au receveur. Ces métho<strong>de</strong>s “ directes ” soulevaient<br />
<strong>de</strong> multiples problèmes: d’abord, le risque <strong>de</strong> coagulation<br />
du sang dans la tuyauterie et la pompe;<br />
ensuite, la difficulté d’évaluer avec exactitu<strong>de</strong> la<br />
quantité <strong>de</strong> sang à transfuser, ce qui risquait, en cas<br />
<strong>de</strong> surcharge, <strong>de</strong> provoquer chez le receveur un<br />
œdème aigu du poumon.<br />
On avait coutume <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au donneur et au<br />
receveur <strong>de</strong> bavar<strong>de</strong>r pendant toute l’opération, ce<br />
qui permettait, en écoutant le timbre <strong>de</strong> leur voix, <strong>de</strong><br />
se faire une idée <strong>de</strong> leur état respectif. En cas d’inci<strong>de</strong>nt,<br />
dans l’affolement général, on se précipitait sur<br />
le receveur, toujours le plus menacé, et on oubliait<br />
parfois le donneur, qui, couché avec sa canule dans<br />
une veine du pli du cou<strong>de</strong>, continuait à saigner goutte<br />
à goutte... jusqu’au moment où quelqu’un se préoccupait<br />
<strong>de</strong> lui.<br />
(d’après Ruffié & Sournia, La transfusion sanguine. Fayard 1996)<br />
Transfusion <strong>de</strong> bras à bras.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 104<br />
9. LA THÉORIE CELLULAIRE<br />
L’invention du microscope vers la fin du 16e siècle/début du 17e siècle a eu <strong>de</strong>s<br />
conséquences énormes sur le développement <strong>de</strong> la biologie et <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine. Le<br />
premier microscope composé a été peut-être été construit vers 1590 par le fabricant<br />
<strong>de</strong> lunettes hollandais Hans Janssen et son fils Zacharias.<br />
•<br />
En 1665, le physicien et naturaliste anglais Robert Hooke (1635-1703) publie son<br />
ouvrage “Micrographia” dans lequel il a figuré le <strong>de</strong>ssin d’une coupe <strong>de</strong> liège observé<br />
sous le microscope. Elle est “perforée et poreuse comme un gâteau <strong>de</strong> miel”. Hooke<br />
se représente ces pores comme <strong>de</strong>s loges allongées compartimentées par <strong>de</strong>s cloisons<br />
transversales. Il les désigne par le nom <strong>de</strong> “cellules”.<br />
Antony van LEEUWENHOEK<br />
(1632-1723)<br />
De nombreuses observations microscopiques ont<br />
été faites par le drapier hollandais Antoine van<br />
Leeuwenhoek (1632-1723) qui a construit luimême<br />
ses microscopes (<strong>de</strong>s microscopes simples<br />
à une seule lentille alors que Hooke s’est servi<br />
d’un microscope composé à <strong>de</strong>ux lentilles).<br />
Leeuwenhoek a décrit les globules rouges nucléés<br />
<strong>de</strong>s poissons (en 1673), les infusoires (en<br />
1675), les bactéries (en 1683), les spermatozoï<strong>de</strong>s<br />
36 , divers tissus animaux (muscles striés p.<br />
ex.), etc.<br />
L’Italien Marcello Malpighi (1628-1694) s’est<br />
servi du microscope pour étudier l’anatomie<br />
animale et végétale. Nous avons vu qu’il a découvert<br />
les capillaires du poumon.<br />
Les observations microscopiques se poursuivent au 18e et au début du 19e siècle.<br />
Leur interprétation donne lieu, en 1838/39, à la formulation <strong>de</strong> la théorie cellulaire<br />
par les naturalistes allemands Schlei<strong>de</strong>n et Schwann.<br />
Elle a été esquissée une première fois par le botaniste Mathias Jacob Schlei<strong>de</strong>n (1804-<br />
1881) dans son article “Beiträge zur Phytogenesis” (1838): “La cellule est un petit organisme.<br />
Chaque plante … est un agrégat <strong>de</strong> cellules complètement individualisées et ayant<br />
36 Les spermatozoï<strong>de</strong>s ont été découverts dans le sperme humain en 1677 par le Hollandais Jan Ham<br />
(1650-1723), qui se hâta <strong>de</strong> communiquer sa découverte à Leeuwenhoek. Ce <strong>de</strong>rnier s’appliqua ensuite<br />
à rechercher les spermatozoï<strong>de</strong>s — qu’il appelait “diertjes” (animalcules) — dans la semence <strong>de</strong><br />
nombreux animaux (chien , lapin, bélier, loir, coq, grenouille, cabillaud, etc.). Il les décrivit et en comprit<br />
le rôle dans la reproduction.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 105<br />
LE MICROSCOPE COMPOSÉ DE R. HOOKE.<br />
LE MICROSCOPE SIMPLE DE LEEUWENHOEK.<br />
à gauche: aspect <strong>de</strong> l'instrument;<br />
à droite: coupe schématique montrant son fonctionnement<br />
(L = lentille, O = objet examiné)<br />
Coupe transversale (dr.) et longitudinale<br />
(g.) à travers un morceau <strong>de</strong> liège.<br />
Dessin <strong>de</strong> Robert Hooke, 1665.<br />
Bactéries <strong>de</strong> la plaque <strong>de</strong>ntaire.<br />
Dessin <strong>de</strong> Leeuwenhoek<br />
(édition <strong>de</strong> 1694, lettre du 17 sept. 1683).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 106<br />
Mathias Jacob SCHLEIDEN<br />
(1804-1881)<br />
Theodor SCHWANN<br />
(1810-1882)<br />
Rudolf VIRCHOW<br />
(1821-1902)<br />
une existence propre.” Theodor Schwann<br />
(1810-1882) 37 généralise l’idée <strong>de</strong> Schlei<strong>de</strong>n<br />
dans son ouvrage “Mikroskopische<br />
Untersuchungen über die Übereinstimmung<br />
in <strong>de</strong>r Struktur und im Wachstum <strong>de</strong>r Thiere<br />
und Pflanzen” publié en 1839. Il montre<br />
qu’elle s’applique également aux animaux.<br />
Schwann considère la cellule<br />
comme l’unité élémentaire <strong>de</strong> la vie.<br />
Se basant sur la théorie cellulaire, le mé<strong>de</strong>cin<br />
allemand Rudolf Virchow (1821-<br />
1902) entreprend l’étu<strong>de</strong> systématique au<br />
microscope <strong>de</strong>s lésions anatomo-pathologiques.<br />
Virchow montre que chaque<br />
tissu est caractérisé par un type particulier<br />
<strong>de</strong> cellules qui lui confère ses propriétés<br />
caractéristiques. Il postule dès 1848<br />
que l’origine <strong>de</strong>s maladies se situe non<br />
pas au niveau <strong>de</strong> l’ensemble d’un organe<br />
ou d’un tissu, mais dans l’un <strong>de</strong>s types<br />
<strong>de</strong> cellules qui le constituent, ou résulte<br />
<strong>de</strong> l’infiltration <strong>de</strong> l’organe ou du tissu<br />
par <strong>de</strong>s cellules étrangères. Virchow a<br />
développé ses idées sur la pathologie cellulaire<br />
dans son ouvrage “Die Cellularpathologie<br />
in ihrer Begründung auf physiologische<br />
und pathologische Gewebelehre”<br />
(1858).<br />
37 né à Neuß am Rhein, professeur à l’université <strong>de</strong> Louvain (1839-1848), puis à Liège jusqu’en 1879,<br />
mort à Cologne.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 107<br />
REPRÉSENTATION DE CELLULES AUX 18e ET 19e SIÈCLES.<br />
A: cellules épithéliales <strong>de</strong> l'anguille (Fontana, 1781).<br />
B: cellules végétales avec noyau dans la paroi (Schlei<strong>de</strong>n, 1838).<br />
C: cellules du cartilage d'une larve d'Amphibien (Schwann, 1839).<br />
D: cellules tumorales humaines multinucléées (Virchow)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 108<br />
10. LA QUESTION DE LA GÉNÉRATION SPONTANÉE<br />
Parmi les savants et les philosophes, certains ont enseigné que <strong>de</strong>s êtres vivants peuvent<br />
venir à l’existence sans l’intermédiaire d’autres êtres vivants semblables qui les<br />
auraient engendrés. C’est la théorie <strong>de</strong> la génération spontanée (allem.: Urzeugung) qui<br />
se retrouve dans l’histoire <strong>de</strong>puis l’Antiquité jusqu’aux temps mo<strong>de</strong>rnes.<br />
1. La génération spontanée dans l’Antiquité<br />
Empédocle (485-425 av. J.-C.), l’auteur <strong>de</strong> la théorie <strong>de</strong>s quatre éléments (eau, terre,<br />
air, feu) admettait que les êtres sont nés par mélange <strong>de</strong>s quatre éléments. Au départ<br />
<strong>de</strong>s formes fragmentaires, constituées par l’eau et la terre sortent du sol sous l’influence<br />
du feu. “Ainsi poussèrent nombre <strong>de</strong> têtes sans cou, errèrent <strong>de</strong>s bras nus sans<br />
épaule, et <strong>de</strong>s yeux pas fixés à <strong>de</strong>s visages. (…) Ces membres s’ajustèrent comme ils se rencontrèrent.<br />
(…) Il y eut nombre d’êtres à double visage et à double poitrine, <strong>de</strong>s formes bovines<br />
à tête humaine, et inversement <strong>de</strong>s formes humaines à tête bovine…” Dans une troisième<br />
étape <strong>de</strong>s corps complets apparaissent. Désormais, les êtres vivants, au lieu <strong>de</strong><br />
provenir <strong>de</strong>s quatre éléments, naîtront les uns <strong>de</strong>s autres.<br />
Aristote (384-322 av. J.-C.) voit <strong>de</strong>s poissons s’organiser d’eux-mêmes dans la vase<br />
<strong>de</strong>s marais. Pour Lucrèce (98-55 av. J.-C.), philosophe et naturaliste romain, herbes et<br />
bêtes naissent spontanément à partir <strong>de</strong> la terre fécon<strong>de</strong>.<br />
L’arbre qui produit <strong>de</strong>s bernacles<br />
(lithographie <strong>de</strong> 1544)<br />
2. La génération spontanée au Moyen Âge<br />
Au Moyen Âge cette théorie annonce d’extraordinaires<br />
phénomènes:<br />
• Les arbres produisent parfois comme fruits singuliers<br />
<strong>de</strong>s oies à bec court appelées bernacles ou bernaches<br />
(allem.: Ringelgans). 38<br />
• Du bois pourri en mer sortent <strong>de</strong>s vers qui <strong>de</strong>viennent<br />
ensuite papillons.<br />
3. La génération spontanée aux 17e et 18e siècles<br />
Du 17e siècle à la pério<strong>de</strong> contemporaine, la génération spontanée connaît <strong>de</strong>s fortunes<br />
diverses.<br />
Ainsi, van Helmont est persuadé qu’on peut faire naître <strong>de</strong>s souris d’une chemise<br />
sale enfermée dans un pot avec du son <strong>de</strong> blé. Par contre, le savant italien Francesco<br />
Redi (1626-1697) montre que les asticots ne se développent pas dans la vian<strong>de</strong> si au<br />
38 Oies marines, à répartition circumpolaire, vivant p.ex. au Spitzberg et pouvant venir en hiver<br />
jusque dans nos régions.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 109<br />
moyen d’une gaze on empêche les mouches d’y pondre. D’autres reconnaissent que<br />
les vers <strong>de</strong>s fruits proviennent d’oeufs déposés par <strong>de</strong>s insectes.<br />
La découverte du microscope à la fin du 16e siècle semble d’abord apporter <strong>de</strong>s arguments<br />
favorables à la thèse <strong>de</strong> la génération spontanée. D’où proviennent les animalcules<br />
observés évoluant dans les gouttes d’infusions très variées? Ces “infusoires”<br />
sont, pour beaucoup d’observateurs, la preuve d’une organisation spontanée<br />
<strong>de</strong> la matière inerte.<br />
Deux ecclésiastiques soutinrent à ce sujet <strong>de</strong>s opinions contraires. L’Anglais John<br />
Turbevill Needham (1713-1781) trouvait <strong>de</strong>s animalcules dans les substances organiques<br />
contenues dans <strong>de</strong>s pots exposés au feu (chaleur) <strong>de</strong> la cendre chau<strong>de</strong>; il y<br />
voyait une génération spontanée. Le célèbre naturaliste français Buffon (1707-1788)<br />
pensait comme lui. L’abbé Lazzaro Spallanzani (1729-1799), au contraire, soutenait<br />
que l’expérience <strong>de</strong> Needham était mal faite; en particulier le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> feu <strong>de</strong> la cendre<br />
ne pouvait suffire à tuer les semences préexistantes. Spallanzani ne découvrit pas<br />
un seul animalcule dans le contenu organique <strong>de</strong> vases maintenus quelques instants<br />
dans l’eau bouillante.<br />
À la suite <strong>de</strong> ces expériences, la génération spontanée perdit même la faveur du<br />
public. Voltaire écrivait: “Il est démontré aujourd’hui aux yeux <strong>de</strong> la raison qu’il n’est ni<br />
végétal ni animal qui n’ait son germe.” Les preuves décisives cependant manquaient<br />
toujours; <strong>de</strong>s savants comme Lamarck et Dumas 39 restaient favorables à la génération<br />
spontanée.<br />
Francesco REDI<br />
(1626-1697)<br />
Lazzaro SPALLANZANI<br />
(1729-1799)<br />
39 Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), célèbre chimiste français.<br />
Le bocal A est recouvert d'une gaze fine empêchant les<br />
mouches D d'y pénétrer, mais permettant à leurs oeufs <strong>de</strong><br />
passer et <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s asticots F tombant sur le fond du<br />
bocal A et sur le <strong>de</strong>ssus du bocal B recouvert d'une gaze plus<br />
fine qui les empêche <strong>de</strong> passer, ce qui permet au morceau <strong>de</strong><br />
vian<strong>de</strong> C d'en être dépourvu (d'après un <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> 1689).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 110<br />
4. L’idée <strong>de</strong> la génération spontanée au 19e siècle et les travaux <strong>de</strong> Pasteur<br />
4.1. L’expérience <strong>de</strong> Pouchet<br />
À l’époque <strong>de</strong> Pasteur, les discussions reprirent, soulevées en 1858 par Archimè<strong>de</strong><br />
Pouchet (1800-1872), directeur du muséum <strong>de</strong> Rouen. Les idées <strong>de</strong> Pouchet sont<br />
résumées dans le titre d’une communication à l’Académie <strong>de</strong>s Sciences: Note sur les<br />
protoorganismes végétaux et animaux nés spontanément dans l’air artificiel et dans le gaz<br />
oxygène.<br />
Archimè<strong>de</strong> Pouchet<br />
(1800-1872)<br />
Les preuves apportées par ce naturaliste découlaient surtout<br />
d’une expérience ainsi conduite:<br />
Un flacon stérilisé plein d’eau bouillie est renversé sur une cuve<br />
à mercure; on y fait ensuite pénétrer un mélange d’oxygène et<br />
d’azote préparés chimiquement. Un <strong>de</strong>uxième flacon bouché à<br />
l’émeri contient une bourre <strong>de</strong> foin. Après stérilisation <strong>de</strong> l’ensemble<br />
à 100°C, on ouvre le flacon sous le mercure et la bourre<br />
gagne le niveau <strong>de</strong> l’eau bouillie, après avoir traversé le mercure.<br />
Pouchet pensait n’avoir introduit aucun germe dans l’eau;<br />
les organismes qu’on voyait se développer quelques jours après<br />
provenaient donc, selon lui, d’une génération spontanée.<br />
4.2. Critiques et expériences <strong>de</strong> Pasteur<br />
Pasteur avait souligné dans un exemplaire <strong>de</strong> la note <strong>de</strong> Pouchet tous les points qu’il<br />
se proposait <strong>de</strong> combattre. Les critiques <strong>de</strong> Pasteur portèrent d’abord sur les modalités<br />
<strong>de</strong> l’expérience <strong>de</strong> Pouchet. En apparence bien faite, elle était cependant défectueuse.<br />
Selon Pasteur, la bourre, d’abord stérile, avait rencontré <strong>de</strong>s germes au contact<br />
du mercure et les avait entraînés, en même temps peut-être que <strong>de</strong>s bulles d’air<br />
infecté introduites au cours <strong>de</strong> la manipulation. Pasteur démontra l’erreur <strong>de</strong> ses<br />
adversaires avec une série d’expériences rigoureuses.<br />
1ère expérience <strong>de</strong> Pasteur:<br />
Étu<strong>de</strong> microscopique <strong>de</strong> l’air<br />
Cette expérience démontre qu’il y a dans l’air <strong>de</strong>s germes d’êtres vivants. On trouve<br />
dans un mémoire <strong>de</strong> Pasteur la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> l’expérience.<br />
“Le procédé que j’ai suivi, dit Pasteur, pour recueillir la poussière en suspension dans l’air et l’examiner<br />
au microscope est d’une gran<strong>de</strong> simplicité; il consiste à filtrer un volume d’air déterminé sur<br />
du coton poudre 40 , soluble dans un mélange d’alcool et d’éther. Les fibres du coton arrêtent les particules<br />
soli<strong>de</strong>s, on traite alors le coton par son dissolvant; après un repos suffisamment prolongé, toutes<br />
les particules soli<strong>de</strong>s tombent au fond <strong>de</strong> la liqueur; on les soumet à quelques lavages, puis on les<br />
40 nitrocellulose; synonyme: fulmicoton.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 111<br />
Expérience <strong>de</strong> Pasteur montrant que l'air<br />
contient <strong>de</strong>s germes vivants.<br />
air <strong>de</strong> la rue<br />
Expérience <strong>de</strong> Pasteur montrant la stérilisation <strong>de</strong> l'air<br />
par la chaleur.<br />
tube <strong>de</strong> platine<br />
chauffé au rouge<br />
air<br />
ballons à col sinueux<br />
bouillon<br />
stérilisé<br />
coton poudre<br />
trompe<br />
à eau<br />
Ballons <strong>de</strong> Pasteur à col sinueux.<br />
bouillon<br />
stérilisé<br />
refroidissement<br />
<strong>de</strong> l'air<br />
ballon<br />
"décapité"<br />
Le bouillon <strong>de</strong> foin préalablement stérilisé se conserve dans ces ballons. Il ne tar<strong>de</strong> pas<br />
à s'altérer si l'on supprime le col sinueux (ballon à droite).<br />
Poussières et germes vivants<br />
contenus dans l'air.<br />
bouillon<br />
trouble<br />
ballon à col droit<br />
bouillon<br />
<strong>de</strong> foin<br />
stérilisé<br />
Le liqui<strong>de</strong> du ballon <strong>de</strong>meure stérile:<br />
les germes vivants <strong>de</strong> l'air ont été<br />
détruits en traversant le tube.<br />
bouillon<br />
stérilisé<br />
coton<br />
stérilisé<br />
sang ou<br />
urine<br />
ampoule <strong>de</strong> Pasteur pour prélever<br />
aseptiquement un liqui<strong>de</strong><br />
biologique
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 112<br />
dépose sur le porte-objet du microscope, où leur étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>vient facile. Ces manipulations fort simples<br />
permettent <strong>de</strong> reconnaître qu’il y a dans l’air un nombre variable <strong>de</strong> corpuscules dont la forme et la<br />
structure annoncent qu’ils sont organisés...”<br />
La matière organique du coton fut suspectée par Pouchet. À sa place, Pasteur mit<br />
une bourre d’amiante et l’expérience, un peu modifiée, donna les mêmes résultats<br />
avec cette substance minérale.<br />
2e expérience:<br />
un bouillon fermentescible peut être conservé inaltéré<br />
À cette secon<strong>de</strong> expérience, Pasteur donna plusieurs aspects.<br />
1° Il introduisit d’abord une infusion <strong>de</strong> foin dans un ballon à long col qu’il mit en communication<br />
avec un tube <strong>de</strong> platine disposé dans un four à réverbère. L’infusion<br />
fut portée à l’ébullition pendant qu’on chauffait au rouge le tube <strong>de</strong> platine. De<br />
cette manière, l’air est chassé <strong>de</strong> l’appareil par la vapeur d’eau produite et le<br />
bouillon est stérilisé. En se refroidissant, le ballon s’emplissait à nouveau d’un air<br />
ayant traversé le tube <strong>de</strong> platine au rouge; on obturait ensuite à la lampe le col du<br />
ballon. Ainsi privée <strong>de</strong> contact avec l’atmosphère, l’infusion restait définitivement<br />
claire et inaltérée, car l’air réintroduit avait été débarrassé <strong>de</strong> ses germes<br />
lors <strong>de</strong> son passage à travers le tube <strong>de</strong> platine porté au rouge.<br />
2° Il fit bouillir l’infusion dans un ballon à col sinueux. Les parois du col restant humi<strong>de</strong>s,<br />
pendant le refroidissement, l’air venu <strong>de</strong> l’extérieur abandonne ses semences<br />
sur les parois et arrive purifié au contact du liqui<strong>de</strong> nutritif. L’infusion reste<br />
encore inaltérée, mais elle est envahie <strong>de</strong> microbes dès que le ballon décapité <strong>de</strong><br />
son col sinueux permet à l’air souillé d’introduire <strong>de</strong>s germes. Pasteur répondait<br />
ainsi à l’objection suivant laquelle l’air calciné dans le tube <strong>de</strong> platine n’avait plus<br />
sa “force germinative”.<br />
3° Pouchet objecta ensuite que tant <strong>de</strong> germes contenus dans le peu d’air suffisant<br />
pour ensemencer les infusions “formeraient un brouillard <strong>de</strong>nse comme le fer”, si<br />
réellement ils existaient en grand nombre.<br />
Pasteur répondit en montrant que les divers lieux ne sont pas également riches en<br />
semences. Sur dix ballons stérilisés ouverts à l’air <strong>de</strong> la cave <strong>de</strong> l’observatoire <strong>de</strong><br />
Paris, un seul donna une culture, onze autres, dans les mêmes conditions, s’ensemencèrent<br />
tous dans la cour. Vingt autres ballons furent portés à 850 mètres sur le<br />
mont Poupet (dans le Jura): tous furent ouverts, cinq seulement furent contaminés.<br />
Plus tard, Pasteur répéta la même démonstration sur la Mer <strong>de</strong> Glace 41 , à 2.000<br />
mètres d’altitu<strong>de</strong>: sur vingt autres ballons ouverts, un seul fut envahi <strong>de</strong> microbes.<br />
3e expérience:<br />
les liqui<strong>de</strong>s organiques se conservent dans un air privé <strong>de</strong> germes<br />
La <strong>de</strong>rnière objection <strong>de</strong> ses contradicteurs relative au phénomène <strong>de</strong> la génération<br />
spontanée possible dans les liqui<strong>de</strong>s organiques non bouillis fut éliminée <strong>de</strong> la façon<br />
41 Grand glacier du versant Nord du massif du Mont-Blanc, accessible par Chamonix.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 113<br />
suivante:<br />
Pasteur imagina une ampoule spéciale qui lui permettrait <strong>de</strong> puiser <strong>de</strong>s liqui<strong>de</strong>s organiques<br />
dans le corps d’un animal. L’ampoule est obturée par du coton stérile; une<br />
fine tubulure latérale sert d’aiguille à ponction; on l’introduit, à travers la peau désinfectée,<br />
dans une veine ou la vessie d’un animal. Après la ponction, la tubulure est<br />
refermée à la flamme et le liqui<strong>de</strong> recueilli, sang ou urine, privé <strong>de</strong> contact avec l’air<br />
souillé, se conserve très bien sans avoir jamais subi d’ébullition.<br />
Le triomphe <strong>de</strong> Pasteur<br />
Les discussions entamées en 1859 se poursuivirent jusqu’en 1863. Dès 1862, la note<br />
<strong>de</strong> Pasteur sur les corpuscules organisés qui existent dans l’atmosphère (publiée en 1861)<br />
avait mérité l’approbation <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong>s Sciences. Le mon<strong>de</strong> savant venait à ses<br />
idées et une commission d’examen, réclamée d’abord par les adversaires <strong>de</strong> Pasteur,<br />
puis par lui-même, ne tint jamais séance; les partisans <strong>de</strong> la génération spontanée<br />
avaient réclamé certains délais, finalement, ils se dérobèrent.<br />
Les expériences <strong>de</strong> Pasteur furent dévoilées au public “du tout Paris” dans une conférence<br />
qu’il fit à la Sorbonne en avril 1864; son exposé, dont voici la conclusion,<br />
enthousiasma les auditeurs: “Il n’y a aucune circonstance, aujourd’hui connue, dans laquelle<br />
on puisse affirmer que <strong>de</strong>s êtres microscopiques sont venus au mon<strong>de</strong> sans germes,<br />
sans parents semblables à eux ...”<br />
Louis PASTEUR (1822-1895)<br />
chimiste et microbiologiste
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 114<br />
11. L’<strong>HISTOIRE</strong> <strong>DES</strong> VACCINATIONS<br />
11. 1 JENNER ET LA PREMIÈRE VACCINATION (1796)<br />
La variole ou petite vérole (ainsi nommée parce que certains <strong>de</strong> ses effets cliniques<br />
peuvent évoquer la syphilis) est une maladie connue en Chine, en In<strong>de</strong> et en Arabie<br />
<strong>de</strong>puis environ 3.000 ans. En Europe, c’est au 6 e siècle qu’une épidémie <strong>de</strong> variole<br />
est attestée pour la première fois. Des épidémies <strong>de</strong> variole ont eu lieu pendant tout<br />
le Moyen Âge. Au 18 e siècle les ravages ont été particulièrement grands.<br />
La variolisation<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l’Europe occi<strong>de</strong>ntale on avait appris à se protéger contre le fléau par<br />
un procédé appelé variolisation. Elle consistait à inoculer à un sujet sain, plus ou<br />
moins directement menacé par le fléau, une forme aussi bénigne que possible <strong>de</strong> la<br />
maladie elle-même. La variolisation a été pratiquée bien avant le 16 e siècle sur les<br />
bords <strong>de</strong> la Caspienne. Elle se faisait en introduisant dans une narine un tampon <strong>de</strong><br />
coton imprégné <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong> provenant d’une pustule variolique. En fait, on sait que<br />
les anciens Chinois ont sporadiquement pratiqué la variolisation en insufflant <strong>de</strong> la<br />
croûte varioleuse pulvérisée dans la narine <strong>de</strong>s enfants, narine droite pour les filles,<br />
narine gauche pour les garçons (la narine gauche était considérée comme plus noble).<br />
Au début du 18 e siècle, la variolisation a<br />
été popularisée en Gran<strong>de</strong>-Bretagne par<br />
Lady Wortley Montagu 42 (dont le mari<br />
était ambassa<strong>de</strong>ur d’Angleterre à Constantinople)<br />
qui avait fait “varioliser” son<br />
fils âgé <strong>de</strong> cinq ans, en 1718, par Maitland,<br />
mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> l’ambassa<strong>de</strong>. Maitland tenta<br />
<strong>de</strong> répandre la variolisation 43 en Angleterre,<br />
sans grand succès d’ailleurs, car le<br />
procédé n’était pas sans danger.<br />
Il n’était point rare, en effet, que <strong>de</strong>s sujets<br />
variolisés succombassent à la mala-<br />
Lady Mary Wortley MONTAGU (1689-1762)<br />
42 Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), née à Londres, mariée en 1712 avec Edward Wortley<br />
Montagu. Écrivain, poète, essayiste, féministe, c’était une femme dont la gran<strong>de</strong> beauté portait quelques<br />
traces <strong>de</strong> la variole qu’elle avait eue dans sa jeunesse.<br />
43 également appelée“inoculation”.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 115<br />
die contre laquelle on essayait <strong>de</strong> les protéger <strong>de</strong> cette façon. De plus, les sujets inoculés<br />
avec le «poison» variolique pouvaient transmettre le «poison» dans leur entourage<br />
et essaimer ainsi la variole.<br />
En France, les discussions étaient vives; la variolisation était traitée <strong>de</strong> procédé diabolique<br />
et, malgré les efforts <strong>de</strong> ses partisans, le procédé ne semblait pas voué à une<br />
gran<strong>de</strong> extension.<br />
Le cow-pox et la variole<br />
Dans le courant du 18 e siècle, certaines observations avaient été faites en Angleterre,<br />
dont celle-ci: les individus qui contractent la maladie connue sous le nom <strong>de</strong> cow-pox<br />
ou vaccine 44 paraissent protégés contre la variole.<br />
Edward Jenner (1749-1823), mé<strong>de</strong>cin “variolisateur” dans son district, n’ignorait pas<br />
ces observations. Il signale que <strong>de</strong>s personnes qui avaient contracté plus ou moins<br />
longtemps auparavant le cow-pox, restent in<strong>de</strong>mnes <strong>de</strong> variole, lorsque plus tard,<br />
elles sont soumises à l’inoculation variolique.<br />
Pustules <strong>de</strong> la variole :<br />
en se <strong>de</strong>sséchant elles laisseront <strong>de</strong>s<br />
cicatrices indélébiles<br />
La vaccination<br />
44 variola vaccina = variole <strong>de</strong> la vache (lat.: vacca = vache).<br />
Pustules du cow-pox<br />
sur le pis d'une vache.<br />
En mai 1796, on présente à Jenner une jeune fille, Sarah Nelmes, au service d’un fermier<br />
<strong>de</strong> la région. En soignant une vache, elle a contracté à la main droite, sur une<br />
égratignure qu’elle s’était faite, un gros “bouton” pustuleux. Jenner pense qu’il se<br />
trouve en présence d’une manifestation du cow-pox qui doit protéger <strong>de</strong> la variole.<br />
S’il en est ainsi, si le contenu <strong>de</strong>s pustules est actif, il doit montrer cette même activité<br />
sur un enfant encore épargné par la variole.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 116<br />
Le 14 mai, Jenner fait <strong>de</strong>ux incisions superficielles au bras d’un jeune garçon, James<br />
Phipps; il y insère une partie du liqui<strong>de</strong> recueilli dans la grosse pustule <strong>de</strong> Sarah<br />
Nelmes; il espère mettre ainsi à l’abri James Phipps d’une atteinte ultérieure <strong>de</strong> la<br />
variole. Jenner surveille avec attention son “opéré”. La réaction paraît d’abord insignifiante;<br />
elle s’atténue peu à peu. Au moment où il semble qu’elle va disparaître,<br />
elle se réveille, une pustule apparaît au niveau <strong>de</strong> l’inoculation, elle va se développer.<br />
“Le septième jour, déclare Jenner, le jeune James Phipps se plaignit d’une petite douleur<br />
au niveau <strong>de</strong>s ganglions axillaires et, le neuvième jour, il ressentait quelques frissons, perdait<br />
l’appétit. Pendant toute la journée, il continua à être indisposé. Le len<strong>de</strong>main, il était parfaitement<br />
bien portant. Au reste, le tout se dissipa sans laisser ni à mon mala<strong>de</strong>, ni à moi, la plus<br />
petite inquiétu<strong>de</strong>.”<br />
Mais Phipps échappera-t-il aux atteintes <strong>de</strong> la variole? Jenner l’espère, il en a même<br />
l’intime conviction, cependant il lui faut en administrer la preuve et une preuve incontestable.<br />
Le 1 er juillet 1796, Jenner <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à l’expérience <strong>de</strong> mettre un terme à son attente, <strong>de</strong><br />
lui fournir la réponse décisive: il inocule la variole à James Phipps. L’attention, l’inquiétu<strong>de</strong>,<br />
les espérances <strong>de</strong> Jenner redoublent. Les jours se succè<strong>de</strong>nt, James Phipps<br />
n’a présenté aucune réaction locale au point d’infection variolique, il est réfractaire à<br />
la variole. Le cow-pox l’a immunisé!<br />
Dans son ouvrage “Recherches” 45 , Jenner souligne le grand avantage que l’inoculation<br />
<strong>de</strong> la vaccine ou vaccination possé<strong>de</strong>rait sur la variolisation puisqu’elle ne comporte<br />
pas le danger d’extension <strong>de</strong> la variole à partir <strong>de</strong>s sujets vaccinés. 46<br />
Edward JENNER<br />
(1749-1823)<br />
45 An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, a Disease Discovered in Some of the Western<br />
Counties of England, particularly Gloucestershire, and Known by the Name of the Cow Pox. 1798.<br />
46 Ce chapitre s’est inspiré largement <strong>de</strong> RAMON, Pages d’histoire <strong>de</strong> l’immunologie, dans Biologie médicale,<br />
Éditions Specia. Cité d’après: L’Homme. Collection Marcel Oria. Paris, Hatier, 1974, p. 174-175.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 117<br />
La vaccination et la variole au Grand-Duché <strong>de</strong> Luxembourg<br />
En France, la vaccination a été introduite dès le début du 19 e siècle grâce notamment<br />
à l’appui <strong>de</strong> Napoléon qui, en 1804, met personnellement en place la “Société pour<br />
l’extinction <strong>de</strong> la petite vérole en France par la propagation <strong>de</strong> la vaccine”. Napoléon prône<br />
<strong>de</strong> même la vaccination <strong>de</strong>s soldats <strong>de</strong> son armée, mais le succès <strong>de</strong> son action restera<br />
très limité. Un premier décret sur la vaccine est publié en 1809. Au Département<br />
<strong>de</strong>s Forêts, l’ordonnance du 19 juillet 1814 prescrit la vaccination pour les enfants<br />
dans les trois mois <strong>de</strong> leur naissance.<br />
Parmi les premiers vaccinateurs au Luxembourg nous trouvons, en 1801, l’«officier<br />
<strong>de</strong> santé» français, Alexandre Danel, auteur d’un manifeste appelant la population à<br />
faire vacciner ses enfants. Mais la métho<strong>de</strong> a mis du temps pour gagner du terrain.<br />
En 1805, il y a eu pour tout le Département <strong>de</strong>s Forêts 517 enfants vaccinés. En 1806,<br />
ce nombre a déjà été <strong>de</strong> 1672. Des 9.796 nouveaux-nés <strong>de</strong> l’année 1811, 2.222 ont été<br />
vaccinés (environ 22 %).<br />
En 1814, le “Journal officiel du Département <strong>de</strong>s Forêts” publie sous le titre “Livre <strong>de</strong> la vaccine”<br />
un long texte sur les avantages <strong>de</strong> la vaccination. Nous y trouvons entre autres la <strong>de</strong>scription<br />
imagée suivante <strong>de</strong> la variole: “Si on réfléchit ensuite, combien d’hommes ont jadis, par la<br />
petite vérole, perdu leur beauté et leur santé, et combien en ont péri; — quand on pense aux douleurs<br />
auxquelles ont été en proie le plus grand nombre <strong>de</strong> ceux qui ont eu la maladie; — quand on se les<br />
représente gisant sur leurs lits, défigurés par les croûtes varioliques et puantes, privés <strong>de</strong> leur vue<br />
pendant plusieurs jours, tourmentés par une fièvre violente, et dévorés par une soif ar<strong>de</strong>nte, sans<br />
pouvoir dormir, délirant, et luttant avec <strong>de</strong>s convulsions, <strong>de</strong>mandant en vain <strong>de</strong>s secours par leurs<br />
gémissements, et déchirant par ce spectacle affreux le coeur <strong>de</strong> leurs parents; — quand on considère,<br />
dis-je, tous ces maux qu’a produits la petite vérole, on ne peut alors que convenir que l’inoculation du<br />
vaccin, ou la vaccine, qui garantit d’un <strong>de</strong>s fléaux les plus terribles dont l’humanité ait été affligée, est<br />
une <strong>de</strong>s découvertes les plus importantes qui jamais ait été faite pour la conservation <strong>de</strong> la beauté, <strong>de</strong><br />
la santé et <strong>de</strong> la vie du genre humain. Aussi la nation anglaise a fait don au mé<strong>de</strong>cin Édouard Jenner,<br />
qui a fait cette découverte, en reconnaissance <strong>de</strong> ce grand service, <strong>de</strong> la somme <strong>de</strong> quarante mille<br />
couronnes.”<br />
Instruments pour la vaccination :<br />
1. cupule <strong>de</strong> verre pour le vaccin.<br />
2. lancette.<br />
3 et 4. vaccinostyles.<br />
5. porte-vaccinostyle.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 118<br />
En 1826, une épidémie <strong>de</strong> variole s’est déclarée dans les parties alleman<strong>de</strong>s du Grand-<br />
Duché <strong>de</strong> Luxembourg (donc, dans le pays actuel). Il y a eu 1.500 mala<strong>de</strong>s, 150 décès<br />
et 123 défigurés.<br />
De 1870 à 1872, une épidémie <strong>de</strong> variole fait rage en Europe. Vers la fin <strong>de</strong> l’année<br />
1870 la maladie est importée au Luxembourg par <strong>de</strong>s voyageurs venant <strong>de</strong> Paris. En<br />
1871, c’est l’épidémie un peu partout dans le pays. On peut lire dans le “Luxemburger<br />
Wort” du 12 avril 1871 que dans le village <strong>de</strong> Garnich 36 personnes ont succombé à la<br />
variole. Dans son ensemble l’épidémie <strong>de</strong> 1870/71 a été néanmoins qualifiée <strong>de</strong> plutôt<br />
bénigne au Luxembourg, où elle a fait en tout 200 victimes, surtout <strong>de</strong>s enfants.<br />
La cause <strong>de</strong> ces décès a été attribuée par les mé<strong>de</strong>cins à “l’habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mères d’effacer<br />
le virus vaccin 47 immédiatement après la vaccination”. En France, l’épidémie <strong>de</strong> 1871 a<br />
fait 200.000 victimes. En Prusse, 160.000 personnes en sont mortes en 1871/72, en<br />
Belgique et en Hollan<strong>de</strong> 50.000.<br />
Dans les années 1880/82 une nouvelle épidémie <strong>de</strong> variole a régné dans différentes<br />
localités du Grand-Duché. Ainsi, à Vian<strong>de</strong>n 40 personnes sont emportées par la maladie<br />
sur une population totale <strong>de</strong> 1.400 habitants. L’épidémie d’Esch-sur-Alzette a<br />
été étudiée en détail par le Dr Jean Meyers (1842-1891) dans son article “Pocken und<br />
Schutzpocken in Esch an <strong>de</strong>r Alzette (1881-82)”. Sur une population <strong>de</strong> 6.000 habitants<br />
on a compté quelque 250 personnes mala<strong>de</strong>s, dont 50 sont mortes (20% <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s).<br />
À une exception près, les personnes décédées ont été <strong>de</strong>s gens non vaccinés (20<br />
cas) ou non revaccinés (29 cas).<br />
Tab.: Statistique <strong>de</strong> l’épidémie <strong>de</strong> variole <strong>de</strong> 1881-1882 à Esch-sur-Alzette (Meyers 1882).<br />
47 Le terme <strong>de</strong> “virus” n’est pas à prendre au sens mo<strong>de</strong>rne. On désignait par “virus” (= suc, poison,<br />
venin) toute substance organique (pus, etc.) susceptible <strong>de</strong> transmettre la maladie.<br />
A partir <strong>de</strong> 1850/60, le terme a été appliqué à tout germe pathogène. Après leur découverte, les virus<br />
au sens mo<strong>de</strong>rne ont d’abord été appelés “virus filtrants” ou “ultravirus”.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 119<br />
11.2. PASTEUR ET SES TRAVAUX SUR LA VACCINATION<br />
Jenner ignorait le mécanisme intime qui protégeait <strong>de</strong> la variole. Quand, en 1877,<br />
Pasteur s’attaqua à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s maladies contagieuses chez les animaux supérieurs,<br />
une maladie redoutable, le charbon, ruinait les élevages <strong>de</strong> moutons.<br />
Il décida d’en rechercher l’origine. Mais que savait-on en 1877 sur cette maladie?<br />
11.2.1. La maladie du charbon ou anthrax (Milzbrand)<br />
Symptômes et évolution<br />
L’Homme est parfois atteint <strong>de</strong> la maladie du charbon, mais elle est surtout commune<br />
chez le Mouton où la maladie évolue rapi<strong>de</strong>ment. L’animal, saisi par la fièvre,<br />
peut tomber foudroyé au pâturage. Du sang <strong>de</strong> couleur noire sort par les naseaux,<br />
d’où le nom <strong>de</strong> la maladie. La rate et le foie sont noirs également. Chez l’Homme, il<br />
se forme une pustule maligne, presque toujours à la place d’une écorchure. Le plus<br />
souvent, la maladie évolue en une septicémie charbonneuse qui, à l’époque <strong>de</strong> Pasteur,<br />
était généralement mortelle.<br />
L’agent <strong>de</strong> la maladie<br />
En 1850, <strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins français, Rayer 48 et son élève Davaine 49 , observant au<br />
microscope du sang d’un animal charbonneux, y trouvent <strong>de</strong>s petits corps immobiles<br />
en forme <strong>de</strong> bâtonnets. Ils n’y attachent pas d’importance particulière: à cette<br />
époque on pense que les fermentations et les maladies engendrent ces corpuscules<br />
(voir la théorie <strong>de</strong> la génération spontanée).<br />
Mais en 1861, Pasteur publie son mémoire sur les fermentations et insiste sur le fait<br />
que les micro-organismes en sont la cause et non pas l’effet.<br />
Davaine est vivement frappé par ce travail. À partir <strong>de</strong> 1863,<br />
persuadé que les bâtonnets qu’il a observés treize ans plus<br />
tôt dans le sang <strong>de</strong>s animaux charbonneux sont responsables<br />
<strong>de</strong> la maladie, il reprend ses observations. Il retrouve<br />
les bâtonnets immobiles et les baptise “bactéridies”. Il constate<br />
que le sang chargé <strong>de</strong> “bactéridies” peut transmettre la<br />
maladie à un autre animal. Il montre que la pustule maligne<br />
<strong>de</strong> l’Homme est un aspect du charbon et que les mouches<br />
peuvent jouer un rôle dans la transmission <strong>de</strong> cette<br />
maladie.<br />
Casimir <strong>Jos</strong>eph Davaine<br />
(1812-1882).<br />
48 Pierre Rayer (1793-1867).<br />
49 Casimir <strong>Jos</strong>eph Davaine (1812-1882).<br />
Davaine avait donc bien compris le rôle <strong>de</strong>s “bactéridies”.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 120<br />
Mais cette conception absolument nouvelle <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong>s maladies rencontra<br />
une vive opposition <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s vétérinaires <strong>de</strong> l’époque. Aussi,<br />
quand Pasteur reprit l’étu<strong>de</strong> du charbon, lui fallut-il d’abord démontrer que les<br />
“bactéridies” étaient bien la cause <strong>de</strong> la maladie et non l’effet.<br />
Culture du germe<br />
Pasteur dépose une goutte <strong>de</strong> sang d’un animal charbonneux dans un bouillon <strong>de</strong><br />
culture stérilisé. Les bâtonnets se multiplient activement. Quand le liqui<strong>de</strong> est bien<br />
trouble par suite <strong>de</strong> la prolifération <strong>de</strong>s “bactéridies”, Pasteur prélève une goutte<br />
<strong>de</strong> ce bouillon et l’introduit dans un second ballon contenant le même milieu <strong>de</strong><br />
culture stérilisé. Pasteur répète 100 fois cette opération. Au centième ballon, on<br />
peut admettre que tous les éléments spécifiques du sang (une goutte au départ!)<br />
ont été éliminés: il ne reste plus qu’une culture pure <strong>de</strong> Bacille du charbon, nom<br />
que l’on donne aujourd’hui à la “bactéridie”. Quelques centimètres cubes <strong>de</strong> cette<br />
culture pure sont alors injectés sous la peau d’un mouton: l’animal ne tar<strong>de</strong> pas à<br />
mourir du charbon et son sang renferme les bacilles caractéristiques. Les bacilles<br />
introduits sous la peau se sont donc multipliés activement. Le bâtonnet découvert<br />
par Rayer et Davaine est donc bien la cause <strong>de</strong> la maladie.<br />
Observé dans le sang, le Bacille du charbon a la forme d’un bâtonnet <strong>de</strong> 6 à 8<br />
microns <strong>de</strong> long sur 1 μm <strong>de</strong> large. Mais en culture, il a l’aspect <strong>de</strong> filaments: le<br />
milieu étant calme, les <strong>de</strong>scendants d’une même bactérie restent les uns au bout<br />
<strong>de</strong>s autres, ce qui donne <strong>de</strong>s filaments. Le Bacille du charbon produit <strong>de</strong>s spores<br />
très résistantes qui restent vivantes plusieurs années dans le sol.<br />
Dans le sang, le Bacille absorbe l’oxygène, d’où la couleur noire. L’animal s’asphyxie.<br />
De plus, le Bacille du charbon sécrète <strong>de</strong>s poisons, ou toxines, qui empoisonnent<br />
le mouton. Tout le corps est envahi par le microbe: le charbon est une<br />
septicémie.<br />
La contagion<br />
Pasteur démontra que la maladie pouvait se propager par <strong>de</strong>s aliments souillés. Il<br />
arrose <strong>de</strong> la luzerne avec une culture pure <strong>de</strong> bacilles charbonneux, mais ne constate<br />
que <strong>de</strong> très rares cas <strong>de</strong> charbon. Il mélange alors <strong>de</strong>s chardons et <strong>de</strong>s épis<br />
d’orge à la luzerne: presque tous les moutons sont atteints. Il faut donc que le<br />
microbe pénètre dans le sang. La peau et les muqueuses en bon état s’opposent au<br />
passage du bacille, d’où les échecs avec la luzerne seule.<br />
Un animal charbonneux enfoui dans un pré peut être la source <strong>de</strong> nombreux cas<br />
pendant <strong>de</strong>s années. En effet, les spores contenues dans le cadavre restent vivantes<br />
et les vers <strong>de</strong> terre les remontent à la surface avec leurs excréments. Ces <strong>de</strong>rniers se<br />
<strong>de</strong>ssèchent, et le vent entraîne les spores sur les herbes. Pasteur expliqua ainsi<br />
l’existence <strong>de</strong>s “champs maudits” où les animaux contractaient la maladie. Les éleveurs<br />
purent alors limiter l’extension d’une épidémie en brûlant les cadavres, en<br />
les recouvrant <strong>de</strong> chaux vive et en désinfectant les bergeries.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 121<br />
UN ASPECT DE LA MALADIE DU CHARBON<br />
CHEZ L'HOMME<br />
BACILLE DU CHARBON<br />
DANS LE SANG<br />
pustules<br />
malignes<br />
BACILLE DU CHARBON<br />
DONNANT <strong>DES</strong> SPORES<br />
OBTENTION D'UNE CULTURE PURE DE BACILLE DU CHARBON<br />
SELON LA MÉTHODE INVENTÉE PAR PASTEUR<br />
100e ballon
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 122<br />
11.2.2. La vaccination anticharbonneuse.<br />
Immunité et réceptivité.<br />
Pasteur s’aperçut que toutes les races <strong>de</strong> moutons n’étaient pas atteintes par la maladie<br />
du charbon. Ainsi le Mouton d’Algérie ne la contracte pas: on dit qu’il est immunisé,<br />
c’est-à-dire réfractaire à la maladie; c’est une immunité naturelle. L’animal la<br />
possè<strong>de</strong> dès sa naissance.<br />
Chez les Bovins, le charbon est souvent moins grave que chez le Mouton. Après leur<br />
guérison, les Vaches <strong>de</strong>viennent réfractaires à la maladie. L’injection d’une culture<br />
<strong>de</strong> bacilles du charbon est sans effet. Là encore, l’animal est immunisé, mais c’est<br />
une immunité acquise. D’ailleurs, cette immunité disparaît au bout d’un temps plus<br />
ou moins long, et les vaches re<strong>de</strong>viennent réceptives. On dit qu’un animal est en état<br />
<strong>de</strong> réceptivité vis-à-vis d’une maladie quand il peut la contracter (la recevoir). Cette<br />
observation allait avoir une importance capitale. Un animal pouvait donc acquérir<br />
une immunité temporaire. Mais comment la faire apparaître à volonté et sans danger?<br />
Le choléra <strong>de</strong>s Poules<br />
Le choléra <strong>de</strong>s Poules, caractérisé par une diarrhée abondante, est une maladie souvent<br />
mortelle. Elle est provoquée par un Microcoque. Vers 1880, Pasteur entretenait<br />
dans son laboratoire une culture pure <strong>de</strong> ce microbe. Il en vérifiait la virulence, c’està-dire<br />
l’activité pathogène, en l’inoculant à <strong>de</strong>s poules. Or il s’aperçut, qu’une culture<br />
vieille rendait simplement les poules mala<strong>de</strong>s, mais ne les tuait pas. La virulence<br />
<strong>de</strong> cette culture était atténuée par le vieillissement (on dit culture atténuée, sousentendu:<br />
à virulence atténuée).<br />
Une culture fraîche et virulente <strong>de</strong> Microcoque du choléra injectée aux poules qui<br />
avaient supporté la culture atténuée ne provoquait aucun trouble: les animaux étaient<br />
immunisés, et cette immunité acquise pouvait être conférée (donnée) à volonté. Le<br />
principe du vaccin était découvert: on fait contracter à un animal, sous une forme bénigne, la<br />
maladie contre laquelle on veut l’immuniser. Pour cela on réalise une culture à virulence<br />
atténuée.<br />
Le vaccin anticharbonneux<br />
Pasteur appliqua au Bacille du charbon la même métho<strong>de</strong> qu’au Microcoque du<br />
choléra <strong>de</strong>s Poules. Il laissa vieillir une culture à la température habituelle <strong>de</strong> 37°C.<br />
Dans ces conditions, le Bacille, quand la culture vieillit, forme <strong>de</strong>s spores qui conservent<br />
toute leur virulence. On ne peut donc appliquer le procédé du vieillissement<br />
pour atténuer la culture.<br />
Une autre observation mit Pasteur sur la bonne voie. Les Poules sont réfractaires à la<br />
maladie du charbon: c’est une immunité naturelle. Leur température normale est <strong>de</strong><br />
42°C. Si l’on abaisse cette température à 37° en les plongeant dans <strong>de</strong> l’eau, les Poules<br />
contractent le charbon et meurent.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 123<br />
PASTEUR ET LE CHOLÉRA <strong>DES</strong> POULES<br />
42,5 °C
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 124<br />
Deux choses ont pu se modifier:<br />
a) Les défenses naturelles <strong>de</strong> l’animal ont été amoindries.<br />
b) La virulence du Bacille est plus gran<strong>de</strong> à 37 °C qu’à 42 °C.<br />
Mais alors, en chauffant une culture <strong>de</strong> Bacilles du charbon, ne peut-on l’atténuer?<br />
C’est ce que tenta Pasteur; il arriva aux résultats suivants. Une culture charbonneuse<br />
portée à 42,5°C est encore un peu virulente au bout d’une semaine, plus du tout au<br />
bout <strong>de</strong> trois semaines. Elle meurt au bout <strong>de</strong> six semaines sans avoir donné <strong>de</strong> spores.<br />
Il n’y a pas <strong>de</strong> toxine dans le milieu. La technique <strong>de</strong> la vaccination<br />
anticharbonneuse est la suivante:<br />
• On injecte d’abord, à l’ai<strong>de</strong> d’une seringue, une culture chauffée pendant trois<br />
semaines à 42,5 °C, donc <strong>de</strong> virulence très atténuée et ne provoquant aucun trouble;<br />
• Douze jours plus tard, on injecte une culture chauffée pendant une semaine à 42,5°C,<br />
donc moins atténuée (introduite en premier, elle aurait fortement incommodé l’animal).<br />
L’immunité est acquise une douzaine <strong>de</strong> jours plus tard. Elle se maintient environ un<br />
an. En 1881, Pasteur réalisa cette expérience sur 25 moutons à Pouilly-le-Fort, près <strong>de</strong><br />
Melun, en Seine-et-Marne. Douze jours après la secon<strong>de</strong> injection <strong>de</strong> culture atténuée,<br />
il inocula une triple dose mortelle à ces 25 moutons et à 25 moutons témoins<br />
non vaccinés. Ces <strong>de</strong>rniers moururent tous. Les 25 moutons vaccinés ne furent même<br />
pas mala<strong>de</strong>s.<br />
Ces expériences <strong>de</strong> Pasteur, et en particulier celle <strong>de</strong> Pouilly-le-Fort, eurent un immense<br />
retentissement dans le mon<strong>de</strong>; une nouvelle métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> lutte contre les maladies<br />
microbiennes était trouvée: on prévenait le mal au lieu <strong>de</strong> le guérir.<br />
Pouilly-le-Fort (1881)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 125<br />
11.2.3. L’APPLICATION DU TRAITEMENT PASTORIEN À L’HOMME:<br />
LA VACCINATION CONTRE LA RAGE<br />
Après l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la maladie du charbon, Pasteur se tourna vers celle <strong>de</strong> la rage (encore<br />
appelée hydrophobie à l’époque). Il rechercha vainement le microbe <strong>de</strong> la rage<br />
dans la bave ou le sang <strong>de</strong>s chiens enragés. Il découvrit cependant les localisations<br />
du virus rabique dans les sécrétions buccales et surtout dans les centres nerveux <strong>de</strong>s<br />
animaux atteints. Il montra que le virus se cultive facilement dans les centres nerveux.<br />
Le virus fixe<br />
Pasteur l’obtint très virulent au moyen <strong>de</strong> passages successifs par inoculation directe<br />
dans le cerveau <strong>de</strong> lapins trépanés. Le virus prélevé sur un premier lapin enragé<br />
sert à inoculer le <strong>de</strong>uxième encore sain, <strong>de</strong> celui-ci on passe à un troisième animal,<br />
etc. Après une centaine <strong>de</strong> passages successifs, l’incubation prend une durée<br />
constante <strong>de</strong> 6 à 7 jours, le virus ne s’exalte plus, il est <strong>de</strong>venu fixe, on peut donc<br />
essayer plus sûrement son atténuation.<br />
moelle<br />
<strong>de</strong>sséchée<br />
potasse<br />
Dessication <strong>de</strong> moelle <strong>de</strong> lapin<br />
enragé.<br />
L’atténuation du virus fut obtenue conformément<br />
aux métho<strong>de</strong>s générales. Pasteur <strong>de</strong>scendit l’échelle<br />
<strong>de</strong> virulence du germe <strong>de</strong> la rage en faisant vieillir<br />
<strong>de</strong>s fragments <strong>de</strong> moelle rabique, en même temps<br />
<strong>de</strong>sséchée (dans l’atmosphère d’un flacon maintenu<br />
à 23° et muni <strong>de</strong> potasse caustique, avi<strong>de</strong> <strong>de</strong> vapeur<br />
d’eau). La <strong>de</strong>ssiccation progresse avec le<br />
vieillissement, et après une quinzaine <strong>de</strong> jours, la<br />
moelle est inoffensive, elle peut servir <strong>de</strong> vaccin.<br />
Vaccination <strong>de</strong>s chiens<br />
Pasteur appliqua d’abord ce vaccin aux chiens. Les inoculations sous-épi<strong>de</strong>rmiques<br />
furent pratiquées tous les jours avec <strong>de</strong>s suspensions dans l’eau <strong>de</strong> moelle <strong>de</strong> moins<br />
en moins vieille. Le premier jour, on utilisait la culture <strong>de</strong> quatorze jours, puis celle<br />
<strong>de</strong> treize... et ainsi jusqu’aux moelles plus fraîches, donc plus virulentes, <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
jours. Les chiens vaccinés exposés dans <strong>de</strong>s cages aux morsures <strong>de</strong> leurs congénères<br />
enragés ne prirent jamais la maladie, et le traitement permettait d’éviter l’éclosion<br />
<strong>de</strong> la rage chez <strong>de</strong>s chiens mordus contaminés.<br />
Vaccination <strong>de</strong> l’Homme<br />
Une commission scientifique suivait les expériences <strong>de</strong> vaccination et en contrôlait<br />
les bons effets. Pasteur cependant n’avait pas encore essayé son vaccin sur l’Homme.<br />
Il écrivait en mars 1885: “Je n’ai pas encore osé traiter <strong>de</strong>s hommes après morsure par chien
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 126<br />
rabique... J’ai gran<strong>de</strong> envie <strong>de</strong> commencer par moi, c’est-à-dire <strong>de</strong> m’inoculer la rage pour en<br />
arrêter les effets, tant je commence à m’aguerrir et à être sûr <strong>de</strong> mes résultats.”<br />
Les circonstances l’obligèrent à vaincre ses hésitations.<br />
Peu <strong>de</strong> temps après, le 6 juillet 1885, un petit Alsacien <strong>de</strong> neuf ans, <strong>Jos</strong>eph Meister,<br />
durement mordu par un chien enragé qui lui avait fait quatorze blessures, fut confié<br />
aux soins <strong>de</strong> Pasteur. Plusieurs célèbres mé<strong>de</strong>cins l’encouragèrent à faire vacciner le<br />
jeune Meister, et cet enfant reçut la série d’inoculations qui lui sauvèrent la vie. 50<br />
En octobre 1885, le berger Jupille, âgé <strong>de</strong> quinze ans, bénéficiait du même traitement<br />
sauveur après avoir été mordu au cours d’une lutte où il parvint à étrangler un chien<br />
enragé qui se précipitait sur un groupe <strong>de</strong> ses camara<strong>de</strong>s.<br />
Peu à peu, le mon<strong>de</strong> apprit les merveilles du traitement antirabique; <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s<br />
arrivèrent à Paris, d’Amérique, <strong>de</strong> Russie, etc. En mars 1886, Pasteur avait déjà soigné<br />
350 personnes, une seule mourut parce qu’elle avait été inoculée trop tard. L’Académie<br />
<strong>de</strong>s Sciences adopta alors un projet “d’établissement vaccinal contre la rage”.<br />
Une souscription permit <strong>de</strong> l’élever à Paris sous le nom d’«Institut Pasteur». Des<br />
établissements semblables furent ensuite créés dans certaines gran<strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> France<br />
et <strong>de</strong> l’étranger.<br />
6 juillet 1885:<br />
La première vaccination antirabique<br />
sur le jeune <strong>Jos</strong>eph Meister.<br />
Le Dr Grancher inocule le<br />
vaccin;<br />
Pasteur se tient à côté.<br />
Jacques-<strong>Jos</strong>eph GRANCHER<br />
(1843-1907<br />
50 Pasteur n’est pas mé<strong>de</strong>cin. C’est le Dr Jacques-<strong>Jos</strong>eph Grancher (1843-1907) qui vaccina Meister.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 127<br />
Ce lundi 6 juillet 1885, la femme du boulanger<br />
<strong>de</strong> Steige (Bas-Rhin), Angélique Meister, se présente<br />
au laboratoire <strong>de</strong> Pasteur, rue d’Ulm, accompagnée<br />
<strong>de</strong> son fils <strong>Jos</strong>eph âgé <strong>de</strong> 9 ans et<br />
<strong>de</strong> Théodore Vonne, épicier aubergiste au village<br />
voisin <strong>de</strong> Meissengott.<br />
Quarante-huit heures plus tôt, le chien enragé<br />
<strong>de</strong> Théodore Vonne a légèrement mordu son<br />
maître et très cruellement le petit <strong>Jos</strong>eph. Pasteur<br />
va-t-il pouvoir les traiter et les protéger<br />
contre la rage, comme il l’a déjà fait à <strong>de</strong>s<br />
chiens?<br />
Reportons-nous au samedi précé<strong>de</strong>nt. Ce 4<br />
juillet, <strong>Jos</strong>eph Meister, fils du boulanger <strong>de</strong><br />
Steige, va, comme il le fait régulièrement à la<br />
brasserie Witz à Meissengott distante <strong>de</strong> quelques<br />
kilomètres, chercher <strong>de</strong> la levure. Arrivé<br />
au village, il est agressé par le chien <strong>de</strong> l’épicier<br />
qui le mord aux jambes et au bras droit en<br />
14 endroits différents. Vonne accourt, est mordu<br />
à son tour, mais très légèrement à travers ses<br />
vêtements. Avec la mère <strong>de</strong> <strong>Jos</strong>eph prévenue<br />
aussitôt, ils se ren<strong>de</strong>nt tous les trois chez le Dr<br />
Weber, mé<strong>de</strong>cin exerçant à Villé. Celui-ci désinfecte<br />
à l’aci<strong>de</strong> phénique les plaies <strong>de</strong> <strong>Jos</strong>eph,<br />
mais <strong>de</strong>vant la gravité et le nombre <strong>de</strong>s blessures,<br />
il laisse peu d’espoir à la maman. La rage<br />
est malheureusement fréquente en Alsace et<br />
l’on en sait bien les conséquences, aussi conseille-t-il<br />
d’aller à Paris consulter Pasteur: il connaît<br />
en effet le succès <strong>de</strong> son traitement <strong>de</strong> vaccination<br />
antirabique et il espère qu’il pourra<br />
l’appliquer à <strong>Jos</strong>eph.<br />
Pasteur qui n’a traité que <strong>de</strong>s chiens, n’est pas<br />
mé<strong>de</strong>cin et hésite à passer à l’homme, mais il<br />
considère <strong>Jos</strong>eph comme perdu; aussi prend-il<br />
l’avis <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux éminents collègues: d’une part,<br />
le Dr A. Vulpian <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong>s Sciences<br />
qui, en qualité <strong>de</strong> membre <strong>de</strong> la Commission<br />
ministérielle <strong>de</strong> la Rage, a bien suivi ses travaux,<br />
et d’autres part le Dr J. Grancher, professeur<br />
et pédiatre réputé. Ces <strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins le<br />
LECTURE<br />
LES PREMIÈRES VACCINATIONS.<br />
par R. Rosset<br />
confortent dans sa décision et dès 8 heures, le<br />
soir même, Grancher commence avec son nouveau<br />
vaccin, à traiter <strong>Jos</strong>eph, hébergé avec sa<br />
mère à l’annexe Rollin du laboratoire <strong>de</strong> Pasteur.<br />
Vonne n’est pas traité, et renvoyé, car il<br />
ne présente pas <strong>de</strong> blessure réelle. Les inoculations<br />
sont poursuivies pendant 10 jours avec le<br />
succès que l’on sait.<br />
Pasteur entretiendra avec le petit Alsacien une<br />
correspondance affectueuse et paternelle. Il suivra<br />
l’évolution <strong>de</strong> sa santé avec une gran<strong>de</strong> attention.<br />
<strong>Jos</strong>eph Meister sera par la suite engagé<br />
à l’Institut Pasteur en qualité <strong>de</strong> gardien et ce,<br />
jusqu’en mars 1940, date à laquelle il se suici<strong>de</strong>ra<br />
lors <strong>de</strong> l’entrée <strong>de</strong>s Allemands à Paris.<br />
Le second vacciné, Jean-Baptiste Jupille, berger<br />
<strong>de</strong> 14 ans <strong>de</strong> Villers-Farlay (Jura), sera sauvé<br />
par un traitement entrepris le 20 octobre. Il sera<br />
lui aussi employé à l’lnstitut Pasteur en qualité<br />
<strong>de</strong> concierge. Sa renommée sera plus gran<strong>de</strong><br />
que celle <strong>de</strong> Meister qui restera très effacé et le<br />
public confondra souvent les <strong>de</strong>ux hommes. En<br />
effet, les conditions dans lesquelles il fut blessé<br />
(lors d’un combat avec un chien enragé entrepris<br />
pour protéger ses jeunes camara<strong>de</strong>s) lui<br />
valurent immédiatement une gran<strong>de</strong> célébrité.<br />
Une statue en bronze, oeuvre du sculpteur E.L.<br />
Truffot, fut érigée en son honneur et placée dans<br />
le jardin <strong>de</strong> l’Institut, près <strong>de</strong> sa loge. Portant<br />
un bel uniforme, il fut souvent photographié<br />
par les visiteurs et les journalistes. 51<br />
D’autres vaccinés plus ou moins célèbres suivront<br />
et parmi ceux-ci notamment les “russes<br />
<strong>de</strong> Smolensk” mordus par un loup enragé. Leur<br />
long voyage, leur tenue originale et le succès<br />
du traitement leur valurent d’apparaître dans<br />
maints reportages.<br />
(Article publié dans l’ouvrage: Pasteur et la rage. Informations<br />
techniques <strong>de</strong>s services vétérinaires, Nos 92-<br />
95. Paris, 1985)<br />
51 <strong>Jos</strong>eph Meister est né en 1876, mort en 1940; Jean-Baptiste Jupille est né en 1869, mort en 1923. En<br />
1919, après la première guerre mondiale, le village <strong>de</strong> Meissengott reprit son nom traditionnel <strong>de</strong><br />
Maisonsgoutte et c’est ainsi qu’on doit le désigner aujourd’hui.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 128<br />
12. LES AUTRES PROGRÈS DE LA MICRO-BIOLOGIE<br />
AU 19 e SIÈCLE<br />
Les travaux <strong>de</strong> Robert Koch<br />
À côté <strong>de</strong> Pasteur, la microbiologie du 19e siècle est dominée par le mé<strong>de</strong>cin allemand<br />
Robert Koch (1843-1910).<br />
• Tout comme Pasteur, il a étudié la maladie du charbon. Il arrive à cultiver le Bacille<br />
du charbon (Bacillus anthracis) et à démontrer qu’il est l’agent <strong>de</strong> la maladie du<br />
charbon (1876).<br />
• En, 1882, il découvre le Bacille <strong>de</strong> la tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), une<br />
découverte sensationnelle à une époque où cette maladie fait <strong>de</strong>s ravages. Le bacille<br />
a été appelé Bacille <strong>de</strong> Koch en l’honneur <strong>de</strong> son découvreur.<br />
• En 1883/84, Koch étudie le choléra en Égypte et en In<strong>de</strong> et démontre que cette<br />
redoutable maladie est due à un bacille présent dans l’intestin <strong>de</strong>s cholériques.<br />
C’est la découverte du Vibrion du choléra (Vibrio cholerae) 52 dont Koch souligne la<br />
forme en virgule (Komma-Bazillus).<br />
En 1891, Koch pense avoir trouvé un moyen <strong>de</strong> lutte contre la tuberculose: la “tuberculine”,<br />
un extrait glycériné <strong>de</strong> culture du Bacille <strong>de</strong> la tuberculose. Mais, il n’en est<br />
rien! La tuberculine servira toutefois dans le diagnostic <strong>de</strong> la tuberculose (tuberculinodiagnostic,<br />
p. ex. par cuti-réaction).<br />
Robert KOCH<br />
(1843-1910)<br />
Bacilles <strong>de</strong> la tuberculose: <strong>de</strong> fins bâtonnets, souvent<br />
légèrement incurvés, <strong>de</strong>ssinés par Koch en 1882.<br />
52 Il faut remarquer qu’en 1854 le mé<strong>de</strong>cin italien Filippo Pacini (1812-1883) avait observé sous le<br />
microscope un “microbio colerigeno” présent dans la muqueuse <strong>de</strong> l’intestin grêle <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s cholériques.<br />
Il l’a représenté avec sa forme incurvée en virgule. Mais, sa découverte est tombée dans l’oubli,<br />
<strong>de</strong> sorte <strong>de</strong> Koch est entré dans l’histoire comme l’unique découvreur <strong>de</strong> l’agent du choléra.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 129<br />
Le Vibrion du choléra<br />
(Vibrio cholerae)<br />
découvert par Koch en 1883/84.<br />
Le triomphe du contagionnisme<br />
En mé<strong>de</strong>cine, les travaux <strong>de</strong> Pasteur et <strong>de</strong> Koch consacrent le triomphe du<br />
contagionnisme sur les théories localistes telle que la “Bo<strong>de</strong>ntheorie” (théorie du sol) <strong>de</strong><br />
l’hygiéniste Max von Pettenkofer (1818-1901). Pour ce <strong>de</strong>rnier les micro-organismes<br />
sont incapables <strong>de</strong> provoquer une maladie par passage direct d’un organisme à<br />
un autre. Pour <strong>de</strong>venir infectieux, ils doivent passer d’abord par le sol; c’est là qu’ils<br />
acquièrent leur pouvoir pathogène ou non, selon la nature du sol. Dans ce processus<br />
le niveau <strong>de</strong> la nappe phréatique semble jouer un rôle important, mais l’eau potable,<br />
elle, est sans importance.<br />
En 1892, l’année <strong>de</strong> l’épidémie <strong>de</strong> choléra à Hambourg, Pettenkofer entreprend une<br />
auto-expérience pour démontrer l’innocuité <strong>de</strong>s vibrions du choléra n’ayant pas été<br />
en contact avec le sol. En présence <strong>de</strong> témoins, il avale une culture pure <strong>de</strong> vibrions.<br />
Par bonheur, il ne <strong>de</strong>vient que faiblement mala<strong>de</strong>. Ceci s’explique probablement par<br />
le fait qu’en 1854 Pettenkofer avait déjà été atteint d’une forme légère <strong>de</strong> choléra; <strong>de</strong><br />
plus Koch lui avait envoyé une culture peu virulente pour cette expérience pleine <strong>de</strong><br />
risques.<br />
Max von PETTENKOFER<br />
(1818-1901)<br />
L'une <strong>de</strong>s préparations microscopiques <strong>de</strong> Pacini (29<br />
août 1854) avec en-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins exécutés par<br />
Pacini en 1855 et montrant <strong>de</strong>s bactéries en forme <strong>de</strong><br />
virgule.<br />
Filippo PACINI<br />
(1812-1883)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 130<br />
13. DE LA SYSTÉMATIQUE À L’IDÉE<br />
DE L’ÉVOLUTION *)<br />
Au 18e siècle, au «siècle <strong>de</strong>s lumières», <strong>de</strong>s philosophes et savants à l’esprit indépendant<br />
ont réagi contre les excès <strong>de</strong> la théologie pour tenter <strong>de</strong> faire triompher le rationalisme<br />
et <strong>de</strong> lutter contre la scolastique, le merveilleux et la superstition. C’est la<br />
pério<strong>de</strong> où la biologie a commencé à <strong>de</strong>venir une science expérimentale, notamment<br />
dans la secon<strong>de</strong> moitié du siècle qui, à beaucoup d’égards, annonce déjà les découvertes<br />
du 19e siècle.<br />
Mais au cours <strong>de</strong> ce 18e siècle, s’est également poursuivie l’oeuvre <strong>de</strong>s naturalistes<br />
<strong>de</strong>scripteurs, dont les noms les plus illustres sont ceux <strong>de</strong> Linné et Buffon, ainsi que<br />
celle <strong>de</strong>s anatomistes. C’est <strong>de</strong> la double approche à la fois taxonomique et biologique<br />
<strong>de</strong>s êtres vivants que naîtra dès la fin du 18e siècle la conception transformiste qui<br />
mènera à la théorie <strong>de</strong> l’évolution.<br />
13.1. Carl Linné : le père <strong>de</strong> la systématique et <strong>de</strong><br />
la nomenclature binominale<br />
Carl (von) Linné (1707-1778) était un Suédois d’origine très mo<strong>de</strong>ste; il étudia la<br />
mé<strong>de</strong>cine et les sciences naturelles (surtout la botanique) aux Universités <strong>de</strong> Lund et<br />
d’Uppsala, fit un voyage en Laponie (1732), puis poursuivit ses étu<strong>de</strong>s aux Pays-Bas<br />
où il obtint en 1735 le titre <strong>de</strong> docteur en mé<strong>de</strong>cine. Il publia la même année la première<br />
édition <strong>de</strong> son Systema naturae qui <strong>de</strong>vait immortaliser son nom, puis ses<br />
Fundamenta botanica (1736). En 1741, il fut nommé professeur <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> botanique<br />
à l’Université d’Uppsala où il <strong>de</strong>meura jusqu’à<br />
sa mort.<br />
Carl von Linné (1707-1778)<br />
*) Texte largement inspiré <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Théodoridès (PUF, 1995).<br />
Linné fut avant tout un classificateur <strong>de</strong>s espèces<br />
animales et végétales connues à son époque qu’il<br />
entreprit <strong>de</strong> nommer en latin. C’est lui qui adopta<br />
le premier la nomenclature binaire ou binominale consistant<br />
à désigner chaque être vivant par un double<br />
nom, le premier correspondant au genre, le second<br />
à l’espèce (exemples: Phaseolus vulgaris, le Haricot;<br />
Canis lupus, le Loup). Avant Linné, chaque espèce<br />
était définie par une diagnose ayant parfois plusieurs<br />
lignes dont on conçoit toute l’incommodité.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 131<br />
Systema naturae,<br />
1ère édition (1735)<br />
Systema naturae,<br />
2e édition (1740)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 132<br />
C’est dans son ouvrage “Species plantarum” (1753, 2 vol.) que Linné a pour la première<br />
fois appliqué <strong>de</strong> manière uniforme et conséquente son système binominal,<br />
alors que dans ses ouvrages antérieurs il n’avait pas encore élevé la pratique du<br />
binôme au rang <strong>de</strong> règle générale, se servant parfois <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mots parfois <strong>de</strong> plusieurs<br />
pour désigner une espèce.<br />
Linné prit comme base <strong>de</strong> son système <strong>de</strong> classification en botanique les organes sexuels<br />
<strong>de</strong>s plantes — les étamines et le pistil. Certains <strong>de</strong> ses contemporains furent offusqués<br />
par cette sexualité qui imprégnait la classification <strong>de</strong> Linné. En 1808, longtemps après<br />
la mort du savant suédois, un certain Samuel Goo<strong>de</strong>nough — qui <strong>de</strong>vait <strong>de</strong>venir plus<br />
tard évêque <strong>de</strong> Carlisle — écrit dans une lettre adressée à J.E. Smith, scientifique acquis<br />
aux conceptions <strong>de</strong> Linné et fondateur <strong>de</strong> la “Linnean Society” <strong>de</strong> Londres : “Vous<br />
dire que rien ne peut égaler l’esprit <strong>de</strong> luxure <strong>de</strong> Linné me paraît tout à fait inutile.” Car “une<br />
traduction littérale <strong>de</strong>s premiers principes botaniques <strong>de</strong> Linné suffit a choquer la pu<strong>de</strong>ur féminine.<br />
Il est fort probable que bien <strong>de</strong>s étudiants vertueux puissent ne jamais comprendre quel<br />
rapprochement suggère le nom générique <strong>de</strong> Clitoria.” Que <strong>de</strong>s Tartufes soient choqués<br />
d’une classification qui souligne la sexualité <strong>de</strong>s plantes n’est guère surprenant, mais<br />
il est plus inattendu que Goethe lui-même, le génial père littéraire <strong>de</strong> Faust et néanmoins<br />
naturaliste amateur chevronné, ait dû s’inquiéter, en 1820, pour les “âmes chastes<br />
<strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>s jeunes gens” qui auraient pu être embarrassées à la lecture <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s présentant “le dogme <strong>de</strong> la sexualité” <strong>de</strong>s plantes...<br />
Tout en rapprochant dans un même genre les espèces qui avaient entre elles suffisamment<br />
<strong>de</strong> ressemblances, Linné, dans ses premiers écrits fut résolument fixiste,<br />
ne concevant pas que ces espèces puissent dériver l’une <strong>de</strong> l’autre.<br />
Pour Linné, fidèle à la tradition biblique, chacune d’elles s’était maintenue i<strong>de</strong>ntique<br />
<strong>de</strong>puis la Création: Species tot sunt diversae quot diversas formas ab initio creavit infinitum<br />
ens.<br />
Cependant, à partir <strong>de</strong> 1742, ayant observé <strong>de</strong>s «variations» chez certaines plantes<br />
(nous dirions aujourd’hui <strong>de</strong>s mutations), Linné sera conduit à réviser ses conceptions<br />
initiales et à remplacer son farouche immutabilisme par une sorte <strong>de</strong> transformisme<br />
restreint. Il concevra alors l’immutabilité du genre, tandis que les espèces<br />
pourraient se modifier par hybridation et sous l’influence du milieu.<br />
Bien qu’étant surtout botaniste, Linné a également donné une nouvelle classification<br />
<strong>de</strong>s animaux dans son Systema naturae. Il a créé l’embranchement <strong>de</strong>s Mammalia<br />
(Mammifères) dans lequel il a placé les Cétacés et a classé l’espèce humaine avec les<br />
singes dans l’ordre <strong>de</strong>s Primates conservé encore dans la systématique actuelle<br />
De plus, Linné a employé pour la première fois les termes <strong>de</strong> “flore” et “faune” pour<br />
désigner le peuplement végétal et animal d’une région ou d’un pays et c’est un <strong>de</strong>s<br />
fondateurs <strong>de</strong> l’écologie et <strong>de</strong> la biogéographie par l’attention qu’il a accordée aux<br />
localités <strong>de</strong> récolte <strong>de</strong>s plantes et animaux et à l’influence <strong>de</strong>s conditions du milieu<br />
sur leur développement et leur répartition.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 133
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 134<br />
«Species plantarum» <strong>de</strong> Linné (1753), tome II, page 723.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 135<br />
Les classes du système sexuel <strong>de</strong> Linné<br />
A, 1. Monandria; B, 2. Diandria; C, 3. Triandria; D, 4. Tetrandria;<br />
E, 5. Pentandria; F, 6. Hexandria; G, 7 Heptandria; H, 8. Octandria;<br />
I, 9. Enneandria; K, 10. Decandria; L, 11. Do<strong>de</strong>candria; M, 12. Icosandria;<br />
N, 13. Polyandria; O,14. Didynamia; P, 15. Tetradynamia; Q, 16. Mona<strong>de</strong>lphia;<br />
R, 17. Dia<strong>de</strong>lphia; S, 18. Polya<strong>de</strong>lphia; T, 19. Syngenesia; U, 20. Gynandria;<br />
V, 21. Monoecia; X, 22. Dioecia; Y, 23. Polygamia; Z, 24. Cryptogamia.<br />
La planche explicative ci-<strong>de</strong>ssus a été exécutée en 1736 par le <strong>de</strong>ssinateur G.D. Ehret. Elle a<br />
été intégrée dans l’ouvrage «Genera plantarum» que Linné a publié en 1737. Le principe du<br />
système sexuel a été défini pour la première fois dans le «Systema naturae» en 1735.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 136
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 137<br />
13.2. Georges-Louis Leclerc, comte <strong>de</strong> Buffon (1707-1788),<br />
auteur <strong>de</strong> l’Histoire naturelle et critique <strong>de</strong> Linné<br />
Au contraire <strong>de</strong> Linné, Georges-Louis Leclerc, chevalier, puis comte <strong>de</strong> Buffon<br />
(1707-1788) était d’une famille noble et aisée. A la tête d’une importante fortune<br />
personnelle, il mena une vie <strong>de</strong> grand seigneur, partagée entre le Jardin du Roi à<br />
Paris dont il fut nommé intendant en 1739 et son domaine <strong>de</strong> Montbard en Bourgogne.<br />
Ses premiers travaux scientifiques lui valurent d’être admis à l’Académie <strong>de</strong>s Sciences<br />
dans la section <strong>de</strong> Mécanique dès 1733, mais c’est aux sciences naturelles et particulièrement<br />
à la zoologie, la géologie et la minéralogie que Buffon va désormais se<br />
consacrer entièrement, publiant une série d’ouvrages qui constitueront une Histoire<br />
naturelle en 44 volumes dont certains seront posthumes (1749-1804).<br />
Pour réaliser cette imposante somme <strong>de</strong> travail, Buffon s’assura la collaboration <strong>de</strong><br />
divers savants, dont l’anatomiste Louis Daubenton (1716-1800). Les <strong>de</strong>rniers volumes<br />
posthumes furent publiés par Lacépè<strong>de</strong> (1756-1825).<br />
Le contenu <strong>de</strong> cette vaste collection se répartit ainsi:<br />
1) Histoire naturelle générale et particulière (15 volumes: 1749-1767);<br />
2) Suppléments (7 volumes: 1774-1789);<br />
3) Histoire naturelle <strong>de</strong>s oiseaux (9 volumes: 1770-1783);<br />
4) Histoire naturelle <strong>de</strong>s minéraux (5 volumes et un atlas: 1783-1788);<br />
5) Ovipares, Serpents, Poissons, Cétacés par Lacepè<strong>de</strong> (8 volumes: 1788-1804).<br />
C’est en somme une Histoire naturelle complète du règne minéral et du règne animal<br />
à l’exclusion <strong>de</strong>s Invertébrés.<br />
On a reproché à Buffon sa partialité envers les naturalistes <strong>de</strong> son temps (il n’aimait<br />
pas Linné ni Réaumur), son style pompeux, son mépris pour les Invertébrés qu’il ne<br />
voulait pas s’abaisser à étudier, sa croyance à la génération spontanée qui marque<br />
un notable recul sur la pensée <strong>de</strong> son temps.<br />
Buffon (1707-1788)<br />
Il fut cependant un <strong>de</strong>s grands biologistes <strong>de</strong> son siècle<br />
et son influence sur ses contemporains et ses successeurs<br />
fut considérable. Malgré son côté <strong>de</strong>scriptif,<br />
Buffon se montre déjà un vrai biologiste. Comme l’écrit<br />
Jean Rostand:<br />
“Dans sa vaste enquête sur les espèces animales, il recueille<br />
soigneusement toutes les données concernant la proportion<br />
sexuelle, le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> fécondité, la durée <strong>de</strong> gestation, l’âge<br />
où commence et finit l’aptitu<strong>de</strong> à la reproduction, les possibilités<br />
<strong>de</strong> croisement, etc. Généticien avant la lettre, il comprend<br />
que seule l’expérimentation aura qualité pour éclairer<br />
la notion d’espèce, et il sait, à l’occasion retirer ses manchettes<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ntelle pour expérimenter lui-même sur l’animal.”
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 138<br />
De plus, Buffon a eu le grand mérite <strong>de</strong> considérer les phénomènes biologiques dans<br />
leur intégralité et la nature comme un tout. En cela, il a été certainement influencé<br />
par les idées <strong>de</strong> Leibniz et <strong>de</strong> Newton (dont il avait traduit un ouvrage dans sa<br />
jeunesse). Frappé par les lois gouvernant l’Univers, à la lumière <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières découvertes<br />
physiques et astronomiques, le Cosmos lui apparaît comme un imposant<br />
mécanisme soumis également à <strong>de</strong>s lois bien déterminées et dont le passé et le futur<br />
peuvent être calculés mathématiquement.<br />
Cette conception unitaire <strong>de</strong> la Nature chez Buffon l’amena à s’opposer vigoureusement<br />
au système <strong>de</strong> classification <strong>de</strong> Linné. Pour lui, les notions <strong>de</strong> famille, genre,<br />
espèce sont abstraites et arbitraires: “␣ La Nature n’a jamais rangé ses ouvrages par tas, ni<br />
les êtres par genre. Chaque espèce réclame une place isolée et doit avoir son portrait à part␣ ”,<br />
dit-il.<br />
Il considère qu’il n’y a pas <strong>de</strong> limite entre le règne végétal et le règne animal.<br />
Pour lui “le polype d’eau douce sera, si l’on veut, le <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>s animaux et la première<br />
<strong>de</strong>s plantes” (Des animaux). Plantes et animaux ont le même pouvoir <strong>de</strong> se reproduire<br />
i<strong>de</strong>ntiques à eux-mêmes et <strong>de</strong> croître. Pour Buffon, tout le règne animal<br />
dérive d’un certain nombre <strong>de</strong> types originels dont certains se sont maintenus<br />
sans changement jusqu’à l’époque actuelle, alors que d’autres ont “dégénérés”.<br />
Pour Buffon, la mutabilité d’une espèce, loin <strong>de</strong> marquer un progrès, un<br />
perfectionnement, est signe <strong>de</strong> dégradation, <strong>de</strong> déchéance.<br />
L’éléphant.<br />
Illustration tirée <strong>de</strong> l’Histoire naturelle<br />
<strong>de</strong> Buffon.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 139<br />
L’idée d’une variation progressive tirant le supérieur <strong>de</strong> l’inférieur, est donc étrangère<br />
à Buffon. Elle est même contraire à l’ensemble <strong>de</strong> sa philosophie naturelle.<br />
Faire dériver une espèce “noble” d’une espèce basse eût paru scandaleux à cet<br />
aristocrate <strong>de</strong> la biologie.<br />
Selon Buffon, les types originels (au nombre <strong>de</strong> 38) auraient apparu par génération<br />
spontanée (nous avons vu qu’il y croyait encore). Les êtres vivants auraient été formés<br />
à partir <strong>de</strong> “molécules organiques” distinctes <strong>de</strong> la matière ordinaire qui en se<br />
groupant d’une certaine façon auraient donné <strong>de</strong>s “moules primitifs” dont seraient<br />
issus à leur tour les animaux aquatiques (Crustacés, Mollusques à coquilles, Poissons)<br />
puis les animaux terrestres (Quadrupè<strong>de</strong>s et Oiseaux).<br />
Pour lui, il y aurait eu une succession <strong>de</strong> faunes mais sans filiation entre elles. Son<br />
transformisme est donc extrêmement limité. “Buffon ne soupçonne pas que les êtres<br />
vivants aient pu se modifier dans le sens d’une complexité toujours croissante (J. Rostand).<br />
“L’âne et le cheval sont-ils <strong>de</strong> la même famille, comme le veulent les nomenclateurs ? S’ils le<br />
sont vraiment, ne pourra-t-on dire également que l’homme et le singe ont eux aussi une<br />
origine commune?” Cette question provocatrice a amené certains auteurs mo<strong>de</strong>rnes<br />
à penser que Buffon était partisan du transformisme généralisé. En fait, il semble<br />
évi<strong>de</strong>nt que la question ne fait que traduire l’indignation <strong>de</strong> Buffon face à l’idée d’un<br />
transformisme généralisé.<br />
Jean Rostand a donc bien raison en écrivant : “Pour voir apparaître la gran<strong>de</strong> idée <strong>de</strong><br />
l’engendrement du complexe par le simple, du supérieur par l’inférieur, il faudra attendre<br />
Jean Lamarck.”
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 140<br />
Biologie<br />
14. OUVRAGES RECOMMANDÉS<br />
Buican, Denis (1994): Histoire <strong>de</strong> la biologie. Hérédité. Evolution. - Paris, Nathan Université, Collection<br />
128, No 66, 127 p.<br />
Jahn, Ilse (Hrsg.) (1998): Geschichte <strong>de</strong>r Biologie. Theorien, Metho<strong>de</strong>n, Institutionen, Kurzbiographien.<br />
3. Aufl. - Jena, VEB Gustav Fischer Verlag, 1088 p. [1. Aufl. 1982]<br />
Jahn, Ilse & M. Schmitt (Hrsg.) (2001): Darwin & Co. Eine Geschichte <strong>de</strong>r Biologie in Portraits, Bd. 1.<br />
- München, C.H. Beck, 552 p.<br />
Jahn, Ilse & M. Schmitt (Hrsg.) (2001): Darwin & Co. Eine Geschichte <strong>de</strong>r Biologie in Portraits, Bd. 2.<br />
- München, C.H. Beck, 574 p.<br />
Magner, Lois N. (1993): A History of the Life Sciences. 2nd ed. - New York, Marcel Dekker, 496 p.<br />
Rostand, Jean (1945): Esquisse d’une histoire <strong>de</strong> la biologie. - Paris, Editions Gallimard. [Cet excellent<br />
ouvrage a connu plusieurs éditions plus récentes, ex. Edition: Coll. Idées, No 64, 1964, 252 p.]<br />
Serafini, Anthony (1993): The epic of biology. - New York, Plenum Press, 395 p.<br />
Sutcliffe, J. & N. Duin (1992): A history of medicine. - New York, Barnes & Noble, 256 p.<br />
Théodoridès, Jean (1995): Histoire <strong>de</strong> la biologie. 6e édition. - Paris, Presses <strong>Universitaire</strong>s <strong>de</strong> France,<br />
127 p. (= Que sais-je?, 1).<br />
Vignais, Paul (2001): La Biologie, <strong>de</strong>s origines à nos jours. Une histoire <strong>de</strong>s idées et <strong>de</strong>s hommes. - Les<br />
Ulis, EDP Sciences, 478 p. (Coll. Grenoble Sciences).<br />
Mé<strong>de</strong>cine<br />
Dumaître, Paule (1977): Mé<strong>de</strong>cine et mé<strong>de</strong>cins. - Paris, Magnard, 173 p. [Excellente lecture, ouvrage<br />
épuisé].<br />
Magner, Lois N. (1993): A History of Medicine. - New York, Marcel Dekker, 393 p.<br />
Mochmann, H. & W. Köhler (1997): Meilensteine <strong>de</strong>r Bakteriologie. 2. Aufl. - Frankfurt a. Main, Edition<br />
Wötzel, 401 p.<br />
Nuland, S.B. (1994): Im Dienste <strong>de</strong>s Hippokrates: <strong>de</strong>r Fortschritt in <strong>de</strong>r Medizin. - München, Knaur,<br />
784 p. (Knaur 77053) (Originalausgabe: Doctors : the biography of medicine. New York, 1988).<br />
Reichardt, Hans (1980): Berühmte Ärzte. - Hamburg, Tessloff Verlag, 48 p. (= Was ist was?, Bd. 66).<br />
[Lecture agréable et facile.]<br />
Schott, Heinz (1993): Die Chronik <strong>de</strong>r Medizin. - Dortmund, Chronik Verlag, 648 p.<br />
Sournia, Jean-Charles (1992): Histoire <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine. - Paris, Editions <strong>de</strong> la Découverte, 358 p. (Coll.<br />
Histoire <strong>de</strong>s sciences) [autre édition: La Découverte Poche, 1997].<br />
Sciences en général<br />
Fischer, Ernst Peter (1996): Aristoteles & Co.: eine kleine Geschichte <strong>de</strong>r Wissenschaft in Porträts von<br />
<strong>de</strong>r Antike bis ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt. - München, Piper Verlag, 235 p. (= Serie Piper) [Bearbeitete<br />
Teilausgabe <strong>de</strong>s Buches «Aristoteles, Einstein & Co., Piper 1995]<br />
Fischer, Ernst Peter (1997): Einstein & Co.: eine kleine Geschichte <strong>de</strong>r Wissenschaft <strong>de</strong>r letzten hun<strong>de</strong>rt<br />
Jahre in Porträts. - München, Piper Verlag, 230 p. (= Serie Piper) [Bearbeitete Teilausgabe <strong>de</strong>s<br />
Buches «Aristoteles, Einstein & Co., Piper 1995]<br />
Meadows, Jack (1996): Les grands scientifiques: l'histoire <strong>de</strong> la science à travers les vies <strong>de</strong> douze<br />
savants célèbres. - Maxi-Livres Profrance, 256 p. (1ère éd. franç.: Armand Collin 1989) (édition<br />
orig.: Andromeda Oxford 1989, The great scientists.)<br />
Paturi, F.R. (1998): Harenberg Schlüsseldaten Ent<strong>de</strong>ckungen und Erfindungen. - Dortmund, Harenberg<br />
Lexikon Verlag, 752 p.<br />
Ronan, C. (1999): Histoire mondiale <strong>de</strong>s sciences. - Paris, Editions du Seuil, 715 p. (= Collection Points,<br />
S129) [Titre original: The Cambridge illustrated history of the world’s science. 1983].<br />
Serres, Michel (dir.) (1997: Eléments d’histoire <strong>de</strong>s sciences. - Paris, Larousse, 890 p. (= Larousse in<br />
extenso)<br />
Gribbin, J. (ed.) (1998): A brief history of science. - New York, Barnes & Noble, 224 p.<br />
Vidal, Bernard (1985): Histoire <strong>de</strong> la chimie. - Paris, Presses <strong>Universitaire</strong>s <strong>de</strong> France, 126 p. (= Que<br />
sais-je?, 35).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 141<br />
Aspects luxembourgeois<br />
Duhr, Emile (1989): La situation médicale et sanitaire au XIXe siècle. - in: M. Gerges (ed.): Mémorial<br />
1989. La Société luxembourgeoise <strong>de</strong> 1839 à 1989. Les Publications Mosellanes, Luxembourg:<br />
587-608.<br />
Kugener, Henri (1995): Die zivilen und militärischen Ärzte und Chirurgen in Luxemburg. - Luxemburg,<br />
Eigenverlag, 768 p.<br />
<strong>Massard</strong>, <strong>Jos</strong>. A. (1988): Echternach und die Cholera. Ein Beitrag zur Geschichte <strong>de</strong>r Medizin und <strong>de</strong>r<br />
öffentlichen Hygiene in Luxemburg. - Publications du <strong>Centre</strong> <strong>Universitaire</strong> <strong>de</strong> Luxembourg,<br />
Département <strong>de</strong>s Sciences: Biologie-Chimie-Physique, fasc. 1: 1-259.<br />
<strong>Massard</strong>, <strong>Jos</strong>. A. (1990): La Société <strong>de</strong>s Naturalistes Luxembourgeois du point <strong>de</strong> vue historique. -<br />
Bull. Soc. Nat. luxemb., 91 (1990): 5-214.<br />
<strong>Massard</strong>, <strong>Jos</strong>. A. (2000): Les origines <strong>de</strong> la Section <strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong> l’Institut grand-ducal. - in: Section<br />
<strong>de</strong>s Sciences naturelles, physiques et mathématiques, 1850-2000: Les sciences à l’aube du 21e<br />
siècle. Cycle <strong>de</strong> conférences du 12 octobre au 21 décembre 2000 au <strong>Centre</strong> <strong>Universitaire</strong> <strong>de</strong><br />
Luxembourg. Luxembourg: 10-20.<br />
Theves, Georges (1991): Le Luxembourg et ses vétérinaires. 1790-1990. - Luxembourg, Arts et Livres,<br />
310 p.<br />
Philosophie <strong>de</strong>s sciences<br />
Gjertsen, Derek (1992): Science and philosophy. Past and present. - London, Penguin Books, 296 p.<br />
[first published in Pelican Books, 1989].<br />
Janich, Peter (1997: Kleine Philosophie <strong>de</strong>r Naturwissenschaften. - München, C.H. Beck, 207 p.<br />
(Beck’sche Reihe, 1203).<br />
Jarrosson, Bruno (1992): Invitation à la philosophie <strong>de</strong>s sciences. - Paris, Editions du Seuil, 238 p.<br />
(Coll. Points, Série Sciences, No S74).
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 142
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 143<br />
centre <strong>Universitaire</strong> <strong>de</strong> Luxembourg<br />
Département <strong>de</strong>s Sciences<br />
<strong>HISTOIRE</strong> <strong>DES</strong> ScIEncES<br />
cours <strong>de</strong><br />
<strong>Jos</strong>. A. MASSARD<br />
DOcUMEnTS
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 144
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 145<br />
L’<strong>HISTOIRE</strong> <strong>DES</strong> ScIEncES,… à qUOI bOn ?<br />
Discours prononcé par <strong>Jos</strong>. A. <strong>Massard</strong> lors <strong>de</strong> la remise <strong>de</strong>s diplômes <strong>de</strong> fin<br />
d’étu<strong>de</strong>s aux élèves du Lycée classique d’Echternach en juillet 2000.<br />
Il y a quelques semaines j’ai <strong>de</strong>mandé à mes collègues professeurs d’histoire <strong>de</strong> me fournir<br />
une liste <strong>de</strong> cinq dates qui à leurs yeux sont à considérer comme particulièrement importantes<br />
dans l’histoire <strong>de</strong> l’humanité.<br />
L’une <strong>de</strong>s réponses, se plaçant dans le contexte <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s temps mo<strong>de</strong>rnes, relève les<br />
dates et les événements suivants:<br />
• 1776: — la Déclaration d’Indépendance <strong>de</strong>s Etats-Unis (elle marque les débuts d’une<br />
puissance mondiale);<br />
• 1789: — la Révolution Française (c’est la fin <strong>de</strong> l’Ancien Régime et <strong>de</strong> la société <strong>de</strong>s<br />
ordres, et c’est la déclaration <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’Homme);<br />
• 1917: — la Révolution Russe (c’est le début <strong>de</strong> l’ère communiste);<br />
• 1945: — avec <strong>de</strong>ux événements:<br />
1° la Conférence <strong>de</strong> Yalta et le partage <strong>de</strong> l’Europe;<br />
2° la fondation <strong>de</strong> l’ONU et la Charte <strong>de</strong> la Déclaration Universelle <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong><br />
l’Homme.<br />
• 1989: — la chute du mur <strong>de</strong> Berlin et la fin <strong>de</strong> l’ère soviétique.<br />
Une autre réponse épouse un point <strong>de</strong> vue tout à fait différent, ne s’orientant pas vers l’Histoire<br />
en tant que telle, mais vers l’histoire au sens <strong>de</strong> science <strong>de</strong> l’histoire = “Gechichtswissenschaft”,<br />
donc en rapport avec le travail <strong>de</strong> l’historien et l’évolution <strong>de</strong> ses métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
travail au cours <strong>de</strong>s temps.<br />
Voici ces dates-clés:<br />
• 5e siècle avant notre ère: — c’est la parution <strong>de</strong>s Histoires d’Hérodote, le premier<br />
ouvrage d’histoire, rédigé par celui que l’on a surnommé le père <strong>de</strong> l’histoire;<br />
• 1er siècle av. notre ère: — c’est l’introduction <strong>de</strong> l’écriture dans nos régions;<br />
• l’année 1198: — avec un décret du pape Innocent III rendant attentif aux moyens<br />
permettant <strong>de</strong> dépister <strong>de</strong>s documents faux;<br />
• 1681 — c’est la parution <strong>de</strong> l’ouvrage “De re diplomatica” <strong>de</strong> Jean Mabillon, énonçant<br />
les règles <strong>de</strong> l’interprétation critique <strong>de</strong>s documents.<br />
• 1826 — c’est l’année <strong>de</strong> la publication du 1er volume <strong>de</strong>s “Monumenta Germaniae<br />
Historica”, qui établit les principes fondamentaux <strong>de</strong> l’édition mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> sources<br />
historiques.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 146<br />
La troisième liste reçue considère comme particulièrement importantes dans l’histoire <strong>de</strong><br />
l’humanité les dates suivantes:<br />
• vers 1450 — Gutenberg, invente l’imprimerie à caractères mobiles;<br />
• 1519-1522 — premier tour du mon<strong>de</strong> par Magellan;<br />
• 1903 — les frères Wright et les débuts <strong>de</strong> l’aviation;<br />
• 1942 — Enrico Fermi jette les bases du premier réacteur nucléaire;<br />
• 1969 — Armstrong, le premier homme à marcher sur la lune, … après Tintin, ajouterais-je.<br />
On voit que selon le point <strong>de</strong> vue adopté, les réponses peuvent être tout à fait différentes.<br />
La <strong>de</strong>rnière liste m’arrange particulièrement bien parce qu’elle cite <strong>de</strong>s découvertes et <strong>de</strong>s<br />
inventions en relation avec le développement scientifique et technologique <strong>de</strong>s époques correspondantes.<br />
Elle établit ainsi le passage entre l’histoire classique et celle dont je voudrais<br />
vous parler dans mon discours d’aujourd’hui: l’histoire <strong>de</strong>s sciences.<br />
•<br />
C’est là une histoire souvent négligée à la fois par l’historien, — parce qu’elle présuppose<br />
<strong>de</strong>s connaissances qui souvent lui manquent —, et par le scientifique, — parce qu’elle exige<br />
une approche et <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s qui ne lui sont pas familières, ou même parce que tout simplement<br />
il n’en voit pas l’intérêt.<br />
Ainsi, le chimiste mo<strong>de</strong>rne peut très bien ignorer tout ou presque du développement historique<br />
<strong>de</strong> sa science, cela ne le gênera aucunement dans son travail. C’est bien entendu vrai<br />
aussi pour le physicien, le mathématicien, le biologiste ou le mé<strong>de</strong>cin.<br />
Et on constate que nos livres <strong>de</strong> sciences n’ont que trop souvent tendance à négliger le<br />
contexte historique.<br />
Prenons le cas suivant.:<br />
•<br />
Dans le temps, nous autres biologistes avons introduit la génétique par les expériences classiques<br />
que le moine autrichien Gregor MENDEL a réalisées au 19e siècle. C’était concret,<br />
simple, logique, et même captivant par son côté anecdotique.<br />
Mais, les choses ont bien changé!<br />
Ainsi, dans un article publié en 1993 dans “Les Cahiers <strong>de</strong> Science et Vie”, un enseignant,<br />
regrette, en parlant <strong>de</strong> MENDEL et <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> la génétique, que les nouveaux<br />
programmes français <strong>de</strong> la classe terminale ont imposé une autre présentation <strong>de</strong> la génétique<br />
classique (Rumelhard 1993):<br />
“Désormais, pour introduire au cas <strong>de</strong>s mammifères et <strong>de</strong> l’Homme, l’exposé ne commence plus par<br />
celui <strong>de</strong>s végétaux ou <strong>de</strong>s drosophiles, mais par celui <strong>de</strong>s champignons microscopiques. Cette modification,<br />
qui peut sembler mineure, véhicule en fait une conception différente <strong>de</strong> la façon dont les<br />
découvertes scientifiques se font.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 147<br />
«Le manuel <strong>de</strong> terminale D <strong>de</strong> Nathan mentionne encore Men<strong>de</strong>l comme un nom et une date sur un<br />
tableau. Les autres ouvrages ne le mentionnent même plus!”<br />
L’auteur s’insurge contre le fait que la génétique est introduite par une expérience d’hybridation<br />
réalisée chez la moisissure haploï<strong>de</strong> Sordaria et dont l’interprétation doit avoir recours<br />
à l’observation <strong>de</strong> la répartition <strong>de</strong>s spores dans les asques, <strong>de</strong>s sortes <strong>de</strong> sacs où elles se<br />
forment.<br />
Pas content du tout l’auteur <strong>de</strong> l’article <strong>de</strong> “Science et Vie” insiste que “l’enseignement scientifique<br />
ne doit pas se limiter à un exposé <strong>de</strong> faits et <strong>de</strong> résultats. Il doit également mettre en valeur les<br />
barrières culturelles qui ont jalonné le parcours du savant.”<br />
•<br />
Cette approche qui favorise l’histoire <strong>de</strong>s sciences est en fait celle <strong>de</strong> bon nombre d’enseignants.<br />
Qu’il s’agisse <strong>de</strong> biologistes ou d’autres scientifiques, la réflexion <strong>de</strong> fond et les arguments<br />
qui en découlent restent les mêmes. Ainsi le physicien français Jean SIVARDIèRE a proposé<br />
en 1994 dans le “Bulletin <strong>de</strong> l’Union <strong>de</strong>s Physiciens” les arguments suivants en faveur <strong>de</strong> l’apprentissage<br />
<strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la physique en licence (Sivardière 1994):<br />
1° l’acquisition <strong>de</strong> points <strong>de</strong> repères historiques facilite la compréhension et la mémorisation<br />
<strong>de</strong>s phénomènes et <strong>de</strong>s théories physiques par les étudiants;<br />
2° l’approche historique permet <strong>de</strong> montrer que la science n’est pas une construction<br />
statique, qu’elle se développe dans le temps;<br />
3° l’approche historique permet <strong>de</strong> comprendre selon quelles métho<strong>de</strong>s s’élabore la<br />
connaissance scientifique.<br />
SIVARDIèRE conclut en citant <strong>de</strong> Broglie que “l’histoire <strong>de</strong> la science est un excellent moyen<br />
d’enseigner la science”. Il insiste qu’il ne s’agit pas <strong>de</strong> présenter une histoire événementielle<br />
juxtaposant les “vies édifiantes” <strong>de</strong> quelques “grands savants”, ou <strong>de</strong> faire preuve d’érudition<br />
en accumulant noms, dates et lieux <strong>de</strong> naissance ou <strong>de</strong> découverte, citations et anecdotes plus<br />
ou moins authentiques, mais <strong>de</strong> mettre l’accent sur l’évolution <strong>de</strong>s idées.<br />
Ce qui est vrai pour l’histoire <strong>de</strong> la physique au niveau <strong>de</strong> l’enseignement universitaire, est<br />
également valable au niveau du secondaire, où les programmes français recomman<strong>de</strong>nt<br />
d’inclure “la dimension historique <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s idées en physique” et <strong>de</strong> “développer chez<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s élèves les éléments d’une culture scientifique” (Hulin 1996). Ces vues s’appliquent<br />
mutatis mutandis aussi à l’enseignement <strong>de</strong> la biologie, <strong>de</strong> la chimie et, pourquoi pas aussi,<br />
<strong>de</strong>s mathématiques.<br />
•<br />
Dans un article sur le rôle <strong>de</strong> l’histoire dans l’enseignement <strong>de</strong>s sciences, Robert M. HEN-<br />
DRICk, professeur d’histoire à l’université <strong>de</strong> Jamaica (NY), plai<strong>de</strong> pour l’introduction <strong>de</strong><br />
l’histoire dans l’enseignement <strong>de</strong>s sciences et souligne son point <strong>de</strong> vue par la citation suivante<br />
empruntée à un rapport publié en 1990 par l’«American Association for the Advancement<br />
of Science » (Hendrick 1992):<br />
“During their school years, stu<strong>de</strong>nts should encounter many scientific i<strong>de</strong>as presented in historical<br />
context… History is important for the effective teaching of sciences (…) because it can lead to social<br />
perspectives — the influence of society on the <strong>de</strong>velopment of science and technology, and the impact<br />
of science and technology on society.”
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 148<br />
Au cours <strong>de</strong>s années 1979 et 1980, la «British Association for Science Education» a également<br />
insisté sur l’importance <strong>de</strong> l’incorporation <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> matière historique (et philosophique)<br />
dans les programmes <strong>de</strong> science (Matthews 1992).<br />
En Gran<strong>de</strong>-Bretagne, le “National Curriculum Council” a recommandé <strong>de</strong> réserver aux sciences<br />
20 % du total du programme prévu pour les élèves âgés entre cinq et seize ans; et, que<br />
<strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 5 % du programme <strong>de</strong> science soit consacré à l’histoire et à la philosophie <strong>de</strong>s<br />
sciences (Matthews 1994).<br />
•<br />
D’une manière générale, on a le sentiment que les scientifiques, <strong>de</strong> quelque formation <strong>de</strong><br />
base qu’ils soient, accor<strong>de</strong>nt une part croissante à l’histoire dans l’enseignement <strong>de</strong> leurs<br />
disciplines respectives.<br />
A en juger par la littérature, les physiciens semblent développer un activisme particulièrement<br />
prononcé dans ce domaine (cf. Sivardière 1994, Bevilacqua & Giannetto 1996, Stuewer 1998).<br />
Il y en a même qui ont avancé l’argument un peu saugrenu que par l’approche historique<br />
<strong>de</strong>s composantes mathématiques d’une loi scientifique on pourrait arriver à augmenter la<br />
proportion <strong>de</strong>s femmes parmi les physiciens professionnels (<strong>de</strong> Berg 1992).<br />
•<br />
Les auteurs s’accor<strong>de</strong>nt également à exiger qu’une part croissante soit accordée à l’histoire<br />
<strong>de</strong>s sciences dans la formation <strong>de</strong>s enseignants (cf. Matthews 1992, 1994, kipnis 1996). Ce<br />
point <strong>de</strong> vue est partagé par un rapport <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong>s Sciences sur l’histoire <strong>de</strong>s sciences<br />
en France paru en 1995 (Académie <strong>de</strong>s Sciences 1995).<br />
Un livre pédagogique belge sorti en 1997 fait la remarque que du point <strong>de</strong> vue épistémologique<br />
c’est “sans doute l’histoire <strong>de</strong>s sciences qui constitue la branche <strong>de</strong> l’épistémologie la plus<br />
souvent convoquée au service <strong>de</strong> la pédagogie et <strong>de</strong> la didactique. (…)<br />
«Elle a connu un net développement <strong>de</strong>puis le début du XXe siècle; ses enseignements rectifient la<br />
conception dogmatique qu’avait fini par imposer la tradition scolaire. (…) Au lieu <strong>de</strong> décrire <strong>de</strong>s<br />
‘processus universels’, il faut donc écrire, <strong>de</strong> manière historique, la suite <strong>de</strong>s événements, <strong>de</strong>s moyens,<br />
<strong>de</strong>s procédés qui ont permis les découvertes.” (Astolfi et al. 1997).<br />
•<br />
Il faut dire que dans la formation <strong>de</strong>s professeurs <strong>de</strong> sciences luxembourgeois, on n’a guère<br />
accordé <strong>de</strong> valeur à <strong>de</strong> telles considérations, et, autant que je sache, la récente réforme du<br />
stage pédagogique n’a rien changé à cette situation.<br />
•<br />
Les programmes <strong>de</strong> l’enseignement secondaire luxembourgeois ne prévoient guère non plus<br />
<strong>de</strong> place pour l’histoire <strong>de</strong>s sciences, nulle part mentionnée “expressis verbis”.<br />
Il faut néanmoins remarquer que <strong>de</strong>puis l’année académique 1995/96 l’histoire <strong>de</strong>s sciences<br />
figure au programme du département <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong>s Cours universitaires luxembourgeois<br />
où j’ai l’honneur <strong>de</strong> l’enseigner. Il s’agit en fait d’un cours à option d’histoire <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine<br />
fréquenté essentiellement par <strong>de</strong>s étudiants en mé<strong>de</strong>cine voulant poursuivre leurs étu<strong>de</strong>s<br />
en France.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 149<br />
De plus, à partir <strong>de</strong> l’année académique 2000/2001, un cours à option “histoire <strong>de</strong>s sciences”<br />
sera offert aux étudiants <strong>de</strong> la nouvelle 2e année <strong>de</strong> la section CB <strong>de</strong>s Cours universitaires.<br />
•<br />
Je ne voudrais cependant pas donner l’impression qu’au niveau du secondaire le souci<br />
historique ait toujours été absent <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong>s sciences. Ce serait faux, car <strong>de</strong><br />
nombreux collègues, ont et ont eu le besoin d’illustrer leur cours <strong>de</strong> l’un ou <strong>de</strong> l’autre aspect<br />
historique.<br />
Au congrès <strong>de</strong> l’Association Française pour l’Avancement <strong>de</strong>s Sciences qui s’est tenu en 1953 à<br />
Luxembourg, Gustave FABER, professeur <strong>de</strong> chimie, puis directeur <strong>de</strong> l’Ecole industrielle et<br />
commerciale <strong>de</strong> Luxembourg (l’actuel LGL), a expliqué que pendant la trentaine d’années qu’il<br />
avait enseigné la chimie dans les classes supérieures <strong>de</strong> lycées, il avait dès le début <strong>de</strong> sa<br />
carrière émaillé ses leçons <strong>de</strong> données historiques (Faber 1953).<br />
C’était, à ses yeux, un moyen simple et sûr pour captiver l’attention <strong>de</strong>s élèves, pour développer<br />
chez eux le culte <strong>de</strong>s grands hommes et <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s choses, pour leur faire comprendre<br />
que le progrès scientifique exige la collaboration <strong>de</strong> toutes les nations et qu’aucune d’elles<br />
n’a un monopole dans le développement d’une science. Il y voyait aussi un moyen efficace<br />
d’assurer l’enchaînement logique <strong>de</strong>s idées.<br />
Cette formulation est à mettre dans le contexte <strong>de</strong> l’époque, mais elle montre néanmoins le<br />
réel avantage pédagogique <strong>de</strong> cette approche.<br />
•<br />
En biologie, un récent mémoire pédagogique rédigé par une jeune professeure stagiaire du<br />
Lycée du Nord a démontré, statistiques à l’appui, que les élèves s’intéressent en forte majorité<br />
aux aspects historiques <strong>de</strong> la matière traitée et qu’ils préfèrent un cours avec <strong>de</strong>s données<br />
historiques à un cours sans références à l’histoire V. <strong>Massard</strong> 1999).<br />
Le mémoire en question a porté sur la biologie en classe <strong>de</strong> 4e et 3e. Il comprend 26 fiches<br />
historiques avec <strong>de</strong>s textes et <strong>de</strong>s illustrations qui permettent <strong>de</strong> suivre la voie par laquelle nos<br />
connaissances actuelles sur l’anatomie et la physiologie humaines ainsi que sur les moyens<br />
<strong>de</strong> lutte contre les infections se sont développés au cours <strong>de</strong>s siècles.<br />
•<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s sciences, cette approche historique élargira la culture générale <strong>de</strong>s élèves à<br />
orientation scientifique et rendra l’enseignement <strong>de</strong>s sciences plus attrayant pour les élèves<br />
<strong>de</strong> sections non scientifiques.<br />
L’histoire <strong>de</strong>s sciences peut très bien servir à mieux comprendre <strong>de</strong>s faits littéraires ou historiques.<br />
Je cite <strong>de</strong>ux exemples; le premier en rapport avec la littérature.<br />
Dans le “Mala<strong>de</strong> imaginaire” <strong>de</strong> MOLIèRE, Thomas Diafoirus déclame avec fierté: “J’ai contre<br />
les circulateurs soutenu une thèse” (Molière, s.d.). Comment comprendre cette déclaration si l’on<br />
ignore l’histoire <strong>de</strong> la découverte <strong>de</strong> la circulation sanguine par William HARVEY en 1628<br />
et l’opposition que cette découverte a provoquée chez les anticirculateurs restés attachés à<br />
la vieille physiologie galénique qui, du 2e au 17e s., a dominé la mé<strong>de</strong>cine européenne?<br />
Dans l’intermè<strong>de</strong> burlesque à la fin du “Mala<strong>de</strong> imaginaire”, un mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à un<br />
étudiant en mé<strong>de</strong>cine ce qu’il faut faire pour traiter un mala<strong>de</strong> déterminé, et l’étudiant <strong>de</strong>
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 150<br />
répondre en latin <strong>de</strong> cuisine:<br />
Clysterium donare,<br />
Postea seignare,<br />
Ensuitta purgare.<br />
Donner un clystère, puis saigner, ensuite purger.<br />
MOLIèRE se moque ici <strong>de</strong> l’arsenal classique <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine d’HIppOCRATE et <strong>de</strong> GALIEN.<br />
Encore faut-il connaître ces mé<strong>de</strong>cins antiques et leur théorie <strong>de</strong>s quatre humeurs pour bien<br />
saisir la scène. C’est là que l’histoire <strong>de</strong>s sciences peut éclairer la littérature.<br />
Rappelons que d’après HIppOCRATE et GALIEN, le corps humain contient quatre liqui<strong>de</strong>s<br />
ou humeurs: le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme, et que leur déséquilibre<br />
provoque la maladie. L’équilibre peut être rétabli en éliminant l’humeur en excès par <strong>de</strong>s<br />
lavements du rectum (c’est le clystère), par la saignée ou l’application <strong>de</strong> sangsues, et enfin,<br />
par l’administration <strong>de</strong> purgatifs (cf. J.A. <strong>Massard</strong> 2000).<br />
Le second exemple que je voudrais citer est en rapport avec l’histoire.<br />
•<br />
Il y a un certain temps, j’ai lu dans le livre <strong>de</strong> classe d’une V e que la découverte <strong>de</strong> l’Amérique<br />
venait d’être traitée en cours d’histoire. Curieux comme je suis, j’ai <strong>de</strong>mandé à mes élèves<br />
pourquoi beaucoup <strong>de</strong> contemporains <strong>de</strong> Christophe COLOMB étaient persuadés que son<br />
projet d’atteindre les In<strong>de</strong>s en traversant l’océan était une utopie.<br />
Les élèves ont spontanément répondu que l’on croyait que la terre était un disque, alors que<br />
Christophe COLOMB prétendait qu’elle était sphérique.<br />
Et puis, l’un d’entre eux s’est aventuré à dire que ceux qui s’opposaient à COLOMB, pensaient<br />
tout simplement qu’il ne pouvait jamais atteindre l’In<strong>de</strong> par l’océan, la distance étant<br />
trop gran<strong>de</strong>.<br />
C’était là, en effet, la bonne réponse (voir: prause 1990).<br />
Car, bien entendu les scientifiques <strong>de</strong> l’époque n’ignoraient pas que la terre était ron<strong>de</strong>,<br />
mais ils étaient d’avis que sa circonférence était nettement plus gran<strong>de</strong> que ne le pensait<br />
Christophe COLOMB et que les calculs <strong>de</strong> celui-ci étaient faux.<br />
Et ils avaient raison!<br />
Si ce continent inconnu qu’on allait appeler l’Amérique, ne s’était pas trouvé sur son chemin,<br />
lui permettant <strong>de</strong> se ravitailler en nourriture et en eau potable, jamais plus personne n’aurait<br />
entendu parler <strong>de</strong> Christophe COLOMB, …… et Gérard DEpARDIEU aurait manqué l’un<br />
<strong>de</strong> ses grands rôles!<br />
L’histoire <strong>de</strong>s sciences nous apprend d’ailleurs que déjà au VIe s. avant notre ère, pYTHA-<br />
GORE, ou mieux les pythagoriciens, avaient déjà suggéré que la terre est sphérique. Au<br />
IVe s. avant notre ère, ARISTOTE a été le premier à fournir <strong>de</strong>s arguments précis en faveur<br />
<strong>de</strong> la sphéricité <strong>de</strong> la Terre. Et puis, vers 250 av. J.C., ERATOSTHèNE a réussi à calculer la<br />
circonférence <strong>de</strong> la Terre qu’il a évaluée à 40.500 km, soit un excès <strong>de</strong> 500 km seulement!
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 151<br />
•<br />
On voit donc bien que l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s sciences peut servir dans <strong>de</strong> nombreux domaines<br />
et constituer un enrichissement intellectuel pour le littéraire tout comme pour le<br />
scientifique.<br />
•<br />
A un moment où une réforme du cycle supérieur <strong>de</strong> l’enseignement secondaire s’annonce, il<br />
faudra tenir compte, à mon avis, <strong>de</strong> cet aspect, et redéfinir les programmes en conséquence.<br />
Cela me paraît particulièrement important pour les programmes <strong>de</strong> sciences dans les sections<br />
littéraires et artistiques.<br />
Et finalement, je voudrais encore recomman<strong>de</strong>r à nos bacheliers d’aujourd’hui, étudiants<br />
en sciences <strong>de</strong> <strong>de</strong>main, <strong>de</strong> profiter <strong>de</strong>s cours d’histoire <strong>de</strong>s sciences ou <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine que<br />
<strong>de</strong> plus en plus d’universités offrent comme option, si ce n’est comme cours obligatoire.<br />
C’est peut être un effort supplémentaire, mais il sera payant sur le plan intellectuel sinon<br />
professionnel.<br />
•<br />
Voilà les quelques réflexions que j’ai voulues vous soumettre aujourd’hui dans le cadre <strong>de</strong><br />
cette remise <strong>de</strong>s diplômes qui pour nombre d’entre nous est une date sans doute non moins<br />
historique que celles qui ont été citées.<br />
Pour terminer, je ne voudrais pas cacher la liste <strong>de</strong>s dates historiques que j’ai retenu, moi,<br />
en tant que biologiste et historien <strong>de</strong>s sciences:<br />
• 1543 — la publication <strong>de</strong> l’ouvrage “De humani corporis fabrica” d’André Vésale, une<br />
véritable révolution pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’anatomie humaine,<br />
• 1628 — la découverte <strong>de</strong> la circulation sanguine par William Harvey; une étape phare<br />
dans le développement <strong>de</strong> la physiologie humaine;<br />
• 1796 — la vaccination contre la variole par Edward Jenner, une étape marquante<br />
dans la lutte <strong>de</strong> l’homme contre les maladies infectieuses;<br />
• 1859 — la publication <strong>de</strong> l’ouvrage “On the origin of species” par Charles Darwin<br />
qui aboutira à une mise en cause profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong> la création et <strong>de</strong> la place <strong>de</strong><br />
l’homme dans l’ensemble <strong>de</strong> la vie organisée;<br />
• 1953 — l’explication <strong>de</strong> la structure <strong>de</strong> la molécule d’ADN par le fameux modèle en<br />
double hélice <strong>de</strong> Watson et Crick ouvrant la voie au génie génétique mo<strong>de</strong>rne et à<br />
l’établissement du génome humain.<br />
(Fin du discours)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 152<br />
Références:<br />
Académie <strong>de</strong>s Sciences (1995): L’histoire <strong>de</strong>s sciences en France. - Paris, Lavoisier, Technique & Documentation,<br />
48 p. (= Académie <strong>de</strong>s Sciences, Rapport n° 35)<br />
Astolfi, P., Darot, E., Y. Ginsburger-Vogel, J. Toussaint (1997): Mots-clés <strong>de</strong> la didactique <strong>de</strong>s sciences : repères,<br />
définitions, bibliographies. - Liège, De Boeck Université, 193 p. (Pratiques pédagogiques).<br />
Berg, K.C. <strong>de</strong> (1992): Mathematics in science: the role of history of science in communicating the significance<br />
of mathematical formalism in science. - Science & Education, 1 (1): 77-87.<br />
Bevilacqua, F. & Giannetto, E. (1996): The history of physics and European physics. - Science & Education,<br />
5 (3): 235-246.<br />
Faber, Gustave (1953): L’histoire <strong>de</strong>s sciences dans l’enseignement secondaire (enseignement <strong>de</strong> la chimie). -<br />
In: Actes du Congrès <strong>de</strong> Luxembourg, 72e session <strong>de</strong> l’Association Française pour l’Avancement <strong>de</strong>s<br />
Sciences. Publs lit. sci. Minist. Educ. nat. G.-D. Luxemb., 3: 627.<br />
Hendrick, R.M. (1992): The role of history in teaching science. A case study. - Science & Education, 1 (2):<br />
145-162.<br />
Hulin, Nicole (1996): Histoire <strong>de</strong>s sciences et enseignement scientifique. Quels rapports? Un bilan XIXe<br />
- XXe siècles. - Bulletin <strong>de</strong> l’Union <strong>de</strong>s Physiciens, 90 (786): 1201-1243.<br />
Kipnis, N. (1996): The “historical-investigative” approach to teaching science. - Science & Education, 5 (3):<br />
277-292.<br />
<strong>Massard</strong>, <strong>Jos</strong>. A. (2000): Histoire <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine. Cours <strong>de</strong> <strong>Jos</strong>. A. <strong>Massard</strong>. - Luxembourg, <strong>Centre</strong> <strong>Universitaire</strong><br />
<strong>de</strong> Luxembourg, Départment <strong>de</strong>s Sciences, 166 p. (polycopié).<br />
<strong>Massard</strong>, Véronique (1999): Biologie et histoire <strong>de</strong>s sciences au niveau <strong>de</strong>s classes <strong>de</strong> 4e et 3e <strong>de</strong> l’enseignement<br />
secondaire: analyse <strong>de</strong>s manuels et discussion. - Wiltz, 91 p. (Mémoire pédagogique)*<br />
Matthews, M.R. (1992): History, philosophy and science teaching : the present rapprochement. - Science &<br />
Education, 1 (1): 11-47.<br />
Matthews, Michael R. (1994): Science Teaching. The Role of History and Philosophy of Science. - New<br />
York, Routledge, 287 p.<br />
Molière (s.d.): Théâtre complet. Vol. II. - Paris, Garnier, 926 p.<br />
Prause, Gerhard (1990): Niemand hat Kolumbus ausgelacht. Fälschungen und Legen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Geschichte<br />
richtiggestellt. 5. Aufl. - Düsseldorf, Econ Verlag, 352 p.<br />
Sivardière, Jean (1994): Enseigner l’histoire <strong>de</strong> la physique en licence: pourquoi, comment? - Bulletin <strong>de</strong><br />
l’Union <strong>de</strong>s Physiciens, 88 (768): 1495-1508.<br />
Stuewer, R.H. (1998): History and physics. - Science & Education, 7 (1) : 13-30.<br />
* ouvrage dont j’ai cité <strong>de</strong> larges extraits dans mon discours.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 153<br />
Aristote: Hist. anim. VI, x<br />
Les sélaciens<br />
Quant à la configuration <strong>de</strong> l’utérus, il faut la considérer sur les Planches anatomiques.<br />
Elle est différente chez les mêmes poissons, comparés les uns aux autres; par<br />
exemple chez les squales comparés entre eux et comparés aux poissons plats, car<br />
chez certains, les œufs sont attachés au milieu <strong>de</strong> l’utérus dans la région du rachis,<br />
comme on l’a dit, par exemple, chez les chiens <strong>de</strong> mer; mais durant leur croissance,<br />
les œufs changent <strong>de</strong> place. Et comme l’utérus est bifurqué et qu’il se rattache au<br />
diaphragme, comme chez les autres animaux <strong>de</strong> ce genre, les œufs vont dans l’une<br />
et l’autre parties Et cet utérus, comme celui <strong>de</strong>s autres squales, en partant un peu<br />
du diaphragme, possè<strong>de</strong> comme <strong>de</strong>s mamelles blanches qui ne se produisent pas<br />
s’il n’y a pas d’embryon.<br />
Les chiens <strong>de</strong> mer et les raies ont <strong>de</strong>s sortes <strong>de</strong> coquilles dans lesquelles il y a une<br />
humidité du type <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> l’œuf. La configuration <strong>de</strong> la coquille ressemble à <strong>de</strong>s<br />
languettes <strong>de</strong> flûtes et <strong>de</strong>s conduits ressemblant à <strong>de</strong>s poils s’attachent aux coquilles.<br />
Chez les chiens <strong>de</strong> mer que certains appellent squales tachetés, lorsque la coquille<br />
s’est ouverte et qu’elle est tombée, les petits en naissent; chez les raies, lorsqu’elles<br />
ont donné naissance aux œufs et que la coquille s’est fendue le petit en sort Le squale<br />
épineux a ses œufs près du diaphragme, au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>s mamelles; et lorsque l’œuf<br />
<strong>de</strong>scend, une fois qu’il en est libéré, le petit naît. La naissance se produit également<br />
<strong>de</strong> la même façon chez les renards <strong>de</strong> mer. Les squales qu’on appelle lisses ont leur<br />
œuf au milieu <strong>de</strong> l’utérus, comme les chiens, et en progressant ils <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nt vers<br />
la partie bifurque et les animaux naissent avec le cordon ombilical relié à l’utérus,<br />
si bien que, lorsque les œufs sont épuisés, l’embryon semble être pareil à celui <strong>de</strong>s<br />
animaux à quatre pieds. Le cordon ombilical, qui est allongé, se rattache à l’utérus<br />
dans sa partie inférieure, chacun se rattachant comme à un cotylédon et à l’embryon,<br />
au milieu, là où est le foie. Si l’on divise celui-ci, l’aliment, même s’il n’y a plus d’œuf,<br />
est du type <strong>de</strong> l’œuf. Un chorion et <strong>de</strong>s membranes particulières enveloppent chacun<br />
<strong>de</strong>s embryons, comme chez les animaux à quatre pieds. Les embryons ont la tête en<br />
haut, lorsqu’ils sont encore jeunes, mais quand ils ont grossi et qu’ils sont achevés, ils<br />
l’ont en bas. Les mâles se forment dans la partie droite et les femelles dans la partie<br />
gauche, et dans le même, il y a ensemble <strong>de</strong>s mâles et <strong>de</strong>s femelles. Les embryons<br />
divisés, <strong>de</strong> la même façon que les animaux à quatre pieds, ont <strong>de</strong> grands viscères<br />
(ceux qu’ils possè<strong>de</strong>nt), par exemple le foie, et <strong>de</strong> type sanguin.<br />
Tous les sélaciens ont, en même temps, <strong>de</strong>s œufs en haut, près du diaphragme, certains<br />
plus grands, d’autres plus petits, en grand nombre, et en bas déjà <strong>de</strong>s embryons. Aussi<br />
beaucoup <strong>de</strong> gens croient-ils que <strong>de</strong> semblables poissons s’accouplent et donnent<br />
naissance à <strong>de</strong>s œufs tous les mois, parce qu’ils ne produisent pas tous leurs petits<br />
à la fois, mais à plusieurs reprises et pendant longtemps. Mais ceux qui sont dans<br />
l’utérus, en bas, sont coctés et s’achèvent en même temps.<br />
Les autres squales laissent leurs petits aller au. <strong>de</strong>hors et rentrer à l’intérieur d’eux-mêmes,<br />
et aussi les anges <strong>de</strong> mer et les torpilles (on a déjà vu une gran<strong>de</strong> torpille qui<br />
avait en elle-même quatre-vingts embryons), seul parmi les squales, l’acanthias ne
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 154<br />
les laisse pas rentrer à cause <strong>de</strong>s épines. Et parmi les poissons plats, la pastenague<br />
et la raie ne les reçoivent pas à cause <strong>de</strong> la rugosité <strong>de</strong> leur queue. La baudroie ne<br />
fait pas non plus rentrer ses petits à l’intérieur en raison <strong>de</strong> la dimension <strong>de</strong> leur tête<br />
et <strong>de</strong> ses épines. C’est donc le seul <strong>de</strong> ces poissons à ne pas donner naissance à <strong>de</strong>s<br />
animaux comme on l’a dit auparavant.<br />
Voilà donc comment se présentent les générations <strong>de</strong>s poissons à partir <strong>de</strong>s œufs et<br />
leurs différences.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 155<br />
Text von Petrus Candidus (15. Jh.):<br />
Matrosentier, Argonauta argo<br />
Nautilus<br />
Der Nautilus, das sogenannte Matrosentier, ragt, wie Plinius schreibt, unter <strong>de</strong>n staunenswerten<br />
Meereswun<strong>de</strong>rn aufs höchste hervor. Es steigt nämlich an die Meeresoberfläche und erleichtert<br />
sich dort, in<strong>de</strong>m es durch ein Röhrchen Wasser, das es verschluckt hat, abläßt: Es erleichtert<br />
sich also von schmutzigem Wasser, um leichter zu segeln. Bald darauf breitet es, in<strong>de</strong>m es<br />
zwei Arme über die Meeresfläche emporhebt, eine zwischen diesen Armen befestigte Haut<br />
von wun<strong>de</strong>rbarer Zartheit aus, die ihm zum Segeln am frühen Morgen dient. Während es mit<br />
<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Armen ru<strong>de</strong>rt, steuert es mittels seines Schwanzes wie mit einem Steuerru<strong>de</strong>r.<br />
Auf diese Weise segelt es über die Wellen, und das nicht ohne die allergrößte Bewun<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>rjenigen, die es dabei beobachten. Sobald es sich aber über irgend etwas erschreckt, taucht<br />
es sogleich in die tiefen Fluten hinab. Augustinus hat geschrieben, daß dieses Tier sich zum<br />
Schutz mit einem Schiffchen umgibt. Wenn es dann dreißig o<strong>de</strong>r vierzig Stadien zurückgelegt<br />
hat, ist es von dieser Anstrengung so erschöpft, daß es die Segel einholt und nicht mehr<br />
weiterschwimmt, son<strong>de</strong>rn auf <strong>de</strong>n tiefsten Meeresgrund zurückkehrt.<br />
(1 Stadium = ± 185 m)
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 156<br />
Text : Urania-Tierreich:<br />
Familie Argonautidae<br />
Die bekannteste Gattung dieser Familie trägt seit Linné <strong>de</strong>n Namen Argonauta und wird in<br />
<strong>de</strong>r Vulgärsprache als Perlboot bezeichnet. Argonauta lebt in mehreren (zweifelhaften) Arten<br />
in <strong>de</strong>n wärmeren Meeresteilen und hier vorwiegend in <strong>de</strong>n oberen Wasserschichten, wur<strong>de</strong><br />
aber auch mehrfach in Tiefseenetzen gefangen. Das Perlboot ist zum aktiven Schwimmen<br />
durchaus befähigt, treibt wohl aber mehr durch das Wasser. Der Geschlechtsdimorphismus<br />
geht bei Argonauta so weit, daß es sinnvoll erscheint, Weibchen und Männchen getrennt<br />
abzuhan<strong>de</strong>ln.<br />
Das Weibchen von Argonauta argo, einer Mittelmeer-Art dieser Gattung, hält sich in einer<br />
zarten, kahnartigen spiraligen Schale auf, die bis zu 20 cm lang wer<strong>de</strong>n kann. Sie ist meist<br />
hauchdünn, manchmal wie Pergament, weshalb die Vertreter <strong>de</strong>r Argonauti<strong>de</strong>n auch <strong>de</strong>n Namen<br />
Papierboot fuhren. Diese äußere Schalenanlage ist eine <strong>de</strong>n Schalen an<strong>de</strong>rer Kopffüßer nicht<br />
vergleichbare Bildung, <strong>de</strong>nn sie wird nicht vom Mantel, son<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Rückenarmen<br />
produziert, die lappenartig verbreitert sind und durch Schalendrüsen die Kalksubstanz abson<strong>de</strong>rn.<br />
Diese membranartigen Lappen umhüllen gewöhnlich die erzeugte Schale, können sich<br />
aber auch davon zurückziehen und sie nach Bedarf wie<strong>de</strong>r neu über<strong>de</strong>cken. In dieser Schale<br />
sitzend, schwimmt das Weibchen relativ langsam. Wie bei Nautilus o<strong>de</strong>r Spirula funktioniert<br />
die Kalkhülle auch als hydrostatischer Apparat, <strong>de</strong>nn man konnte in <strong>de</strong>r Schalenspitze Gas<br />
nachweisen. Von ihrem «Boot» aus greift Argonauta dann nach vorbeischwimmen<strong>de</strong>n Beutetieren<br />
und packt diejenigen, die zufällig an die Arme o<strong>de</strong>r die empfindlichen Armlappen<br />
anstoßen. Zu einer schnellen Bewegung o<strong>de</strong>r gar zu einem Verfolgen <strong>de</strong>r Beute ist Argonauta<br />
mit ihrem Boot nicht fähig. Nur unter ganz ungewöhnlichen Umstän<strong>de</strong>n wird dieses Tier<br />
seine Schale verlassen, es kann nämlich ohne diese Hülle nicht mehr schwimmen, son<strong>de</strong>rn<br />
nur noch am Bo<strong>de</strong>n kriechen. Neben <strong>de</strong>r Schwimmfunktion <strong>de</strong>r Schale darf eine zweite nicht<br />
vergessen wer<strong>de</strong>n. Argonauta betreibt Brutpflege und bewahrt ihre kleinen zahlreichen Eier<br />
bis zum Schlüpfen in ihrer Schale auf.<br />
Der Größenunterschied zwischen Weibchen und Männchen ist bei Argonauta von allen Tintenfischen<br />
am auffallendsten. Während das Weibchen 20 bis 30 cm lang wer<strong>de</strong>n kann, erreicht<br />
das Männchen nur 1 cm. Es ist eigentlich nur noch Geschlechtstier von octopusähnlichem<br />
Habitus, an <strong>de</strong>m sich ein Arm zu einem langen Hectocotylus umbil<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r zunächst in einer<br />
Hauttasche liegt und erst bei <strong>de</strong>r Geschlechtsreife frei wird. Er löst sich zur Begattung vom<br />
Männchen ab und sucht mit <strong>de</strong>r Spermatophore das Weibchen aktiv auf, in<strong>de</strong>m er in <strong>de</strong>ssen<br />
Mantelhöhle eindringt. Der Name Hectocotylus entstand übrigens durch Beobachtungen an<br />
Argonauta. Man fand nämlich in <strong>de</strong>r Mantelhöhle weiblicher Papierboote wurmähnliche<br />
Gebil<strong>de</strong>, die mit Saugnäpfen ausgestattet waren. Man hielt sie für Parasiten und nannte sie<br />
Hectocotylus (hun<strong>de</strong>rt Saugnäpfe); erst viel später erkannte man, daß es die abgelösten Kopfarme<br />
von männlichen Argonauti<strong>de</strong>n waren, die <strong>de</strong>r Begattung dienten. Ob je<strong>de</strong>s Männchen<br />
nur ein einziges Mal zur Begattung kommt o<strong>de</strong>r für ein weiteres Mal erneut einen Hectocotylus<br />
bil<strong>de</strong>n kann, ist heute noch ungewiß. Es kann an<strong>de</strong>rerseits aber vorkommen, daß ein<br />
Weibchen von mehreren Hectocotyli aufgesucht wird, je<strong>de</strong>nfalls fand man schon weibliche<br />
Tiere, bei <strong>de</strong>nen sich mehrere in ihrer Mantelhöhle befan<strong>de</strong>n.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 157<br />
Konrad von Megenberg: Buch <strong>de</strong>r Natur, 1347-1350,<br />
Von <strong>de</strong>m Bären<br />
Ursus heißt ein Bär. Das ist ein sehr grimmiges Tier und unförmig, wenn ihm die Haut abgezogen<br />
ist. Es hat Gliedmaßen fast genauso wie die eines Menschen. Seine Kraft ist vor allem in<br />
<strong>de</strong>n Armen und in <strong>de</strong>n Len<strong>de</strong>n, aber es hat einen schwächlichen Kopf. Ambrosius sagt, die<br />
Bärinnen gebären am dreißigsten Tag nach ihrer Empfängnis ein noch nicht voll entwickeltes<br />
Junges, wenig größer als eine Maus. Plinius sagt, daß die Bärin danach <strong>de</strong>n geborenen Fleischklumpen<br />
leckt und das Geborene so lange bearbeitet, bis daß sie Gliedmaßen erzeugt, <strong>de</strong>nn<br />
wenn die Frucht geboren wird, erscheinen keinerlei Gliedrnaßen daran, außer <strong>de</strong>n Klauen. Die<br />
Bären begatten sich im Liegen wie die Menschen. Solinus sagt, daß die Bären die Bärinnen<br />
heimlich verehren. Es gibt keinen seltsameren Anblick unter tragen<strong>de</strong>n Tieren als eine Bärin,<br />
die gebären will, das heißt, die in <strong>de</strong>n Geburtswehen ist. Die Bärinnen sind stärker und kühner<br />
als die Bären, ebenso sind auch die Leopar<strong>de</strong>nweibchen stärker als die Männchen. Sie wer<strong>de</strong>n<br />
auch schnell zahm und sind schlauer als die Bären. Die Bären fressen Ameisen und Krebse<br />
als Arznei. Das Bärenfleisch wächst, wenn man es kocht; das tut kein an<strong>de</strong>res Fleisch, wie<br />
Plinius sagt. Der Bär ist so sehr verseucht, daß kein Tier das Futter berührt, das er berührt hat,<br />
und was er, wenn er nach <strong>de</strong>r Anstrengung Ruhe hat, anbläst o<strong>de</strong>r ankeucht, das fault. Wenn<br />
man <strong>de</strong>n Bären fängt, dann blen<strong>de</strong>t man ihn auf folgen<strong>de</strong> Weise: Man nimmt ein glühen<strong>de</strong>s<br />
Stück Eisen o<strong>de</strong>r Glockenmetall [Bronze] und hält das vor ihn, dann erblin<strong>de</strong>t er sofort und<br />
kann sich kaum auf <strong>de</strong>n Beinen halten. Der Bär wächst unaufhörlich. Solinus sagt, daß <strong>de</strong>r<br />
Bär auf die Bienenkörbe versessen ist wegen <strong>de</strong>s darin enthaltenen Honigs. Deshalb graben<br />
die Jäger, wenn sie einen Bären fangen wollen, eine Grube und träufeln Honig auf <strong>de</strong>n Weg<br />
zur Grube, damit er <strong>de</strong>m Weg folge und in die Grube falle.
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 158<br />
TABLE <strong>DES</strong> MATIèRES<br />
1. LA pRé<strong>HISTOIRE</strong> ........................................................................................................................................ 3<br />
1.1. L’homme préhistorique et le mon<strong>de</strong> vivant .......................................................................................... 3<br />
1.2. Paléopathologie et ethnomé<strong>de</strong>cine ......................................................................................................... 5<br />
1.2.1. Paléopathologie ...................................................................................................................................... 5<br />
Traumatismes et maladies ................................................................................................................... 5<br />
La paléomé<strong>de</strong>cine ................................................................................................................................. 6<br />
1.2.2. L’ethnomé<strong>de</strong>cine .................................................................................................................................... 8<br />
Les causes <strong>de</strong>s maladies ....................................................................................................................... 8<br />
Le sorcier (Medizinmann, medicine man) ........................................................................................ 8<br />
2. SCIENCE ET MéDECINE DE LA MéSOpOTAMIE ..............................................................................11<br />
Les sources .......................................................................................................................................................11<br />
La divination ................................................................................................................................................... 12<br />
La magie .......................................................................................................................................................... 12<br />
Les sciences ..................................................................................................................................................... 12<br />
Astronomie .......................................................................................................................................... 12<br />
Sciences biologiques et mé<strong>de</strong>cine ..................................................................................................... 13<br />
Mé<strong>de</strong>cine .............................................................................................................................................. 13<br />
3. LA MéDECINE éGYpTIENNE ................................................................................................................ 16<br />
Les sources ...................................................................................................................................................... 16<br />
Organisation <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine ........................................................................................................................ 16<br />
Imhotep — un mé<strong>de</strong>cin divinisé .................................................................................................................. 16<br />
Pathologie et thérapeutique ......................................................................................................................... 17<br />
Documents: Les papyri égyptiens ............................................................................................................... 21<br />
4. L’ANTIQUITé GRECQUE ET ROMAINE ............................................................................................. 22<br />
4.1. LES CONCEpTIONS THéORIQUES SUR LA NATURE DE LA MATIèRE .................................. 22<br />
4.1.1. Les théories <strong>de</strong>s éléments .................................................................................................................... 22<br />
4.1.2. La théorie atomique ............................................................................................................................. 26<br />
4.1.3. Devenir <strong>de</strong>s théories grecques sur la matière .................................................................................. 26<br />
4.2. LA MéDECINE EN GRèCE ANTIQUE .............................................................................................. 28<br />
4.2.1. Des dieux guérisseurs .......................................................................................................................... 28<br />
La mé<strong>de</strong>cine théurgique et le culte d’Asklépios ............................................................................ 30<br />
Le bâton d’Asklépios et le caducée .................................................................................................. 30<br />
4.2.2. Hippocrate, le “père <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine” .............................................................................................. 32<br />
Les principes <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine hippocratique .................................................................................. 33<br />
Le Corpus hippocratique (Corpus hippocraticum) ....................................................................... 33<br />
La nature <strong>de</strong> la maladie et la doctrine <strong>de</strong>s quatre humeurs ......................................................... 34<br />
Le serment d’Hippocrate ................................................................................................................... 39<br />
Quelques aphorismes d’Hippocrate ................................................................................................ 39<br />
Extraits du traité ................................................................................................................................. 40<br />
De la nature <strong>de</strong> l’homme ................................................................................................................... 40<br />
L’anatomo-physiologie hippocratique ............................................................................................. 42
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 159<br />
4.3. Aristote, le «père» <strong>de</strong> la biologie ........................................................................................................... 45<br />
Les successeurs d’Aristote ................................................................................................................. 46<br />
La finalité chez Aristote : A chaque chose, sa fin ............................................................................ 47<br />
L’héritage d’Aristote ........................................................................................................................... 48<br />
L’induction .......................................................................................................................................... 48<br />
4.4. La mé<strong>de</strong>cine à Alexandrie : les premières dissections ....................................................................... 49<br />
Lecture: premières dissections à Alexandrie .................................................................................. 50<br />
Concepts <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine antique ..................................................................................................... 51<br />
4.5. La pathologie solidiste .......................................................................................................................... 51<br />
5. MéDECINE ET <strong>SCIENCES</strong> NATURELLES à L’épOQUE DE L’EMpIRE ROMAIN ...................... 52<br />
5.1. Mé<strong>de</strong>cine et pharmacologie romaines au 1er siècle après J.-C. ........................................................ 52<br />
Celse (Aulus Cornelius Celsus), De medicina. ............................................................................................ 52<br />
Dioscori<strong>de</strong>s (pedanios Dioskuri<strong>de</strong>s), De materia medica ........................................................................... 53<br />
Lecture: Extraits commentés <strong>de</strong> l’ouvrage De medicina <strong>de</strong> Celse ........................................................... 54<br />
5.2. La mé<strong>de</strong>cine et anatomie-physiologie romaines au 2e siècle après J.-C. ....................................... 56<br />
Clau<strong>de</strong> Galien <strong>de</strong> pergame (Claudius Galenus) ........................................................................................ 56<br />
Diagnostic ............................................................................................................................................ 58<br />
Thérapeutique ..................................................................................................................................... 59<br />
Galien et l’anatomie ............................................................................................................................ 60<br />
Galien et la physiologie ..................................................................................................................... 60<br />
Expériences physiologiques .............................................................................................................. 60<br />
Les grands appareils et leurs fonctions ........................................................................................... 60<br />
Points importants ................................................................................................................................ 61<br />
5.3. Rome et l’histoire naturelle .................................................................................................................... 63<br />
Lucrèce (Titus Lucretius Carus) (98-55 av. J.-C.) ............................................................................ 63<br />
pline l’Ancien (23-79 apr. J.-C.) ........................................................................................................ 63<br />
6. LE MOYEN AGE ........................................................................................................................................ 64<br />
6.1. La science <strong>de</strong> l’Orient ............................................................................................................................. 64<br />
6.1.1. Byzance .................................................................................................................................................. 64<br />
6.1.2. L’islam .................................................................................................................................................... 65<br />
6.1. 3. Les Juifs ................................................................................................................................................. 67<br />
6.2. La science <strong>de</strong> L’Occi<strong>de</strong>nt: un évêque, un empereur ........................................................................... 68<br />
Albert le Grand (Albertus Magnus) (vers 1200 - 1280) ............................................................................. 68<br />
Frédéric II <strong>de</strong> Hohenstaufen (1194-1250) .................................................................................................... 68<br />
7. MéDECINE ET <strong>SCIENCES</strong> NATURELLES à L’épOQUE DE LA RENAISSANCE ....................... 70<br />
7.1. L’essor <strong>de</strong> la botanique et <strong>de</strong> la zoologie ............................................................................................. 71<br />
7.2. André Vésale et l’anatomie .................................................................................................................... 73<br />
Lecture: André Vésale ........................................................................................................................ 76<br />
7.3. Ambroise paré et la chirurgie ................................................................................................................ 78<br />
Lecture: Ambroise paré ...................................................................................................................... 80
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 160<br />
7.4. paracelse et la mé<strong>de</strong>cine interne ........................................................................................................... 81<br />
7.5. La syphilis ................................................................................................................................................ 84<br />
Fracastor, the father of ‘syphilis’ ....................................................................................................... 86<br />
8. MéDECINE ET pHYSIOLOGIE EXpéRIMENTALE AU 17e SIèCLE .............................................. 87<br />
8.1. William Harvey (1578-1657)et la découverte <strong>de</strong> la circulation sanguine ....................................... 87<br />
8.1.1. Rappel préliminaire: les idées anciennes .......................................................................................... 87<br />
8.1.2. La découverte <strong>de</strong> la circulation pulmonaire ou petite circulation ................................................ 89<br />
8.1.2.1. Ibn an-Nafis (1211-1288 ou 1296) ......................................................................................... 89<br />
8.1.2.2. Michel Servet (1511?-1553) ................................................................................................... 89<br />
Lecture: Michael Servetus (1511-1553) ............................................................................................. 90<br />
8.1.2.3. Realdo Colombo (1510-1559)................................................................................................ 91<br />
8.1.3. Les travaux <strong>de</strong> William Harvey : circulation pulmonaire et circulation générale ...................... 93<br />
8.1.3.1. Arguments anatomiques et physiologiques ...................................................................... 93<br />
8.1.3.2. Arguments quantitatifs (mathématiques) .......................................................................... 95<br />
8.1.3.3. Etu<strong>de</strong> expérimentale du trajet du sang .............................................................................. 95<br />
8.1.4. Conséquences <strong>de</strong> la théorie circulatoire ................................................................................ 98<br />
Schéma général <strong>de</strong> la circulation ..................................................................................................... 99<br />
Une expérience <strong>de</strong> vivisection .................................................................................................................... 100<br />
Première mesure <strong>de</strong> la pression sanguine ................................................................................................ 101<br />
La saignée ...................................................................................................................................................... 102<br />
La découverte <strong>de</strong>s groupes sanguins par Landsteiner (1901) ............................................................... 103<br />
9. LA THéORIE CELLULAIRE .................................................................................................................. 104<br />
10. LA QUESTION DE LA GéNéRATION SpONTANéE ..................................................................... 108<br />
1. La génération spontanée dans l’Antiquité ........................................................................................... 108<br />
2. La génération spontanée au Moyen Âge .............................................................................................. 108<br />
3. La génération spontanée aux 17e et 18e siècles ................................................................................... 108<br />
4. L’idée <strong>de</strong> la génération spontanée au 19e siècle et les travaux <strong>de</strong> pasteur .......................................110<br />
4.1. L’expérience <strong>de</strong> Pouchet ............................................................................................................110<br />
4.2. Critiques et expériences <strong>de</strong> Pasteur .........................................................................................110<br />
Le triomphe <strong>de</strong> Pasteur ....................................................................................................................113<br />
11. L’<strong>HISTOIRE</strong> <strong>DES</strong> VACCINATIONS .....................................................................................................114<br />
11. 1 Jenner et la première vaccination (1796) ..........................................................................................114<br />
La variolisation ...................................................................................................................................114<br />
La vaccination ....................................................................................................................................115<br />
Le cow-pox et la variole ....................................................................................................................115<br />
La vaccination et la variole au Grand-Duché <strong>de</strong> Luxembourg ...................................................117<br />
11.2. Pasteur et ses travaux sur la vaccination .........................................................................................119<br />
11.2.1. La maladie du charbon ou anthrax (Milzbrand) ..........................................................................119<br />
Symptômes et évolution ...................................................................................................................119<br />
L’agent <strong>de</strong> la maladie ........................................................................................................................119<br />
Culture du germe .............................................................................................................................. 120<br />
La contagion ...................................................................................................................................... 120<br />
11.2.2. La vaccination anticharbonneuse. .................................................................................................. 122<br />
Immunité et réceptivité. .................................................................................................................. 122<br />
Le choléra <strong>de</strong>s Poules ...................................................................................................................... 122<br />
Le vaccin anticharbonneux ............................................................................................................. 122<br />
11.2.3. L’application du traitement pastorien à l’Homme: .................................................................... 125<br />
Vaccination <strong>de</strong>s chiens ..................................................................................................................... 125
Histoire <strong>de</strong>s sciences CUNLUX <strong>Massard</strong> Version 2002 161<br />
Vaccination <strong>de</strong> l’Homme.................................................................................................................. 125<br />
La vaccination contre la rage ........................................................................................................... 125<br />
Le virus fixe ....................................................................................................................................... 125<br />
Lecture: Les premières vaccinations .............................................................................................. 127<br />
12. LES AUTRES pROGRèS DE LA MICRO-BIOLOGIE AU 19e SIèCLE ......................................... 128<br />
12.1. Les travaux <strong>de</strong> Robert koch .............................................................................................................. 128<br />
12.2. Le triomphe du contagionnisme ....................................................................................................... 129<br />
13. DE LA SYSTéMATIQUE à L’IDéE DE L’éVOLUTION ................................................................. 130<br />
13.1. Carl Linné : le père <strong>de</strong> la systématique et <strong>de</strong> la nomenclature binominale ................................ 130<br />
13.2. Georges-Louis Leclerc, comte <strong>de</strong> Buffon (1707-1788), auteur <strong>de</strong> l’Histoire naturelle<br />
et critique <strong>de</strong> Linné ............................................................................................................................ 137<br />
14. OUVRAGES RECOMMANDéS ......................................................................................................... 140<br />
15. ANNEXE : Histoire <strong>de</strong>s sciences, cours <strong>de</strong> <strong>Jos</strong>. A. <strong>Massard</strong>, Documents ...................................... 143<br />
15.1. L’histoire <strong>de</strong>s sciences… à quoi bon? Discours prononcé par <strong>Jos</strong>. A. <strong>Massard</strong> lors <strong>de</strong> la remise<br />
<strong>de</strong>s diplômes <strong>de</strong> fin d’étu<strong>de</strong>s aux élèves du Lycée Classique d’Echternach en juillet 2000 ........................145<br />
15.2. Documents ..............................................................................................................................................................153<br />
15.3. Spécificité, présuppositions et limites <strong>de</strong> la connaissance scientifique<br />
(texte d’une conférence du prof. Edmond Wagner), 23 pages<br />
(document non inclus).<br />
16. TABLE <strong>DES</strong> MATIèRES ....................................................................................................................... 158