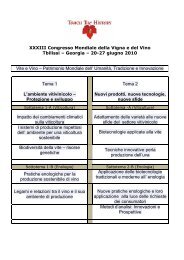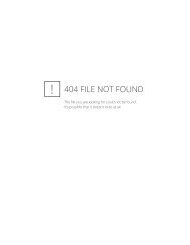le chitosane A. Renou(1) - Oiv2010.ge
le chitosane A. Renou(1) - Oiv2010.ge
le chitosane A. Renou(1) - Oiv2010.ge
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
kombucha, <strong>le</strong> kefyr, la téquila, etc [Greenwalt C.J. et al., 2000 ; Martens H. et al 1997 ;<br />
Morrissey W.F. et al. 2004 ; Silva P. et al. 2004 ; Teoh A.L. et al. 2004 ; Wyder M.T. et al.<br />
1997].<br />
Dans <strong>le</strong> milieu vitico<strong>le</strong>, la détection de ces <strong>le</strong>vures de contamination au vignob<strong>le</strong> est rendue<br />
délicate par <strong>le</strong> fait qu’el<strong>le</strong>s sont, à ce stade, minoritaires. Toutefois la fermentation (processus<br />
de transformation des sucres en alcool) va entraîner une véritab<strong>le</strong> « sé<strong>le</strong>ction » de ces<br />
microorganismes. En effet, <strong>le</strong>s Brettanomyces sont particulièrement résistantes à l’éthanol et<br />
au SO 2 et sont capab<strong>le</strong>s de subsister dans <strong>le</strong> milieu malgré son appauvrissement en sucres. De<br />
plus, certaines techniques ou certains protoco<strong>le</strong>s de vinification peuvent favoriser <strong>le</strong><br />
développement des Brettanomyces dans <strong>le</strong> vin, comme l’é<strong>le</strong>vage sur lies. Pour que <strong>le</strong>s<br />
Brettanomyces puissent se développer, moins de 500 mg/l de sucre suffisent.<br />
L’impact des <strong>le</strong>vures de contamination Brettanomyces a été prouvé par de nombreux auteurs<br />
sur des vins dans différents pays [Di Stefano R. 1985 ; Ciolfi G. 1991 ; Tucknott J. 1977 ;<br />
Heresztyn T. 1986 ; Henschke P. 1996 ; Fridriere I. et al. 1988], des vins mousseux al<strong>le</strong>mands<br />
[Barret et al. 1955] des vins jaunes d’Arbois [Galzy P. et al. 1955] ou des vins du midi de la<br />
France. En 1965, Domercq a rapporté l’iso<strong>le</strong>ment des Brettanomyces dans des moûts des<br />
appellations Saint Emilion et Premières Côtes de Bordeaux et dans des vins rouges ou blancs<br />
en cours de conservation des appellations Médoc, Graves et Saint-Emilion.<br />
Quant aux cépages, <strong>le</strong> pinot semb<strong>le</strong> être <strong>le</strong> plus touché. En Bourgogne, par exemp<strong>le</strong>, pour <strong>le</strong><br />
millésime 2000, 50% des vins en fermentation issus de ce cépage et 25% après embouteillage<br />
avaient été affectés [Gerbaux V. et al. 2000].<br />
En définitive, la maîtrise de cette altération reste diffici<strong>le</strong>, même avec des pratiques<br />
œnologiques réfléchies. Les moyens de lutte sont essentiel<strong>le</strong>ment curatifs, ils permettent<br />
d’agir sur <strong>le</strong>s populations de Brettanomyces (flash pasteurisation, filtration). Toutefois ces<br />
traitements modifient <strong>le</strong>s qualités organo<strong>le</strong>ptiques des vins et ne préservent pas <strong>le</strong>s vins traités<br />
des contaminations ultérieures [Ruiz-Hernandez M . 2003 ; Calderon F. et al. 2004 ; Delfini<br />
C. et al. 2002 ; Puig M. et al. 2003 ; Comitini F. et al. 2004 ; Blateyron L. et al. 2008].<br />
Les propriétés antibactériennes et antifongiques du <strong>chitosane</strong> ont été largement étudiées et<br />
documentées et sont aujourd’hui bien reconnues. Récemment KitoZyme a initié en<br />
collaboration avec l’ICV (Institut Coopératif du Vin), un projet de recherche &<br />
développement dans <strong>le</strong> but de proposer un auxiliaire technologique naturel de type<br />
polysaccharide, <strong>le</strong> <strong>chitosane</strong>, qui puisse répondre aux attentes des professionnels de la filière<br />
pour la prévention du risque Brettanomyces.<br />
MATERIEL & METHODE<br />
1- Le produit de traitement : <strong>le</strong> <strong>chitosane</strong> (Cs)<br />
Le <strong>chitosane</strong> est un polysaccharide linéaire composé de la distribution <strong>le</strong> long de la chaîne<br />
polymère des unités de répétition D-glucosamine (unité désacétylée) et N-acétyl-Dglucosamine<br />
(unité acétylée). Le <strong>chitosane</strong> est obtenu par désacétylation (hydrolyse des<br />
groupement N-acétyl) de la chitine. Il est produit à partir d’une source fongique, non-OGM, <strong>le</strong><br />
mycélium d’Aspergillus niger, un champignon microscopique utilisé pour la production<br />
d’acide citrique à destination des industries alimentaires et pharmaceutiques.<br />
Le <strong>chitosane</strong> se présente sous forme d’une poudre fine insolub<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> vin, de cou<strong>le</strong>ur<br />
blanche à légèrement brune, inodore et sans saveur. La structure chimique du <strong>chitosane</strong> est<br />
illustrée sur la Figure 1.